ICConline - années 2020
- 822 lectures
Structure du Site:
- ICConline [1]
ICConline - 2020
- 583 lectures
ICCOnline - janvier 2020
- 114 lectures
Contre les attaques du gouvernement, lutte massive et unie de tous les exploités! (Tract)
| Fichier attaché | Taille |
|---|---|
| 148.97 Ko |
- 233 lectures
Après des années d’atonie, le mouvement social contre la réforme des retraites montre un réveil de la combativité du prolétariat en France. Malgré toutes ses difficultés, la classe ouvrière a commencé à relever la tête. Alors qu’il y a un an, tout le terrain social était occupé par le mouvement inter-classiste des Gilets jaunes, aujourd’hui, les exploités de tous les secteurs et de toutes les générations ont profité des journées d’action organisées par les syndicats pour descendre dans la rue, déterminés à lutter sur leur propre terrain de classe contre cette attaque frontale et massive du gouvernement qui frappe l’ensemble des exploités.
La classe ouvrière existe et “elle est là” !
Alors que depuis près de dix ans, les salariés demeuraient paralysés, totalement isolés chacun dans leur coin sur leur lieu de travail, ils sont parvenus ces dernières semaines à retrouver le chemin de la lutte collective.
Les aspirations à l’unité et à la solidarité dans la lutte montrent que les travailleurs en France commencent à se reconnaître de nouveau comme faisant partie d’une seule et même classe ayant les mêmes intérêts à défendre. Ainsi, dans plusieurs cortèges, et notamment à Marseille, on a pu entendre : “La classe ouvrière existe !” À Paris, des groupes de manifestants qui ne défilaient pas derrière les banderoles syndicales, chantaient : “On est là, on est là pour l’honneur des travailleurs et pour un monde meilleur”. Dans la manifestation du 9 janvier, même des badauds qui se promenaient sur les trottoirs, en marge du cortège syndical, ont entonné ce vieux chant du mouvement ouvrier : “L’Internationale”, tandis qu’étudiants et lycéens scandaient, derrière leurs propres banderoles : “Les jeunes dans la galère, les vieux dans la misère !”
Il est clair qu’en refusant de continuer à courber l’échine, la classe ouvrière en France est en train de retrouver sa dignité.
Un autre élément, très significatif d’un changement dans la situation sociale, a été l’attitude et l’état d’esprit des “usagers” dans la grève des transports. C’est la première fois, depuis le mouvement de décembre 1995, qu’une grève des transports n’est pas “impopulaire” malgré toutes les campagnes orchestrées par les médias sur la “galère” des “usagers” pour se rendre à leur travail, rentrer chez eux ou partir en vacances lors des fêtes de fin d’année. Nulle part, excepté dans les médias aux ordres, on n’a pu entendre que les cheminots de la SNCF ou de la RATP prenaient les usagers “en otage”. Sur les quais ou dans les trains et RER bondés, on attendait patiemment. Pour se déplacer dans la capitale, on se débrouillait sans râler contre les cheminots en grève ; covoiturages, vélos, trottinettes… Mais, plus encore, le soutien et l’estime envers les cheminots se sont concrétisés par les nombreux dons aux caisses de solidarité pour les grévistes qui ont fait le sacrifice de plus d’un mois de salaire (plus de trois millions d’euros ont été récoltés en quelques semaines !) en luttant non seulement pour eux-mêmes mais aussi pour les autres.
Cependant, après un mois et demi de grève, après des manifestations hebdomadaires rassemblant des centaines de milliers de personnes, ce mouvement n’est pas parvenu à faire reculer le gouvernement.
Depuis le début, la bourgeoisie, son gouvernement et ses “partenaires sociaux” avait orchestré une stratégie pour faire passer l’attaque sur les retraites. La question de l’ “âge pivot” était une carte qu’ils avaient gardée dans leur manche pour saboter la riposte de la classe ouvrière et faire passer la “réforme” grâce à la stratégie classique de division du “front syndical”.
De plus, la bourgeoisie blinde son État policier, au nom du maintien de l’ “ordre républicain”. Le gouvernement déploie, de façon hallucinante, ses forces de répression afin de nous intimider. Les flics ne cessent de gazer et tabasser aveuglément des travailleurs (y compris des femmes et des retraités) appuyés par les médias qui font l’amalgame entre la classe exploitée, les black blocs et autres “casseurs”. Afin d’empêcher les travailleurs de se regrouper à la fin des manifs pour discuter, les cohortes de CRS les dispersent, sur ordre de la Préfecture, à coups de grenades de “désencerclement”. Les violences policières ne sont nullement le fruit de simples “bavures” individuelles de quelques CRS excités et incontrôlables. Elles annoncent la répression impitoyable et féroce que la classe dominante n’hésitera pas à déchaîner contre les prolétaires, dans le futur (comme elle l’a fait dans le passé, par exemple, lors la “semaine sanglante” de la Commune de Paris en 1871).
Comment faire reculer le gouvernement ?
Pour pouvoir s’affronter à la classe dominante et faire reculer le gouvernement, les travailleurs doivent prendre eux-mêmes leur lutte en main. Ils ne doivent pas la confier aux syndicats, à ces “partenaires sociaux” qui ont toujours négocié dans leur dos et dans le secret des cabinets ministériels.
Si nous continuons à demander aux syndicats de nous “représenter”, si nous continuons à attendre qu’ils organisent la lutte à notre place, alors oui, nous sommes “foutus” !
Pour pouvoir prendre notre lutte en main, pour l’élargir et l’unifier, il faut organiser nous-mêmes des assemblées générales massives, souveraines, et ouvertes à toute la classe ouvrière. C’est dans ces AG que nous pouvons discuter tous ensemble, décider collectivement des actions à mener, former des comités de grève avec des délégués élus et révocables à tout moment.
Les jeunes travailleurs qui ont participé au mouvement contre le “Contrat Première Embauche” au printemps 2006, lorsqu’ils étaient encore étudiants ou lycéens, doivent se souvenir et transmettre cette expérience à leurs camarades de travail, les plus jeunes ou les plus vieux. Comment ont-ils pu faire reculer le gouvernement Villepin en l’obligeant à retirer son “CPE” ? Grâce à leur capacité à organiser eux-mêmes leur lutte dans leurs assemblées générales massives dans toutes les universités, et sans aucun syndicat. Ces AG n’étaient pas verrouillées. Au contraire : les étudiants avaient appelé tous les travailleurs, actifs et retraités, à venir discuter avec eux dans leurs AG et à participer au mouvement en solidarité avec les jeunes générations confrontées au chômage et à la précarité. Le gouvernement Villepin a dû retirer le CPE sans qu’il y ait aucune “négociation”. Les étudiants, jeunes travailleurs précaires et futurs chômeurs n’étaient pas représentés par des “partenaires sociaux” et ils ont gagné.
Même si nous perdons une bataille, nous n’avons pas perdu la guerre !
Les cheminots qui ont été le fer de lance de cette mobilisation, ne peuvent pas poursuivre leur grève seuls sans que les autres secteurs n’engagent eux-mêmes la lutte avec eux. Malgré leur courage et leur détermination, ils ne peuvent pas lutter “à la place” de toute la classe ouvrière. Ce n’est pas la “grève par procuration” qui peut faire reculer le gouvernement, aussi déterminée soit-elle.
Aujourd’hui, la classe ouvrière n’est pas encore prête à s’engager massivement dans la lutte. Même si de nombreux travailleurs de tous les secteurs, de toutes les catégories professionnelles (essentiellement de la fonction publique), de toutes les générations étaient présents à battre le pavé dans les manifestations organisées par les syndicats depuis le 5 décembre. Ce dont nous avons besoin pour freiner les attaques de la bourgeoisie, c’est de développer la solidarité active dans la lutte et pas seulement en remplissant les caisses de solidarité pour permettre aux grévistes de “tenir”.
La reprise du travail qui a déjà commencé dans le secteur des transports (notamment à la SNCF) n’est pas une capitulation ! Faire une “pause” dans la lutte est aussi un moyen de ne pas s’épuiser dans une grève longue et isolée, qui ne peut déboucher que sur un sentiment d’impuissance et d’amertume.
La grande majorité des travailleurs mobilisés ont le sentiment que si on perd cette bataille, si on ne parvient pas à obliger le gouvernement à retirer sa réforme, nous sommes “foutus”. Ce n’est pas vrai ! La mobilisation actuelle,et le rejet massif de cette attaque ne sont qu’un début, une première bataille qui en annonce d’autres demain. Car la bourgeoisie, son gouvernement et son patronat vont continuer à nous exploiter, à attaquer notre pouvoir d’achat, à nous plonger dans une pauvreté et une misère croissantes. La colère ne peut que s’amplifier jusqu’à déboucher sur de nouvelles explosions, de nouveaux mouvements de lutte.
Même si la classe ouvrière perd cette première bataille, elle n’a pas perdu la guerre. Elle ne doit pas céder à la démoralisation !
La “guerre de classe” est faite d’avancées et de reculs, de moments de mobilisation et de pause pour pouvoir repartir de nouveau encore plus fort. Ce n’est jamais un combat en “ligne droite” où on gagne immédiatement du premier coup. Toute l’histoire du mouvement ouvrier a démontré que la lutte de la classe exploitée contre la bourgeoisie ne peut aboutir à la victoire qu’à la suite de toute une série de défaites.
Le seul moyen de renforcer la lutte, c’est de profiter des périodes de repli en bon ordre pour réfléchir et discuter ensemble, en se regroupant partout, sur nos lieux de travail, dans nos quartiers et tous les lieux publics.
Les travailleurs les plus combatifs et déterminés, qu’ils soient actifs ou chômeurs, retraités ou étudiants, doivent essayer de former des “comités de lutte” interprofessionnels ouverts à toutes les générations pour préparer les luttes futures. Il faudra tirer les leçons de ce mouvement, comprendre quelles ont été ses difficultés pour pouvoir les surmonter dans les prochains combats.
Ce mouvement social, malgré toutes ses limites, ses faiblesses et difficultés, est déjà une première victoire. Après des années de paralysie, de désarroi et d’atomisation, il a permis à des centaines de milliers de travailleurs de sortir dans la rue pour exprimer leur volonté de lutter contre les attaques du Capital. Cette mobilisation leur a permis d’exprimer leur besoin de solidarité et d’unité. Elle leur a permis aussi de faire l’expérience des manœuvres de la bourgeoisie pour faire passer cette attaque.
Ce n’est que par la lutte et dans la lutte que le prolétariat pourra prendre conscience qu’il est la seule force de la société capable d’abolir l’exploitation capitaliste pour construire un monde nouveau. Le chemin qui mène à la révolution prolétarienne mondiale, au renversement du capitalisme, sera long et difficile. Il sera parsemé d’embûches et de défaites, mais il n’y en a pas d’autre.
Plus que jamais, l’avenir appartient à la classe ouvrière !
Courant Communiste International, 13 janvier 2020
Situations territoriales:
Rubrique:
Le mouvement contre la réforme des retraites n’est qu’un premier pas pour retrouver le chemin des luttes massives
- 268 lectures
Depuis début décembre, venant de tous les secteurs et issus de toutes les générations, des centaines de milliers de manifestants descendent dans la rue contre la “réforme” des retraites. Dans les cortèges, la colère et la combativité sont évidentes. Depuis les luttes de 2003 et 2010 contre les précédentes “réformes” des retraites, nous n’avions pas vu en France un tel enthousiasme d’être aussi nombreux à se mobiliser tous ensemble contre cette attaque qui touche toute la classe des exploités : salariés du public et du privé, actifs et retraités, chômeurs, travailleurs précaires, étudiants. La solidarité dans la lutte se manifeste par une volonté de se battre non seulement pour nous-mêmes mais aussi pour les autres secteurs et pour les générations futures.
Néanmoins, ce mouvement connaît aussi d’importantes limites et difficultés en particulier dans la prise en main et l’organisation de la lutte par les prolétaires eux-mêmes. Il n’y a que très peu, ou pas, de réelles assemblées générales dans lesquelles les travailleurs peuvent débattre, prendre ensemble les décisions et la conduite de leur lutte. Contrairement, par exemple, à Mai 68.
Quelles leçons tirer du mouvement en cours ? Quelles sont ses forces et ses faiblesses ? Comment préparer au mieux les luttes futures ? Quel rôle jouent réellement les syndicats et les partis de “gauche” ? Ce sont de toutes ces questions, et bien d’autres encore, que nous proposons de discuter lors des réunions publiques à :
– Paris [4], le samedi 18 janvier 2020 à 15:00.
– Marseille [5], le samedi 18 janvier 2020 à 15:00.
– Toulouse [6], le samedi 18 janvier 2020 à 15:00.
– Lille [7], le samedi 8 février 2020 à 15:00.
– Nantes [8], le samedi 8 février 2020 à 15:00.
– Lyon [9], le samedi 8 février 2020 à 15:00.
Rubrique:
Vox (Espagne): Une “voix” clairement capitaliste
- 104 lectures
Sur les réseaux sociaux, dans les partis de gauche et d’extrême-gauche, dans les médias, on cherche à nous effrayer en criant au loup fasciste ! Il est évident que le fascisme est l’une des expressions les plus brutales de la barbarie capitaliste, (1) il est clair également que Vox est un parti répugnant, qui affiche une attitude provocatrice et agressive, qui alimente la xénophobie contre les immigrés et défend le nationalisme espagnol le plus rance.
Vox représente-t-il une menace plus grande que les autres partis ?
Cependant, ce serait tomber dans un piège très dangereux pour le prolétariat que de céder à la propagande qui présente Vox comme le Mal Absolu face à ses rivaux bourgeois de gauche (PSOE et Podemos) ou de droite (PP, Ciudadanos) qui représenteraient un moindre mal auquel il faudrait s’agripper coûte que coûte. L’histoire nous a montré que le piège qui consiste à choisir dans le menu empoisonné des fractions capitalistes a provoqué de terribles bains de sang : la boucherie de la Seconde Guerre mondiale (choisir entre le camp nazi et le camp démocratique), la Guerre d’Espagne de 1936 (choisir entre Franco et la République) ou le coup d’État de Pinochet (choisir entre l’ “Unité Populaire” d’Allende et les militaires).
Le prolétariat doit combattre le capitalisme et son État comme un tout et non de deux maux choisir le soi-disant moindre. Sous la domination du capitalisme, le prolétariat a seulement de faux amis et des ennemis déclarés. Entre les partis capitalistes, il n’y a pas de “meilleurs” ou de “pires” : tous représentent la pire alternative. Comme le disait Blanqui, un révolutionnaire du XIXe siècle, “pour les prolétaires qui se laissent amuser par des promenades ridicules dans les rues, par des plantations d’arbres de Liberté, par des phrases sonores d’avocat, il y aura de l’eau bénite d’abord, des injures ensuite, enfin, de la mitraille, de la misère toujours”.
La défense du capitalisme va de l’extrême-droite à l’extrême-gauche
Dans l’appareil politique du Capital il y a toute une mosaïque qui va de l’extrême-droite à l’extrême-gauche, passant par tous types de nationalismes, régionalismes jusqu’à des candidatures citoyennes du style Teruel Existe, un parti défendant les “intérêts” de la province de Teruel en Aragon (dans l’actuelle législature parlementaire espagnole, il y a 19 groupes différents !). Il y a entre eux des divergences, des nuances et surtout des intérêts opposés de fraction, de clique ou purement régionalistes ou localistes. Cependant, au-delà de leurs conflits d’intérêts et des querelles interminables auxquelles ils se livrent, ils sont tous unis pour :
– la défense du capital comme mode de production basé sur l’exploitation du prolétariat ;
– la défense de la nation (que celle-ci soit espagnole ou catalane) ;
– la défense de l’État ;
– la volonté de contrôler, diviser et écraser le prolétariat.
Ceci constitue une réalité qui s’applique à tous les pays du monde et qui, pour se limiter au cas de l’Espagne, peut se vérifier si nous analysons l’histoire de la Seconde République (1931-39) et de la restauration de la démocratie (depuis 1975).
Sous la Seconde République
Le premier gouvernement de la Seconde République (produit de la coalition entre républicains et socialistes de 1931 à 1933) assassina 1500 ouvriers lors de la brutale répression des grèves et des protestations des ouvriers agricoles. Il faut particulièrement souligner le massacre de Casas Viejas durant lequel le démocrate Azaña donna l’ordre de “tirer au ventre !”
Le gouvernement suivant, présidé par la droite (la CEDA), massacra l’insurrection ouvrière des Asturies (1934) qui fut suivie par l’emprisonnement de dizaines de milliers d’ouvriers et les tortures les plus sadiques. La répression se fit avec la collaboration de Esquerra Republicana de Cataluña (ERC ou Gauche républicaine de Catalogne, au pouvoir en Catalogne avec le parti indépendantiste de Puigdemont) et son corps d’Escamots qui se chargeaient de torturer les ouvriers combatifs, particulièrement les membres de la CNT.
En 1937, le parti “communiste” fut le principal artisan de la répression sauvage de l’insurrection ouvrière de Barcelone, avec, à nouveau, sa montagne de cadavres et son cortège de tortures et d’emprisonnements. (2)
Franco, avec son régime de terreur (1939-1975), acheva la besogne commencée par ses acolytes de gauche et de droite.
Sous la démocratie (depuis 1975)
Le baptême du feu fut la répression de la grève de Vitoria (mars 1976, cinq morts). (3) L’UCD (1977-1981) imposa avec l’accord de tous les partis (depuis la droite de Alianza Popular jusqu’à la gauche du PCE), le Pacte de la Moncloa qui marqua les premiers pas dans la chute des conditions de vie des travailleurs. Le gouvernement du PSOE (1982-1996) détruisit un million d’emplois et entacha ses mains du sang des trois ouvriers tués pendant la répression des grèves (Gijón, Bilbao et Reinosa). Le gouvernement du PP (1996-2004) entreprit des attaques de grande envergure qui ont généralisé la précarité et ont rendu impossible l’accès au logement. Le gouvernement du PSOE (2004-2011) ouvrit la voie à des coupes brutales dans les prestations sociales, la santé, etc., que généralisera ensuite le gouvernement du PP (2011-2018) avec la complicité du gouvernement régional d’Artur Mas qui fera des travailleurs catalans, les cobayes d’un plan de coupes budgétaires qui s’étendra à toute l’Espagne.
Vox n’a pas eu l’occasion d’exercer le pouvoir (à peine a-t-il fait quelques timides premiers pas dans des coalitions pour des gouvernements autonomes) mais dans la pratique comme sur le fond, il coïncide pleinement avec ses rivaux du duo PP-PSOE. Vox est un autre ennemi des travailleurs
Avec l’avancée de la décomposition, le monstre franquiste ressort du chapeau du PP
Pour comprendre pourquoi surgit Vox, nous devons partir de deux faits. Le premier, de nature espagnole, réside dans la dénommée “transition démocratique” des années 1970. Le second est lié à ce que nous appelons : la phase de décomposition capitaliste, de dimension mondiale et historique.
Un des accords les plus importants de la transition espagnole fut celui de charger l’ancien ministre de Franco, Manuel Fraga, et son parti, d’abord appelé Alianza Popular et rebaptisé ensuite Partido Popular, d’intégrer en son sein l’important secteur franquiste de la bourgeoisie. Ce dispositif fit du PP “le grand parti de la droite” qui englobait des tendances politiques allant de l’extrême-droite jusqu’aux factions libérales, voire avec certaines ayant des accents sociaux-démocrates. Avec cet assemblage, ils purent neutraliser durant quatre décennies des secteurs issus de l’ancien régime qui étaient devenus inadaptés pour affronter les nouvelles nécessités du capital espagnol, particulièrement face à la classe ouvrière qui, d’abord avec les grandes grèves des Asturies en 1962, puis avec les luttes importantes de la période 1971-1976 s’inscrivaient pleinement dans la réémergence générale du prolétariat mondial débutée avec Mai 68.
Cependant, le processus de décomposition capitaliste, un phénomène mondial que nous avons identifié, vint bouleverser ce dispositif bien huilé. Dans les “Thèses sur la décomposition [10]” (Thèse 9), nous signalions : “Parmi les caractéristiques majeures de la décomposition de la société capitaliste, il faut souligner la difficulté croissante de la bourgeoisie à contrôler l’évolution de la situation sur le plan politique. À la base de ce phénomène, on trouve évidemment la perte de contrôle toujours plus grande de la classe dominante sur son appareil économique, lequel constitue l’infrastructure de la société. L’impasse historique dans laquelle se trouve enfermé le mode de production capitaliste, les échecs successifs des différentes politiques menées par la bourgeoisie, la fuite en avant permanente dans l’endettement généralisé au moyen de laquelle se survit l’économie mondiale, tous ces éléments ne peuvent que se répercuter sur un appareil politique incapable, pour sa part, d’imposer à la société, et particulièrement à la classe ouvrière, la “discipline” et l’adhésion requises pour mobiliser toutes les forces et les énergies vers la guerre mondiale, seule “réponse” historique que la bourgeoisie puisse offrir. L’absence d’une perspective (exceptée celle de “sauver les meubles” de son économie au jour le jour) vers laquelle elle puisse se mobiliser comme classe, et alors que le prolétariat ne constitue pas encore une menace pour sa survie, détermine au sein de la classe dominante, et particulièrement de son appareil politique, une tendance croissante à l’indiscipline et au sauve-qui-peut”.
Cette tendance à l’indiscipline des différents secteurs de la bourgeoisie qui ne veulent pas être “les premiers à se sacrifier”, ni ne souhaitent être les derniers à “partager la part de gâteau” du pouvoir, et mettent en avant toutes sortes d’intérêts particuliers, localistes, régionaux, etc., amenant le secteur franquiste, qui durant des années était resté silencieux, à sortir à nouveau du bois.
Vox, porte-parole de l’ultra-nationalisme espagnol et de la décomposition idéologique du capitalisme
Fondé en 2013, Vox fut durant les premières années un parti d’appoint. Cependant, le contentieux catalan lui a donné une forte impulsion. Le défi irrationnel et suicidaire de la fraction indépendantiste catalane a donné des ailes au nationalisme espagnol le plus extrémiste. Pour des raisons historiques, le capitalisme espagnol n’a jamais pu s’appuyer sur un nationalisme “démocratique”, capable d’unir toutes ses fractions et particulièrement les partis régionalistes. Au contraire, “la nation espagnole dût s’affirmer, depuis le XVIe siècle, à partir de la prédominance brutale de la féodalité avec ses prétentions impériales, son extrémisme catholique et sa pureté de sang, acquise à travers les expulsions massives de Maures et de Juifs ainsi que le sadisme de la “Sainte Inquisition”. Au XIXe siècle, durant l’apogée du capitalisme, le capital espagnol fut soumis à une succession interminable de convulsions (la perte des colonies, les guerres carlistes, l’instabilité gouvernementale chronique) qui l’obligèrent à s’affirmer comme Nation, pieds et poings liés à ses secteurs les plus réactionnaires. Le développement déséquilibré de l’industrie (principalement en Catalogne) et la mauvaise soudure du marché national, donna un pouvoir disproportionné aux militaires castillans qui, avec leurs violentes actions contre les luttes ouvrières, assuraient aux bourgeois catalans la “loi et l’ordre” et maintenaient d’une main de fer la cohésion nationale. Le résultat fut un nationalisme arrogant, excluant, répugnant pour les classes “populaires” et qui connut son apogée avec le régime franquiste. La transition démocratique de 1975 fut obligée de mettre de côté toute référence au nationalisme espagnol, cédant du terrain aux “Autonomies” et aux illusions d’une “Espagne pour tous”, chose que l’expérience de ces quarante dernières années a radicalement démentie. Désormais, face au défi de ses rivaux catalanistes, le capital espagnol se trouve privé d’un nationalisme “présentable” et doit recourir à “l’espagnolisme”, le nationalisme espagnol de toujours qui donne des ailes à un parti comme Vox”. (4)
Mais Vox possède une seconde composante, non moins importante que la première et qui le rapproche des partis populistes qui prolifèrent aujourd’hui dans les pays centraux (avec les Trump, Salvini, Le Pen ou Orban). Son fond de commerce émane également de la décomposition et spécifiquement de la décomposition idéologique du capitalisme.
La thèse 8 des “Thèses sur la décomposition” mentionnées précédemment, rappelle que les “manifestations de la putréfaction sociale qui aujourd’hui, à une échelle inconnue dans l’histoire, envahissent tous les pores de la société humaine, ne savent exprimer qu’une chose : non seulement la dislocation de la société bourgeoise, mais encore l’anéantissement de tout principe de vie collective au sein d’une société qui se trouve privée du moindre projet, de la moindre perspective, même à court terme, même la plus illusoire”. Cela provoque des tendances destructrices : “l’accroissement permanent de la criminalité, de l’insécurité, de la violence urbaine (…), le développement du nihilisme, du suicide des jeunes, du désespoir (…), de la haine et de la xénophobie (…) ; La profusion des sectes, le regain de l’esprit religieux, y compris dans certains pays avancés, le rejet d’une pensée rationnelle, cohérente, construite, du spectacle de la violence, de l’horreur, du sang, des massacres qui prend dans les médias une place prépondérante (…) ; le “chacun pour soi”, la marginalisation, l’atomisation des individus, la destruction des rapports familiaux, l’exclusion des personnes âgées, l’anéantissement de l’affectivité et son remplacement par la pornographie, le sport commercialisé et médiatisé”.
De ces matériaux pourris, Vox fait surgir ses mantras. Parmi ces derniers, il y a la nostalgie irrationnelle d’un “passé glorieux” qui, en réalité, n’a jamais existé ; comme le disait un présentateur de journal télévisé [11] : “La nostalgie franquiste de Vox n’éloigne pas pour autant ce parti du radicalisme anti-européen britannique : les deux mouvements expriment la nostalgie d’un paysage humain sans immigrés, uniforme (et hiérarchisé). Le regret d’un temps passé durant lequel leurs pays respectifs régnaient de manière effective (pour l’empire britannique) ou fantasmée (“l’unité de destin dans l’universel” de l’Espagne franquiste)”.
Si cette obstination peut sembler ridicule, il y a d’autres “thèmes” sinistres qui sèment la division dans les rangs ouvriers. L’un d’entre eux est la haine de Vox envers les immigrés, qu’il rend responsables de la pauvreté, des services de santé désastreux, du chômage, faisant d’eux des boucs émissaires que l’on accuse de tous les maux imaginables. Dans la même veine, se trouve son négationnisme réactionnaire du machisme envers les femmes, du désastre climatique, etc.
Les conséquences de l’irruption de Vox sur l’échiquier politique
Dans un premier temps, le PSOE a gonflé Vox avec deux objectifs : d’un côté, diviser le vote de droite et, de l’autre, susciter un vote aveugle pour le “moindre mal” afin de “barrer la route au fascisme”. Cette ruse lui a plutôt souri lors des élections d’avril. Pour celles de novembre, il a voulu user du même stratagème, ce qui déboucha sur la mascarade du transfert des restes de Franco afin de mendier à nouveau des voix à gauche et d’alimenter autant que possible la “peur de Vox”.
Mais, cette fois-ci, la manœuvre n’a pas fonctionné. Les violents incidents de Barcelone, fomentés en coulisses par des fractions tant catalanistes qu’espagnolistes, ont propulsé Vox de façon spectaculaire sur le devant de la scène politique. D’un autre côté, les deux partis de la droite “civilisée”, le PP et Ciudadanos, ont payé cher leur stratégie de battre Vox dans la surenchère à l’espagnolisme et à la “loi et l’ordre”. Le résultat a été le naufrage de Ciudadanos.
Globalement, les deux partis fondamentaux de l’État espagnol (PP et PSOE) en sont sortis très affaiblis. Le PSOE a perdu des électeurs par rapport à avril et les gains du PP ont été faibles. La présence importante de Vox, que tous se sont chargés d’alimenter, a profondément altéré le jeu politique, le rendant très difficile à gérer. Le PP ne peut pas cautionner le PSOE en le rejoignant dans un gouvernement de “grande coalition” ou simplement s’abstenir comme le fit le PSOE en octobre 2016. Cela risquerait de renforcer encore plus Vox. Et le PSOE a besoin de “regarder à gauche” s’il ne veut pas ruiner une des armes idéologiques les plus importantes de la bourgeoisie espagnole contre la classe ouvrière : l’antifascisme.
Aussi bien l’ascension de Vox que l’irresponsabilité et les contradictions des “grands partis”, mettent clairement en évidence ce que nous disions au début de l’article : la perte de contrôle croissante de la part de la bourgeoisie de son jeu politique et particulièrement de son mécanisme électoral avec lequel elle dissimule sous les traits de la “volonté populaire” ses options politiques de gouvernement. Vox représente un facteur d’aggravation de cette crise, pas tant par l’ “intelligence tactique” de ses “leaders politiques”, mais essentiellement du fait de la déstabilisation et des contradictions croissantes de l’appareil politique dans les pays centraux.
Aucun camp à défendre dans la barbarie capitaliste, mais défendre l’autonomie de classe du prolétariat
Comme nous l’avons vu plus haut, la bourgeoisie a infligé au prolétariat les pires défaites et a entraîné l’humanité dans la guerre impérialiste, la faisant choisir entre fractions de la bourgeoisie, le fascisme ou l’antifascisme, la démocratie ou la dictature, etc. À travers cela, le prolétariat a perdu son identité de classe et son autonomie politique, se convertissant en chair à canon pour les intérêts du Capital, de ses plans de misères, de chômage et de guerre.
Guidé par cette expérience historique, le prolétariat doit rejeter les deux pôles qui, à travers une apparente opposition, renforcent et consolident la domination capitaliste :
– l’antifascisme de la gauche face au fascisme de Vox et la connivence du duo PP/Ciudadanos ;
– les politiques “civilisées et démocratiques” des PP, PSOE, Podemos, face à l’autoritarisme arrogant de Vox ;
– le paternalisme cynique et hypocrite du PSOE et de Podemos avec les immigrés, face à la xénophobie et le racisme de Vox ;
– la supposée “politique sociale” et le féminisme du couple PSOE/Podemos face au machisme et au traditionalisme aberrant de Vox ;
– l’étatisme et l’augmentation des impôts “pour les riches” du couple PSOE-Podemos face aux mesures “libérales” de réduction des impôts du trio de la droite (Vox, PP et Ciudadanos).
Face à ces élections qui le livrent pieds et poings liés à l’enfoncement inéluctable du capitalisme dans la misère, la destruction, la guerre et la barbarie, le prolétariat doit défendre :
– autochtone ou immigrée : une même classe ouvrière ;
– la réponse massive, unie et auto-organisée contre les mesures de licenciements, les baisses de salaires, la précarité, etc., que tous les gouvernements pratiquent ;
– la perspective de son unité internationale et la lutte pour une société sans exploitation, sans frontières, sans États, sans divisions en classes, la communauté humaine mondiale, le communisme.
S, 16 décembre 2019
1Voir : “Les Causes économiques, sociales et politiques du fascisme [12]”.
2Voir notre article en espagnol : “Franco y la República masacran al proletariado [13]”.
3Voir : “Il y a 40 ans, la démocratie espagnole naissante débutait avec des assassinats d’ouvriers à Vitoria [14]”.
4Voir notre article en espagnol : “Contra la campaña de Vox en medios obreros : ¡Los obreros no tenemos patria ! [15]”
Géographique:
- Espagne [16]
Rubrique:
Grève chez General Motors: les syndicats divisent les travailleurs et les montent les uns contre les autres
- 81 lectures
Le capitalisme a de plus en plus de mal à gérer sa propre crise économique et cela se répercute dans tous les secteurs de l’économie mondiale : l’endettement s’accroît, le travail précaire est de plus en plus massif, les délocalisations d’usines vers des pays avec des coûts de production moindre augmentent, etc. En outre, la crise oblige la bourgeoisie à prendre de nouvelles mesures pour restructurer la production, mesures dont les ouvriers sont systématiquement les principales victimes.
La restructuration et la grève de General Motors (GM) ne peuvent à ce titre être comprises que dans le cadre de l’analyse de la crise mondiale et historique du capitalisme. Le 15 septembre 2019, après deux mois de négociations infructueuses entre l’entreprise automobile et les syndicats, 850 ouvriers de la zone de maintenance de cinq usines de GM aux États-Unis se mirent spontanément en grève. Le jour suivant, face à cette situation qui menaçait de devenir incontrôlable et à la pression émanant du reste de ses adhérents, le syndicat United Auto Workers (UAW) déclara la grève de près de 50 000 ouvriers. Bien que GM n’ait pas connu de grève aussi massive depuis 2007, les attaques contre les conditions de vie et de travail des ouvriers de cette entreprise ne sont pas sorties de nulle part et elles ont également eu lieu dans d’autres pays.
Auparavant, GM avait dû fermer une usine de moteurs au Mexique, une autre d’assemblage au Canada et autre dans l’Ohio. Dans ces deux dernières, fin septembre 2018, respectivement 3 200 et 500 ouvriers furent “temporairement” licenciés (ce que les patrons appellent “mise au chômage technique”) et en octobre, la société proposa à quelque 18 000 travailleurs des départs volontaires. En outre, le 26 novembre 2018, GM annonça un plan de “grande restructuration”, comprenant notamment le licenciement de 14 000 ouvriers, la fermeture de trois usines aux États-Unis en 2019, à Oshawa au Canada, et celle de Gunsan en Corée du Sud d’ici fin 2019-début 2020, entraînant le licenciement de plus de 6 000 ouvriers.
Les revendications des ouvriers du GM se situaient clairement sur le terrain de la classe ouvrière : la sécurité de l’emploi, empêcher la baisse des salaires, l’amélioration de la couverture médicale et des primes. Il est important de noter l’existence de revendications qui démontrent la solidarité et l’esprit d’unité des ouvriers : ils ont exigé des contrats fixes pour les intérimaires, la réouverture des usines inactives et le refus de nouvelles fermetures d’usines avec la perte d’emplois qui en résulte. Toutefois, le syndicat ne s’est pas focalisé sur la défense de ces revendications.
Le syndicat sabote la lutte des travailleurs
Selon les médias, le gouvernement et le patronat, les défenseurs des intérêts des travailleurs sont les syndicats. Pourtant, les ouvriers eux-mêmes, de par leur expérience quotidienne, ont compris que la réalité est différente. Cela s’est vérifié une fois de plus lors de la grève chez GM. Cette réalité est présente depuis déjà plus d’un siècle : “Le syndicalisme est apparu au XIXe siècle. Leur approche n’est pas de détruire le capitalisme mais d’obtenir, dans le cadre des rapports de production, les meilleures conditions de vie possible pour les travailleurs.
Lorsque le capitalisme ne s’était pas encore implanté dans tous les pays et toutes les sphères économiques (XIXe et début du XXe siècle), le syndicalisme pouvait encore jouer un rôle favorable pour les travailleurs. Mais avec l’entrée du capitalisme dans sa phase de décadence, le syndicat ne peut plus obtenir que de rares miettes et tombe dans les filets de l’État et dans la défense du capitalisme.
Le syndicalisme ne peut pas remettre en question les infrastructures de production de l’économie capitaliste que sont l’entreprise, l’industrie et la nation. Au contraire (à l’instar des partis de la gauche du capital), il figure parmi ses défenseurs les plus fidèles. D’après les syndicats, le développement de la nation serait bénéfique à l’ensemble de la population, puisque tout le monde aurait une plus grande part du gâteau. Marx, dans “Salaires, prix et profits”, a combattu ces fantaisies des syndicalistes anglais en prenant comme exemple une soupière : les syndicalistes disaient que si la soupière était plus grande, il y aurait plus de soupe à distribuer, Marx leur a réfuté que le problème n’était pas la taille de la soupière mais la taille de la cuillère avec laquelle les travailleurs mangeaient et que celle-ci avait tendance, historiquement, à devenir de plus en plus petite”. (1)
Les syndicats dénaturent les revendications ouvrières pour mieux défendre l’entreprise et la nation
Le syndicat a mené les négociations avec l’entreprise à huis clos (2). Ceci est une nécessité pour les syndicats, car, dans ce type de négociation, ils examinent avec l’entreprise la façon dont préserver les profits qu’elle réalise au détriment des conditions de vie des ouvriers, en délaissant les revendications les plus importantes de ces derniers, en mesurant la capacité de réaction et la force que ceux-ci opposent, tout en convenant de la manière dont les épuiser. L’intérêt pour l’avenir de l’entreprise au détriment de l’avenir des travailleurs est à 100 % partagé par les syndicats. “Les dirigeants du syndicat UAW allèguent un manque d’intérêt des patrons pour le sort de leurs ouvriers, malgré le fait que l’année passée, l’entreprise a gagné plus de 8 000 millions de dollars” (3). Ainsi, d’après les syndicats, si l’entreprise réalise des bénéfices, elle devrait en laisser quelques miettes pour les ouvriers. Mais, que se passera-t-il si l’entreprise ne fait pas de bénéfices ? Pour les syndicats, les ouvriers doivent se sacrifier, renoncer à nourrir leurs familles pour sauver l’entreprise, comme il y a douze ans lors de la crise de 2008 pendant laquelle tous les syndicats de GM, dans divers pays, avaient demandé l’appui inconditionnel des travailleurs afin de pouvoir sauver l’entreprise : “L’UAW s’est plaint que les ouvriers, après avoir aidé General Motors des années durant à réaliser des millions de bénéfices, n’avaient pas reçu quoi que ce soit de plus pour subvenir au besoin de leurs familles. Terry Dittes, vice-président de l’UAW, a mis cette question au premier plan : il y a dix ans, pendant la crise financière, les dirigeants syndicaux ont accepté une diminution des avantages sociaux et un gel des salaires… Nous avons défendu GM quand elle avait le plus besoin de nous, maintenant nous sommes solidaires et unis pour nos membres, leurs familles et les communautés dans lesquelles nous vivons et travaillons”. (4) L’hypocrisie du syndicat s’est à nouveau révélée lors des nouveaux accords conclus avec l’entreprise où les revendications des ouvriers ont été tout simplement abandonnées.
De la même façon, le syndicat change les revendications des travailleurs par d’autres qui vont impacter certains d’entre eux : “Le syndicat réclame des augmentations de salaire par heure travaillée, ce que l’entreprise n’accepte pas. En outre, ils exigent une garantie que de nouveaux modèles [de véhicule] seront attribués aux usines américaines”. (5) L’exigence de “nouveaux modèles attribués aux usines américaines” est-elle une revendication de la classe ouvrière ? NON ! Cette approche est la même que celle de l’America First de Trump. De fait, Trump, dans le cadre de sa guerre commerciale, avait demandé à la présidente de GM, Mary Barra, de transférer la production du Mexique et celle de la Chine à Detroit. Les syndicats, fidèles serviteurs de la bourgeoisie nationale, ne cherchent qu’à détruire la solidarité entre les travailleurs de différents pays en leur inoculant le poison du nationalisme, en exigeant une production uniquement destinée aux Américains du Nord ; semant la division, ils veulent que les travailleurs se considèrent comme des citoyens américains avant tout et non comme des membres de la classe ouvrière internationale, les obligeant à se dissocier de ce qui arrive à leurs frères et sœurs de classe au Canada, en Chine, en Corée du Sud ou au Mexique, qui sont touchés par les mêmes licenciements, les mêmes conditions de vie. La solidarité et l’unité que les syndicats encouragent sont uniquement celles de l’entreprise et de la nation.
Les syndicats promeuvent des luttes longues et isolées
Certains grévistes ont dit qu’ils étaient prêts à se battre jusqu’au bout. Ils ont estimé que le moment était approprié pour défendre leurs revendications. Cependant, une des manœuvres des syndicats pour empêcher la victoire des mobilisations a été la prolongation de la grève, en maintenant les ouvriers enfermés sur eux-mêmes, dans leur secteur, afin que la grève ne prenne pas plus d’ampleur et que les travailleurs soient épuisés économiquement, physiquement, moralement et cèdent plus facilement. Ainsi, Jason Watson, leader de l’UAW, a par exemple déclaré : “J’ai environ 500 jeunes gens, avec une faible ancienneté salariale qui ont très, très peur”. (6) Leur objectif était non pas l’extension de la lutte mais la prolongation d’une grève isolée jusqu’à Noël : “En ce qui me concerne, la compagnie a fait marche arrière sur son offre et moi et mes membres sommes prêts à rester ici aussi longtemps que nécessaire”. (7)
Enfermés dans cet isolement total, les travailleurs ont été soumis à la pression morale de la bourgeoisie et des syndicats, qui les ont tenus pour responsables de tout ce qui était possible : de la défense de leurs “privilèges”, du retard de la sortie de la Corvette 2020, des pertes par millions des “pauvres employeurs” (près de deux milliards de dollars, soit 25 % de leurs juteux bénéfices, alors que les travailleurs en grève ont cessé de percevoir, pendant la grève, jusqu’à 75 % de leur salaire), de la fermeture d’usines dans d’autres branches et pays, de l’aggravation de la pollution pour éviter la reconversion vers la production de voitures électriques, du ralentissement de l’économie du Michigan, et même d’accélérer la récession dans le pays ! Il a s’agit de culpabiliser et de démoraliser d’une façon infâme. En effet, ces visions font croire aux ouvriers qu’ils sont des “citoyens de la nation”, occultant ce qu’ils sont en réalité : une classe sociale historique qui se bat pour ses intérêts et pour l’avenir de l’humanité. Lorsque les travailleurs luttent pour améliorer leurs salaires ou éviter les licenciements, cette lutte doit les amener à la conclusion qu’une société différente de celle que nous avons aujourd’hui peut exister. Dans la société actuelle, le profit, l’accumulation du capital et la guerre impérialiste sont primordiaux. Une société où les besoins de l’humanité toute entière sont satisfaits en premier lieu, voilà ce à quoi il faut aspirer. “(…) ils se doivent de protester contre la baisse de salaire et même contre la nécessité de la baisse, parce qu’ils doivent expliquer qu’eux, en tant qu’hommes, n’ont pas à se plier aux circonstances, mais que bien au contraire, les circonstances doivent se plier à eux, qui sont des êtres humains ; parce que leur silence équivaudrait à une acceptation de ces conditions de vie, une acceptation du droit de la bourgeoisie à les exploiter pendant les périodes économiques favorables et à les laisser mourir de faim dans les mauvaises périodes”. (8)
Les syndicats divisent et dressent les travailleurs les uns contre les autres
Les manœuvres du syndicat ne se limitent pas à entraver et à éroder les revendications des travailleurs. Leur principale préoccupation est d’isoler les ouvriers et de semer la division dans leurs rangs : par entreprise, par secteur, par région et par nation. Ainsi, par exemple, lorsque dans l’usine de Villa de Reyes (dans la municipalité de San Luis Potosi au Mexique) une des trois équipes de travail a été supprimée, un des leaders du syndicat canadien a déclaré : “c’est une bonne nouvelle pour nous, parce nous ne sommes pas les seuls à perdre cette fois-ci… puisque les ventes commençaient à baisser”. Autrement dit, pour les syndicats, il faut qu’il y ait de la concurrence entre les travailleurs, pas de la solidarité.
Voici un autre exemple, significatif, de la façon dont le syndicat empêche la solidarité : “Douze travailleurs mexicains de l’usine General Motors à Silao, Guanajuato, ont publié une déclaration en solidarité avec la grève de leurs pairs de l’autre côté de la frontière. (…) Ces douze ouvriers ont été licenciés de la manière la plus crapuleuse qui soit, l’un d’eux a été accusé d’être un toxicomane, bien qu’un test ait été négatif. (…) Ce n’était que le premier parmi les douze, tous ceux qui ont fait front face au syndicat mexicain et ont affiché leur soutien aux ouvriers de l’UAW avaient beaucoup d’ancienneté”. (9).
De la même façon, les syndicats nord-américains se sont plaints que “les pourparlers pour relancer l’emploi seraient entravés par les préoccupations des travailleurs, qui s’inquiètent de la production croissante de GM au Mexique”. Aux États-Unis comme au Canada, le message était le suivant : “les ouvriers mexicains volent notre travail parce qu’ils coûtent moins cher à l’entreprise et qu’ils acceptent de travailler dans de pires conditions”. Au Mexique, le message était à l’opposé : “les ouvriers des États-Unis, dans le but de maintenir leurs acquis, font grève et à cause de cela ils nous portent préjudice”. Autrement dit, les syndicats de part et d’autre de la frontière ont décidé de diviser et de monter les ouvriers les uns contre les autres.
Cette division et cette confrontation s’est étendue jusqu’aux ouvriers fabriquant les pièces pour l’industrie automobile. Les syndicats de GM ont oublié ces collègues dont le travail est indispensable à la production dans les usines de la multinationale. Les syndicats des entreprises sous-traitantes ont déclaré aux ouvriers qu’à cause de la grève, ils étaient moins bien payés, que c’est pour cette raison qu’ils se retrouvaient au chômage technique et qu’ils risquaient de perdre leur emploi. C’était un vil mensonge : aucune grève n’avait eu lieu depuis 2007. Pourtant GM, au Mexique, a décrété de nombreux chômages techniques en raison de la chute des commandes, de la fin d’anciens modèles, de la restructuration en vue de créer de nouveaux modèles, etc. Les ouvriers ne sont pas responsables des chômages techniques, c’est le Capital qui l’est.
C’est en tirant les leçons de cette défaite que l’on pourra préparer les victoires futures
Ces manœuvres syndicales visaient à briser la grève, et elles ont réussi. Le 25 octobre, près de dix jours après sa signature, le syndicat a ratifié la nouvelle convention collective de quatre ans avec à peine plus de 50 % des voix de ses membres, et 850 travailleurs d’Aramark qui n’en voulaient pas non plus. La société a accordé une augmentation dérisoire de 3 et 4 % pour les quatre prochaines années, un bonus qui couvre à peine ce que les ouvriers des 33 centres de production et des 22 centres de distribution de GM aux États-Unis ont perdu. Rien, en revanche, pour les milliers d’ouvriers au Canada, au Mexique et dans d’autres pays qui ont participé à quarante et même cinquante jours de grève durant lesquels ils ont été épuisés, trompés, divisés et démoralisés. De plus, il n’y a eu aucune amélioration du système de soins et trois usines aux États-Unis ont été fermées : l’usine d’assemblage de Lordstown, en Ohio, et deux usines au Michigan et au Maryland. Cela signifie la mise a pied immédiate de plus de 2 000 travailleurs, qui subissent des pressions pour prendre leur retraite ou bien démissionner. D’autre part, “le vice-président de l’UAW a remercié les employés de GM pour leur “sacrifice” durant cette grève de 50 jours, qui a fait perdre aux ouvriers des centaines de millions de dollars en salaire non perçu”. (10) De plus, il ajoute que “de nombreux points ont été négligés, notamment en ce qui concerne le système de santé, les salaires, la main-d’œuvre intérimaire, les emplois qualifiés et la sécurité de l’emploi, pour ne citer que ceux-là”. En réalité, toutes les revendications des ouvriers ! Les analystes bourgeois, quant à eux, font peu de cas des conséquences pour les ouvriers : “L’accord définitif n’est pas si catastrophique que ça pour les travailleurs, mais c’est loin d’être une victoire. “Personne ne va se précipiter pour reprendre le travail, enthousiaste à propos de ce qu’il a obtenu. Mais c’est quelque chose avec lequel tu peux vivre”. La grève est survenue après une décennie de frustration des employés envers l’entreprise, qui a sévèrement diminué les avantages sociaux et les salaires pendant la Grande Récession. Les employés se sont sentis abandonnés lorsque le constructeur automobile a commencé à réaliser d’importants bénéfices. Le nouvel accord ne change pas grand-chose à cette dynamique, mais il fait quelques pas dans la bonne direction”. (11)
Bien que la grève chez GM ait échoué, de nombreuses leçons sont à tirer de cette défaite, et c’est le plus important. Cette grève est un exemple récent des terribles coups qu’est en train d’asséner la bourgeoisie du monde entier :
– c’est la grève la plus massive de ces cinquante dernières années, et la première qui a eu lieu aux États-Unis en douze ans, après une période où la classe ouvrière ne s’est guère mobilisée au niveau international.
– Elle montre clairement, contrairement à ce que prétend la bourgeoisie, que la classe prolétarienne existe et qu’elle est prête à répondre sur son terrain de classe, même dans une situation globale de grande faiblesse et de confusion, exploitée par les entreprises et les syndicats.
– Elle montre à nouveau que les syndicats font partie intégrante de l’État capitaliste, avec comme rôle celui de contrôler les ouvriers et d’empêcher leur véritable lutte autonome.
– Elle montre comment les coups portés aux conditions de vie et de travail prennent de plus en plus un caractère international, et que cela augmente les raisons de l’extension de la lutte à d’autres secteurs et à d’autres pays.
Par ailleurs, les travailleurs de GM ont déclaré que la compagnie ne les formait plus et qu’ils ne pouvaient plus apprendre des ouvriers les plus anciens parce qu’ils ont pris leur retraite ou ont été licenciés. Tous les travailleurs devraient se rappeler que les “anciens” ont non seulement une expérience sur le lieu de travail, mais aussi dans la lutte contre l’exploitation capitaliste. En 1965-1967, d’importantes grèves chez GM ont eu lieu, comme dans d’autres entreprises automobiles de Detroit, dont un grand nombre hors des syndicats, où les ouvriers ont lutté de manière unie, faisant tomber les barrières de l’entreprise. À cette occasion, l’entreprise a cédé en quelques jours, contrairement à cette grève-ci, pourtant la plus longue du secteur automobile depuis cinquante ans. Cette expérience, comme celle que les travailleurs de GM ont désormais un demi-siècle plus tard, est précieuse pour la classe ouvrière. Elle est particulièrement utile pour comprendre ce qui s’est réellement passé lors de la grève des travailleurs de GM et pour savoir quoi faire lors des luttes futures, que la classe ouvrière finira sûrement par mener.
Dans ce sens, les ouvriers doivent se réapproprier les leçons des précédentes luttes pour éviter de nouvelles défaites comme celle-ci. Par exemple, il est à noter que le syndicat UAW comptait frapper sur une partie des ouvriers du secteur automobile pour les empêcher de se joindre à la lutte : “Le syndicat a annoncé qu’il se concentrera désormais sur l’obtention d’une nouvelle convention collective pour les ouvriers de Ford. Le syndicat avait mis en veilleuse les négociations avec Ford et Fiat Chrysler tout en cherchant à obtenir l’accord avec GM. (…) Le syndicat utilisera l’accord avec GM comme base de négociation avec les autres constructeurs automobiles de Detroit”. (12)
Deux leçons essentielles laissées par cette grève, et qui proviennent des grandes luttes de 1905 en Russie et dans d’autres pays (13) sont que :
1) la lutte doit être lancée, organisée et étendue par les ouvriers eux-mêmes, hors du contrôle syndical, au travers d’assemblées générales et des comités mandatés et révocables à tout moment ;
2) la lutte ne pourra aboutir si elle reste prisonnière des murs de l’entreprise, du secteur, ou de la nation. Au contraire, elle doit s’étendre, en abattant toutes les barrières que le capital impose et qui les relient à lui.
Revolución Mundial,
section du CCI au Mexique,
21 novembre 2019.
1 Voir sur notre site en espagnol l’article complet : “Lucha aislada lucha perdida [17]” (7 février 2013).
2 Jason Watson, président de la section 2164 de la UAW, a déclaré, se vantant que ses affiliés étaient impatients de connaître l’issue des négociations : “Étant moi-même quelqu’un qui, depuis quinze ans, a mené des négociations, je sais que c’est comme une partie de poker, et un bon joueur ne dévoile jamais ses cartes. Nos membres se montrent curieux des détails, mais ils comprennent pourquoi ceux-ci doivent rester confidentiels”. Face à des négociations secrètes où deux ou trois éléments du Capital et de son État conspirent contre les travailleurs (Gouvernement, patronat et syndicats), la première chose que la grève de masse de 1980 en Pologne a fait, portée par les assemblées générales, fût d’exiger que toutes les négociations entre les représentants des ouvriers et le gouvernement soient enregistrées et rendues publiques aux assemblées. Voir : “Un an de luttes ouvrières en Pologne [18]” Revue Internationale n° 27 (4e trimestre 1981).
3 Telesur (19 septembre 2019).
4 Idem.
5 Expansión (15 septembre 2019).
6 Detroit Free Press (08 octobre 2019).
7 Idem.
8 Engels, La situation de la classe laborieuse en Angleterre [19] (1845).
9 Humberto Juárez, économiste mexicain, dans un’article paru dans Sputnik (17 octobre 2019).
10 EFE (26 octobre 2019)
11 Vox (25 octobre 2019).
12 CNN (25 octobre 2019).
13 Voir sur notre site le premier article de la série : Le communisme n’est pas un bel idéal, il est à l’ordre du jour de l’histoire, intitulé : “1905 : la grève de masse ouvre la voie à la révolution prolétarienne [20]”. Revue Internationale n° 90 (3e trimestre 1997).
Géographique:
- Mexique [21]
Rubrique:
75 ans après la libération des camps de la mort, Auschwitz demeure le "grand alibi" de la démocratie bourgeoise
- 170 lectures
75 ans après, les chefs d’État et têtes couronnées du mode entier continuent de célébrer avec la même hypocrisie la libération de quelque 7000 survivants du camp de concentration et d’extermination d’Auschwitz, le 27 janvier 1945, par l’armée russe. Le “grand alibi” (pour reprendre les mots de Bordiga) que fût la libération des camps nazis, permit au “camp démocratique” de masquer ses propres crimes, massacres, rapines et bombardements massifs. En cette occasion, tous les médias continuent de repasser en boucle les images insoutenables d’êtres humains réduits à l’état squelettique derrière des barbelés et de rappeler l’horreur de l’extermination impitoyable de millions de Juifs, Tziganes et autres "indésirables". Mais la bourgeoisie continue aussi de passer sous silence le fait avéré que les gouvernements alliés du camp “démocratique” étaient non seulement parfaitement au courant de l’exécution de la “solution finale” dès 1942, mais qu’en toute complicité, ils ont délibérément caché la réalité et laissé perpétrer le massacre, refusant même sciemment de sauver des dizaines, voire des centaines de milliers de vies. Une façon de masquer ou de faire oublier qu’ils restent eux-mêmes un produit du même système criminel qui a pu enfanter les nazis et les staliniens : le capitalisme.
C’est pourquoi nous remettons en avant un article tiré de notre brochure “Fascisme et démocratie, deux expressions de la dictature du capital [22]”, contre l’escroquerie de la propagande invitant toujours les prolétaires à se mobiliser sous la bannière de la défense de la “liberté” et de la “démocratie”, que ce soit au nom de “l’antifascisme” ou de “l’anti-populisme”.
– La coresponsabilité des alliés et des nazis dans l'holocauste [23]
Géographique:
- Europe [24]
Evènements historiques:
Questions théoriques:
- Guerre [26]
Rubrique:
ICCOnline - février 2020
- 65 lectures
Face aux attaques du gouvernement, il faut prendre nous-mêmes nos luttes en main! (Tract)
| Fichier attaché | Taille |
|---|---|
| 125.51 Ko |
- 247 lectures
Après des années d’atonie, le mouvement social contre la réforme des retraites a montré un réveil de la combativité du prolétariat en France. Malgré toutes ses difficultés, la classe ouvrière a commencé à relever la tête. Alors qu’il y a un an, tout le terrain social était occupé par le mouvement interclassiste des gilets jaunes, aujourd’hui, les exploités de tous les secteurs, de toutes les générations ont profité des journées d’action organisées par les syndicats pour descendre dans la rue, déterminés à lutter sur leur propre terrain de classe contre cette attaque frontale et massive du gouvernement qui frappe l’ensemble des exploités.
La classe ouvrière existe !
Alors que depuis près de dix ans, les salariés demeuraient paralysés, totalement isolés chacun dans son coin sur son lieu de travail, ils sont parvenus ces dernières semaines à retrouver le chemin de la lutte collective.
Les aspirations à l’unité et à la solidarité dans la lutte montrent que les travailleurs en France commencent à se reconnaître de nouveau comme faisant partie d’une seule et même classe ayant les mêmes intérêts à défendre. Il est clair qu’en refusant de continuer à courber l’échine, la classe ouvrière en France est en train de retrouver sa dignité.
Cependant, après des manifestations hebdomadaires rassemblant des centaines de milliers de personnes, ce mouvement n’est pas parvenu à faire reculer le gouvernement.
Depuis le début, la bourgeoisie, son gouvernement et ses “partenaires sociaux” avait orchestré une stratégie pour faire passer l’attaque sur les retraites.
De plus, la bourgeoisie blinde son État policier, au nom du maintien de l’“ordre républicain”. Le gouvernement déploie, de façon hallucinante, ses forces de répression afin de nous intimider. Les flics ne cessent de gazer et tabasser aveuglément des travailleurs (y compris des femmes et des retraités) appuyés par les media qui font l’amalgame entre la classe exploitée, les black blocks et autres “casseurs”. Afin d’empêcher les travailleurs de se regrouper à la fin des manifs pour discuter, les cohortes de CRS les dispersent, sur ordre de la Préfecture. Les violences policières ne sont nullement le fruit de simples “bavures” individuelles de quelques CRS excités et incontrôlables. Elles annoncent la répression impitoyable et féroce que la classe dominante n’hésitera pas à déchaîner contre les prolétaires, dans le futur (comme elle l’a fait dans le passé, par exemple, dans la “semaine sanglante” de la Commune de Paris en 1871).
À quoi servent donc les syndicats ?
Aujourd’hui, alors que le mouvement reflue, les syndicats, et notamment la CGT, appellent à l’“extension”. Ils organisent des actions minoritaires complètement stériles comme les retraites aux flambeaux, et la grève des éboueurs pour rendre impopulaire notre mouvement. Les centrales syndicales les plus “radicales” et “jusqu’au boutistes” cherchent ainsi à épuiser notre combativité et à pourrir le mouvement pour nous conduire à la défaite. Les manifestations qu’ils continuent à organiser depuis que les cheminots ont repris le travail après presque 2 mois de grève, et alors que nous sommes de moins en moins nombreux dans la rue, visent justement à épuiser ceux qui veulent aller jusqu’au retrait de la réforme. Mais il ne faut pas se faire d’illusion : le gouvernement ne reculera pas et les dirigeants syndicaux (et autres “partenaires sociaux” du gouvernement) le savent pertinemment.
Pourquoi ? Parce que les syndicats se sont bien gardés d’appeler tous les travailleurs de toutes les entreprises et tous les secteurs à descendre massivement dans la rue (comme c’était le cas en Mai 1968 ou la grève massive de 9 millions de travailleurs avaient obligé le gouvernement à augmenter le SMIC de 20 %). Dans de nombreux secteurs et entreprises, les syndicats ont joué leur rôle habituel de “pompiers sociaux”. Malgré leurs discours “radicaux”, ils n’ont pas appelé tous les travailleurs du public et du privé à venir aux manifestations. Nous n’étions pas assez nombreux, même si au début du mouvement, il y avait plusieurs centaines de milliers de travailleurs, retraités, étudiants et lycéens en colère, et déterminés à lutter tous ensemble contre cette réforme des retraites qui touche toute la classe exploitée.
Maintenant que l’extension massive de la lutte a été bien sabotée, Martinez (dirigeant de la CGT) a annoncé que son syndicat va participer à la “conférence sur le financement des retraites” (alors qu’au début, il n’en n’était pas question). Ils vont tous s’asseoir à la table des négociations, dans le dos des travailleurs, pour empêcher que la colère ne débouche encore sur de nouvelles explosions quand cette réforme sera votée par l’Assemblée Nationale.
Les syndicats verrouillent et noyautent toutes les AG “interpro” ; ils poussent les travailleurs de telle ou telle entreprise à faire grève alors que le mouvement est entré dans sa phase de reflux. Même si la bourgeoisie a encore des difficultés à “faire rentrer le dentifrice dans le tube” (comme le disait, sur les plateaux télé, la directrice de la rédaction du journal Le Parisien) !
Maintenant on a droit à la campagne sur la mascarade électorale où tous les partis bourgeois se précipitent à la curée des Municipales ! Les médias aux ordres nous bassinent, jour après jour, sur les dégâts du “coronavirus” chinois, (de plus ils utilisent cette catastrophe sanitaire pour stigmatiser une partie de la population), avec cynisme sur la polémique malsaine autour des 12 jours de congé pour le deuil d’un enfant, etc. Ceci pour amuser la galerie et faire diversion.
Face aux attaques du Capital, comment faire reculer le gouvernement ?
Aujourd’hui, la classe ouvrière n’est pas encore prête à s’engager massivement dans la lutte. Même si de nombreux travailleurs de tous les secteurs, de toutes les catégories professionnelles (essentiellement de la fonction publique), de toutes les générations étaient présents à battre le pavé dans les manifestations organisées par les syndicats depuis le 5 décembre. Ce dont nous avons besoin pour freiner les attaques de la bourgeoisie, c’est de développer la solidarité active dans la lutte et pas seulement en remplissant les caisses de solidarité pour permettre aux grévistes de “tenir”.
Les cheminots qui ont été le fer de lance de cette mobilisation contre la réforme des retraites, ne pouvaient pas poursuivre leur grève seuls sans que les autres secteurs n’engagent eux-mêmes la lutte avec eux. Malgré leur courage et leur détermination, ils ne pouvaient pas lutter “à la place” de toute la classe ouvrière. Ce n’est pas la “grève par procuration” qui pouvait faire reculer le gouvernement, aussi déterminée soit-elle.
Pour pouvoir s’affronter à la classe dominante et faire reculer le gouvernement, les travailleurs doivent prendre eux-mêmes leur lutte en main. Ils ne doivent pas la confier aux syndicats, à ces “partenaires sociaux” qui ont toujours négocié dans leur dos et dans le secret des cabinets ministériels.
Si nous continuons à demander aux syndicats de nous “représenter”, si nous continuons à attendre qu’ils organisent la lutte à notre place, alors oui, “nous sommes foutus” !
Pour pouvoir prendre nous-mêmes notre lutte en main, pour l’élargir et l’unifier, il fallait nous organiser nous-mêmes ! C’est dans les AG que nous pouvons discuter tous ensemble, décider collectivement des actions à mener, former des comités de grève avec des délégués élus et révocables à tout moment.
Pour pouvoir construire un rapport de forces face à la bourgeoisie, son gouvernement et son patronat, il faut étendre la lutte immédiatement au début d’un mouvement, en envoyant des délégations massives entraîner dans la lutte les travailleurs des entreprises les plus proches sur une base géographique et non pas catégorielle, secteur par secteur. Il faut organiser des AG ouvertes à tous, où tous les travailleurs, actifs, précaires ou chômeurs, retraités et étudiants, peuvent participer, prendre la parole pour réfléchir ensemble, faire des propositions sans laisser les syndicats confisquer leur lutte.
Les travailleurs ont les moyens de faire reculer le gouvernement, de freiner les attaques si toute la classe exploitée prend confiance en elle, en sa propre force. Souvenons-nous de la grève de masse en Pologne en août 1980 qui était partie des chantiers navals de Gdansk et qui a pu s’étendre immédiatement comme une traînée de poudre aux quatre coins du pays. Les AG étaient souveraines et massives. Les négociations avec le gouvernement de Jaruzelski étaient publiques et non pas secrètes dans le dos des grévistes et dans les coulisses des cabinets ministériels. Tous les travailleurs réunis en Assemblées Générales pouvaient tout entendre !
Cette grève de masse a été défaite dès lors que le syndicat “libre” Solidarnosc (avec Lech Walesa à sa tête) a été créé avec l’aide des syndicats occidentaux (notamment la CFDT). C’est le sabotage de ce syndicat “libre” qui avait livré la classe ouvrière de Pologne pieds et poings liés à la répression !
Les jeunes travailleurs qui ont participé au mouvement contre le “Contrat Première Embauche” au printemps 2006, lorsqu’ils étaient encore étudiants ou lycéens doivent se souvenir et transmettre cette expérience à leurs camarades de travail. Comment ont-ils pu faire reculer le gouvernement Villepin en l’obligeant à retirer son “CPE” ? Grâce à leur capacité à organiser eux-mêmes leur lutte dans leurs Assemblées Générales massives dans toutes les universités, et sans aucun syndicat. Les étudiants avaient appelé tous les travailleurs, actifs et retraités, à venir discuter avec eux dans leurs AG et à participer au mouvement en solidarité avec les jeunes générations confrontées au chômage et à la précarité. Le gouvernement Villepin a dû retirer le CPE sans qu’il y ait eu aucune “négociation”.
Nous avons perdu une bataille, mais nous n’avons pas perdu la guerre !
La reprise du travail dans le secteur des transports n’est pas une capitulation ! Faire une “pause” dans la lutte est aussi un moyen de ne pas s’épuiser dans une grève longue, isolée, qui ne peut déboucher que sur un sentiment d’impuissance et d’amertume.
La grande majorité des travailleurs mobilisés ont le sentiment que si on perd cette bataille, si on ne parvient pas à obliger le gouvernement à retirer sa réforme, “on est foutus !” Ce n’est pas vrai ! La mobilisation contre la réforme des retraites, et le rejet massif de cette attaque, n’est qu’un début, une première bataille qui en annonce d’autres demain. Car la bourgeoisie, son gouvernement et son patronat vont continuer à nous exploiter, à attaquer notre pouvoir d’achat, à nous plonger dans une pauvreté et une misère croissantes. La colère ne peut que s’amplifier jusqu’à déboucher sur de nouvelles explosions, de nouveaux mouvements de lutte.
Même si la classe ouvrière perd cette première bataille, elle n’a pas perdu la guerre. Elle ne doit pas céder à la démoralisation !
La “guerre de classe” est faite d’avancées et de reculs, de moments de mobilisation et de pause pour pouvoir repartir de nouveau encore plus forts. Ce n’est jamais un combat en “ligne droite” où on gagne immédiatement du premier coup. Toute l’histoire du mouvement ouvrier a démontré que la lutte de la classe exploitée contre la bourgeoisie ne peut aboutir à la victoire qu’à la suite de toute une série de défaites.
Le seul moyen de renforcer la lutte, c’est de profiter des périodes de repli en bon ordre pour réfléchir et discuter ensemble, en se regroupant partout, sur nos lieux de travail, dans nos quartiers et tous les lieux publics.
Les travailleurs les plus combatifs et déterminés, qu’ils soient actifs ou chômeurs, retraités ou étudiants, doivent essayer de former des “comités de lutte” interprofessionnels ouverts à toutes les générations pour préparer les luttes futures. Il faudra tirer les leçons de ce mouvement, comprendre quelles ont été ses difficultés pour pouvoir les surmonter dans les prochains combats.
Ce mouvement social, malgré toutes ses limites, ses faiblesses et difficultés, est déjà une première victoire. Après des années de paralysie, de désarroi et d’atomisation, il a permis à des centaines de milliers de travailleurs de sortir dans la rue pour exprimer leur volonté de lutter contre les attaques du Capital. Cette mobilisation leur a permis d’exprimer leur besoin de solidarité et d’unité. Elle leur a permis aussi de faire l’expérience des manœuvres de la bourgeoisie pour faire passer cette attaque.
Le principal “gain” de la lutte, notre première “victoire” c’est la lutte elle-même, c’est notre capacité à relever la tête tous ensemble pour dire Non ! On ne se laissera pas faire ! Nous sommes déterminés à défendre nos conditions de vie, l’avenir de nos enfants et de toutes les générations futures ! Même si nous devons encaisser encore des défaites, nous irons jusqu’au bout !
Le prolétariat est la seule force de la société capable d’abolir l’exploitation capitaliste pour construire un monde nouveau. Le chemin qui mène à la révolution prolétarienne mondiale, au renversement du capitalisme, sera long et difficile. Il sera parsemé d’embûches et de défaites, mais il n’y en a pas d’autre.
Plus que jamais, l’avenir appartient à la classe ouvrière.
Courant Communiste International, 4 février 2020
Situations territoriales:
Rubrique:
Le gouvernement Conte II (Italie), un seul mot d’ordre: “se maintenir à tout prix”!
- 48 lectures
S’il y a un objectif que le gouvernement Conte II ne peut manquer de poursuivre, c’est bien celui de durer le plus longtemps possible. Contrairement aux coalitions du passé, en effet, ce gouvernement n’est pas basé sur un projet commun, du moins en principe, mais sur la nécessité de ne pas aller aux élections en remettant le pays à la droite et en particulier à la Ligue de Salvini.
En effet, l’opposition de Salvini et de Meloni tente par tous les moyens d’utiliser les divisions gouvernementales pour faire sauter le gouvernement et conduire l’Italie à des élections anticipées qui, étant donné l’orientation politique actuelle des électeurs italiens, conduiraient à un parlement majoritairement de droite avec une influence populiste encore plus forte. Ce résultat produirait non seulement un gouvernement de droite dirigé par Salvini, mais aussi l’élection d’un président de la République convenant à la droite et surtout aux populistes. Le scénario qui s’ouvrirait serait alors vraiment catastrophique pour la bourgeoisie qui s’est jusqu’à présent accrochée aux interventions délicates et discrètes de personnages tels que les Présidents Napolitano et Mattarella. Avec la remise en selle d’un personnage comme Berlusconi, elle verrait sa marge de manœuvre encore plus réduite que ces dernières années.
Formé par nécessité, le gouvernement actuel n’a pas toutes les marges de manœuvre pour jouer son rôle dans la vie politique et économique italienne, étant donné qu’il ne peut même pas avoir un minimum de tranquillité stabilité en son sein. Dans les faits, les différents partis gouvernementaux s’opposent tour à tour sur des questions spécifiques. Un exemple : l’aciérie de Tarente, louée à Arcelor Mittal, qui voit le Mouvement 5 étoiles (M5S) divisées entre les partisans de la fermeture et ceux de la défense de l’emploi. Le Président du Conseil, Conte, s’est lui-même rendu à Tarente pour essayer de calmer la situation, tout en affirmant qu’il n’avait pas de solutions. Il semble au final qu’un compromis ait été trouvé entre fermetures de postes et investissements de fonds publics pour aider Arcelor à relancer le site industriel.
Tandis que les campagnes de propagande du gouvernement Di Maio-Salvini étaient centrées sur sa réforme des retraites (le “quota 100”), sur le revenu de citoyenneté et le rejet des migrants, celles du gouvernement actuel peinent à exister. Comme il n’y a pas de base commune, le gouvernement avance sans discernement pour disparaître ensuite de la scène politique. Il n’est plus question du débarquement des migrants, pourtant cheval de bataille de Salvini, du développement des infrastructures (TGV, réseau routier…), de la situation économique du pays (avec notamment la question de la compagnie aérienne Alitalia), (1) ni même du monde du travail et de sa précarité qui devait prétendument être abolie. Ce gouvernement qui se dit de gauche n’a rien à offrir aux travailleurs, si ce n’est une réduction d’impôts ridicule de 40 euros par mois qui ne concerne même pas l’ensemble de la population.
Sur le plan économique, l’élément le plus important des actions du gouvernement a été de stopper l’augmentation de la TVA. Il y est parvenu, mais au détriment des fonds nécessaires à l’adaptation des infrastructures nécessaires au développement du capital national. Face aux glissements et aux effondrements de terrain, aux inondations et aux crues, les interventions à grande échelle indispensables pour éviter le pire sont au point mort. Le gouvernement est seulement capable de se disputer sur ce qui devrait être fait.
Ces derniers jours, après une réunion au niveau européen, l’accord sur le MES (le mécanisme européen de stabilité) a porté le conflit entre le gouvernement et l’opposition à un niveau supérieur, Salvini et Meloni accusant Conte de trahir la nation. Ce dernier, montrant un caractère différent qu’à l’époque du premier gouvernement, a jeté au visage de Salvini son accord précédent sur le MES. Si Conte est sûr de l’appui du Président de la République et de secteurs importants de la bourgeoisie, il ne peut pas en dire autant de Di Maio, qui est tenté de le poignarder dans le dos.
Ce gouvernement semble concentrer en lui-même tous les problèmes de la période. En fait, c’est un gouvernement qui n’a pas les moyens de faire face à la crise actuelle, pas tellement à cause de son incompétence, cependant bien que réelle, mais parce que la situation est objectivement insoluble. Qui plus est, le pays est soumis aux attaques incessantes du populisme et se trouve au centre de l’une des crises industrielles les plus graves de ces dernières décennies. Le problème de la bourgeoisie italienne est donc de savoir comment reprendre le contrôle de l’électorat, et donc de la machine électorale, pour se concentrer sur des forces politiques plus responsables lors des prochaines élections.
Ce n’est pas une opération facile, mais des tentatives peuvent être constatées dans au moins deux domaines. Le premier est la création totalement artificielle de divers mouvements et manifestations écologistes, notamment impulsés par le “phénomène” Greta Tumberg. Tout ceci a déjà donné une nouvelle vie à divers partis Verts lors de plusieurs élections en Europe. L’autre, plus local, est le développement du “mouvement des sardines”, (2) un mouvement en premier lieu anti-populiste qui a déjà gagné la confiance de couches importantes de la population et dont l’intention est explicitement de contrer le populisme de Salvini et de produire une sorte d’anticorps politique dans le pays.
Il est presque impossible de prévoir l’évolution de cette situation, mais nous savons que l’issue de l’affrontement entre les différentes forces politiques dépendra du rythme de développement de la crise politique et économique, et certainement pas de son impossible résolution. Celle-ci, au contraire, ne dépend que de la reprise de la lutte de classe et de l’affirmation du prolétariat comme classe révolutionnaire dans cette société.
Rivoluzione Internazionale, section du CCI en Italie
Oblomov, 8 décembre 2019
1 La Ligue de Salvini a déclaré son opposition à une vente de l’entreprise aérienne. Début janvier, Salvini a ravivé les hostilités sur cette question en affirmant : “Même sur Alitalia, le gouvernement perd du temps et met en danger une entreprise stratégique pour le pays et l’avenir de 10 000 travailleurs”. (Source : ANSA.it)
2 Le mouvement est né avec la protestation de la Piazza Maggiore contre Matteo Salvini, qui a lancé la campagne électorale légaliste en vue des élections régionales en Émilie-Romagne.
Géographique:
- Italie [28]
Questions théoriques:
- Populisme [29]
Rubrique:
Soudan: la mystification démocratique alimente le foyer de la barbarie capitaliste
- 55 lectures
Le Soudan est un pays ruiné par plus de 40 ans de guerres civiles dans lesquelles les grandes puissances impérialistes s’impliquent en permanence. Les différents conflits armés ont causé plus de 2 millions de morts (au Sud-Soudan et au Darfour) et provoqué misère et chaos sanglant, d’où réguliérement des révoltes et des émeutes de la faim contre les régimes militaires et islamistes qui se succèdent depuis “l’indépendance”.
À partir décembre 2018, le Soudan a était secoué par un puissant mouvement social avec des grèves et des manifestations massives que le pouvoir islamo-militaire a violemment réprimé, causant des centaines de morts, des milliers de prisonniers et de disparus. Le mouvement était au départ spontané avec la présence massive d’ouvriers et de personnes misérables : “Les gens veulent du pain (dont le prix a été multiplié par trois le 18 décembre), de l’essence, du “cash”, des médicaments. (…) Tant que la petite bourgeoisie qui ne s’intéressait pas à la politique pouvait prospérer ou du moins survivre, alors les frustrations des plus pauvres de la société ne pouvaient pas suffire à déclencher un grand mouvement de protestation. Mais la paralysie économique a obligé les cols blancs à frayer avec les ouvriers dans les files d’attente pour l’approvisionnement alimentaire” (1). En effet, des grèves massives à répétition ont éclaté, paralysant même à plusieurs reprises les rouages de l’économie et de l’administration, au point de pousser l’institution militaire et étatique à évincer son grand chef, Omar Al Bachir, en tentant ainsi d’amadouer “la rue”. Au départ, il s’agissait d’un mouvement emmené initié par la classe ouvrière qui, importante numériquement dans un pays où le secteur pétrolier représente une part significative de l’économie, est descendue dans la rue contre la dégradation des conditions de vie.
Cependant, une partie de la bourgeoisie a très rapidement su exploiter les faiblesses de ce mouvement. Dans un pays où le prolétariat reste très isolé, peu expérimenté et peu aguerri aux pièges qui lui sont tendus, la bourgeoisie n’a pas eu de difficulté à détourner ce mouvement sur le terrain des règlements de comptes entre factions en lutte pour la direction de l’État. Les forces “démocratiques” autour de l’Association des professionnels du Soudan (APS) ont ainsi canalisé et encadré le mouvement en appelant de leurs vœux “le transfert du pouvoir à un gouvernement civil de transition dans lequel l’armée participe”. Ce mouvement social s’est rapidement trouvé entre les mains des organisations bourgeoises dont le but premier est l’instauration d’un “gouvernement démocratique” en vue de gérer plus efficacement le capital national. “En octobre 2016, un noyau s’est formé à partir du groupement de trois entités : le Comité central des médecins, le Réseau de journalistes et l’Alliance démocratique des avocats. Progressivement, des comités d’ingénieurs, des pharmaciens ou encore de professeurs ont rejoint l’APS. Fin 2018, l’APS affiche l’union de quinze corps de métier qui soutiennent les manifestants descendus dans la rue le 19 décembre pour protester contre la cherté de la vie, au lendemain d’une décision faisant tripler le prix du pain. Rapidement, les revendications liées à la crise économique et à la baisse du pouvoir d’achat ont évolué pour réclamer la chute du régime” (2). Cette association a d’ailleurs entrepris de fédérer tous les partis d’opposition dans une coalition allant du Parti républicain aux staliniens en passant par les opposants islamistes et certains groupes armés.
Le mouvement social est ainsi devenu l’expression ouverte d’une orientation purement étatique et bourgeoise dont la classe ouvrière n’a pas tardé à faire les frais. En août dernier, un gouvernement technocrate de “transition” a été nommé sous l’égide d’un organe exécutif composé de six civils et de cinq militaires. Quand on sait que les chefs de l’armée qui avaient mené la sanglante répression contre les manifestants (entre 180 et 250 morts en moins de six mois) ont gardé les mêmes postes répressifs (défense et intérieur) dans ce nouveau gouvernement de “transition”, il n’y a décidément aucune illusion à se faire sur la fin de la misère et des tueries que subissent la classe ouvrière et les couches opprimées.
Quant à l’hypocrite concert d’applaudissements des médias et de de tous les grands requins qui ont salué le soi-disant "changement de régime », à l’instar de Macron qui s’est empressé d’annoncer à l’issue de la rencontre avec le nouveau président Abdalla Hamdok le 30 septembre dernier un « soutien inconditionnel à la transition démocratique », il ne doit pas davantage duper sur l’avenir de misère et de nouveaux massacres réservés aux populations.
D’ailleurs, Par ailleurs ce pays est sous influence de bon nombre de puissances impérialistes (notamment du Golfe) dont dépend le pouvoir soudanais pour sa survie : “Au Soudan, le chef du Conseil militaire de transition (CMT) a reçu le “feu vert” de l’Arabie Saoudite et de ses alliés régionaux pour lancer la répression contre les manifestants qui campaient depuis des semaines (le 6 avril) devant le siège de l’armée à Khartoum, souligne un expert militaire soudanais. D’après ce spécialiste qui tient à garder l’anonymat, la destruction (lundi 3 juin) du campement des manifestants avait fait l’objet de discussions lors de récentes visites du général Abdel Fattah Al Bourhan, chef du CMT, en Arabie Saoudite, aux Emirats arabes unis et en Égypte. (Selon un analyste algéro-soudanais, le 21 avril, Ryad et Abou Dhabi ont annoncé qu’ils verseraient 3 milliards de dollars au Soudan. Ils ne l’ont pas fait sans contrepartie. Ce qu’ils attendent en retour, ce n’est pas la démocratie (…), c’est la préservation de leurs intérêts économiques” (3).
Évidemment, il n’y pas que des intérêts purement économiques qui expliquent l’intervention de l’Arabie Saoudite et des Émirats du Golfe au Soudan, mais aussi, et surtout, leur volonté de puissance hégémonique face à leurs rivaux impérialistes. Le Soudan participe directement aux tueries perpétrées au Yémen avec ses 14 000 soldats à la disposition du régime assassin saoudien. Il faut également se rappeler que ce sont les mêmes coalitions d’assassins qui s’affrontent au Soudan, en Libye ou en Syrie pour les mêmes raisons, à savoir la préservation de leurs sordides intérêts capitalistes et impérialistes.
Si la classe ouvrière existe bel et bien au Soudan, elle est cependant récente et sans expérience de lutte significative. Elle est surtout bien encadrée par les syndicats (sous contrôle du Parti communiste stalinien soudanais considéré comme le plus important du monde arabe) qui ont pu immédiatement enterrer les revendications ouvrières sur le terrain pourri de la “lutte pour la démocratie”. La prétendue “révolution soudanaise” a une nouvelle fois fait la démonstration que le développement de la conscience politique est une arme indispensable. Face aux récupérations de mouvements sociaux sur le terrain des luttes sanglantes de la bourgeoisie, la classe ouvrière ne pourra, à l’avenir, n’opposer que l’unification internationale de ses luttes en s’appuyant particulièrement sur le prolétariat des pays de l’Europe occidentale qui a la plus vieille expérience des luttes et se trouve confronté depuis des décennies aux mystifications “démocratiques” et aux pièges syndicaux les plus sophistiqués.
Amina, novembre 2019
1Courrier international (6 février 2019).
2Courrier international (24 avril 2019).
3Courrier international (9 juin 2019).
Géographique:
- Afrique [30]
Rubrique:
Le futur de la planète ne peut pas être laissé entre les mains de la classe capitaliste
- 38 lectures
La civilisation capitaliste, ce système mondial basé sur le travail salarié et la production pour le profit, est en train d’agoniser. Tout comme la société esclavagiste de la Rome antique ou le servage féodal, elle est condamnée à disparaître. Mais contrairement aux systèmes qui l’ont précédé, elle menace d’entraîner dans sa chute l’humanité tout entière.
Depuis plus de cent ans, les symptômes de son déclin sont devenus de plus en plus évidents. Deux guerres mondiales marquées par des niveaux sans précédents de destruction, suivies par des décennies de guerres par procuration entre les deux blocs impérialistes (États-Unis et URSS), conflits qui contenaient en eux-mêmes la menace d’une troisième et ultime Guerre mondiale. Depuis que le bloc de l’Est s’est dissout en 1989, nous n’avons pas vu la paix, mais des conflits locaux et régionaux toujours plus chaotiques, comme ceux qui ravagent actuellement le Moyen-Orient. Nous sommes passés par des convulsions économiques mondiales comme celles des années 1930, 1970 ou encore celle de 2008 qui ont fait basculer des millions de personnes dans le chômage et la précarité, qui accélèrent les conflits impérialistes entre les diverses puissances capitalistes.
Quand le capitalisme réussit à redynamiser l’accumulation (que ce soit au lendemain d’une destruction massive comme en 1945 ou en s’auto-dopant par l’endettement), nous savons désormais que la croissance même et l’expansion du capital ajoute une nouvelle menace pour l’humanité à travers la destruction de la nature elle-même.
Rosa Luxemburg en 1916, en réponse aux horreurs de la Première Guerre mondiale, a mis en lumière le choix auquel l’humanité doit faire face : “ou bien le triomphe de l’impérialisme et la décadence de toute civilisation, avec pour conséquences, comme dans la Rome antique, le dépeuplement, la désolation, la dégénérescence, un grand cimetière ; ou bien la victoire du socialisme c’est-à-dire de la lutte consciente du prolétariat international contre l’impérialisme et contre sa méthode d’action : la guerre. C’est là un dilemme de l’histoire du monde, un “ou bien – ou bien” encore indécis dont les plateaux balancent devant la décision du prolétariat conscient”. (La Brochure de Junius)
Contrairement au système esclavagiste qui a finalement ouvert la voie au féodalisme, ou le féodalisme, à son tour, qui a permis au capitalisme de se développer en son sein, le système actuel dans son agonie n’engendrera pas mécaniquement une nouvelle société basée sur de nouveaux rapports sociaux. Une nouvelle société peut seulement être construite à travers la “lutte active consciente du prolétariat international”, à travers l’union de tous les exploités du monde, se reconnaissant comme une seule et même classe partageant les mêmes intérêts dans chaque partie du globe.
C’est une tâche immense, rendue encore plus difficile par la perte de l’identité de classe ces dernières décennies : ceux qui sentent qu’il y a quelque chose qui ne va pas du tout dans le système actuel, éprouvent des difficultés à accepter que la classe ouvrière existe bel et bien, sans même parler de l’oubli qu’elle seule détient la capacité de changer le monde.
Pourtant la révolution prolétarienne demeure le seul espoir pour la planète car elle signifie la fin de toutes les sociétés dans lesquelles l’humanité est dominée par des forces économiques aveugles, l’avènement de la première société dans laquelle toute la production est consciemment planifiée pour satisfaire les besoins de l’humanité dans son interaction avec la nature. Cela est basé sur la possibilité et la nécessité pour les êtres humains de prendre en main leur vie sociale.
C’est la raison pour laquelle nous devons nous opposer aux slogans et aux méthodes de ceux qui organisent les protestations actuelles pour le climat, nous exhortant à exercer nos droits démocratiques pour manifester ou voter afin d’exercer une pression sur les gouvernements et les partis politiques pour les contraindre à réagir face à la crise écologique. C’est une duperie parce que le rôle de tous ces gouvernements et partis (qu’ils soient de droite ou de gauche) est de gérer et défendre le système même qui est à la racine des multiples dangers auxquels fait face la planète.
Les choix que nous offrent les politiciens de tous bords sont de faux choix. Une Grande-Bretagne en dehors de l’UE ou une Grande-Bretagne qui resterait dans l’UE ne protégera pas la classe ouvrière des tempêtes qui planent sur l’économie mondiale. Une Amérique gouvernée selon le slogan agressif “America First” de Trump ou par des politiques “multilatérales” plus traditionnelles menées par d’autres factions, sera toujours une puissance impérialiste obligée de défendre son statut contre d’autres puissances impérialistes. Des gouvernements qui nient la réalité du changement climatique ou des gouvernements qui parlent d’investir dans un “New Deal Vert” seront toujours obligés de maintenir une économie nationale rentable et par conséquent, seront obligés d’effectuer des attaques incessantes contre la classe ouvrière. Ils seront toujours pris dans la même spirale de l’accumulation, laquelle est en train de transformer la Terre en un désert.
Mais, nous dit-on, nous pouvons au moins voter pour une équipe différente et, dans les pays où ce “droit” même est dénié, nous pouvons exiger qu’on nous l’octroie.
En fait, l’illusion selon laquelle nous pourions avoir le contrôle sur la force destructrice du capitalisme en allant voter à intervalles réguliers fait partie intégrante de cette grande escroquerie qu’est la démocratie capitaliste. Le vote, l’isoloir, ne nous retient pas seulement prisonniers des fausses alternatives que l’on nous offre, il est aussi l’expression de notre impuissance, nous réduisant à des individus atomisés, des “citoyens” de tel ou tel État.
La lutte de classe du prolétariat a montré la véritable alternative à cette impuissance institutionnalisée. En 1917-19, la classe ouvrière s’est révoltée contre le carnage de la guerre, en formant des conseils ouvriers en Russie, en Allemagne, en Hongrie et dans d’autres pays, des conseils de délégués élus et révocables sur leurs lieux de travail ainsi que d’autres assemblées ouvertes à tous qui, pour la première fois, contenaient la potentialité d’un contrôle conscient de la vie politique et sociale. Ce soulèvement international massif a mis fin à la guerre, alors que, de leur côté, les dirigeants des camps belligérants ont uni leurs forces pour écraser la menace de la révolution.
L’humanité a chèrement payé la défaite qui s’en suivit : toute la barbarie des cent dernières années prend sa source dans l’échec de la première tentative de renversement du capital mondial. Ce coût sera encore plus lourd si la classe ouvrière ne récupère pas ses forces et n’effectue pas de nouvelle tentative pour partir à l’assaut du ciel.
Cela peut sembler une perspective lointaine mais, tant que le capitalisme existera, la lutte des classes continuera. Parce que le capitalisme, dans son agonie, n’a pas d’autre choix que d’accroître l’exploitation et la répression de ses esclaves salariés, le potentiel demeure pour ses derniers de passer de la défensive à l’offensive, de la défense de ses intérêts économiques à l’action directement politique, de la révolte instinctive au renversement organisé du capitalisme.
CCI, 16 novembre 2019.
Récent et en cours:
- Ecologie [31]
Rubrique:
Le New Deal Vert ou la mascarade écologique du capitalisme
- 93 lectures
Les campagnes médiatiques sur le changement climatique opposent souvent l’urgente nécessité de stopper l’émission des gaz à effet de serre aux intérêts particuliers des travailleurs, voire aux “personnes les moins éduquées”. En France, ces campagnes se sont particulièrement développées lorsque les “gilets jaunes” protestaient au départ contre la taxe carbone qui rend les coûts de l’essence prohibitifs là où il n’y a pas de transports publics adéquats ou aux États-Unis contre le slogan “Trump aime le charbon et travaille pour lui !”, quand le président américain prétendait défendre l’industrie du charbon et les travailleurs qui en dépendent. La campagne pour un New Deal Vert (appelé aussi : révolution industrielle verte) prétend résoudre tout à la fois les problèmes du changement climatique, du chômage et des inégalités. Par exemple : “Le New Deal Vert défendu par les activistes du mouvement Sunrise éliminerait, en 10 ans, les gaz à effet de serre issus de la production d’électricité, du transport, de l’industrie, de l’agriculture et d’autres secteurs. Il viserait également une production d’énergie 100 % renouvelable et incluerait un programme de garantie d’emploi pour “assurer un travail avec un salaire décent à toute personne le désirant”. Il viserait à “atténuer les inégalités de revenus et de richesses principalement fondées sur l’appartenance raciale, régionale et sexuelle”.” (1)
La nécessité de remédier à l’effet destructeur du capitalisme sur la nature, en particulier au danger avec lequel les gaz à effet de serre modifient le climat, est indéniable. Tout comme l’augmentation de l’inégalité intrinsèque au capitalisme et le fait que les économistes indiquent déjà que la hausse de l’endettement ainsi que l’intensification de la guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine sont des signes annonciateurs d’une nouvelle récession. Tout cela ferait apparaître la prétendue solution du New Deal Vert comme une sorte d’évidence.
Trop beau pour être vrai…
Ceux qui mettent en garde contre les arnaques disent souvent que si une proposition semble trop belle pour être vraie, c’est qu’elle cache probablement un piège. C’est pourquoi il faut examiner de plus près le New Deal Vert : d’abord du point de vue de sa référence directe aux mesures capitalistes d’État du New Deal de Roosevelt dans les années 1930. Ensuite, nous verrons l’incapacité de l’État-nation capitaliste à résoudre un problème global, en considérant les conséquences d’une telle politique pour l’environnement. Plus important encore, il s’agira de montrer que cette politique sert en fait à masquer la véritable nature du capitalisme et a pour fonction de saper le développement de la conscience et de la lutte du prolétariat.
Le New Deal Vert trouve son inspiration dans la politique capitaliste d’État menée dans les années 1930 afin de relancer la croissance suite à la Grande dépression. (2) Le New Deal s’est lui-même inspiré de la prise de contrôle par l’État de l’économie durant la Grande Guerre en 1917-18 : tout en réalisant des investissements dans des infrastructures indispensables, l’Administration des Travaux Publics (PWA) a “construit de nombreux navires de guerre dont deux porte-avions ; l’argent provenait de l’Agence de la PWA. L’Administration des Travaux Publics a également construit des avions de guerre alors que la WPA (Work Projects Administration) construisait des bases militaires et des terrains d’aviation”.3 En cela, il n’était pas différent des politiques en vigueur à cette époque en Allemagne, quand de nombreuses autoroutes étaient construites en préparation de la guerre à venir.
Le changement climatique est un problème global et il ne peut pas être traité nation par nation et pourtant le New Deal Vert propose justement ceci : “Un New Deal Vert pour le Royaume-Uni…”, “L’Écosse occupe une place unique, au vu de son abondance en ressources renouvelables…” (4), “visant à éliminer pratiquement la pollution des gaz à effet de serre aux États-Unis…” (5) Ceci est un non-sens : même la mesure de la production de gaz à effets de serre est frauduleuse ; par exemple, 40 % de la consommation par le Royaume-Uni de marchandises dont la production émet des gaz à effet de serre n’apparaissent pas dans les chiffres nationaux du fait qu’elles sont importées. Le capitalisme pollue la planète entière et cela s’étend jusqu’au plus profond des océans et même dans les parties les plus reculées de l’Arctique.
Les idées simplistes d’une nouvelle croissance basée sur l’énergie verte semblent promettre un soutien à l’économie en s’appuyant sur l’augmentation des dépenses publiques mais elles ne sont fondées sur aucune véritable considération globale des effets de la destruction environnementale et sur les gaz à effet de serre qu’elles provoqueront. Passer aux énergies renouvelables requiert de grandes quantités de métaux de terres rares, dont l’extraction minière produirait une gigantesque pollution en Chine, pays dans lequel 70 % de ces métaux sont extraits. La production du lithium dans le désert d’Atacama au Chili a déjà détruit les lacs d’eau salée nécessaires aux flamants roses et a accaparé toutes les réserves d’eau douce, détruisant l’agriculture de la région. Pendant ce temps, deux firmes, Albemarle et SQM s’accusent mutuellement de bafouer la réglementation. Le cobalt doit maintenant être extrait du sol océanique, sans tenir compte de l’impact écologique (que l’on connaît très mal) que cela aura sur une partie du monde. Comme cela est nécessaire pour le développement des énergies renouvelables, c’est supposé être une “solution pour sauver la planète”. Si nous devons acheter de nouvelles voitures électriques, cela va sans nul doute soutenir l’industrie automobile mais qui a comptabilisé les émissions de gaz à effet de serre découlant d’une telle production ?
Pour comprendre comment la civilisation capitaliste peut-être aussi prédatrice avec le monde dont nous dépendons tous, il est nécessaire de saisir la nature du capitalisme lui-même.
Mentir sur la nature du capitalisme
Le Green New Deal promet de surmonter la destruction de l’environnement par le capitalisme, en particulier le changement climatique, par le biais de l’État bourgeois, mais cela n’est pas possible. Le capitalisme n’est pas lié à telle ou telle gestion politique gouvernementale dont les diverses lois pourraient être choisies ou modifiées au gré d’un vote parlementaire ; il est le résultat des contradictions historiques entre le développement des forces productives et les rapports sociaux de production. Un pas important à cet égard fût la séparation des producteurs de leurs moyens de productions, par exemple lorsque les paysans furent chassés de leurs terres pour être remplacés par des moutons pour les besoins de la plus lucrative industrie de la laine.
Cela a créé un système de production généralisée de marchandises, de production pour le marché. À la place des paysans qui pouvaient produire presque tout ce dont ils avaient besoin à partir de la terre, il y avait des travailleurs salariés qui ne pouvaient faire autrement que tout acheter. Les capitalistes pour lesquels ils travaillent (que ce soit un entrepreneur individuel, une compagnie, une multinationale ou une industrie d’État) sont en compétition pour vendre à profit. Le New Deal Vert ne peut changer en rien la façon dont le capitalisme fonctionne.
Le Capital offre une certaine ressemblance avec la légende du roi Midas : tout ce qu’il produit doit se transformer en profit pour que le business survive, tout étant calculé pour rapporter plus, peu importe ce qui est produit. Mais pour le Capital, les ressources naturelles sont un cadeau, comme Marx l’a démontré : “Les éléments naturels jouant un rôle actif dans la production sans rien coûter (quel que ce soit ce rôle) n’y entrent pas comme composantes du capital, mais comme une ressource naturelle offerte gratuitement au capital, c’est-à-dire comme une force productive offerte par la nature au travail mais qui, sur la base de l’économie capitaliste, se présente, ainsi que toute autre force productive, comme productivité du capital”. (6) Dans le capitalisme, ce qui ne coûte rien n’a pas de valeur d’échange et peut donc être utilisé et pillé à volonté. Dans cette perspective, une forêt tropicale irremplaçable n’a aucune valeur. Un fermier qui abat les arbres d’une forêt tropicale pour produire de l’huile de palme, du soja ou tout autre culture est obligé de le faire parce qu’il peut gagner plus d’argent de cette manière, voire parce que c’est l’unique façon pour lui d’avoir juste de quoi vivre. Dans le capitalisme, la question d’une activité économique servant les besoins de la nature et de l’humanité ne peut pas être posée, sauf si elle est source de profit.
Au XIXe siècle, lorsque le capital a étendu sa domination sur l’ensemble du globe, il polluait et détruisait déjà la nature. La pollution issue de l’exploitation minière et de l’industrie est un fait bien connu, tout comme celui des eaux usées s’écoulant des grandes villes. L’effet sur le sol l’est bien moins. “Dans l’agriculture moderne, de même que dans l’industrie des villes, l’accroissement de productivité et le rendement supérieur du travail s’achètent au prix de la destruction et du tarissement de la force de travail. En outre, chaque progrès de l’agriculture capitaliste est un progrès non seulement dans l’art d’exploiter le travailleur mais encore dans l’art de dépouiller le sol ; chaque progrès dans l’art d’accroître sa fertilité pour un temps, un progrès dans la ruine de ses sources durables de fertilité. Plus un pays (…) se développe sur la base de la grande industrie plus ce procès de destruction s’accomplit rapidement. La production capitaliste ne développe donc la technique et la combinaison du procès de production sociale qu’en épuisant en même temps les deux sources d’où jaillit toute richesse : la terre et le travailleur”. (7) Ce que Marx a démontré pour le XIXe siècle n’a fait qu’empirer. À la fin de ce même siècle, Kautsky pouvait écrire : “Les engrais permettent d’éviter la diminution de la fertilité des sols mais la nécessité de l’utiliser en quantités toujours plus grandes ne fait qu’ajouter un fardeau supplémentaire à l’agriculture ; fardeau non pas imposé inévitablement par la nature mais qui est le résultat direct de l’organisation sociale actuelle. En dépassant l’antithèse entre la ville et la campagne (…) la production pourrait revenir à la normale”. (8) Depuis, l’agriculture, tout comme l’industrie, s’est énormément développée, ses rendements et sa productivité ont augmenté sur une très grande échelle et les engrais nécessaires pour les maintenir sont devenus une véritable menace pour le sol et les cours d’eau.
Aussi polluant, meurtrier et exploiteur qu’ait été le capitalisme alors qu’il s’étendait à travers le monde, la période qui s’est écoulée depuis la Première Guerre mondiale a été marquée par une spirale de destruction de la nature et de la vie humaine. La Première Guerre mondiale fut suivie par la Seconde et des conflits locaux soutenus par de plus grandes puissances impérialistes se sont multipliés depuis.
Les capitalistes et les États ont été contraints à une concurrence économique et militaire encore plus féroce. La destruction de l’environnement a atteint alors de nouveaux seuils. Les entreprises capitalistes, qu’elles soient privées ou publiques, ont augmenté la pollution et le pillage des ressources de la planète à des niveaux sans précédents. Ce à quoi il faut ajouter la pollution et la destruction occasionnées par le secteur militaire et les guerres. (9)
Les menaces qui pèsent sur l’environnement, sur le climat, en un mot : sur la nature, ne peuvent être surmontées sans le renversement du capitalisme. Le New Deal Vert ne sera pas plus efficace pour les enrayer que les droits d’émission qui tentaient de limiter les émissions de gaz à effet de serre par des mécanismes de marché. Pire encore, en fournissant une fausse “solution”, il peut que répandre davantage d’illusions au sein de la classe ouvrière, prolongeant par conséquent la vie de ce système et faisant augmenter le danger qu’il ne sombre dans une barbarie et une destruction environnementale irréversibles.
Alex
1 “What is the Green New Deal and is it technically possible ? [32]”, The Guardian (29 décembre 2018).
2 Voir : “90 ans après la crise de 1929, le capitalisme en décadence peine de plus en plus à endiguer la surproduction [33]”, Révolution Internationale n° 479 (nov.-déc. 2019).
3 Source Wikipedia
4 New Economics Foundation [34].
5 “What is the Green New Deal and is it technically possible ? [32]”, The Guardian (29 décembre 2018).
6 Marx, Le Capital, Livre III.
7 Marx, Le Capital Livre I.
8 Kautsky, La Question Agraire, cité dans le livre de John Bellamy : Marx écologiste.
9 Voir : “Ecological disaster : the poison of militarism [35]”, World Revolution n° 384 (Automne 2019).
Récent et en cours:
- Ecologie [31]
Rubrique:
Nouvelle course à l’espace: un champ de bataille impérialiste pour le capitalisme
- 118 lectures
Le 20 juillet 1969, deux hommes marchaient pour la première fois sur la Lune. Cet exploit concrétisait un des rêves les plus audacieux de l’humanité, un dessein sans égal déjà imaginé par Lucien de Samosate, au IIᵉ siècle, par le poète Cyrano de Bergerac, plus tard, ou encore par Jules Verne. Mais avec le capitalisme, tout exploit, toute conquête a son revers. La mission Apollo 11 charriait dans son sillage un esprit de compétition et une mentalité belliqueuse qui, à l’échelle des États, se nommaient : impérialisme et “suprématie spatiale”. La militarisation de l’espace est une vieille obsession des grandes puissances. La course à l’espace fut, en effet, un enjeu crucial de la guerre froide entre Américains et Russes. Il fallait arriver sur la Lune les premiers et, si possible, les seuls (1).
La “course à l’espace” : une course à la militarisation
Ces programmes spatiaux avaient d’abord une utilité propagandiste : l’envoi du premier Spoutnik puis du premier homme dans l’espace, ont donné lieu à une communication triomphaliste de l’État soviétique. On peut du reste continuer à voir en Russie les restes du véritable culte voué à Youri Gagarine depuis son voyage autour de la Terre (2). L’envoi des trois astronautes d’Apollo 11 sur la Lune a évidemment été présenté comme le succès de l’avance technologique américaine.
Mais derrière la propagande, ces programmes spatiaux avaient une dimension militariste bien concrète. Le fait que tous les hommes destinés à partir dans l’espace étaient au départ des militaires (le premier civil à poser le pied sur la Lune sera Harrison Schmitt, en 1972… lors de l’ultime mission Apollo), la technologie des fusées utilisées aussi bien par les Américains que par les Russes était initialement celle des missiles intercontinentaux. La NASA fit appel à Wernher von Braun, que les Américains avaient débauché au Troisième Reich en 1945 suite au succès de sa V2 (3), pour concevoir la fusée américaine Saturn V utilisée pour aller sur la Lune. Les lanceurs soviétiques étaient également des copies peu à peu améliorées des V2 allemands. Le R-7, qui a placé Spoutnik 1 en orbite, n’était d’ailleurs rien d’autre qu’un missile intercontinental. Quant aux européennes, Anglais et Français ont aussi profité de la technologie allemande en procédant à des lancements de V2, puis, en ce qui concerne la France, au développement, sur cette base, de son propre lanceur, aboutissant à l’actuel : programme Ariane. Les États soviétique et américain ont donc d’abord construit des missiles permettant d’emporter des charges nucléaires avant de s’intéresser à l’exploration spatiale, rendue possible par l’existence des premiers.
D’ailleurs, les premiers satellites envoyés dans l’espace avaient une visée strictement militaire : les 144 satellites du programme américain Corona, débuté en 1959, avaient pour unique but d’espionner l’ennemi. En 1962, les États-Unis réalisent un premier essai nucléaire à 400 km d’altitude (Starfish Prime) tandis que les Russes, à partir de 1968, développeront leurs “satellites kamikazes” pour tenter d’éliminer les satellites espions américains. L’URSS réussira même à mettre en orbite deux stations spatiales secrètement armées de canons automatiques (Saliout 3 en 1974 et Saliout 5 en 1976).
Lors de la présidence Reagan, l’armée américaine promut “l’Initiative de Défense Stratégique” popularisée sous le nom de Star Wars. Le but de ce programme militaire était de pouvoir intercepter des missiles balistiques dont la trajectoire (comme le V2) sort de l’atmosphère terrestre. Des armes bien réelles ont ainsi été développées à cette époque, comme le missile anti-satellite ASM-135 ou le système antimissile Patriot, déployé notamment pendant la guerre du Golfe. Si l’URSS a tenté de suivre, elle a très vite renoncé, tant les moyens mis en place par les Américains étaient énormes : douze milliards de dollars sur cinq ans ont permis de faire travailler jusqu’à 30 000 scientifiques sur ces projets. L’avance technologique qui en a résulté a permis aux États-Unis de dominer de façon outrancière leurs rivaux impérialistes dans le domaine spatial. L’effort fourni à cette occasion par l’URSS n’a pas été pour rien dans sa ruine, ce qui a abouti à son effondrement économique et politique en 1990.
Une nouvelle course à la militarisation de l’espace
Aujourd’hui, divers signaux montrent que les principales puissances impérialistes s’intéressent de plus en plus à l’espace comme champs de bataille possible dans l’affrontement qui les oppose. On pourrait n’y voir qu’un simple enjeu technologique et scientifique, mais les acteurs de cette course, quand ils en parlent ouvertement, voient les choses beaucoup plus “stratégiquement” : “Et face aux querelles incessantes qui règnent dans le spatial européen et français, Tomasz Husak (…) a estimé que “vu les enjeux stratégiques, nous ne pouvons pas nous permettre d’avoir des divisions”. À bon entendeur… D’autant que les États-Unis et la Chine, au-delà des questions de souveraineté, participent à une véritable guerre commerciale en développant leurs capacités spatiales (lanceurs, applications…). L’Union européenne en a bien pris conscience en pariant fortement sur le spatial, avec un budget en hausse constante : cinq milliards d’euros en 2007, puis treize milliards en 2018 et enfin seize milliards en 2027”. (4)
Aujourd’hui, en plus des Russes, des Américains et des Européens, il y a d’autres acteurs nouvellement arrivés dans la compétition spatiale : l’Inde et la Chine ont montré leurs ambitions dans ce domaine… en démontrant leur capacité à détruire un satellite en orbite. En lançant un satellite capable de changer d’orbite pour se rapprocher d’autres satellites, la Russie a suffisamment inquiété certains autres États pour qu’ils réagissent, comme l’a fait la France en se dotant d’un commandement spatial autonome [36], dont le but avoué est de protéger les satellites tricolores : “On s’est aperçus, avec cette intrusion, qu’on était vulnérables, résume Stéphane Mazouffre. Et c’est d’autant plus vrai que l’Europe n’a pas développé de système de destruction de satellite depuis le sol. En mars 2019, c’est l’Inde qui est devenu le quatrième pays [37] à détruire, par missile, un de ses satellites en orbite basse”. (5)
Le général Friedling, qui dirige le commandement français interarmées de l’espace, a bien précisé lors d’une interview qu’il n’est pas illégal d’installer des armes dans l’espace “à des fins non-agressives” (6). Quand on sait que les États les plus développés dépendent pour 6 ou 7 % de leur PIB de la technologie de positionnement satellitaire américaine GPS, on comprend quel intérêt il y a pour eux à protéger leurs satellites et leurs communications spatiales !
L’exploration “pacifique”, masque hypocrite de la militarisation de l’espace
Évidemment, quand la bourgeoisie développe une stratégie ouvertement agressive, surtout dans un domaine spatial qui n’apparaît pas stratégique au premier abord, elle développe aussi toute une propagande pour le masquer. En France, tel a été le rôle, conscient ou pas, du spationaute Thomas Pesquet, qui a servi de tête de gondole à toute une propagande étatique montrant le côté le plus “pacifique” de l’activité spatiale des grandes nations. Outre le fait que l’équipage de la Station spatiale internationale (ISS) a toujours été très international, les liaisons avec les écoles, les expériences scientifiques en direct et les nombreuses photos de la Terre prises par Thomas Pesquet ont donné une image très “pacifique” et “désintéressée” de l’activité spatiale actuelle. (7) L’implication du président Macron et l’accueil officiel qu’il a reçu lors de son retour illustrent néanmoins toute l’opération de communication de l’État derrière cet épisode. L’exploration de la Lune et de Mars pose beaucoup d’enjeux purement scientifiques, mais aussi des questions nettement plus prosaïques, notamment celle de la propriété du sol et des ressources que l’on pourrait éventuellement extraire des sols lunaire et martien.
On a vu depuis les années 2000 fleurir les projets plus ou moins fantaisistes de “tourisme de l’espace”, ainsi que d’exploitation pure et simple des ressources minières des astéroïdes, voire de la Lune et de Mars. Divers pays se sont même dotés, à tout hasard, d’une législation propre sur la propriété des objets célestes (8). Le but est d’établir un support juridique à l’éventuelle prospection minière dans l’espace. Un certain nombre d’entreprises et de milliardaires comme Richard Branson se sont proclamés intéressés par ces opportunités et par la création d’un tourisme spatial, mais un certain nombre d’éléments montrent qu’il ne s’agit en réalité que d’un mirage. La société Virgin Galactic, dont la fondation date quand même de 2004, est toujours incapable de réaliser concrètement ce pour quoi elle a été créée, à savoir envoyer des “touristes” en orbite terrestre. Si la création d’un “avion orbital” capable de suivre une trajectoire sortant de l’attraction terrestre est possible, expédier des touristes sur la Lune est une toute autre histoire : même la future fusée de la NASA ne pourra pas emporter plus de quatre passagers ! Pourtant, spatialement parlant, la Lune, ça n’est pas loin ! En fait, techniquement, rien n’est prêt.
Si un “tourisme spatial” apparaît chimérique, que dire d’une exploitation des ressources minières de l’espace ? Pour exploiter de chimériques ressources naturelles spatiales, il faudrait expédier des ouvriers en nombre dans l’espace, avec un matériel particulièrement sophistiqué et donc coûteux. La rentabilité d’une telle opération apparaît par conséquent totalement illusoire, d’autant que techniquement tout reste à inventer. Ce n’est de toute façon pas cette activité qui peut régler les problèmes du capitalisme : ce qui manque, ce ne sont pas les matières premières, mais les clients !
Enfin, un récent rapport indépendant, publié en février 2019, a conclu que dans les conditions actuelles, il n’y a ni but précis, ni capacité technique, ni financement prévu pour envoyer des hommes sur Mars d’ici… 2033 ! “Nous constatons que, même sans contraintes budgétaires, une mission orbitale Mars 2033 ne peut être planifiée de façon réaliste dans le cadre des plans actuels et théoriques de la NASA”(9). Quand on sait que ledit rapport chiffre à 217 milliards au bas mot le coût d’un programme spatial vers Mars, on comprend l’ampleur de l’effort demandé à l’économie américaine alors que les perspectives économiques mondiales s’assombrissent de jour en jour. Quant à la raison qui pousserait effectivement l’agence spatiale américaine à planifier une expédition martienne, le rapport conclut… qu’il n’y en a pas !
Il est du reste cocasse de constater que les problèmes de coûts n’épargnent aucunement l’industrie spatiale “pacifique” : le budget de la NASA, qui représentait 4,5 % du PIB américain en 1966, n’en représente plus que 0,5 %. L’Inde a lancé en septembre dernier un atterrisseur lunaire dont la principale caractéristique était son bas coût (six fois inférieur à un programme identique développé par la Chine). L’échec de l’alunissage, précédé par un nombre impressionnant de reports de lancement [38] dus à divers incidents, montre que faire beaucoup avec trop peu n’est pas vraiment une stratégie payante dans l’espace… Loin de doper l’économie, ces projets non seulement coûteraient une fortune sans rien rapporter, mais ils sont d’ores et déjà soumis au “low cost” qui gangrène toute l’économie capitaliste.
De tout cela, nous ne pouvons conclure qu’une chose : les perspectives scientifiques et “pacifiques” que les États développés nous font miroiter pour la conquête du système solaire ne sont que propagande ! Ce qui est par contre bien réel et mis en perspective, c’est tout l’intérêt de disposer d’un dispositif de satellites militaires dans le cadre d’un affrontement impérialiste.
De fait, l’espace est un enjeu essentiellement militaire et stratégique : espionnage, télécommunications, repérage GPS, communications militaires, tout concours à faire de l’espace le champ très actuel des opérations stratégiques des grands impérialismes. “L’espace est déjà militarisé, prévient Stéphane Mazouffre, directeur de recherche au laboratoire Icare du CNRS, à Orléans-La Source. Tous les pays ont des satellites espions, des satellites de télécommunication dédiés au militaire, qui utilise aussi les systèmes GPS… Un satellite en lui-même, c’est une arme. Pourquoi ? Pourquoi ? Parce que s’il peut se déplacer, il suffit de le rapprocher d’un satellite ennemi pour perturber l’orbite de ce dernier et le rendre inopérant. Le simple fait de pouvoir amener un satellite près d’un autre peut être considéré comme une possibilité d’attaque” (10). Tout le positionnement d’une armée, du simple soldat jusqu’aux bombardiers stratégiques, dépend du système GPS ou de son concurrent européen Galileo. Toutes les communications sécurisées passent par des satellites qu’il faut par conséquent protéger, au risque de se retrouver totalement désarmé face à l’adversaire. On comprend donc dans cette optique pourquoi tous les grands États se dotent d’une organisation militaire spécifiquement spatiale dotée d’un budget propre. L’effondrement de la politique de blocs et le développement du « chacun pour soi » ont largement favorisé le fait que de nouveaux acteurs cherchent constamment à mettre le pied dans ce domaine vital pour leurs propres ambitions impérialistes. Ces intentions sont très claires côté français qui bénéficie d’une expérience plus ancienne11: “La loi de programmation militaire française (LPM) 2019-2025 prévoit un budget de 3,6 milliards d’euros pour le spatial de défense. Il doit notamment permettre de financer le renouvellement des satellites français d’observation CSO et de communication (Syracuse), de lancer en orbite trois satellites d’écoute électromagnétique (Ceres) et de moderniser le radar de surveillance spatiale Graves”. (12)
Le Capital fait la guerre partout, y compris dans l’espace
Comme on le voit, et malgré les déclarations d’intention lénifiantes, l’espace est depuis longtemps le champ des rivalités entre grands requins impérialistes et il est aujourd’hui plus que jamais un élément-clé de l’affirmation de leur puissance militaire. Au-delà même des visées économiques étalées par la propagande bourgeoise et par certains opérateurs privés (tourisme spatial, extraction de minéraux sur des astéroïdes, exploration planétaire, retour pérenne sur la Lune), qui constituent en elles-mêmes une composante de l’impérialisme, il fait aussi l’objet d’une intense bataille pour la protection de l’avance technologique des grandes puissances vis-à-vis d’éventuels nouveaux concurrents. Mais par dessus tout cela, l’enjeu réel de la militarisation de l’espace ne peut être que la préparation de futurs conflits.
“Le capitalisme porte la guerre comme la nuée porte l’orage”, disait Jaurès. Il ne pouvait pas imaginer que le capital, loin de se contenter de la terre et du ciel, irait un siècle plus tard porter la guerre et le militarisme encore plus haut que les nuages, et que la nécessité de détruire ce système pour arrêter cette militarisation de l’univers ne s’en trouverait que plus urgente.
H. D. ,10 février 2020
1 Cf. “Apollo 11 et la conquête de l’espace : une aventure sans lendemain [39]”, Revue Internationale n° 139 (4ᵉ trimestre 2009).
2 Le culte voué à Gagarine par le complexe militaro-spatial russe est d’ailleurs moqué dans la bande dessinée de Marion Montaigne publiée en 2017 : Dans la combi de Thomas Pesquet, elle-même vouée, même si humoristiquement, à la personnalité du dernier spationaute français…
3 La V2 était un missile développé par l’Allemagne nazie durant la Seconde Guerre mondiale. L’avantage recherché par l’Allemagne lors de la création du V2 était le fait que ce missile sortait de la stratosphère au cours de sa trajectoire, ce qui rendait son interception impossible.
4 “L’espace, un enjeu stratégique et vital pour la compétitivité de l’Union européenne [40]”, La Tribune (27 juin 2018).
5 “Militarisation de l’espace : Un satellite, en lui-même, c’est une arme [41]”, France 3 Centre-Val de Loire (26 juillet 2019).
6 “La France pourrait envoyer des armes dans l’espace [42]”, Le Point (18 mars 2019).
7 C’est d’ailleurs ce qui est très explicitement développé dans la bande dessinée : Dans la combi de Thomas Pesquet, qui retrace tout son périple spatial.
8 Les États-Unis en 2015, le… Luxembourg en 2017 !
9 Cité par : “Independent report concludes 2033 human Mars mission is not feasible [43]”, Spacenews (18 avril 2019).
10 “Militarisation de l’espace : Un satellite, en lui-même, c’est une arme [41]”, France 3 Centre-Val de Loire (26 juillet 2019).
11 Depuis la politique gaulienne « d’auto-détermination » en matière de « force de dissuasion nucléaire » parallèle mais aussi en marge de l’OTAN. La creation du Centre National d’Etudes Spatiale (CNES) en 1961 en est illustration et, même si celui-ci s’est ensuite intégré dans un cadre européen dans les années 1970, la France est restée le membre le plus actif de l’Agence spatiale européenne.
12 “La France passe à l’offensive dans l’espace [36]”, Le Figaro (14 juillet 2019).
Récent et en cours:
- Course à l'espace [44]
Questions théoriques:
- Impérialisme [45]
Rubrique:
ICCOnline - mars 2020
- 112 lectures
Extinction Rebellion: Un auxiliaire du système capitaliste
- 153 lectures
Extinction Rebellion (XR) organise régulièrement de brèves actions de «rébellion internationale», dans un certain nombre de villes du monde. Il peut s’agir de manifestations, d’occupation de carrefours routiers, de l’arrestation et, généralement, de monter des opérations spectaculaires dans des lieux publics pour faire connaître l’état critique dans lequel se trouve l’écologie à l’échelle mondiale.
Les réactions aux actions de XR ont été mitigées. Ainsi, les médias s’accordent à dire qu’Extinction Rebellion attire l’attention sur d’importants sujets, mais désapprouvent leur façon de faire. Extinction Rebellion bénéficie également d’un soutien sans faille de la part de célébrités et de gauchistes. Le Socialist Workers Party (trotskyste) encense "les personnes bravant les arrestations et les attaques médiatiques avec des démonstrations brillantes de créativité et de résistance". "Ils suscitent des demandes pour une transformation radicale de la société et créent un espace de luttes pour cela."
Le soutien de XR à l'État
Leur publication Commun Sense paraît s’opposer en paroles à ce qu’il appelle « les réformistes » : «Ils offrent des solutions gradualistes qui, selon eux, fonctionneront... Ils cherchent donc à dévoyer l'opinion populaire et à détourner l’attention et l’énergie du public de la tâche à accomplir : entreprendre une action collective radicale contre le régime politique qui planifie notre suicide collectif. " Ainsi XR pense que toutes les autres questions sociales doivent être suspendues jusqu'à ce que le capitalisme s'engage à affronter directement «l'urgence climatique». La préoccupation centrale de XR est l'environnement et la possibilité que l'État capitaliste puisse empêcher l'éco-génocide par l’imposition de taxes et de tarifs ou encore le bannissement de technologies nuisibles. En théorie et en pratique, ils cherchent à polariser l'attention sur l'écologie en tant que problème particulier et occultent l’existence du capitalisme en tant que système mondial qui donne lieu à la guerre impérialiste aussi bien qu'à la déprédation écologique.
L'approche de XR envers l'appareil répressif de l'État capitaliste est un bon exemple de ce qu’il incarne dans la pratique. Selon Common Sense, «une approche ‘positive active’ envers la police est un moyen efficace de permettre une désobéissance civile de masse dans le contexte actuel. Cela consiste à rencontrer la police dès son arrivée sur les lieux en lui disant clairement deux choses : « il s'agit ici d'une action pacifique non violente » et "nous respectons le fait que vous devez faire votre travail ». Nous avons rapporté maintes fois des preuves que cela apaisait les policiers, ouvrant ainsi la voie à des échanges ultérieures y compris dans les commissariats. » XR se targue d'être raisonnable et coopératif´ : "Souvent, une rencontre directe avec la police est efficace car celle-ci est capable de comprendre que les personnes auxquelles elle a affaire sont des personnes raisonnables et avec lesquelles on peut communiquer." XR ne voit donc aucun problème dans la gestion des « événements XR » par la police : "Il vaut mieux que la police gère ainsi un épisode ordonné et peu coûteux qui est tout à fait compatible avec notre intérêt à ce qu'un grand nombre de personnes participent à un acte hautement symbolique et dramatique." Du point de vue de la classe dirigeante, les XR ne sont pas considérés comme une menace pour ceux qui sont au pouvoir, mais plutôt comme un obstacle occasionnel au trafic.
Certes, les dirigeants de XR ne voient pas non plus la police comme une menace ; au contraire, les forces de répression et les multiples arrestations sont utilisées afin de renforcer l'impact publicitaire de XR. L'expérience historique des exploités et des opprimés montre que la police, avec les tribunaux, les prisons, les services de sécurité et l'armée, font partie intégrante de l'appareil de répression de l'État capitaliste. Ils n'existent que pour défendre les institutions de la classe dirigeante, dans l'intérêt de la bourgeoisie exploiteuse. Tout ce qui menace l'ordre capitaliste sera combattu par la force de l'État, en particulier par la police.
Extinction Rebellion contre la révolution
XR prétend être le défenseur d'une sorte de « révolution », tout en mettant en avant qu ' « une poursuite dogmatique de modèles révolutionnaires discrédités peut être socialement ruineuse». Son cofondateur Hallam est si confiant que la «planification» de XR est la clé de voûte de « sa lutte » qu’il affirme que, sans elle, «nous nous retrouvons avec des soulèvements spontanés et incontrôlés (…) dont les expériences ont démontré qu’elles aboutissent généralement à des résultats autoritaires et à une guerre civile». Hallam répète un mantra capitaliste de base, l'idée selon laquelle les révolutions conduisent à des régimes autoritaires et / ou au chaos social. Contre cela, les marxistes ont toujours montré que la seule force révolutionnaire dans la société capitaliste est la classe ouvrière, et qu’une révolution prolétarienne est le seul processus qui puisse renverser l'État capitaliste. Common Sense a une toute autre vision du monde.
Il existe un certain nombre d'éléments différents qui font partie de la conception exprimée par XR sur « rébellion ». Hallam déclare que "Le dossier historique montre que les " épisodes de résistance civile réussis durent entre trois et six mois" ou encore que "l'acte le plus efficace de désobéissance civile de masse est d'avoir un nombre important de personnes (au moins 5 000 à 10 000 au départ) qui occupent des espaces publics dans une capitale de plusieurs jours à plusieurs semaines. » Tout cela va de pair avec l’idée qu’"1% de la population générale dirigera le soulèvement." L'un des 10 principes de base de XR se concentre sur "la mobilisation de 3,5% de la population pour réaliser un changement de système". En réalité, la société capitaliste a plongé l'humanité dans une impasse meurtrière et il n'y a pas d'autre issue qu’une mobilisation massive et radicale de la classe exploitée et le changement le plus gigantesque de la conscience qu’ait connu l'histoire humaine. Ne compter que sur une petite minorité pour mener à bien cette tâche se moque de l'énorme défi auquel est confrontée la classe ouvrière.
XR est totalement à l'aise avec les institutions de la domination bourgeoise. ils avaient en effet pris position lors des élections européennes de 2019. Bien évidemment, ils prétendaient ne pas être un parti politique, mais ils étaient ravis de se tenir aux côtés de tous les autres politiciens bourgeois vendant leurs marchandises idéologiques, avec la propagande sur le climat qui s’intégrait au nationalisme, au populisme, au racisme, au stalinisme et à toutes les autres mystifications bourgeoises. À différentes reprises, Common Sense a proposé effectivement divers organismes qui pourraient participer au «changement social». Par exemple, il y a l'idée d'une «Assemblée nationale des citoyens sélectionnée par tirage au sort pour élaborer le programme de mesures afin de faire face à la crise. Il est représentatif de la composition démographique du pays. » Une chose que le gouvernement conservateur du Royaume-Uni lui-même préconise. Des lettres ont été envoyées à 30 000 ménages à travers le Royaume-Uni invitant ces derniers à se regrouper en une assemblée de citoyens sur le changement climatique. Mais ces propositions ne sauraient constituer une base pour le «changement de la société» puisqu’elles sont parfaitement en harmonie avec les autres institutions de la démocratie bourgeoise. De telles assemblées inoffensives contrastent avec les assemblées et conseils créés par la classe ouvrière au cours de son histoire dans le but de défendre ses intérêts, et qui ont seuls, en définitive, la capacité de renverser le capitalisme.
Pour prendre des décisions responsables, nous n'avons pas besoin de délégués choisis de manière aléatoire dans l’ensemble de la population. Les prolétaires qui luttent contre ce système ont besoin de délégués qui ont des idées claires, qui sont une émanation de la conviction et de l’orientation à donner pour s'attaquer aux racines des mécanismes destructeurs du capitalisme. Nous ne pouvons pas remettre notre destin entre les mains d'une sélection de délégués tirés au sort : nous devons pouvoir faire confiance à des délegués élus et révocables à tout moment par les conseils pour défendre vraiment nos intérêts. En outre, comme ces délégués ne peuvent fonctionner que comme l'expression d'une classe en mouvement, de véritables conseils ouvriers peuvent créer un «rapport de force» qui repousse les attaques de la classe dirigeante et préparer le terrain pour son renversement.
Parmi les autres propositions de Hallam, figurent des assemblées populaires qui discuteront des questions écologiques. Contrairement à l'auto-organisation de la classe ouvrière et à la discussion au sein d'une classe associée, dans les assemblées de Hallam, "des experts du monde entier peuvent aider à former des facilitateurs et à produire des ordres du jour." Nous sommes ici en présence d’organes dirigés par des «experts», des « élites » pour former des «facilitateurs» et fixer des ordres du jour, sans intention de menacer l'ordre existant.
Alors que XR prétend vouloir changer la société, en réalité tout son projet reste dans les limites de ce système et vise à assurer sa préservation. Il ne veut pas renverser l'appareil de la démocratie capitaliste. Fondamentalement, la liste des éco-demandes de XR est tout à fait envisageable dans le cadre de l’Etat-nation et dans le système social actuel. Il s’agit seulement de faire avaler la mystification selon laquelle malgré la «corruption» du système politique, la «classe politique» est capable de négocier et de démanteler tout ce qui est nuisible à l'environnement.
Des intérêts de classe différents, des valeurs différentes
Dans Common Sense, il y a beaucoup de conseils sur la façon d'aborder les médias. Implicitement, tout au long de sa brochure, émerge un sens des valeurs. Il y est affirmé que "des mots comme l'honneur, le devoir, la tradition, la nation et l'héritage doivent être utilisés à chaque occasion." Nous pouvons y lire comment utiliser "les discours de Martin Luther King comme un excellent exemple de la façon de récupérer les cadres de la fierté nationale." Depuis sa fondation en avril 2018, XR s'est propagé depuis Royaume-Uni jusqu’à un certain nombre d'autres pays. Mais bien qu'il ait une présence internationale, ses perspectives sont liées à l'État-nation, cadre du capitalisme, car XR ne voit aucun problème de revendiquer «une fierté nationale». Au contraire, il est pleinement favorable à la renaissance de valeurs telle que la fierté nationale, qui fait partie intégrante de l'idéologie bourgeoise.
Il y a une inquiétude généralisée, en particulier chez les jeunes, sur l'état de la planète, mais aussi une volonté de réagir contre le futur proposé par le capitalisme. Cependant XR fournit une idéologie et un calendrier de manifestations visant à récupérer ces préoccupations et les énergies militantes afin de les mener sur un terrain inoffensif pour le capitalisme et le déclin environnemental. Comme avec la propagande des partis verts au cours des 40 dernières années, ou comme les campagnes plus récentes autour de Greta Thunberg, c'est un mensonge dangereux de prétendre que le capitalisme peut s'attaquer à l'état de l'environnement.
Toutes les preuves montrent que, loin de réagir, le capitalisme montre des signes de plus en plus manifestes de sa propension à entraîner toute l’humanité dans la destruction. Les intérêts de la classe ouvrière sont antagonistes au capital et ne peuvent être satisfaits au sein de cette société. L'état de la planète Terre ne peut être amélioré que par le renversement du capitalisme par le prolétariat. Cela ne peut pas être accompli par une minorité, quelle que soit sa détermination. Cela nécessite une conscience politique qui dépasse largement la préoccupation des problèmes environnementaux. Le temps n'est pas du côté de la classe ouvrière, mais les actions de campagnes comme celles de XR prolongent activement la vie du système capitaliste.
Une réponse commune des écologistes radicaux à ceux qui insistent sur le fait que seule la révolution mondiale peut surmonter les problèmes posés par le capitalisme est : nous n'avons pas le temps pour cela. Mais l'idéologie de XR, comme d’autres mouvements «radicaux» similaires, agit précisément comme un moyen de canaliser les préoccupations concernant l'environnement dans des impasses bourgeoises, elle constitue en définitive un frein réel au développement de la conscience de classe et donc au potentiel d'une révolution authentiquement prolétarienne.
Barrow, janvier 2020
Rubrique:
Épidémie du coronavirus: une preuve supplémentaire du danger du capitalisme pour l’humanité
- 345 lectures
L’émergence de ce nouveau virus et la réaction de la bourgeoisie montrent à quel point le développement des forces productives se heurte à la mort et à la destruction causées par le capitalisme. Ainsi, alors que la Chine est devenue la deuxième puissance économique mondiale, elle a été lourdement frappée par une épidémie virale. Alors que la science médicale progresse, le capitalisme ne peut protéger sa population des maladies, pas plus qu’il ne peut le faire contre la crise économique, la guerre ou la pollution.
Le Covid-19 est l’une des nombreuses nouvelles maladies infectieuses qui ont fait leur apparition, en particulier au cours des cinquante dernières années, avec notamment le VIH (SIDA), Ebola, le SRAS, le MERS, la fièvre de Lassa, le Zika. Comme tant de nouvelles maladies liées aux changements provoqués par le capitalisme aujourd’hui, le Covid-19 est une infection virale d’origine animale qui a migré d’une espèce à l’autre, infectant les gens en se propageant très rapidement. Nous avons des chaînes d’approvisionnement et une urbanisation de plus en plus globales : pour la première fois dans l’histoire, la majorité de la population mondiale vit dans des villes, souvent entassée avec des infrastructures d’hygiène inadéquates. Comme en Chine, de nombreux travailleurs ne sont pas seulement concentrés dans les villes mais aussi dans des dortoirs d’usine surpeuplés, comme les travailleurs de Foxconn qui vivent à huit dans une pièce. Dans un tel contexte, l’utilisation de viande d’animaux sauvages, comme à Wuhan, où probablement un marché illégal de ces animaux sauvages a éte la source de la nouvelle infection, le risque s’avère très élevé. En outre, la destruction de l’environnement et les effets du changement climatique poussent de plus en plus d’animaux, à la recherche de nourriture, vers les villes. Ces dernières, déjà surpeuplées, sont un terrain propice aux épidémies, comme le montre l’exemple de Wuhan. De plus, le développement considérable des liens internationaux favorise la transmission à l’étranger.
Ces conditions sont bel et bien le résultat du capitalisme décadent qui est poussé à perturber et à polluer chaque coin de la planète pour faire face à sa crise de surproduction. L’impact destructeur de son expansion mondiale avait déjà été clairement démontrée lors de la Première Guerre mondiale, signe de son de déclin historique. Dès la fin de la guerre, la pandémie mortelle de grippe espagnole surgissait, infectant environ un tiers de la population mondiale, tuant plus de 50 millions de personnes en trois phases successives. Le taux de mortalité très élevé était lié aux conditions de la guerre impérialiste, notamment à cause de la faim, de la malnutrition, du manque d’hygiène et du déplacement des soldats malades dans les tranchées, ce qui a fait de ce virus un agent pathogène particulièrement mortel.
Plus récemment, le VIH a tué 32 millions de personnes, principalement en Afrique, et il est désormais devenu endémique. Malgré les progrès médicaux qui ont fait du VIH une maladie chronique au lieu d’une maladie mortelle, le SIDA a tué 770 000 personnes en 2018 [46] en raison du manque d’accès aux soins. De nombreuses autres maladies que la science médicale peut prévenir, continuent de provoquer des pathologies et des décès. Nous entendons parler des cas de rougeole aux États-Unis, peut-être à Samoa, et de l’importance de l’immunisation pour prévenir sa transmission. Mais les médias restent muets sur les quelque 300 000 cas de cette maladie en République démocratique du Congo, (RDC) où près de 6 000 enfants sont morts, et où des établissements de soins délabrés tentent également de faire face au virus Ebola. Ces décès ne présentent pas un grand intérêt pour la classe dirigeante car, contrairement à la pandémie de grippe porcine de 2009 ou à l’actuelle épidémie de Covid-19 en Chine, ils ne menacent pas sa production, ses échanges et ses profits dans la même mesure. Cependant, le capitalisme est responsable des conditions qui donnent naissance à ces épidémies : dans ce cas africain, celui d’une région instable, produit du découpage du continent par les puissances impérialistes européennes, constamment ravagé par des luttes pour ses ressources naturelles (or, diamants, pétrole et cobalt) et qui ont déjà fait des millions de morts, 50 % des exportations de la RDC sont destinées à la Chine. C’est un exemple particulièrement frappant de ce que nous entendons par la décomposition du capitalisme, période pendant laquelle la classe dirigeante n’a pas suffisamment de contrôle pour apporter autre chose aux populations, en plus d’une misère croissante, que des guerres toujours plus chaotiques. (1)
La persistance de la polio est également directement liée à la décomposition, lorsque les combats ou le fondamentalisme empêchent l’immunisation, les travailleurs de la santé étant assassinés par des djihadistes, comme par exemple au Pakistan. Toute médiatisation à ce sujet est totalement hypocrite. Les grandes puissances qui condamnent cela sont parfaitement disposées à utiliser des mercenaires et des terroristes – comme l’Occident a utilisé les moudjahidines en Afghanistan contre les Russes dans les années 1980 et depuis lors dans de nombreux autres conflits. En fait, la montée du terrorisme est une caractéristique des conflits impérialistes en période de décomposition.
En attendant, loin de pouvoir financer la santé ou l’éducation, les dépenses mondiales du capitalisme ne peuvent que se consacrer à la défense : en 2019 ces dépenses militaires ont augmenté de 4 % par rapport à 2018. Pour les États-Unis et la Chine, elles ont augmenté de plus de 6 % et pour l’Allemagne de plus de 9 %. Pour donner une idée des priorités effrayantes de la bourgeoisie, alors que le budget du CDC (en français, le Centre de Contrôle des Maladies) aux États-Unis a été réduit, passant de 10,8 milliards de dollars en 2010 à 6,6 milliards de dollars en 2020, les États-Unis viennent de voter un budget de réarmement de 738 milliards de dollars. Le budget annuel de la Chine pour la défense est estimé à 250 milliards de dollars. Le budget de l’OMS n’était que de 5,1 milliards de dollars en 2016-2017.
Mensonges et irrationalité
De nombreuses maladies causent actuellement plus de décès que le Covid-19, mais la bourgeoisie prend cette menace au sérieux, comme elle le fait pour chaque nouvelle maladie susceptible de devenir une pandémie et donc de menacer davantage sa productivité et ses profits, par exemple avec des absences accrues pour cause de maladie – ce que nous constatons avec ce nouveau virus en Chine – ainsi que par des menaces pour la santé et les vies humaines. De nombreux aspects de la maladie peuvent contribuer à son potentiel pandémique – l’infectiosité, la nature de la maladie. Il est significatif qu’elle soit apparue dans une grande ville de 11 millions d’habitants, dans un pays qui est désormais fortement connecté au niveau international pour le commerce et le tourisme, ce qui rend beaucoup plus difficile la maîtrise de la propagation du virus. Plus difficile à contenir que s’il était apparu, comme le virus Ebola, en Afrique avec beaucoup moins de possibilités de voyages à l’étranger, ou s’il était apparu en 2003, comme l’épidémie de SRAS, lorsque l’économie et les connexions de la Chine étaient plus réduites.
Une grande partie de la réponse initiale de l’État chinois à ce nouveau virus a été marquée par une négligence criminelle et un manque de scrupules. Alors qu’elles avaient déjà obtenu le 26 décembre des données génétiques préliminaires indiquant un virus de type SRAS, les autorités chinoises harcelaient le Dr Li Wenliang « coupable » d’avoir voulu avertir du danger encouru le 30 décembre. Dans le même temps, elles mettaient en garde l’OMS contre le virus. Néanmoins, les autorités de Wuhan ont continué à étouffer l’information sur l’épidémie, organisant un énorme repas communal et une danse du Nouvel An lunaire les 18 et 19 janvier, en prétendant qu’elle ne se transmettait pas de personne à personne, avant de fermer la ville le 23 janvier, alors que 5 millions de personnes, soit près de la moitié de la population, étaient déjà parties en voyage pour les vacances du Nouvel An.
Tout cela a suscité une énorme colère au sein de la population, exaspérée que le gouvernement cache les dangers de la maladie au public et fasse signer à un médecin de faux aveux pour avoir « répandu des rumeurs » en mettant en garde les autorités. Cela a engendré une campagne démocratique pour la liberté d’expression en Chine. Les médias et les politiciens des pays occidentaux se sont fait l’écho de cette campagne par des sermons sur les bienfaits de la démocratie et de la liberté d’expression. Cependant, nous ne devons pas penser un seul instant que notre propre classe dirigeante a de plus grands scrupules moraux à mentir et à dissimuler des informations quand cela l’arrange, même si cela met la vie humaine en danger. Les sociétés pharmaceutiques suppriment les essais cliniques qui mettent leurs profits en danger, même si cela signifie ne pas avertir que certains antidépresseurs présentent un risque de suicide accru pour les adolescents et les jeunes adultes (voir Bad Pharma de Ben Goldacre, un livre consacré à la dénociation de cette malhonnêteté). Et n’oublions pas par ailleurs que les gouvernements américain et britannique ont tristement menti sur les armes de destruction massive pour justifier l’invasion de l’Irak en 2003.
L’État chinois a cyniquement placé de sang-froid son souci de préserver son autorité bien au dessus de la préoccupation de la santé et de la vie de la population, cela, aggravé par la rigidité de sa bureaucratie stalinienne, l’a conduit à vouloir passer sous silence et étouffer au maximum à ses débuts l’information sur l’épidémie alors qu’il fallait agir à temps pour réduire et ralentir la propagation du virus. Cela montre la brutalité du régime qui ne tient guère compte de la vie humaine, mais aussi son irrationalité, car une action opportune en réponse à l’épidémie aurait non seulement permis de sauver des vies, mais même d’éviter une grande partie des pertes subies par son économie et une grande partie des dommages causés au prestige de la Chine en tant que puissance impérialiste mondiale montante avec son ambitieuse initiative des « routes de la soie ». Cette irrationalité du régime chinois dans sa réponse à l’épidémie est liée à sa paranoïa face à toute perte de pouvoir ou de contrôle, une paranoïa qui se manifeste dans ses grands camps de travail et de “rééducation” pour les Ouïgours et autres, par son penchant obsessionnel pour la technologie de reconnaissance faciale et son système de Crédit Social pour maintenir la population dans le « droit chemin ». Pour préserver son autorité, elle ose nier la reálité des faits eux-mêmes.
Mesures de quarantaine répressives
Mettre en quarantaine une ville de 11 millions d’habitants en bloquant tous les moyens de transport et en mettant en place des barrages routiers est une première. Le fait de le faire après que la moitié de la population ait été autorisée à partir aggrave la situation. La construction de deux nouveaux hôpitaux pour accueillir 2 600 patients supplémentaires en 10 jours est un impressionnant travail de propagande, et même une prouesse d’ingénierie préfabriquée (même s’ils n’étaient finalement pas prêts à temps). Mais l’équipement, les médecins et les infirmières nécessaires n’ont pas été fournis – même avec des médecins de l’armée et des volontaires d’autres régions. Les hôpitaux de Wuhan ont été débordés, tout comme les centres de quarantaine équipés de 10 000 lits. Les malades atteints de coronavirus ne peuvent pas entrer dans les centres de quarantaine et encore moins dans les hôpitaux. Les patients atteints d’autres maladies, notamment le cancer, ne peuvent pas être traités à l’hôpital, car tous les lits sont occupés. Les patients malades et mourants dans les centres de quarantaine ne bénéficient d’aucun soin infirmier. Les centres de quarantaine comptent des centaines de personnes entassées dans des lits ou sur des matelas à même le sol, portant des masques de protection en papier d’une efficacité plus que douteuse, avec des toilettes et des installations sanitaires inadéquates, parfois des toilettes et des douches portables à l’extérieur. Il est bien évident que toute personne entrant dans un centre de quarantaine sans Covid-19 l’attrapera rapidement. Les personnes soupçonnées d’être porteuses du virus ont été emmenées de force dans des centres de quarantaine – un garçon handicapé est mort de faim après que les parents sur lesquels il comptait ont été emmenés. Il s’agit là au moins autant d’une mesure de répression policière que d’une mesure sanitaire.
Rassembler les gens dans des centres de quarantaine qui ne peuvent que devenir des centres de transmission du virus rappelle les hôpitaux pour pauvres jusqu’au 19e siècle en Europe qui étaient également des sources d’infection (par exemple l’augmentation de la mortalité maternelle due à la fièvre puerpérale du 17e au 19e siècle avant que l’on comprenne la nécessité de l’hygiène).
Les équipements font défaut, notamment les vêtements de protection pour le personnel hospitalier ; les médecins et les infirmières travaillent de très longues heures, ce qui les rend plus vulnérables aux maladies. 1700 d’entre eux ont été infectés et 6 sont morts.
Un suivi incontrôlable de la maladie
Dans ces circonstances, il est clair que de nombreux patients sur le point de mourir auraient pu être sauvés grâce à des soins médicaux adéquats. Il semble que le taux de mortalité du Covid-19 soit plus de deux fois supérieur à Wuhan qu’ailleurs pour cette raison. Cependant, que les autorités chinoises continuent ou non à mentir sur le nombre de personnes infectées, les chiffres sont suspects car tous les cas ne peuvent être confirmés. C’est pourquoi le nombre de cas signalés à Wuhan a atteint un sommet le 11 février, lorsque les cas diagnostiqués cliniquement – sans test – ont été inclus, portant le total des cas enregistrés à plus de 60 000.
Il n’y a pas qu’en Chine que les chiffres relatifs aux maladies sont susceptibles d’être imprécis. Contrairement à Singapour, un pays préparé à une épidémie depuis le SRAS en 2003, de nombreux autres pays plus pauvres ne sont pas préparés. « Tout pays qui a de nombreux voyages aller-retour avec la Chine et qui n’a pas trouvé de cas devrait s’inquiéter », déclare un professeur d’épidémiologie de Harvard. (2) L’Indonésie, par exemple, a évacué 238 citoyens de Wuhan et les a mis en quarantaine pendant deux semaines, mais n’a pas effectué de test pour la maladie parce que c’est trop cher. Qu’en est-il du commerce africain de la Chine et de ses clients pour la nouvelle route de la soie ? Il y aura de nombreux endroits qui ne disposeront pas des infrastructures sanitaires nécessaires pour diagnostiquer et soigner les patients atteints du virus.
Ce qui est impressionnant, c’est que le nouveau virus a été séquencé dès le 12 janvier. Dans la foulée, la Coalition pour l’Innovation en matière de Préparation aux Epidémies (CEPI en anglais), créée en 2017 après l’épidémie d’Ebola en Afrique de l’Ouest, travaille à la mise au point d’un vaccin, dans l’espoir que celui-ci puisse être prêt si Covid-19 se répand, et en particulier s’il devient une maladie saisonnière comme la grippe. En fait, au moment où nous écrivons cet article, des travaux sur le vaccin sont en cours, utilisant une nouvelle méthode basée sur le séquençage des gènes, qui est plus sûre que de travailler avec un virus mortel, et a déjà accéléré la production de vaccins pour le Zika, Ebola, le SRAS et le MERS. Bien entendu, il faudra procéder à des tests de sécurité et d’efficacité avant de pouvoir l’utiliser, ce qui prendra du temps.
Cependant, ce potentiel impressionnant issu des forces productives n’est pas la fin de l’histoire. Il manque d’usines pour produire suffisamment de vaccins, et comme avec le risque de pandémie les gouvernements n’exporteront pas de vaccin tant qu’ils n’en auront pas stocké suffisamment pour leur propre usage « en invoquant la défense ou la sécurité nationale", (3) le CEPI doit prévoir de le fabriquer sur plusieurs sites.
Effets sur l’économie mondiale
L’économie de la Chine s’est arrêtée, car elle s’est refermée pour contenir le nouveau virus. En réaction, elle injecte de l’argent dans l’économie, le régulateur bancaire assouplit les règles sur les créances douteuses. Cependant, la Chine est désormais responsable de 16 % du PIB mondial, soit quatre fois plus qu’en 2003, au moment de l’épidémie de SRAS qui a amputé de 1 % de son PIB pour l’année. Son économie est beaucoup plus intégrée dans les chaînes d’approvisionnement mondiales qu’il y a 17 ans. Cela a déjà obligé Hyundai à fermer des usines automobiles en Corée du Sud, Nissan à en fermer une au Japon et Fiat-Chrysler à avertir qu’elle pourrait fermer une partie de sa production européenne. La production de smartphones pourrait baisser de 10 % cette année. Les textiles (la Chine produit 40 % des exportations mondiales), les meubles et les produits pharmaceutiques pourraient tous être touchés. Tout comme le tourisme. Et la Chine représente aujourd’hui près de 20 % des importations minières mondiales et tente d’annuler les livraisons de pétrole, de gaz et de charbon dont elle n’a pas besoin. Les actions des entreprises américaines fortement exposées aux ventes chinoises sont moins performantes de 5 %. La guerre commerciale avec les États-Unis n’étant pas résolue, le moment est mal venu – pour la Chine et l’économie mondiale.
À plus long terme, la Chine pourrait devenir un partenaire commercial moins fiable pour les multinationales qui souhaitent y investir. Cela la fait certainement passer pour un partenaire commercial et un bailleur de fonds impérialiste moins puissant pour ses clients sur la Nouvelle route de la soie. Cela peut dépendre de la rapidité avec laquelle elle peut ramener son économie à flots.
Quoi qu’il arrive avec ce nouveau virus du Covid-19, qu’il devienne une nouvelle pandémie, qu’il s’éteigne comme le SRAS, ou qu’il s’établisse comme un nouveau virus respiratoire saisonnier, cette nouvelle maladie est un nouvel avertissement que le capitalisme est devenu un danger pour l’humanité, et pour la vie sur cette planète. L’énorme capacité des forces productives, y compris la science médicale à nous protéger des maladies se heurte à la recherche meurtrière du profit, à l’entassement d’une proportion toujours plus grande de la population dans des villes immenses, avec tous les risques de nouvelles épidémies. La menace du capitalisme ne s’arrête pas là, il y a aussi les risques de pollution, de destruction écologique et de guerres impérialistes de plus en plus chaotiques.
Alex, 15 février 2020
1 Voir les “Thèses sur la décomposition [10]”.
2 D’après The Economist du 15 février 2020.
3 The Economist, 8 février 2020.
Rubrique:
Brexit et gouvernement Johnson: La crise politique au Royaume-Uni n’a pas disparu
- 46 lectures
L’élection, à une large majorité, de Boris Johnson par le Parti conservateur (Tories) a mis fin à plusieurs mois d’impasse parlementaire et a entraîné le départ officiel du Royaume-Uni de l’Union Européenne (UE), le 31 janvier. Cet événement semble marquer une rupture décisive avec la crise politique qui a agité la classe dirigeante britannique ces dernières années. Un simple procédé a permis de mettre fin à cette paralysie politique : le parti travailliste (Labour) et les autres partis d’opposition ont accepté la tenue de nouvelles élections générales en décembre 2019 ; les conservateurs ont fait campagne avec un unique slogan : “Get Brexit Done” (“Que l’on fasse le Brexit et que l’on en finisse”) ; l’électorat s’est entassé dans les isoloirs et, lassé des années de disputes sur le Brexit, a dégagé une majorité sans équivoque pour les conservateurs, en dépit de l’austérité imposée durant la dernière décennie.
Le capital britannique a quitté l’UE mais les contradictions sociales qui ont engendré la profonde crise politique qui a secoué la classe dirigeante ces dernières années ne se sont pas évaporées. Au niveau international, l’approfondissement des contradictions et de la crise économique, depuis plus de 50 ans, a conduit à une situation de tensions économiques aiguës entre les principales puissances capitalistes. Les États-Unis, la Chine et l’UE sont tous engagés dans des guerres commerciales de plus en plus à couteaux tirés. Les États-Unis, confrontés à leurs concurrents et à leur propre manque de compétitivité, utilisent tous les moyens pour saper leurs rivaux. Au niveau impérialiste, l’effondrement du bloc de l’Est n’a pas conduit aux promesses d’un “nouvel ordre mondial”, mais à un chaos sanglant. L’impasse sociale engendrée par le blocage du rapport de force entre la bourgeoisie et le prolétariat signifie que les contradictions économiques, sociales et politiques d’un capitalisme moribond sont quotidiennement exacerbées. Avec l’approfondissement de ce phénomène de décomposition, la bourgeoisie a également de plus en plus de difficulté à contrôler son appareil politique.
Des entrailles de ce système en décomposition est né le populisme, expression du désespoir, de la frustration et de la colère générés par la crise du capitalisme, à laquelle les partis politiques traditionnels semblent ne pas avoir de réponse et que les populistes sont capables d’exploiter et de manipuler. Les politiciens populistes ont de mirifiques projets de dépenses non chiffrées pour l’économie nationale, mais ils cherchent surtout à jeter en pâture des boucs émissaires : les immigrants, l’Islam, l’Union européenne, tout comme l’ “élite” qui a ignoré les besoins de la population “autochtone”.
Un assaut idéologique contre le prolétariat
La victoire de Boris Johnson ne résoudra pas les problèmes du capitalisme britannique. Elle marque au contraire le point culminant d’un assaut idéologique contre la classe ouvrière où tout se réduit à la question de la sortie ou du maintien au sein de l’UE, d’un accord ou non, d’un Brexit dur ou modéré. Toutes ces questions ont été prétendument résolues par le référendum de 2016 ou définitivement résolues par les élections générales de 2019.
La bourgeoisie veut convaincre la classe ouvrière que le vote compte vraiment, qu’elle peut faire entendre sa “voix” dans la démocratie bourgeoise. L’opération de séduction que Johnson exerce à l’égard de certaines parties de la classe ouvrière dans les régions marquées par la désindustrialisation, comme le Nord de l’Angleterre et les Midlands, est censée renforcer cette illusion. La classe ouvrière semble être de nouveau à la mode aux yeux des principaux partis politiques, après avoir cherché pendant des années à faire croire qu’elle n’existait plus, tout en attaquant brutalement ses conditions de vies.
Le parti conservateur de Theresa May s’enlisait au Parlement et déclinait dans les sondages. Mais dès que Johnson a pris le relais, les sondages n’ont cessé de grimper jusqu’aux élections. L’élection n’a pas été remportée par les Tories mais par une combinaison de politiques à la fois contradictoires et incompréhensibles des travaillistes, et par le pragmatisme de Johnson et de son entourage, en particulier de Dominic Cummings, son principal conseiller. Sans Johnson, le parti conservateur n’aurait pas gagné. La bourgeoisie britannique en est réduite à compter sur un arriviste politique qui a flatté sans vergogne les sentiments populistes afin de favoriser son ascension au pouvoir. Aucun autre homme politique n’a eu l’absence de scrupules nécessaire pour mener une âpre lutte des factions au sein du parti conservateur, puis pendant la campagne électorale.
Johnson (que le collège d’Eton et l’université d’Oxford ont visiblement éduqué pour en faire la figure de proue du “peuple” !) et Cummings ont réduit le conflit politique à celui d’un “Parlement opposé au peuple”. La prorogation du Parlement, les batailles devant les tribunaux, les déclarations provocatrices de Johnson et de ses partisans, tout cela a créé une atmosphère de crise et de confrontation, de division entre les pro- et les anti-Brexit, entre la prétendue “élite” et les “laissés-pour-compte”.
Cette atmosphère s’est maintenue pendant les élections. Le parti conservateur a effrontément diffusé des vidéos manipulées, voire fausses de leurs adversaires, a mis en ligne de faux sites web, etc. L’impunité des mensonges de Johnson a atteint un tel niveau que, lors d’un débat télévisé, le public a ri lorsqu’il a parlé de “lui faire confiance”. Toutes ces tactiques ont été apprises lors de la campagne présidentielle de Trump et celles d’autres populistes.
Johnson, tout en utilisant les tactiques développées par Trump, n’est pas une simple copie britannique du président américain et n’a rien d’un nouveau venu au sein du parti conservateur. Il a grandi au sein de “l’establishment” mais, tout comme Trump, il n’a montré aucun scrupule et a chevauché la marée populiste. Comme Trump, il a utilisé un parti établi pour satisfaire des ambitions personnelles. Comme Trump, il comprend aussi que ses déclarations mensongères et provocatrices ne lui feront pas perdre de son influence auprès de certaines parties de la population.
Une autre similitude avec le président américain est sa tendance à faire peu de cas des traditions de longue date et à imposer une forme de gouvernement plus dictatoriale. Le remaniement ministériel de Johnson en février, qui a contraint le chancelier de l’Échiquier, Sajid Javid, à démissionner, a montré qu’avec la mainmise des conseillers spéciaux, Johnson et Cummings s’efforcent de garder un contrôle étroit sur l’exécutif, mais aussi qu’il n’y a plus de discipline budgétaire rigide de la part du Trésor. Cela ouvre la porte à une version populiste du keynésianisme dépensier, illustré par des programmes comme le projet de ligne à grande vitesse (HS2) entre Londres et le nord de l’Angleterre et d’autres régions plus défavorisées.
Cependant, Johnson n’est pas l’homme de main de Trump en Grande-Bretagne ( contrairement à Farage). Lui et son équipe sont conscients du prix amer que la bourgeoisie a dû payer pour s’être trop rapprochée de l’impérialisme américain au début des années 2000. Le différend entre Trump et Johnson sur l’implication de l’entreprise chinoise Huawei dans l’infrastructure technique britannique est un exemple des véritables divisions entre le Royaume-Uni et les États-Unis. D’autre part, les Américains sont conscients de la faiblesse du Royaume-Uni dans la recherche d’accords commerciaux, ce qui rend le capitalisme britannique vulnérable aux exigences américaines. Comme l’Union européenne se montre ferme dans ses négociations commerciales post-Brexit, il est toujours possible que la Grande-Bretagne soit confrontée aux conséquences d’une absence d’accord, ce qui affaiblirait encore davantage la position économique du pays face à une récession mondiale imminente.
Possibilité de scission du Royaume-Uni
L’unité territoriale du Royaume-Uni est remise en question par le fiasco du Brexit. Le Scottish National Party (SNP) domine le Parlement écossais depuis 2011 et les élections écossaises au Parlement britannique depuis 2015. Le SNP a pris des sièges aux conservateurs, aux travaillistes et aux libéraux-démocrates (LibDem) lors des élections de 2019. L’ampleur même de la victoire des Tories en Angleterre et au Pays de Galles a renforcé les ambitions du SNP qui prospère en dénonçant la domination de Johnson, présenté comme la caricature de l’anglais typique arrogant. Prévenir l’éclatement du Royaume-Uni dont l’unité est menacée par les velléités d’indépendance de l’Écosse, est un défi pour la bourgeoisie britannique. Vu le passif de Johnson, qui a toujours méprisé l’indépendantisme écossais, il est fort probable que le conflit entre Londres et Édimbourg s’intensifie.
Même avant l’élection, les tensions se sont accentuées en Irlande du Nord. Contrairement à May, Johnson n’avait pas conclu d’accord avec le parti unioniste démocrate (DUP). En effet, alors qu’il est défavorable au “filet de sécurité irlandais” (backstop) dans l’accord de retrait de l’UE (qui implique une frontière effective entre la Grande-Bretagne et l’Irlande du Nord), le DUP n’a pas seulement été ignoré, mais carrément balancé hors du train. Le DUP avait maintenu le parti conservateur au pouvoir après 2017, mais il a été écarté par Johnson afin d’obtenir un accord. L’Irlande du Nord se retrouve maintenant avec un statut ambigu, un pied à l’extérieur de l’Union européenne, un autre à l’intérieur. Cette situation ne fera qu’alimenter les tendances à l’éclatement du Royaume-Uni.
La cohésion de l’appareil politique en danger
La dernière défaite électorale du parti travailliste a ouvert la perspective de sa fragmentation. Dans d’autres pays européens, les partis “socialistes” ont connu un déclin, mais en Grande-Bretagne, l’arrivée de Corbyn à la tête du Labour a entraîné une croissance du parti : lors des élections de 2017, le résultat a été meilleur que prévu. Mais désormais, la situation très précaire du parti travailliste pourrait commencer à le rendre inutile en tant que parti d’opposition. Sans perspective de retour au gouvernement, le risque d’un nouveau conflit au sein du parti s’accroît également. Le danger pour la classe dirigeante est que le parti travailliste se déchire alors qu’il est encore tenu de jouer un rôle dans la pantomime démocratique.
En attendant, compte tenu de la taille de la majorité conservatrice et du grand nombre de députés qui ne jouent aucun rôle au sein du gouvernement, la possibilité que les divisions au sein du Parti conservateur se transforment en de nouveaux conflits ne peut être écartée. La paralysie parlementaire a été débloquée, mais cela laisse la place à de nouvelles éruptions de divisions sous-jacentes. La probabilité d’un nouveau déclin économique de la Grande-Bretagne en dehors de l’UE signifie que l’appareil politique aura un rôle important à jouer contre toute réaction de la classe ouvrière.
En 2019, la classe ouvrière a été à nouveau entraînée dans la mascarade des élections parlementaires, toutes les parties affirmant qu’il s’agissait d’une élection cruciale, la plus importante d’une génération. Sur ce plan, les forces de la démocratie bourgeoise ont enregistré un véritable succès. Cependant, les tensions au sein de l’appareil politique montrent que les problèmes de la bourgeoisie pour contrôler la situation n’ont pas diminué. L’actuel Premier ministre britannique est un arriviste imprévisible dont la ligne de conduite ne peut être facilement cernée. Les principaux partis politiques sont toujours déchirés par des divisions. Le principal parti d’opposition est l’ombre de lui-même et l’éclatement du Royaume-Uni n’est plus un fantasme irréalisable. La Grande-Bretagne “tournée vers le monde” a de nombreux problèmes politiques devant elle.
Sam, 16 février 2020
Géographique:
- Grande-Bretagne [47]
Rubrique:
Communiqué international de solidarité avec la lutte de la classe ouvrière en France
- 76 lectures
Ceci est une déclaration de solidarité de la part des militants prolétariens des pays hispanophones, parce que la classe ouvrière est une classe internationale et une classe d’immigrés. Votre lutte est notre lutte, car ce n’est pas une lutte pour les retraites des ouvriers français, bien que cela ait été l’élément déclencheur de votre indignation, c’est une lutte de la classe ouvrière pour défendre nos conditions de vie et notre organisation en tant que classe.
Dans cet esprit de solidarité, nous autres, un groupe de camarades de différents pays du monde réuni suite à une réunion de contacts et de sympathisants du Courant Communiste International, voulons contribuer à donner une perspective à la lutte.
Quelles sont les tâches du moment ? Comment lutter aujourd’hui ?
Il est nécessaire de se battre en tant que classe ouvrière. C’est-à-dire, non pas en tant qu’individus ou secteurs isolés ou agglomérés dans des manifestations syndicales, mais en tant que classe, en tant que classe ouvrière exploitée, partageant les mêmes nécessités que les travailleurs du monde entier, quels que soient les secteurs, n’ayant pas d’intérêts particuliers par rapport aux autres travailleurs, en dépit des pièges que nous tend la bourgeoisie pour nous faire entrer en concurrence les uns avec les autres, ou lutter en tant que secteurs isolés qui auraient des intérêts particuliers.
Il est nécessaire de retrouver la continuité avec notre lutte historique. Notre classe a une histoire et une expérience. La perspective demeure la grève de masse (qui est apparue en 1905 comme la méthode moderne de lutte de notre classe) et les conseils ouvriers dont le prélude sont les assemblées générales ouvertes à tous les prolétaires. Des assemblées dans lesquelles nous discutons collectivement de nos besoins et de nos perspectives, à l’image de l’expérience récente des grèves anti-CPE (2006) et des Indignés (2011). (1) Des assemblées contrôlées par la classe ouvrière et animées par des principes de camaraderie, pas en suivant [les directives des organes bourgeois d’encadrement que sont les syndicats] (NdT), où tout le monde peut prendre la parole et s’exprimer en tant qu’ouvriers, avec des délégués révocables à tout moment afin de centraliser la lutte.
La grève de type syndical est un piège ! Vous n’êtes pas dans la rue grâce à eux. Ils n’ont pour fonction que de prendre la direction du mouvement pour mieux le contrôler et le diviser. L’organisation de type syndical n’est en aucun cas une méthode de lutte mais un facteur d’isolement et de démoralisation. (2)
Que font les médias étrangers de notre lutte commune en France ? Ils la réduisent au silence, la banalisent, ne montrent que la perspective syndicale et surtout la rendent impopulaire en mentionnant surtout les problèmes qu’elle cause. Mais les problèmes qu’elle cause ne sont pas à mettre sur le compte des travailleurs en lutte mais bien sur celui de la bourgeoisie qui fait tout pour éviter que les ouvriers puissent se coordonner ! Les travailleurs du monde entier partagent vos inquiétudes et votre indignation. Mais ils sont isolés et enfermés dans le cadre de la nation et de problèmes spécifiques. Quand elle ne se tait pas, la bourgeoisie nous assène que vous êtes des privilégiés qui se plaignent de tout ou vous assimilent aux “gilets jaunes”, afin qu’à l’étranger nous ne puissions faire la distinction. Vous devez nous demander ouvertement de l’aide. Prolétaires du monde entier, unissons-nous ! Là est la perspective. C’est une perspective difficile mais en même temps la seule voie, dont la dynamique même fait progresser la conscience de classe, tout en étant parsemée de défaites sur le plan le plus tangible, le plus matériel. C’est pourquoi, tout en prolongeant la lutte dans tous les sens du terme, nous devons, dans cette dynamique, créer les meilleures conditions pour faire face à la défaite qui se profile.
Nous pouvons soit battre en retraite consciemment, soit tomber dans les pièges et les provocations démoralisantes des syndicats et du gouvernement. Toutes les mobilisations ne sont pas positives, car elles peuvent aussi nous épuiser. La question de comment se battre nécessite une réponse sur le long terme, autrement dit ce n’est pas seulement “comment se battre maintenant, en ce moment même”, bien que cela soit très important comme nous avons essayé de l’expliquer plus haut. La perspective de la lutte d’aujourd’hui et de l’avenir doit être un tout cohérent et unifié. Nous devons savoir quand et comment battre en retraite et quoi faire dans notre retraite, pour garder à l’esprit la perspective et la continuité de la lutte afin que les futures luttes soient plus fortes.
Il est nécessaire que les camarades qui veulent continuer à prendre part à la lutte n’insistent pas pour la suivre à tout prix, alors qu’une défaite partielle est déjà en vue. Il existe une alternative à cette lutte “sans issue”, à cette impasse dans laquelle mènent les syndicats : c’est de se regrouper en comités de lutte qui en tireront les leçons, uniront les forces et prépareront ainsi les luttes futures.
Ce n’est pas une lutte limitée a la question des retraites, c’est une lutte avant tout pour défendre nos conditions de vie en tant que classe ouvrière et plus généralement, une lutte pour défendre la perspective de la révolution prolétarienne, la révolution communiste mondiale. Il est essentiel de trouver cette continuité avec l’expérience historique accumulée par la classe ouvrière à travers ses organisations révolutionnaires.
Adopté lors d’une réunion de contacts du CCI avec des camarades de France, d’Espagne, du Mexique, du Chili, de Colombie, du Costa Rica et du Brésil, le 13 janvier 2020.
1Voir respectivement : Les “Thèses sur le mouvement des étudiants du printemps 2006 en France”, Revue Internationale n° 125 (2e trimestre 2006) et “2011 : de la indignación a la esperanza”, (sur le site web du CCI, avril 2012). (NdR)
2Sur la nature et la fonction des syndicats, voir notre brochure : Les syndicats contre la classe ouvrière et l’article : “Apuntes sobre la cuestión sindical”, (sur le site web du CCI, 2011). (NdR)
Situations territoriales:
Rubrique:
Pandémie de COVID-19 en France: L’incurie criminelle de la bourgeoisie!
- 927 lectures
Alors que l’épidémie s’était déjà largement étendue en Europe et notamment en Italie, c’est avec beaucoup de retard que la bourgeoisie française a timidement commencé à prendre des mesures pour “protéger” la population. Il a fallu attendre que la situation soit catastrophique dans certaines régions comme la Picardie ou l’Alsace pour que le gouvernement Macron se réveille et prenne des décisions drastiques : confinement obligatoire, fermeture des frontières, contrôles policiers, mobilisation de l’armée pour venir à la rescousse des équipes soignantes, totalement débordées.
“Nous sommes en guerre !”, déclarait le Président Macron dans son discours du 16 mars. Les éléments de langages martiaux ont depuis fleuri dans la bouche de tous les ministres et des politiciens de tous bords : “l’ennemi est là” ! “union nationale” ! “guerre de position” ! “mobilisation générale” ! “effort de guerre” !… Le gouvernement a même ressorti de pauvres vieillards, “héros de la Seconde Guerre mondiale”, pour expliquer que “tousser dans son coude” relève de l’ “acte de Résistance”.
Si “l’ennemi” demeure “invisible” et “insaisissable”, la lutte contre cette pandémie a, en effet, tout d’une véritable guerre : le gouvernement multiplie les mensonges et les demi-vérités, il envoie des millions d’ouvriers risquer leur vie au front (économique, s’entend !), quand il ne sacrifie pas la piétaille, à l’assaut des élections municipales, dans des offensives aussi suicidaires qu’irresponsables !
L’État bourgeois est responsable de l’hécatombe !
“Nous sommes prêts et archi-prêts. La guerre dût-elle durer deux ans, il ne manquerait pas un masque, pas un flacon de gel hydro-alcoolique à nos soldats (en blouse blanche)”, aurait pu déclarer le général Macron ! Mais la réalité est à l’exact opposé : face à l’incurie de l’État et à l’amateurisme de Macron, le gouvernement navigue à vue et s’en remet désormais entièrement aux médecins pour “protéger” la population. Ainsi, pendant que le “chef de guerre” jupitérien et ses ministres jouent leur petit tour d’histrion, le personnel hospitalier se sacrifie pour sauver des vies en faisant son possible avec des moyens largement insuffisants.
Aujourd’hui, face au COVID-19, les horaires s’allongent de façon délirante dans tous les services et des soignants épuisés témoignent de journées de travail de plus de quatorze heures, accroissant davantage les risques d’erreur dramatique. Les soignants exténués crient leur colère jusque sur les plateaux de télévision ! En Alsace, face au nombre de décès et de patients en état de détresse respiratoire, l’État a dû improviser un “hôpital militaire de campagne”, dans un brouillard logistique inouï, pour soutenir les hôpitaux civils asphyxiés par le manque de lits et de moyens.
Quant aux stocks de masques, de solutions hydro-alcooliques, de charlottes, de blouses, de respirateurs : la pénurie est générale ! En 2005, l’État comptait sur un stock stratégique de 723 millions de masques (1,4 milliards en 2011 suite à la crise du H1N1). Mais en 2013, les restrictions budgétaires ont scellé le sort de ce stock tombé à 150 millions d’exemplaires. Face aux rationnements, aux recours à des masques périmés, voire à la réutilisation de masques usagés, le gouvernement vient seulement, après plusieurs semaines de crise, d’en puiser 12 millions dans les réserves déjà insuffisantes de l’État… pour 1,1 millions d’agents hospitaliers censés les jeter à la poubelle toutes les quatre heures. De quoi tenir quelques jours pour les hôpitaux qui ont la chance d’être livrés ! Quant aux services “non prioritaires” et aux laboratoires pratiquant des milliers de tests quotidiennement, c’est aussi la déroute. Plus de masques ! (1) Le personnel soignant, “en première ligne” (sic !), se trouve donc directement exposé à la maladie. Un médecin urgentiste de Compiègne vient de trouver la mort à cause du virus et d’autres le suivront probablement dans la tombe ! Comment Macron peut-il se regarder dans une glace quand il ose affirmer que la santé doit passer avant tout le reste ?
D’ailleurs, pour dissimuler sa responsabilité et la réalité de la situation, l'État, digne d'une république bananière, ment effrontément. Le nombre de malades est ainsi largement sous-estimé, le gouvernement et les Agences Régionales de Santé ayant tenté de passer sous silence, pendant plusieurs jours, le fait que les dépistages “ne sont plus systématiques”, selon l’admirable litote du Ministre de la Santé. De même, les autorités laissent entendre (de plus en plus difficilement) que la “saturation des hôpitaux” est localisée à quelques départements. Mensonge éhonté ! La presse et même les réseaux sociaux fourmillent de témoignages poignants de soignants parfois en pleurs, montrant l’ampleur de la catastrophe.
Il faut le dire clairement : ce chaos est le produit de la décadence du système capitaliste, des coupes budgétaires que l’État doit opérer depuis des décennies pour maintenir le capital national à flot !
Dès 2004, l’État a fait le choix de réduire drastiquement la recherche fondamentale sur le coronavirus pour des raisons budgétaires ! (2) La classe dominante savait parfaitement que ses hôpitaux, déjà exsangues face aux simples grippes saisonnières, ne tiendraient pas le choc face à une épidémie majeure ! (3) L’État bourgeois a délibérément choisi de laisser crever des ouvriers en masse pour “assainir” ses finances !
Avec un ton paternaliste insupportable, le général Macron loue donc aujourd’hui le courage et l’héroïsme des médecins, des aides-soignants, des infirmiers et des ambulanciers, oubliant bien opportunément qu’il a envoyé ses CRS les gazer pendant toute une année alors que les “soldats en blouse blanche” réclamaient plus de moyens et de personnels pour soigner les patients ! Pendant un an de grèves et de manifestations, la bourgeoisie n’a pas cessé de mépriser les urgentistes avec pour seules réponses un “plan hôpital” totalement insignifiant (4) et des insinuations écœurantes sur leurs prétendus privilèges de fonctionnaires. Macron peut bien leur passer la brosse à reluire en qualifiant les soignants de “héros”, leur salaire n’augmentera pas et leurs conditions de travail ne cesseront pas de se dégrader” !
Le démantèlement du système de santé en France
Le système de santé en France, comme partout dans le monde, est en ruine, découpé à la hache sur l’autel de la “rigueur budgétaire” si chère au Ministre Darmanin, l’un des meilleurs sabreurs du général Macron. En une vingtaine d’années, le nombre de lits d’hôpitaux a diminué de 100 000 ! Le nombre d’hôpitaux et de cliniques est passé de 1 416 sites en 2014 à 1 356 en 2018. (5) Comme symbole de la destruction du système de soins, le gouvernement décidait, en 2014, de vendre l’hôpital militaire du Val de Grâce, le plus performant et le mieux équipé des hôpitaux français.
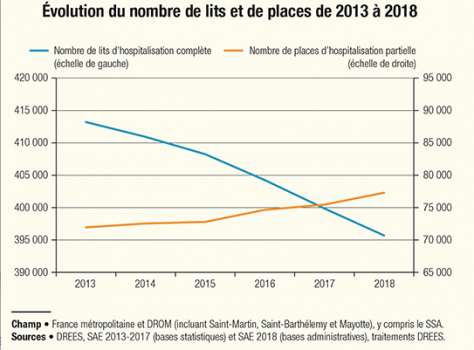
Logiquement, la France comptait déjà en 2017, 309 places en soins intensifs pour 100 000 habitants, contre 601 lits en Allemagne, (6) qui (Ô miracle !) connaît (pour le moment) un taux de mortalité lié au COVID-19 largement inférieur à celui de ses voisins. Dans certaines régions, comme dans l’Est de la France ou la Corse, les places et les moyens manquent cruellement et le “tri” des patients a déjà commencé. Une authentique “médecine de guerre” où les blessés les plus gravement atteints et estropiés (notamment les personnes âgées) sont laissés sur le carreau s’ils ne sont pas récupérables pour la rentabilité de l’économie nationale !
Tout cela s’accompagne évidemment d’un manque chronique de personnel, soumis à des cadences infernales, des heures supplémentaires par milliers et des salaires de misère. (7) Le démantèlement du système de soins s’est aussi traduit par la politique dite du numerus clausus, appliqué aux étudiants des écoles de médecine et d’infirmières. Pendant 50 ans, les médecins et les infirmiers ont été sélectionnés sur concours avec un nombre de lauréats fixé arbitrairement par arrêté ministériel, dans, on s’en doutera, la plus stricte logique de rigueur budgétaire. Cela a contraint la deuxième puissance économique européenne à littéralement “importer” des médecins et des infirmiers moins coûteux venus d’Espagne, du Maghreb ou des pays de l’Est.
La bourgeoisie n’a pas d’autre arme que la coercition pour endiguer la pandémie
Pour amortir l’impact de la crise sanitaire sur “l’appareil de production français”, l’État-major étatique a adopté une série de mesures d’urgence, au premier rang desquelles un semi-confinement bien tardif. Alors que l’épidémie a débuté en Europe au début du mois de février, il a fallu attendre le 16 mars pour que le général Macron annonce enfin des mesures de confinement. Jusqu’alors, sa priorité était de prendre des mesures d’austérité contre la classe ouvrière, et notamment le passage en force de sa réforme des retraites alors que l’épidémie continuait de progresser.
Pourtant, le gouvernement connaissait parfaitement le danger que représente le COVID-19. C’est l’ex-ministre de la santé, “l’ange blanc” Agnès Buzyn, qui a publiquement vendu la mèche en déclarant (sans doute aigrie par ses piètres résultats électoraux dans la course à la mairie de Paris) avoir averti très tôt le chef de l’État de l’imminence de la catastrophe : “Je savais que la vague du tsunami était devant nous”. “Le 30 janvier, j’ai averti [le premier ministre] Édouard Philippe que les élections ne pourraient sans doute pas se tenir”. “On aurait dû tout arrêter, c’était une mascarade”. (8)
La “mascarade” a bien eu lieu ! Le gouvernement a sciemment aggravé la propagation de l’épidémie en envoyant dans les bureaux de vote des millions de citoyens à la grande messe démocratique ! L’incapacité criante d’une des principales puissances mondiales à approvisionner la population en moyens de protection efficaces (masques, gants et solutions hydro-alcooliques), impose pourtant des mesures de confinement drastiques.
La “mascarade”, donc, ne se résume pas à l’organisation criminelle d’élections en pleine montée de l’épidémie et alors que dans le même discours du 16 mars, Macron demandait à ses “chers compatriotes” de ne pas sortir dans la rue… “sauf pour aller voter et faire des courses”. Face à cette injonction paradoxale (sortez de chez vous, mais ne sortez pas !), personne ne pouvait croire à la réalité et à la gravité de cette pandémie. Il n’était donc pas surprenant que de nombreux “citoyens” aient manqué de “civisme” et aient profité du beau temps pour aller se promener sur les bords de Seine et dans les jardins publics.
Le discours mi-chèvre mi-chou de Macron, de même que sa décision de maintenir le premier tour des élections Municipales, étaient encore une “boulette” qui n’a pas manqué d’être exploitée par Marine Le Pen pour les besoins de sa campagne électorale.
C’est sous la pression des cris d’alarme du corps médical que Macron et son ministre de l’Intérieur, Christophe Castaner ont pris la décision d’exiger le confinement général. Une armée de 100 000 flics et de militaires a été déployée sur tout le territoire pour faire respecter le confinement et la multiplication des couvre-feux. Face à la gravité de la pandémie, la classe dominante n’a pas d’autre choix que d’utiliser la coercition pour éviter l’hécatombe.
Sur la Côte-d’Azur, un drone muni d’un haut-parleur survole même les communes de Nice et de Cannes en ordonnant aux passants de rester chez eux : “Rappel des consignes relatives à l’épidémie de Covid-19 : tous les déplacements hors du domicile sont interdits sauf dérogation. Veuillez respecter une distance de sécurité d’au moins un mètre entre chaque personne”, répète en boucle l’engin.
La police, avec le sens du discernement qu’on lui connaît, n’a pas hésité à appliquer les mesures gouvernementales en ciblant les plus démunis et sans abri : “plusieurs sans-domicile fixe ont été verbalisés par les forces de l’ordre en France, car ils ne respectaient pas le confinement. […] Des cas ont notamment été recensés à Paris, Lyon et Bayonne” ! (9) Les flics n’ont également pas hésité à verbaliser quatre personnes en deuil à la porte d’un cimetière pour “non respect des règles de confinement” en affirmant qu’un “enterrement n’a rien d’impératif” ! La bourgeoisie ne peut pas faire autrement que déployer ses forces de l’ordre, mais elle profite aussi de la situation pour habituer la population à la militarisation de la société quand “l’ennemi intérieur” ne sera plus le virus mais la classe ouvrière en lutte !
Sur tous les plateaux télé, chaque jour, des médecins mobilisés sur le “front” sont interviewés pour exhorter la population à respecter rigoureusement les mesures de confinement et de distanciation sociale. Car c’est (hélas) le seul moyen aujourd’hui de combattre les ravages du coronavirus et de limiter la contagion.
La bourgeoisie se moque royalement de la santé des exploités
La “mascarade”, ce sont aussi les millions de personnes qu’on entasse chaque jour dans les transports en commun, ce sont les ateliers d’usines et les grandes surfaces dans lesquelles la bourgeoisie “confine” les ouvriers par centaines ! La “mascarade” criminelle de la bourgeoisie et son gouvernement, ce sont les milliers d’entreprises encore ouvertes dont la production n’a d’ “essentielle” que le nom. Alors que les ouvriers du bâtiment refusaient de s’exposer inutilement, la Ministre du Travail, Pénicaud, a osé parler de “défaitisme”. “Dans la guerre contre cette épidémie, le monde économique représente les forces arrières”, soulignait d’ailleurs le président du MEDEF.
Pour contraindre les prolétaires forcément rétifs à se déplacer sur leur lieu d’exploitation, le gouvernement a dégainé ses armes les plus redoutables : la répression et la propagande. L’État peut naturellement compter sur ses chiens de garde syndicaux pour assurer la discipline. Ces derniers ne cessent d’appeler à la mise en œuvre “des moyens indispensables à la protection de la santé et de la sécurité des salariés devant travailler” et “saluent l’engagement des agents des services publics et des salariés”. (10) Traduction : allez bosser, on s’occupe de votre protection grâce au “dialogue social” avec la direction et le patron ! Lorsque les travailleurs expriment trop ouvertement leur réticence, les syndicats s’empressent de faire jouer le “droit de retrait” chacun dans “son” entreprise.
“L’État d’urgence sanitaire” n’a pas empêché le gouvernement d’exhorter les travailleurs à ne pas respecter le confinement lorsque le télétravail n’est pas possible. Mais désormais, si les ouvriers refusent d’aller travailler, préférant préserver leur santé et celle de leurs proches, on enverra les flics réquisitionner les récalcitrants et faire pleuvoir les sanctions sur tout ce que l’État jugera entraver le bon fonctionnement de l’économie nationale ! Les congés pourront également être posés d’office par les employeurs pour “compenser” l’absentéisme. Même les fonctionnaires de certains centres des impôts sont contraints de ne pas déserter leur poste de travail ! Le confinement sélectif fait partie de la logique du capital : il ne faut pas que cette pandémie meurtrière entrave la “continuité” de l’économie nationale.
“Ma priorité est de sauver l’appareil de production français”, rappelait ainsi, sabre au clair, le Ministre-hussard de l’Économie, Bruno Le Maire. Comme le soulignait si joliment le journaliste d’Atlantico, Jean-Sébastien Ferjou, sur LCI : “la vraie question, […] c’est : est-ce qu’on préfère sacrifier nos vieux et les personnes affaiblies ou est-ce qu’on préfère sacrifier deux points de PIB ?” Le gouvernement a choisi : on sacrifiera les vieux !
C’est la classe ouvrière qui va devoir payer l’addition !
En matière de propagande outrancière, la bourgeoisie française, à l’image de ses voisins, n’a pas lésiné sur les moyens ! En appelant à la “mobilisation générale” et à “l’unité nationale”, la bourgeoisie a déchaîné une campagne nationaliste des plus nauséabondes !
La bourgeoisie prépare déjà les esprits au “champ de ruines” économique qu’engendrera la “guerre sanitaire” ; et c’est la classe ouvrière qui paiera l’addition ! L’ “esprit de sacrifice” propre à une période de “reconstruction” est de mise. Déjà, les salariés les plus précaires commencent à perdre les quelques heures de travail qui leur permettaient de survivre ! Déjà, ceux qui sont au chômage technique ne toucheront finalement pas l’entièreté de leur salaire, contrairement aux promesses du gouvernement ! La propagande bat son plein pour faire entrer dans les crânes qu’à cause de l’épidémie, tout le monde devra à l’avenir se serrer la ceinture. Tout comme elle avait fait croire que les “banquiers véreux” et la “finance folle” étaient à l’origine de la crise économique de 2008, elle cherche aujourd’hui à faire croire que c’est le COVID-19 qui serait à l’origine de la crise économique. Mais la réalité est bien différente : non seulement, l’épidémie n’est qu’un catalyseur, un accélérateur de la crise du système capitaliste, mais elle est elle-même un pur produit de cette crise !
Dans la presse et sur les réseaux sociaux, à la télévision et sur YouTube, ceux qui font encore leur jogging en solitaire sont désignés comme des irresponsables, fautifs de la propagation de l’épidémie. N’est-il pas venu à l’esprit des journalistes et de leurs supplétifs “youtubeurs”, que ces imprudents promeneurs ont pu trouver parfaitement dérisoire l’interdiction de déambuler à l’air libre après s’être entassés par millions dans le RER, dans leurs open spaces ou dans leurs entrepôts, et, la veille, dans les bureaux de vote ? L’État déchaîne une campagne de culpabilisation individuelle pour mieux dissimuler sa propre incurie et son incapacité à endiguer la pandémie !
Mais là où la campagne idéologique de la bourgeoisie est la plus pernicieuse, c’est dans ses appels à ovationner le personnel soignant. Les chaînes de télévision passent en boucle les images de la Tour Eiffel illuminée et des beaux quartiers en liesse, applaudissant, tous les soirs à 20 heures, depuis les fenêtres et parfois même sur fond de Marseillaise, les médecins et les infirmiers. La bourgeoisie ne recule devant aucun cynisme ni aucune indécence en appelant la population à redoubler les applaudissements après le décès d’un premier médecin. Les “soldats morts pour la France” tombent au champ d’honneur sous la liesse populaire ! Il ne s’agit ni plus ni moins que d’un dévoiement de la solidarité prolétarienne faisant écho au discours martial du général Macron vantant l’ “héroïsme” des soignants. Bien que ces applaudissements leur mettent un peu de baume au cœur, les urgentistes n’ont pas besoin de médailles pour leurs bons et loyaux services rendus à la “Nation”. Ils ont besoin de personnels supplémentaires et de matériels, ils ont besoin de masques et de protection ! Ils ont besoin que la “reconnaissance” de leurs exploiteurs se manifeste par des augmentations de salaire (11) et d’effectifs afin de ne pas crouler sous le fardeau des cadences infernales !
La colère ne peut que s’amplifier
Face à l’incurie de la bourgeoisie et la casse du système de santé rendant de plus en plus difficile la prise en charge des malades, la colère monte dans les rangs ouvriers. Le mépris de la classe dominante à l’égard de la vie humaine ulcère les exploités. Nombreux sont ceux qui ne supportent plus la volonté affichée du gouvernement de débusquer les tire-au-flanc, ni de devoir s’exposer alors que rien ne justifie leur présence indispensable au travail. Les livreurs de Deliveroo et Uber-eats, les ouvriers de l’usine SNF d’Andrézieux, ceux de La Redoute et de Saverglass dans l’Oise se sont ainsi mis en grève pour protester contre leurs dangereuses conditions de travail. Chez Amazon ou à La Poste, les salariés ont également débrayé. Partout ailleurs, de nombreux prolétaires n’ont pas tardé à exprimer leur solidarité à leur fenêtre en réclament des moyens pour les soignants, non pas en ovationnant les “héros de la Nation”, mais au cri de : “Du fric ! Du fric, pour l’hôpital public ! [48]”
Mais dans l’immédiat, ce qui domine c’est la peur et la sidération face à cette catastrophe sanitaire que la classe dominante ne parvient pas à maîtriser. L’impossibilité de se rassembler massivement, ne permet pas, aujourd’hui, à la classe ouvrière de reprendre le chemin de la lutte sur son propre terrain de classe.
Toutes ces expressions de colère démontrent néanmoins que la combativité est encore bien vivace, que les prolétaires ne sont pas résignés à accepter comme une fatalité l’incurie de ceux qui les exploitent. “On n’est pas de la chair à canon”, peut-on entendre parmi les personnels soignants.
Dès que cette crise sanitaire sera surmontée, l’État “protecteur” va dévoiler de nouveau son vrai visage. Les attaques contre toutes les conditions de vie des prolétaires, (aggravées par la plongée de l’économie dans l’abîme de la récession) ne pourront que déboucher, à terme, non pas sur l’union sacrée des exploités avec leurs exploiteurs, mais sur de nouvelles explosions de colère et d’indignation.
Cette catastrophe sanitaire mondiale ne peut que contribuer à la réflexion dans la classe ouvrière et à la prise de conscience que le capitalisme est un système complètement pourri, un véritable fléau menaçant la survie de l’espèce humaine.
EG, 22 mars 2020
1 Le général Macron peut au moins compter sur un corps expéditionnaire, la Croix-Rouge chinoise, qui vient de faire “don” au Vieux Continent de plusieurs millions de masques et de matériels pour ventiler et intuber les malades. Bien sûr les “dons” de Pékin, en plus d’être anecdotiques, n’ont rien d’un acte altruiste et désintéressé. Alors que les États sont incapables de coordonner un minimum leurs actions, les “largesses” de la Chine sont plutôt l’expression du chacun-pour-soi généralisé qui caractérise le capitalisme en putréfaction et dont la pandémie de COVID-19 est une spectaculaire illustration. Nous reviendrons sur ces questions dans un prochain article.
2 Cf. l’interview du professeur Bruno Canard, directeur de recherche au CNRS et spécialiste des coronavirus, parue dans Le Monde : “Face aux coronavirus, énormément de temps a été perdu pour trouver des médicaments [49]” (29 février 2020).
3 Le COVID-19 est d’ailleurs loin d’être la maladie la plus virulente qui ait jamais frappé l’humanité. On peut d’ores et déjà anticiper sans trop de difficulté l’impact apocalyptique d’une pandémie de MERS-CoV avec son taux de létalité à 30 % [50] !
4 On appréciera la plaisanterie en comparant cet “investissement très important” de 300 millions d’euros (dixit l’ex-ministre de la santé, Agnès Buzyn) au plan d’aide de quelques 750 milliards d’euros que vient de débloquer la BCE pour “sauver l’économie”.
5 Cf. le Panorama de la DRESS de 2019 [51] et un rapport de la DRESS publié la même année [51].
6 Cf. “Curative care beds in hospitals [52]”. Ces chiffres datent de 2017. Le doute sur la dégradation continue des moyens depuis deux ans est à peine permis.
7 L’État a d’ailleurs aggravé la misère en remplaçant des postes d’infirmiers par des aides-soignants payés au lance-pierre.
8 “Les regrets d’Agnès Buzyn [53]”, Le Monde (17 mars 2020).
9 “Coronavirus : des SDF verbalisés pour non-respect du confinement” AFP (20 mars 2020).
10 Communiqué intersyndical du 19 mars 2020 [54] signé, main dans la main, par les organisations salariales et patronales.
11 La promesse d’une prime de 1000 € aux soignants n’est même pas un 13e mois au SMIC ; ces miettes sont une véritable insulte.
Récent et en cours:
- Coronavirus [55]
- COVID-19 [56]
Rubrique:
Assassinat de Soleimani: Le Moyen-Orient dominé par le chacun pour soi impérialiste
- 43 lectures
Avec l'assassinat de Qassem Soleimani et de neuf autres associés, incluant des chefs de puissants groupes militaires iraniens, les Unités de Mobilisation Populaire et Kataeb Hezbollah le 3 janvier 2020, Trump a envoyé un signal, en pleine cohérence avec sa présidence, que toute "convention" passait à la trappe et que personne n'était à l'abri dans ce face-à-face tendu entre les Etats-Unis et l'Iran. Hassan Nasrallah, président du Hezbollah au Liban et fidèle allié de l'Iran, probablement un peu nerveux dans les heures qui ont suivi l'attaque, a pris l'antenne pour appeler Téhéran à ne pas agir précipitamment ainsi qu'au "départ des troupes américaines d'Irak". Le jour suivant, malgré le bruit émanant de quelques "partisans de la ligne dure" du régime qui furent rapidement réduits au silence, cela était [devenu] la position officielle de la République Islamique dont l'élite dirigeante communiquait les détails de leur "vengeance" aux Américains à travers des porte-paroles irakiens. Malgré tout le battage réalisé lors d'une grande campagne médiatique, il n'y avait pas de réelle possibilité de conflagration régionale de grande ampleur à travers un échange de missiles (l'usage des troupes américaines n'était pas non plus vraisemblable) et il y avait encore moins de possibilité d'une Troisième Guerre mondiale, malgré les gros titres sensationnels de certains journaux bourgeois. Nous reviendrons plus loin sur les raisons pour lesquelles nous pensons que cela n'était pas le cas et pourquoi cela ne signifie pas pour autant une atténuation de l'expansion de la barbarie militaire. Dans le même temps, la disparition de Soleimani a porté un coup à l'impérialisme iranien mais cela ne se résumant jamais à un seul homme, il reste à voir quelles seront les conséquences de ce coup pour la République Islamique: s'il va l'affaiblir encore plus suite aux récentes protestations (réprimées mais pas disparues) ou s'il va renforcer le nationalisme iranien et sa base.
Dans tous les cas, Soleimani, au fil des décennies, avait déjà beaucoup fait pour l'extension de l'impérialisme iranien au Moyen-Orient et en Afrique sub-saharienne.
Qassem Soleimani : le boucher des bouchers.
La force Al-Qods ("Jerusalem") et les unités associées, créées sous l'impulsion de Soleimani à partir des années 80 et dont il prit la tête il y a environ une quinzaine d'années, furent responsables de la répression interne des protestations et des luttes des travailleurs iraniens entre autres en 1999, dix ans plus tard en 2009 et à nouveau une décennie plus tard en 2019/2020. Ils causèrent de nombreux morts chez les manifestants irakiens dernièrement et ce sont ces forces qui ont déchaîné une répression sans pitié contre les manifestants anti-Assad après 2012, sauvant pratiquement le boucher syrien et son régime chancelant. Soleimani n'était pas un fanatique Chiite mais un important représentant de l'impérialisme iranien. C'était un allié de la Russie mais il n'était pas pour autant le laquais de cette dernière. Il fut également, à différents moments, allié avec les Américains mais aussi avec les Kurdes, les Alaouites, les Maronites, les Sunnites, quiconque en fait pouvait faire avancer sa cause. Il a même utilisé Al-Qaida contre les Américains, ce pour quoi l'Iran a reçu son propre "retour de bâton". Ce n'est pas surprenant que Soleimani était tenu en si grande estime par un régime iranien miné par les luttes de factions [1] et c'est pourquoi il fut déclaré "martyr vivant" par le "guide suprême", Ali Khamenei.
L'Iran et particulièrement les éléments fidèles à Soleimani ne furent jamais les jouets ou les pions de la Russie, agissant sous les ordres de Moscou. Ce n'était pas le cas récemment et déjà après la chute du Shah, qui eut lieu en 1979 alors que les blocs existaient toujours, l'Iran a eu tendance à suivre sa propre voie. Le régime des mollahs était en quelque sorte un joker, présageant d'une certaine façon l'effondrement des blocs et le chacun pour soi impérialiste qui en découlerait. Cela étant, alors qu'il était responsable directement et indirectement de nombreux morts américains, Soleimani voulait continuer à travailler avec les Etats-Unis. Et il n'y a pas de doute que même après que le Président George W. Bush ait ciblé l'Iran comme faisant partie de l'"Axe du Mal" en 2002, les branches diplomatiques et militaires américaines ont joué un rôle significatif dans la construction et la consolidation des Al-Qods et des forces iraniennes associées en Irak. Même si les relations sont devenues plus compliquées par la suite, après la chute de Saddam, le conseil gouvernemental irakien était essentiellement constitué d'Américains et d'Iraniens, car les Etats-Unis n'avaient pas d'autre alternative que de tolérer la montée des partis Chiites après le renversement de Saddam.
Après l'horreur des Tours Jumelles en 2001 et une certaine "main tendue" par l'Iran, le diplomate de carrière et haut responsable du Département d'Etat, Ryan Crocker et son équipe, ont régulièrement rencontré [2] les officiels iraniens y compris Soleimani afin de discuter de leurs ennemis communs : Al Qaida et les Talibans. Même après que les diatribes d'inspiration néo-conservatrices de Bush avaient mis fin aux rencontres officielles (et au rapprochement officiel), les contacts irano-américains furent maintenus dans les années qui suivirent. Le jeu que Soleimani a mis au point était de poursuivre le dialogue avec les Américains, faisant des concessions par-ci, des faveurs par-là, tout en continuant à mettre la pression sur les Etats-Unis et harceler leurs troupes ainsi que celles de leurs alliés. Le dévoilement des échanges de messages diplomatiques par Wikileaks montre que Soleimani était en contact avec le général américain David Petraeus, commandant en chef des Forces américaines en Irak autour de 2008. C'est dans ce développement sans précédent de guerre asymétrique -un facteur général de la décomposition capitaliste qui inclut le terrorisme- que le général iranien a attiré les Etats-Unis dans un piège, en grande partie tendu grâce aux installations et au champ d’action fournis par les Américains eux-mêmes. A cette époque, il y avait plus de 100 000 soldats américains en Irak et chacun d'entre-eux était une cible. Les Iraniens les ont utilisés et ensuite soumis à une violence et à une pression psychologique constantes, facteurs qui ont contribué au retrait graduel des troupes américaines. Et bien que cela puisse avoir convenu ou arrangé les Russes, la force motrice derrière tout cela était l'impérialisme iranien.
Trump s'est récemment auto-proclamé vainqueur de Daech mais si un homme est responsable de la défaite de l'EI (aux côtés de la logistique américaine, de l'aviation russe et des troupes kurdes au sol), c'est bien Soleimani et ses milices.
Dans la bataille contre l'EI, les hauts commandements américains et iraniens ont collaboré étroitement, avec parfois l'Iran aux commandes.
La bataille d'Amerli, une ville turkmène chiite en Irak tenue par Daech, a vu la combinaison d'attaques aériennes et terrestres impliquant les deux pays et ce fut une défaite significative pour l'Etat Islamique et une victoire majeure pour la coalition irano-américaine. Dans ce contexte, Soleimani pouvait s'appuyer également sur les Russes et même, dans une certaine mesure, sur les Kurdes ; à nouveau, cela montre la relative indépendance de l'impérialisme iranien.
L’attaque américaine
De tout l'éventail de réactions possibles de la part des Etats-Unis en réponse à l'agression continue de l'Iran, c'est la plus "extrême" qui fut choisie et la frappe contre l'Iran et Soleimani fut commanditée par Trump dans le plus pur style mafieux. Le Président, qui était calme et lucide durant tout l'épisode, a posé ses cartes sur la table et s’est déclaré ouvert à toutes les options ; les Iraniens, logiquement, se sont repliés. Il n'y avait pas d'intérêt à un échange de tirs de missiles, pas d'intérêt pour l'Iran de souffrir de plus lourdes pertes et pas le moindre intérêt pour Trump de s'engager dans une guerre plus étendue. De leur côté, la Chine et la Russie n'avaient pas non plus d'intérêt à s'engager dans une guerre au Moyen-Orient au sujet de l'Iran, guerre dont les conséquences néfastes étaient évidentes. Toutes les guerres impérialistes sont fondamentalement irrationnelles et un Iran blessé, potentiellement sans leader, serait devenu un terreau fertile pour tous les vautours impérialistes, créant un trou noir instable aspirant toutes sortes d'éléments (incluant un EI partiellement résurgent) et aggravant encore plus les tendances centrifuges actuellement à l'oeuvre.
Néanmoins, la politique générale des Etats-Unis de jeter de l'huile sur le feu en Iran générera très certainement plus d'instabilité dans la région. Même si le Conseiller à la Sécurité nationale, John Bolton, est parti, Trump est toujours entouré de « faucons » anti-Iraniens. La lettre adressée au gouvernement irakien par le général W.H Seely, commandant des opérations militaires en Irak, accédant à la requête du premier de retirer toutes les troupes américaines, montre la confusion qui règne dans les plus hauts échelons de l'armée américaine. Les Allemands et les Français ont ouvertement méprisé l'action et la Grande-Bretagne, qui a désespérément besoin de Trump à ses côtés, s'est jointe aux critiques de l'UE. Aucun d'entre eux n'a d'intérêt à ce que les Etats-Unis exacerbent encore plus le chaos au Moyen-Orient.
La reformation de nouveaux blocs n’est pas à l'ordre du jour
La relation entre la Russie et l'Iran, mise en lumière par les récents événements, mérite un bref examen plus approfondi, particulièrement par rapport à l'analyse générale du CCI de la décomposition et de la perspective soulevée par la Tendance Communiste Internationale (TCI), qui parle d'un potentiel d'une guerre mondiale entre blocs avec la Russie à sa tête, qui, selon la position de la TCI ne peut rester passive face aux assassinats des Etats-Unis, ne pouvant laisser l'Iran être attaqué "en toute impunité"[3]. Non seulement la Russie peut se le "permettre" en laissant faire les attaques contre les forces iraniennes en Syrie par Israël mais elle n'est pas non plus hostile à une éventuelle attaque de positions iraniennes en Syrie en utilisant ses propres forces. La tendance principale n'est pas vers la "cohérence" d'une guerre mondiale entre blocs mais vers le chacun contre tous et le développement de la barbarie militaire qui est aussi dangereuse pour la classe ouvrière et l'humanité, si ce n'est plus.
Dans ses commentaires après l'attaque américaine, Poutine n'a pas mentionné une seule fois le nom "Soleimani" et sa critique implicite de l'attaque a révélé la position du Kremlin comme un tout, laissant à ses médias le rôle de jouer sur la question de "l'agression de l'impérialisme américain". Les liens historiques de la Russie avec l'Iran ont laissé de profondes cicatrices et ses récentes relations ont été pour le moins ambigües. Cependant la mort de Soleimani donne à l'impérialisme russe une chance de renforcer plus encore sa mainmise sur la Syrie et potentiellement sur l'Irak.
Bien que ce rôle ait été quelque peu exagéré par Téhéran, Soleimani a travaillé étroitement en Syrie avec les Russes comme alliés. Mais nous avons vu qu'il a également collaboré de très près avec le haut commandement américain en Syrie comme en Irak
La stratégie récente de l'Iran et des Gardiens de la Révolution (Al-Qods et autres milices) a été de renforcer le rôle de l'Iran en Syrie afin d'étendre sa portée. À l'opposé, le but de la Russie est de renforcer le régime d'Assad et, ce faisant, sa propre position. Plutôt que de pousser à une confrontation plus grande suite aux attaques américaines sur l'Iran, il se peut que les Russes ne soient pas trop mécontents de l'issue de ces mêmes attaques ; et s'il y avait un leader qui aurait pu été informé préalablement par Trump des attaques de drones, c'est bien Poutine.
Sous le commandement de Soleimani, les Gardiens de la Révolution ont acheté, autour d'Homs et Damas, de vastes étendues de terres et de bâtments qui sont devenus des enclaves iraniennes. Il y a de claires tensions émanant de trois directions et la Russie ne partage pas l'opinion de l'Iran sur la question syrienne. La Russie aurait pu protéger les forces iraniennes en Syrie des attaques d'Israël simplement en gardant déployé son nouveau système de missiles S-300 mais, en collusion avec l'Etat hébreu, elle laisse régulièrement les avions israéliens violer l'espace aérien syrien pour utiliser ses armes contre les positions iraniennes et repartir ensuite. L'Iran a exprimé à la Russie sa colère à plusieurs reprises mais celle-ci l'a tout simplement ignoré. La Russie a également fait savoir à Israël que ce dernier pourrait être associé à la discussion sur la réduction des stocks d'armes iraniens présents à Damas, une carte que détient la Russie face à l'Iran et il n'hésitera pas à se confronter directement aux forces iraniennes dans le pays (comme ce fut le cas dans la province de Deraa lorsqu'il a mis en déroute la 4e division appuyée par l'Iran). Et tout comme Israël, la Russie a récemment noué des liens avec l'Arabie Saoudite et les Emirats Arabes Unis, aucun n'étant allié de l'Iran.
Aucun de ces éléments ne fait ressortir une quelconque cohérence de bloc autour de la Russie, pas plus qu’il ne confirme l’hypothèse d’une riposte "nécessaire" de cette dernière aux attaques américaines envers les intérêts iraniens de la façon dont l'envisage la TCI. Et rien de tout cela n'empêche par ailleurs la Russie de se poser en "protecteur" de l'Iran et d'utiliser ses "avantages" qui se sont révélés très profitables en Syrie. Et avec la présence de la Turquie qui perturbe tout le monde avec sa campagne en faveur du dénommé "nouvel Empire ottoman" qui a récemment engendré des confrontations directes entre la Turquie et l'armée syrienne autour d'Idlib, on n'observe pas de tendance vers le développement de blocs militaires unifiés. On voit plutôt la guerre de chacun contre tous et la domination des tendances centrifuges. Sans aller plus loin dans les multiples divergences d’intérêts entre les différentes puissances sur les diverses régions, le "grand jeu" au Moyen-Orient ressemble désormais encore plus à la description faite par un diplomate britannique il y a quelques temps: "un jeu d'échec à neuf côtés sans aucune règle".
L'effondrement du système des blocs et l'avènement du "Nouveau désordre mondial”
Du début des années 50 jusqu'à la fin des années 80, une Troisième Guerre mondiale était une possibilité envisageable. Les deux blocs impérialistes existaient, le monde était plus ou moins partagé entre eux et des tensions surgissaient partout, particulièrement autour de zones poudrières-clefs. Mais dans la période allant de 1968 à 1989, quand le retour de la crise économique mondiale impliquait "logiquement" une nouvelle marche vers la guerre, l'insistance opiniâtre du prolétariat à lutter pour ses intérêts de classe a empêché la mobilisation pour une conflagration impérialiste. Aujourd'hui pourtant, avec la complète absence de blocs impérialistes unifiés, l'absence de perspective de les voir surgir à l'horizon et, probablement, leur disparition pour de bon, la bourgeoisie n'est pas forcée de confronter et mobiliser le prolétariat dans ce sens. Et ceci résulte de l'incapacité du capitalisme à imposer la cohésion et la discipline nécessaire pour que de grands deux blocs s'affrontent dans un conflit mondial. Au lieu de cela, il y a toutes sortes de tendances centrifuges à l'oeuvre : le chacun pour soi, la fragmentation, la concurrence impérialiste du "nous d'abord, contre tous les autres" et l’instabilité. La formation des blocs n'est pas à la racine de l'impérialisme, bien au contraire et la conséquence de 1989 est que l'impérialisme désormais prend une forme différente mais non moins dangereuse, en accord avec la décadence générale et la décomposition du système capitaliste entier. Les blocs impérialistes s'affrontant à l'échelle mondiale sont une conséquence du capitalisme décadent mais la fragmentation de cette forme particulière et son élimination probable dans un 'avenir proche, est significatif de l'aggravation de la décomposition capitaliste et résulte de l'ouverture en 1989 d'une boîte de Pandore.
L'effondrement du bloc de l'Est en 1989 fut l'une des plus spectaculaires expressions en "temps de paix" de la crise et de la décomposition du système capitaliste tout entier. Du jour au lendemain, la guerre mondiale n'était plus à l'ordre du jour. L'implosion du bloc de l'Est et de toutes ses structures a eu ses répercussions à l'Ouest où, presque immédiatement, les liens de bloc se sont relâchés. Malgré les campagnes assourdissantes sur la "mort du communisme" et la "victoire du capitalisme", il n'a pas fallu longtemps -deux ans- pour que la réalité du "Nouvel ordre mondial" s'affirme. Peu de temps après la tentative vouée à l'échec des Etats-Unis de prévenir la fragmentation de son propre bloc via la coalition qui combattit durant la première Guerre du Golfe en 1991, la guerre a éclaté en Yougoslavie en 1992, la première guerre ouverte en Europe depuis 1945.
Ce fut un conflit brutal, bestial, ciblant les civils d'une façon rappelant la Seconde Guerre mondiale. Il fut attisé et instrumentalisé initialement par l'Allemagne, qui exprimait la tendance à l'indiscipline de bloc et ce fut ensuite la descente aux enfers avec presque toutes les grandes puissances appuyant chacune leur propre faction tout en y participant. Et depuis, cela est allé en s'empirant dans d'autres zones grandissantes de guerre et de militarisme, le Moyen-Orient et l'Afrique l'illustrant particulièrement.
Des problèmes supplémentaires pour la perspective prolétarienne mais ses tâches restent les mêmes
Il est certain que depuis la chute de l'URSS, l'impérialisme russe s'est rationalisé et réarmé, émergeant de nouveau comme un acteur principal sur des acteurs principaux dans l'arène internationale.
Plus important encore, la Chine est apparue comme le principal concurrent de l'hégémonie américaine, montrant qu'une tendance vers une bipolarisation entre les Etats impérialistes les plus puissants existe toujours. En outre, c'est avant tout la montée en puissance de la Chine qui, déjà sous Obama, a conduit les Etats-Unis à déclarer l'Asie comme étant le nouveau pivot et le confinement de la Chine sa nouvelle priorité. Cela était la véritable signification derrière la politique d'Obama de désengagement envers de larges parties du Moyen-Orient que le régime de Trump a poussé encore plus en avant. Mais ni la rivalité croissante entre la Chine et les Etats-Unis ni les tensions entre ces derniers et la Russie ne devraient être confondues avec une formation de blocs à l'heure actuelle, laquelle est constamment minée par la tendance dominante à la fragmentation des conflits. Cette tendance a été illustrée très clairement non seulement par l'incroyable chaos militaire au Moyen- Orient mais également par les menaces planant sur l'unité de l'Union Européenne, de l'OMC, de l'OTAN et toute une foule ribambelle d'organisations "internationales" ainsi que par rapport aux protocoles et accords sur lesquels elles sont basées.
Rien de tout cela ne rend le combat de la classe ouvrière plus facile, au contraire. Mais cela le rend d'autant plus essentiel pour son avenir et le futur de l'humanité. Le prolétariat uni reste la seule force capable d'affronter et de mettre en échec l’effroyable perspective que le capitalisme nous réserve. Et de notre point de vue, cela importe peu si nous sommes soufflés par des bombes, empoisonnés à mort par les contaminations ou rôtis par le changement climatique. Dans le même temps, comme les récents développements dans la lutte de classe l'ont encore timidement indiqué, la classe ouvrière, comme classe exploitée, détient le potentiel de combattre, de s'auto-organiser, de mettre en place des assemblées pour consolider et étendre ses combats contre l'enfermement prêché par les syndicats, l'atomisation comme "citoyens" et le piège du corporatisme et des frontières nationales.
Ce serait mentir ou s’illusionner que de ne pas mentionner les difficiles et sérieuses épreuves auxquelles fait face la classe ouvrière par ces évolutions du capitalisme, évolutions qui ne peuvent que pousser le capitalisme à s’enfoncer davantage dans sa décadence et générer davantage de barbarie. Mais malgré le repli et la démoralisation des dernières décennies, la classe ouvrière a été historiquement et demeure l'unique force sociale capable d'offrir à l'humanité une sortie du cauchemar de ce capitalisme moribond.
Baboon, 4.2.20
[1] Voir : https://fr.internationalism.org/icconline/201801/9659/iran-lutte-entre-c... [57]
[2] Le commandant fantôme: https://www.newyorker.com/magazine/2013/09/30/the-shadow-commander [58]
[3] https://www.leftcom.org/en/articles/2020-01-04/the-us-attack-on-baghdad [59]
Géographique:
- Moyen Orient [60]
- Syrie [61]
Rubrique:
Le 18 Brumaire de Pedro Sánchez
- 115 lectures
BRUMAIRE est le nom du deuxième mois du calendrier républicain français, le deuxième de la saison automnale, qui s’étend du 22, 23 ou 24 octobre jusqu’au 20, 21 ou 22 novembre. Le 18 Brumaire de l’an 1799 eut lieu le coup d’État de Napoléon Bonaparte, qui est considéré comme le point final de la Révolution française. Depuis lors, le 18 Brumaire symbolise la notion même de “coup d’État”. En 1851, Marx écrivait son ouvrage : Le 18 Brumaire de Louis Bonaparte, en référence au coup d’État du neveu de Napoléon, qui déclinait, sous la forme d’une comédie, la tragédie de l’oncle, en s’offrant son petit moment de gloire sans jamais donner d’alternative sur le plan politique. Pedro Sánchez n’a pas fait de coup d’État, mais la motion de censure qui l’a conduit au gouvernement provisoire (qui perdure encore) faisait figure d’assaut contre l’ancien gouvernement, bien qu’il n’ait pour l’instant pas été capable de gouverner. On peut également noter que les dernières élections générales en Espagne se sont déroulées en Brumaire, le 10 novembre.
L’imbroglio de la situation politique espagnole d’avant et après les dernières élections du 10 novembre ne fait pas office d’exception, mais est plutôt la règle parmi les États les plus importants. En commençant par la première puissance mondiale, les États-Unis, où le gouvernement Trump déclenche des tensions au sein des partis républicain et démocrate, tout comme l’un envers l’autre. Mais également en Europe, où la bourgeoisie britannique, une des plus expérimentées dans le jeu politique, se voit aspirée par le Brexit, sous l’impulsion des populistes ; ou en Italie, où la République vient juste de se débarrasser d’un gouvernement de coalition de deux partis populistes de tendance opposée (la Ligue de Salvini et le Mouvement 5 étoiles ou M5S) pour former à nouveau un gouvernement de coalition instable entre le Parti démocrate et le M5S. Aussi en Allemagne, où Merkel (véritable leader de l’UE ces dernières années) sera bientôt contrainte de quitter le gouvernement sans avoir pu contenir la montée du populisme ; ou en France, où La République en Marche de Macron n’a aucune alternative fiable au cas où son bras de fer contre Le Pen échouerait.
Cette augmentation quantitative des crises politiques représente, en réalité, un aspect qualitatif typique de la période historique actuelle : la tendance à la perte de contrôle par la bourgeoisie de son appareil politique. Dès 1990, nous l’annoncions déjà dans les Thèses sur la décomposition1, comme le souligne le point 4 de la résolution sur la situation internationale de notre dernier congrès2 : “Parmi les caractéristiques majeures de la décomposition de la société capitaliste, il faut souligner la difficulté croissante de la bourgeoisie à contrôler l’évolution de la situation sur le plan politique” (point 9). Un phénomène clairement énoncé dans le rapport du 22e congrès : “Ce qu’il faut souligner dans la situation actuelle, c’est la pleine confirmation de cet aspect que nous avions identifié il y 25 ans : la tendance à une perte de contrôle croissante par la classe dominante de son appareil politique”.
À leur manière, certains éléments de la bourgeoisie, comme Cebrián ou Felipe González en Espagne, n’ont pas d’autre choix que de le reconnaître : “Nous ne sommes pas confrontés à une crise du gouvernement, mais de l’État, et celle-ci s’inscrit à son tour dans une nouvelle ère dont les emblèmes sont la mondialisation technologique et financière ; la disparition du monde bipolaire qui a émergé après les guerres du siècle dernier ; la corruption de nombreux gouvernements ; la multiplication des inégalités et l’absence d’espoir dans leur avenir pour les nouvelles générations. Felipe González a décrit le phénomène comme étant la crise de la gouvernance de la démocratie représentative dans l’État-nation. Il s’agit de cela, mais pas seulement. Nous sommes confrontés à l’effondrement de l’ordre établi au milieu d’un chaos qui ne fait que commencer et qui nous accompagnera encore quelque temps…”.3
Mais la perte de contrôle par la bourgeoisie de son appareil politique est nettement différente des diverses crises politiques que celle-ci a connu dans les années 1960 et 1980. Avant les années 1990, les crises politiques de la bourgeoisie étaient liées soit à la nécessité d’affronter les luttes de la classe ouvrière, soit aux tensions impérialistes (la crise du canal de Suez pour la Grande-Bretagne et la France). De plus, elles étaient gérées au sein même de l’appareil politique bourgeois. Dans la présente crise, le prolétariat n’est pour l’instant pas au centre de la scène sociale. Ainsi, la crise actuelle réside dans la perte de contrôle de la bourgeoisie de son propre appareil politique. Les mouvements populistes se constituent autour de thèmes récurrents comme les réfugiés, la sécurité face au terrorisme, la rancœur des personnes ruinées par la crise… Mais ils se nourrissent également des tensions particulières au sein même des bourgeoisies nationales : de la désorientation de la bourgeoisie américaine face à l’affaiblissement de son leadership mondial, de l’ambiguïté de la bourgeoisie britannique face à l’Union européenne, des divisions entre fractions régionalistes et nationalistes au sein de la bourgeoisie espagnole ou belge, etc.
L’explication de l’impasse dans laquelle se trouve actuellement la bourgeoisie espagnole pour former un gouvernement se comprend dans ce cadre de référence historique et international et dans la façon dont cela s’est concrétisé dans le jeu politique de l’État national. Nous ne pouvons pas refaire ici un développement détaillé des analyses que nous avons faites des différents épisodes de l’expression de la crise de l’appareil politique de l’État espagnol ; bien qu’il ne soit pas non plus possible de parler de la situation actuelle sans les avoir à l’esprit.
Du bipartisme à l’ “Octo-Pedro”4
Des précédents
La bourgeoisie espagnole, grâce à la Constitution de 1978, s’était dotée d’un terrain de jeu consensuel pour gérer ses tensions politiques. Parmi les résultats les plus notables, citons le fait que le PSOE devienne le principal parti de l’État bourgeois et mène la transformation vers la démocratie ainsi que la restructuration industrielle ; qu’une droite démocratique se soit formée, balayant en les camouflant sous le tapis les vestiges du franquisme ; ou que les tensions nationalistes avec la Catalogne et le Pays basque aient été canalisées dans une lutte pour des avantages financiers et des élargissements de leur autonomie régionale.5 Mais cela n’a été possible que grâce à l’unité de tous pour faire face à la lutte du prolétariat et à la discipline du bloc impérialiste américain qui, par l’intermédiaire de l’Allemagne et de la France, a parrainé la transition démocratique. Aucun de ces deux facteurs n’est présent aujourd’hui et avec l’aggravation de la crise, le bateau prend l’eau de toutes parts.
Le bipartisme et l’alternance PP-PSOE sont, en Espagne, l’expression d’une tendance générale au parti unique, propre au totalitarisme étatique qui caractérise la décadence du capitalisme et qui, dans les pays démocratiques, prend la forme du bipartisme : deux partis (un plus à droite et l’autre plus à gauche) qui se répartissent le pouvoir d’une façon presque monopolistique. Aux États-Unis, on retrouve l’alternance Démocrates-Républicains ; en Allemagne, la CDU et le SPD ; en Grande-Bretagne, les Conservateurs et les Travaillistes, et en Espagne le duo PP–PSOE. L’usure de cette recette, due aux chocs de la crise économique qui dure depuis près d’un demi-siècle et à la décomposition, comme nous l’avons expliqué plus haut, s’est manifestée dans le cas espagnol au travers du PP dans lequel il n’y avait quasiment plus de hauts cadres qui ne soit pris dans des affaires de corruption ; tandis que le PSOE devenait un royaume de taïfas6 sous le commandement des “barons” et de la “vieille garde” au blason terni. Ceci a abouti en 2016 à la crise du PSOE, à un équilibre instable ainsi qu’à une lutte acharnée entre des apparatchiks et des arrivistes, ce qui est aujourd’hui la marque de fabrique de la maison social-démocrate. Le PP, en revanche, doit affronter la montée en puissance des dissidents de Vox, parti dont il a nourri l’idéologie. 7
La tentative d’une alternative au bipartisme fut celle de la “chronique d’une mort annoncée”. Comme nous l’énoncions en 2016 : “Le PSOE, parti gouvernemental par excellence, ne peut pas faire alliance avec la droite “moderne” et “renouvelée” que devait être Ciudadanos. Ce parti est viscéralement espagnoliste (plus encore que le PP) et il ne peut servir de canal de dialogue avec les nationalistes de droite. Mis à part sa démagogie anti-corruption, il n’offre rien de “centriste” qui pourrait séduire un électorat plus “moderne”. À commencer par son leader, l’immense majorité de ses cadres sent le snobinard à plein nez, de manière plus puante encore que ceux du PP. Malgré les gesticulations de monsieur Rivera, Ciudadanos ne peut pas être plus qu’une béquille boiteuse du PP. Ciudadanos n’a rien à voir avec les partis charnières qui existent en Allemagne (les libéraux, les Verts) et qui peuvent donner de la crédibilité aux partis du centre (CDU et SPD) qui prennent fermement position contre le populisme”.8
Et d’autre part : “(…) au niveau du gouvernement central, la coalition “front populiste” est dangereuse pour les intérêts du capital espagnol. Tout d’abord, Podemos est un conglomérat chaotique de tendances variées au sein duquel un groupuscule trotskiste joue un rôle non-négligeable (Izquierda Anticapitalista) et qui, quelle que soit l’ampleur des ambitions de ses leaders, et quel que soit leur degré de “modération”, sont clairement inaptes à la gestion d’un gouvernement. De plus, existe à Podemos le poids des nationalismes périphériques qui le poussent à la démagogie risquée du “droit des peuples à décider”, chose que la plupart des barons socialistes ne tolèrent pas. En bref, les partis nationalistes périphériques ne sont pas fiables étant donné la mauvaise soudure de l’unité nationale du capital espagnol et ils suscitent beaucoup de méfiance au sein de l’appareil socialiste. À tout cela, il faut ajouter le discrédit qu’engendrerait un “gouvernement progressiste”, non seulement pour le PSOE lui-même, ainsi qu’à Podemos, mais également pour toute la soi-disant “classe politique””.
Justement, la surenchère des nationalismes9 est l’autre grand facteur de chaos responsable de la situation actuelle. La promesse de Zapatero “d’approfondir” la question du “statut catalan”, ainsi que l’incompétence du PP, sont le déclencheur des récents événements. Bien que la cause soit mondiale, comme nous venons de le développer, la toile de fond est une escalade du radicalisme entre l’ERC10 et l’ex-CiU11 à des fins électorales.12 Le PP qui, en 2012, refusait de tenir sa promesse de revoir la question du statut d’autonomie et d’égaliser l’offre de transferts de compétence catalans avec celle du Pays basque, a fait déclarer à Mas, alors président de la Generalité, que “la Catalogne entrait en territoire inconnu”. Un territoire où, de facto, les fractions les plus radicales et les plus irresponsables du nationalisme, comme la CUP/CDR,13 se renforcent et s’engagent sur la voie unilatérale de l’indépendance qui a connu son heure de gloire grâce au référendum d’octobre 2017 et à la proclamation de la “République catalane”.14
Conséquences
Les secteurs les plus responsables de la bourgeoisie ont répondu à cette situation par la motion de censure qui a chassé Rajoy du pouvoir et a permis au PSOE de redevenir le pivot de la politique bourgeoise, après une période où il risquait d’être ostracisé (comme lorsqu’il a soutenu l’application de l’article 155 de la Constitution en Catalogne, sans que cet appui soit nécessaire). Cette motion de censure, notamment concoctée par Podemos, a rapidement été soutenue par le PNV15 et l’ERC (qui a été le premier groupe à parler ouvertement de la fin de la voie unilatérale vers l’indépendance). Cette opération a reçu la bénédiction de la majeure partie de la bourgeoisie, ce qui a donné un élan important au PSOE lors des élections du 27 avril dernier.
Pour quelle raison l’ERC et, dans une moindre mesure, Podemos ont-ils torpillé cette majorité en votant contre les budgets, et ce, juste avant les élections ? Pourquoi le PSOE, qui disposait de meilleurs atouts pour gouverner, n’a-t-il pas réussi à investir Pedro Sánchez après ces élections et a dû organiser les élections du 10 novembre dernier ? Il est difficile de donner une réponse, mais il semble que les plans des secteurs les plus responsables de la bourgeoisie aient été rapidement sabotés par les secteurs les plus imprévisibles.
En voici quelques exemples :
- le sabotage de la majorité de la motion de censure est essentiellement imputable à la fraction Puigdemont avec ses réunions à Pedralbes avec le gouvernement du PSOE en novembre 2018, qu’elle arrive presque à présenter comme une capitulation (puisque l’État aurait accepté de négocier “entre gouvernements”), ce qui laisse une marge de manœuvre à l’ERC ainsi qu’au PSOE lui-même ;
- celle qui a saboté le gouvernement PSOE en juillet est principalement la fraction Iglesias dans Podemos, qui voit dans le gouvernement de coalition l’unique façon de survivre à l’envenimement des querelles intestines au sein du groupe lui-même, mais aussi un secteur très important du PSOE, rebuté par une alliance avec Podemos.
-Alors que la sentence du “procès” était connue depuis des mois par tous les politiciens, les réactions qu’elle a provoquées, surtout sous la forme de mobilisations et d’affrontements de radicaux avec la police durant quinze nuits consécutives, ont laissé les principaux acteurs politiques “hors-jeu”. Les quinze nuits d’affrontements violents entre la police et les radicaux n’ont pas conduit à un affaiblissement du poids électoral des fractions les plus imprévisibles (en fait, celles qui ont le plus progressé lors des dernières élections, à part Vox, ont été Bildu, le CUP/CDR, les partisans de Puigdemont, etc), mais plutôt de celles qui sont les plus enclines à la négociation (ERC). Si, par cette manœuvre, le PSOE a cherché à associer la question de l’indépendance avec la violence afin d’obtenir un soutien international et ainsi assouplir davantage de secteurs indépendantistes, il faut dire que cela a été un échec relatif. Les tribunaux européens continuent de jouer les prolongations, tandis que des personnalités internationales font signer un manifeste pour que soit trouvée une solution “négociée” au “conflit catalan”. Ainsi, l’orientation des mobilisations en Catalogne est passée de l’indépendance à l’anti-répression, c’est pourquoi, contrairement à ce qui s’est passé en octobre 2017 par exemple, il y a eu des manifestations dans les principales villes espagnoles en solidarité contre les violences en Catalogne.
Les élections du 10 novembre n’ont rien donné et soulèvent les mêmes questions dans les mêmes termes. L’apparente coalition avec Podemos satisfait seulement sa fraction dirigeante (qui se réjouit à la perspective de “prendre la relève”) ; mais elle laisse les choses exactement comme elles étaient en ce qui concerne la question catalane et l’opposition dans et hors du PSOE.
Antifascisme et campagne démocratique : un cocktail explosif contre le prolétariat en Espagne
La transition vers la démocratie dans le but de se libérer du franquisme s’est appuyée sur deux grands piliers :
- Face au prolétariat, l’illusion sur les “syndicats ouvriers”, sur les “libertés démocratiques”, les partis de droite, la défense de la Démocratie ;
- Face au problème chronique de la mauvaise soudure de l’unité nationale du capital espagnol, la puissance des nationalismes périphériques (particulièrement basque et catalan) qui ont conduit à l’ “État des Autonomies” dans l’État.
Le nationalisme rance et “grand espagnol” du franquisme avec ses ridicules prétentions impérialistes et son catholicisme national condensé dans le slogan “pour l’empire jusqu’à Dieu” n’arrive plus à réintroduire le poison de la “défense de la nation” dans les rangs du prolétariat et s’avère contre-productif. La bourgeoisie a donc dû recourir au renforcement des micro-nationalismes, persécutés par le régime franquiste. Ainsi, la gauche et surtout le PSUC16 en Catalogne ont mené une intense campagne démocratico-nationaliste avec le fameux slogan “Llibertat, amnistia et Estatut d’autonomia” (Liberté, amnistie et Statut d’autonomie).
Cependant, ce qui a historiquement fait le plus de mal au prolétariat a été l’antifascisme et la défense de la démocratie. Telle a été la leçon fondamentale de la période de la République et de la guerre de 1936, lorsque la CNT a perdu tous les liens qu’elle avait encore avec la classe ouvrière, en raison de son adhésion inconditionnelle à la mystification antifasciste17 et la réponse initiale des ouvriers sur leur terrain de classe au coup d’État militaire de juillet 1936 qui a été détournée par le Front populaire, soutenu par la CNT-POUM,18 vers le terrain de la guerre impérialiste, celui de “la défense de la République contre le fascisme”. Les ultimes résistances du prolétariat furent écrasées par le Parti communiste d’Espagne en mai 1937 avec l’aide de l’ERC et de la CNT, son ministre Montseny appelant depuis la radio les ouvriers massacrés à “embrasser les gardes d’assaut”.19
Aujourd’hui, la CUP/CDR et d’autres “nationalistes de gauche” sont comme qui dirait des carcasses du PSUC et d’autres cliques de gauche.
La classe ouvrière, dans les principales concentrations de la Catalogne, fait partie des bataillons centraux du prolétariat en Espagne, avec une tradition notable de luttes, comme dans le Bajo Llobregat, à la SEAT, etc., qui a apporté des contributions précieuses à la mémoire historique du prolétariat. Et s’il est vrai qu’elle ne s’est pas laissée entraîner sur le terrain indépendantiste, l’ambiance de polarisation brutale entre le nationalisme espagnol et le nationalisme catalan crée une barrière difficile à surmonter dans l’effort que le prolétariat doit faire pour trouver son propre terrain de classe autonome et international, afin de lutter contre les attaques de plus en plus graves du capitalisme en crise et contre sa dérive vers la barbarie de la guerre, de la misère et de la destruction de l’environnement.
Hic Rodas/Pinto, 20 décembre 2019
[1] Voir sur notre site internet : “La décomposition, phase ultime de la décadence capitaliste [10]”.
[2] Voir sur notre site internet : “Résolution sur la situation internationale (2019) : Conflits impérialistes, vie de la bourgeoisie, crise économique [62]”.
[3] Extrait d’un article paru sur El Pais, Opinión (25 novembre 2019).
[4] Déformation par les médias du mot “octoedro” (l’octaèdre) en octo-pedro pour désigner le gouvernement actuel, en référence au prénom de Pedro Sanchez. (NdT). Son gouvernement est en effet arrivé au pouvoir grâce au soutien d’au moins huit partis politiques. Il a également été surnommé le gouvernement Frankenstein.
[5] Toutefois, la violence des attentats n’a pas faibli (ETA pour les indépendantistes basques ou Terra Lliure, Hipercor pour les Catalans, etc.).
[6] Les taïfas étaient les 23 royaumes musulmans indépendants qui s’étaient formés après la dissolution du Califat de Cordoue en 1031. (NdT)
[7] Voir sur notre site Vox (Espagne) : Une “voix” clairement capitaliste [63].
[8] Voir l’article sur notre site web : “Espagne : qu’arrive-t-il au PSOE ? [64]”
[9] Bien qu’aujourd’hui le nationalisme en Catalogne ait pris le dessus, cela n’empêche pas le nationalisme basque (échaudé par l’échec du plan Ibarretxe) de faire profil bas et de prendre son mal en patience pendant qu’il se rend indispensable au gouvernement et joue ses cartes dans l’ombre, incitant à une plus grande autonomie/autodétermination.
[10] Esquerra Republicana de Catalunya, en français : Gauche Républicaine de Catalogne. (NdT)
[11] Convergència i Unió (Convergence et Union), aujourd’hui devenue Junts per Catalunya (Ensemble pour la Catalogne ou JxCat). (NdT)
[12] Après la mort de Franco et le retour de Tarradellas (ERC, ancien ministre de l’Intérieur de la Généralité, organisateur avec le Parti communiste de l’Union soviétique et d’autres de la répression de mai 1937), ce fut le parti créé par Pujol en 1974, qui, en réalité, était au cœur du nationalisme catalan, avec un “projet politique de secteurs de la bourgeoisie, de la petite bourgeoisie et de la classe moyenne à haut revenu, ainsi que de composantes importantes de l’Église en Catalogne, qui tente de mobiliser de larges secteurs de la société catalane…” Comme le dit un historien, c’est un parti à deux facettes : l’une “centriste”, désireuse de s’allier aux “partis de Madrid”, et l’autre déjà populiste, autour de la figure centrale de Pujol.
Ce parti, Convergència Democràtica de Catalunya (CDC), a commencé à perdre du poids suite au retrait de Pujol et des scandales de corruption de son clan familial. Dès lors, la facette ultra-nationaliste est apparue, brisant la coalition (CiU) avec les régionalistes marginaux de l’UDC et la partie moins catalaniste du CDC, tombant entre les mains de personnages au style aventurier comme Puigdemont, ou à des illuminés comme Torra, sans parler de son entourage. Ce parti est aujourd’hui l’expression même de la symbiose du populisme et du nationalisme, entérinée par les changements successifs d’ “en-tête” : PDCat, alors devenu JxCat. Ce parti du “seny” (bon sens, en catalan) bourgeois a fini entre les mains de personnes qui se sont alliées ou qui contrôlent les nationalistes de gauche du CUP, du CDR et autres Tsunamis démocratiques (TD), qui se sont formés avec le rebut de groupes gauchistes du paysage politique catalan (trotskystes de toutes tendances, altermondialistes “anticapitalistes”, voire anarchistes).
Ces sbires de la contre-révolution, qui pendant des décennies, n’ont cessé de soutenir toutes sortes de nationalismes plus ou moins exotiques, ont finalement pu mettre en pratique leurs politiques dans leur propre pays. Telle est la nouvelle coalition du parti centre-droit de Catalogne, avec ce magma nationalo-gauchiste.
[13] Candidatura d’Unitat Popular (Candidature d’unité populaire, en catalan) et Comitès de Defensa de la República (Les Comités de défense de la République). (NdT)
[14] Une annonce faite de mensonges, comme l’ont reconnu les “braves” dirigeants indépendantistes.
[15] Partido Nacionalista Vasco (Parti nationaliste basque). (NdT)
[16] Parti socialiste unifié de Catalogne. (NdT)
[17] Voir sur notre site web : “L’antifascisme, la voie de la trahison de la CNT (1934-1936) [65]”.
[18]Partido Obrero de Unificación Marxista (Parti ouvrier d’unification marxiste). (NdT)
[19] Voir notre brochure en espagnol : “Franco y la Republica masacran al proletariado”.
Géographique:
- Espagne [16]
Personnages:
- Pedro Sanchez [66]
Rubrique:
Appel à la solidarité avec le CCI dans le milieu prolétarien face à une nouvelle attaque parasitaire
- 259 lectures
Quelques jours après la publication par le CCI à la fois en espagnol, en français, en anglais et en allemand (du moins, autant que je sache), cela en raison de l’importance et de la gravité de l’affaire, d’un appel à la responsabilité du milieu prolétarien pour assurer sa défense1 contre les agissements d’un élément ayant une activité très nocive et qui a toujours refusé de clarifier son comportement, le GIGC (ex-FICCI) a publié un communiqué pour défendre cet élément2 et surtout attaquer le CCI.3
En solidarité, je commenterai certains passages de la déclaration du GIGC :
“Il en va de même du seul reproche “politique” qu’il porte : Nuevo Curso n’a pas répondu aux critiques, dont les nôtres, portant sur sa revendication historique de l’Opposition de gauche trotskiste des années 1930. Mais quelle autorité peut avoir le CCI en la matière, lui qui se refuse obstinément à répondre publiquement à ceux, dont nous sommes aussi, qui relèvent ses abandons successifs et gravissimes des principes marxistes”.
C’est la logique même du : “œil pour œil, dent pour dent”. Selon le GIGC, le CCI n'était pas en droit d'attendre une réponse de Nuevo Curso car ce dernier ne répond pas publiquement aux critiques du GIGC. dont il mentionne même pas le nom. Pour commencer, c’est un grand mensonge de prétendre que le CCI n’a pas répondu au GIGC (et cela peut être vérifié sur le site internet lui-même).4 Et pour finir, cet “œil pour œil, dent pour dent” est un principe totalement étranger à la classe ouvrière. Il serait très important que certains éléments du milieu prolétarien appellent au débat sur certaines questions, même si dans la logique de leur démarche interne, ils refusent de répondre provisoirement à d’autres questions.
“Nous l’avions déjà signalé l’été dernier : “Le CCI lance aujourd’hui une véritable attaque parasitaire – pour reprendre ses propres termes – vis-à-vis de ces forces, en particulier vis-à-vis du Gulf Coast Communist Fraction, en essayant de les convaincre de débattre en priorité du parasitisme””. Le texte ajoute : “Peu importe pour le CCI que le GCCF ait affiché son opposition à cette position, le fait même de réussir à leur faire accepter une réunion sur ce thème en lieu et place des questions politiques liées à l’expérience et aux leçons programmatiques de la Gauche communiste, est déjà en soi un piège pour de nouvelles forces sans expérience ”.
Le CCI a cherché à discuter de cette question importante en priorité afin de clarifier une divergence importante avec la GCCF (sans pour autant laisser de côté “les questions politiques liées à l’expérience et aux leçons programmatiques de la Gauche communiste”, comme s’il y avait une contradiction entre les deux ! C’était précisément une des questions politiques soulevées par ce groupe !) et il pensait que son contact étroit avec le parasitisme constituait une menace à discuter d’urgence avec ce groupe. Le CCI cherche avant tout à encourager la discussion et la clarification, et si le GCCF a exprimé un désaccord, ce n’est pas quelque chose de négatif qui clôturait le débat une fois pour toutes. Le CCI n’a rien fait “accepter” à la GCCF, leurs membres ont décidé d’accepter cette discussion et ont finalement décidé de la clore. Le CCI n’a ni les moyens ni l’intention de faire accepter de force ses positions ni d’embrouiller le débat. Il a recherché au contraire la poursuite de ce débat pour le développer dans la plus grande clarté possible.5 Le GIGC traite les éléments du groupe GCCF comme s’ils n’étaient que des suivistes sans force de volonté ni sens des responsabilités pour défendre la cohérence de leurs positions. C’est ce traitement ambivalent auquel s’exposent ceux en contact étroit avec le parasitisme.
D’un autre côté, comment un groupe qui se présente comme “cohérent avec lui-même” peut-il utiliser et adopter des concepts avec lesquels il est en désaccord : “une attaque parasitaire – en utilisant les propres termes”. Ce ne peut être qu’une instrumentalisation puérile du “c’est celui qui le dit qui l’est !”. Cela s’inscrit dans la dynamique parasitaire typique d’accuser les autres de suivre leur propre logique, et de projeter sur d’autres ce qu’ils font eux-mêmes. Ils disent même cela de manière plus sophistiquée, pour pouvoir accuser le CCI en retour. Sans doute, certains éléments le font consciemment, mais d’autres s’enferment dans le cercle vicieux de la conception du “œil pour œil, dent pour dent”. Il est important de sortir de ce cercle des accusations faciles et disséminées à tort et à travers pour distinguer les allégations sérieuses et fondées pour défendre le milieu prolétarien de la calomnie. Dans tout ce rideau de fumée d’accusations, toutes peuvent sembler identiques. Le CCI, cependant, ne nie pas la nécessité de porter des accusations sérieuses, rigoureuses, fondées et courageuses, pour la défense du milieu prolétarien, et déclare qu’il s’agit d’une question grave qui ne doit pas être prise à la légère et qu’elle requiert discrétion et enquête approfondie. Ce n’est pas quelque chose de nouveau qui surgirait avec le CCI mais qui appartient à la tradition de la défense de la classe ouvrière (contre Vogt, Lassalle, Schweitzer, l’Alliance de Bakounine, etc.) et ce n’est pas un outil qui vise à enfoncer personnellement des individus, mais à clarifier et distinguer les comportements qui appartiennent à la classe ouvrière et ceux qui n’en font pas partie, sur la base d’une enquête sérieusement menée sur les éléments avec une attitude trouble, pour assurer la défense du milieu prolétarien. Le CCI cherche également à distinguer ce type de calomnie de la diffamation, deux choses qui ne relèvent pas d’une vague unité confuse mais sont bien distinctes.
Les éléments qui composent le milieu politique prolétarien doivent chercher à clarifier ce qui se cache derrière cette attaque du GIGC non pas en partant de préjugés, mais à partir d’une méthode d’analyse et de la recherche de la clarté. Non en sortant les mots de leur contexte, mais aussi clairement que possible en lisant attentivement leur texte qui s’oppose aux documents du CCI et à son activité générale. En plus, il importe de suivre le reste des textes publiés par le CCI sur le GIGC ou la FICCI, et de les comparer avec ceux publiés par le GIGC sur le CCI. Ce n’est qu’ainsi que nous pourrons faire face à la confusion et à l’embourbement du milieu prolétarien. La rigueur et le sérieux sont nécessaires. Cette rigueur méthodique et ce sérieux me conduisent à une dénonciation claire de ce type d’activité parasitaire, et à distinguer qui fait partie du milieu prolétarien et qui, même s’il prétend le contraire pour d’autres raisons, n’en fait pas partie. La recherche de la clarté est fondamentale, elle est une démarche essentielle pour la classe ouvrière. Le CCI ne cherche pas à dénaturer les propos des groupes parasites, ni de la bourgeoisie.
“On voit mal l’intérêt que le PS et l’État espagnol auraient à créer de toute pièce un groupe comme Nuevo Curso dont la dénonciation du caractère capitaliste du… PS lui-même est systématique. Et qui, d’autre part, a joué un rôle actif dans l’émergence et le regroupement international de nouvelles forces révolutionnaires et communistes, particulièrement sur le continent américain ”.
Le CCI n’a jamais dit que le PSOE avait créé Nuevo Curso. Quiconque lit l’article du CCI peut le constater. C’est donc un mensonge.6 Ce n’est pas que le GIGC soit confus ou incapable de distinguer les choses. Le GIGC n’a pas d’autre moyen pour maintenir son existence que d’attaquer le CCI. Ici, il fait passer l’idée que tout ce qui, apparemment, rassemble des forces révolutionnaires constitue une réalité dans ce sens. Il est contraire à la nature du GIGC de reconnaître l’existence de groupes qui dénoncent le système capitaliste, mais qui n’appartiennent pas à la classe ouvrière, même s’ils s’en revendiquent (comme l’Alliance de Bakounine ou comme eux-mêmes) et de rechercher la clarté à ce sujet. Donc ils fourrent tout dans le même sac, pour se camoufler. La superficialité avec laquelle ils défendent Nuevo Curso (bien que ce ne soit pas NC mais Gaizka l’axe principal des investigations du document du CCI) est la même que celle qui pourrait être utilisée pour défendre le gauchisme (bien que NC ne fasse même pas partie du gauchisme ni de la Gauche communiste). Que se passe-t-il alors ? Il ne se soucie pas du tout de savoir si l’honneur de cet individu est défendable ou non. Trouver des éléments pour enquêter et comprendre aiderait à éliminer le rideau de fumée derrière lequel se cache le GIGC. Le GIGC ajoute d’ailleurs, avec une grande hypocrisie, soit dit en passant, que parler d’individus spécifiques, c’est entrer dans la “psychologie des individus et des supposés comportements individuels” et qu’il s’agit d’un terrain “nauséabond et destructeur” où il est impossible de vérifier quoi que ce soit. Une fois de plus, le GIGC attaque la conscience de la classe ouvrière, en l’empêchant de reconnaître des comportements qui n’ont rien de prolétariens et en la rendant très craintive à l'idée de comprendre les comportements individuels.
En outre, le CCI met clairement en garde “les participants au blog de Nuevo Curso qui le font de bonne foi”. Le but du CCI est de faire revenir ces éléments dans le camp prolétarien avec la plus grande clarté et la meilleure qualité possible, et non de détruire, renverser ou démolir des organisations, comme l’exprime le GIGC. Dans sa dénonciation du parasitisme, le CCI offre une perspective positive.
Le CCI “N’a-t-il pas émis une résolution interne appelant à la destruction de la TCI (ex-BIPR) lors de son 16e congrès de 2005 ? Aujourd’hui c’est au tour de Nuevo Curso”.
Le GIGC ne met pas de liens web vers les textes du CCI, il ne cite que les éléments qui lui conviennent, hors de tout contexte. Ils veulent même y mêler le dernier Congrès du CCI7 mais, pour commencer, ils ont tout à fait tort de dire que le CCI renie la nécessité de la lutte des classes. Seulement, ils ne cherchent pas à comprendre la théorie du cours historique, ils l’utilisent simplement comme une arme pour lancer leurs attaques anti-CCI.
De plus, ils font allusion et déforment les débats internes du CCI en 2005 ! Mais le GIGC, anciennement FICCI a été exclu du CCI en 2003. Comment ont-ils fait pour se procurer ces documents ? Et ils osent affirmer péremptoirement que le CCI a demandé la destruction de la TCI !8 Dans ce contexte, je demande, en tant que sympathisant du CCI et de la Gauche communiste, à la TCI d’exprimer sa solidarité avec le CCI au nom de la défense du milieu prolétarien.
Je n’irai pas plus loin dans le commentaire de ce document du GIGC, qui doit être analysé plus en profondeur. Mon intention est seulement d’exprimer le plus rapidement possible ma solidarité avec le CCI.
Fraternellement
TV, 19 février 2020.
[1] “Qui est qui dans Nuevo Curso ?” sur notre site internet. (NdR)
[2] Plus qu’en défense de cet élément, le GIGC prétend défendre le groupe Nuevo Curso, cherchant à faire passer Gaizka pour un épouvantail agité par le CCI. Ensuite, ses accusations de “personnalisation de divergences politiques” signifient, en réalité, déguiser l’individu en le cachant derrière le groupe, et travestir, en les dénaturant, les arguments du CCI. Le GIGC, n’a évidemment aucun intérêt à théoriser une distinction entre, d’une part, l’enquête rigoureuse sur l’honneur d’individus suspectés d’être des aventuriers afin d’assurer la défense du milieu prolétarien et, d’autre part, les attaques personnelles. Cependant, il n’a eu aucun scrupule à faire contre le CCI ce qu’il prétend aujourd’hui dénoncer en révélant le nom de militants qu’il cherchait à discréditer : https://fr.internationalism.org/ri330/ficci.html [67] Le CCI a sérieusement enquêté sur cet individu en lui donnant l’occasion de s’expliquer à plusieurs reprises. S’il était honnête, il aurait considéré que l’enquête du CCI sur lui était injustifiée, il lui appartiendrait alors de clarifier son activité plus que suspecte, ainsi que de justifier son refus de s’en expliquer par le passé.
[4] Le CCI a répondu aux attaques du GIGC, bien qu’il ne soit bien sûr pas entré dans son jeu en l’incluant dans la Gauche communiste, en le traitant comme tel. Malgré cela, il s’est défendu contre ses attaques en répondant à ses calomnies et fausses déclarations depuis qu’il a constitué sa fausse fraction interne du CCI. Il suffit d’écrire “ficci”, “gigc”, “giic” ou “igcl” dans le moteur de recherche du site internet du CCI en espagnol, en anglais ou en français pour voir que le CCI n’a pas ignoré le GIGC, mais a recherché la plus grande clarté sur ses comportements.
[5] Le CCI, et l’on peut voir la maturité à cet égard dans les résolutions du 23e Congrès dernier, comprend que la lutte contre le parasitisme est l’une des luttes politiques fondamentales de cette période de décomposition. Ce phénomène, n’a rien d’extraordinaire dans la société bourgeoise, par rapport auquel il est loin d’être un corps étranger. Face à cela, il est nécessaire de lutter pour la défense de l’organisation contre des groupes qui prétendent faire partie du milieu politique prolétarien (aux origines diverses et hétérogènes) mais dont l’activité collective (malgré l’inclusion de positions contradictoires) vise à détruire les véritables organisations révolutionnaires, de la manière la plus voilée possible, pas nécessairement à travers des attaques frontales et continues qui leur feraient perdre leur apparence. Son origine n’est pas nécessairement la présence d’agents rémunérés par la bourgeoisie, car le GIGC a l’intention de déformer ce que dit le CCI pour fabriquer un épouvantail (bien que ce soit un bon terrain pour l’infiltration de tels éléments, mais aussi pour des aventuriers politiques et des ambitieux déclassés en mal de reconnaissance). Distinguer ces groupes des véritables organisations révolutionnaires est une question qui doit être abordée de manière méthodique et rigoureuse, en recherchant la clarté et la discussion avec des éléments en recherche qui ont du mal à aller au-delà des apparences. Il est important de distinguer, par exemple, le parasitisme du gauchisme, d’une part, et du marais, de l’autre, ou des éléments en recherche, car la confusion réelle en leur sein pourrait être confondue avec l’utilisation et la propagation de ces confusions à des fins propres. Les outils pour faire cette distinction sont fondamentaux et ne sont pas une invention du CCI.
[6] La déformation est très claire pour ceux qui ont lu les deux textes. Le CCI déclare qu’ “il est le principal animateur de Nuevo Curso” et “qu’aujourd’hui Gaizka prétende créer avec Nuevo Curso un lien “historique” avec une soi-disant Gauche communiste espagnole”, mais à aucun moment il ne dit que le PSOE a créé NC. Qu’un individu en contact régulier, bien qu’en alternance (avec la droite aussi), avec des hauts responsables de la bourgeoisie dans sa carrière alors qu’il était en contact avec le CCI, ait été le principal animateur de NC ne signifie pas nécessairement que la bourgeoisie a créé ce groupe.
[7] “en particulier celui de son dernier congrès liquidant le principe fondamental et central du marxisme de la lutte des classes comme moteur de l’histoire : « la dynamique générale de la société capitaliste (…) n’est plus déterminée par le rapport de forces entre les classes » (Résolution du 23e congrès du CCI) ?”
[8] Pour le CCI, le TCI est une organisation de la Gauche communiste ! Il y a peut-être eu alors un débat interne sur la TCI (mais sûrement pas dans les termes avancés par le GIGC !) mais si cela avait été une résolution du CCI, cela aurait été publié. Ou s’agit-il d’une contribution hors contexte ? Nous ne savons pas. Je ne connais pas cette discussion interne, fictive ou réelle, ni son contenu. Ce qui est clair, c’est la nature malveillante du GIGC, qui rend le document du CCI équivalent à une prétendue conspiration interne et secrète contre la TCI : pourquoi cherchent-ils à rompre la nécessaire solidarité entre les deux organisations ?
Rubrique:
Covid-19: Soit le prolétariat mondial met fin au capitalisme, soit le capitalisme met fin à l’humanité!
- 337 lectures
Nous publions ci-dessous un article réalisé par Acción Proletaria et Rivoluzione Internazionale, organes de presse du CCI en Espagne et en Italie, qui démontre que dans tous les pays, face à la pandémie, la bourgeoisie étale son incurie criminelle et son mépris pour la vie des travailleurs.
L’État capitaliste se présente aujourd’hui comme notre “sauveur”. C’est une arnaque de la pire espèce. Face à l’avancée de la pandémie, qu’ont-ils fait ? Le pire ! Partout, dans tous les pays, ils ont pris les mesures au dernier moment, contraints et forcés face à l’amoncellement de morts ; ils ont maintenu des millions de travailleurs sur leur lieu de travail, sans masque, sans gel, sans gants et entassés. Pourquoi ? Pour continuer de produire, coûte que coûte ! Ils espéraient ainsi gagner des parts de marché face à la concurrence de leurs rivaux en difficulté ! “La Chine est à terre ? Produisons !”, “L’Italie est à terre ? Produisons !”, et ainsi de suite. Même sous la vague de l’épidémie, lorsque le confinement est déclaré, la pression pour soutenir “la santé de l’économie” et les “entreprises qui souffrent” ne cessent pas ! Les déclarations de Trump ou de Bolsonaro sur “l’économie avant tout” ne sont que la caricature de la politique assassine des dirigeants de tous les gouvernements de la planète.
Ce faisant, chaque bourgeoisie nationale met en fait sa propre activité en danger en favorisant la propagation du virus. En riposte, un certain nombre de grèves sont apparues en Italie, en Espagne, en Belgique, en France, aux États-Unis, au Brésil, au Canada… Certes, ces luttes sont limitées, comment pourrait-il en être autrement avec le confinement et l’impossibilité de se rassembler ? Mais justement, leur existence dans plusieurs pays dans ces conditions extrêmement difficiles pour la lutte de classe démontre que, dans certaines parties de la classe ouvrière, existe une résistance au “sacrifice” exigé, à l’idée de servir de chair à canon pour les intérêts du capital. Nous ne pouvons pas nous en remettre à l’État capitaliste qui profite de son rôle de “coordinateur” dans la lutte contre la pandémie pour renforcer davantage son contrôle totalitaire, l’atomisation, l’individualisme et développer une idéologie d’union nationale et même de guerre.
Plus que jamais, cette pandémie nous offre une alternative claire : soit nous laisser emporter par la barbarie du capitalisme, soit contribuer patiemment et avec une vision d’avenir à la perspective de la révolution prolétarienne mondiale.
Aujourd’hui, les rues de Madrid offrent le spectacle du ballet ininterrompu d’ambulances hurlantes, du chaos des services de santé et de douleurs comparables à celle des attentats d’Atocha en 2004 (193 morts et plus de 1 400 blessés). Mais, cette fois, il s’agit d’une pandémie qui a déjà fait 2 300 morts et près de 35 000 personnes infectées en Espagne selon les chiffres officiels, une épidémie qui se propage à une vitesse supérieure à celle atteinte en Italie qui, il y a quelques jours, avait déjà battu tous les records en termes de décès quotidiens (651). Sa létalité (plus de 7 000 décès) fait d’ores et déjà considérer cette épidémie comme la pire catastrophe sanitaire dans les deux pays depuis la Seconde Guerre mondiale. Ces pays ne sont que les signes annonciateurs de ce qui attend probablement les populations des métropoles comme New York, Los Angeles, Londres, etc. Une réalité qui sera encore pire lorsque cette épidémie frappera plus durement l’Amérique latine, l’Afrique, et d’autres régions du monde où les systèmes de santé sont encore plus précaires ou carrément inexistants.
Mais auparavant, pendant des semaines, les dirigeants d’Espagne et d’Italie, – tout comme en France (comme nous l’avons montré dans l’article de notre publication en français)[1] et sans aucun doute d’autres puissances capitalistes, – pouvaient parfaitement imaginer les dégâts que cette épidémie allait causer. Pourtant, comme les autres États capitalistes (pas seulement le populiste Johnson en Grande-Bretagne ou Trump aux États-Unis), ils ont décidé de placer les besoins de l’économie capitaliste avant la santé de la population. Désormais, dans leurs discours histrioniques et hypocrites, ces dirigeants se disent prêts à tout pour protéger la santé de leurs citoyens, et ils accusent le “virus”, contre lequel ils prétendent avoir “déclaré la guerre”.
Mais la responsabilité des décès causées par la pandémie est entièrement imputable aux conditions sociales, à un mode de production qui, au lieu d’utiliser le développement des forces productives, des ressources naturelles, de l’avancement des connaissances pour favoriser la vie, immole la vie humaine et la nature sur l’autel de la loi du profit.
La classe exploitée est la principale victime de cette pandémie
On nous martèle que cette pandémie affecte tout le monde sans distinguer les riches ou les pauvres. Ils diffusent les cas de certaines “célébrités” touchées ou même tuées par le Covid-19. Mais de telles anecdotes sont mises en avant pour cacher que ce sont les conditions d’exploitation des travailleurs qui expliquent la montée et la propagation de cette pandémie.
Premièrement, en raison des conditions de surpopulation des quartiers dans lesquels les exploités doivent vivre, qui sont un terreau propice à la propagation des épidémies. Ceci est facilement vérifiable vu l’incidence plus élevée de cette pandémie dans les régions industrielles à forte concentration humaine (Lombardie, Vénétie et Émilie-Romagne en Italie, Madrid, Catalogne et Pays basque en Espagne), que dans les régions moins peuplées (Sicile, Andalousie) à cause de ces mêmes besoins d’exploitation. L’aggravation du problème du logement des travailleurs accentue encore cette vulnérabilité. Dans le cas de Madrid, les hôpitaux qui souffrent de la plus grande saturation et dont les services s’effondrent, correspondent essentiellement à ceux qui desservent la population des villes industrielles du sud. Dans les logements vétustes et surpeuplés, il est également plus difficile de supporter la quarantaine décrétée par les autorités sanitaires. Dans les “chalets” de Somosierra ou les villas de la ville de Nice où Berlusconi se réfugie avec ses enfants, l’isolement est plus supportable. Les exploiteurs cherchent ainsi, et avec quel cynisme, à se vanter de “leur sens civique”.
Ne parlons pas des répercussions sur la population vivant d’emplois précaires qui doivent, en plus, s’occuper de jeunes enfants ou de personnes âgées qui sont entassées dans de tels types de logements. Le cas des personnes âgées est particulièrement scandaleux qui, après avoir été exploitées tout au long de leur vie, sont aujourd’hui contraintes de vivre seules, ou négligées dans des “résidences” régies par les seules lois du profit capitaliste. Avec un soignant pour 18 patients en moyenne, les maisons de retraite sont devenues l’une des principales sources de propagation de la pandémie, comme on l’a vu en Espagne non seulement parmi les prétendus “pensionnaires”, mais aussi parmi ceux qui y travaillent et qui, avec des contrats temporaires et des salaires de misère, ont été contraints de s’occuper de patients à risque, souvent sans [69]mesures [69]minimales d’autoprotection. La situation est identique en France, jusqu’à récemment présentée comme un modèle étatique de protection sociale. En Espagne, le comble a été atteint pour des patients hospitalisés, qui doivent rester isolés dans leurs chambres à côté des cadavres de leurs compagnons d’infortune décédés, car les services funéraires sont débordés ou manquent de mesures d’autoprotection qui ne suffisent pas à recueillir les dépouilles mortelles. De même, les transferts vers des hôpitaux totalement saturés sont retardés et l’avenir qui attend les malades est, dans de nombreux cas, d’être relégués comme patients de troisième ou quatrième catégorie, par les règles d’un “tri” déterminées en considération des ressources matérielles et personnelles et des critères du rapport coûts/bénéfices. Ces critères constituent de véritables atteintes à la dignité humaine et à la vie, aux instincts sociaux qui ont permis à l’humanité de se développer, et qui aujourd’hui sont mis en place, ouvertement, par les autorités italiennes, espagnoles, françaises, etc.
On peut ajouter à cela la surexploitation et la surexposition au virus désormais bien connues des travailleurs de la santé qui concentrent à eux-seuls entre 8 et 12 % des cas d’infections : plus de 5 000 seulement en Espagne. Même ces statistiques sont en fait largement tronquées, car une bonne partie de ces travailleurs n’ont pas pu être testés pour savoir s’ils sont infectés ou non par le coronavirus. Pourtant, ils sont obligés de travailler sans les gants, masques et blouses de protection nécessaires, qui ont été considérés comme des dépenses “superflues” pour les budgets de santé et le fonctionnement de l’économie capitaliste. Comme dans les hôpitaux, les lits de soins intensifs, les respirateurs, la recherche sur les coronavirus, les remèdes et les vaccins possibles,… tout cela a été sacrifié au nom de la rentabilité de l’exploitation. Aujourd’hui, les cahiers de doléances médiatisées, en particulier véhiculées par les personnalités politiques de “gauche”, tentent de détourner la colère de la population contre la “privatisation” du système des soins de santé. Mais quel que soit le propriétaire de l’hôpital, du laboratoire pharmaceutique ou de la maison de retraite, la vérité est que la santé de la population est soumise à la règle du profit que peut retirer une minorité exploiteuse au détriment de l’ensemble de la société.
La défense de la vie contre les lois de l’exploitation
La dictature des lois du capital sur les besoins humains s’est clairement révélée dans la mise en place des mesures de quarantaine et de confinement en Italie, en Espagne et en France, pays qui ont imposé des restrictions draconiennes pour faire les courses, supprimer les visites aux personnes âgées, isoler des enfants ou des patients en situation de handicap, mais qui ont néanmoins été totalement laxistes sur d’autres déplacements pour inciter la population à se rendre sur les chantiers de construction, pour charger les navires avec des conteneurs de toutes sortes de matériaux, pour maintenir coûte que coûte la production dans différentes usines (textile, appareils électroménager, chaînes d’automobiles, etc.). Et pour “sécuriser” ces conditions d’exploitation, tout en poursuivant quelques “joggers” ou ouvriers qui prennent la voiture en petits groupes pour se rendre au travail (et économiser une partie des frais de déplacement), l’utilisation du métro ou des transports en commun est autorisée jusque dans les banlieues pour que “la production nationale” se poursuive. De nombreux travailleurs sont scandalisés par le cynisme criminel de la bourgeoisie et expriment leur colère à travers les réseaux sociaux, car dans les conditions actuelles, il est impossible de le faire ensemble dans la rue ou dans les assemblées. Ainsi, face à la campagne assurée par les principaux médias avec le slogan “Restez chez vous !”, un hashtag tout aussi populaire a été lancé #Je-ne-peux pas-rester-à-la-maison à travers lequel s’expriment des livreurs (Deliveroo, Uber), des aides à domicile, des travailleurs du vaste secteur de l’économie souterraine, etc.
Des protestations et des grèves ont également éclaté contre le maintien du travail dans des conditions qui méprisent la vie et la sécurité des travailleurs. Comme il a été crié lors des manifestations en Italie : “Vos profits valent plus que notre santé !”
En Italie, cette colère a explosé depuis le 10 mars à l’usine FIAT de Pomigliano où 5 000 travailleurs sont présents quotidiennement. Les ouvriers se sont mis en grève pour protester contre les conditions précaires dans lesquelles ils ont été contraints de travailler. Dans d’autres usines du secteur de la métallurgie, à Brescia, par exemple, les ouvriers ont posé un ultimatum aux entreprises pour qu’elles adaptent la production aux besoins de la protection des travailleurs, en menaçant de se mettre en grève. Finalement, les entreprises ont décidé de fermer les usines. Et lorsque, plus récemment, le 23 mars, un décret ultérieur du Premier ministre Conte a donné le feu vert à la poursuite du travail dans des industries pas forcément essentielles, des grèves spontanées ont de nouveau éclaté, ce qui a conduit le syndicat CGIL à faire semblant d’appeler à une “grève générale”.
En Espagne, cela a commencé dans l’usine Mercedes de Vitoria, après l’apparition de cas d’infection par le Covid-19 lorsque les travailleurs ont décidé d’arrêter immédiatement le travail. La même chose s’est produite dans l’usine de produits électroménagers Balay à Saragosse (1 000 travailleurs) ou dans l’usine Renault de Valladolid. Il faut dire que, dans bien des cas, c’est l’entreprise elle-même qui a décidé un lock-out (comme à Airbus à Madrid, à la SEAT à Barcelone ou chez Ford à Valence dans la même période, puis chez PSA à Saragosse ou chez Michelin à Vitoria) pour que ce soient les caisses de l’État (autrement dit la plus-value extraite de la classe ouvrière dans son ensemble) qui assument le paiement d’une partie du salaire de ses travailleurs, alors qu’en réalité, avant la pandémie, il y avait déjà des plans de licenciement (dans les usines Ford ou chez Nissan à Barcelone).
Mais il y a aussi des manifestations ouvertes de combativité de classe comme la grève sauvage, c’est-à-dire en marge et contre les syndicats, qui a eu lieu dans les bus à Liège (Belgique) contre l’irresponsabilité de l’entreprise de faire travailler ses employés restant exposés à la contagion, alors que la Belgique avait été l’un des premiers pays à promulguer une fermeture du pays. Il en va de même, par exemple, du personnel de la boulangerie Neuhauser et des chantiers navals ou de la société SNF à Andrézieux (près de Lyon). En France, il y a eu des expressions très dures de protestation dans les chantiers navals de Saint-Nazaire. C’est ainsi qu’un travailleur de ces chantiers navals s’est exprimé à la télévision : “Je suis obligé de travailler dans des espaces confinés avec 2 ou 3 collègues dans des cabines de seulement 9 m² et sans aucune protection. Ensuite, je dois retourner chez moi où ma femme et mes enfants sont confinés. Et je me demande avec angoisse si je ne représente pas un danger pour eux. Je ne peux pas supporter cela”.
Au fur et à mesure que l’épidémie se propage avec ses effets désastreux sur les travailleurs, des foyers, même minoritaires, de protestations ouvrières naissent de cette imposition de la logique et des besoins de l’exploitation capitaliste : nous l’avons vu à la FIAT-Chrysler des usines de Tripton (dans l’Indiana) qui protestaient contre le fait de devoir se rendre au travail quand il est interdit de se réunir en dehors des usines. Des réactions similaires ont pu être observées dans les usines de Lear à Hammond, également dans l’Indiana, dans les usines FIAT de Windsor (Ontario au Canada), ou dans l’usine de camions Warren dans la périphérie de Détroit. Les chauffeurs de bus de la ville de Detroit ont également interrompu leur travail jusqu’à ce que l’entreprise leur assure un minimum de sécurité au travail. Il est très significatif que, dans ces luttes aux États-Unis, les travailleurs aient dû imposer leur décision de cesser de travailler contre la consigne donnée par le syndicat (en l’occurrence l’UAW) qui les a encouragés à continuer de travailler afin de ne pas nuire aux intérêts de l’entreprise.
Dans le port de Santos (Brésil), des travailleurs ont manifesté contre les obligations imposées par les autorités de se rendre au travail. Également dans ce pays, il y a une préoccupation croissante parmi les travailleurs des usines Volkswagen, Toyota, GM, etc. contre le fait de devoir poursuivre la production comme s’il n’y avait pas de pandémie.
Si limitées que soient ces protestations, elles constituent une part importante de la réponse de classe du prolétariat à la pandémie, qui a indubitablement un caractère de classe contre le capitalisme. Même sur un terrain purement défensif, les exploités refusent d’accepter d’être réduits à de la chair à canon pour les intérêts de leurs exploiteurs.
La réponse de la bourgeoisie : hypocrisie et totalitarisme d’État
La bourgeoisie elle-même est consciente du potentiel de développement de la combativité et de la conscience du prolétariat que contient cette accumulation d’agitation, d’indignation et de sacrifices qui sont exigés des travailleurs. Désormais, même les principaux protagonistes de “l’austéricide”[2] (comme Merkel, ou Berlusconi, ou l’espagnol Luis de Guindos) sont plein la bouche de promesses d’aide sociale. Mais les armes de la classe exploiteuse restent les armes traditionnelles de toute l’histoire de la lutte des classes : tromperie et répression.
L’hypocrisie des campagnes d’applaudissements a été programmée et organisée partout en faveur des travailleurs du secteur sanitaire. Bien sûr, ces prolétaires méritent toute la reconnaissance et la solidarité car ce sont essentiellement eux qui, avec leurs efforts et leur soutien, essaient de maintenir les soins de santé à flot. Ils le font depuis des années contre les suppressions d’emplois et la détérioration des ressources matérielles. Ce qui est d’un cynisme répugnant, c’est de voir comment les autorités gouvernementales qui ont précisément créé ces conditions de surexploitation et d’impuissance de ces travailleurs, cherchent à associer leur prétendue “solidarité” avec l’idée que nous devrions tous nous sentir embarqués dans le même bateau, en chantant l’hymne national et en exaltant les valeurs nationalistes comme réponse à la propagation de la pandémie. Le nationalisme dégoûtant de ces “mobilisations” promues par les propres organes de l’État tente de cacher qu’il ne peut y avoir le moindre intérêt commun entre exploiteurs et exploités, entre capitalistes et personnes affectées par la dégradation des infrastructures sanitaires, entre ceux qui ne se préoccupent que du maintien de la production et de la compétitivité du capital national et ceux qui placent le respect de la vie et des besoins humains au premier plan. La “patrie” n’est qu’un énorme bobard pour les travailleurs, qu’elle soit mise en avant par des fractions populistes comme Salvini et Vox, ou par des chantres de la démocratie comme Podemos, Macron et autres Conte.
Au nom précisément de cette mensongère “solidarité nationale”, les citoyens sont appelés à dénoncer les personnes qui “outrepassent” la quarantaine, favorisant un climat de “chasse aux sorcières” envers des mères d’enfants autistes ou des couples âgés qui font du shopping ou même du personnel de santé se rendant dans les hôpitaux. Il est particulièrement cynique de blâmer quelques “contrevenants” pour la propagation de la pandémie, pour les décès causés par celle-ci ou pour le stress subi par le personnel soignant.
Il n’y a rien de plus antisocial (c’est-à-dire contraire à la communauté humaine) que l’État capitaliste qui défend précisément les intérêts de classe de la minorité exploiteuse, et qui le cache précisément avec la feuille de vigne de cette prétendue et fausse solidarité. De façon doublement hypocrite et criminelle, la bourgeoisie essaie d’utiliser le désastre causé par l’incurie de l’État capitaliste qui défend ses sordides intérêts de classe, comme un moyen d’opposer certains travailleurs à d’autres. Si les employés de l’hôpital refusent d’accepter de travailler sans moyens de protection, ils sont dénoncés comme étant “non solidaires” et menacés de sanctions, comme cela a été récemment le cas avec le licenciement du directeur médical de l’hôpital de Vigo (Galice) pour avoir osé dénoncer le “bla-bla” des politiciens bourgeois concernant les mesures de protection. Le gouvernement de Valence (les mêmes partis que la coalition “progressiste” qui gouverne l’Espagne) menace de censurer les images qui montrent l’état de santé [70]désastreux dans cette région, invoquant le droit à la “vie privée” des patients lorsqu’ils sont entassés dans les services d’urgence !
Si les travailleurs de la compagnie municipale de transports funéraires refusent de travailler sans protection avec les cadavres tués par le Covid-19, ils sont accusés d’être ceux qui empêchent la famille, les proches, les amis d’assister aux funérailles et de faire le deuil du défunt… Comme avec les conditions de logement ou comme lorsqu’ils nous font nous déplacer comme du bétail dans les transports en commun vers les lieux de travail, comme sur les lieux mêmes de travail où l’ergonomie est conçue en fonction de la productivité et non de la physiologie des travailleurs, ceux tués par le coronavirus sont aussi entassés dans des bâtiments transformés en morgues de masse improvisées comme le Palacio de Hielo (Palais de Glace) à Madrid.
Tout l’étalage de cette brutalité inhumaine nous est cependant présenté comme le summum de l’union de toute la société. Ce n’est pas un hasard si dans les conférences de presse du gouvernement espagnol, face aux questions angoissées qui sont posées (“quand arriveront les tests ? Et les masques ? Et les respirateurs ?”), on a invariablement la même réponse imperturbable et évasive du ministre de la Santé : “Dans les prochains jours…”) alors qu’à ses côtés apparaissent les généraux de l’armée, de la police, de la garde civile, bardés de toutes leurs médailles. Le but est d’imprégner les esprits de la population et la plonger dans une ambiance militariste bien connue : “Obéissez sans poser de questions”. La bourgeoisie profite également de l’occasion pour habituer la population à toutes sortes de restrictions aux dites “libertés civiles”, cela à la discrétion de l’Autorité gouvernementale, avec des effets hautement discutables, mais qui favorisent l’autodiscipline sociale et la délation comme nous l’avons vu précédemment et qui sont présentées comme le seul rempart contre les maladies et le chaos social. Ce n’est pas non plus par hasard que la bourgeoisie occidentale exprime aujourd’hui une fascination non dissimulée pour le contrôle que certains régimes totalitaires, comme celui du capitalisme chinois,[3] exercent sur la population. Si aujourd’hui le succès de “la mise en quarantaine” en Chine contre le coronavirus est autant salué, c’est aussi pour camoufler leur admiration pour les instruments de ce contrôle totalitaire de l’État (reconnaissance faciale, suivi des mouvements et rencontres de personnes, utilisation de ces informations pour classer la population en catégories selon leur niveau de “dangerosité sociale”), et pour être en mesure, à l’avenir, de présenter ces moyens d’un plus grand contrôle totalitaire de l’État exploiteur comme le moyen le plus efficace de “protéger la population” contre les épidémies et autres produits du chaos capitaliste.
La seule alternative, c’est le communisme
Nous avons montré comment, face à une crise sociale, se révèle l’existence de deux classes antagonistes : le prolétariat et la bourgeoisie. Qui est en train d’organiser le meilleur des efforts de l’humanité pour essayer de limiter l’impact de l’épidémie ? C’est essentiellement le travail des services sanitaires, des chauffeurs des transports en commun, des ouvriers des supermarchés et de l’industrie alimentaire qui ont constitué la planche de salut à laquelle se cramponne l'État en pleine débâcle. Il a été démontré une fois de plus que le prolétariat est, au niveau mondial, la classe productrice de la richesse sociale, et que la bourgeoisie est une classe parasite qui profite de cette démonstration de ténacité, de créativité, de travail d’équipe dans le but de faire fructifier son capital. Chacune de ces classes antagonistes offre une perspective complètement différente par rapport au chaos mondial dans lequel le capitalisme a plongé l’humanité aujourd’hui : le régime d’exploitation capitaliste précipite l’humanité dans toujours plus de guerres, d’épidémies, de misère, de désastres écologiques ; la perspective révolutionnaire libère l’espèce humaine de sa soumission aux lois de l’appropriation privée par une minorité exploiteuse.
Mais les exploités ne peuvent échapper individuellement à cette dictature. Ils ne peuvent échapper par des actions particulières aux orientations chaotiques d’un État qui agit, en effet, au profit d’un mode de production qui domine le monde entier. Le sabotage ou la désobéissance individuelle est le rêve impossible de classes qui n’ont aucun avenir à offrir à l’humanité dans son ensemble. La classe ouvrière n’est pas une classe de victimes impuissantes. C’est une classe qui porte en elle la possibilité d’un monde nouveau libéré précisément de l’exploitation, des divisions entre classes et nations, de la sujétion des besoins humains aux lois de l’accumulation.
Un philosophe (Buyng Chul Han) très à la mode pour sa description du chaos provoqué par les relations sociales capitalistes actuelles a récemment déclaré que “nous ne pouvons pas laisser la révolution au virus”. C’est certain. Seule l’action consciente d’une classe mondiale pour éradiquer consciemment les racines de la société de classe peut constituer une véritable force révolutionnaire.
Valerio, 24 mars 2020
[2] C’est le nom sous lequel avaient été “popularisées” les mesures décrétées par l’Union européenne face à la crise de 2008 et qui impliquaient, entre autres, un démantèlement des structures de santé.
[3] Évidemment pour le communisme authentique, la Russie, la Chine, Cuba et leurs variantes ne sont que l’expression extrême du caractère totalitaire de la forme de domination universelle du capitalisme d’État dans la période de décadence du capitalisme.
Géographique:
- Europe [24]
Récent et en cours:
- Coronavirus [55]
- COVID-19 [56]
Rubrique:
ICCOnline - avril 2020
- 84 lectures
Suspension des envois des journaux papiers
- 41 lectures
Nous n'avons pas été en mesure d'envoyer le journal de mars-avril à nos abonnés (Révolution internationale n° 481 [72]). Dans la situation actuelle de confinement, notre imprimeur a du momentanément fermer ses portes et nous n'avons pas trouvé d'autres solutions pour imprimer ce numéro. Nous procéderons à son envoi dès que la situation le permettra.
En attendant, vous pouvez consulter le journal en ligne sur notre site internet.
Nous invitons également les lecteurs souhaitant apporter leur soutien à la presse révolutionnaire, à s'abonner à notre presse (Voir la rubrique “Abonnements [73]”).
RI
DOSSIER SPÉCIAL COVID-19 : Le vrai tueur, c'est le capitalisme !
- 944 lectures
Nous publions désormais dans cette rubrique l'ensemble de nos articles sur la pandémie de Covid-19.
– Confinement: l’État bourgeois montre toute sa brutalité [74] (New)
– Guerre des vaccins: Le capitalisme est un obstacle à la découverte d’un traitement [75]
– Les groupes gauchistes face à la pandémie, chiens de garde et rabatteurs du capitalisme [76]
– La réponse chaotique de la bourgeoisie américaine face à la pandémie [77]
– L’impact profond de la crise du Covid-19 en Grande-Bretagne [78]
– Déconfinement scolaire: École “sans contact” et appel à la délation [80]
– Covid-19: Malgré tous les obstacles, la lutte de classe forge son futur [81]
– Covid-19: L’instinct de puissance de la bourgeoisie allemande [82]
– L’État capitaliste, responsable de la catastrophe dans les hôpitaux! [85]
– Pandémie du Covid-19: contribution d’un camarade proche [86]
– Covid 19: Des réactions face à l'incurie de la bourgeoisie [87]
– Pandémie du Covid-19: À Guayaquil (Équateur), le capitalisme sème la mort et l’horreur [88]
– Guerre des masques: la bourgeoisie est une classe de voyous! [90]
– Pandémie de COVID-19 en France: L’incurie criminelle de la bourgeoisie! [71]
Récent et en cours:
- Coronavirus [55]
- COVID-19 [56]
L’impact profond de la crise du Covid-19 en Grande-Bretagne
- 49 lectures
En Grande-Bretagne, la propagande permanente de la bourgeoisie sur la pandémie de Covid-19 a plusieurs thèmes, mais aucun n’est aussi répété et faux que le slogan : “Nous sommes tous ensemble face à la situation”, “Nous sommes tous dans le même bateau”. Le Premier ministre Boris Johnson est même allé jusqu’à remettre en cause une pierre angulaire du thatchérisme en affirmant : “Une chose que la crise du coronavirus a déjà prouvée, je pense, c’est qu’il faut considérer la question sociale”. En réalité, alors que n’importe qui peut contracter le virus, y compris Johnson, le ministre de la santé, le Chief Medical Officer et le prince Charles, la société de classes continue et la crise a des répercussions profondes mais différentes sur les services de santé, la vie politique de la bourgeoisie, l’économie et le prolétariat.
La pandémie est un désastre pour l’économie, elle risque d’aggraver la désorientation de la classe ouvrière et aggraver ses conditions d’existence, et elle a stimulé la propagande pour l’unité nationale, que la bourgeoise va essayer de faire fonctionner en rejetant toujours la faute sur le Covid-19. La seule chose à laquelle elle ne devrait pas échapper, c’est la responsabilité de la classe dirigeante d’avoir laissé le coronavirus se répandre dans la population. Il n’y a pas de statistiques fiables parce qu’il y a eu très peu de tests effectués, mais bien plus de personnes auront été touchées que ne le montrent les chiffres officiels. La responsabilité incombe à la bourgeoisie, car il existe déjà des prévisions selon lesquelles la Grande-Bretagne aura le plus grand nombre de décès en Europe, bien qu’elle ait été avertie lorsque le nombre de morts augmentait en Chine, en Iran, en Italie et en Espagne.
La crise sanitaire était prévue
Le système de santé n’a pas été en mesure de faire face au développement de la crise. En janvier dernier, la revue médicale The Lancet déclarait : “Les plans de préparation doivent être prêts à être déployés à court terme, notamment en sécurisant les chaînes d’approvisionnement en produits pharmaceutiques, en équipements de protection individuelle, en fournitures hospitalières et en ressources humaines nécessaires pour faire face aux conséquences d’une épidémie mondiale de cette ampleur”. Cela n’a pas été fait et le rédacteur en chef de Lancet a dénoncé cet échec : “Cet échec est dû en partie au fait que les ministres n’ont pas suivi le conseil de l’OMS de "tester, tester, tester" chaque cas suspect. Ils n’ont pas isolé et mis en quarantaine. Ils n’ont pas tracé les contacts. Ces principes de base de la santé publique et du contrôle des maladies infectieuses ont été ignorés, pour des raisons qui restent opaques. Le résultat a été le chaos et la panique dans tout le NHS”. (1) Quant aux mesures mises en place, “ce plan, adopté beaucoup trop tard au cours de l’épidémie, a laissé le NHS totalement désemparé face à l’afflux de patients gravement malades qui ne tardera pas à arriver”.
Les défaillances du NHS ne sont pas nouvelles. Au cours des trente dernières années, le nombre de lits d’hôpitaux a été réduit de 299 000 à 142 000. L’Allemagne compte 621 lits d’hôpital pour 100 000 habitants, contre 228 pour 100 000 en Grande-Bretagne. L’Allemagne dispose de 28 000 lits de soins intensifs (qui devraient bientôt doubler) contre 4 100 pour la Grande-Bretagne. En Grande-Bretagne, un poste de soins infirmiers sur huit est vacant. Parmi les pays développés, la Grande-Bretagne se situe à l’avant-dernier rang pour le nombre de médecins et d’infirmières par habitant (2,8 et 7,9 pour 1000 habitants).
L’une des questions qui revient sans cesse est la suivante : Comment se fait-il que l’Allemagne puisse tester 500 000 personnes par semaine alors que le Royaume-Uni ne peut même pas en tester 10 000 par jour ? Cette question suscite une tempête de plus en plus vive, car il devient de plus en plus évident que le service de santé était mal préparé. De plus, la question des équipements de protection individuelle est devenue une préoccupation majeure pour les travailleurs de la santé et des services sociaux. Il ne s’agit pas seulement du manque d’équipement, mais aussi de l’obsolescence des équipements de protection individuelle (EPI) à porter lors des soins aux patients atteints de Covid. Au départ, le NHS utilisait des EPI recommandés par l’OMS, mais il a ensuite adopté ses propres critères, ce qui a suscité une méfiance généralisée. Il y a aussi le scandale des EPI qui ont été envoyés par la Grande-Bretagne en Chine au début de l’épidémie, alors que ces fournitures en Grande-Bretagne étaient sérieusement limitées.
La conversion de centres d’exposition à Londres et Birmingham en hôpitaux de fortune, le retour au travail de personnels de la santé à la retraite, ainsi que des volontaires qui effectueront des tâches non médicalisées, ne fait que souligner les carences criantes du NHS.
Le manque de préparation du NHS était connu bien à l’avance. En 2016, le gouvernement a organisé un exercice de trois jours (Exercice Cygnus) pour voir dans quelle mesure seraient prêts les hôpitaux, les autorités sanitaires et d’autres organismes gouvernementaux face à sept semaines d’une nouvelle pandémie de grippe respiratoire. Le NHS a échoué au test et le rapport n’a jamais été publié. Le Daily Telegraph du 28 mars 2020 a décrit les résultats de l’exercice : “Le pic de l’épidémie n’était pas encore arrivé, que les dispensaires, les centres locaux de thérapie, les hôpitaux et les morgues de tout le pays étaient déjà débordés. Il n’y avait pas assez d’équipements de protection individuelle (EPI) pour les médecins et les infirmières du pays. Le NHS était sur le point de “tomber” en raison d’une pénurie de ventilateurs et de lits de soins intensifs. Les morgues étaient sur le point de déborder, et il était devenu terriblement évident que les messages d’urgence du gouvernement n’étaient pas bien accueillis par le public”. Parmi les raisons invoquées pour ne pas publier le rapport, il y avait le fait que les résultats étaient “trop terrifiants” et qu’il y avait des préoccupations de “sécurité nationale”.
Parmi les lacunes identifiées, il y avait la pénurie de lits de soins intensifs et d’équipements de protection individuelle, mais les mesures d’austérité du gouvernement ont empêché toute action en ce domaine. Bien que le rapport n’ait pas été publié, un certain nombre de ses implications ont été prises en charge par d’autres instances. Par exemple, il semble avoir été prévu que si les cadres supérieurs du NHS n’étaient plus en mesure de prendre en charge la coordination du système de soins, l’armée serait amenée à le faire. Le NHS étant de plus en plus sollicité, l’appel à des militaires et à des bénévoles était déjà utilisé pour faire face à la situation.
Il faut également dire que ce n’est pas seulement le NHS qui est sous pression, c’est tout le système d’aide sociale qui est mis à rude épreuve. Le fait que le nombre de décès dans les maisons de soins ait été massivement sous-estimé nous rappelle que ce n’est pas seulement le NHS mais toute une série d’institutions qui sont au bord de la rupture.
Après avoir laissé faire, la bourgeoisie s’est retrouvée impuissante
Alors que la classe dirigeante de la plupart des pays a réagi de manière similaire au développement de la pandémie, en Grande-Bretagne, ce fut différent, bien qu’elle ne se soit pas tout à fait comportée comme Trump aux États-Unis ou Bolsonaro au Brésil. Comme l’indique un article de l’Observer du 15 mars 2020 : “Plutôt que d’apprendre des autres pays et de suivre les conseils de l’OMS, qui proviennent d’experts ayant des décennies d’expérience dans la lutte contre les épidémies dans le monde entier, le Royaume-Uni a décidé de suivre sa propre voie. Il semble accepter le fait que le virus est inéluctable et qu’il deviendra probablement une infection annuelle et saisonnière. Le plan, comme l’a expliqué le conseiller scientifique en chef, consiste à travailler à une “immunité collective”, c’est-à-dire à faire en sorte que la majorité de la population contracte le virus, développe des anticorps et devienne ensuite immunisée contre lui”. C’était l’idée, comme celle de “l’idéologie du Brexit”, que la Grande-Bretagne pouvait faire cavalier seul, avec ses propres experts, en ignorant les directives de l’OMS. En particulier, l’idée que combattre l’avancée du Covid-19 pourrait être laissé de côté et qu’une “immunité collective” se développerait parmi les survivants, au détriment de ceux qui devaient en mourir. Cette approche totalement cynique est censée protéger l’économie. Si beaucoup de retraités venaient à mourir, alors “tant pis”. Que ces deux derniers mots aient été prononcés ou non, ils résument certainement l’attitude des membres du gouvernement. Ce dernier, guidé par les experts qu’il avait choisis, avait une politique de survie du plus apte, qui n’est qu’une condamnation à mort des plus vulnérables, les personnes âgées, les personnes en surpoids et celles souffrant de maladies graves. En février, Johnson avait critiqué “la bizarre rhétorique autarcique” et défendu “le droit des populations de la Terre à acheter et à vendre librement entre elles”. Cependant, après qu’un rapport de l’Imperial College a pronostiqué que la politique du gouvernement engendrerait 250 000 morts, le gouvernement a reculé sur cette position. Le 16 mars, Johnson est apparu à la télévision en disant que tout contact non essentiel avec les autres devrait cesser et que les gens devraient désormais rester chez eux. Le fait que certains proches du gouvernement affirmaient alors que moins de 20 000 morts serait “un très bon résultat” pour le Royaume-Uni montre à quel point la bourgeoisie jouait encore avec la vie des gens comme si tout cela n’était qu’une compétition macabre.
Les critiques envers la politique du gouvernement ont attribué cette situation à la négligence propre des Tories (Parti conservateur), sans reconnaître que la réponse de la bourgeoisie totalement dépassée au niveau international a été inadéquate, indépendamment des louanges adressées à l’Allemagne, à la Corée du Sud, etc. Au fil du temps, la réponse de l’État britannique a fini par ressembler à celle d’autres pays. Cependant, le populisme a toujours son influence. Par exemple, le Royaume-Uni était en négociation avec l’Union européenne (UE) pour l’achat de 8 000 respirateurs, mais il a abandonné ce projet parce que (selon un porte-parole du Premier ministre) le pays n’est “plus membre” et “fait ses propres efforts”. Plus tard, l’UE a été accusée d’avoir eu un “problème de communication” lors de ce contrat. Les personnes âgées ou fragilisées par d’autres affections médicales, l’approche de la bourgeoisie, à la lumière du retard pris dans la production de respirateurs, sera de traiter les jeunes et d’abandonner les autres.
Nombre de ces mêmes critiques sur la responsabilité et l’arrogance incontestable du gouvernement pendant la crise actuelle, nous invitent à concentrer notre colère sur le gouvernement conservateur nouvellement élu, ainsi que sur ses prédécesseurs de droite. Cela revient à ignorer le rôle historique et continu de “l’Opposition loyale de Sa Majesté”, le Parti travailliste, dans la réduction des “services publics”, par exemple en élargissant considérablement le financement privé de la santé qui a drainé environ 80 milliards de livres sterling des ressources du NHS entre 1997 et 2010, ce qui représente jusqu’à un sixième des budgets des autorités sanitaires locales (dotation) et laisse des dettes à payer jusqu’en 2050.
Le slogan “Protéger le NHS” a été mis en avant par le gouvernement tout en blâmant les “égoïstes” qui stockent de la nourriture, du désinfectant pour les mains ou des rouleaux de papier toilette, ou qui vont travailler si ce n’est pas essentiel, ou qui vont trop loin pour faire de l’exercice. Dans l’esprit de la campagne guerrière menée contre le marché noir, les attaques contre les petits profits détourneront l’attention des véritables coupables : toute la classe capitaliste et le système qu’elle défend.
La bourgeoise britannique a néanmoins soutenu une “importation étrangère”, à savoir les applaudissements envers les travailleurs de la santé. Cette action a été prise en charge et institutionnalisée à 20 heures tous les jeudis. Elle ne coûte rien et s’ajoute à la campagne “Protéger le NHS”.
Mais en quoi le NHS est-il protégé ? Son insuffisance a été mise en évidence dès le début. Lorsque 750 000 personnes ont répondu à l’appel, la presse grand public a salué leur humanité : “l’armée d’un peuple vaillant”, “une nation de héros”, “une armée de cœur”. Les bénévoles avaient certainement le désir d’aider face au besoin. En pratique, la nécessité de faire appel aux ressources de l’armée et aux masses de bénévoles montre que c’est le mythe du NHS que la bourgeoisie tente de protéger. Il n’y a pas de héros, seulement une main-d’œuvre surexploitée qui est obligée de travailler dans des conditions désespérément inadéquates.
Alors que dans d’autres pays on a utilisé l’image de la guerre, en Grande-Bretagne, on évoque l’esprit du Blitz pendant la Seconde Guerre mondiale. Le Royaume-Uni est attaqué par un ennemi invisible et chacun est censé “faire sa part de devoir”. Que ce soit au sein du NHS, en faisant du bénévolat ou en effectuant d’autres travaux essentiels, ou simplement en restant chez soi, nous sommes tous censés nous rassembler… derrière la bourgeoise responsable de milliers de tragédies.
L’État se précipite au secours de l’économie
Avec l’arrêt de toutes les opérations non essentielles et l’obligation pour les personnes de rester chez elles, toutes sortes d’entreprises sont confrontées à la faillite, et les travailleurs sont confrontés au chômage et tentent de réclamer des allocations, de payer le loyer et de continuer à rembourser les dettes déjà accumulées. Les prévisions concernant l’augmentation du chômage, selon la holding financière Nomura, s’élèvent à 8 %, ce qui suggère 1,4 million de chômeurs supplémentaires : soit un total de 2,75 millions d’ici à juin.
Quant au PIB, Nomura suggère qu’il va s’effondrer de 13,5 %, d’autres prévoient une baisse de 15 %. Le gouvernement a alloué l’énorme somme de 266 milliards de livres cette année pour faire face à toutes les éventualités découlant du Covid-19. Cela pourrait signifier emprunter au moins 200 milliards de livres et que le niveau d’endettement du Royaume-Uni pourrait atteindre 2 000 milliards de livres dans les douze mois, ce que le budget du 11 mars n’avait pas prévu avant 2025. Ce niveau d’emprunt, équivalant à 9 % du PIB, effacerait presque toutes les réductions de dette de la dernière décennie d’austérité.
L’Office de la responsabilité budgétaire a émis l’hypothèse que l’économie britannique pourrait se contracter de 15 % ce printemps, avec un taux de chômage de 10 % et, avec des emprunts publics qui augmentent à un rythme jamais vu depuis la Seconde Guerre mondiale, une dette qui dépasserait les 100 % du PIB. On prévoit la plus grave récession depuis 1929. La Banque d’Angleterre a réduit les taux d’intérêt à deux reprises pour atteindre un taux marginal de 0,1 %. Son programme de relance, qui consiste essentiellement à imprimer de l’argent pour stimuler l’économie, a été étendu à 645 milliards de livres sterling. L’intervention de l’État dans l’économie n’est pas une sorte de “virage à gauche” tel que le réclament les gauchistes, mais la réponse inévitable du capitalisme à chaque secousse de la crise économique. Parmi les mesures prises on peut citer :
– le gouvernement couvrira 80 % de la masse salariale des employeurs afin de garder les employés, jusqu’à 2 500 £ par mois ;
– des dispositions similaires pour les indépendants ;
– le report de factures de TVA d’une valeur de 30 milliards de livres sterling ;
– une augmentation des prestations sociales de 7 milliards de livres
– une augmentation d’un milliard de livres de l’aide au logement pour aider les locataires ;
– une relance budgétaire de 30 milliards de livres, dont 2 milliards directement pour la lutte contre les coronavirus, avec plus de fonds pour le NHS ;
– des prêts garantis par le gouvernement pour une valeur de 330 milliards de livres, soit 15 % du PIB ;
– une enveloppe de 20 milliards de livres pour les entreprises, dont 12 mois de congé pour toutes les entreprises du secteur du commerce de détail, des loisirs et de l’hôtellerie, et des subventions en espèces pouvant atteindre 25 000 livres pour les petites entreprises ;
– une suspension de trois mois de versement hypothécaire pour les propriétaires ;
– une interdiction de trois mois d’expulsion de locataires.
Ce n’est qu’un début. Le gouvernement Johnson avait déjà mis en place un régime de dépenses qui n’avait pas été chiffré ; à présent, toute une série de mesures s’y ajoutent. L’économie est touchée de plein fouet, sans que l’on se préoccupe de savoir d’où viendra l’argent. Ce qui est sûr, c’est que la classe ouvrière devra payer la facture ! Quelle que soit la forme qu’elles prendront, les mesures d’austérité de ces dix dernières années sembleront insignifiantes en comparaison. Mais alors que les attaques précédentes pouvaient être imputées aux “banquiers” et au “néo-libéralisme”, les attaques futures seront mises exclusivement sur le compte de l’impact de la pandémie.
La situation de la classe ouvrière
Il faut dire que le travail (et l’exploitation) n’a pas vraiment cessé en Grande-Bretagne. Les hôpitaux et les centres de soins sont confrontées, comme les usines, à l’accélération de la demande. Les chauffeurs de bus des transports publics ont été des victimes notables du virus et les transporteurs continuent pourtant à livrer leurs marchandises. Les centres de distribution de nourriture et de vêtements ont connu des protestations contre l’insuffisance de la protection. Les travailleurs dans le secteur de la défense nationale (sur la Clyde et ailleurs) ont été priés de retourner à leur poste de travail “désinfecté”, au nom de la “sécurité nationale”, avec seulement 2 mètres de distance de sécurité pour se protéger, tandis que les personnels des supermarchés ont été salués comme “des prolétaires, fiers et patriotiques” accomplissant leur devoir au service de la Reine et du pays.
Cependant, du point de vue de la survie immédiate, des millions d’autres travailleurs n’ont guère d’autre choix que de suivre l’instruction donnée à tous, à l’exception des “travailleurs essentiels”, de rester chez eux et, lorsqu’ils sont dehors, de pratiquer la “distanciation sociale”. Mais en même temps, ces conditions constituent une grande barrière au développement de toute résistance ouverte au système. Cette atomisation forcée pour des millions de personnes va de pair avec l’héroïsation de ceux qui travaillent dans le NHS. Alors que l’association fait partie de la condition de la classe ouvrière, actuellement une grande partie de la main-d’œuvre est coincée chez elle, soumise à la propagande médiatique 24 heures sur 24. On nous dit constamment que tout cela est la faute du coronavirus, et non pas du fait de la décomposition d’un mode de production en déclin depuis plus d’un siècle.
Les travailleurs sont susceptibles, à juste titre, d’être préoccupés par la défense de leurs intérêts immédiats. Dois-je prendre les moyens de transport ? Où puis-je me procurer de la nourriture ? Comment maintenir la distance entre moi et d’autres personnes qui pourraient être porteurs du virus ? Si je suis licencié, d’où viendra l’argent ?
On fait miroiter la possibilité de recours au “crédit universel” mais les demandes ont dépassé les moyens du Ministère du travail et des pensions (Department for Work and Pension ou DWP). En une quinzaine de jours, 950 000 travailleurs ont demandé ce “crédit universel”. Les travailleurs ont appelé le DWP une centaine de fois sans pouvoir parler à personne. Et pour ceux qui ont réussi à faire leur demande, il y a une attente d’au moins cinq semaines avant d’obtenir une réponse.
Dans les enquêtes, 1,5 million d’adultes disent ne pas pouvoir se nourrir suffisamment et 3 millions affirment avoir dû emprunter de l’argent en raison de la réduction de leurs revenus provoquée par la situation.
Tout ce qui découle de la fermeture des sites et de la distanciation sociale rend donc (pour l’instant) plus difficile pour les travailleurs l’élaboration d’une réponse collective. Cela ne peut qu’accroître le sentiment d’atomisation et créer un véritable obstacle au développement de l’identité de classe. Nous sommes ainsi transformés en une armée d’individus, demandeurs de crédits à l’État capitaliste.
Toutes ces préoccupations fondamentales des travailleurs passent probablement en premier, avant de réfléchir à la nature de la crise sociale ou à la nécessité de renverser le capitalisme. Et les gauchistes sont toujours là pour contribuer à la désorientation de la classe ouvrière. Le Socialist Workers Party (parti trotskiste britannique), par exemple, critique Corbyn, le Labour (Parti travailliste) et le Trades Union Congress (2) pour avoir exprimé leur accord avec les mesures gouvernementales tout en exigeant que l’État “reprenne les services essentiels des mains des patrons privés pour s’assurer que les gens obtiennent ce dont ils ont besoin”. Il y a aussi la tentative d’identifier des individus comme étant les seuls responsables, comme Alan Thornett (Socialist Resistance) qui a déclaré que “la profondeur et la gravité de la crise à laquelle nous allons faire face en Grande-Bretagne a été faite à Westminster par Boris Johnson et Dominic Cummings”. D’autres ont demandé la démission du ministre de la santé, Matt Hancock. Chercher un coupable parmi la classe dirigeante (comme si le remplacement de certains de ces responsables allait changer quelque chose) ne fait que détourner l’attention d’une réflexion sur la crise sous-jacente du capitalisme en tant que système mondial.
Le responsable en chef de la Croix-Rouge internationale a déclaré que, comme des millions de personnes ont vu leurs revenus baisser ou dépendent des allocations de l’État, les “troubles civils” ne devraient pas tarder. Il a déclaré que les troubles sont sur le point “d’exploser à tout moment”, car les plus grandes villes d’Europe sont aux prises avec des revenus faibles ou nuls en raison de la pandémie. “C’est une bombe sociale qui peut exploser à tout moment, car elles n’ont aucun moyen d’avoir un revenu. […] Dans les quartiers les plus difficiles des grandes villes, je crains que dans quelques semaines nous ayons des problèmes sociaux”. En Grande-Bretagne, il y a eu quelques conflits concernant la sécurité des travailleurs, notamment des actions des travailleurs postaux [93] préoccupés par la sécurité en Écosse et dans le nord et le sud de l’Angleterre, tandis que les éboueurs dans le Kent ont menacé de faire grève pour des raisons similaires. Mais à notre connaissance, ces actions ne sont pas de l’ampleur des grèves qui ont été observées en Italie, en Espagne ou aux États-Unis par exemple. Nous devons être conscients que les “troubles sociaux”, notamment en raison des caractéristiques de la période de décomposition sociale, peuvent prendre n’importe quelle forme, et pas nécessairement celle de la lutte des travailleurs sur un terrain de classe.
D’autre part, nous assistons à une certaine réflexion sur la situation. Alors que les querelles au sein de la bourgeoisie se poursuivent pour savoir qui est responsable des pénuries, de l’état de délabrement du NHS ou du changement de politique gouvernementale, il existe une minorité en recherche qui comprend que le capitalisme en tant que système est à la base de la pandémie et qui est ouverte à la discussion sur la nature du capitalisme et au-delà. La question de la pandémie est une chose qui ne peut être évitée car tous les aspects de la vie sociale ont été touchés et de profondes questions ont été soulevées sur la réalité de la société capitaliste. Et cette réflexion s’accompagne d’une grande colère face à la manière dont les travailleurs ont été traités, les personnes âgées abandonnées à la mort, les travailleurs de la santé laissés sans protection. Il y a la perspective que ces éléments puissent se combiner dans les luttes futures. Pour l’instant, la nécessité d’une discussion est primordiale, pour l’instant, pas en face à face, mais dans les forums et sur les réseaux sociaux. Le capitalisme se révèle crûment pour ce qu’il est, et tente de se couvrir par ses mensonges. Les travailleurs peuvent développer la capacité de voir à travers la propagande et réaliser que seule la classe ouvrière peut stopper l’anéantissement de la société en luttant contre le capitalisme afin de le détruire.
Barrow, 19 avril 2020
1 National Health Service, le système de la santé publique du Royaume-Uni.
2 Sorte de congrès intersyndical annuel, une instance importante pour les syndicats britanniques.
Récent et en cours:
- Coronavirus [55]
- COVID-19 [56]
Rubrique:
Pandémie du Covid-19: contribution d’un camarade proche
- 136 lectures
Nous publions ci-dessous la contribution envoyée par un camarade en Espagne proche du CCI afin de poursuivre la clarification sur la signification de la pandémie de Covid-19 et ses répercussions pour le prolétariat. Il nous parait extrêmement important dans les conditions actuelles de confinement et d’isolement physique (que les campagnes de la bourgeoisie prétendent convertir en isolement social, comme le souligne le camarade), soient prises toutes sortes d’initiatives afin d’élargir le débat et de dénoncer les fables de la bourgeoisie. Cela maintiendra un climat de solidarité de classe malgré l’impossibilité de nous rassembler physiquement. Nous espérons que l’initiative du camarade puisse servir d’exemple.
Nous partageons en outre une grande partie de ce que signale le camarade. Nous souhaitons préciser que dans notre analyse, et comme nous l’avons montré dans les articles publiés sur notre site internet (1), la motivation essentielle pour retarder la mise en œuvre des mesures de confinement est la résistance capitaliste à mettre un frein à la production et perdre des profits et, surtout, des avantages compétitifs face aux autres rivaux. (2) C’est pourquoi ce retard, comme le souligne également cette contribution, est fréquent dans les pays ayant un gouvernement de gauche ou de droite, qu’il soit “féministe” ou “ultra-chrétien”.
Nous voudrions cependant nuancer ce qui est dit dans le courrier quand le camarade évoque “la production des masques artisanaux qui s’avèrent être totalement inefficaces face au coronavirus”. Sur cette question,
même si la bourgeoise a clairement menti et a dit tout et son contraire, il nous semble quand même qu’un masque, même artisanal, soit un moindre mal même s’il ne garantit pas vraiment du risque de contagion. Cela ne retire rien à la dénonciation, pleinement valable, que fait le camarade de “l’effort national” en ce sens. La dénonciation que fait l’article de la campagne d’ “ovations” aux travailleurs de la santé, qui est effectivement une perversion organisée par toutes les instances de l’État bourgeois d’un sentiment de solidarité qui naît entre les ouvriers devant l’effort réalisé par leurs frères du secteur sanitaire. Cette perversion tire profit et utilise, à la convenance de l’État, l’expression individuelle (et individualiste) de la solidarité qui est totalement stérile et n’a rien à voir avec la solidarité de classe du prolétariat. Nous autres, ouvriers, nous devons dénoncer cette manipulation répugnante de la solidarité qui vise à la faire entrer sur le terrain de l’union nationale et de l’idéologie de guerre. Face à cela nous devons chercher des moyens pour exprimer la solidarité sur un terrain de classe. L’un d’entre eux consiste à écrire des contributions pour la presse révolutionnaire.
CCI
Le virus du Covid-19 a mis l’État espagnol dans une situation qu’il n’arrive pas à gérer, une situation qui fait ressortir de manière scandaleuse que la société capitaliste est l’ombre d’une société humaine, incapable même désormais de maintenir les exploités/travailleurs dans des conditions qui permettent leur exploitation de manière constante dans le temps. La tragédie humaine dans les hôpitaux fera pâle figure face à celle qui s’ensuivra, lorsque sera passée l’épidémie et que sera venu le moment de la “reconstruction” et des “sacrifices”. La classe ouvrière peut réagir, mais pour cela, il est nécessaire de comprendre ce qu’est en train de faire la bourgeoisie. Malgré les milliers de morts qu’il y a déjà eu et les milliers à venir à cause du virus, c’est en réalité le calme qui précède la tempête. Il faut garder les yeux bien ouverts.
Si l’on regarde ce qui s’est passé en Espagne ces dernières semaines, la plus grande question qui se pose est de savoir pourquoi toute la bourgeoisie, du gouvernement aux médias, a mis autant de temps à réagir. Ces jours-ci, plusieurs médias invoquent le “caractère rétrospectif”, argumentant qu’il est très facile de penser, avec le recul, qu’il était clair que la situation allait dégénérer de la sorte quand, en réalité, cela n’était pas si évident sur le moment. Dans ce cas précis, l’argument ne tient pas debout. L’unique information nécessaire pour pouvoir envisager cette situation est la présence d’un virus aussi contagieux que celui-là. Devant l’absence de mesures, comment est-il possible de penser qu’il ne va pas s’étendre ? Pourtant, c’est ce qui a été défendu non seulement par le gouvernement mais aussi par les médias et tous les partis politiques de la bourgeoisie. Il est probable que, dans le cas de l’Espagne, on ait souhaité attendre le 8 mars afin de ne pas détourner l’attention des médias de la pseudo-polémique entre féminisme et anti-féminisme (3) avec laquelle la bourgeoisie empoisonne notre esprit dernièrement. Il semblerait également que les considérations économiques aient joué un rôle important dans le retard de la bourgeoisie. Mais dans l’ensemble, c’est un sujet qui n’est pas du tout clair et qui s’est répété aussi bien avant qu’après dans d’autres pays. Nous devons être attentifs aux possibles intentions sounoises derrière un retard prémédité mais aussi au fait que ces attentes puissent être la conséquence de l’inaptitude d’une bourgeoisie décadente aux facultés amoindries.
Un autre aspect auquel les révolutionnaires doivent particulièrement prêter attention, est la gestion de la tension sociale durant cette situation de quarantaine généralisée. Les moyens avec lesquels compte aujourd’hui la bourgeoisie pour manipuler la conduite des travailleurs n’ont pas de précédent : en plus des moyens classiques, ces jours-ci, la majorité de la population maintient le contact social à travers les réseaux sociaux dans lesquels des algorithmes machiavéliques décident (et enregistrent) ce que voient ses usagers, quand et comment. Le nouveau rite qui consiste à applaudir le personnel soignant à 20h donne un bon exemple de la direction dans laquelle on nous pousse ; celle d’une masse stupide, ivre de nationalisme, admirant l’État et d’un grégarisme agressif.
Les dénonciations à la police et les insultes depuis les fenêtres envers ceux qui semblent passer outre la quarantaine témoignent du danger et de l’efficacité potentiels de cette stratégie de la bourgeoisie. Un élément particulièrement frappant de cette campagne d’ “unité nationale” est celui des masques faits maison : des dizaines d’articles de journaux et des centaines de publications sur les réseaux sociaux exaltent l’héroïsme stakhanoviste de ceux qui fabriquent à la main des masques de tissu “pour aider”. En dépit de l’obsession (supposée) des médias à “combattre les canulars”, ils font ressortir son côté positif et encouragent à participer à la production de ces masques qui s’avèrent être totalement inefficaces face au coronavirus. La ressemblance entre les articles qui louent cette activité inutile mais patriotique et la propagande de l’ère stalinienne est frappante.
Un autre facteur auquel il faut être très attentif, en plus de le dénoncer, est l’intervention accrue de l’armée. Les médias se concentrent sur l’Unité Militaire d’Urgence (UME), dont les activités sont plus faciles à justifier dans une perspective de “gestion de la crise”, par exemple des travaux de désinfection. Cependant le déploiement militaire va bien au-delà de l’UME et de ce type de travaux. La tâche principale des militaires est de patrouiller dans les rues, dans un mouvement clair d’intimidation. Divers corps militaires s’affichent dans les rues vides, augmentant notre sensation d’impuissance face à l’État, déjà accentuée par l’isolement dans son domicile. Il est difficile de savoir quelle est l’intention concrète de l’État à travers ce mouvement et il s’agit de rester en alerte. La bourgeoisie a démontré d’innombrables fois sa disposition à massacrer (activement) les travailleurs en cas de nécessité.
Pour terminer, une petite remarque sur la terminologie avec laquelle on ne cesse de nous abreuver : le terme de “distanciation sociale” interpelle particulièrement, car la distance nécessaire pour prévenir la contagion n’est pas sociale mais physique. Mais la bourgeoisie veut nous isoler socialement, réduire nos relations humaines à l’interaction avec leurs « réseaux sociaux » et aux rites d’extase nationalistes qu’ils dictent.
Le pire est à venir et il viendra après la quarantaine. Il est nécessaire d’être très vigilants quant à l’évolution de la situation, quels pièges et stratégies sont tendus par la bourgeoisie et comment nous pouvons les dénoncer et les combattre. Le prolétariat est en situation de faiblesse mais cela pourrait changer rapidement. Le capitalisme est en train de montrer de manière évidente sa véritable nature, de telle façon qu’il n’y a pas de moyen de propagande ni de technique de manipulation sociale qui puissent totalement l’occulter. Soyons en alerte.
Comunero, 3 avril 2020.
1 Voir principalement : “Covid 19 : Soit le prolétariat mondial met fin au capitalisme, soit le capitalisme met fin à l’humanité [92]” et “Pandémie de COVID-19 en France : L’incurie criminelle de la bourgeoisie ! [71]”
2 N’oublions pas que le monde est immergé dans une violente guerre commerciale et que celle-ci n’a pas disparu avec la pandémie. Ainsi, il y a des pays qui ne veulent pas vendre à d’autres du matériel sanitaire urgent ou augmentent de façon démesurée les prix de ces produits. Pour les nations comme pour les capitalistes individuels, seuls comptent le profit et l’accumulation !
3 Sur l’idéologie féministe voir : “Huelga feminista : contra las mujeres y contra la clase obrera [94]”.
Récent et en cours:
- Coronavirus [55]
- COVID-19 [56]
Covid 19: Des réactions face à l'incurie de la bourgeoisie
- 159 lectures
Nous publions ci-dessous plusieurs réactions trouvées sur les réseaux sociaux, des cris et des expressions d’indignation de colère mais aussi de combativité face à la catastrophe sanitaire que vit l’humanité à l’heure actuelle et dont la bourgeoisie est la seule responsable.
La première est un coup de gueule d’un professionnel de santé [95] (publié sur Le VIF, 21 mars 2020) qui, en dépit de ses confusions sur la nature des élections, exprime un véritable cri de révolte qui permet, selon nous, de mettre en évidence deux choses :
– que les attaques contre le système de santé et la dégradation des conditions de travail ne sont pas une nouveauté mais le produit d’une politique de rentabilité, d’une planification purement comptable et donc froidement criminelle de la part de l’État bourgeois ;
– que les discours politiques de la classe dominante ne sont qu’une hypocrite mascarade destinée à justifier ou à masquer l’austérité, la pénurie et la souffrance des salariés, quels que soient les secteurs.
Depuis mercredi, les Belges sont appelés à applaudir, tous les soirs à 20 heures, le personnel soignant, (1) en première ligne dans la lutte contre la propagation du Coronavirus. Face à ce soutien populaire, un médecin urgentiste liégeois a voulu pousser un “coup de gueule” :
“Je pense que je suis aigri, en mode lendemain de garde (24h d’affilée en ayant peu dormi). Mais globalement, je ne supporte pas les gens qui applaudissent : les hôpitaux n’ont pas attendu le Covid-19 pour être dans la galère, en surbooking permanent. Les services d’urgences n’ont pas attendu non plus d’être surchargés, en manque de personnel (infirmier.es surtout), dans des locaux vétustes ou sous-dimensionnés. Que l’hôpital Saint-Pierre doive faire la manche pour avoir des respirateurs, c’est une honte totale !
On est où ? MSF va débarquer ? Une bonne partie des gens qui applaudissent, votent chaque année pour les connards qui diminuent les budgets, font des hashtags #keepsophie en soutien à la Premier ministre Sophie Wilmès en oubliant qu’elle a été ministre du Budget d’un gouvernement qui a retiré plusieurs milliards d’euros dans les soins de santé.
Et soi-disant, ils ont peur parce qu’on risque nos vies ?! Les gens qui font des pauses et des boulots stressants par manque de moyens ne meurent pas d’infection. Ils meurent de leur boulot aux cadences infernales en perdant 10-15-20 ans d’espérance de vie.
Donc merci quand même pour vos applaudissements, mais ça fait des années que le personnel hospitalier travaille dans des conditions de merde et se nique la santé en faisant son job du mieux possible.
La prochaine fois que vous voyez des manifestations pour refinancer les soins de santé, soutenez-nous !
Et quand vous retournerez glisser un bulletin dans l’urne, réfléchissez-y à deux fois !
Un médecin assistant aux urgences à Liège, cosigné par une infirmière SIAMU aux urgences à Bruxelles
PS : Si vous applaudissez à 20h, pensez aussi à tous les travailleurs de la grande distribution, les crèches, les éboueurs, eux ils n’avaient pas signé pour ça à la base et ils sont très mal payés.
La deuxième réaction, à lire ci-dessous, dénonce le chantage que l’État exerce sur les étudiants en travail social qui refusent de se porter “volontaires” comme personnels hospitaliers et ainsi servir de “chair à virus”. Une mobilisation à laquelle refuse de répondre cette étudiante qui dénonce ouvertement l’incurie et l’hypocrisie du gouvernement.
Réponse publique et anonyme d’une étudiante assistante de service social au “plan de mobilisation volontaire”
Le samedi 21 mars 2020, j’ai reçu un mail de mon centre de formation d’assistante de service social dont je tairai le nom. Il s’agit d’un courrier de la DRDJSCS à propos du “plan de mobilisation des étudiant-es en travail social”.
Ce message nous informe qu’en qualité d’étudiant-es assistant-es de service social, nous sommes désormais mobilisables “sur la base du volontariat”, dans le cadre de la gestion de crise du COVID-19 stade 3. Les missions sont larges : assurer l’accueil et notamment dans le domaine de l’hébergement, de la réinsertion, de l’asile, de l’aide alimentaire, de la protection des majeurs vulnérables, de la protection de l’enfance et de l’accueil de personnes âgées et handicapées. Le message nous assure que les consignes sanitaires seraient rappelées à nos employeurs, nous assurant ainsi une intervention en toute sécurité. Enfin, il est précisé que notre volontariat sera pris en compte pour “valoriser notre engagement” au moment de la certification.
J’ai décidé de répondre publiquement et anonymement à cet email. Je ne voudrais pas que cette déclaration vienne compromettre ma certification en juin 2020, car vous l’avez bien compromis, la DRDJSCS sera regardante et en évaluera ma dévotion de future professionnelle.
A cela je réponds : Cela fait 3 ans que je suis en formation d’assistante de service social, 3 ans que j’entends le même discours. Nos conditions de travail sont médiocres, mais nous avons choisi ce secteur par vocation… alors sacrifions nous ! Nous sommes constamment dans l’obligation d’adapter nos accompagnements au manque de financement, nous devons être flexibles, adaptables, discret-es et altruistes. Nous continuons à appliquer des dispositifs qui nous semblent injustes et contraires à notre déontologie : des conditions d’accueil et d’accompagnement difficiles dans les centres d’hébergement, dans les appartements éducatifs pour les mineurs, les MECS et les hôpitaux ; des consignes imposées par la Préfecture discriminantes et irrespectueuses envers les personnes migrantes ; les financements stables sont rarissimes et remplacés par des appels à projets éphémères, provoquant ainsi une grande insécurité chez les travailleurs sociaux et chez les personnes accompagnées ; et enfin, une évaluation de nos pratiques professionnelles en terme d’efficacité et non pas de relation d’aide.
Mes 3 ans de formation m’ont suffi à me décourager du secteur social, et pourtant je continue car je reste persuadée que l’entraide est primordiale dans notre société. Oui, nous avons choisi cette profession car nous sommes des personnes altruistes et empathiques. Mais personnellement, je l’ai également choisi par engagement, par conviction, pour lutter pour une société plus juste, où les travailleurs sociaux seraient inutiles car la solidarité serait l’affaire de tous et toutes. Une société qui arrêterait de créer de la misère et de l’entretenir.
Le gouvernement Macron a tourné le dos au secteur médical et social, et aujourd’hui, il nous demande d’aider la “Nation” car “nous sommes en guerre”.
Le gouvernement a maltraité les professionnel-les du soin, ainsi que les travailleurs-ses sociaux-les, et aujourd’hui c’est la population qui paye les pots cassés. Je suis en colère car il y a un mois de ça, nos manifestations et revendications étaient réprimées par les forces de l’ordre, par l’État. Nous demandions inlassablement des financements permettant de proposer un accueil digne des personnes en situation de vulnérabilité, que ce soit dans les structures médicales ou sociales. Nous avons tenté de prévenir le gouvernement. Et quelques semaines plus tard, nous sommes appelé-es à la dévotion pour sauver les structures qui, de plus, accompagnent ces personnes oubliées, discriminées, maltraitées et humiliées par l’État. Les personnes sans domicile fixe, les personnes migrantes, les personnes précaires, les personnes porteuses d’un handicap limitant leur autonomie (dans la société qui leur est proposée) et les personnes âgées ne font plus parties des priorités de notre gouvernement. Et nous, travailleurs sociaux et professionnels du soin, sommes quotidiennement témoin de la violence que cela induit sur elles. Nous sommes contraint-es de flirter constamment avec la maltraitance, du fait du manque de moyen, de temps et de personnel. Cela est insupportable.
Aujourd’hui, vous nous demandez de nous sacrifier pour ces personnes que vous avez vous-même mis en souffrance. Vous nous promettez des conditions de travail sécurisées, or nous sommes informé-es de la rupture de stock des masques, des gants et du gel hydroalcoolique dans les structures médicales et médico-sociales. Nous ne sommes pas dupes.
Je vous demande donc, face à quel choix nous mettez-vous ?
L’équipe de soin de l’hôpital Edouard Herriot a été entièrement contaminée à cause du manque de matériel de protection. L’État nous enverrait-il au casse-pipe ? L’État compte sur nous pour assurer l’accès aux soins pour tous et pour limiter les dégâts dans les structures sociales, mais une fois de plus il ne nous donne pas les moyens de faire notre travail dans de bonnes conditions. Si je refuse d’être volontaire, je serai égoïste et peut-être devrais-je me justifier de ce choix lors de ma certification. Si j’accepte, je sacrifie potentiellement ma santé et celle de mon entourage, mais je serai héroïque, telle un-e soldat au front ? Mourir pour mes idées d’accord, mais de mort lente !
Malgré les beaux discours et les applaudissements de 20h, l’État continue de fermer les yeux sur les réalités de nos professions.
Aujourd’hui, le gouvernement m’empêche de pouvoir aider les personnes dans le besoin, il m’empêche de répondre à mes missions d’assistante sociale et d’agir en accord avec mes convictions.
Je ne répondrai pas à cette mobilisation, et je refuse d’en porter la responsabilité.
Une étudiante assistante sociale
Face au manque de masques, de respirateurs, de lits dans les services de réanimation, de tests de dépistage, etc. ; résultat de décennies de démantèlement du système de santé dans le monde entier, nous pouvons voir que la colère ne cesse de croître dans les rangs de la classe ouvrière tout particulièrement dans le secteur hospitalier qui est en première ligne sans possibilité de se protéger de la contamination au Covid-19. D’où les mouvements de manifestations de la part des personnels hospitaliers dans plusieurs pays comme en France, dans la ville de Tourcoing, comme on peut le voir dans la vidéo suivante : ICI [96], mais aussi aux États-Unis comme l’illustrent les photographies ci-dessous :


Par ailleurs, malgré la campagne idéologique assourdissante de la part de la bourgeoisie appelant les exploités à faire corps avec leurs exploiteurs dans une grande “union nationale”, en orchestrant notamment “l’héroïsation” du personnel médical par l’appel à applaudir tous les soirs ces sacrifiés qui doivent assister et soigner les malades sans quasiment de moyens, les images ci-dessous montrent que la réflexion au sein de la classe ouvrière continue à s’opérer mettant en cause le seul responsable de cette pandémie : le capitalisme !


1Comme en France, en Espagne ou en Italie, notamment (NDLR).
Récent et en cours:
- Coronavirus [55]
- COVID-19 [56]
Rubrique:
ICCOnline - mai 2020
- 47 lectures
Arctique: Comment tirer profit d’une catastrophe écologique
- 77 lectures
Alors qu’à l’été 2019 l’Europe haletait sous la canicule, un autre pays la subissait aussi, avec des conséquences potentiellement bien plus ravageuses : le 30 juillet, la température sur la côte est du Groenland atteignait le record absolu de 25°. Des scientifiques du monde entier réagissaient avec indignation face à l’ampleur de la catastrophe : “Quand on regarde sur plusieurs décennies, il vaut mieux s’asseoir sur sa chaise avant de regarder les résultats, parce que ça fait un petit peu peur de voir à quelle vitesse ça change (…) C’est aussi quelque chose qui affecte les quatre coins du Groenland, pas juste les parties plus chaudes au Sud”. (1) Plus de la moitié de la calotte glaciaire groenlandaise était à ce moment réduite à de la neige fondue. Les conséquences étaient d’ores et déjà préoccupantes pour les autochtones, les rivières se gonflant tellement de la glace fondue qu’elles détruisirent plusieurs ponts. Dans l’avenir, cette situation tendra à devenir la norme, comme les prévisionnistes climatiques le pensent de plus en plus.
Les conséquences sont énormes, et pas qu’au niveau climatique ; le retrait de la banquise, qui devient permanent, permet à tous les pays riverains d’envisager d’exploiter la situation, à plusieurs niveaux : accès à de nouvelles ressources naturelles, à de nouvelles régions stratégiques, à de nouvelles routes commerciales. La bourgeoisie exploite ainsi les catastrophes que son système a engendrées, accroissant davantage les risques pour l’environnement.
Un nouveau terrain pour le pillage des ressources naturelles
L’Arctique est riche de différentes ressources naturelles qui étaient jusqu’à présent gelées par la banquise, par les difficultés d’exploitation et le relatif désintérêt des pays riverains pour cette région glacée et inhospitalière. Tout change évidemment avec le réchauffement climatique et la course effrénée des grandes puissances aux ressources minérales accessibles, dans un monde où elles pourraient devenir rares et où elles constituent un atout dans la guerre économique et industrielle : métaux comme le zinc, le cuivre, l’étain, le plomb, le nickel, l’or, l’uranium, diamants, terres rares, gaz ou pétrole, tout est présent en Arctique, pour celui qui aura les moyens et la puissance de s’en emparer. La Mer de Kara recèlerait autant de pétrole que l’Arabie Saoudite, et une étude américaine avance que 13 % des réserves pétrolières et 30 % des réserves gazières mondiales non exploitées se trouveraient dans la région.
Tous les discours des médias bourgeois sur la sauvegarde de l’environnement, la nécessaire modification de “nos modes de consommation” (mais pas de production !) et l’indispensable “examen de conscience” de chacun selon son “empreinte carbone” et sa “surconsommation” sont parfaitement hypocrites face à cette réalité : la bourgeoisie cherche son profit partout, dans la catastrophe climatique que nous avons sous les yeux comme dans tout le reste ! S’il lui est possible d’exploiter (voire de surexploiter) la fonte des glaces de l’Arctique de façon rentable, elle le fera, et ce n’est qu’une facette du problème : dès lors qu’il y a exploitation de ressources naturelles, les risques inhérents (pollution, accidents, destruction accentuée de l’environnement, acculturation et destruction des conditions de vie des groupes humains autochtones) ne peuvent que suivre, comme le redoute un représentant inuit : “Notre culture et notre mode de vie sont attaqués. Les animaux, les oiseaux et les poissons dont nous dépendons pour notre survie culturelle sont de plus en plus sous pression. Nous sommes inquiets pour notre sécurité alimentaire”. (2) Tout en culpabilisant les ouvriers pour leur “irresponsabilité” face à la catastrophe climatique, chaque bourgeoisie nationale s’organise pour en tirer parti, et mieux encore, pour en retirer des avantages stratégiques.
“De nouvelles opportunités commerciales”
L’Arctique n’est pas seulement une source potentielle de matières premières, il est aussi convoité car la fonte des glaces permet également d’ouvrir de nouvelles routes maritimes, potentiellement plus courtes et par conséquent plus rentables que celles qui existent. Mike Pompeo lui-même, Secrétaire d’État américain et ancien directeur de la CIA, a remarqué que “le recul régulier de la banquise ouvre de nouvelles voies de passage et offre de nouvelles opportunités commerciales”. (3) Ainsi, tout en niant tout changement climatique, ce digne représentant de la bourgeoisie américaine avoue sans détour vouloir en profiter ! Et il n’est pas le seul requin à nager en eaux polaires : outre les six pays concernés directement (Canada, États-Unis, Russie, Danemark, Norvège et Islande), un certain nombre d’autres s’intéressent directement à la question.
Au premier rang, on trouve la Chine, observatrice du Conseil de l’Arctique qui a souligné son intérêt pour une route qui lui permettrait d’atteindre les ports atlantiques sans avoir à faire le tour de l’Afrique ou passer par Panama ; elle y aurait d’ailleurs investi quelque 90 milliards de dollars entre 2012 et 2017, selon Pompeo [97], et y a envoyé des navires spécialisés pour “tester” la nouvelle route. La Russie est évidemment intéressée au plus haut point par cette possibilité d’utiliser sans restriction ses ports arctiques qui présenteraient alors le grand intérêt d’être en eaux libres, au contraire de tous les ports qu’elle utilise habituellement (à part Mourmansk), et qui lui permettraient de surveiller très étroitement cette nouvelle voie maritime. La Norvège, le Canada, le Danemark qui sont directement concernés sont évidemment partie prenante de toutes les manœuvres concernant la région. Mais d’autres puissances cherchent également à mettre un pied dans la porte, par exemple la France qui a un statut d’observatrice au Conseil de l’Arctique, qui a institué un poste d’“ambassadeur des pôles” confié jusqu’à il y a peu à Ségolène Royal après l’avoir été à Michel Rocard, et qui prend régulièrement part à des exercices militaires dans le cadre de l’OTAN dans la région.
Cet intérêt de diverses puissances est affirmé dans une très martiale déclaration des États-Unis, toujours par la bouche de Mike Pompeo [98] : “Nous entrons dans une nouvelle ère d’engagement stratégique dans l’Arctique, avec de nouvelles menaces pour l’Arctique et ses ressources, et pour l’ensemble de nos intérêts dans cette région”. Selon lui [99], le passage par l’Arctique “pourrait réduire d’environ vingt jours le temps de trajet entre l’Asie et l’Occident”. Il souhaite que les routes de l’Arctique deviennent “les canaux de Suez et de Panama du XXIe siècle”. Quand on connaît le poids du canal de Panama pour l’impérialisme américain, l’intérêt porté au “passage du Nord-Ouest” prend une importance pratiquement historique. Et on comprend aussi pourquoi les États-Unis cherchent ouvertement à exclure la Chine du Conseil de l’Arctique !
Au-delà des routes maritimes, la possibilité ouverte par le réchauffement de rendre les routes terrestres praticables plus longtemps dans l’année ouvre la porte à l’installation d’infrastructures plus nombreuses et plus importantes, et par conséquent à la possibilité d’accéder plus facilement à ces régions normalement invivables les trois quarts de l’année, ce qui permettra une meilleure exploitation économique et un désenclavement de ces régions, tout en y abaissant le coût de la vie pour les résidents permanents. Le gouvernement canadien a par exemple lancé de tels projets depuis plusieurs années.
Des “empreintes de bottes dans la neige”…
En toute bonne logique impérialiste, ces développements ne peuvent qu’entraîner une présence militaire accrue dans cette région où, depuis la fin de la Guerre froide, il n’y avait plus beaucoup de soldats, chaque puissance impliquée ayant à cœur de défendre ses intérêts bien compris en montrant ses crocs militaires. Pompeo a été clair [97] : “La région est devenue un espace de pouvoir mondial et de concurrence”, ce qui y a entraîné une présence accrue des armées de l’Oncle Sam, d’autant que “la Russie laisse déjà dans la neige des empreintes de bottes”. Dénonçant de multiples provocations militaires russes, brouillage du réseau GPS, incursions d’avions dans des espaces jusqu’ici inusités, manœuvres maritimes régulières, les pays de l’OTAN ont riposté : l’Islande a rouvert aux GI’s sa base de Keflavik, tandis que la Norvège a rendu son port de Grøtsund accessible aux sous-marins nucléaires américains et britanniques, et que l’aérodrome de Bodø est régulièrement utilisé par des avions de combat pour des exercices divers, auxquels la France participe…
De son côté, la Russie a réactivé ses bases sibériennes datant de la Guerre froide et depuis abandonnées, tout en rénovant sa flotte vieillissante de brise-glaces. L’expression de Pompeo n’est finalement pas dénuée de fondement…
Ces développements impérialistes ont aussi donné lieu à un événement plutôt cocasse. L’idée de Trump d’acheter le Groenland au Danemark, sous des dehors saugrenus, met en fait en lumière tous les appétits très voraces des puissances impérialistes. Bien que cette région vaste comme quatre fois la France et constamment recouverte du plus gros glacier du monde coûte fort cher à l’État danois, il est bien entendu inenvisageable pour Copenhague d’abandonner un avant-poste aussi potentiellement lucratif que le Groenland. Les États-Unis, qui ont toujours assuré la défense de cette grande île depuis la Seconde Guerre mondiale, ont déjà tenté de l’acheter en 1946 ; mais on se heurte ici à toute la logique impérialiste du capitalisme ; situé en Arctique, riche lui-même de nombreuses ressources naturelles inexploitées, stratégiquement bien placé par rapport à une route qui contournerait le continent américain par le Nord, si stratégique pour la sécurité américaine que les États-Unis l’ont occupé militairement dès 1940, le Groenland n’a d’un point de vue impérialiste que des qualités, et il faut en ajouter d’autres : non seulement le port de Thulé est en eaux profondes et peut donc accueillir les plus grands navires, civils ou militaires, mais la piste de l’aéroport permet de faire décoller n’importe quel appareil. Par ailleurs, la Zone Économique Exclusive du Groenland permet à son État de tutelle d’exploiter toute ressource qui se trouverait à l’intérieur de cette zone de 200 milles nautiques autour du territoire. En prime, le Groenland est associé à l’Union Européenne du fait de l’appartenance de son État de tutelle, le Danemark, à cette organisation, ce qui ne peut que multiplier les marques d’intérêt pour lui… L’intérêt de Trump pour ce territoire est loin d’être absurde dans une logique impérialiste, d’autant que le réchauffement climatique offre des perspectives inédites à tous ceux qui le contrôleront !
Le capitalisme nous a habitués à tirer profit de tout, c’est ce qui fait de lui le système de production le plus dynamique qui soit. Mais qu’il tire profit en l’aggravant d’une menace planétaire majeure sur l’écosystème, qu’il a lui-même provoquée et qui met en jeu l’avenir de l’humanité, au même titre que la déforestation criminelle des régions amazoniennes, montre à quel point ce système en décomposition n’a plus aucun avenir viable à proposer, et illustre pleinement ce que disait déjà le CCI en 1990 dans ses Thèses sur la décomposition [10] : “Toutes ces calamités économiques et sociales qui, si elles relèvent en général de la décadence elle-même, rendent compte, par leur accumulation et leur ampleur, de l’enfoncement dans une impasse complète d’un système qui n’a aucun avenir à proposer à la plus grande partie de la population mondiale, sinon celui d’une barbarie croissante dépassant l’imagination. Un système dont les politiques économiques, les recherches, les investissements, sont réalisés systématiquement au détriment du futur de l’humanité et, partant, au détriment du futur de ce système lui-même”. L’avenir tel que nous le montre le sort réservé à l’Arctique est celui que le capitalisme réserve à l’espèce humaine toute entière : surexploitation et transformation de l’environnement en enfer invivable, recherche du profit y compris en aliénant totalement l’avenir, barbarie militariste, tout y est ! L’alternative qui en résulte pour l’humanité est bien celle que la Troisième Internationale avait mise en avant il y a maintenant un siècle : socialisme ou barbarie, destruction de ce système capitaliste barbare et sans avenir ou lente destruction de l’Humanité.
H.D., 24 avril 2020
1“Le Groenland touché par une vague de chaleur, avec des températures qui devraient atteindre les 25 °C [100]”, Science et Avenir (1er août 2019).
2“Le climato-scepticisme américain chamboule la coopération régionale dans l’Arctique”, GEO (7 mai 2019).
3Idem.
Rubrique:
Covid-19 au Pérou: Le capitalisme, c’est toujours plus de morts, de misère et d’attaques contre les travailleurs!
- 94 lectures
Dans l’article ci-dessous, notre section au Pérou dénonce les ravages de la pandémie, mais surtout le cynisme et l’incurie de l’État démocratique qui n’a d’autre préoccupation que le profit et l’accumulation du capital, qui abandonne et sacrifie aussi bien les salariés de la santé que les malades. Des travailleurs de la santé à Lima et dans d’autres villes ont tenté d’organiser dans un premier temps des sit-in, des manifestations, demandant protection et moyens. L’État n’y a répondu que par la répression et des arrestations policières !
Déjà 20 jours de confinement sont passés, c’est la mesure la plus importante prise par une grande partie des États dans le monde afin d’isoler le virus Covid-19.
Au Pérou, l’état d’urgence s’accompagne d’un couvre-feu imposé par l’État démocratique, situation qui vient renforcer l’atomisation sociale. Cette pandémie mondiale a déjà provoqué des dizaines de milliers de victimes, selon les chiffres officiels. La rapide et brutale propagation du virus a mis en échec tous les États et économies du monde. Les bourgeoisies des différents pays continuent à ne pas coordonner leurs efforts pour contenir l’épidémie et faire face à cette menace qui rend de plus en plus aiguë la crise économique capitaliste.
Covid-19 et ses effets économiques sur la classe ouvrière
Le FMI annonce déjà que l’économie internationale se trouve dans une récession égale à celle de 2008-2009, voire pire. Le Covid-19 a eu des conséquences économiques terribles au niveau international, conséquences dont la classe ouvrière supportera, encore une fois, le pire.
Au Pérou, la crise du Coronavirus a démontré la vulnérabilité d’une grande partie de la population, au-delà des enfants et des personnes âgées : les travailleurs. De larges secteurs et travailleurs du pays sont vulnérables du point de vue économique à cause du chômage forcé lié à la pandémie.
À Lima et dans d’autres villes du pays, le taux de chômage a été multiplié par trois dans les quinze premiers jours du confinement. (1) 30 % de la population est ruinée, sans travail ni économies puisque 70 % de la population vit de l’économie informelle, gagnant de l’argent au jour le jour pour subvenir aux besoins familiaux. Des millions de travailleurs au Pérou vivent avec moins de 5 dollars par jour.
Mais l’inquiétude croissante touche aussi le secteur privé formel à cause des 3,7 millions d’emplois qui seront touchés par cette crise. Les chaînes de paiement se sont interrompues complètement. Beaucoup de familles, du fait qu’elles ne touchent plus leurs salaires, sont face aux difficultés pour payer les loyers, acheter des vivres, des médicaments et autres. Cette situation a commencé à se répandre à tous les niveaux touchant directement les travailleurs et nourrissant la panique dans l’ensemble de la population. Cette situation a mis le gouvernement en alerte et l’a obligé à agir.
Le gouvernement Vizcarra a développé un plan économique pour tenter de désamorcer les conséquences du confinement. Ce plan a consisté, dans une première étape à libérer la CTS, (2) en deuxième lieu à donner des primes de 380 soles (115 dollars) renouvelables les deux premières quinzaines de confinement, et en troisième lieu, dans la même ligne, à libérer 25 % des fonds du Système privé de pensions (AFPs).
Mais ces mesures ne sont ni ne seront suffisantes pour affronter la crise économique, ne serait-ce que parce que 70 % de la population sont des travailleurs informels indépendants qui ne bénéficient ni de CTS, ni de AFPs ni d’aucun fonds de réserve.
D’autre part, la Cepal (3) annonce que la crise pourrait laisser 22 millions de personnes de plus dans une pauvreté extrême en Amérique latine, et annonce que nous sommes face au début d’une profonde récession.
“Nous sommes face à la chute de la croissance la plus forte jamais connue dans la région” a signalé Alicia Barcena, secrétaire de direction de la Commission Économique pour l’Amérique latine et les Caraïbes.
Beaucoup d’entreprises locales profitent déjà de la situation : mise au chômage technique non payé, paiements en attente, licenciements, réduction du coût du travail, entre autres. Ce sont des manœuvres exécutées afin de ne pas voir une baisse de leurs profits au milieu de la tragédie. Selon Ricardo Herrera, avocat spécialisé en droit du travail, les entreprises peuvent prendre ces mesures parce que la Loi de Productivité et Compétitivité du travail le permet. Cette loi autorise les employeurs à ne plus rémunérer pendant 90 jours les travailleurs qui arrêtent leur activité. (4) La loi du profit condamne toujours la classe ouvrière à l’exploitation et à la misère.
Le coronavirus a révélé la précarité des systèmes de santé au niveau mondial
L’arrivée du coronavirus a mis à nu le manque criminel de prévention et les coupes dans les budgets de la santé [92] de la part des États bourgeois : hôpitaux saturés, médecins et infirmiers sans matériel, sans équipements, travaillant sans sécurité sanitaire, etc.
La progression de la contagion semaine après semaine a mis à nu le fait que toutes les années de prospérité économique dont a joui la bourgeoisie péruvienne, produit des prix élevés des matières premières, des privatisations, des concessions minières, des recettes d’impôts et d’autres opérations, ont seulement servi à se remplir ses poches et que ce sont les travailleurs qui paieront les pots cassés. D’ailleurs, l’État bourgeois et patronal en appelle cyniquement à la responsabilité individuelle des citoyens en imposant le confinement par décret pour éviter la chute du système de santé publique, déjà saturé.
Le virus a provoqué une véritable crise sanitaire au niveau national et planétaire. Au Pérou, l’Assurance sociale de santé et le Ministère de la santé sont en train d’occulter les terribles conditions dans lesquelles travaillent des centaines de médecins et infirmières. Toute cette situation de précarité dans la sécurité sociale a été dénoncée par un groupe de travailleurs liés au Syndicat National de Médecine de l’Assurance Sociale du Pérou (Sinamssop), qui ont été par la suite arrêtés dans leur local syndical par la police nationale sous l’ordre de la présidente de ESSALUD, Fiorella Molinelli.
Au Pérou comme ailleurs, sur toute la planète, durant des décennies, la bourgeoisie s’est fichue éperdument de la santé publique, jamais il n’y a eu d’investissement durable. Au contraire, année après année, il n’y a eu que des coupes dans les budgets de santé. Par exemple, l’Espagne, qui présente l’une des pires infrastructures sanitaires en Europe, donne une idée de la précarité des moyens. Par comparaison, avec 33 millions d’habitants (presque 75 % de la population de l’Espagne), le Pérou compte environ à peine 350 lits dans les Unités de soins intensifs !
Aujourd’hui, au moment où l’urgence mondiale pour la santé explose, en pleine crise, on voit comment les autorités courent pour acheter des équipements et autre matériel. L’ordre de la bourgeoisie est d’arrêter la pandémie sans sacrifier l’exploitation et les profits. La première chose qu’il faut dénoncer est que nous sommes en face d’un effondrement annoncé du système de santé publique. Cela n’est pas dû à “l’irresponsabilité” des citoyens, mais aux coupes depuis des décennies dans les dépenses sanitaires, dans le personnel sanitaire et dans les budgets d’entretien des hôpitaux et de la recherche médicale [92].
Les médias excellent dans la diffusion de nombreux reportages sur le confinement : images de rues vides, de personnes qui ne respectent pas le couvre-feu, de la police et de l’armée remplissant leur tâche de contrôle de l’ordre et de répression ouvrière. En revanche, il n’y a aucun reportage, aucune image ou information qui montre les centres médicaux ou les hôpitaux publics qui prennent en charge les cas du coronavirus. Pourquoi ? Parce qu’ils ne veulent pas montrer la saturation du système de santé et ses installations. Chaque jour sur les réseaux sociaux, on voit de plus en plus de médecins et infirmières qui dénoncent les mauvaises conditions dans lesquelles ils travaillent quotidiennement.
L’effondrement ne se trouve pas seulement dans l’assistance médicale. Par exemple, à Sao Paolo, au Brésil, on prépare le plus grand cimetière du monde, puisque le nombre de morts ne cesse d’augmenter et que les morgues et cimetières de la ville sont saturés. À Guayaquil, en Équateur, où la misère a progressé brutalement ces 10 dernières années, les vagues de violence, les bandes, le trafic de drogue, les populations entassées, le manque d’infrastructures publiques et de services de base, sont quelques-uns des problèmes qui apparaissent plus clairement durant cette pandémie. Des morts sont brûlés dans la rue suite à la saturation des morgues et des cimetières. Beaucoup de familles gardent leurs morts devant leur domicile, certaines autorités commencent à remplir des bennes avec les cadavres. Ce sont de véritables scènes de guerre avec des morts partout.
Sur le contrôle de la population et la répression des travailleurs
L’État bourgeois du Président Martin Vizcarra a approuvé une loi qui permet aux forces de l’ordre de tirer pour “leur légitime défense” face aux possibles manifestations ou réactions de la classe ouvrière. La loi n° 31012, loi de protection policière donne à la police nationale du Pérou, dans le cadre de ses fonctions, le droit de faire usage de ses armes ou d’autres moyens de défense… Cette loi est une nouvelle arme contre le prolétariat. Elle montre la peur crainte de la bourgeoisie et du gouvernement des manifestations de travailleurs qui commencent déjà à se produire dans différentes parties du pays, à cause de l’insoutenable situation de misère dans laquelle les travailleurs sont poussés par l’accroissement de la crise économique avec le Covid-19.
La bourgeoisie montre ses griffes une fois de plus avec cette loi, que certains juristes eux-mêmes considèrent comme inconstitutionnelle.
Mais l’attaque idéologique de la bourgeoisie est présente aussi dans le message qui dit qu’aujourd’hui les gouvernements sont en train de faire “tout le nécessaire” pour sauver, non pas “les banques” en premier, comme lors de la “crise financière” de 2008, mais la population d’abord.
On l’entend dans des phrases comme “Pérou d’abord”, “tous contre le coronavirus”, “ensemble, nous le pouvons”, phrases qui sont répétées tous les jours en pleine crise. Nous devons dénoncer ici le nationalisme et la fausse communauté d’intérêts entre exploiteurs et exploités, qui est utilisée comme venin idéologique pour demander des sacrifices et diluer le prolétariat dans des luttes inter-classistes.
Nous l’avons déjà vu lors de révoltes populaires de l’automne dernier au Chili et en Équateur, où le prolétariat fut encadré et dévoyé sur un terrain interclassiste derrière la défense de l’indigénisme, de la démocratie, du gauchisme, des chansons patriotiques à la mode, de la bataille pour une nouvelle Assemblée constituante et autres pièges idéologiques de la bourgeoisie. (5)
Cette pandémie mondiale, qui s’ajoute aux vertigineux cas de malnutrition, tuberculose ou dengue avec d’innombrables morts chaque année, en plus de l’infinité des cas de contamination et de morts dans l’activité minière, est une nouvelle expression du fait que le capitalisme est entré dans une phase terminale, celle de la décomposition sociale [10] qui menace visiblement la survie de l’humanité.
Dans cette situation, il est possible d’affirmer que, quoi qu’il arrive avec le virus Covid-19, cette maladie alerte sur le fait que le capitalisme est devenu un danger pour l’humanité et pour la vie sur cette planète. Les énormes capacités des forces productives, la recherche médicale incluse, pour nous protéger contre les maladies se heurtent à la criminelle recherche de profit, avec l’entassement d’une grande partie de la population humaine dans des mégapoles invivables [101] (rien qu’à Lima il y a presque 9 millions d’habitants) et avec les risques de nouvelles épidémies que tout cela entraîne.
Médecins et infirmières protestent et manifestent
Des médecins et des infirmières de plusieurs hôpitaux de Lima et de quelques provinces ont manifesté et protesté contre le manque de sécurité sanitaire, le manque de matériel et contre la politique sanitaire du gouvernement. Beaucoup de médecins et d’infirmières ont fait des sit-in avec des pancartes et hauts-parleurs pour dénoncer les conditions de travail abominables qu’ils affrontent chaque jour, prenant des risques pour leur santé et celle de leurs familles.
Au Pérou, le gouvernement savait dès janvier ce qui allait arriver et pourtant il a ignoré les avertissements et a sous-estimé la pandémie. Quand le mal était fait, l’Assurance sociale de santé et le Ministère de la santé ont envoyé les ouvriers de la santé, médecins, infirmières, techniciens et même étudiants en médecine, “au front” pour traiter les cas sans aucune protection, comme des soldats réquisitionnés pour la guerre, ce qui a produit des contaminations et des morts à Lima et dans d’autres provinces.
Pour autant les travailleurs ne se sont pas tus. Par exemple, le 7 avril à l’hôpital de Ate-Vitarte, présenté pompeusement par Vizcarra comme “modèle de lutte contre le Covid-19”, les médecins et infirmières ont refusé de travailler et sont restés devant la porte pour protester contre le gouvernement face au manque de masques, de gants, de respirateurs et de normes de sécurité. (6) Beaucoup d’entre eux ont été licenciés, d’autres arrêtés.
De nombreux médecins et infirmières ont mené des actions sur les réseaux sociaux, filmant avec leurs portables les installations des hôpitaux et dénonçant la précarité dans laquelle ils travaillent.
Ceci est en train de se multiplier au niveau national ; et pourtant, les médias de masse à la télé cachent toutes ces informations sur ordre de la bourgeoisie et du gouvernement, pour que la misère dans laquelle les hôpitaux sont plongés ne soit pas révélée.
Dans d’autres parties du monde, on a vu aussi surgir des manifestations de travailleurs de la santé face à la crise de la pandémie, comme en France, Espagne et Italie où il y a eu des protestations contre la précarité au travail, contre le manque de sécurité, de brancards, de respirateurs, de gants et de masques. Partout on trouve le même scénario : la précarité des systèmes de santé publique due aux coupes budgétaires dans la santé.
Expliquer, par tous les moyens possibles, qu’il n’existe pas de sortie ni de solutions dans le capitalisme
La crise économique mondiale se développe de plus en plus, fait sentir ses effets sur la classe ouvrière et s’exprime principalement dans la précarité du travail et l’augmentation du chômage, SITUATION Aggravée MAINTENANT AVEC LA PANDÉMIE DU CORONAVIRUS ET LA CHUTE DE LA CROISSANCE ÉCONOMIQUE. Cette perspective de nouvelles attaques plus brutales contre la classe ouvrière dans le monde entier ouvre la possibilité d’un développement des luttes du prolétariat sur son terrain de classe. Ce n’est pas le terrain de la rage interclassiste à la manière, par exemple, du mouvement des “gilet jaunes” en France (comme nous le dénonçons dans des articles sur notre site web [102]), mais plutôt le terrain des luttes qui ont eu lieu à la fin de l’année dernière en France avec le mouvement des travailleurs contre la réforme des retraites et où il a été mis sur la table la réflexion sur “comment la classe ouvrière doit lutter et s’organiser contre son ennemi historique”. Même si on a vu beaucoup de faiblesses dans ce mouvement des travailleurs, on doit en tirer des enseignements pour la classe ouvrière mondiale, situation qui démontre l’arrivée de nouvelles luttes avec un certain degré de maturation politique qui devra être développé.
Internacionalismo, section du CCI au Pérou (11 avril 2020).
1 Commentaires d’Oscar Dancourt, ex-président de la Banque centrale de réserve du Pérou, 3 avril 2020.
2 Compensation pour temps de Service, prime cumulable accordée aux travailleurs du secteur privé.
3 Cepal, Commission économique pour l’Amérique latine, une des cinq commissions régionales des Nations Unies, fondée pour contribuer au développement de l’Amérique latine.
4 Journal Diario Perú (4 avril 2020).
5 Voir nos interventions et articles sur le Chili et l’Equateur :
– “Mouvement social au Chili : l’alternative dictature ou démocratie est une impasse [103]”
– “Face à la plongée dans la crise économique mondiale et la misère, les « révoltes populaires » constituent une impasse [104]” et en espagnol :
6 LID (8 avril 2020).
Récent et en cours:
- Coronavirus [55]
- COVID-19 [56]
Covid-19: Malgré tous les obstacles, la lutte de classe forge son futur
- 207 lectures
Avant que le raz-de-marée de la crise de Covid-19 ne déferle sur la planète, les luttes de la classe ouvrière en France, en Finlande, aux États-Unis et ailleurs étaient le signe d’un nouvel état d’esprit au sein du prolétariat, d’une réticence à s’incliner devant les exigences imposées par une crise économique croissante. En France en particulier, nous avons pu discerner des signes de récupération de l’identité de classe érodée par des décennies de décomposition capitaliste, par la montée d’un courant populiste qui falsifie les véritables divisions de la société et qui est descendu dans la rue en France en portant un gilet jaune.
En ce sens, la pandémie de Covid-19 ne pouvait pas survenir à un pire moment pour la lutte du prolétariat : alors qu’il commençait à se retrouver dans les rues, à se rassembler dans des manifestations pour résister aux attaques économiques dont le lien avec la crise capitaliste est difficile à dissimuler, la majorité de la classe ouvrière n’a eu d’autre choix que de se replier dans le foyer individuel, d’éviter tout grand rassemblement, de “se confiner” sous l’œil d’un appareil d’État tout puissant qui a su lancer de forts appels à “l’unité nationale” face à un ennemi invisible qui, nous dit-on, ne fait pas de discrimination entre riches et pauvres, entre patrons et ouvriers.
Les difficultés auxquelles la classe ouvrière est confrontée sont réelles et profondes. Mais ce qui est d’une certaine manière remarquable, c’est le fait que, malgré la crainte omniprésente de la contagion, malgré l’apparente omnipotence de l’État capitaliste, les signes de combativité de classe qui se sont manifestés en hiver, ne se sont pas évaporés. Dans une première phase et face à la négligence et à l’impréparation choquantes de la bourgeoisie, nous avons vu des mouvements défensifs très étendus de la classe ouvrière. Les travailleurs du monde entier ont refusé d’aller comme des “agneaux à l’abattoir” mais ont mené une lutte déterminée pour défendre leur santé, leur vie même, en exigeant des mesures de protection adéquates ou la fermeture des entreprises qui ne sont pas engagées dans la production essentielle (comme les usines automobiles).
Les principales caractéristiques de ces luttes sont les suivantes :
– Elles ont eu lieu à l’échelle mondiale, étant donné la nature globale de la pandémie. Mais l’un des éléments les plus importants est qu’elles ont été plus évidentes dans les pays centraux du capitalisme, en particulier dans les pays qui ont été le plus durement touchés par la maladie : en Italie, par exemple, la Tendance communiste internationaliste mentionne des grèves spontanées [106] dans le Piémont, en Ligurie, en Lombardie, en Vénétie, dans l’Émilie-Romagne, en Toscane, dans l’Ombrie et les Pouilles. Ce sont surtout les ouvriers des usines italiennes qui ont été les premiers à lancer le slogan “nous ne sommes pas des moutons qu’on mène à l’abattoir”. En Espagne, il y a eu grèves chez Mercedes, à la FIAT, dans l’usine de produits électroménagers Balay à Saragosse ; les travailleurs de Telepizza se sont mis en grève contre les sanctions prises contre ceux qui ne voulaient pas risquer leur vie en livrant des pizzas, il y a eu d’autres protestations des livreurs à Madrid. Peut-être le plus important de tous, notamment parce qu’il remet en question l’image d’une classe ouvrière américaine qui s’est ralliée sans critique à la démagogie de Donald Trump, il y a eu des luttes généralisées aux États-Unis : grèves chez FIAT-Chrysler des usines de Tripton dans l’Indiana, dans l’usine de production de camions Warren dans la périphérie de Détroit, chez les chauffeurs de bus à Detroit et à Birmingham (en Alabama), dans les ports, les restaurants, dans la distribution alimentaire, dans le secteur du nettoyage et celui de la construction ; des grèves ont eu lieu chez Amazon (qui a également été touché par des grèves dans plusieurs autres pays), Whole Foods, Instacart, Walmart, FedEx, etc. Nous avons également assisté à un grand nombre de grèves des loyers aux États-Unis. C’est une forme de lutte qui, si elle n’implique pas automatiquement les prolétaires, n’est pas non plus étrangère aux traditions de la classe (on pourrait citer, par exemple, les grèves des loyers de Glasgow qui ont fait partie intégrante des luttes ouvrières pendant la Première Guerre mondiale, ou la grève de loyers du Merseyside en 1972 qui a accompagné la première vague internationale de luttes après 1968). Aux États-Unis en particulier, une menace réelle d’expulsion pèse sur de nombreux secteurs “bloqués” de la classe ouvrière.
En France et en Grande-Bretagne, de tels mouvements étaient moins répandus, mais nous avons vu des débrayages non officiels de la part des postiers et des ouvriers du bâtiment, des magasiniers et des ramasseurs de poubelles en Grande-Bretagne et, en France, des grèves sur les chantiers navals de Saint-Nazaire, chez Amazon à Lille et à Montélimar, à ID logistics… En Amérique latine, on peut citer le Chili (Coca-Cola), les travailleurs portuaires en Argentine et au Brésil ou d’emballage au Venezuela. Au Mexique, “des grèves se sont étendues à la ville mexicaine de Ciudad Juárez, à la lisière de la cité texane d’El Paso, impliquant des centaines de travailleurs des maquiladoras qui réclament la fermeture des usines non essentielles qui ont été maintenues ouvertes malgré le nombre croissant de décès dus à la pandémie de Covid-19, dont treize employés de l’usine de sièges automobiles Lear, propriété des États-Unis. Les grèves […] font suite à des actions similaires menées par les travailleurs des villes frontalières de Matamoros, Mexicali, Reynosa et Tijuana”. (1) En Turquie, des grèves de protestation se sont produites à l’usine textile de Sarar (contre l’avis des syndicats), au chantier naval de Galataport et par les travailleurs des postes et des télégraphes. En Australie, ont eu lieu des grèves des travailleurs des ports et dans le secteur de la distribution. La liste pourrait facilement être allongée.
– Un certain nombre de grèves ont été spontanées, comme en Italie, dans les usines automobiles américaines et les centres Amazon, et les syndicats ont été largement critiqués et parfois en opposition frontale contre leur collaboration ouverte avec la direction. Selon un article sur libcom.com [107], qui offre un large panorama des luttes récentes aux États-Unis : “Les travailleurs des usines d’assemblage de Fiat-Chrysler de Sterling Heights (SHAP) et Jefferson North (JNAP) dans la région de Detroit ont pris les choses en main hier soir et ce matin et ils ont décidé d’arrêter la production pour stopper la propagation du coronavirus. Les arrêts de travail ont commencé à Sterling Heights la nuit dernière, quelques heures seulement après que le United Auto Workers (2) et les constructeurs automobiles de Detroit ont conclu un accord pourri [108] pour maintenir les usines ouvertes et opérationnelles pendant la pandémie mondiale… Le même jour, des dizaines de travailleurs de l’usine Lear Seating à Hammond dans l’Indiana ont refusé de travailler, forçant la fermeture de l’usine de pièces détachées et de l’usine d’assemblage de Chicago située à proximité”. L’article contient également une interview d’un travailleur de l’automobile :
“L’UAW devrait en fait se battre pour que nous quittions le travail. Le syndicat et l’entreprise se soucient davantage de la fabrication des camions que de la santé de chacun. J’ai l’impression qu’ils ne feront rien si nous n’agissons pas. Nous devons nous regrouper. Ils ne peuvent pas tous nous virer”.
– Ces mouvements se situent sur un terrain de classe : autour des conditions de travail (demande d’équipements de protection adéquats) mais aussi des indemnités de maladie, des salaires impayés, contre les sanctions contre les travailleurs qui ont refusé de travailler dans des conditions dangereuses, etc. Ils témoignent d’un refus de sacrifice qui s’inscrit dans la continuité de la capacité de la classe à résister à la poussée vers la guerre, un facteur sous-jacent de la situation mondiale depuis la reprise des luttes de classes en 1968.
– Les travailleurs de la santé, s’ils ont fait preuve d’un extraordinaire sens des responsabilités qui est un élément de la solidarité prolétarienne, ont également exprimé leur mécontentement face à leurs conditions, leur colère face aux appels hypocrites et aux éloges des gouvernements, même si cela a surtout pris la forme de protestations et de déclarations individuelles ; (3) mais il y a eu des actions collectives, y compris des grèves, au Malawi, au Zimbabwe, en Papouasie-Nouvelle-Guinée, comme des manifestations d’infirmières à New York.
La crise pandémique : un coup dur pour la lutte de classe
Mais ce sens de la responsabilité du prolétariat, qui incite également des millions de personnes à suivre les règles de l’auto-isolement, montre que la majorité de la classe ouvrière accepte la réalité de cette maladie, même dans un pays comme les États-Unis qui est le “cœur” de diverses formes de déni de la pandémie. Ainsi, les luttes que nous avons vues se sont nécessairement limitées soit aux travailleurs dans les secteurs “essentiels” qui se battent pour des conditions de travail plus sûres (et ces catégories resteront forcément minoritaires, même si leur rôle est vital) soit à des travailleurs qui se sont très tôt interrogés sur la nécessité réelle de leur travail, comme les travailleurs de l’automobile en Italie et aux États-Unis ; et donc leur revendication centrale était d’être renvoyés chez eux (avec une rémunération de l’entreprise ou de l’État plutôt que d’être licenciés, comme beaucoup l’ont été). Mais cette revendication, aussi nécessaire soit-elle, ne pouvait qu’impliquer une sorte de recul tactique dans la lutte, plutôt que son intensification ou son extension. Il y a eu des tentatives (par exemple parmi les travailleurs d’Amazon aux États-Unis) de tenir des réunions de lutte en ligne, de faire des piquets de grève tout en observant les distances de sécurité, etc. mais on ne peut pas ignorer le fait que les conditions d’isolement et de confinement constituent un obstacle énorme à tout développement immédiat de la lutte.
Dans des conditions d’isolement, il est plus difficile de résister au gigantesque barrage de propagande et d’obscurcissement idéologique.
Des hymnes à l’unité nationale sont chantés chaque jour par les médias, basés sur l’idée que le virus est un ennemi qui ne discrimine personne : au Royaume-Uni, le fait que Boris Johnson et le Prince Charles aient été infectés par le virus en est présenté comme la preuve. (4) La référence à la guerre, l’esprit du “Blitz” pendant la Seconde Guerre mondiale (lui-même étant le produit d’un important exercice de propagande visant à dissimuler tout mécontentement social) est incessante au Royaume-Uni, notamment avec les applaudissements donnés à un vétéran centenaire de l’aviation qui a récolté des millions pour le NHS (5) en réalisant cent longueurs de son grand jardin. En France, Macron s’est également présenté comme un chef de guerre ; aux États-Unis, Trump s’est efforcé de définir le Covid-19 comme le “virus chinois”, détournant l’attention de la triste gestion de la crise par son administration et jouant sur le thème habituel de “America First” (l’Amérique d’abord). Partout (y compris dans l’espace Schengen de l’Union européenne), la fermeture des frontières a été mis en avant comme le meilleur moyen d’endiguer la contagion. Des gouvernements d’unité nationale ont été formés là où régnait autrefois une division apparemment insoluble (comme en Belgique), où des partis d’opposition deviennent plus que jamais “loyaux” à “l’effort de guerre” national.
L’appel au nationalisme va de pair avec la présentation de l’État comme la seule force capable de protéger les citoyens, que ce soit par l’application vigoureuse des fermetures ou sous sa forme plus douce de fournisseur d’aide aux personnes dans le besoin, que ce soit les milliers de milliards distribués pour maintenir les travailleurs licenciés ainsi que les indépendants dont les entreprises ont dû fermer, ou les services de santé administrés par l’État. En Grande-Bretagne, le National Health Service a longtemps été une icône sacrée de presque toute la bourgeoisie, mais surtout de la gauche qui l’a considéré comme sa réalisation particulière, puisqu’il a été introduit par le gouvernement travailliste d’après-guerre qui le présente comme étant en quelque sorte en dehors de la marchandisation capitaliste de l’existence, malgré les empiétements “maléfiques” des entrepreneurs privés. Cette vantardise autour du NHS et des institutions similaires est soutenue par les rituels hebdomadaires d’applaudissements et les louanges incessantes des travailleurs de la santé “héroïques”, surtout par les mêmes politiciens qui ont contribué à démanteler le système de santé au cours de la dernière décennie, voire depuis plus longtemps.
Selon Michael Foot, représentant de l’aile gauche du parti travailliste, la Grande-Bretagne n’a jamais été aussi proche du socialisme que pendant la Seconde Guerre mondiale. Aujourd’hui, alors que l’État doit mettre de côté les préoccupations de rentabilité immédiate pour maintenir la cohésion de la société, la vieille illusion selon laquelle “nous sommes tous socialistes aujourd’hui” (qui était une idée communément exprimée par la classe dirigeante pendant la vague révolutionnaire après 1917) a reçu un nouveau souffle grâce aux dépenses massives imposées aux gouvernements par la crise du Covid-19. L’influent philosophe de gauche Slavo Zizek, dans une interview sur Youtube intitulée “Communisme ou barbarie [109]”, semble impliquer que la bourgeoisie elle-même est maintenant obligée de traiter l’argent comme un simple mécanisme comptable, une sorte de bon de temps de travail, totalement détaché de la valeur actuelle. En somme, les barbares deviennent communistes. En réalité, la séparation croissante entre l’argent et la valeur est le signe de l’épuisement complet du rapport social capitaliste et donc de la nécessité du communisme, mais le mépris des lois du marché par l’État bourgeois est tout sauf un pas vers un mode de production supérieur : c’est le dernier rempart de cet ordre en déclin. Et c’est surtout la fonction de la gauche du capitalisme de le cacher à la classe ouvrière, de la détourner de sa propre voie qui exige de sortir de l’emprise de l’État et de préparer sa destruction révolutionnaire.
Mais à l’époque du populisme, la gauche n’a pas le monopole des fausses critiques du système. La réalité certaine que l’État va partout utiliser cette crise pour intensifier sa surveillance et son contrôle de la population (et donc la réalité d’une classe dirigeante qui “conspire” sans cesse pour maintenir sa domination de classe) donne lieu à un nouveau lot de “théories complotistes”, dans lesquelles le danger réel de Covid-19 est écarté ou nié catégoriquement : il s’agit d’une “Scamdémie” soutenue par une sinistre cabale de mondialistes pour imposer leur programme de “gouvernement mondial unique”. Et ces théories, qui sont particulièrement influentes aux États-Unis, ne se limitent pas au cyberespace. La faction Trump aux États-Unis a agité cet épouvantail, affirmant qu’il existe des preuves que le Covid-19 s’est échappé d’un laboratoire de Wuhan (même si les services de renseignements américains ont déjà écarté cette hypothèse). La Chine a répondu par des accusations similaires contre les États-Unis. Il y a également eu de grandes manifestations aux États-Unis pour exiger le retour au travail et la fin du confinement, encouragées par Trump et souvent inspirées par les théories ambiantes conspiratives (ainsi que par des fantasmes religieux : la maladie est réelle, mais nous pouvons la vaincre grâce au pouvoir de la prière). Il y a également eu quelques attaques racistes contre des personnes originaires d’Extrême-Orient, identifiées comme étant responsables du virus. Il ne fait aucun doute que de telles idéologies affectent certaines parties de la classe ouvrière, en particulier celles qui ne reçoivent aucune forme de soutien financier des employeurs ou de l’État, mais les manifestations pour le retour au travail aux États-Unis semblent avoir été menées principalement par des éléments de la petite-bourgeoisie soucieux de relancer leurs entreprises. Comme nous avons vu, de nombreux travailleurs ont lutté pour aller dans la direction opposée !
Cette vaste offensive idéologique renforce l’atomisation objective, imposée par le confinement, la peur que quiconque en dehors du foyer familial puisse être source de maladie et de mort. Et le fait que le “blocage” (lock-down, NDT) va probablement durer un certain temps, qu’il n’y aura pas de retour à la normale et qu’il pourrait y avoir d’autres périodes de confinement si la maladie passe par une deuxième vague, aura tendance à exacerber les difficultés de la classe ouvrière. Et nous ne pouvons pas nous permettre d’oublier que ces difficultés n’ont pas commencé avec le confinement, mais qu’elles ont une longue histoire derrière elles, surtout depuis le début de la période de décomposition après 1989, qui a vu un profond recul à la fois dans la combativité et la conscience, une perte croissante de l’identité de classe, une exacerbation de la tendance au “chacun pour soi” à tous les niveaux. Ainsi, la pandémie, en tant que produit évident du processus de décomposition, marque une nouvelle étape dans le processus, une intensification de tous ses éléments les plus caractéristiques. (6)
La nécessité d’une réflexion politique et du débat
Néanmoins, la crise de Covid-19 a également attiré l’attention sur la dimension politique à un degré sans précédent : les conversations quotidiennes ainsi que le bavardage incessant des médias sont presque entièrement centrés sur la pandémie et le confinement, la réponse des gouvernements, la situation critique des travailleurs de la santé et autres travailleurs “essentiels” et les problèmes de survie quotidienne d’une grande partie de la population dans son ensemble. Il ne fait aucun doute que le marché des idées a été en grande partie accaparé par les différentes formes de l’idéologie dominante, mais il existe encore des endroits où une minorité importante peut poser des questions fondamentales sur la nature de cette société. La question de savoir ce qui est “essentiel” dans la vie sociale, de savoir qui fait le travail le plus vital et qui est pourtant si misérablement payé pour cela, la négligence des gouvernements, l’absurdité des divisions nationales et du chacun pour soi face à une pandémie mondiale, le genre de monde dans lequel nous vivrons après cette pandémie : ce sont là des questions qui ne peuvent être complètement cachées ou détournées. Et les gens ne sont pas entièrement atomisés : les gens confinés ont recours aux médias sociaux, aux forums Internet, aux vidéos ou audioconférences non seulement pour continuer le travail salarié ou rester en contact avec leur famille et leurs amis, mais aussi pour discuter de la situation et poser des questions sur sa véritable signification. La rencontre physique (si elle se fait à la distance sociale requise…) avec les résidents de l’immeuble ou du quartier peut également devenir un espace de discussion, même s’il ne faut pas confondre le rituel hebdomadaire des applaudissements avec la solidarité réelle ou les groupes locaux d’entraide avec la lutte contre le système.
En France, un slogan qui s’est popularisé est “le capitalisme est le virus, la révolution est le vaccin”. En d’autres termes, des minorités dans la classe amènent la discussion et la réflexion jusqu’à leur conclusion logique. “L’avant-garde” de ce processus est constituée par les éléments, dont certains très jeunes, qui ont clairement compris que le capitalisme est totalement en faillite et que la seule alternative pour l’humanité est la révolution prolétarienne mondiale (en d’autres termes, par ceux qui se dirigent vers des positions communistes, et donc la tradition de la Gauche communiste). L’apparition de cette génération de minorités “en recherche” pour le communisme confère aux groupes existants de la Gauche communiste une immense responsabilité dans le processus de construction d’une organisation communiste qui pourra jouer un rôle important dans les luttes futures du prolétariat.
Les luttes défensives que nous avons vues au début de la pandémie, le processus de réflexion qui s’est déroulé pendant le confinement, sont des indications du potentiel intact de la lutte des classes, qui peut aussi être “confinées” pendant une période considérable, mais qui à plus long terme pourrait mûrir au point de pouvoir s’exprimer ouvertement. L’incapacité à réintégrer un grand nombre de personnes licenciées au plus fort de la crise, la nécessité pour la bourgeoisie de récupérer les “cadeaux” qu’elle a distribués dans l’intérêt de la stabilité sociale, la nouvelle vague d’austérité que la classe dominante sera obligée d’imposer : telle sera certainement la réalité de la prochaine étape de l’histoire du Covid-19, qui est simultanément l’histoire de la crise économique historique du capitalisme et de sa décomposition progressive. C’est aussi l’histoire de l’aggravation des tensions impérialistes, alors que diverses puissances cherchent à utiliser la crise de Covid-19 pour perturber davantage l’ordre mondial : en particulier, il pourrait y avoir une nouvelle offensive du capitalisme chinois visant à défier les États-Unis en tant que première puissance mondiale. En tout état de cause, les tentatives de Trump de rejeter la responsabilité de la pandémie sur la Chine annoncent déjà une attitude de plus en plus agressive de la part des États-Unis. On demandera aux travailleurs de faire des sacrifices pour “reconstruire” le monde post-Covid, et pour défendre l’économie nationale contre la menace extérieure.
Une fois de plus, nous devons mettre en garde contre tout risque d’immédiatisme dans ce domaine. Un danger probable (étant donné le faible niveau actuel de conscience d’une identité de classe et la misère croissante qui touche toutes les couches de la population mondiale) sera que la réponse à de nouvelles attaques contre le niveau de vie prenne la forme de révoltes interclassistes, “populaires”, dans lesquelles les travailleurs n’apparaissent pas comme une classe distincte avec leurs propres méthodes de lutte et leurs revendications. Nous avons vu une vague de telles révoltes avant le confinement et, même pendant le confinement, elles ont déjà réapparu au Liban, au Chili et ailleurs, soulignant que ce type de réaction est un problème particulier dans les régions plus “périphériques” du système capitaliste. Un récent rapport de l’ONU [110] a averti que certaines régions du monde, en particulier l’Afrique et les pays ravagés par la guerre comme le Yémen et l’Afghanistan, connaîtront des famines aux “proportions bibliques” à la suite de la crise pandémique, ce qui tendra également à accroître le danger de réactions désespérées qui n’offrent aucune perspective.
Nous savons également que le chômage massif peut, dans un premier temps, tendre à paralyser la classe ouvrière : la bourgeoisie peut s’en servir pour discipliner les travailleurs et créer des divisions entre les employés et les chômeurs, et il est de toutes façons intrinsèquement plus difficile de lutter contre la fermeture d’entreprises que de résister aux attaques contre les salaires et les conditions de travail. Nous savons que, dans les périodes de crise économique ouverte, la bourgeoisie cherchera toujours des alibis pour tirer le système capitaliste d’affaire : au début des années 1970, c’était la “crise du pétrole” ; en 2008, “les banquiers avides”. Aujourd’hui, si on perd son emploi, c’est le virus qui sera désigné comme responsable. Mais ces alibis sont précisément nécessaires pour la bourgeoisie parce que la crise économique, et en particulier le chômage de masse, est une mise en accusation du mode de production capitaliste, dont les lois, en fin de compte, l’empêchent de nourrir ses esclaves.
Plus que jamais, les révolutionnaires doivent être patients. Comme dit le Manifeste du Parti communiste, les communistes se distinguent par leur capacité à comprendre “les conditions, la marche et les fins générales du mouvement prolétarien”. Les luttes massives de notre classe, leur généralisation et leur politisation, est un processus qui se développe sur une longue période et qui passe par de nombreuses avancées et reculs. Nous ne nous contentons pas de formuler des vœux lorsque nous insistons, comme nous le faisons à la fin de notre tract international [91] sur la pandémie, sur le fait que “l’avenir appartient à la lutte de classe”.
Amos, 12 mai 2020
1 “Workers strike across Ciudad Juárez, Mexico as COVID-19 death toll rises in factories [111]” World socialist web site (20 avril 2020).
2 UAW : un des principaux syndicats en Amérique du Nord. NdR
3 À propos des réactions des ouvriers de la santé en Belgique et en France, voir : “Covid 19 : Des réactions face à l’incurie de la bourgeoisie [87]”. La prise de position d’un médecin belge [112] est disponible en anglais sur notre forum.
4 Dans une certaine mesure, ce leitmotiv a été sapé par des preuves croissantes que les éléments les plus pauvres de la société, y compris les minorités ethniques, sont beaucoup plus durement touchés par le virus.
5 National Health Service, système de santé en Grande-Bretagne.
6 Nous avons examiné certaines de ces difficultés au sein de la classe dans différents textes récents, notamment : “Rapport sur la lutte de classe pour le 23e Congrès international du CCI (2019) : Formation, perte et reconquête de l’identité de classe prolétarienne [113]”.
Récent et en cours:
- Coronavirus [55]
- COVID-19 [56]
La pandémie révèle et accélère la décadence et la décomposition du capitalisme (Texte de camarades d’un groupe de discussion dans la région d’Alicante)
- 80 lectures
Nous publions ci-dessous, la contribution de camarades d’un groupe de discussion dans la région d’Alicante, suivie de notre réponse.
DÉBATS SUR (ET CONTRE) LE VIRUS DU CAPITALISME
En ces jours étranges où l’anormal est devenu la norme, sans pour autant égratigner la surface du système de domination, mais plutôt comme continuation exacerbée de cette étouffante domination du capitalisme sur la vie quotidienne. Avec un État capitaliste de plus en plus puissant en tant qu’entité médiatrice de toute la vie sociale, nous, un groupe de camarades qui, depuis des années, continuons de partager le militantisme à travers diverses initiatives dans la ville d’Alicante et ses environs, nous nous sommes réunis pour lancer un débat sur la situation actuelle et historique. Notre militantisme, qui a pris un chemin différent au fil des ans, a retenu deux éléments selon une perspective de classe : l’affirmation du besoin réel de l’autonomie de la classe ouvrière (notre classe) et de l’internationalisme prolétarien. Par conséquent, même lorsqu’existent des divergences d’opinion sur certaines questions, nous nous reconnaissons dans le mouvement révolutionnaire historique et international du prolétariat.
LE CADRE GÉNÉRAL À PARTIR DUQUEL NOUS SOMMES PARTIS :
– Le besoin constant d’accumulation du capital détermine l’inévitable répétition de ses crises. La science historique de la classe ouvrière en est venue à établir un schéma temporel : tous les 10 à 15 ans, la crise est un phénomène imparable.
– La crise a été résolue par la destruction de personnes, de marchandises et de marchés ; la guerre est le phénomène prioritaire pour favoriser les destructions nécessaires imposées par la logique suicidaire du capital.
– La mondialisation du capitalisme (depuis le début du XXe siècle) et la disparition progressive des marchés précapitalistes, exacerbe les rivalités inter-bourgeoises et donne lieu à une situation de crise accumulée, où se développent des guerres impérialistes à grande échelle avec une puissance de destruction massive.
– La Seconde Guerre mondiale impérialiste et les terribles destructions qu’elle a engendrées (dans le sillage de la Première Guerre impérialiste), avec le consensus des ouvriers de tous les pays alliés à leurs bourgeoisies respectives sous les bannières du fascisme ou de la démocratie (deux faces complémentaires de la perversion du capital pervers), favorisent la reprise économique des soi-disant “30 glorieuses”, les années de reconstruction et de croissance accélérée. Un ballon d’oxygène pour un capital acculé par son propre développement.
– Depuis le retour de la crise (années 1970) et de la lutte prolétarienne, le capital a fait de nombreuses tentatives pour nous mobiliser de nouveau dans une grande guerre, et de nombreuses guerres locales ont été menées en passant sur nos corps et ceux de nos frères et sœurs de classe.
– Cependant, deux facteurs ont empêché le développement d’une guerre à grande échelle au sens classique du terme : l’humanité refuse d’être enrôlée dans de nouvelles guerres, il existe une conscience (pas encore de classe) qui refuse la logique de la guerre sous un angle pacifiste, pas révolutionnaire. Une tentative forcée du capital vers la guerre pourrait accélérer la prise de conscience, actuellement lente. D’autre part, la prolifération des armes nucléaires pourrait faire d’une dernière aventure guerrière, la dernière des guerres. La bourgeoisie, une classe sans scrupules qui n’a pas peur de verser le sang des autres, craint pour ses propres veines.
La crise actuelle du coronavirus soulève des questions qu’il convient d’évaluer et de clarifier.
Questions d’ordre général :
– Idéologiquement, cette crise exacerbe les éléments les plus brutaux de l’idéologie dominante, les piliers sur lesquels repose la fausse conscience de la réalité : le nationalisme, la défense de la nation et la lutte unie par-delà les divisions de la société en classes, contre le virus malfaisant, l’union des riches et des pauvres par-delà la réalité elle-même, l’appel constant (entre acclamations, applaudissements et chansons populaires) à la sacro-sainte unité nationale. L’atomisation, la stratégie de cloisonnement entre nos pairs et nous-mêmes, cristallisée à la perfection dans le confinement, l’interdiction du contact, de l’affection, de la solidarité.
– Politiquement, elle renouvelle les besoins du capitalisme d’État, le rôle supérieur et directeur de l’État en tant que garant et médiateur direct de toutes, absolument toutes, les relations humaines. Et n’oublions pas (comme le fait de manière si intéressée la gauche capitaliste) que l’État est l’organe de pouvoir de la bourgeoisie, ce n’est pas une entité neutre qui veille objectivement aux intérêts de la majorité, c’est l’état de pouvoir d’une minorité. La répression sous un prétexte virologique, la militarisation de la vie sociale, ne sont que quelques symptômes de cette maladie, et peut-être sont-ils là pour rester. On parle d’une économie de guerre, d’un état de guerre, et ils veulent tous nous transformer en petits soldats, dans cette logique militariste répugnante.
Sur le plan économique, nous avons examiné différentes options, que nous ne sommes pas en mesure de clarifier pour l’instant :
Eh bien, la vérité, c’est que ce qui se passe actuellement ne commencera à nous paraître plus ou moins clair qu’après un certain temps, cela va de soi.
Sur le plan économique, nous voyons comment la pandémie est en train d’affecter l’ensemble des pays dans une mesure plus ou moins grande, et il est difficile de dire quel “bloc impérialiste” en sortira vainqueur. Même s’il est vrai que la libre circulation des marchandises favorise l’accumulation, il n’en est pas moins vrai que, ces dernières années, la Chine, les États-Unis et l’Union européenne se livrent une guerre commerciale. Les politiques protectionnistes se sont accrues face à un gâteau (le monde) plus petit à se partager entre ces charognards. Il reste à évaluer les répercussions du coronavirus et la manière dont le capital en tirera parti, mais une hypothèse se dégage et s’imbrique dans la nécessité même de la guerre impérialiste :
Nous nous demandons si ce phénomène viral peut constituer un substitut à la guerre impérialiste classique, car cela pourrait finir par en égaler la faculté destructrice de main-d’œuvre, de marchandises et de marchés, en favorisant les processus cycliques de reconstruction. Si cette option est viable (cela ne dépend pas seulement de la volonté de la bourgeoisie), la répétition de ces situations, de ces états d’exception et de l’arrêt temporaire et partiel de certains secteurs économiques, deviendra cyclique et constante. De fait, ce type de situations se produit déjà dans certaines régions de la planète où ce qui est ici considéré comme exceptionnel, est quelque chose de normal dans les cycles de survie. Cela pourrait être une preuve de l’imparable décadence du système capitaliste, ou bien d’une des voies d’accumulation face à sa décadence inévitable. En d’autres termes, ce serait la forme que prendrait la guerre impérialiste à grande échelle dans un avenir immédiat.
Cependant, nous avons de sérieux doutes sur cette hypothèse, car pour qu’il en soit ainsi, il faudrait qu’elle provoque, outre la destruction des marchés et des marchandises (ce qui est possible en raison de l’effondrement économique), des millions de morts pour parvenir à détruire suffisamment de main-d’œuvre qui, autrement, resterait dans la misère. Cela ne semble pas être le cas, le nombre de morts, même si cela fait beaucoup de bruit, est loin d’être alarmant, il semble plutôt que ce que l’on veuille éviter, c’est l’effondrement des hôpitaux. La misère quotidienne à elle seule est déjà la cause de millions de décès dus à la faim, à la maladie ou à la pollution dans les pays industrialisés… Et même si cette hypothèse est envisageable, cela serait bien trop dangereux, y compris pour les élites, tout comme le serait une guerre nucléaire. En d’autres termes, une véritable pandémie virale d’envergure majeure affecterait à la fois les pauvres comme les riches, à moins que ces derniers ne disposent au préalable du vaccin.
Nous ne devons pas non plus ignorer les avertissements répétés concernant la destruction imminente de millions d’emplois dus à la robotisation, les migrations massives dues aux phénomènes météorologiques en raison du changement climatique et la surpopulation des villes transformées dans la plupart des cas en de gigantesques bidonvilles.
Cette “pandémie” servira peut-être de prétexte à une nouvelle réflexion sur les relations de travail, avec une précarité de plus en plus grande, etc. et à un nouvel ordre mondial, mais cela entrerait sur le terrainconspiratif, avec leur ordre capitaliste “international” capable de dicter les politiques que les États doivent respecter. Tous ? Même si, à vrai dire, les capitalistes ont leur propre ordre international, via différents organismes tels que la Banque mondiale, le FMI, le G7, l’OMS, etc.
Nous savons qu’une simulation d’épidémie virale a été menée en septembre et celle-ci a été révélée au grand jour.1
S’agirait-il d’un écran de fumée qui cacherait un effondrement “imminent” de l’économie mondiale et servirait à remettre le système à zéro… et déjà s’infiltrent pour une période indéterminée de nouveaux moyens de répression ?
La logique du capitalisme exige sans aucun doute la destruction de la main-d’œuvre, tout en la rendant moins chère, et pour différentes raisons (certaines participant de théories plus complotistes que d’autres), cela va de soi. La surpopulation est un problème de sécurité et un problème majeur pour tous les États.
On ne peut pas non plus exclure que ces pandémies soient en fait dues à des crises climatiques et à la relation nocive entre l’homme et les autres espèces, couplé à l’incapacité des États à les résoudre au-delà de la mise en œuvre de mesures policières/militaires… et en gagnant peut-être un peu d’argent au passage.
AUTRES CONSIDÉRATIONS NÉCESSAIRES :
– Les limites du capital ne se fondent pas seulement, ni principalement dans ses contradictions économiques, dans cette tendance mathématique à diminuer le taux de profit. En ce sens, le capital démontre sa capacité créative, avec l’ouverture de nouvelles voies d’accumulation, même si c’est dans un sens erroné, et de sa capacité à tirer maintenir la tête hors de la boue sanglante qui est son domaine.
– La vraie limite du capital, la seule qui puisse le renverser et transformer le monde en profondeur, pour instaurer la vraie Vie au lieu de la survie, c’est la révolution prolétarienne mondiale.
– Comme dans toute guerre impérialiste, la bourgeoisie concentre ses efforts sur le terrain idéologique, nous submergeant sous un torrent d’activités inutiles à réaliser durant le confinement, pour nous maintenir actifs et sans réfléchir (comme de bons zombies), tout en étendant avec férocité ses éléments idéologiques classiques : défense de l’économie nationale et rejet de “l’extérieur” (aujourd’hui synonyme de maladie dangereuse) et méfiance envers nos pairs. La solitude continuera à nous tuer, plus vite que n’importe quel virus.
– Il n’est pas nécessaire de nier l’existence du virus pour exiger le besoin de rejeter, dans les faits, la brutalité de la société existante. La logique militaire et guerrière du capital.
– Hier comme aujourd’hui, le mot d’ordre internationaliste et révolutionnaire du prolétariat sera d’affronter toutes les bourgeoisies et leurs États, pour reprendre l’expression, à savoir que, si nous avons le choix, nous choisissons notre autonomie de classe, parce que, et sans aucun doute, toutes les fractions de la bourgeoisie sont pires.
Notre intention est de continuer à discuter et à débattre, l’activité la plus subversive qui puisse être développée aujourd’hui est de récupérer les armes de la critique, et nous souhaitons ouvrir cette discussion à tous les camarades qui souhaitent en parler et partager leurs positions avec nous. Ce document n’est donc que le début de la mise en œuvre d’un outil de débat… (À suivre)…
Prolétaires de tous les pays, étreignons-nous !
Prolétaires de tous les pays, toussons avec force sur le bourgeois le plus proche !
Réponse du CCI
Nous saluons l’initiative de se rassembler et de discuter. C’est une expression de l’effort de prise de conscience de la classe ouvrière et en même temps une contribution à son développement.
Les camarades ont pris comme point de départ leur adhésion à la classe ouvrière et à l’internationalisme. Ils y voient un cadre de discussion où s’expriment des divergences. D’autre part, ils conçoivent leurs réflexions comme quelque chose d’ouvert, d’évolutif, et déclarent leur intention de “continuer à discuter et à débattre, l’activité la plus subversive qui puisse être développée aujourd’hui est de récupérer les armes de la critique, et nous souhaitons ouvrir cette discussion à tous les camarades qui souhaitent en parler et partager leurs positions avec nous”.
Nous pensons que c’est la méthode adéquate dans le milieu prolétarien : partir de ce qui nous unit pour ensuite aborder ce qui peut nous diviser à travers un débat sain et ouvert.
C’est la méthode que nous allons suivre dans notre réponse afin d’encourager une discussion impliquant d’autres groupes ainsi que d’autres camarades.
Face à la crise pandémique et à la crise économique qui s’annonce, les camarades rejettent le fait que le capitalisme disparaîtra de lui-même, écrasé sous le poids de ses propres contradictions. Au contraire, ils affirment que “la vraie limite du capital, la seule qui puisse le renverser et transformer le monde en profondeur, pour instaurer la vraie Vie au lieu de la survie, c’est la révolution prolétarienne mondiale”. Par conséquent, “il n’est pas nécessaire de nier l’existence du virus pour exiger le besoin de rejeter, en pratique, la brutalité de la société existante. La logique militaire et guerrière du capital”, par ce qu’ “hier comme aujourd’hui, le mot d’ordre internationaliste et révolutionnaire du prolétariat sera d’affronter toutes les bourgeoisies et leurs États, pour reprendre l’expression, à savoir que, si nous avons le choix, nous choisissons notre autonomie de classe, parce que, et sans aucun doute, toutes les fractions de la bourgeoisie sont pires”.
Nous partageons pleinement ces positions, ainsi que la dénonciation de la manière dont le capital “gère” la crise pandémique : il profite du confinement pour imposer une idéologie de guerre et d’Union nationale qui favorise l’atomisation, l’individualisme, le chacun pour soi, le tous contre tous, la peur de “l’étranger” et qui, par conséquent, stimule insidieusement la xénophobie et le racisme. “La bourgeoisie concentre ses efforts sur le terrain idéologique, nous submergeant sous un torrent d’activités inutiles à réaliser durant le confinement, pour nous maintenir actifs et sans réfléchir (comme de bons zombies), tout en étendant avec férocité ses éléments idéologiques classiques : défense de l’économie nationale et rejet de “l’extérieur” (aujourd’hui synonyme de maladie dangereuse) et méfiance envers nos pairs. La solitude continuera à nous tuer, plus vite que n’importe quel virus”.
Partageant ce précieux terrain d’entente, nous voulons à présent analyser ce que nous ne trouvons pas valable dans les positions exprimées par les camarades.
Une partie du texte développe des spéculations sur la possibilité que la pandémie ait été provoquée par le capital, de sorte qu’en éliminant massivement des vies, elle jouerait le rôle d’une guerre impérialiste : liquider la force de travail et les marchandises pour reprendre l’accumulation du capital.2 Les camarades eux-mêmes affichent de sérieux doutes quant à ces idées.
La pandémie du Covid-19, déclencheur d’une crise sociale de dimension mondiale
Cependant, les camarades doutent un peu de la gravité de la pandémie : “le nombre de morts, même si cela fait beaucoup de bruit, est loin d’être alarmant, il semble plutôt que ce que l’on veuille éviter, c’est l’effondrement des hôpitaux. La misère quotidienne à elle seule est déjà la cause de millions de décès dus à la faim, à la maladie ou à la pollution dans les pays industrialisés…” Ce n’est pas la nature strictement virale de la maladie qui la rend si mortelle, mais une série de facteurs sociaux historiques de grande importance : l’effondrement des systèmes de santé dans le monde entier ; sa propagation rapide et vertigineuse liée à la gigantesque intensification de la production mondiale au cours des dernières décennies, la désorganisation et la paralysie sociale et économique qu’elle a provoqué et aggravé ; la réponse même des États qui révèle une incompétence évidente et une incurie scandaleuse. C’est cet ensemble de facteurs, associé à la phase historique de décomposition du capitalisme,3 qui fait du virus le catalyseur d’une crise sociale de dimension mondiale. Dans toute l’histoire de l’humanité, les grandes pandémies que l’on connaît ont été associées à des moments historiques de décadence d’un mode de production en particulier. La peste noire du XIVe siècle a éclaté lors de la décadence de la féodalité. La Première Guerre mondiale, qui marque l’entrée du capitalisme dans sa phase de décadence, s’accompagne de la terrible pandémie de grippe espagnole qui fera 50 millions de morts.
Pour nous, la pandémie du Covid-19 est une expression de la décadence du capitalisme et plus précisément de sa phase finale de décomposition. Elle doit se comprendre dans le cadre d’un système dont les contradictions provoquent d’énormes catastrophes comme : deux guerres mondiales et un enchaînement sans fin de guerres localisées plus dévastatrices encore ; les grands cataclysmes économiques qui se traduisent par un chômage chronique, par une aggravation de la précarité, un effondrement des salaires et un appauvrissement généralisé ; par l’altération du climat et la destruction environnementale qui conduisent également à des catastrophes qualifiées de “naturelles” ; par la détérioration générale de la santé ; et, non des moindres, par la désagrégation du tissu social avec une morale barbare et une décomposition idéologique qui favorise toutes sortes de dérives mystiques et irrationnelles.
Il est très positif que les camarades revendiquent la nécessité de la révolution prolétarienne mondiale comme seule réponse possible à cette escalade de la barbarie. Mais quelle est la base matérielle de cette revendication ? Pour nous, c’est la décadence du capitalisme, comme l’a déjà souligné la Plateforme de l’Internationale Communiste (1919) : “Une nouvelle époque est née. Époque de désagrégation du capitalisme, de son effondrement intérieur. Époque de la révolution communiste du prolétariat”.
Cette pandémie illustre le bien-fondé d’appliquer le concept marxiste de la décadence (lorsque le mode de production devient un frein aux forces productives qu’il a lui-même développées) à la situation du capitalisme actuel : l’existence des microbes était peu connue lors de la grande peste du XIVe siècle, de même qu’en 1918-1919, les virus n’avaient pas été découverts. Mais aujourd’hui ? Le virus du Covid 19 a été séquencé en quelques semaines. Ce qui est insupportable dans les décès dus au coronavirus n’est pas leur quantité, mais le fait qu’ils auraient tous pu être évités si la science et la technologie existantes n’étaient pas soumises aux lois du profit et de la concurrence.
Crises cycliques ou crise chronique et latente ?
Les camarades développent certaines idées qui relativisent la notion de décadence du capitalisme. Ainsi, ils affirment que “Le besoin constant d’accumulation du capital détermine l’inévitable répétition de ses crises. La science historique de la classe ouvrière en est venue à établir un schéma temporel : tous les 10 à 15 ans la crise est un phénomène imparable”.
Dans le capitalisme ascendant (dont l’apogée se situe au XIXe et au début du siècle suivant), les crises avaient un caractère cyclique car elles étaient “la manifestation que le marché antérieur se trouve saturé et nécessite un nouvel élargissement. Elles sont donc périodiques (tous les 7 à 10 ans) et trouvent leur solution dans l’ouverture de nouveaux marchés. Elles éclatent brusquement. Leur durée est courte et elles ne sont pas généralisées à tous les pays. Elles débouchent sur un nouvel essor industriel. Elles ne posent pas les conditions pour une crise politique du système”.4 Dans la période ascendante, les crises cycliques étaient l’expression du développement du capitalisme, chacune d’entre elles étant un déclencheur de nouvelles expansions dans le monde entier, pour la conquête des marchés et un développement spectaculaire des forces productives.
En revanche, dans la phase de décadence (depuis la deuxième décennie du XXe siècle), les crises “se développent progressivement dans le temps. Une fois qu’elles ont débuté, elles se caractérisent par leur longue durée. Ainsi, alors que le rapport récession/prospérité était d’environ 1 à 4 au XIXe siècle (2 années de crise sur un cycle de 10 ans), le rapport entre la durée du marasme et celle de la reprise passe à 2 au XXe siècle. En effet, entre 1914 et 1980, on compte 10 années de guerre généralisée (sans compter les guerres locales permanentes), 32 années de dépression (1918-22, 1929-39, 1945-50, 1967-80), soit au total 42 années de guerre et de crise, contre seulement 24 années de reconstruction (1922-29 et 1950-67). Alors qu’au XIXe siècle, la machine économique était relancée par ses propres forces à l’issue de chaque crise, les crises du XXe siècle n’ont, du point de vue capitaliste, d’autre issue que la guerre généralisée. Râles d’un système moribond, elles posent pour le prolétariat la nécessité et la possibilité de la révolution communiste. Le XXe siècle est bien “l’ère des guerres et des révolutions” comme l’indiquait, à sa fondation l’Internationale communiste”.
Depuis 1914, l’économie capitaliste ne fonctionne plus selon le schéma de crise (prospérité dans une dynamique ascendante mais qui tend vers une crise chronique) qui, malgré l’intervention massive des États (le capitalisme d’État), s’aggrave de plus en plus.
Les guerres dans le capitalisme décadent
Les camarades dénoncent clairement la nature impérialiste de la guerre et combattent fermement les drapeaux sous lesquels les forces du capital (de l’extrême-droite à l’extrême-gauche) entendent mobiliser les prolétaires : nation, fascisme, démocratie, etc.
Ceci est absolument juste et nous partageons ce point de vue. Cependant, ils considèrent que “deux facteurs ont empêché le développement d’une guerre à grande échelle au sens classique du terme : l’humanité refuse d’être enrôlée dans de nouvelles guerres, il existe une conscience (pas encore de classe) qui refuse la logique de la guerre sous un angle pacifiste, et non pas révolutionnaire. Une tentative forcée du capital vers la guerre pourrait accélérer la prise de conscience, actuellement lente. D’autre part, la prolifération des armes nucléaires pourrait faire d’une dernière aventure guerrière, la dernière des guerres. La bourgeoisie, une classe sans scrupules qui n’a pas peur de verser le sang des autres, craint pour ses propres veines”.
Nous sommes tout à fait d’accord sur le premier facteur. Si l’humanité n’a pas sombré dans une troisième guerre mondiale dans les années 1970-80, c’est grâce à la résistance du prolétariat dans les grandes concentrations industrielles à se faire enrôler dans la guerre. Cette résistance était plutôt passive et s’élevait au niveau individuel, ce qui a sérieusement limité sa force comme disent les camarades.
Or, le deuxième facteur qu’ils invoquent ne nous semble pas correct. La guerre impérialiste a une logique infernale qui, une fois déclenchée, se mue en un vortex de destruction et de barbarie qu’il est presque impossible d’arrêter.
Dans la période ascendante du capitalisme, “la guerre a pour fonction d’assurer à chaque nation capitaliste une unité et une extension territoriale nécessaires à son développement. En ce sens, malgré les calamités qu’elle entraîne, elle est un moment de la nature progressive du capital. Les guerres sont donc, par nature, limitées à 2 ou 3 pays généralement limitrophes et sont de courte durée, provoquent peu de destructions et déterminent, tant pour les vaincus que pour les vainqueurs un nouvel essor ”.
En revanche, les guerres de la décadence “ne relèvent plus des nécessités économiques du développement des forces productives de la société mais essentiellement de causes politiques. Elles ne sont plus des moments de l’expansion du mode de production capitaliste, mais l’expression de l’impossibilité de son expansion. Désormais un bloc de pays ne peut développer mais simplement maintenir la valorisation de son capital que directement aux dépens des pays du bloc adverse, avec, comme résultat final, la dégradation de la globalité du capital mondial. Les guerres sont des guerres généralisées à l’ensemble du monde et ont pour résultat d’énormes destructions de l’ensemble de l’économie mondiale menant à la barbarie généralisée. Nullement des “cures de jouvence”, les guerres du XXe siècle ne sont rien d’autre que les convulsions d’un système moribond à l’agonie”.
Les guerres impérialistes n’offrent aucune solution aux contradictions du capital ; au contraire, elles les aggravent. Même s’il est vrai que, comme le disent les camarades, “la Seconde Guerre mondiale impérialiste et les terribles destructions qu’elle engendre […], favorisent la reprise économique des soi-disant “30 glorieuses”, les années de reconstruction et de croissance accélérée. Un ballon d’oxygène pour un capital acculé au piège de son propre développement”, cette reconstruction est due au fait que, d’une part, les États-Unis n’ont subi aucune destruction sur leur sol, de sorte qu’ils ont pu s’ériger en facteur d’accumulation à l’échelle mondiale et, d’autre part, les zones non capitalistes qui existaient encore sur la planète ont permis au capitalisme ce ballon d’oxygène.
De ce point de vue, la guerre impérialiste est un engrenage irrationnel qui échappe au contrôle des différents impérialismes nationaux qui y participent. Il est possible que chacun “regrette” la ruine qui est en train d’être générée, mais le pari de chaque capital national est d’en sortir vainqueur et de faire payer à ses rivaux (et à sa propre classe ouvrière) les conséquences de la guerre. Ainsi, la prolifération actuelle des armes nucléaires ne constitue pas le moindre frein susceptible de rendre les capitalistes “rationnels” et leur éviter d’aller “trop loin”.
Le caractère de plus en plus incontrôlable et loin de toute rationalité du système lui-même, de ses contradictions, nous permet de comprendre la pandémie actuelle. De la même manière que les guerres impérialistes (surtout celles qui se mondialisent) deviennent un mécanisme imparable, les pandémies, comme celle que nous connaissons actuellement, sont un engrenage qui, une fois mis en marche, est très difficile à contrôler.
Cette irrationalité conduit à ce que les pays les plus “avancés” se volent les uns les autres le matériel nécessaire pour faire face à la pandémie, quitte à l’aggraver à l’échelle mondiale ! Et donc pour eux-mêmes à moyen terme. Comme nous l’avons souligné dans l’article sur la “guerre des masques”, [90] face à des problèmes d’envergure mondiale, la classe exploiteuse ne peut pas se départir de son morcellement en intérêts nationaux concurrents. La dynamique centrifuge irrationnelle s’exprime également dans la pandémie actuelle par le phénomène qui, au sein des États, voit les administrations régionales se faire concurrence et se voler mutuellement du matériel médical, comme nous avons pu le constater aux États-Unis, en Allemagne et en Espagne.
Nous constatons que la pandémie est l’expression d’une crise économique mondiale naissante qui prend enfin forme et tend à prendre des proportions que de nombreux analystes considèrent comme plus graves encore qu’en 2008.
Concentrons-nous sur le plan épidémiologique, la bourgeoisie nous dit de “faire avec la période de confinement” dans l’attente du “jour d’après”. Cependant, ce “jour d’après” tarde à venir et tend à se prolonger. Par ailleurs, il existe un consensus au sein de la communauté scientifique concernant d’éventuelles nouvelles vagues d’infection aux conséquences imprévisibles. Enfin, les systèmes de santé, déjà gravement détériorés avant même la pandémie : dans quelles conditions font-ils face à cette maladie et bien d’autres ? N’oublions pas que ces dernières années, les épidémies d’Ebola, de dengue, du sida, du choléra, de zika, etc. ont proliféré.
Par conséquent, nous pensons que la question essentielle n’est pas celle de la pandémie elle-même, mais les conditions historiques dans lesquelles elle se développe comme résultat et facteur d’accélération des graves contradictions dans lesquelles le capitalisme sombre après un siècle de décadence et plus de 30 ans de décomposition sociale et idéologique.
CCI, 20 avril 2020
1 En fait, il s’agissait d’une fake news (NDLR) .Cf. https://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2020/02/06/coronavirus-la-f... [114]
2 Les idées “complotistes” ont un impact certain. Une enquête aux États-Unis montre que 33 % des sondés pensent que la pandémie a été provoquée artificiellement. Nous avons l’intention de faire un article à ce sujet.
4 “La lutte du prolétariat dans la décadence du capitalisme” [115]. Sauf mention contraire, les citations ultérieures proviendront de ce document.
Récent et en cours:
- Coronavirus [55]
- COVID-19 [56]
Covid-19: L’instinct de puissance de la bourgeoisie allemande
- 73 lectures
L’Allemagne : une fois encore l’exception, une fois encore championne du monde ?
Le monde entier est menacé par un nouveau genre de pandémie : le mastodonte chinois a au départ tenté de le dissimuler, mobilisant toute la puissance de sa machine capitaliste, dictatoriale et étatique ; puis, la pandémie a frappé le cœur historique du capitalisme : l’Italie, l’Espagne, la France et la Grande-Bretagne. La pandémie ne connaît aucune frontière et prend complètement par surprise des pays non préparés ; près de 200 000 personnes sont décédées (à l’heure où ces lignes sont écrites) (1) ; le système de soins est en train de s’effondrer dans de nombreuses régions. Actuellement, les États-Unis, puissance mondiale en déclin de l’époque révolue de la guerre froide, est ébranlée (2).
Et l’Allemagne ? Après avoir fait preuve d’un manque de préparation et d’une certaine hésitation lors de la première phase de l’épidémie, les autorités ont ensuite agi de manière plus rigoureuse et ont donné l’impression dans le monde entier qu’elles étaient plus efficaces pour combattre et gérer la pandémie et, qu’avec la Corée du Sud, elles constituaient presque une exception. La disponibilité et le taux de remplissage des lits en soins intensifs et le nombre de morts (qui venait d’atteindre 5 000 morts à l’heure où nous écrivons ces lignes) sont notamment cités comme indicateurs.
Pourquoi l’Allemagne parait-elle à peine ébranlée par une situation potentiellement catastrophique pour tous les pays ?
La capitalisation grandissante du secteur des soins et de la santé
Tout comme en Italie, en Espagne, en France ou en Grande-Bretagne, le secteur des soins et de la santé en Allemagne a délibérément été restructuré ces dernières années, partiellement privatisé, avec des coûts de revient impitoyablement maintenus à la baisse. (3) Les hôpitaux par exemple, deviennent de pures “opportunités de placement” pour des fonds spéculatifs, dont on attend le meilleur rendement possible. En fait, l’Allemagne était pionnière dans ce type de restructuration. La restructuration simultanée (et par conséquent les coupes budgétaires) dans le secteur social (Agenda 2010, plan Hartz IV) mais aussi dans d’anciennes entreprises publiques (Deutsche Post, Telekom, Deutsche Bahn, etc.) a planté les jalons pour l’Allemagne, portée par sa puissance industrielle et sa capacité d’exportation, à réaliser des bénéfices substantiels selon les normes internationales au cours des quinze dernières années, inversant la tendance à l’aggravation de la crise.
À présent, si nous examinons de plus près le secteur des soins et de la santé, nous pouvons remarquer que 37 % des hôpitaux ont d’ores et déjà été privatisés. Mais le plus important est que la gestion des hôpitaux a été très fortement soumise aux lois de l’économie capitaliste, et ce de la part de tous les organismes de financement (y compris les autorités publiques et ecclésiastiques). Cela vaut, par exemple, pour la rationalisation des méthodes de travail, l’apurement des comptes avec les compagnies d’assurance maladie et la fermeture des hôpitaux. Alors qu’en 1998 l’Allemagne comptait 2 263 hôpitaux, ceux-ci ont été réduits à 2 087 en 2007, puis à 1 942 hôpitaux en 2017. Par conséquent, le nombre de lits d’hôpitaux a été réduit d’environ 10 000 unités en dix ans, passant de 506 954 lits (2007) à 497 200 lits (2017). Malgré une intensité de travail accrue, le personnel infirmier a été réduit depuis 1993. (4)
Un schéma similaire peut également être observé au sein des maisons de repos, avec un vieillissement simultané de la population. L’exploitation du personnel soignant et infirmier a massivement augmenté. Déjà en 2016, des prévisions établissaient qu’en 2025, il manquerait entre 100 000 et 200 000 soignants qualifiés, et dans le même temps, l’attrait pour la profession d’infirmier a diminué en raison des conditions de travail insupportables. La durée moyenne pendant laquelle les personnes exercent la profession d’infirmier auprès des personnes âgées est de 8 ans seulement. Les différentes tentatives de recrutement à l’échelle internationale ne parviennent pas à inciter le personnel à aller travailler dans le pays “où coulent le lait et le miel”. Autrement dit, les gens quittent et changent de profession dès que possible, notamment à cause du travail posté et des changements d’horaires de dernière minute et, en particulier, à cause de la confrontation à des conditions de travail inhumaines, qui sont des conditions que personne ne peut supporter bien longtemps.
La réalité capitaliste dans les “usines de la santé” était déjà structurellement inhumaine bien avant la pandémie en Allemagne. Les hôpitaux sont censés rafistoler les travailleurs malades pour qu’ils reprennent du service et se débarrasser d’eux le plus rapidement possible. Le personnel sous-payé, soumis à de dures conditions de travail, a dû être recruté dans les endroits où les salaires sont les plus bas.
Comme dans tout secteur de l’économie, où une proportion toujours plus importante de machines est utilisée (une part toujours plus grande de la composition organique du capital), la proportion d’appareils médicaux a également augmenté de façon constante dans le domaine de la médecine. La technologie médicale produit des appareils médicaux de plus en plus chers et techniquement complexes, qui sont utilisés dans les usines de la santé et qui doivent générer des profits, mais qui ne peuvent être exploités que par des spécialistes hautement qualifiés. Ces nouveaux appareils et nouvelles technologies représentent une avancée considérable dans le domaine du diagnostic et du traitement, mais en raison des coûts énormes d’acquisition, de maintenance et d’exploitation qu’ils impliquent, ils accentuent la nécessité de “canaliser” davantage de patients afin de rentabiliser au maximum les équipements, de payer le personnel et, au final, faire des bénéfices.
Dans le même temps, la médecine du XXIe siècle n’a pas réussi à se débarrasser du vieux fléau de la maladie (et de la mort) dans les hôpitaux en raison du manque d’hygiène, ce dont la plupart des patients dans les hôpitaux du XIXe siècle mouraient avant l’introduction des techniques modernes d’hygiène. L’Institut Robert-Koch estime que chaque année, 600 000 infections ont lieu en milieu hospitalier à cause des bactéries qui y prospèrent, et près de 20 000 personnes en décèdent.
En fin de compte, cela signifie que sur le marché des soins et de la santé, les patients sont uniquement considérés comme des “clients” à qui l’on tente de vendre le plus de “services” possible, et les employés sont pressés comme des citrons pour que l’accumulation de valeur dans le secteur médical atteigne le niveau le plus élevé possible. Le patient fait face au soignant, pour qui il devient une marchandise, la relation sociale devient un service, le mode de travail est soumis à une énorme compression et contrainte de temps. Cette perversion décrit très bien ce que Marx a analysé comme la réification, la déshumanisation et l’exploitation. Le véritable but de cette pratique (la valeur d’usage), le soin et/ou la guérison des personnes disparaît complètement. Le fait de reléguer les personnes négligées dans les maisons de retraite, la maltraitance générale qui découle entre autres, à cause du manque de personnel, des abus flagrants qui sont longtemps restés tus, (5) la remise en cause ou le refus de certaines opérations pour les personnes âgées, sont l’expression de ce caractère inhumain, qui n’est brisé que par la solidarité prolétarienne et le sacrifice individuel de soignants face à cette déshumanisation et cette réification quotidiennes et structurelles. Même avant l’arrivée de la pandémie, les contradictions sociales d’un système pourri étaient déjà apparues de façon très brutale dans les “usines de la santé”.
Indifférence politique et manque de préparation face aux pandémies
Des historiens de la médecine et des épidémiologistes signalent depuis longtemps que le danger des pandémies mondiales s’accroît. De plus, les conditions de vie sous le capitalisme aggravent les forces négatives et destructrices de telles pandémies : la destruction des habitats naturels des animaux sauvages, leur vente et leur consommation sans véritable contrôle vétérinaire, l’industrialisation de l’agriculture et en particulier les techniques d’élevage des animaux, l’urbanisation qui prend principalement la forme de “villes taudis”, de quartiers insalubres et déshérités, de bidonvilles, etc., tout ceci renforce la tendance des virus à franchir les frontières entre les espèces. (6)
En prévision de ces pandémies, des enquêtes, des simulations et des exercices d’urgence ont été réalisés dans le monde entier, y compris en Allemagne en 2012, où un simulacre de “scénario épidémique extraordinaire” a été mis en place : “Mesures anti-épidémiques, recommandations d’action par phases, communication de crise, mesures officielles, évaluation des effets sur la protection des objets précités, suivi de l’évolution de la propagation et du nombre de nouveaux cas de la maladie, etc.” Si nous observons les réactions à la crise lors des premières semaines, et si nous additionnons tous les éléments pointant un grave manque de disponibilité d’équipements de protection, des capacités des services d’urgences, de personnels, etc, nous ne pouvons qu’y voir une réaction irresponsable de la classe politique. Les lits d’hôpitaux, le personnel, les infrastructures, les équipements ont été réduits dans de nombreux secteurs au lieu d’être installés de manière préventive. Un infirmier berlinois fait ainsi état de l’utilisation de vêtements de protection “faits maison”, (7) plusieurs hôpitaux berlinois lancent des appels communs, l’association des hôpitaux berlinois demande à des volontaires de coudre des masques, les infirmières qui se plaignent sont confrontées à la répression…
En Allemagne également, nous pouvons observer la nature destructrice du capitalisme, qui tue déjà dans des circonstances normales et qui, maintenant, face à une pandémie mondiale, se refuse à faire ce qui est scientifiquement possible. Cela suscite l’indignation parmi les travailleurs qui sont en première ligne : beaucoup rejettent les faux éloges des politiciens et les applaudissements symboliques. À Mittelbaden, les premières infirmières à avoir quitté leur emploi l’auraient fait en raison du manque de protection. À Brandebourg, des tenues protectrices ont été demandées dans une lettre ouverte au début du mois d’avril et la situation a clairement été analysée : “Nos hôpitaux sont devenus des usines et la santé est devenue une marchandise”. (8) Il peut sembler surprenant alors que le taux de mortalité en Allemagne reste bien inférieur à celui de l’Italie, de l’Espagne ou celui de la France.
La mobilisation de la bourgeoisie allemande
Plusieurs facteurs doivent être pris en compte dans l’évolution particulière de la pandémie en Allemagne. Par exemple, on peut même parler de circonstances heureuses, dans une certaine mesure, car les premiers cas ont pu être immédiatement localisés et donc rapidement isolés. En effet, la première vague a principalement touché de jeunes skieurs et des sportifs ; ensuite, la structure familiale en Allemagne est différente de celle de l’Italie et de l’Espagne, où de nombreux grands-parents vivent à proximité de leurs enfants et petits-enfants ; et enfin, malgré toutes les économies et les restructurations, le système de santé reste plus performant que dans les autres pays européens, (9) voire dans le monde entier.
Toutefois, le facteur décisif est la capacité de la bourgeoisie allemande à se mobiliser plus fortement et de manière plus cohérente que les autres pays après les premières semaines de désorientation. L’Allemagne, moteur de l’Union Européenne, a une économie qui reste stable. Sa classe politique n’est cependant pas épargnée par les tendances à la décomposition du monde capitaliste, ni par les comportements irresponsables, ce qui tend à se généraliser de plus en plus, (10) mais le populisme par exemple, et contrairement à tous les autres pays européens (et aux États-Unis aussi), n’a ici pas encore érodé l’appareil politique. Et, comme autre facteur clé de la capacité de la classe dirigeante à se mobiliser, il faut souligner le rôle particulièrement fort des syndicats en Allemagne. Bien que les difficultés dans les chaînes d’approvisionnement mondiales (en particulier les liaisons avec la Chine puis l’Italie) aient sensibilisé très tôt l’industrie automobile allemande aux effets du coronavirus, il a fallu un coup de semonce du président du comité d’entreprise, Bernd Osterloh, pour que les usines de Volkswagen ferment dès le 17 mars (soit avant la fermeture politique officielle par le gouvernement allemand !). (11) Volkswagen, grâce à ses rapports historiquement étroits avec l’État fédéral et le capital (la Volkswagen sous le régime nazi), est quasiment une entreprise de premier plan, presque un symbole de l’avant-garde du capitalisme d’État allemand.
Après la Seconde Guerre mondiale, ce rôle a été renforcé et davantage développé grâce à une implication étroite du syndicat IG-Metall (IGM). Alors que le 17 mars, les chaînes de montage tournaient encore chez BMW, Porsche, et que Daimler avait seulement prévu une pause de quelques jours (pour permettre de s’occuper des enfants), IGM, via Volkswagen, fixait le cap. Contrairement aux autres pays européens (et aux États-Unis) où le capital national, malgré les recommandations médicales, a ordonné aux ouvriers de se rendre sur les chaînes de montage, dans des conditions mettant leur vie en danger, la bourgeoisie allemande, avec l’aide des syndicats et en accord avec son appareil d’État, a fait preuve de son instinct de puissance. L’ingénieux “système de partenariat social” entre le capital et les syndicats pour contrôler la classe ouvrière, pour renforcer le capital national et le rôle mondial de l’Allemagne apparaît comme un jeu de concessions mutuelles. Les négociations collectives conflictuelles qui auraient été à l’ordre du jour dans la métallurgie et l’industrie électrique le 31 mars (avec de possibles grèves d’avertissement) ont été annulées face à la crise dans la circonscription de Rhénanie du Nord-Westphalie et un accord d’urgence sans augmentation de salaire (après des années de prospérité) a été instauré. (12) Cet accord d’urgence a immédiatement été adopté par les autres circonscriptions.
Après une courte phase d’incurie politique et un manque de planification, (13) la bourgeoisie a de nouveau démontré sa puissance économique et son instinct de pouvoir politique, bien qu’étant partiellement réduits. Cela a permis la prise de décisions politiques qui n’étaient nullement marquées par le souci de la santé des travailleurs en soi, mais plutôt par une stratégie à long terme de maintien du pouvoir et de continuité du processus de production capitaliste. Pour les capitalistes, c’est une question de calcul : soit se retrouver avec une main-d’œuvre contaminée par la pandémie et donc longtemps malade, avec une hausse des coûts reliés à la santé, soit tabler sur une réduction contrôlée de la production et la cessation des activités économiques, option “économiquement” plus rentable.
Tout d’abord, l’austère Angela Merkel a réuni autour d’elle une équipe scientifique de l’Institut Robert Koch pour élaborer une stratégie d’action, (14) qu’elle a annoncé le 18 mars dans un discours télévisé : confinement et distanciation sociale. L’Allemagne, premier exportateur mondial, a fermé la quasi-totalité de ses commerces ouverts au public (à l’exception des épiceries, des pharmacies, des drogueries, etc.). En étroite coordination avec les syndicats, l’ensemble de l’industrie automobile a été mise à l’arrêt, (15) ouvrant la voie à d’autres secteurs. Les écoles, les universités et les maternelles ont été fermées. Cette mesure choc a été accompagnée d’une intervention du bazooka monétaire de l’État capitaliste, avec en son centre le dispositif éprouvé du chômage partiel, (16) accompagné d’innombrables variantes locales et fédérales de fonds d’urgence. Le 20 mars, un budget supplémentaire de 150 milliards d’euros a été voté, auquel se sont ajouté plusieurs milliards d’euros provenant de fonds européens et nationaux. On estime qu’un total de 750 milliards d’euros sera dépensé dans le fonds d’urgence, et quotidiennement, on annonce de nouvelles subventions pour les industries en difficulté. Ce qui est aujourd’hui perçu comme une mesure directe visant à “sauver” les personnes menacées de licenciement, etc. conduira tôt ou tard aux attaques les plus violentes sous diverses formes, pour lesquelles la classe ouvrière, en particulier, devra payer. Nous reviendrons dans un article ultérieur sur les conséquences catastrophiques de cette montagne de dettes croissante.
L’armée est impliquée dans tout ceci : par exemple, un hôpital de 1 000 lits devait être construit à Berlin en un mois avec l’aide de l’armée allemande (Bundesrat) ; la Ministre de la Défense, Annegret Kramp-Karrenbauer fait état de requêtes croissantes pour une assistance administrative de l’armée, ce qui amène les réservistes mobilisés à rentrer en jeu. Cette mobilisation de l’armée ne peut en aucune façon être quantitativement comparée à celle de la France. En Allemagne, toute rhétorique de guerre était complètement absente ; néanmoins, le renforcement progressif de l’armée et sa mobilisation pour le secteur médical (17) est remarquable compte tenu du contexte de l’histoire allemande. Dans l’ensemble, les mesures devraient envoyer le signal : “nous ferons tout pour vous” et en même temps, l’Allemagne a renoncé aux couvre-feux draconiens et aux restrictions concernant les contacts comme c’est le cas par exemple en Espagne, en Italie ou en France, ralliant ainsi la population derrière son gouvernement. (18)
Ceci montre que la bourgeoisie allemande, en comparaison avec les autres principaux États du monde capitaliste, est toujours capable d’agir habilement et qu’elle n’a pas perdu son intelligence politique. C’est la seule explication au fait qu’une étude place l’Allemagne leader mondial en matière de gestion de crises (19) Cette intelligence politique de la bourgeoisie allemande repose sur sa réussite historique à repousser, bien qu’avec beaucoup de sang, l’assaut révolutionnaire de 1918-1919 en Allemagne. Les éléments contre-révolutionnaires actifs à cette époque, composés de syndicats, de la social-démocratie (majoritaire et indépendante), des corps francs et des grands capitalistes ont, cent ans plus tard, “grandi ensemble” pour former un bloc capitaliste d’État solide. Tel est le contexte historique de l’instinct de puissance prononcé de la bourgeoisie allemande.
Aujourd’hui, cela se traduit par une préoccupation apparemment plus grande pour la santé des travailleurs, qui ne repose cependant pas sur une plus grande “humanité”, mais entièrement sur le souci de la préservation de main-d’œuvre la meilleure et la plus rentable possible, et aussi sur la connaissance des conséquences dangereuses que pourrait avoir une mobilisation de la classe ouvrière en Allemagne. Nous avons déjà mentionné ailleurs que les forces centrifuges de la décomposition capitaliste, et particulièrement le populisme, n’ont pas épargné l’Allemagne et pourtant, l’appareil politique allemand reste nettement plus stable qu’en France, en Italie ou au Royaume-Uni et bien plus encore qu’aux États-Unis. On peut déjà constater que des éléments du populisme ont été partiellement absorbés et appliqués dans les mesures prises par la bourgeoisie au travers de la mobilisation de l’appareil d’État (il reste à voir si cela signifie le début d’une décomposition de l’appareil politique ou si le populisme sera ainsi plus aisément contrôlable) ; par conséquent, le parti populiste AfD est pour l’instant affaibli. La gestion de la crise montre que la bourgeoisie allemande a intégré dans son réservoir d’action un État fort, la fermeture des frontières, l’indifférence à la misère des réfugiés et l’égoïsme national et que pour le moment, l’AfD n’est qu’un gênant fauteur de troubles.
Compte tenu du caractère mondial de la pandémie et de la préparation tout à fait insuffisante à l’échelle mondiale, même la classe dirigeante en Allemagne n’a pas pu échapper à la pression du chacun pour soi. Dans la quête désespérée de masques, la réglementation du gouvernement allemand selon laquelle les équipements médicaux ne pouvaient être exportés que si les besoins vitaux de l’Allemagne étaient comblés a également été appliquée en Allemagne. Cette règle s’applique, même si le manque de protections dans d’autres pays met en danger des vies humaines. La défense des intérêts de la nation passe avant tout. Et dans sa tentative de ne pas laisser l’UE s’effondrer, et d’agir de façon aussi coordonnée que possible au niveau national dans ce chaos toujours croissant, le capital allemand a ouvert presque indéfiniment le robinet du crédit pour l’économie nationale. Parallèlement, la bourgeoisie allemande est restée largement intransigeante à l’égard de ses “partenaires” chancelants en Italie, en Espagne et de la demande de mise en place de corona bonds. Les conséquences que cela aura pour l’UE ne peuvent être prévues pour le moment.
De même, il est impossible de savoir aujourd’hui si cela sera en mesure de repousser l’impérialisme chinois, de plus en plus agressif, en Europe et partout ailleurs. La montagne de coûts engendrés par les mesures de sauvetage économique (20) décidées par les puissances mondiales conduira à une augmentation de la dette, (21) où la tendance au chacun pour soi deviendra de plus en plus dévastatrice. Au milieu de ce chaos, la bourgeoisie allemande a peut-être mieux réussi que ses rivaux jusqu’à présent, mais étant l’un des pays les plus dépendants des exportations et de la stabilité internationale, elle ne peut, malgré certains atouts, échapper aux chocs de la crise et au chaos qu’elle provoquera à long terme. Les défis que cela implique pour la classe ouvrière seront abordés dans un prochain article.
Gerald, 23 avril 2020
1 L’article a d’abord été publié par la section en Allemagne du CCI. Au moment où nous publions cette traduction, le chiffre est passé à plus de 300 000 !
2 Il n’est pas encore possible de prédire si le taux d’infection qui continue d’augmenter de manière exponentielle dans l’ancien bloc rival russe atteindra un niveau aussi dévastateur.
3 Ceci illustre très bien le concept de la “capitalisation”, qui se réfère à la logique économique de valorisation et d’accumulation du capital avec l’obligation de le faire fructifier (accumulation de capital) dans le but ultime de faire du profit.
4 “Lors de la conférence Usine ou Hôpital ? à Stuttgart, le 20 octobre 2018, il est fait état d’une diminution du chiffre réel de 1993 à 2016 de 289 000 à 277 000, soit 12 000 personnels soignants, malgré une augmentation du nombre de cas, une réduction de la durée de séjour et donc une augmentation de l’intensité de travail. Dans la fourchette cible calculée selon le règlement du personnel infirmier (PPR), en supposant une augmentation de 20 % des besoins en personnel en raison d’une augmentation des performances, il y a tout de même une différence de 143 000 infirmiers”. (Syndicat Verdi, avril 2018)
5 Au début des années 2000, une infirmière a tué dans le nord de l’Allemagne plus de cent patients sans que personne ne s’en aperçoive.
6 Voir également le livre en anglais de Mike Davis sur ce sujet, The Monster at Our Door : The Global Threat of Avian Flu (2005).
7 “Ils ont en fait acheté du film plastique au magasin de bricolage et en ont fait une sorte de bouclier qui s’étend sur les yeux et la bouche. Donc à présent, nous, les infirmières, nous devons nous procurer notre propre équipement parce que l’État n’avait pas de plan d’urgence viable en cas de pandémie !”
8 Le 7 avril, des docteurs, infirmiers ainsi que d’autres employés de plus de vingt hôpitaux à Brandebourg ont écrit dans une lettre ouverte au gouvernement fédéral en faisant la demande suivante : “Le Land de Brandebourg doit trouver un moyen de produire des masques, des blouses, des lunettes de protection et du désinfectant – tout de suite !”
9 “En janvier, il y avait en Allemagne environ 28 000 lits en soins intensifs, soit 34 pour 100 000 personnes. Par comparaison, en Italie il y en a douze et aux Pays-Bas, sept pour 100 000”.
10 “La montée du populisme constitue une expression, dans les circonstances actuelles, de la perte de contrôle croissante par la bourgeoisie des rouages de la société résultant fondamentalement de ce qui se trouve au cœur de la décomposition de celle-ci, l’incapacité des deux classes fondamentales de la société d’apporter une réponse à la crise insoluble dans laquelle s’enfonce l’économie capitaliste. En d’autres termes, la décomposition résulte fondamentalement d’une impuissance de la part de la classe régnante, d’une impuissance qui trouve sa source dans son incapacité à surmonter cette crise de son mode de production et qui tend de plus en plus à affecter son appareil politique”. (“Résolution sur la situation internationale : Conflits impérialistes, vie de la bourgeoisie, crise économique”, Revue Internationale n° 164)
11 “La décision a donc été précédée tôt mardi matin d’un débat houleux entre le conseil d’administration et les représentants des travailleurs de Wolfsburg, traditionnellement très influents, autour du président du comité d’entreprise, Bernd Osterloh. Le fait que la décision ait été prise au pied levé est également illustré par le fait qu’on ne sait pas encore très bien comment Volkswagen entend mettre en œuvre la fermeture en termes de droit du travail.”
12 “Dans l’industrie métallurgique et électrique, les partenaires de négociation ont conclu un accord pilote en Rhénanie-du-Nord-Westphalie. Sous l’effet de la crise du coronavirus, IG Metall et les employeurs ont convenu de ne pas augmenter les salaires cette année”.
13 Le DAX a plongé de près de 14 000 points (mi-février) pour passer sous les 9 000 points. Le Land de Bavière parle d’une catastrophe dès le 16 mars.
14 Nous devons reprendre ailleurs cette tendance à la dictature “sans alternative” des experts, mais elle était déjà apparue avec le mouvement pour le climat, et la même idée avait été avancée par les experts (économiques) en réponse à la crise grecque de l’UE. Malgré l’intelligence politique de la majorité de la classe dirigeante, cela ne cache pas une certaine “lâcheté” politique de leur part, car c’est aussi une façon de cacher le caractère de classe des attaques derrière une science apparemment “neutre”, exempte d’idéologie.
15 Avec plus de 800 000 employés, l’industrie automobile représente une large part de l’industrie allemande.
16 Le 22 avril, il a même été décidé d’augmenter les indemnités de temps partiel de 60 à 80 % ou 67 à 87 %.
17 Le fait que de nouveaux avions de chasse aient été commandés ces jours-ci pour remplacer les avions Tornado “obsolètes” et qu’ils ne reculent pas devant les dépenses élevées n’est pas contradictoire mais va de pair.
18 Dans les sondages, c’est Merkel qui obtient la plus forte cote de satisfaction au cours de cette législature et la CDU a enregistré une forte progression, de sorte que des rumeurs sur un cinquième mandat se répandent déjà.
19 “Par rapport aux autres pays, l’Allemagne occupe actuellement la première place en Europe en matière de sécurité et de stabilité et est également l’une des meilleures nations au monde en termes de gestion des crises”, a déclaré Dimitry Kaminsky, fondateur de la DKG (Deep Knowledge Group). En outre, l’Allemagne a agi “avec une extrême efficacité”.
20 Le CCI étudiera la question dans d’autres analyses. Nous invitons nos lecteurs à suivre notre presse internationale et à participer au débat sur l’évaluation de la situation, ses perspectives et nos tâches.
21 Nous invitons tous les lecteurs à examiner plus en profondeur la résolution sur la situation internationale adoptée par le 23e Congrès international : “Non seulement les causes de la crise de 2007-2011 n’ont pas été résolues ou dépassées, mais la gravité et les contradictions de la crise sont passées à un stade supérieur : ce sont désormais les États eux-mêmes qui sont confrontés au poids écrasant de leur endettement (la “dette souveraine”) qui affecte encore plus leur capacité à intervenir pour relancer leurs économies nationales respectives. “L’endettement a constitué un moyen de suppléer à l’insuffisance des marchés solvables, mais celui-ci ne peut s’accroître indéfiniment, ce qu’a mis en évidence la crise financière à partir de 2007. Cependant, toutes les mesures qui peuvent être prises pour limiter l’endettement placent à nouveau le capitalisme devant sa crise de surproduction, et cela dans un contexte économique international qui limite de plus en plus sa marge de manœuvre.” (“Résolution sur la situation internationale : Conflits impérialistes, vie de la bourgeoisie, crise économique”, Revue Internationale n° 164).
Récent et en cours:
- Coronavirus [55]
- COVID-19 [56]
Rubrique:
ICCOnline - juin 2020
- 57 lectures
150 ans de Lénine: naissance d’un tyran ou d’un combattant pour l’émancipation de l’humanité?
- 172 lectures
Il y a 150 ans, le 22 avril 1870, naissait Vladimir Ilitch Oulianov, dit Lénine, qui allait jouer un rôle central dans le mouvement révolutionnaire prolétarien du début du XXe siècle.
Alors que la bourgeoisie a fait de lui le “père du totalitarisme”, les révolutionnaires d’aujourd’hui se doivent de mettre en évidence que toute sa vie fut consacrée à la lutte pour l’émancipation de la classe ouvrière et non à l’établissement sur celle-ci d’une des formes les plus barbares d’exploitation et d’oppression capitaliste comme l’a été le stalinisme. L’article ci-dessous, déjà paru dans notre presse, retrace la trajectoire de ce grand combattant de la classe ouvrière que fut Lénine.
– “Lénine : un combattant du prolétariat ; Staline : un agent du capitalisme [116]”, brochure Effondrement du Stalinisme.
Conscience et organisation:
Rubrique:
La Libye, foyer de la barbarie capitaliste
- 92 lectures
La Libye est régulièrement sous le feu des médias depuis 2011, l’année de la liquidation par les puissances impérialistes de l’OTAN (France, Royaume-Uniet États-Unis) de Mouammar Kadhafi qui dirigea le pays d’une main de fer pendant quarante ans.
“Cette malheureuse Libye, que la guerre franco-britannique de 2011 a transformé en paradis pour les terroristes de Daech et d’Al-Qaïda, hérite donc aujourd’hui d’une guerre civile. Les trafiquants d’armes, de drogue ou de migrants y prolifèrent et entrent rarement en conflit avec les djihadistes. Normal, ils sont souvent cousins en affaires…”. (1))
Après le passage du “printemps arabe” en Libye qui vit une partie de la population se soulever contre le régime sanguinaire et corrompu de Kadhafi, les puissances occidentales (au nom de “la protection de la population civile” que l’ex-dictateur réprimait brutalement) déclaraient la guerre au dirigeant libyen. Après avoir écrasé la population sous les bombes et liquidé Kadhafi, elles laissaient le pays entre les mains de multiples groupes sanguinaires qui se disputent toujours le contrôle du moribond État libyen.
Aujourd’hui, parmi la dizaine de groupes et de milices qui écument le pays, les deux plus importantes factions en présence prétendent au statut d’interlocuteurs privilégiés auprès des grandes puissances et de l’ONU : il s’agit du “Gouvernement d’accord national” (GAN) siégeant à Tripoli et dirigé par Faïse Sarraj, et “l’Armée nationale libyenne” (ANL) dirigée par Khalifa Haftar qui gouverne la région cyrénaïque. Chacun de ces deux “petits” gangsters bénéficie d’un nombre de soutiens, de parrains impérialistes plus ou moins affichés.
“Au cœur de ce chaos de tribus et de cités États qu’est devenue la Libye, le Kremlin siège dans le même camp que les Émirats, l’Arabie Saoudite, l’Égypte et… la France, alors que l’Italie, le Qatar et surtout la Turquie portent à bout de bras le gouvernement de Fayez al-Sarraj. Un soutien multiforme puisque la Russie est allée jusqu’à imprimer des conteneurs entiers de dinars libyens pour le compte de son protégé, dont le rival contrôle la Banque centrale, en échange de cargaisons de pétrole. Dans cette guerre sans issue, où les drones de combats chinois et turcs à 2 millions de dollars pièce tirent sur des miliciens en tee-shirt, jeans et baskets, le Kremlin joue un jeu qui est tout sauf stabilisateur. Mais qui en dehors d’une Union africaine presque totalement marginalisée sur ce dossier, veut réellement voir la Libye renaître de ses cendres ?” (2)
Sur le papier, deux groupes s’affrontent formellement sur le sol libyen. Mais en réalité, le chacun pour soi domine.
Ce spectacle barbare dévoile l’attitude hypocrite et abjecte des grandes puissances en Libye qui jouent toutes un double jeu : “La résurgence du conflit en Libye a révélé de nombreuses manœuvres d’ingérence que certaines puissances, régionales ou mondiales, auraient préféré garder dans l’ombre”. (3) À l’instar du gouvernement français pris en flagrant délit de mensonge quand il a tenté de nier l’existence des missiles fournis par ses services secrets au maréchal Haftar tout en affirmant que “la France est en Libye pour combattre le terrorisme”.
Quant aux deux chefs de guerre libyens, leurs objectifs sont aussi crapuleux : “Ainsi dressés l’un face à l’autre, les deux camps n’oseront jamais avouer le véritable mobile de leur affrontement. Le recours emphatique à une rhétorique justificatrice à usage externe (‘révolution’ ou ‘antiterrorisme’) camoufle mal le caractère brut d’une rivalité autour de l’appropriation des ressources, laquelle prend un sens très particulier dans cet ancien eldorado pétrolier qu’est la Libye. En dépit des perturbations causées par le chaos post-2011, le pétrole libyen continue de générer 70 millions de dollars (62,5 millions d’euros) de revenus par jour. Aussi la maîtrise des circuits de distribution de cette rente pétrolière aiguise-t-elle bien des appétits”. (4)
Voilà un autre aspect du conflit dont personne ne parle dans les discours officiels des dirigeants du monde capitaliste ! Cette course au “butin” pétrolier, ouverte par le chaos engendré après 2011, oppose un grand nombre de petits et grands gangsters locaux et internationaux sur le sol libyen.
Les impérialismes turc et russe se disputent violemment le contrôle de la Libye “en amis”
Non contents des atrocités perpétrées en Syrie, la Russie et la Turquie débarquent en Libye avec armes et bagages dans le but affiché de déloger les puissances rivales mafieuses en présence :
“Alors que les combats ravagent la périphérie de Tripoli depuis 2019, la Russie et la Turquie sont ces nouveaux acteurs se rêvant parrains d’une future solution politique en Libye. Édifiante, une scène a illustré ce grand retournement géopolitique en Méditerranée orientale : celles de retrouvailles, le 8 janvier, à Istanbul, entre le président turc, Recep Tayyip Erdogan, et le chef du Kremlin, Vladimir Poutine. Ce jour-là les deux hommes ont ostensiblement affiché leur complicité au moment d’annoncer le lancement de TurkS-tream, un gazoduc reliant la Russie à la Turquie via la mer noire. Plus important, ils ont lancé un appel conjoint à un cessez-le feu en Libye ‘à compter 12 janvier’ et, signe de leur influence croisant sur un terrain où ils étaient jusque-là discrets, la trêve a été relativement respectée par leurs affidés locaux. Dans la bataille en cours autour de Tripoli, Moscou soutient le Maréchal dissident Khalifa Haftar, patron de l’Armée nationale libyenne (ANL), surtout enracinée en Cyrénaïque (Est). De son côté, Ankara appuie le gouvernement d’accord national (GAN) de Faïz Sarraj, basé à Tripoli et formellement reconnu par la communauté internationale.
Neuf mois après l’assaut déclenché par Haftar contre la capitale libyenne, Russes et Turcs ont ainsi démontré qu’ils étaient maîtres du tempo sur ce front, capables d’alterner à leur guise escalades et accalmies”. (5)
Comme le souligne la presse, dans la nouvelle situation libyenne, l’Europe et les États-Unis ne sont plus que des figurants tandis que l’OTAN est totalement paralysée par ses propres divisions. Les dirigeants russe et turc peuvent ainsi occuper le terrain librement et s’affronter militairement (certes par affidés interposés) comme pour exporter en Libye les atrocités sanglantes qu’ils ont déjà perpétrés en Syrie. Certes ces deux pays sont des puissances émergentes aux capacités limitées. (6)
Mais les deux États sont bien décidés à avaler le “gâteau libyen”. Ils ont ainsi pu dépêcher leurs mercenaires respectifs (2 000 “Wagner” russes et 3 000 combattants syriens, des brigades à la solde d’Erdogan) en vue de fermement soutenir leurs champions locaux du moment. Chacun de ces monstres tente, d’ailleurs, de “légitimer” son intervention, comme lorsque Erdogan ose affirmer : “Nous sommes sur ces terres où nos ancêtres ont marqué l’histoire, parce que nous y avions été invités pour résoudre l’injustice”. Mais la véritable motivation du dirigeant turc en Libye se trouve dans les perspectives de contrats “alléchants” : Erdogan espère, par exemple, faire valoir les 25 milliards de dollars de contrats signés sous le régime de Kadhafi et se sont envolés en 2011. La Turquie affiche ses ambitions impérialistes non seulement envers ses voisins proches (Syrie, Liban, Israël, Grèce) mais elle essaie aussi de s’implanter en Afrique et dans le Golfe Persique. De fait, la Libye constitue un “gros gibier” pour les ambitions impérialistes turques.
Cependant, Erdogan allume des feux et sème le trouble partout où il peut en sachant que la Turquie n’a pas les moyens de sa politique aventureuse ni au plan militaire (l’OTAN ne veut pas le suivre dans sa confrontation avec la Russie) ni sur le plan financier. (7)
Quant à la Russie il faut se rappeler que l’URSS fut le premier État à reconnaître le régime du colonel Kadhafi après le coup d’État militaire de ce dernier en 1969. Elle resta son principal fournisseur d’armes jusqu’à l’assassinat du “dictateur libyen” en 2011. Poutine a, d’ailleurs, fortement insisté sur le fait que Moscou a effacé, en novembre 2019, 4,6 milliards de dollars de la dette libyenne remontant à l’époque soviétique (en matériels militaires) et qu’il entend récupérer son “bien” les armes à la main, c’est-à-dire avec ses discrets mercenaires Selon Le Monde du 26 janvier 2020 : “En 2017 le maréchal Haftar a commencé un appui russe, principalement l’envoi de mercenaires liés au ‘groupe Wagner’ créé au début du conflit ukrainien, en 2014, et qui, depuis, a opéré en Syrie, au Soudan, en Centrafrique ou encore au Mozambique […]. Cette connexion avec Wagner présente l’avantage de pouvoir être nié. ‘S’il y a des citoyens russes là-bas, ils ne représentent pas les intérêts de l’État russe et ne reçoivent pas d’argent de l’État russe’, assurait ainsi Vladimir Poutine, le 11 janvier”.
Poutine est d’un cynisme hors norme, s’exprimant comme un ex-membre du sinistre KGB surdoué en matière de mensonge et de falsification de l’histoire.
La Libye va donc demeurer longtemps encore un grand champ de bataille des vautours capitalistes, petits ou grands, pour qui tous les moyens sont bons pour défendre leurs sordides intérêts quitte à foncer à peine masqué dans l’accomplissement de leurs crimes.
“Libye : petits meurtres entre amis”
“C’est un rapport de quatorze pages cosigné par un Ghasan Salamé [...]. Publié à la fin de janvier par la mission des Nations unies en Libye, cette autopsie d’un meurtre de masse commis il y a 6 mois à une vingtaine de kilomètres à l’ouest de Tripoli est de celle que l’on glisse aisément sous le tapis pour une raison simple : les victimes sont africaines, et le coupable a des relations si haut placées que l’enquête se contente de suggérer son identité, sans jamais la dévoiler. Nous sommes à Tadjourah, donc, bourgade de 50 000 habitants non loin de la frontière tunisienne, plus précisément au camp de détention de Daman. Gardé par une brigade de miliciens relevant du ministère de l’intérieur du Gouvernement de l’union nationale, de Fayez al-Sarraj, Daman est l’un des 34 centres d’enfermement du Nord-Ouest libyen où s’entassent quelque 10 000 migrants et réfugiés dont nul ne sait quoi faire. Le camp abrite un atelier de réparation de véhicules militaires et, distants d’une centaine de mètres, deux hangars aux toits de tôle où logent les détenus, femmes et hommes séparés. Ils sont 600 environ, africains dans leur grande majorité ; dont le rêve d’Europe s’est mué en un cauchemar quotidien fait de privations, d’humiliations et d’exactions.
La chaleur est étouffante en cette nuit du 2 au 3 juillet 2019, quand les habitants du camp entendent le bombardement d’un drone qui les survole à basse altitude. Les gardiens sont nerveux, les détenus inquiets. En mai, pareille apparition avait précédé le bref mitraillage de Daman par un petit appareil ennemi de l’armée nationale libyenne de Khalifa Haftar, le maréchal de Benghazi. On en avait été quitte pour quelques blessés et une belle frayeur. Mais à 23h30 cette nuit-là, c’est le hurlement du réacteur d’un chasseur bombardier qui précipite tout le monde au sol. Téléguidée avec précision, une bombe pulvérise l’atelier de réparation, vide d’occupants. Ce qui se passe alors, au cours des dix minutes qui suivent, est tragique. Paniqués, les migrants cherchent à fuir les hangars pour se mettre à l’abri hors du camp. Dirigés par un commandant surexcité, les miliciens de la brigade tirent en l’air à la kalachnikov pour les en empêcher. Puis dans le tas. Trois détenus s’effondrent, les autres refluent en désordre dans les entrepôts, où on les enferme. À 23h40, un second avion identique au premier lâche sur le hangar bondé des hommes une bombe de 300 kg qui transperce le toit et explose au sol, creusant un cratère de quatre mètres de large et profond de trois. C’est une boucherie. Les gardiens de Daman dénombrent à la va-vite au moins 57 corps déchiquetés, 96 disparus dont on ignore s’ils sont morts ou en fuite et 80 blessés graves. Tous anonymes. [...]
Dès le lendemain du carnage, le porte-parole de Khalifa Aftar revendique non sans forfanterie un raid des ‘forces aériennes de l’Armé nationale libyenne’ contre le camp de Daman, qualifié de ‘cible militaire’ dont les défenseurs utilisaient les migrants comme boucliers humains. L’annonce fait sourire les observateurs : chacun sait que la petite armée de l’air du maréchal ne possède ni les appareils ni les pilotes capables d’effectuer des pilonnages nocturnes avec des bombes à guidage laser/GPS. En revanche, relève avec une prudence toute diplomatique le rapport de l’ONU, ‘un État étranger’ parrain et allié du maréchal a positionné sur les bases de Jufra et d’Al-Khadim ‘un certain nombre d’avions’ tout à fait en mesure d’effectuer ce genre d’opération. Aux yeux des spécialistes, ces précautions sémantiques cachent un secret de polichinelle : l’État, ce sont les Emirats arabes unis du prince héritier Mohammed Ben Zayad (MBZ), et les avions, des Mirage 2000-9 vendus à Abou Dhabi par la France”. (8)
Autrement dit, c’est bien l’impérialisme français qui se cache derrière les auteurs de cet horrible massacre des migrants directement perpétré par les Émirats arabes unis , gros clients et alliés de Paris dans cette zone. La responsabilité criminelle de la France est tellement évidente que la presse bourgeoise parle ouvertement de crime de guerre impliquant le gouvernement français du fait qu’Abou Dhabi et Dassault Aviation ont signé un contrat de modernisation de la flotte des Mirage 2000-9 en novembre dernier, ce qui expose Paris à l’accusation de “complicité de crime de guerre, en vertu du traité sur le commerce des armes dont la France est signataire”. L’ONU n’est également pas étrangère à cet abominable carnage. Son rapport montre qu’elle connaît parfaitement l’identité des véritables assaillants des camps de réfugiés tout en se gardant bien de la dévoiler.
“Aux côtés des Émirats arabes unis, de l’Égypte et de l’Arabie Saoudite (les véritables alliés de l’ANL), la Russie a aujourd’hui pris la place de la France dans la liste des principaux protecteurs de Haftar, notamment au Conseil de sécurité de l’ONU. Mais en attendant la prise de Tripoli, l’appui français est toujours recherché par le clan de Benghazi”. (9) De fait, l’impérialisme français se trouve, en “bonne compagnie”, au cœur du sanglant chaos libyen. Mais sa responsabilité criminelle de la France ne s’arrête pas là : elle partage avec ses homologues européens la responsabilité de l’existence de monstrueux “camps d’accueil” pour migrants refoulés ou en escale en Libye dans l’attente d’un embarquement mortifère vers l’Europe.
La politique crapuleuse de l’Union européenne en Libye
En plus du chaos sanglant provoqué par les grandes puissances impérialistes, la Libye est devenue un véritable “marché” et un cimetière pour réfugiés dont l’Union européenne est directement responsable.
Le 14 novembre 2017, des images de marchés aux esclaves en Libye étaient diffusées par CNN où l’on pouvait voir des êtres humains vendus aux enchères comme du bétail. Il s’agit de migrants, dont le nombre varie entre 700 000 et 1 million, tombés dans le piège des réseaux et des trafiquants criminels avec la complicité active des États (européens et africains) : Selon un rapport publié par l’Unicef, “Les centres de détention dirigés par les milices ne sont rien d’autre que des camps de travail forcé, des prisons où l’on se fait tout voler sous la menace d’une arme. Pour des milliers de femmes et d’enfants, la vie dans ces prisons est faite de viols, de violences, d’exploitation sexuelle, de faim et d’abus répétés”.Tout cela illustre l’ampleur de la barbarie impliquant directement les puissances impérialistes qui par leur politique jettent les migrants dans les bras d’esclavagistes d’un autre âge.
L’Union européenne exige une “politique active” envers des États défaillants et terriblement corrompus (Niger, Nigéria, Libye, etc.) en les subventionnant pour construire des murs et des camps de mort. L’Union européenne encourage ainsi des pratiques mafieuses, des marchandages entre bandits en fournissant notamment les fonds et le matériel nécessaires aux gardes-côtes libyens qui se chargent d’intercepter les bateaux de migrants et de conduire ces derniers dans des “centres de rétention”. C’est une politique abominable et terriblement inhumaine que mènent les grandes démocraties européennes !
Le marché aux esclaves côtoie le marché aux soldats
“Ils sont Tchadiens ou Soudanais et s’achètent pour une bouchée de pain au ‘grand bazar des mercenaires au rabais’ […]. La marchandise humaine vient ainsi s’exposer de bonne heure sur les trottoirs défoncés (des dizaines d’Africains qui attendent en chaussons, les pieds aussi poussiéreux que leur vie, leur avenir aussi noir que leur peau), et ceux qui défilent en pick-up s’arrêtent quelques minutes, examinent les ouvriers en solde, passent commande : Aujourd’hui il faut quelqu’un pour pousser la brouette, un autre capable de crépir un immeuble à la chaux, et un pour décharger les camions. À moins qu’ils ne recherchent quelqu’un pour faire la guerre : prendre les armes dans les milices s’il est bon ; rester à l’arrière s’il ne sait rien faire d’autre. Certains acceptent, car au moins, à 300 euros par moi, nourris, logés, le boulot rapporte. D’autres déclinent l’offre, refusant de payer de leur vie”. (10)
En Libye les migrants sont plus que jamais dans la même situation de misère, de détresse, au milieu des périls qui les conduisent par milliers à la mort en tentant de traverser la Méditerranée, comme le montre ce récit :“Sur la plage d’Aghir de l’île de Djerba, dans le nord de la Tunisie, il y a plus de cadavres que de baigneurs, en ce début de mois. Lundi 1er juillet, un canot a coulé au large. Une embarcation partie à l’aube de la ville libyenne de Zouara, à 120 kilomètres à l’ouest de Tripoli, avec 86 personnes à bord. Trois ont été repêchés vivants. La mer rend les autres, une à une.‘Moi, j’en peux plus. Là, c’est trop.’ Chemsedddine Marzog, le pêcheur qui, depuis des années, offre une dernière demeure aux corps que la mer rejette, dit son ras-le-bol. ‘J’ai enterré près de 400 cadavres et, là, des dizaines vont encore arriver dans les jours qui viennent. Ce n’est pas possible, c’est inhumain et nous ne pouvons pas gérer ça tout seuls’, se désespère le gardien du cimetière des migrants de Zarzis, ville située au sud-est de la Tunisie, près de la frontière avec la Libye”. (11)
Pendant ce temps les “démocraties occidentales” ferment les yeux et se bouchent le nez sur cette cruelle barbarie et poursuivent leur lutte pour la “sécurisation” (fermeture) de leurs frontières contre les “illégaux” tout en chantant sur tous les toits leur “humanisme universaliste”.
Mais il n’y a pas que les pays de l’UE qui mènent une politique barbare envers les migrants, il y a aussi leur “grand ami/client” saoudien. En effet Ryad matraque, emprisonne, expulse les “indésirables” migrants se trouvant sur son territoire. “10 000 Éthiopiens sont expulsés chaque moi d’Arabie Saoudite depuis 2017, date à laquelle les autorités de ce pays ont intensifié leur campagne sans merci pour renvoyer les migrants sans papiers. Environ 300 000 personnes sont rentrées depuis mars de cette année-là, selon les derniers chiffres de l’Organisation internationale pour les migrants (OIM), et des vols spéciaux chargés de déportés arrivent chaque semaine à l’aéroport d’Addis-Abéba. […] Des centaines de milliers d’Ethiopiens ont été déportés lors d’une précédente vague de répression chaotique menée entre 2013 et 2014”. (12)
Voilà l’œuvre d’un froid criminel, grand acheteur et fournisseur des pays européens et de la France en particulier, qui se trouve dans le même camp que Paris en Libye pour semer la terreur. À dire vrai on a affaire ici à une bande de “grands” et de “petits princes” du Golfe, nouveaux richissimes capitalistes (grâce à l’or noir), assoiffés de pouvoir et de sang, en quête permanente d’influence impérialiste. C’est ainsi qu’on les voit à l’œuvre en première ligne en Libye, en Syrie, au Yémen, etc., dans les zones de massacres de masse. Les États sanguinaires
Compte tenu de l’importance du “gâteau libyen” aucun des bandits capitalistes ne voudra laisser sa “part” à d‘autres. De ce fait la situation en Libye ressemble terriblement à celle de la Syrie avec son lot de tueries et destructions permanentes sans reconstruction possible.
Contre le chaos sanglant et la barbarie capitaliste en Libye et ailleurs, seule la lutte de classe internationale et unitaire portée par la fraction de la classe ouvrière la plus expérimentée peut tordre le bras meurtrier du capitalisme mondial.
D. 22 mars
1 �Le Canard enchaîné (24 avril 2019).
2 �Jeune Afrique (17-23 novembre 2019).
3 �Courrier international (14-21 août 2019).
4 �Le Monde (3 mai 2019).
5 �Le Monde (26 janvier 2020).
6 �Le PIB de la Russie est à peine égal à celui du Texas et les ressources de la Turquie sont encore plus limitées.
7 �D’où son chantage avec l’Union européenne sur la question des réfugiés et plus particulièrement vis-à-vis du gouvernement grec en première ligne.
8 �Jeune Afrique (9-15 février 2020).
9 �Jeune Afrique (15-21 mars 2020).
10 �CI (6-12 février 2020).
11 �Le Monde, (10 juillet 2019).
12 �The Guardian (août 2019)
Géographique:
- Libye [120]
Rubrique:
Grande-Bretagne : Solidarité avec les travailleurs de la santé contre leur employeur, le NHS capitaliste
- 42 lectures
De nombreux articles et programmes détaillent l’insuffisante préparation du National Health Service (NHS) face à la pandémie actuelle. Panorama (un documentaire de la BBC) nous dit que le stock d’équipement de protection personnelle (PPE) ne contenait pas de blouses, le Kings Fund (un groupe de réflexion sur le système de santé britannique) a mis en évidence le nombre peu élevé au Royaume-Uni de docteurs, infirmières, hôpitaux et lits en soins intensifs comparé aux autres pays développés, The Economist a révélé comment en avril les tests pour le coronavirus destinés au Royaume-Uni sont restés quelque part entre les États-Unis et l’Equateur.
Au même moment, nous sommes invités non seulement à applaudir le NHS une fois par semaine mais aussi à nous identifier à cette institution présentée comme un modèle pour tous les autres services de santé. Mais le NHS n’est rien d’autre qu’une institution de l’Etat capitaliste qui envoie ses employés s’occuper de patients infectés sans l’équipement de protection personnelle nécessaire et déporte les patients âgés des hôpitaux vers des maisons de retraite sans pratiquer de tests durant cette crise. Le véritable NHS, c’est celui qui, pendant des années nous a habitués a de longues attentes aux urgences et à d’interminables listes d’attente pour des opérations.
La pandémie de coronavirus a mis en évidence les faiblesses et les défaillances de tous les services de santé sous le système capitaliste. Malgré de véritables différences dans leurs ressources, ou manque de ressources, le degré d’organisation par l’Etat et le niveau de participation des entreprises privées, ils sont tous basés sur deux aspects essentiels du capitalisme : l’Etat-nation et le besoin d’extraire autant de bénéfices possible de ceux qui travaillent dans ce secteur tout en les rémunérant au salaire minimum avec lequel ils peuvent à peine s’en sortir.
« Protéger le NHS »… des patients !
A la mi-mars, les hôpitaux furent sommés d’évacuer 15 000 patients, âgés pour la plupart, soit en les renvoyant chez eux, soit en les parquant dans des maisons pour personnes âgées afin de libérer des lits pour ceux atteints du Covid-19. Le NHS a fait face à la situation aux dépens de ces patients ainsi que des résidents des maisons de retraite et de leur personnel soignant qui ont contracté le virus au contact de ceux qui parmi ces patients étaient infectés. Plusieurs milliers en sont morts [1]. Ce n’est pourtant pas comme si le monde n’avait pas été prévenu de la nécessité de se préparer à une pandémie ; l’OMS, les virologues et les épidémiologistes alertent à ce sujet depuis des décennies. Ce n’est pas comme si le gouvernement britannique n’avait pas été averti du niveau d’impréparation à une pandémie durant l’Exercice Cygnus en 2016 qui montrait que le NHS serait incapable d’y faire face. Les résultats n’ont jamais été publié car jugés trop effrayants. [2]
Tout au long de l’histoire du NHS, il y a eu une pression constante sur les ressources disponibles. En 1949, le NHS disposait de 10,2 lits pour 1000 habitants, essentiellement pris sur les hôpitaux bénévoles ou dispensaires ; en 1976, cette proportion était tombée à 8,3 pour 1000 [3]. A cette époque, l’usage des antibiotiques s’était largement répandus pour combler la différence et les vieux services contre les maladies coloniales tropicales ou la tuberculose (sanatoriums) pouvaient être largement supprimés. Cependant, le nombre de lits a continué de baisser jusqu’à atteindre seulement 2,5 pour 1000 en 2017, les lits pour hospitalisation de courte durée et pour les services de médecine générale ayant chuté de 34 % depuis 1987/88. Surtout, le taux d’occupation des lits est passé de 87,1 % en 2010/11 à 90,2 % en 2018/19 et dépasse régulièrement les 95 % durant l’hiver, ce qui représente un niveau dangereux comme le montre le rapport du Kings Fund : « Les hôpitaux du NHS n’ont sans doute jamais été autant mis à l’épreuve qu’aujourd’hui ». L’augmentation de la population, combinée avec une proportion croissante de personnes âgées qui nécessitent généralement plus de soins de santé, entraine une demande accrue du traitement hospitalier par le NHS. […] Le NHS arrive seulement à la limite d’une pression financière prolongée et se trouve en pleine crise d’effectifs. Les services de l’assistance sociale pour adultes sont soumis à une saturation des demandes qui continuent à augmenter et attendent toujours la réforme financière fondamentale dont ils ont urgemment besoin. Les niveaux actuels d’occupation signifient que l’hôpital moyen en Angleterre court le risque d’être incapable de prendre en charge efficacement le flux des patients, le laissant à la merci de la fluctuation de la demande » [4]. Un des résultats de cette austérité a été le nombre bien médiatisé de morts au-dessus de la moyenne pour cette période de l’année, qui à cette date a presque atteint les 60 000, particulièrement dans les hôpitaux et les maisons de type EHPAD durant la pandémie de Covid-19.
En comparaison avec d’autres pays, la Suède, avec un taux similaire de 2,2 lits d’hôpitaux pour 1000 habitants a pu protéger son système de santé aux dépens des EHPAD avec la moitié des décès chez les plus de 70 ans dans ces dernières.
Le système de santé allemand est mieux pourvu avec 8 lits pour 1000 habitants mais est toujours confronté à des mesures d’austérité. La baisse du nombre de lits d’hôpitaux est une tendance générale observable à l’échelle internationale.
“Protéger le NHS »… des “étrangers” !
Par exemple, « une enfant atteinte de leucémie nécessitait un traitement en soins intensifs et commencer une chimiothérapie […] L’hôpital s’est montré réticent à commencer la chimiothérapie jusqu’à ce que les fonds soient déposés sur son compte et par conséquent le traitement a été reporté. » Pour ceux qui atteignent l’âge de la retraite, particulièrement ceux qui ont travaillé dans les services de santé, c’est exactement le genre de choses dont on nous disait que cela ne pouvait pas arriver ici avec le NHS. C’était exactement comme ce qui se passait aux États-Unis avec le recours à la médecine privée. Continuons la lecture du document : " ce cas nécessitait d’être examiné par un centre spécialisé afin de déterminer les options de traitement possible mais on a refusé de recevoir cette enfant sous prétexte qu’elle « n’était pas en droit d’accéder aux soins du NHS »… » [5] Et ce ne sont pas seulement les enfants de familles récemment immigrées qui se sont vus refuser les traitements. Une partie du scandale Windrush [6] fut qu’on a refusé un traitement à un certain nombre de patients qui ne pouvaient pas prouver qu’ils y avaient droit même après avoir vécu dans le pays depuis l’enfance et même si leur vie était en danger.
On nous parle de plus en plus ces derniers temps du “besoin” de protéger le NHS du « tourisme de la santé ». Cette campagne xénophobe ne date pas seulement du populisme de Boris Johnson ni de « l’environnement hostile » pour les migrants sous le gouvernement de Theresa May : on trouve déjà les mêmes arguments mis en avant à l’époque du dernier gouvernement du Labour lorsque Jack Straw, le Secrétaire d’Etat à l’Intérieur, faisait la chasse aux « faux demandeurs d’asile » qui pourraient entrer sur le territoire et profiter de “nos” services publics.
Cependant la classe dominante connaît certaines difficultés avec sa propagande sur le besoin de protéger le NHS de ces prétendus « touristes de la santé » qui soi-disant « pilleraient continuellement les ressources du NHS » alors que beaucoup d’entre eux travaillent en fait dans le secteur de la santé ou de l’aide sociale et mettent leur vie en danger durant la pandémie en travaillant pour le NHS. La majoration de prélèvements sur les salaires pour l’accès aux soins des travailleurs immigrés devait passer de 400 £ à 600 £ en octobre et jusqu’au récent recul opéré par le gouvernement sur le sujet, il était prévu que les nombreux travailleurs de la santé et du secteur social issus de l’immigration à l’exception des médecins paient cette majoration. En fait le NHS, et l’Etat-Providence plus généralement, n’a jamais été un “cadeau” ni une réforme « gagnée par les travailleurs ». Son but était de garantir un revenu de subsistance sous condition de service et de contribution afin d’améliorer le rendement de leur exploitation et maintenir les prolétaires « en forme pour le service » pour reprendre les mots de Beveridge [7]. Il s’agissait de maintenir les travailleurs en meilleure forme pour le travail ou le service militaire.
Le capitalisme est basé sur l’Etat-nation et dans cette pandémie globale qui affecte le monde entier, chaque État, chaque service de santé national, doit se battre pour obtenir les équipements de protection, les ressources et les tests, dans un esprit de concurrence et de chacun pour soi. Les États-Unis menacent l’OMS de retirer leur contribution. Plusieurs pays ont accusé la Chine d’espionnage industriel sur un vaccin. Au lieu de la coopération nécessaire pour faire face à une menace globale et produire un vaccin, chaque nation protège son service de santé, ses profits, ses intérêts impérialistes. La coopération limitée qu’elles ont réussi à mettre en œuvre dans le passé laisse place désormais à l’égoïsme national débridé et cela au détriment de leur capacité à limiter le danger de cette pandémie.
« Protéger le NHS »… au détriment des travailleurs de la santé et du secteur social
Une étude menée par le Royal College of Nursing (école d’infirmières) a montré que la grande majorité des personnels infirmiers et des sage-femmes avaient la sensation qu’ils étaient, eux et leurs familles, en danger à cause de leur travail et que s’ils étaient “redéployés” vers d’autres hôpitaux pour s’occuper des patients victimes du Covid, ils ne seraient pas suffisamment formés entrainés. Plus de la moitié ont travaillé au-delà des heures réglementaires et la majorité ne s’attendait pas au attendent le paiement des heures supplémentaires [8]. Pendant ce temps, les porte-paroles du gouvernement mentaient sur la disponibilité des équipements de protection personnelle et des tests tout en appelant la population à applaudir tous les jeudis soirs et à accrocher des drapeaux (?) arc-en-ciels à ses fenêtres afin de soutenir le NHS. Le même NHS qui néglige la sécurité des infirmiers et des autres travailleurs face à une infection mortelle ! Comme des soldats au front, comme de la chair à canon ! La Belgique de son côté a menacé de réquisitionner les travailleurs de la santé, ce qui a suscité une vive indignation.
Ceci n’est pas juste une aberration durant la pandémie mais la manière dont les services de santé, comme n’importe quelle autre entreprise capitaliste, traitent leurs employés. Il y a eu une augmentation de l’intensité au travail dans les hôpitaux avec le nombre de lits réduits de moitié alors que le nombre de patients traités augmentait. Les postes non pourvus d’infirmiers sont en augmentation et cette lacune est comblée par du personnel de soutien comme les aides-soignants. Cela a empiré depuis 2016 avec une chute du nombre d’infirmiers européens venant s’intaller au Royaume-Uni. Dans ces circonstances, il y a toujours un chantage moral effectué sur les travailleurs de la santé pour « fournir un effort supplémentaire » dans le soin des patients. Tout cela s’additionne à un accroissement de l’exploitation, phénomène que nous pouvons observer dans tous les services de santé au niveau mondial comme dans tous les secteurs de l’économie.
La solidarité avec les travailleurs de la santé ne se fait pas à travers des applaudissements hebdomadaires pour leur employeur mais à travers la solidarité prolétarienne, la solidarité avec ces travailleurs exploités dont les intérêts sont en conflit avec le NHS et dont la lutte pour de meilleurs salaires et de meilleures conditions de travail est inévitablement une lutte contre leur employeur, l’Etat capitaliste.
Nationalisé ou privatisé, le NHS demeure une institution capitaliste.
La gauche de la bourgeoisie voudrait que nous nous opposions à la privatisation du NHS, affirmant même qu’un système de santé nationalisé serait d’une manière ou d’une autre « socialiste ". C’est la version de gauche du mensonge affirmant que c’est « notre NHS » parce qu’il est administré par l’Etat. Nous parlons d’une institution de l’Etat capitaliste : « Le salaire même est dépendant de l’Etat. La fixation, à sa valeur capitaliste, en est dévolue à des organismes étatiques. Une partie du salaire est enlevée à l’ouvrier et est administrée directement par l’Etat. Ainsi, l’Etat « prend en charge » la vie de l’ouvrier, il contrôle sa santé (lutte contre l’absentéisme), dirige ses loisirs (répression idéologique)" [9]. L’Etat prend donc en charge une partie du salaire pour maintenir la santé des travailleurs et éviter que les employeurs n’aient à payer une assurance santé, de la même façon que l’Etat paye une partie des salaires à travers le « crédit universel " et les allocations logement permettant ainsi aux capitalistes de payer des salaires plus bas. Dans le secteur public ou dans le secteur privé, les travailleurs de la santé sont exploités par le capital, que ce soit par l’Etat pour le bénéfice du capital national comme un tout, ou par une compagnie qui vend ses services à une assurance ou à l’Etat. C’est pourquoi tous les services de santé, qu’ils soient publics ou privés, appliquent la même politique et avant tout, la même politique d’exploitation.
Un des avantages du service de santé privatisé pour l’Etat est qu’il est directement sujet aux lois du marché et peut faire faillite, le gouvernement n’a pas à le renflouer. C’est pourquoi il y a eu partout des mesures pour faire en sorte que les hôpitaux et d’autres institutions de soins de santé respectent leurs budgets, tout en lançant des appels d’offres sur les services, particulièrement depuis les années 80 sous le gouvernement Thatcher et durant les années Blair. Parce que la bourgeoisie britannique compte tant sur l’idéologie du NHS, elle a beaucoup insisté sur le contrôle de l’Etat en matière de ce qui devrait être fait et également sur ce qui ne devrait pas être entrepris ou réalisé car non “rentable”.
Comme nous le disions dans un article sur la réponse apportée par le système de santé allemand : « le plus important est que la gestion des hôpitaux a été durement soumise aux lois de l’économie capitaliste pour tous les organismes de financement (autorités publiques et religieuses incluses). Ceci s’applique, par exemple, à la rationalisation des processus de travail… Les employés sont pressés comme des citrons afin de pousser le plus loin possible l’accumulation de la valeur dans l’industrie des soins de santé. Le patient se retrouve face au soignant dans une situation où il devient une marchandise, la relation sociale devient un service, le processus de travail est sujet à d’énormes pressions et contraintes temporelles. Cette perversion décrit très bien ce que Marx a analysé comme la réification, la déshumanisation et l’exploitation ».
Alex, 23.5.20
[1] https://en.internationalism.org/content/16848/british-governments-herd-i [121]…
[2] https://en.internationalism.org/content/16834/profound-impact-covid-19-c [122]…
[3] https://en.internationalism.org/wr/303/nhs-reforms [123]
[4] https://www.kingsfund.org.uk/publications/nhs-hospital-bed-numbers?gclid... [124]
[5] https://bmjpaedsopen.bmj.com/content/4/1/e000588 [125]
[6] Durant lequel beaucoup de ceux qui étaient arrivés, légalement, au Royaume-Uni lorsqu’ils étaient enfants, furent traités comme immigrés illégaux. voir : https://fr.internationalism.org/content/9988/scandale-windrush-nationali... [126]
[7] L’économiste et politicien libéral dont le rapport durant la Seconde Guerre Mondiale pour le gouvernement de coalition a formé les bases de « l’Etat-Providence » mis en place par le gouvernement Atlee après la guerre.
[8] https://www.cardiff.ac.uk/news/view/2326580-research-highlights-concerns [127]…
[9] 1952 Internationalisme : « L’évolution du capitalisme et la nouvelle perspective », https://fr ; [128] internationalism.org/rinte21/evolution.htm
Récent et en cours:
- Coronavirus [55]
- COVID-19 [56]
Rubrique:
La réponse chaotique de la bourgeoisie américaine face à la pandémie
- 55 lectures
“Si les gens crèvent et tombent aujourd’hui comme des mouches, au cœur même des pays les plus développés, c’est en premier lieu parce que les gouvernements, partout, ont réduit les budgets destinés à la recherche sur les nouvelles maladies. Ainsi, en mai 2018, Donald Trump a supprimé une unité spéciale du Conseil de Sécurité Nationale, composée d’éminents experts, chargée de lutter contre les pandémies”. (1)
Fin décembre 2019, des rapports indiquaient que la Chine était en train d’enquêter sur une épidémie de maladie respiratoire dans la ville de Wuhan. Entre le 6 et le 8 janvier de cette année, les Centres pour le contrôle et la prévention des maladies publiaient une série d’avertissements et d’alertes tandis que le premier cas signalé de Covid-19 aux États-Unis était repéré le 21 janvier. Le jour suivant, le Président américain Donald Trump, déclarait que les États-Unis avaient le coronavirus “totalement sous contrôle. Il s’agit d’une personne qui revient de Chine, et nous avons la situation sous contrôle. Ça va très bien se passer”.
Au milieu du mois de mai, il était devenu évident que “la situation” ni n’était sous contrôle, ni ne se passait bien. Les statistiques ont montré que sur les 1,3 millions d’Américains infectés par le virus du Covid-19 (un tiers des cas mondiaux à l’époque), plus de 80 000 en sont officiellement morts ; le coronavirus a désormais tué plus d’Américains que la guerre du Vietnam qui, elle, a duré presque deux décennies ! (2)
Dans les grandes villes, des corps – victimes du virus – ont été exposés gisant en train de pourrir dans des camions de location devant des pompes funèbres débordées, ou stockés dans des fourgons réfrigérés, garés près d’établissements absurdement étiquetés “maisons de santé”. A la campagne : “Les régions rurales d’Amérique étaient déjà confrontées à une épidémie lorsque le virus a frappé… [dans des régions] dévastées en raison des décès dus à l’oxycontin, au fentanyl et à l’alcool – des “maladies du désespoir”… Parmi les 38 millions d’Américains qui vivent en dessous du seuil de pauvreté fédéral, nombre d’entre eux sont contraints de cumuler plusieurs emplois pour pouvoir survivre. Actuellement, plus de 27,5 millions n’ont pas d’assurance maladie – contre les 25,6 millions de personnes non assurées en 2017, avant que l’administration Trump ne commence ses attaques contre la Loi sur la Protection des Patients et les Soins Abordables (Obamacare) – et des millions d’autres ont un ticket modérateur et doivent payer des franchises élevés pour une faible couverture de soins. Les infections se propageront facilement parmi les détenus dans les conditions de promiscuité des prisons saturées et les plus de deux millions de personnes qui se trouvent dans les quartiers proches des prisons. Les agents et le personnel pénitentiaires sont également menacés, habitant souvent au sein de communautés pour lesquelles les prisons constituent la seule source de travail et où la “crise des opioïdes” a engorgé les prisons rurales. Quelque 10 millions d’immigrants sans papiers ont peur de se faire soigner par crainte d’attirer l’attention des services des douanes et de l’immigration…”. (3)
De plus, durant les six semaines précédant la fin du mois d’avril, plus de 30 millions de travailleurs américains (1 sur 5) a demandé à bénéficier de “l’allocation” chômage, témoignant d’un taux de chômage sans précédent atteignant entre 16 et 20 %. Les demandeurs n’ont pas tous bénéficié de l’ensemble ou même d’une partie des aides d’urgence de l’État fédéral.
A de nombreux égard, l’Amérique est toujours “la plus puissante nation sur terre”. Comme les bourses mondiales se sont effondrées du 24 au 28 février et que les demandes de crédit s’est accrue, c’est la Réserve fédérale des États-Unis qui a avancé des fonds aux principales institutions financières nationales et qui a permis aux banques centrales du monde entier d’échanger leurs propres devises contre des dollars grâce à des “accords de swap”. (4)
Ainsi, rien n’illustre mieux le blocage historique et mondial des rapports capitalistes que le contraste entre le potentiel d’innovation, technologique et productif des États-Unis, face à la détresse, la division et la mort dans les rues comme à huis clos dans le pays le plus avancé au monde ; entre la mise à disposition des meilleures ressources médicales au monde et l’accès socialement limité à de tels “avantages”.
Grosse bourde, complot ou décomposition ?
En vérité, la réponse de l’administration Trump face à la crise du Covid-19 – dans les grandes lignes – a fortement ressemblé à celle de la plupart des grands États-nations : mensonge, déni, manœuvres dilatoires puis dénonciation avant d’être contrainte, à contrecœur, d’agir en interrompant partiellement l’activité économique dans la perspective d’un “retour à la normale” le plus tôt possible.
Mensonge : Trump a déclaré que l’Organisation Mondiale de la Santé n’avait pas émis d’avertissements clairs. En réalité, le dénigrement de l’administration Trump ainsi que sa menace de réduire les fonds alloués à l’OMS, (5) qui avait contribué à coordonner une réponse relativement centralisée et mondiale face à l’épidémie de SRAS en 2003, illustrent la manière dont le capitalisme va de l’avant – en abandonnant les structures internationales et les connaissances accumulées qu’il avait auparavant érigées précisément pour faire face à des situations comme celles de la pandémie actuelle. Ceci révèle un glissement général du multilatéralisme vers le bilatéralisme, associé à l’abandon de la politique de “gendarme du monde” que les États-Unis avaient tenté de maintenir depuis la fin de la guerre froide, en faveur d’une politique populiste de “l’America first”, une acceptation claire du fait qu’au niveau des affaires internationales comme de la politique intérieure, c’est le “chacun pour soi”. Cet épisode – ainsi que le vol de fournitures médicales destinées à d’autres pays – n’est qu’une preuve supplémentaire que l’ancien gendarme mondial tient désormais un rôle majeur dans la propagation du banditisme et du chaos mondial, et qu’il est un élément actif dans le démantèlement des institutions et des accords internationaux existants. De même, les confiscations de matériel et de fournitures médicales aux États-Unis, qui doivent être stockées par les autorités fédérales ou détournées vers des États soutenant la clique de Trump ou vers des États marginaux “hésitants” requérant des pots-de-vin, témoignent d’un niveau de corruption et de mépris des protocoles nationaux tel, que cela met mal à l’aise le clan Bush ou le parti républicain lui-même.
Déni : Après avoir nié la véracité de la crise du COVID19 (“c’est un canular”), ignoré la gravité de l’épidémie (“Ça va disparaître. Un jour, comme par miracle, ça disparaîtra”), puis colporté une tripotée de bobards et de remèdes de charlatan, en suggérant notamment que les injections de désinfectant pourraient être une bonne idée, le Président Trump a prétendu à plusieurs reprises qu’il avait hérité de l’administration Obama un “placard vide” en termes de kits de tests, que toute personne ayant besoin de tests et/ou d’équipement de protection individuelle (PPE) y avait accès, avant de dire que rien de tout cela ne relevait de sa responsabilité – tout dépendait des gouverneurs des États. D’où le spectacle ridicule des différents États fédéraux qui se disputent les masques, les blouses, les gants, faisant monter les prix à la grande joie des profiteurs et au grand désespoir des “travailleurs contraints de continuer à bosser dans les secteurs estimés essentiels de l’économie nationale” qui eux, en ont besoin. Ainsi, le chaos déclenché sur la planète par la décomposition des rapports sociaux capitalistes s’est reflété au sein-même de l’Amérique au fur et à mesure que la pandémie se développait.
Manœuvre dilatoire : La volonté de protéger l’économie et les profits au détriment des personnes, la dissimulation et la tromperie venant d’en haut, ont favorisé les retards dans l’acquisition de matériel PPE et de kits de dépistage ainsi que dans l’obtention de ventilateurs, de lits d’hôpitaux et de personnel médical spécialisé, faisant par conséquent augmenter les taux d’infection et de mortalité. Faire semblant d’abandonner la prise de décision aux États fédéraux a entraîné des approches diverses entre les différents États – et parfois au sein-même de chaque État, par exemple entre les villes et les zones rurales, ces divisions apparaissant souvent en fonction des clivages entre les partis. Cela s’apparente à une sinistre expérience en laboratoire grandeur nature, où l’on oppose une mise en quarantaine imposée de manière enthousiaste et une attitude de “laisser-faire” face à la distanciation sociale et au “confinement”. En réalité, aucune de ces deux approches ne peut ou ne pourrait concilier l’inconciliable du “profit avant les gens”. Et pour comprendre où réside le vrai pouvoir – Washington, le Pentagone et Wall Street – il suffit de se rappeler que c’est finalement l’état d’urgence national déclaré par Trump le 13 mars (avec effet rétroactif !) qui a ouvert la voie à l’émission d’un plan de sauvetage sans précédent de 2,3 milliards de dollars à destination des États fédéraux, des sociétés, des entreprises et des particuliers face au chômage de masse et à l’effondrement de l’économie. Et c’est Washington qui doit faire face à l’augmentation des prêts internationaux pour couvrir le déficit de 3 milliards de dollars qui en résulte…
Dénonciation : Louant initialement les efforts du président chinois Xi Jinping, l’administration Trump a rapidement décidé de faire pression sur son rival extrême-oriental en qualifiant l’épidémie de “virus de Wuhan” et en menaçant de nouvelles sanctions commerciales la Chine et ses partenaires. Elle a également pris part à des théories conspirationnistes naissantes, qui brouillent les pistes et la perception de la réalité en Amérique, en suggérant que le Covid-19 avait été produit dans un laboratoire chinois et que la Chine pourrait l’avoir délibérément diffusé dans le monde entier. En ce sens, au niveau des antagonismes inter-impérialistes, l’administration Trump poursuit clairement la politique de “pivot” asiatique d’Obama visant à contenir les intérêts économiques et impérialistes propres de la Chine. En cela, il est habilement soutenu par le présumé candidat démocrate à la présidence Joe Biden, qui reproche à Trump d’être “trop mou” avec la Chine. Au cours d’une catastrophe sanitaire sans précédent, les États-Unis cherchent ainsi à prendre l’avantage sur l’arène mondiale en recourant à la grandiloquence et à la force. Ils ont choisi ce moment (21 mars) pour annoncer le lancement réussi d’un prototype de missile hypersonique. La Chine n’a pas agi différemment : elle a tenté de se couvrir de la même manière que les États-Unis, et a essayé de gagner des points de propagande en se servant de son apparent succès dans la lutte contre la propagation du virus. Les deux grandes puissances économiques et militaires de la planète sont guidées par le même appât du gain et se comportent de la même manière. (6)
Une perte de contrôle certaine
Le même chaos, qui a été déclenché par les États-Unis en réponse à la pandémie, a été reproduit alors qu’ils cherchaient à mettre fin aux mesures de quarantaine et à “déconfiner” l’économie.
À la fin de la première semaine du mois de mai :
Les ordres demandant de “rester chez soi” ou de “s’abriter sur place” ont été levés dans certains États et étendus dans d’autres. Trump a annoncé son intention de dissoudre le groupe de travail du gouvernement sur le coronavirus, mais il a semblé se rétracter après un tollé. En tout état de cause, alors que les infections et les décès continuent d’augmenter dans de nombreux États, l’administration Trump fait état de son impatience à “déconfiner” l’économie, “pas question de garder l’Amérique en quarantaine pendant cinq ans”. Le chef de file du groupe de travail, le Dr. Anthony Fauci, qui est le visage public de la “lutte contre le virus”, était l’un des trois membres du personnel de la Maison Blanche à se mettre en quarantaine après avoir été en contact avec des personnes infectées.
Le président a encouragé des manifestations (dont certaines armées) contre les ordres de confinement dans une douzaine d’États, a rejeté les recommandations de ses propres conseillers sur la manière dont devrait s’ouvrir très progressivement l’économie, mais n’a actuellement toujours pas pris de mesures positives pour légiférer en vue d’une reprise de l’activité économique (les paroles ne comptent pas).
Trump avait prévu de promulguer une loi, la Defence Production Act, pour obliger les travailleurs des usines de conditionnement de viande – zones à risque de transmission du virus – à retourner au travail face à la menace de pénurie alimentaire, mais bon nombre de ces établissements sont restés fermés.
Les détracteurs démocrates du président – dont Obama – ont accusé le gouvernement de présider le chaos. Ses partisans républicains ont déclaré que le maintien du confinement n’était pas une option et que cela nuisait autant que cela aidait. D’une certaine manière, ils ont tous raison : la classe dirigeante américaine n’a pas de solutions.
Robert Frank, 11 mai 2020
1Voir sur notre site COVID-19 : Barbarie capitaliste généralisée ou Révolution prolétarienne mondiale (Tract international) [91].
2Au moment où nous publions cette traduction, ce décompte macabre a dépassé 112 000, soit près de deux fois plus que les victimes américaines de la guerre au Vietnam (60 000).
3Voir l’article : When a Pandemic Strikes Americans Who Are Already Suffering [129] (New York Times-Opinion, 20/03/2020)
4Accords conclus entre banques centrales pour pouvoir échanger en liquides des devises entre elles.
5En réalité, Trump est depuis allé beaucoup plus loin puisqu’il a suspendu “indéfiniment” le versement des fonds américains (450 millions de dollars par an) à l’OMS le 19 mai en estimant que celle-ci “était une marionnette de la Chine” puis a décidé le 29 du même mois de rompre toute relation avec cet organisme.
6Voir l’article Hong Kong arrests and Taiwan flybys : China advances its interests during Covid-19 crisis (The Guardian, 26/04/2020)
Récent et en cours:
- Coronavirus [55]
- COVID-19 [56]
ICCOnline - juillet 2020
- 60 lectures
Rubrique:
La grève de masse en Pologne 1980 : des leçons pour l'avenir
- 907 lectures
La grève de masse en Pologne 1980 : des leçons pour l'avenir
"Il y a quarante ans, durant l’été 1980, la classe ouvrière en Pologne mettait le monde en haleine. Un gigantesque mouvement de grève s’étendait dans le pays : plusieurs centaines de milliers d’ouvriers se mettaient en grève sauvage dans différentes villes, faisant trembler la classe dominante en Pologne comme dans d’autres pays."[1] C'était il y a quarante ans, mais ce "gigantesque mouvement de grève" pointe un doigt vers l'avenir. Pour la classe ouvrière, pour les combats inévitables qu'elle devra mener, les leçons à tirer de cette grande expérience sont en effet innombrables et précieuses : prise en main des luttes, auto-organisation, élus révocables, extension du mouvement, solidarité ouvrière, assemblées générales, retransmission des débats sur haut-parleurs,… voilà ce qu'a été la lutte des ouvriers en Pologne. Une lutte contre les attaques de leurs conditions de vie, contre l'augmentation du prix de la viande, pour la revalorisation des salaires. L'organisation de ce mouvement de contestation montre de quoi est capable la classe ouvrière. Pologne 1980 est l'une des grandes expériences du mouvement ouvrier qui indique à notre classequ'elle peut et doit avoir confiance en elle-même, qu'unie et organisée elle est forte.
Ce mouvement montre aussi de quoi est capable la classe dominante, quels pièges sophistiqués elle peut dresser contre ceux qu'elle exploite, à quel point les bourgeoisies de tous bords sont prêtes à se serrer les coudes pour écraser la classe ouvrière. La gestion de cette lutte de classe est une nouvelle démonstration de la force et du machiavélisme des appareils bourgeois. À l'Est comme à l'Ouest, toutes les forces possibles ont été mises en œuvre pour éteindre ce feu dangereux et éviter qu'il ne se répande, notamment en Allemagne de l'Est.
Que s'est-il passé en 1980 en Pologne ?
Le mouvement de 1980 n'apparaît pas comme un éclair dans un ciel d'azur, au contraire. Le contexte international est marqué par la reprise des luttes, depuis Mai 1968 en France. Même si la présence du rideau de fer a limité l'influence réciproque entre les combats de la classe ouvrière à l'Ouest et à l'Est, la même dynamique était à l’œuvre. Ainsi, les années 1970 en Pologne sont caractérisées par un profond processus de développement de la combativité et de la réflexion.
Au cours des années 1970, contraint par la crise économique et la faiblesse de son capitalisme d’État, le gouvernement polonais attaque les conditions de vie de la classe : d'effroyables augmentations du prix des denrées accompagnent les pénuries alimentaires, alors que la Pologne continue d'exporter des pommes de terre vers la France. "L’hiver 1970-71, les ouvriers des chantiers navals de la Baltique entrent en grève contre des hausses de prix des denrées de première nécessité. Dans un premier temps, le régime stalinien réagit par une répression féroce des manifestations faisant plusieurs centaines de morts, notamment à Gdansk. Les grèves ne cessent pas pour autant. Finalement, le chef du parti, Gomulka, est limogé et remplacé par un personnage plus “sympathique”, Gierek. Ce dernier a dû discuter pendant 8 heures avec les ouvriers des chantiers navals de Szczecin avant de les convaincre de reprendre le travail. Évidemment, il a rapidement trahi les promesses qu’il leur a faites à ce moment-là. En 1976, de nouvelles attaques économiques brutales provoquent des grèves dans plusieurs villes, notamment à Radom et Ursus. La répression fait plusieurs dizaines de morts."
C'est dans ce contexte et face à l'aggravation de la crise économique que la bourgeoisie polonaise décide une nouvelle augmentation du prix de la viande de près de 60 % en juillet 1980. L'attaque est frontale, sans l'enrobage idéologique dont les bourgeoisies occidentales sont par exemple capables. Caractéristique des méthodes staliniennes brutales qui ne sont absolument pas adaptées face à un prolétariat combatif, les décisions de la bourgeoisie polonaise ne pouvaient qu'engendrer une riposte ouvrière. Forts de leur expérience des années 1970, "les ouvriers de Tczew près de Gdansk et d’Ursus dans la banlieue de Varsovie se mettent en grève. A Ursus, des assemblées générales se tiennent, un comité de grève est élu et des revendications communes sont mises en avant. Durant les jours suivants, les grèves continuent à s’étendre : Varsovie, Lodz, Gdansk, etc. Le gouvernement tente d’empêcher une plus grande extension du mouvement en faisant de rapides concessions telles des augmentations de salaires. Mi-juillet, les ouvriers de Lublin, un important carrefour ferroviaire, se mettent en grève. Lublin était située sur la ligne de train qui relie la Russie à l’Allemagne de l’Est. En 1980, c’était une ligne vitale pour le ravitaillement des troupes russes en Allemagne de l’Est. Les revendications des ouvriers sont les suivantes : pas de répression contre les ouvriers en grève, retrait de la police hors des usines, augmentation des salaires et élections libres de syndicats." Le mouvement s'étend, les tentatives pour l'arrêter et le diviser échouent : la grève de masse est en route. En deux mois, la Pologne est paralysée. Le gouvernement ne peut réprimer, la situation étant trop explosive. En outre, le danger n'est pas cantonné aux seules frontières polonaises. Dans la région charbonnière d’Ostrava en Tchécoslovaquie, et dans les régions minières roumaines, en Russie à Togliattigrad, les mineurs et ouvriers suivent le même chemin. "Dans les pays d’Europe de l’Ouest, s'il n’y a pas de grèves en solidarité directe avec les luttes des ouvriers polonais, les ouvriers de nombreux pays reprennent les mots d’ordre de leurs frères de classe de Pologne. A Turin, on entend en septembre 1980 les ouvriers scander : “Gdansk nous montre le chemin”."
Face à ce danger d'extension, les bourgeoisies travaillent de concert pour écraser le mouvement. Il faut d'un côté l'isoler et de l'autre le dénaturer. Les frontières avec l’Allemagne de l’Est, la Tchécoslovaquie et l’Union soviétique sont très rapidement fermées. Les bourgeoisies internationales vont œuvrer main dans la main à l'enfermement et l'isolement du mouvement : le gouvernement polonais feindra la radicalisation vis-à-vis de l'URSS, les soviétiques menaceront les ouvriers de leurs chars à la frontière, l'Europe de l'Ouest financera et conseillera le syndicat 'libre et indépendant' Solidarnosc, la propagande internationale mettra en avant le héros Solidarnosc et l'intérêt d'un 'vrai' syndicat démocratique libre et indépendant.
Cette alliance des différentes bourgeoisies occidentales avec la bourgeoisie polonaise sera fatale au mouvement de masse polonais. Et c'est d'ailleurs pour cette raison que, contrairement à la théorie du maillon le plus faible, la révolution ne pourra partir que des pays centraux: "Tant que les mouvements importants de la classe ne toucheront que des pays de la périphérie du capitalisme (comme ce fut le cas en Pologne) et même si la bourgeoisie locale est complètement débordée, la Sainte Alliance de toutes les bourgeoisies du monde, avec à leur tête les plus puissantes, sera en mesure d'établir un cordon sanitaire tant économique que politique, idéologique et même militaire autour des secteurs prolétariens concernés. Ce n'est qu'au moment où la lutte prolétarienne touchera le cœur économique et politique du dispositif capitaliste :
- lorsque la mise en place d'un cordon sanitaire économique deviendra impossible, car ce seront les économies les plus riches qui auront été touchées,
- lorsque la mise en place d'un cordon sanitaire politique n'aura plus d'effet parce que ce sera le prolétariat le plus développé qui affrontera la bourgeoisie la plus puissante, c'est alors seulement que cette lutte donnera le signal de l'embrasement révolutionnaire mondial."[2]
Illusions démocratiques et syndicales : les faiblesses de la classe ouvrière en Pologne
La principale arme de la bourgeoisie sera donc le syndicat Solidarnosc lui-même. Appelé à jouer le rôle de 'gauche' du capital, rôle qu'il continuera d'assumer même dans la 'clandestinité' à partir de 1982, il n'aura de cesse de dévoyer la lutte sur le terrain nationaliste et d'amener les ouvriers à la défaite et les livrer à la répression. Ce syndicat, issu du courant de pensée le KOR (comité de défense des ouvriers, constitué d'intellectuels de l’opposition démocratique, naît après les répressions de 1976 et milite pour la légalisation d’un syndicalisme indépendant), sera présent à travers 15 de ses membres au présidium du MKS (comité de grève inter-entreprises).
Alors qu'au début du mouvement de l'été 1980 "il n’y avait pas d’influence syndicale, les membres des "syndicats libres" s’appliquèrent à entraver la lutte. Tandis qu’initialement les négociations étaient menées de façon ouverte, il fut prétendu, au bout d’un certain temps, que des "experts" étaient nécessaires afin de mettre au point les détails des négociations avec le gouvernement. De façon croissante, les ouvriers ne pouvaient plus suivre les négociations, encore moins y participer, les haut-parleurs qui transmettaient celles-ci ne fonctionnaient plus à cause de problèmes "techniques".» Le travail de sabotage a commencé. Les revendications à l'origine d'ordre politique et économique (entre autre, revalorisation des salaires) se centrent sur les intérêts des syndicats plutôt que sur ceux des ouvriers : c'est la reconnaissance de syndicats indépendants qui est mise en avant. Le 31 août, les accords de Gdansk, en exploitant les illusions démocratiques et syndicales, signent le glas de la grève de masse. "Parce que les ouvriers avaient été clairs sur le fait que les syndicats officiels marchaient avec l’État, la plupart d’entre eux pensaient maintenant que le syndicat Solidarnosc nouvellement fondé, fort de dix millions d’ouvriers, n’était pas corrompu et défendrait leurs intérêts. Ils n’étaient pas passés par l’expérience des ouvriers à l’Ouest qui se sont confrontés pendant des décennies aux syndicats “libres”."
Solidarnosc assume parfaitement son rôle de pompier du capitalisme pour éteindre la combativité ouvrière. "Ce sont les illusions démocratiques qui furent le terreau sur lequel la bourgeoisie et son syndicat Solidarnosc purent mener leur politique anti-ouvrière et déchaîner la répression. […] À l’automne 1980, alors que les ouvriers repartent en grève à nouveau pour protester contre les accords de Gdansk, après avoir constaté que même avec un syndicat "libre" à leurs côtés, leur situation matérielle avait empiré, Solidarnosc commence déjà à montrer son vrai visage. Juste après la fin des grèves de masse, Walesa va ici et là dans un hélicoptère de l’armée pour appeler les ouvriers à cesser leurs grèves de toute urgence. "Nous n’avons plus besoin d’autres grèves car elles poussent notre pays vers l’abîme, il faut se calmer." [...] Chaque fois que possible, il s’empare de l’initiative des ouvriers, les empêchant de lancer de nouvelles grèves." Durant une année, Solidarnosc fait un travail de sape et prépare le terrain pour la répression.
Dans la nuit du 12 au 13 décembre 1981, le gouvernement polonais va 'rétablir l'ordre' et mettre en place "l’État de guerre" : ruptures de toutes communications, arrestations massives, tanks dans Varsovie, quadrillage militaire du pays. "Alors que pendant l’été 1980, aucun ouvrier n’avait été frappé ou tué grâce à l’auto-organisation et à l’extension des luttes, et parce qu’il n’y avait pas de syndicat pour encadrer les ouvriers, en décembre 1981, plus de 1200 ouvriers sont assassinés, des dizaines de milliers mis en prison ou conduits vers l’exil." Les conditions de vie qui vont s'en suivre seront pires que celles imposées début juillet 1980. Courant 1982, la combativité n'a pas disparue, mais elle sera achevée sous les coups de la répression féroce conjuguée aux sabotages incessants de Solidarnosc, laissant la classe ouvrière polonaise appauvrie, contrainte à s’exiler pour vendre sa force de travail.
Les leçons de l'été 1980
Malgré cette défaite, l'expérience de ce mouvement ouvrier est inestimable. Ce fut le plus haut point d’une vague internationale de luttes. Elle a fourni une illustration du fait que la lutte de classe est la seule force qui peut contraindre la bourgeoisie à mettre de côté ses rivalités impérialistes alors que l'existence d'un prolétariat non défait dans la bloc de l'Est avait constitué un frein à l'effort de guerre de l'URSS en Afghanistan qu'elle avait envahi en 1979. Mais pas seulement. Elle a montré in-vivo ce qu'était la force de la classe ouvrière. Et c'est cela que nous devons nous réapproprier :
"À l'été 1980, les ouvriers prennent directement l’initiative de la lutte. N’attendant aucune instruction venant d’en-haut, ils marchent ensemble, tiennent des assemblées afin de décider eux-mêmes du lieu et du moment de leurs luttes. Des revendications communes sont mises en avant dans des assemblées de masse. Un comité de grève est formé. Au début, les revendications économiques sont au premier plan. Les ouvriers sont déterminés. Ils ne veulent pas une répétition de l’écrasement sanglant de la lutte comme en 1970 et 1976. Dans le centre industriel de Gdansk-Gdynia-Sopot, un comité de grève inter-usines (MKS) est constitué ; il est formé de 400 membres (deux délégués par entreprise). Durant la seconde moitié d’août, quelque 800 à 1000 délégués se réuniront. Chaque jour des assemblées générales se tiennent aux chantiers navals Lénine. Des haut-parleurs sont installés pour permettre à tous de suivre les discussions des comités de grève et les négociations avec les représentants du gouvernement. Puis, des micros sont mêmes installés en-dehors de la salle de réunion du MKS, afin que les ouvriers présents dans les assemblées générales puissent intervenir directement dans les discussions du MKS. Le soir, les délégués – la plupart pourvus de cassettes avec l’enregistrement des débats – rentrent sur leur lieu de travail et présentent les discussions et la situation dans "leur" assemblée générale d’usine, rendant leur mandat devant celle-ci. Tels sont les moyens grâce auxquels le plus grand nombre d’ouvriers peuvent participer à la lutte. Les délégués doivent rendre leur mandat, sont révocables à tout moment et les assemblées générales sont toujours souveraines. Toutes ces pratiques sont en opposition totale avec la pratique syndicale. Pendant ce temps, après que les ouvriers de Gdansk-Gdynia-Sopot se sont unis, le mouvement s’étend à d’autres villes. Pour saboter la communication entre les ouvriers, le gouvernement coupe les lignes téléphoniques le 16 août. Immédiatement, les ouvriers menacent d’étendre encore plus leur mouvement si le gouvernement ne les rétablit pas sur-le-champ. Ce dernier fait marche arrière. L’assemblée générale décide alors la mise sur pied d’une milice ouvrière. Alors que la consommation d’alcool est largement répandue, il est décidé collectivement de la prohiber. Les ouvriers savent qu’il leur faut avoir la tête claire dans leur confrontation contre le gouvernement. Lorsque le gouvernement menace de réprimer à Gdansk, les cheminots de Lublin déclarent : "Si les ouvriers de Gdansk sont physiquement attaqués et si un seul d’entre eux est touché, nous paralyserons la ligne de chemin de fer stratégiquement la plus importante entre la Russie et l’Allemagne de l’Est." Dans presque toutes les principales villes, les ouvriers sont mobilisés. Plus d’un demi-million d’entre eux comprennent qu’ils constituent la seule force décisive dans le pays capable de s’opposer au gouvernement. Ils sentent ce qui leur donnait cette force :
- l’extension rapide du mouvement au lieu de son épuisement dans des affrontements violents comme en 1970 et 1976 ;
- leur auto-organisation, c’est-à-dire leur capacité à prendre l’initiative eux-mêmes au lieu de compter sur les syndicats ;
- la tenue d’assemblées générales dans lesquelles ils peuvent unir leurs forces, exercer un contrôle sur le mouvement, permettre la plus grande participation de masse possible et négocier avec le gouvernement devant tous.
Et, en effet, l’extension du mouvement fut la meilleure arme de la solidarité ; les ouvriers ne se sont pas contentés de faire des déclarations, ils ont pris eux-mêmes l’initiative des luttes. Cette dynamique a rendu possible le développement d’un rapport de forces différent. Tant que les ouvriers luttaient de façon aussi massive et unie, le gouvernement ne pouvait mener aucune répression."
Pologne 1980 est l'une des grandes expériences historiques du mouvement ouvrier, une expérience que le prolétariat doit se réapproprier pour préparer ses luttes futures, pour avoir confiance en sa force, en ses capacités, pour savoir comment s'organiser, comment faire vivre sa solidarité, mais aussi avoir conscience des pièges qu'est capable de tendre la bourgeoisie, à commencer par ses syndicats.
C'est pour participer à ce processus de réappropriation par la classe ouvrière de sa propre histoire, que nous republions ci -dessous de nombreux articles du CCI, écrits pour une très grande partie au moment même des événements.
Références et accès aux articles du CCI
Les premières luttes des années 1970
Pour faire face à la crise économique et, contraint par la faiblesse de son capitalisme d'État, le gouvernement polonais attaque férocement les conditions de vie de la classe, demandant toujours plus de sacrifices aux ouvriers. "À l'Est, les manifestations du capital en crise, c'est la quasi absence de produits de première nécessité (viande, sucre, …) ; à l'Ouest, c'est un chômage toujours plus massif et une inflation croissante. À l'Est comme à l'Ouest, la crise du capitalisme signifie pour les ouvriers la généralisation de la misère."[3] Les années 1970 en Pologne sont caractérisées par des augmentations de prix incessantes et indécentes, des pénuries alimentaires, du chômage déguisé dans une baisse des cadences, etc. En réponse, la classe ouvrière ne cessera de lutter, principalement en 1970 et 1976.
Sur la situation précise de la Pologne en 1976 :
- Pays de l'Est – Surproduction, pénurie et classe ouvrière [130] -in journal Révolution Internationale n°23 (mars 1976)
- Pologne – Le capitalisme d’État affronte la crise et la classe ouvrière [131] -in journal Révolution Internationale n°28 (août 1976)
Sur l'évolution de la maturation au sein de la classe ouvrière en Pologne durant les années 1970 :
- Pologne – De 70 à 80, un renforcement de la classe ouvrière [132]- in journal Révolution Internationale (décembre 1980)
Sur la situation dans les pays de l'Est (y inclus la Pologne) durant les années 1970 et 1980 :
- La crise capitaliste dans les pays de l'Est [133] – in Revue Internationale n°23 (4e trimestre 1980)
- Lutte de classes en Europe de l'Est (1970-1980) [134] (partie I) – in Revue Internationale n°28 (1e trimestre 1982)
- Lutte de classes en Europe de l'Est (1970-1980) [135] (partie II) – in Revue Internationale n°29 (2e trimestre 1982)
2. Les années 1980 et 1981 : luttes massives et répression
A l'été 1980, le gouvernement polonais décide à nouveau de l'augmentation brutale du prix de la viande, entraînant une explosion de colère. De juillet à août 1980, c'est l'instauration de la grève de masse : extension du mouvement, mise en place de comités de lutte, élus révocables, discussions répercutées en direct sur haut-parleurs, solidarité de classe, auto-organisation des ouvriers... Fin août 1980, les accords de Gdansk signent la fin à la grève de masse et l'affaiblissement de la classe ouvrière dans son rapport de force Sface à la bourgeoisie. Malgré tout, la combativité et la colère vont perdurer jusqu'à la répression féroce de décembre 1981. Très tôt, les bourgeoisies prendront conscience du danger de ce mouvement. Et il faudra les efforts conjugués du POUP (gouvernement polonais), du KOR et de Solidarnosc (jouant le rôle d'opposition de 'gauche'), ainsi que l'aide précieuse des bourgeoisies de tout bord, Est et Ouest, pour venir à bout de ce mouvement et amener les ouvriers à la défaite.
Été 1980 et les premières leçons à tirer :
- Grève de masse en Pologne 1980 : une nouvelle brèche s'est ouverte [136] – in Revue Internationale n°23 (4e trimestre 1980)
De l'été 1980 à la répression de décembre 1981 : les agissements de Solidarnosc et de l'ensemble des bourgeoisies :
- Pologne : malgré les syndicats, la classe ouvrière ne lâche pas prise [137] -in journal Révolution Internationale n°80 (décembre 1980)
- Pologne – Briser l'isolement national et l'encadrement syndical [138] -in journal Révolution Internationale n°82 (février 1981)
- La bourgeoisie mondiale est derrière Jaruzelski [139] -in journal Révolution Internationale n°93 (janvier 1982)
1982 : l'état de guerre et la répression
- Pour dévoyer le prolétariat, Solidarnosc est toujours là [140] -in journal Révolution Internationale n°98 (juin 1982)
- Le prolétariat en Pologne paie le prix de son isolement [141] -in journal Révolution Internationale n°102 (octobre 1982)
- Pologne – Jaruzelski-Walesa, même combat -in journal Révolution Internationale n°105 (janvier 1983)
3. Mieux comprendre ce qu'a été le phénomène de grève de masse en Pologne
Les luttes en Pologne ne sont pas "un exemple isolé du phénomène de la grève de masse, mais plutôt la plus haute expression d'une tendance internationale générale dans la lutte de classe prolétarienne".[4] "La grève de masse est un phénomène mouvant et ne suivant pas un schéma rigide et vide. Elle n'est pas un moyen inventé pour renforcer l'effet de la lutte prolétarienne, mais elle est le mouvement même de la masse prolétarienne dans des conditions historiques déterminées. C'est une mouvement spontané qui, par son extension, son auto-organisation, ses avancées, ses reculs, connaîtra une évolution, prendre une ampleur. [...] Une de ses caractéristiques est l'enchevêtrement des revendications économiques et politiques."[5]
Sur ce qu'est la grève de masse et en quoi le mouvement polonais de l'été 1980 en est une :
- Notes sur la grève de masse [142] – in Revue Internationale n°27 (4e trimestre 1981)
- Grève de masse [143] -in journal Révolution Internationale n°81 (janvier 1981)
4. Les leçons du mouvement de lutte en Pologne
En 1968, le prolétariat reprenait le chemin de la lutte. En 1980, le mouvement en Pologne, à travers sa longévité et sa grève de masse, constituera la manifestation la plus importante de cette tendance à la reprise internationale de la lutte de classe. Tracer le bilan de ces luttes, en tirer les leçons, se réapproprier ses forces et faiblesses, comprendre comment les ouvriers se sont organisés concrètement, analyser les manœuvres des bourgeoisies, démasquer les syndicats, la gauche, etc... C'est tout cela qu'apporte le mouvement polonais à la classe ouvrière.
Sur les leçons et le bilan du mouvement de lutte en Pologne :
-
Un an de luttes ouvrières en Pologne [18] – in Revue Internationale n°27 (4e trimestre 1981)
- État de guerre en Pologne: la classe ouvrière face à la bourgeoisie – in supplément Revue Internationale n°28 (1e trimestre 1982)
- Après la répression en Pologne : perspectives des luttes de classe mondiales [144] – in Revue Internationale n°29 (2e trimestre 1982)
- La dimension internationale des luttes ouvrières en Pologne [145] – in Revue Internationale n°24 (1e trimestre 1981)
- Pologne décembre 1981: quelle défaite ? - in journal Révolution Internationale n°95 (mars 1982)
- L'internationalisation des luttes, seule réponse aux pièges de la bourgeoisie - in journal Révolution Internationale n°103 (novembre 1982)
5. Le syndicalisme en décadence, une arme de défense des intérêts du capital : l'exemple de Solidarnosc
S'appuyant sur les illusions démocratiques de la classe ouvrière, la bourgeoisie polonaise fera éclore à l'été 1980 le syndicat libre Solidarnosc. Celui-là même qui fera passer en première place la revendication du droit d'avoir un syndicat libre plutôt que les augmentations de salaire. Celui qui signera les accords de Gdansk, qui sabotera les retransmissions des négociations par haut-parleurs, qui n'aura de cesse d'enfermer les luttes jusqu'à les mener à la répression. Solidarnosc sera LE moyen, en opposition aux conseils ouvriers, de mystifier la classe ouvrière, en faisant croire à un renouveau du syndicalisme : un syndicalisme indépendant, libre, autogéré, et en prenant le rôle de la 'gauche'. Malgré tout, Solidarnosc aura du mal à s'imposer totalement et les luttes en Pologne perdureront jusqu'en 1981, année où le syndicat le plus 'solidaire' au monde entraînera les ouvriers vers la répression. À partir de 1982, Solidarnosc, passé dans la clandestinité, continuera à servir les intérêts du capital dans son rôle d'opposition de gauche.
1980, le vrai visage de Solidarnosc :
- Les ouvriers posent la vraie question : soviets ou syndicats ? - extraits du journal World Revolution n°33 (octobre 1980)
- Solidarité avec l’État capitaliste [146] - in journal Révolution Internationale n°81 (janvier 1981)
1981, comment Solidarnosc a isolé pour mener à la défaite et a préparé le terrain pour dévoyer la combativité dans l'ensemble du bloc de l'Est :
- Solidarnosc – Une défense ouverte du capital national" - in journal Révolution Internationale n°85 (mai 1981)
- Pologne – Le syndicat Solidarnosc a préparé la répression" - in journal Révolution Internationale n°93 (janvier 1982)
- 1982, le 'clandestin' Solidarnosc continue son rôle d'opposition de gauche :
- Pologne – Solidarnosc au service de l'État - in journal Révolution Internationale n°109 (mai 1983)
6. L'enfermement national : quand les bourgeoisies œuvrent TOUTES au même but : écraser la classe ouvrière
L'extension géographique des luttes ouvrières à l'ensemble de la Pologne durant l'été 1980 a été une des forces du mouvement. L'extension, l'organisation et la solidarité prolétarienne. Et c'est l'isolement national qui aura raison de ce mouvement au cours de l'année 1981.
Conscientes du danger que représentait le mouvement et l'influence que cela pouvait avoir internationalement sur la classe ouvrière, toutes les bourgeoisies, de l'Est comme de l'Ouest, ont œuvré à son enfermement et son écrasement au sein de la nation polonaise. Toutes les bourgeoisies se sont unies pour mettre en œuvre toutes les stratégies connues pour détourner les ouvriers du chemin qu'ils avaient empruntés : fermeture des frontières, syndicalisme 'libre', mise en place d'une opposition de gauche, radicalisation vis-à-vis de l'URSS, menace d'intervention soviétique, propagande.
Sur le travail des bourgeoisies, à l'Est et à l'Ouest :
- Pologne – POUP-Solidarnosc-Washington-Moscou : La bourgeoisie unie pour attaquer le prolétariat - in journal Révolution Internationale n°84 (avril 1981)
- Luttes de classe dans le monde : Pologne - in journal Révolution Internationale n°87 (juillet 1981)
Sur l'enfermement national et l'isolement par secteurs :
- Pologne – L'étau national - in journal Révolution Internationale n°90 (octobre 1981)
- Pologne – la bourgeoisie est forte de l'isolement des ouvriers - in journal Révolution Internationale n°91 (novembre 1981)
Sur les manœuvres bourgeoises autour d'une opposition de gauche :
- "KOR : une 'opposition' au service du capital polonais" [147]- in journal Révolution Internationale n°77 (septembre 1980)
7. L'intervention du CCI dans la lutte
Au feu même des événements, le CCI a diffusé 3 tracts internationaux, dont 2 traduits en polonais :
- Le premier, édité le 6 septembre 1980, décrit la situation de lutte massive de l'été 1980, mettant en avant la force du mouvement (généralisation et auto-organisation), dénonçant le syndicalisme et montrant que les prolétaires n'ont pas de patrie. Ce tract a été diffusé internationalement, dans une dizaine de pays, partout où le CCI le pouvait.
- Le second tract, édité le 10 mars 1981, traduit en polonais et diffusé en Pologne avec les faibles moyens du bord[6]. Il dénonce la prétendue nature 'socialiste' de pays de l'Est, met en avant l'internationalisme, dénonce les agissements des bourgeoisies et des syndicats. Ce tract a été largement diffusé internationalement.
- Le troisième tract a quant à lui été édité au lendemain de la déclaration de l'état de guerre (13 décembre 1981). Il dénonce la répression féroce, apporte sa solidarité aux ouvriers polonais et met en avant la nécessité de solidarité ouvrière à l'international, en dénonçant toutes les impasses et voies de garages mises en avant par les bourgeoisies de tout bord. Outre sa diffusion internationale massive, ce tract ayant été traduit en polonais, les camarades ont pu le diffuser à Paris et New-York auprès de la communauté polonaise et à New-York auprès de marins polonais en escale.
Notre organisation a aussi mené le combat en publiant de nombreux articles dénonçant les pièges tendus (principalement le sabotage syndicat et l'isolement), en appelant à la solidarité et en faisant vivre les leçons de la grève de masse et en polémiquant avec d'autres groupes révolutionnaires :
Les tracts du CCI :
- Pologne : à l'Est commission à l'Ouest, un même lutte ouvrière contre l'exploitation capitaliste ! [148] - Tract international du CCI (6/09/1980)
- Aux ouvriers de Pologne !" - Tract international du CCI (10/03/1981) –traduit également en polonais
- Pologne : une seule solidarité – Le développement international des luttes ouvrières [149]" - Tract international du CCI (18/12/1981) – traduit également en polonais
Sur le rôle des révolutionnaires :
- ·À la lumière des évènements en Pologne, le rôle des révolutionnaires [150] -in Revue Internationale n°24 (1e trimestre 1981)
Sur la propagande gauchiste :
- Les faux-amis des ouvriers -in journal Révolution Internationale n°77 (septembre 1980)
- Contre les mensonges trotskystes – En Pologne aussi, il faut détruire le capitalisme - in journal Révolution Internationale n° 79 (novembre 1980)
- À propos des réunions sur les pays de l'Est – Quelle solidarité ? - in journal Révolution Internationale n°82 (février 1981)
Sur l'appel à la solidarité et à faire vivre les leçons de la lutte :
- Grèves en Pologne capitaliste – Généralisons le 'mauvais exemple' des ouvriers polonais ! - in journal Révolution Internationale n° 77 (septembre 1980)
- La lutte des ouvriers polonais est notre lutte ! - in journal Révolution Internationale n°83 (mars 1981)
- À l'Est et à l'ouest – Contre une même crise, un même combat de classe - in journal Révolution Internationale n°85 (mai 1981)
- Plus aucune lutte ouvrière ne doit rester isolée - in journal Révolution Internationale n°93 (janvier 1982)
Sur la dénonciation de l'isolement national :
- Pologne : la nécessité de la lutte dans les autres pays - in journal Révolution Internationale n°89 (septembre 1981)
- Pologne – Seule la lutte internationale du prolétariat peut retenir le bras de la répression - in journal Révolution Internationale n°81 (janvier 1981)
Sur les convergences et divergences avec les groupes du milieu politique prolétarien :
Polémique – Les révolutionnaires et la lutte de classe en Pologne - in journal Révolution Internationale n°80 (décembre 1980)
À propos de quelques tracts sur la situation en Pologne - in journal Révolution Internationale n°102 (octobre 1982)
[1] L'ensemble des citations sont issues de l'article : Pologne (août 1980): Il y a 40 ans, le prolétariat mondial refaisait l’expérience de la grève de masse [151] - in journal Révolution Internationale n°483 (juillet-août 2020)
[2] Le prolétariat d'Europe occidentale au centre de la généralisation de la lutte de classe [152] - in Revue Internationale n°31 (4°trimestre 1984).
[3] Introduction au recueil de textes Sur la Pologne.
[4] Introduction au recueil de textes Sur la Pologne
[5] Grève de masse - in journal Révolution Internationale n°81 (janvier 1981)
[6] Une délégation du CCI s'était à une autre occasion rendue en Pologne. Ses conclusions, suite à des discussions sur place, mettaient en évidence un niveau très d'important d'illusions au sein du prolétariat dans ce pays participant à créer des difficultés considérables pour faire face à la situation à laquelle il était confronté. Et cela alors que le milieu prolétarien à l'Ouest surestimait largement les possibilités, notamment la CWO avec son "Revolution now!".
Evènements historiques:
- Pologne 1980 [153]
Rubrique:
ICConline - août 2020
- 56 lectures
Les groupes de la Gauche Communiste face au mouvement Black Lives Matter : une incapacité à identifier le terrain de la classe ouvrière
- 276 lectures
Le but de cette polémique est de susciter un débat au sein du milieu politique prolétarien. Nous espérons que les critiques que nous adressons aux autres groupes donneront lieu à des réponses, car la Gauche Communiste ne peut qu’être renforcée par une confrontation ouverte de nos divergences.
Face à des bouleversements sociaux majeurs, le premier devoir des communistes est de défendre leurs principes avec la plus grande clarté, en offrant aux ouvriers les moyens de comprendre où résident leurs intérêts de classe. Les groupes de la Gauche Communiste se sont surtout distingués par leur fidélité à l'internationalisme lors des guerres entre les cliques, alliances et États bourgeois. Malgré des différences d'analyse sur la période historique dans laquelle nous vivons, les groupes existants de la Gauche Communiste - le CCI, la TCI (Tendance Communiste Internationaliste), les différentes organisations bordiguistes - ont globalement su dénoncer toutes les guerres entre les États comme étant impérialistes et appeler la classe ouvrière à refuser tout soutien à leurs protagonistes. Cela les distingue très nettement des pseudo-révolutionnaires comme les trotskistes, qui appliquent invariablement une version totalement falsifiée du marxisme pour justifier le soutien à telle ou telle faction bourgeoise.
La tâche de défendre les intérêts de la classe prolétarienne se pose bien sûr aussi lors de l’éruption de conflits sociaux majeurs - non seulement des mouvements qui sont clairement des expressions de la lutte prolétarienne, mais aussi d'importantes mobilisations qui impliquent un grand nombre de personnes manifestant dans la rue et qui souvent s'opposent aux forces de l'ordre bourgeois. Dans ce dernier cas, la présence d'ouvriers dans de tels mouvements, et même de revendications en lien avec les besoins de la classe ouvrière, peut rendre très difficile une analyse lucide de leur nature de classe. Tous ces éléments étaient présents, par exemple, lors du mouvement des “gilets jaunes” en France, et certains (comme le groupe Guerre de Classe) ont conclu qu'il s'agissait d'une nouvelle forme de la lutte de classe prolétarienne[1]. En revanche, nombre de groupes de la Gauche Communiste ont pu constater qu'il s'agissait d'un mouvement interclassiste, auquel les travailleurs participaient essentiellement en tant qu'individus derrière les slogans de la petite-bourgeoisie et même derrière des revendications et des symboles ouvertement bourgeois (démocratie citoyenne, drapeau tricolore, racisme anti-immigrés, etc.)[2]. Cela ne signifie pas que leurs analyses ne comportaient pas des points de confusion considérables. Le souhait de voir, malgré tout, un certain potentiel de la classe ouvrière dans un mouvement qui avait manifestement commencé puis continué sur un terrain réactionnaire pouvait encore être discerné chez certains groupes, comme nous le verrons ultérieurement.
Les manifestations de Black Lives Matter (BLM) posent un défi encore plus grand aux groupes révolutionnaires : il est indéniable qu'elles sont nées d'une authentique vague de colère face à une expression particulièrement écœurante de la brutalité et du racisme de la police. De plus, la colère ne se restreignait pas à la population noire et elle dépassait largement les frontières des États-Unis. Mais les accès de colère, d'indignation et d'opposition au racisme ne mènent pas automatiquement à la lutte de classe. En l'absence d'une véritable alternative prolétarienne, elles peuvent facilement être instrumentalisées par la bourgeoisie et son État. À notre avis, cela a été le cas avec les manifestations actuelles du BLM. Les communistes sont donc confrontés à la nécessité de montrer exactement comment toute une panoplie de forces bourgeoises – depuis le BLM sur le terrain au Parti démocrate aux États-Unis, en passant par certaines branches de l’industrie, les chefs de l'armée et de la police également - a dès le premier jour été présente afin de prendre en charge la colère légitime et l'utiliser pour ses propres intérêts.
Comment les communistes ont-ils réagi ? Nous ne traiterons pas ici de ces anarchistes qui pensent que les actes de vandalisme mesquin des Black Blocs dans le cadre de telles manifestations sont une expression de la violence de classe, ni des “communisateurs” qui pensent que le pillage est une forme de "shopping prolétarien", ou un coup porté à la forme marchandise. Nous pourrons revenir sur ces arguments dans de prochains articles. Nous nous limiterons aux déclarations faites par les groupes de la Gauche Communiste dans le sillage des premières émeutes et manifestations qui ont suivi l'assassinat de George Floyd par la police à Minneapolis.
Trois de ces groupes appartiennent au courant bordiguiste et ont chacun pour nom « Parti Communiste International ». Nous les différencierons donc grâce à leurs publications : Il comunista / Le Prolétaire ; Il Partito Comunista ; Il Programma Comunista / Cahiers Internationalistes. Le quatrième groupe est la Tendance Communiste Internationaliste (TCI).
Le mouvement Black Lives Matter est-il prolétarien ?
Toutes les prises de position émises par ces groupes contiennent des éléments avec lesquels nous pouvons être d'accord : par exemple, la dénonciation intransigeante de la violence policière, le fait de reconnaître qu’une telle violence, comme le racisme en général, est le produit du capitalisme et qu'elle ne pourra disparaître que par la destruction de ce mode de production. La prise de position du Prolétaire est très claire à ce sujet :
- “Pour éliminer le racisme, qui a ses racines dans la structure économique et sociale de la société bourgeoise, il est nécessaire d’éliminer le mode de production sur lequel il se développe, en commençant non par la culture et la « conscience », qui ne sont que des reflets de la structure économique et sociale capitaliste, mais par la lutte de classe prolétarienne dans laquelle l’élément décisif est constitué par la condition commune de salariés, quelle que soit sa couleur de peau, sa race ou son pays d’origine. La seule façon de vaincre toute forme de racisme est la lutte contre la classe dominante bourgeoise, quelle que soit sa couleur de peau, sa race ou son pays d’origine, parce qu’elle est la bénéficiaire de toutes les oppressions, de tous les racismes, de tous les esclavages.” [3]
Les slogans d'Il Partito sont sur la même ligne : “Ouvriers ! Votre seule défense est dans l'organisation et dans la lutte en tant que classe. La réponse au racisme est la révolution communiste ! ” [4]
Cependant, quand vient la question la plus difficile pour les révolutionnaires, tous ces groupes commettent, dans une mesure plus ou moins grande, la même erreur fondamentale : pour eux, les émeutes qui ont suivi le meurtre et les manifestations de Black Lives Matter s'inscrivent dans le mouvement de la classe ouvrière. Cahiers Internationalistes écrit :
- “Aujourd’hui les prolétaires américains sont contraints à répondre par la force aux abus des flics, et ils font bien de répondre coup sur coup aux agressions, comme ils font bien de répondre à la canaille du ‘suprématisme blanc’, démontrant dans la pratique de la défense commune que le prolétariat est une seule classe : qui touche un prolétaire les touche tous. ”[5]
Il Partito :
- “La gravité des crimes commis par les représentants de l'État bourgeois au cours des dernières semaines et la réaction vigoureuse du prolétariat à ces crimes incitent certainement à la recherche de comparaisons historiques. Les manifestations et les émeutes qui ont suivi l'assassinat de Martin Luther King, Jr. en 1968 viennent immédiatement à l'esprit, tout comme celles qui ont suivi l'acquittement des policiers qui avaient battu Rodney King en 1992.”
La TCI :
- “Les événements de Minneapolis sont une résurgence du même problème historique et systémique. En plus de subir un taux de chômage deux fois plus élevé que celui de leurs contemporains blancs (un chiffre consistant depuis les années 1950), le prolétariat noir reste disproportionnellement affecté par la violence policière, sans réel signe de frein au nombre de victimes. Malgré tout, la classe ouvrière s’est montrée une fois de plus combative en ces funestes moments. Les travailleur(euse)s noir(e)s aux États-Unis, et le reste du prolétariat en solidarité avec eux, ont pris la rue et ont résisté face à la répression étatique. Rien n’a changé. En 1965 comme en 2020, la police tue, et la classe ouvrière y répond en défiant l’ordre social infâme pour lequel ils assassinent. La lutte continue. ” [6]
Bien entendu, tous les groupes ajoutent que le mouvement « ne va pas assez loin » :
Cahiers Internationalistes :
- “Mais ces rébellions (que les moyens de communication de masse, organes d’expression de la bourgeoisie, s’obstinent à réduire à des ‘protestations contre le racisme et les inégalités’, condamnant ainsi toute forme qui outrepasse les plaintes et gémissements des pauvres diables) doivent permettre aux prolétaires du monde entier de se souvenir que le nœud à trancher est celui du pouvoir : se révolter, brûler des postes de police, reprendre les marchandises de magasins et l’argent des offices de prêt sur gage ne suffisent pas. ”
Il Partito :
- “Le mouvement antiraciste actuel commet une grave erreur lorsqu'il prend ses distances par rapport à la base de classe en matière de racisme, en poursuivant son action politique uniquement sur des bases raciales dans l'espoir de faire appel à l'État bourgeois. Il est loin d'avoir ouvertement reconnu le rôle des forces de l'ordre et de l'armée dans le maintien de l'État capitaliste et la domination politique de la bourgeoisie. Pour les gens de couleur, et pour le prolétariat dans son ensemble, la solution réside dans la conquête du pouvoir politique loin de l'État, et non dans l'appel à celui-ci.”
La TCI :
- “Bien que nous sommes enthousiasmés de voir des prolétaires mettre en échec les flics, ce genre d’émeutes a tendance à faner après une semaine, avec ensuite un brutal retour à l’ordre et un renforcement des structures oppressives. ”
Critiquer un mouvement parce qu'il ne va pas assez loin n'a de sens que s'il va d’abord dans la bonne direction. En d'autres termes, cela s'applique aux mouvements qui se trouvent sur un terrain de classe. De notre point de vue, ce n'était pas le cas avec les manifestations concernant l'assassinat de George Floyd.
Qu'est ce que le “terrain de la classe ouvrière" ?
Il ne fait aucun doute que nombre de participants aux manifestations, qu'ils soient noirs, blancs ou "autres", étaient et sont des ouvriers. Tout comme il ne fait également aucun doute qu'ils étaient et sont, à juste titre, indignés par le racisme vicieux des flics. Mais cela ne suffit pas à conférer un caractère prolétarien à ces manifestations.
Ce constat est valable, que les protestations aient pris la forme d'émeutes ou bien de marches pacifistes. L'émeute n'est pas une méthode de lutte prolétarienne, qui revêt nécessairement une forme organisée et collective. Une émeute - et par dessus tout, le pillage - est une réponse désorganisée d'une masse d'individus distincts, une pure expression de rage et de désespoir qui expose non seulement les pilleurs eux-mêmes, mais aussi tous ceux qui participent aux manifestations de rue, à une répression accrue par des forces de police militarisées bien mieux organisées qu'eux.
De nombreux manifestants ont constaté la futilité des émeutes, qui étaient souvent délibérément provoquées par les agressions bestiales de la police et laissaient libre cours à d’autres provocations de la part d'éléments louches parmi la foule. Mais l'alternative préconisée par BLM, immédiatement reprise par les médias et l'appareil politique existant, particulièrement le Parti démocrate, a été l'organisation de marches pacifiques ayant de vagues revendications de “justice” et “d'égalité” , ou bien des plus spécifiques comme celle de “cesser de financer la police ”. Ce sont toutes des revendications politiques bourgeoises.
Bien sûr, un véritable mouvement prolétarien peut contenir toutes sortes de revendications confuses, mais il est avant tout motivé par la nécessité de défendre les intérêts matériels de la classe et est donc le plus souvent axé - dans un premier temps - sur des revendications économiques visant à atténuer l'impact de l'exploitation capitaliste. Comme Rosa Luxemburg l'a montré dans son pamphlet sur la grève de masse, écrit après les luttes prolétariennes de 1905 qui ont fait date en Russie, il peut en effet y avoir une interaction constante entre les revendications économiques et politiques, et la lutte contre la répression policière peut effectivement faire partie de cette dernière. Mais il y a une grande différence entre un mouvement de la classe ouvrière qui exige, par exemple, le retrait de la police d'un lieu de travail ou la libération des grévistes emprisonnés, et un déferlement général de colère qui n'a aucun lien avec la résistance des ouvriers en tant qu'ouvriers et qui est immédiatement pris en main par les forces politiques “d’opposition” de la classe dirigeante.
Plus important encore : le fait que ces contestations portent avant tout sur la question de la race signifie qu'elles ne peuvent servir de moyen d'unification de la classe ouvrière. Indépendamment du fait que les manifestations dès le début étaient rejointes par de nombreuses personnes blanches, notamment des ouvriers ou des étudiants, la majorité d'entre eux étant des jeunes, les manifestations sont présentées par BLM et les autres organisateurs comme un mouvement de personnes noires que d'autres peuvent soutenir si elles le souhaitent. Tandis qu'une lutte de la classe ouvrière a un besoin organique de surmonter toutes les divisions, qu'elles soient raciales, sexuelles ou nationales, faute de quoi elle sera défaite. Nous pouvons à nouveau citer des exemples où la classe ouvrière s'est mobilisée contre les attaques racistes en utilisant ses propres méthodes : en Russie, en 1905, conscients que les pogroms contre les Juifs étaient utilisés par le régime en place pour saper le mouvement révolutionnaire dans son ensemble, les soviets ont posté des gardes armés pour défendre les quartiers juifs contre les pogromistes. Même lors d'une période de défaite et de guerre impérialiste, cette expérience n'a pas été perdue : en 1941, les dockers de la Hollande occupée se sont mis en grève contre la déportation des Juifs.
Ce n'est pas un hasard si les principales factions de la classe dirigeante ont été si empressées de s'identifier aux manifestations de BLM. Lorsque la pandémie de Covid-19 a commencé à frapper l'Amérique, nous avons été témoins de nombreuses réactions de la classe ouvrière face à l'irresponsabilité criminelle de la bourgeoisie, face à ses manœuvres pour contraindre des secteurs entiers de la classe à aller travailler sans mesures de sécurité et équipements adéquats. Il s'agissait alors d'une réaction mondiale de la classe ouvrière[7]. Et s'il est vrai que, derrière les protestations déclenchées par le meurtre de George Floyd, une des raisons de cette colère était le nombre disproportionné de victimes noires du virus, c'est avant tout le résultat de la position des Noirs et des autres minorités dans les couches les plus pauvres de la classe ouvrière - en d'autres termes, de leur position de classe dans la société. L'impact de la pandémie de Covid-19 offre la possibilité de mettre en évidence le caractère central de la question de classe, et la bourgeoisie ne s'est montrée que trop disposée à la reléguer au second plan.
Le rôle des révolutionnaires
Lorsqu'ils sont confrontés au développement d'un mouvement de la classe ouvrière, les révolutionnaires peuvent en effet intervenir dans la perspective d'appeler celle-ci à “aller plus loin” (par le développement de formes autonomes d'auto-organisation, l'extension à d'autres secteurs de la classe, etc). Mais qu'en est-il si de nombreuses personnes sont mobilisées sur un terrain interclassiste ou bourgeois ? Dans ce cas, il faut encore intervenir, mais les révolutionnaires doivent alors accepter le fait que leur intervention se fera “à contre-courant”, principalement dans le but d'influencer les minorités qui remettent en cause les objectifs et méthodes fondamentaux du mouvement.
Les groupes bordiguistes, étonnamment peut-être, n'ont pas beaucoup parlé du rôle du parti par rapport à ces événements, bien que Cahiers Internationalistes ait raison - dans l’abstrait - lorsqu'il écrit que :
- “la révolution est une nécessité qui demande organisation, programme, idées claires et pratique du travail collectif : en termes simples et précis, la révolution a besoin d’un parti qui la dirige.”
Le problème reste entier : comment un tel parti peut-il voir le jour ? Comment passer du milieu dispersé actuel de petits groupes communistes à un véritable parti, un organe international capable de fournir une direction politique à la lutte de classe ?
Cette question reste sans réponse pour Cahiers Internationalistes, qui révèle alors la profondeur de son incompréhension du rôle du parti :
- “Le prolétariat en lutte, le prolétariat révolté doit s’organiser avec et dans le parti communiste !”
Le simple fait de déclarer que votre groupe est Le Parti ne suffit pas, surtout lorsqu'il y a au moins deux autres groupes qui prétendent chacun être le véritable Parti Communiste International. Il n'est pas non plus logique d'affirmer que l'ensemble du prolétariat peut s'organiser “dans le parti communiste”. De telles formulations expriment une incompréhension totale de la distinction entre l'organisation politique révolutionnaire - qui nécessairement ne regroupe qu'une minorité de la classe - et les organes regroupant l’ensemble de la classe tels que les conseils ouvriers. Tous deux sont des instruments essentiels de la révolution prolétarienne. Sur ce point, Il Partito est au moins plus conscient que la voie vers la révolution passe par l'émergence d’organes indépendants regroupant l’ensemble de la classe puisqu'il appelle à des assemblées ouvrières, même s'il affaiblit son argumentation en les appelant “sur chaque lieu de travail et au sein de chaque syndicat existant” - comme si de véritables assemblées ouvrières n'étaient pas essentiellement antagonistes à la forme même du syndicat. Mais Il Partito omet de faire une observation plus cruciale encore : il n’y a pas eu la moindre tendance au développement de véritables assemblées ouvrières au sein des manifestations BLM.
La TCI refuse de s'autoproclamer Le Parti. Elle dit qu’elle est pour le parti mais qu'elle n'est pas le parti[8]. Cependant, elle n'a jamais fait de critique réellement profonde des erreurs qui sont à la base du substitutionnisme bordiguiste - l'erreur, commise en 1943-45, de déclarer la formation du Parti Communiste Internationaliste dans un seul pays, l'Italie, dans les profondeurs de la contre-révolution. Tant les bordiguistes que la TCI trouvent leur origine dans le PCInt de 1943, et tous deux théorisent cette même erreur à leur manière : les bordiguistes avec la distinction métaphysique entre le parti « historique » et le parti « formel », la TCI avec son idée de “besoin permanent du parti”. Ces conceptions dissocient la tendance à l'émergence du parti à partir du mouvement réel de la classe et le rapport de forces effectif entre la bourgeoisie et le prolétariat. Toutes deux impliquent l'abandon de la distinction vitale faite par la Gauche Communiste italienne entre fraction et parti, qui visait à montrer précisément que le parti ne peut pas exister à n'importe quel moment, et donc à définir le rôle réel de l'organisation révolutionnaire lorsque la formation immédiate du parti n'est pas encore à l'ordre du jour.
La dernière partie du tract de la TCI met clairement en évidence cette incompréhension.
Le sous-titre de cette section du tract donne le ton : “7. La rébellion urbaine doit se convertir en révolution internationale ”.
Et cela continue :
- “Bien que nous sommes enthousiasmés de voir des prolétaires mettre en échec les flics, ce genre d’émeutes a tendance à faner après une semaine, avec ensuite un brutal retour à l’ordre et un renforcement des structures oppressives. Pour que le pouvoir des capitalistes et de leurs mercenaires soit concrètement défié et aboli, il nous faut un parti révolutionnaire international. Ce parti serait un outil indispensable dans les mains de la classe ouvrière pour s’organiser et diriger sa hargne non seulement vers la destruction de l’État raciste, mais aussi vers l’édification du pouvoir ouvrier et du communisme”.
Ce seul paragraphe contient tout un recueil d'erreurs, et ce dès le sous-titre : la révolte actuelle peut avancer en ligne droite vers la révolution mondiale, mais pour cela, il faut le parti mondial ; ce parti sera le moyen d'organisation et l'instrument pour transformer le plomb en or, les mouvements non-prolétariens en révolutions prolétariennes. Ce passage révèle à quel point la TCI voit le parti comme une sorte de deus ex machina, une puissance qui vient d'on ne sait où, non seulement pour permettre à la classe de s'organiser et de détruire l'État capitaliste, mais qui a la capacité plus surnaturelle encore de transformer les émeutes, ou les manifestations tombées aux mains de la bourgeoisie, en pas de géant vers la révolution.
Cette erreur n'est pas nouvelle. Par le passé, nous avions déjà critiqué l'illusion du PCInt en 1943-45 selon laquelle les groupes de partisans en Italie - entièrement alignés sur les Alliés dans la guerre impérialiste – pouvaient d'une manière ou d'une autre être ralliés à la révolution prolétarienne par la présence du PCInt dans leurs rangs[9]. Nous l'avons encore vu en 1989, lorsque Battaglia Comunista a non seulement pris le coup d'État des forces de sécurité qui a évincé Ceausescu en Roumanie pour une “insurrection populaire” mais aussi fait valoir qu'il ne manquait que le parti pour mener cette dernière sur la voie de la révolution prolétarienne[10].
Le même problème est apparu l'an dernier avec les “ gilets jaunes”. Quand bien même la TCI décrit le mouvement comme étant “interclassiste ”, elle nous raconte que :
- “Un autre organe est nécessaire. C'est un instrument qui permet d'unifier l'effervescence de classe, lui permettant de faire un saut qualitatif, c'est-à-dire politique, de lui donner une stratégie, et des tactiques anticapitalistes, pour orienter les énergies émanant du conflit de classe vers un assaut du système bourgeois ; il n'y a pas d'autre voie. En bref, la présence active du parti communiste, international et internationaliste est nécessaire. Sinon, la rage du prolétariat et de la petite-bourgeoisie déclassée sera écrasée et dispersée ; soit brutalement, si nécessaire, soit avec de fausses promesses”.[11]
Là encore, le parti est invoqué comme la panacée, une pierre philosophale anhistorique. Ce qui manque à ce scénario, c'est le développement du mouvement de classe dans son ensemble, la nécessité pour la classe ouvrière de retrouver la sensation de sa propre existence en tant que classe, et de renverser l'équilibre des forces existant par des luttes massives. L'expérience historique a montré que non seulement de tels changements historiques sont nécessaires pour permettre aux minorités communistes existantes de développer une réelle influence au sein de la classe ouvrière : mais ils sont également le seul point de départ possible pour transformer le caractère de classe des révoltes sociales et offrir une perspective à l'ensemble de la population opprimée par le capital. Un exemple frappant a été l'entrée massive des travailleurs de France dans les luttes de mai-juin 1968 : en lançant un énorme mouvement de grève en réponse à la répression policière exercée sur les manifestations étudiantes, la classe ouvrière a également changé la nature des manifestations, les intégrant dans un réveil général du prolétariat mondial.
Aujourd'hui, la possibilité de telles transformations semble lointaine, et en l'absence d'une sensation répandue d'identité de classe, la bourgeoisie a plus ou moins les coudées franches pour récupérer l'indignation provoquée par le déclin avancé de son système. Mais nous avons vu des signes, petits mais significatifs, d'un nouvel état d'esprit dans la classe ouvrière, d'une nouvelle sensation d'elle-même en tant que classe, et les révolutionnaires ont le devoir de cultiver ces jeunes pousses au mieux de leurs capacités. Mais cela signifie résister à la pression ambiante qui pousse à s'incliner devant les appels hypocrites de la bourgeoisie en faveur de la justice, de l'égalité et de la démocratie à l'intérieur des frontières de la société capitaliste.
Amos, Juillet 2020
[1] Le groupe semble être un genre de fusion entre l'anarchisme et le bordiguisme, plutôt dans le style du Groupe Communiste Internationaliste, mais sans ses pratiques les plus douteuses (menaces contre des groupes de la Gauche Communiste, un soutien à peine voilé aux actions des cliques nationalistes et islamistes, etc.).
[2] Voir sur notre site “Prise de position dans le camp révolutionnaire : Gilets jaunes : la nécessité de “réarmer“ le prolétariat [154]”.
[3] Voir l’article du Prolétaire n° 537, “Etats-Unis : Révoltes urbaines après le meurtre par la police de Minneapolis de l’Afro-américain George Floyd [155]”
[4] Voir l’article en anglais d'Il Partito, “Racism Protects the Capitalist System, Only the Working Class can Eradicate it [156]” (juin 2020)
[5] Voir l’article de Cahiers Internationalistes, “Après Minneapolis. Que la révolte des prolétaires américains soit un exemple pour les prolétaires de toutes les métropoles [157]” (28/05/2020)
[6] Voir l’article de la TCI, “Minneapolis : brutalité policière et lutte des classes [158]” (31/05/2020)
[7] Voir sur notre site l'article “Covid-19: Malgré tous les obstacles, la lutte de classe forge son futur [81]” dont voici un extrait : “Peut-être le plus important de tous, notamment parce qu’il remet en question l’image d’une classe ouvrière américaine qui s’est ralliée sans critique à la démagogie de Donald Trump, il y a eu des luttes généralisées aux États-Unis : grèves chez FIAT-Chrysler des usines de Tripton dans l’Indiana, dans l’usine de production de camions Warren dans la périphérie de Détroit, chez les chauffeurs de bus à Detroit et à Birmingham (en Alabama), dans les ports, les restaurants, dans la distribution alimentaire, dans le secteur du nettoyage et celui de la construction ; des grèves ont eu lieu chez Amazon (qui a également été touché par des grèves dans plusieurs autres pays), Whole Foods, Instacart, Walmart, FedEx, etc.”
[8] Même si, comme nous l’avons souvent signalé, la clarté sur ce point n’est pas facilitée par le fait que son affilié italien (qui publie Battaglia Comunista) tient toujours absolument à porter le nom de Parti Communiste Internationaliste.
[9] Voir sur notre site l’article “Les ambiguïtés sur les ‘partisans’ dans la constitution du Parti Communiste Internationaliste en Italie [159]”, Revue Internationale n°8
[10] Voir sur notre site nos articles “Polémique : Le vent d'est et la réponse des révolutionnaires [160]”, Revue Internationale n°61 et "Polémique : Face aux bouleversements à l'Est, une avant-garde en retard [161]", Revue Internationale n°62.
[11] Voir l’article en anglais sur le site de la TCI : “Some Further Thoughts on the Yellow Vests Movement [162]” (08/01/2019).
Courants politiques:
- Gauche Communiste [163]
Rubrique:
ICConline - septembre 2020
- 56 lectures
Dans le capitalisme, le virus de l’impérialisme et du militarisme ne peut être éradiqué
- 133 lectures
Sur le plan des tensions impérialistes, le début de l’année 2020 avait été caractérisé par une multiplication des conflits entre brigands de premier, deuxième et troisième ordre, qui avait illustré l’intensification du chacun pour soi dans la lutte entre puissances impérialistes et provoqué une extension de la barbarie guerrière et du chaos. Ainsi,
- le déclin du leadership US, en particulier au Moyen-Orient, engendrait des confrontations tous azimuts et le démembrement de pays entiers, tels l’Irak, la Syrie ou le Yémen ;
- le conflit économique et stratégique entre les USA et la Chine tendait vers une polarisation croissante des tensions entre ces deux puissances ;
- le comportement perturbateur et provocateur de la Russie, mais aussi de la Turquie et de l’Iran, devenait un facteur d’instabilité de plus en plus fort dans les rapports impérialistes ;
- les décisions imprédictibles du président populiste Trump, sa remise en question des alliances traditionnelles et son flirt plus ou moins ouvert avec le Kremlin, contribuaient à l’imprévisibilité des rapports entre puissances et accentuaient les tensions au sein de la bourgeoisie US sur la meilleure stratégie à suivre pour sauvegarder ses intérêts.
Ensuite, la pandémie survint. L’ampleur des infections et des décès dans les zones de conflits, tel le Moyen-Orient par exemple (deux millions d’infections et près de 60.000 morts officiels, dont 400.000 cas positifs et 25.000 morts en Iran), et les dangers d’infections dans les armées (cf. les équipages de navires de guerre US et français mis en quarantaine) appelaient à la circonspection. Aussi, l’intensité des opérations militaires s’étaient, dans un premier temps du moins, apparemment réduite et une trêve avait même été proclamée en Syrie et au Yémen. Cependant, dès le début de la pandémie, les tentatives initiales de la Chine de camoufler l’expansion du virus, la désignation du Covid-19 par Trump de « virus chinois », les refus de nombreux pays de « partager » leurs stocks de matériel sanitaire avec leurs voisins, ou encore les tentatives de Trump de réserver les premiers vaccins pour un usage exclusif aux USA indiquaient déjà que la pandémie n’allait pas mitiger les tensions impérialistes, bien au contraire. D’ailleurs, une série d’informations qui ont filtré pendant la période de confinement ces derniers mois ont confirmé que les tensions continuaient de s’accumuler : de « mystérieux actes de sabotage » contre différents bâtiments liés au programme nucléaire iranien, une confrontation entre navires de guerre turcs et des navires de l’OTAN (dont la Turquie fait par ailleurs partie), les premiers empêchant les seconds de contrôler la cargaison de navires se rendant vers le port libyen de Misratah, un clash violent entre soldats indiens et chinois dans le Ladakh, etc.
Dès lors, diverses interrogations légitimes surgissent quant à l’impact de la crise du Covid-19 sur l’évolution des rapports impérialistes.
1. La gestion calamiteuse de la pandémie par Trump et le chaos que cela a engendré ont-ils amené le président populiste à réduire ses initiatives imprédictibles sur le plan de sa politique étrangère ?
La façon chaotique dont Trump a géré la pandémie, ainsi que les conséquences économiques dramatiques pour l’économie US et pour les conditions de vie de prolétaires, confrontés à l'absence de filet de sécurité sociale par rapport au chômage massif et aux coûts des hospitalisations, compromettent lourdement sa réélection, dans la mesure où il entendait fonder sa campagne sur la santé éclatante de l’économie américaine. Or, Trump est prêt à tout pour gagner les élections : saboter et déstabiliser le processus électoral, en semant le doute sur le vote par correspondance ou en dénonçant l’ingérence de toutes sortes de forces visant à manipuler le scrutin, forcer la main des labos pharmaceutiques pour obtenir en premier un vaccin, exercer un chantage contre d’autres pays pour obtenir ce qu'il veut, etc.
Plus spécifiquement, sur le plan intérieur, il n’hésite pas à jeter de l’huile sur le feu des manifs et émeutes qui secouent le pays pour pouvoir se présenter – paradoxe ahurissant- comme le seul rempart contre le chaos. Sur le plan extérieur, il avive systématiquement la guerre commerciale et technologique avec la Chine (Huawei, TikTok) et exploitera n’importe quel incident sur le plan international pour rassembler la population derrière celui qui se présente comme le seul garant de la grandeur américaine.
Cette volonté de jouer le tout pour le tout pour forcer sa réélection ne peut qu’accentuer l’imprédictibilité et la dangerosité de la politique américaine, car, même si la tendance au déclin du leadership US se confirme, le pays a encore de nombreux atouts économiques et financiers, mais surtout sa superpuissance militaire à faire valoir.
2. La Chine est-elle la grande bénéficiaire de la pandémie ?
Tout le contraire est vrai. La crise de Covid 19 entraîne d'énormes problèmes pour la Chine :
- a) sur le plan économique, l'économie chinoise est confrontée à une crise économique grave : des estimations indépendantes parlent de 205 millions de chômeurs (Monde diplomatique, juin 2020, reprenant des sources Hongkongaises), une délocalisation des industries stratégiques par les États-Unis et les pays européens (Allemagne, France, Grande-Bretagne) est en cours, non seulement vers les pays industrialisés mais aussi vers des pays stratégiquement plus sûrs (le Vietnam par exemple) ; enfin, le pays est confronté à des problèmes très sérieux d’approvisionnement alimentaire.
- (b) sur le plan politique, la méfiance envers la Chine s’accroît : ainsi, la tournée en Europe de l’Ouest (Paris, Rome, Berlin, …) du ministre chinois des affaires étrangères Wang Yi dans la deuxième quinzaine d’août a abouti à des résultats décevants : « S’il s’agissait pour la première démographie mondiale et à son diplomate en chef de capitaliser sur cette tournée estivale pour polir quelque peu son image auprès d’un auditoire européen dubitatif (…) et replacer Pékin au cœur d’une dynamique plus européo-compatible, le bénéfice net de cette opération doit décevoir ses promoteurs » (« Chine : Wang Yi en Europe ou l'opération séduction contrariée », Asialyst, 05.09.20).
- (c) sur le plan impérialiste, les positions antichinoises se multiplient en Asie du sud-ouest : les Philippines ont confirmé leur traité d’assistance avec les USA, le Cambodge a refusé l'accès de son port principal à la marine chinoise, l'Indonésie se montre de plus en plus irritée par les provocations chinoises en mer de Chine, un traité d’assistance militaire a été conclu entre l'Inde et l'Australie.
En conséquence, la « nouvelle route de la soie » devient de plus en plus difficile à réaliser, ce qui est dû aux problèmes financiers liés à la crise économique mais aussi à une méfiance croissante de la part de nombreux pays et à la pression antichinoise des États-Unis. Aussi, il ne faut pas s’étonner qu’en 2020, il y a eu un effondrement de la valeur financière des investissements injectés dans le projet « Nouvelle route de la soie » (-64%).
Cette situation délicate doit être comprise dans le cadre des glissements qui ont lieu à Bejing depuis plusieurs années dans les rapports de force au sommet de l’Etat entre les différentes fractions au sein de la bourgeoisie chinoise : le « tournant à gauche », engagé par la fraction derrière le président Xi, a signifié moins de pragmatisme économique et plus d'idéologie nationaliste ; or, « La situation précaire de Pékin sur plusieurs fronts s’explique en partie par cette attitude cavalière du pouvoir central, le grand virage à gauche de Xi depuis 2013 (…) et par les résultats désastreux de la « diplomatie guerrière » menée par les diplomates chinois. Or, depuis la fin de la retraite de Beidaihe –mais aussi un peu avant– on remarque que Pékin et ses diplomates tentent de calmer le jeu et semble vouloir rouvrir le dialogue » (« Chine : à Beidaihe, "l'université d'été" du Parti, les tensions internes à fleur de peau », A. Payette, Asialyst, 06.09.20). En témoigne la déclaration spectaculaire récente de Xi que la Chine veut atteindre la neutralité carbone pour son économie en 2060.
Bref, une certaine instabilité transparaît ici aussi : d’une part, les dirigeants chinois lancent une politique plus nationaliste et agressive envers Hong Kong, Taiwan, l'Inde, la mer de Chine ; d’autre part, les oppositions internes au sein du parti et de l’Etat se manifestent plus nettement. Ainsi il y a « les tensions persistantes entre le premier ministre Li Keqiang et le président Xi Jinping sur la relance économique, tout comme la « nouvelle position » de la Chine sur la scène internationale ». (Chine : à Beidaihe, "l'université d'été" du Parti, les tensions internes à fleur de peau », A. Payette, Asialyst, 06.09.20).
3. Le jeu perturbateur de la Russie, bénéficiaire de la pandémie ?
Le Kremlin a en effet les capacités de jouer au fauteur de troubles sur la scène impérialiste (essentiellement du fait que l'armée russe est toujours considérée comme la deuxième armée la plus puissante du monde) et il l’a encore démontré récemment par ses tentatives particulièrement actives de déstabilisation au Mali et dans les pays du Sahel contre la France. Cependant, l’impact de la pandémie sur la Russie ne peut être sous-estimé, tant sur le plan économique que social. Ses revenus pétroliers et gaziers sont en forte baisse et son industrie se porte mal. Des milliers de salariés se sont réunis pour manifester contre les pertes d’emplois. Or, les succès économiques étaient le moteur de la popularité de Poutine et celle-ci atteint aujourd’hui des niveaux historiquement bas : 59% dans l’ensemble de la population et 12% seulement chez les moins de 25 ans.
La crise du Covid met plus clairement que jamais en lumière que, si la Russie est un facteur puissant de déstabilisation dans l’arène impérialiste, elle n'a pas les moyens économiques de consolider ses avancées impérialistes, comme par exemple en Syrie, où elle se voit forcée, pour entamer la reconstruction matérielle du pays (au moins de certaines infrastructures vitales), d’accepter la réintégration de Damas dans la « famille arabe », à travers en particulier la restauration des liens avec les Emirats Arabes Unis et le sultanat d’Oman (cf. « Syrie : retour feutré dans la famille arabe » titre le Monde diplomatique de Juin 2020), faute de fonds propres pour le faire.
De plus, Poutine subit à présent une pression importante sur son glacis immédiat à travers le « mouvement pour la démocratie » en Biélorussie, tandis que l’empoisonnement de l’opposant russe Navalny, recueilli en Allemagne, accentue les menaces de boycott économique par l’Allemagne et en particulier le blocage de la construction du pipeline sous la Baltique reliant la Russie à l’Europe de l’Ouest, ce qui aurait des conséquences catastrophiques pour l’économie russe.
Ces divers éléments illustrent la pression croissante sur la Russie : sa faiblesse structurelle fondamentale lui impose une agressivité perturbatrice croissante, de la Syrie au Mali, de la Libye à l’Ukraine. « La Russie s’accommode parfaitement des « conflits gelés ». Elle en a déjà fait la démonstration en Ukraine, en Géorgie ou en Moldavie. Ce dispositif peu coûteux lui procure une influence déstabilisatrice (…) » (Monde diplomatique, septembre 2020).
4. La pandémie tempère-t-elle l’individualisme et le chacun pour soi des différents impérialismes ?
Plusieurs facettes sont à prendre en considération sur ce plan :
D’abord, les deux impérialismes majeurs, les USA et la Chine, subissent, comme nous l’avons montré ci-dessus, un lourd impact économique et social de la crise du Covid 19 et les fractions dirigeantes dans les deux pays tendent à accentuer face à cela (même si cela va de pair avec de fortes tensions au sein des bourgeoisies respectives) une politique de glorification nationaliste et d’affrontement économique et politique : « l’autosuffisance » de Xi ou le « tout ce qui compte, c’est l’Amérique » de Trump sont les slogans par excellence d’une politique du « chacun pour soi ».
Ensuite, la pandémie et ses conséquences économiques déstabilisent aussi divers acteurs impérialistes locaux importants et les poussent vers un jusqu’auboutisme impérialiste. En Inde, le gouvernement du populiste Modi cherche à détourner l’attention de sa politique de santé et de sa gestion de la crise défaillantes en aiguisant les tensions avec la Chine ou en accentuant sa politique antimusulmane ; Israël, confronté à d'importantes manifestations contre la politique de santé du gouvernement et à un nouveau confinement sanitaire, fait monter la tension avec l’Iran ; l’Iran même, face aux ravages destructeurs de la crise sur les plans sanitaire et économique, n’a d’autre perspective que d’intensifier la barbarie guerrière.
Cette tendance à la fuite en avant dans la confrontation impérialiste est particulièrement marquante aujourd’hui dans le cas de la Turquie. Comme le Monde diplomatique de septembre 2020 le souligne, Erdogan subit de plus en plus une pression économique et politique à l’intérieur même du pays : revers de son parti, l’AKP, lors des dernières élections municipales en mars 2019, où l’opposition a remporté les mairies d’Istanbul et d’Ankara, deux scissions au sein de l’AKP cette année, qui témoignent des dissensions au sein même de la formation présidentielle. Face à cela, il s’est lancé dans une surenchère impérialiste dans le but d’exacerber le nationalisme turc et de rallier la population derrière lui. « Les politiques intérieure et extérieure de la Turquie sont entremêlées. La politique étrangère sert de carburant à la politique intérieure » (Fehim Tastekin, journaliste turc, sur le site Daktilo 1984, 21.06.2020, cité par le Monde diplomatique, septembre 2020).
Après son intervention en Syrie, son engagement direct (armes, mercenaires, soldats d’élite) au côté du gouvernement de Tripoli en Libye et ses revendications unilatérales sur de larges zones de la Méditerranée orientale, riches en gaz et en pétrole, provoquent non seulement une exacerbation des tensions avec la Grèce mais aussi avec la Russie, la France, l’Egypte et Israël. Plus que jamais la Turquie est un vecteur majeur du « chacun pour soi » impérialiste (le principe fondateur de la politique extérieure turque est d’ailleurs depuis des décennies « le Turc n’a d’amis que le Turc » (Monde diplomatique, octobre 2019)).
Un dernier plan à considérer est le fait que la crise du Covid-19 annonce aussi de manière insistante la désagrégation d’alliances qui ont joué un rôle majeur depuis la seconde guerre mondiale.
- L’OTAN est un des vestiges majeurs de la « guerre froide » entre blocs de l’Est et de l’Ouest. Aujourd’hui pourtant, le « consensus stratégique » entre les USA et les pays européens n’existe plus : Trump tend à favoriser en Europe aussi une stratégie s’appuyant sur des alliés totalement assujettis, comme la Pologne associée à la Lituanie et l’Ukraine ; d’autre part, les tensions entre pays membres de l’OTAN s’accentuent, comme entre la Grèce et la Turquie à propos des forages en Méditerranée, mais aussi entre la France et l’Italie qui s’opposent en Libye. La « décomposition » de l’OTAN devient de plus en plus inéluctable.
- la perspective d’une politique étrangère unique de l’UE devient, elle aussi, de plus en plus une illusion. Du Moyen-Orient à l’Afrique du Nord, de la Méditerranée à la Russie, l’Allemagne, la France, l’Italie, voire l’Espagne, mènent chacun de son côté, une politique inspirée par ses propres intérêts impérialistes.
L’incapacité patente du capitalisme en décomposition d’affronter de manière coordonnée la crise pandémique ne peut avoir pour corollaire qu’une accentuation massive de la tendance au chacun pour soi, à la fragmentation et au chaos sur tous les plans. Les données concernant le développement des tensions impérialistes confirment largement cette orientation générale. Pour l’ensemble de la population et pour la classe ouvrière en particulier, c’est plus que jamais la perspective d’une exacerbation de la barbarie guerrière et de massacres sanglants.
25.09.20 / R. Havanais
Evènements historiques:
- 2020: Pandémie Covid-19 [164]
Récent et en cours:
- 2020: Pandémie Covid-19 [165]
Questions théoriques:
- Impérialisme [45]
Rubrique:
Un débat entre révolutionnaires sur la situation sociale au Brésil: danger du fascisme ? Mystification antifasciste - Perspectives sur la lutte des classes
- 103 lectures
La CCI a récemment organisé quelques événements au Brésil impliquant des contacts et des sympathisants de notre organisation sur le sujet, "face à l'alternative fascisme - antifascisme, le prolétariat n'a pas de terrain à choisir". Nous rendons compte des débats et des questions qui ont été soulevés tout en ajoutant quelques commentaires et clarifications a posteriori de notre part.
Le thème de la situation au Brésil a été précédé par des aspects généraux concernant la pandémie du coronavirus que les médias du monde entier ont largement couverte avec une insistance toute particulière sur la situation aux États-Unis et surtout au Brésil, principalement en raison des agissements de Trump et Bolsonaro. Beaucoup plus explicitement que dans d'autres pays, ces personnages répugnants ont exprimé de manière cruelle et flagrante la véritable nature et la préoccupation réelle de la bourgeoisie mondiale face à la crise du coronavirus : sauvegarder à tout prix le profit généré par l'exploitation de la classe ouvrière, en obligeant les travailleurs à rester à leur poste avec un risque élevé de contamination, parfois sans protection. En réalité, la politique des autres fractions de la bourgeoisie mondiale démontre également le danger croissant que constitue le capitalisme mondial pour la survie de l'humanité, étant elles-mêmes dans l'incapacité de faire face à la pandémie de Covid-19, malgré le développement considérable des forces productives. Et si elles donnent tant d'importance au cas Bolsonaro, c'est pour essayer de dissimuler le fait qu'en réalité elles ne sont pas tellement différentes.
Si au-delà du Covid, le prolétariat brésilien doit faire face à la bêtise criminelle de Bolsonaro et à ses odieuses orientations politiques ouvertement antiouvrières et criminelles, qui trouvent un terreau fertile dans la prolifération des sectes, des gangs, le rejet du rationnel, du cohérent, ... il doit également faire face à un ennemi beaucoup plus insidieux et donc encore plus dangereux.
En effet, au nom de l'antifascisme, des forces principalement liées à la gauche ou à l'extrême-gauche du capital entendent se mobiliser contre le "diable fasciste" Bolsonaro. De plus, si le diable existait, il ne serait qu'une expression supplémentaire du capitalisme, aux côtés des autres comme la démocratie bourgeoise. Au fond, ils défendent tous l'ordre existant, le capitalisme, qui entraîne le monde dans une catastrophe fatale pour l'humanité.
Un contact très proche a introduit la discussion
La semaine précédente, nous avons observé une vague de réactions antifascistes sur les réseaux sociaux. De nombreuses personnes ont modifié les photos de leur profil, affichant différentes représentations de la bannière antifasciste. Cette vague a été alimentée par les tensions antérieures, mais semble avoir été déclenchée par une réaction de rejet face aux manifestations du groupe "Les 300 du Brésil" et, surtout, aux vidéos de Bolsonaro "buvant du lait". Les 300, menés par la bolsonariste Sara Winter, ont organisé une petite manifestation à Brasilia en défilant aux flambeaux, dans le style du Ku Klux Klan. Le groupe est accusé d'être une milice ayant pour but déclaré d'exterminer la gauche. D'autre part, l'action de boire du lait est un symbole des suprématistes blancs. Bien sûr, Bolsonaro nie avoir eu cette intention, mais la tension n'est pas dissipée, d'autant plus que cette affaire s'ajoute à celle de l'ancien secrétaire à la culture, Roberto Alvim, qui a prononcé un discours dont le texte paraphrasait Joseph Goebbels. Il semble y avoir de nombreux signes du fait que le gouvernement Bolsonaro flirte avec le fascisme. Face à cela, certaines questions se posent. Le gouvernement actuel est-il fasciste ? Même si ce n'est pas le cas, y a-t-il un risque que la situation évolue dans cette direction ? La progression de l'extrême-droite n'est pas un phénomène typiquement brésilien ! En fait, le phénomène semble être encore plus agressif dans d'autres parties du monde, en particulier en Europe. Depuis l'aggravation de la crise en 2010, certains pays européens sont poussés par une vague nationaliste qui s'est aggravée avec la crise de l'immigration. Au Brésil, l'antifascisme s'est déjà exprimé avec une certaine notoriété lors des dernières élections présidentielles avec le mouvement "Pas lui", lorsque même les groupes de gauche qui faisaient généralement campagne pour le "vote nul"[1] ont participé à la campagne de Haddad[2]. Cependant, contrairement à 2017, les récentes manifestations semblent avoir élargi leur spectre idéologique, impliquant des partis plus à droite. Même Celso de Mello, ministre du STF (Cour suprême de justice), a exprimé son inquiétude lorsqu'il a déclaré que "l'œuf de serpent semble être sur le point d'éclore au Brésil".
Malgré la situation de pandémie, certaines manifestations pour la défense de la démocratie ont lieu dans le pays. Sur Twitter, la substitution massive des photos de profil pour l'effigie de la bannière antifasciste a suscité de longs débats concernant sa signification. Certains staliniens ont critiqué sa massification, y compris son utilisation par des personnes connues pour être des libéraux. Ils ont affirmé que l'antifascisme est en même temps "anticapitaliste", de sorte que n'importe qui ne peut pas se prétendre comme tel. Cependant, cette réaction semble suivre les désirs staliniens de contrôler le mouvement, en essayant de ramener la bannière de l'antifascisme dans son domaine idéologique. En tout cas, la question demeure : l'antifascisme est-il incompatible avec le libéralisme ?
Les manifestations antifascistes provoquent déjà des réactions dans le camp de Bolsonaro. Le 1er juin, le membre du Congrès Daniel Silveira (PSL/RJ) a présenté un projet de loi qui propose un amendement à la loi antiterroriste n° 13.260 du 16 mars 2016, afin de qualifier les groupes antifascistes d'organisations terroristes. Quelques jours plus tard, un groupe néo-nazi de São Paulo a publié sur internet une liste des noms et données de personnes qu'il avait identifiées comme antifascistes. Ces données ont été partagées par les personnes elles-mêmes sur Internet.
Face à la menace de l'avancée de l'extrême-droite, il semble irrésistible de ne pas adhérer à la cause antifasciste, car le fascisme représente la face la plus perverse de l'État. Toutefois, avant d'agir de façon impulsive, nous devons nous livrer à un examen rationnel de la situation. Une face moins perverse signifie-t-elle une perversité moindre du corps de l'État ? Quels sont les résultats pratiques de l'adhésion à l'antifascisme ? La démocratie est-elle un moindre mal ? Est-ce l'opposé radical du fascisme ? Que sont le fascisme et la démocratie ? Pourquoi l'État prend-il parfois des formes politiques dictatoriales, parfois démocratiques ? Comment les communistes doivent-ils se positionner face à ce mouvement ? Comment la classe ouvrière doit-elle se positionner ?
Bien que l'antifascisme soit plus prononcé aujourd'hui qu'il y a 20 ans, ce n'est pas la première fois que des communistes sont séduits par ce drapeau. Dans le passé, lorsque le fascisme s'est manifesté pour la première fois entre les années 1920 et 1930, plusieurs groupes communistes et anarchistes ont rejoint la cause antifasciste. La Quatrième Internationale trotskyste a demandé à ses membres et ses partisans à rejoindre les rangs de la guerre contre l'Axe. Pendant la guerre civile espagnole, les anarchistes et les communistes ont soutenu la République en participant aux élections et en prenant les armes pour freiner l'avancée de l'extrême-droite en Espagne. Quelles sont les leçons historiques de ces expériences ?
D'autre part, tous les révolutionnaires n'ont pas adhéré à l'antifascisme. Bilan critiquait cette adhésion parce qu'il la considérait comme un facteur de confusion pour le prolétariat, en plus de contribuer à son adhésion au nationalisme. En Grèce, l'Union communiste internationaliste a refusé de soutenir les démocraties contre le fascisme pendant la Seconde Guerre mondiale. Quelles étaient ses préoccupations ? Ne considéraient-ils pas le fascisme comme une menace ? Ne l'ont-ils pas combattue ?
Les conditions historiques du fascisme
Comme nous l'avons souligné lors de la réunion, nous sommes d'accord avec cette introduction et la nécessité de fournir une base historique à tout débat politique. Et précisément dans ce sens, nous rappelons quelles analyses au sein du mouvement ouvrier ont participé à l'origine à la mystification antifasciste ultérieure du prolétariat et quelles autres, au contraire, ont jeté les bases d'une défense sans compromis de la lutte de classe contre la bourgeoisie et ses diverses expressions, fascistes ou démocratiques.
L'intransigeance de la Gauche Communiste italienne, qui a en fait dirigé le Parti communiste italien, s'est particulièrement exprimée, et de manière exemplaire, face à la montée du fascisme en Italie après la défaite des combats ouvriers en 1920. Sur le plan pratique, cette intransigeance se manifeste par un refus total de s'allier avec les partis bourgeois (libéraux ou "socialistes") face à la menace fasciste : le prolétariat ne peut combattre le fascisme que sur son propre terrain, la grève économique et l'organisation de milices pour l'autodéfense des travailleurs. Sur le plan théorique, Bordiga a été responsable de la première analyse sérieuse (et toujours valable) du phénomène fasciste, une analyse qu'il a présentée aux délégués du 4e Congrès de l'Internationale communiste en réfutation de l’analyse mise en avant dans ce Congrès :
- Le fascisme n'est pas le produit de la classe moyenne et de la bourgeoisie agraire. C'est la conséquence de la défaite du prolétariat, qui a jeté les couches petites bourgeoises indécises derrière la réaction fasciste.
- Le fascisme n'est pas une réaction féodale. Il est né dans de grandes concentrations industrielles comme Milan et a reçu le soutien de la bourgeoisie industrielle.
- Le fascisme n'est pas opposé à la démocratie. Les forces armées sont un complément indispensable lorsque "l'État ne suffit plus pour défendre le pouvoir de la bourgeoisie".
Y a-t-il un danger de fascisme au Brésil ? La popularité des mouvements "antifascistes" menés par la gauche, ainsi que par la droite démocratique, a été un sujet de préoccupation parmi nos contacts. Comme cela a été souligné, les actions chaotiques de Bolsonaro, très en phase avec les stupidités de Trump, où il apparaît en train de boire du lait, avec une posture clairement raciste, encourageant des groupes qui se disent "fascistes", tout cela alimente la préoccupation de nos contacts, surtout parce que la réaction antifasciste et son discours sont attrayants pour de nombreuses critiques du régime. Alors, est-il possible que le fascisme émerge au Brésil ? Bolsonaro est-il l'un de leurs premiers porte-paroles, comme le prétend le mouvement antifasciste ?
Le débat a débouché sur une conclusion très claire : malgré les actions chaotiques de Bolsonaro - dont certaines sont ouvertement racistes - elles ne sont pas l'expression de la montée du fascisme car le fascisme est le produit de conditions historiques très concrètes qui ne sont pas remplies aujourd'hui. En fait, le fascisme naît à une époque de défaite physique et idéologique de la classe ouvrière, comme dans les années 1930. Le prolétariat italien et allemand en particulier a été totalement écrasé l’un par le fascisme, l’autre d’abord par le parti social-democrate (SPD) au pouvoir puis par le régime nazi, le prolétariat russe par le stalinisme, et le prolétariat d'autres pays industrialisés démocratiques, gouvernés par l'antifascisme. Ce n'est pas seulement grâce au fascisme, mais aussi grâce aux courants de gauche - en particulier son aile trotskyste "critique" - qui ont conduit à la "lutte", d'abord de la classe ouvrière pour la défense du "moindre mal" de la République en Espagne, puis à l'enrôlement de la classe ouvrière dans la Deuxième Guerre mondiale du XXe siècle en défense des démocraties occidentales.
Le débat sur le "moindre mal" a remis en question le faux dualisme "fascisme contre démocratie". Comme on l'a dit, l'antifascisme est donc une impasse qui a des effets pernicieux sur l'unité de classe, car il entretient une série d'éléments, déjà signalés, qui cherchent à miner précisément son unité ; d'une part, faire croire que face au danger du "fascisme", il est nécessaire de s'organiser pour sauver les intérêts d'une nation ; en d'autres termes, il est impératif de défendre la "démocratie" qui est présentée comme "un moindre mal".
Le fascisme est-il le contraire de la démocratie ?
Non. Mussolini et Hitler sont arrivés au pouvoir précisément grâce à la démocratie bourgeoise et à ses institutions parlementaires. La démocratie était la base, la tribune, que le fascisme utilisait pour arriver au pouvoir et mettre en œuvre son projet.
Dans ce cas, l'arrivée démocratique de Trump et surtout de Bolsonaro ne tend-elle pas à prouver la réalité actuelle de ce danger du fascisme ? Nous insistons, les conditions historiques sont différentes de celles dans lesquelles le fascisme est arrivé au pouvoir démocratiquement en Allemagne. Aujourd'hui, le prolétariat n'a pas subi une défaite décisive comme ce fut le cas dans le monde entier avec la défaite de la première vague révolutionnaire mondiale de 1917-23. La confusion réside dans le fait que le capitalisme, dans sa phase actuelle de décomposition, produit des clowns ou des monstres comme Bolsonaro ou Trump, qui expriment de manière caricaturale la tendance au chaos et au déchaînement du chacun pour soi.
Le débat a été très clair à ce sujet. La démocratie n'est pas quelque chose d'opposé au fascisme, qui est une des formes de capitalisme d'État typiques de la période de décadence, correspondant (au début du XXe siècle) à une configuration totalement nouvelle de l'organisation de la bourgeoisie, où l'intervention de l'Etat dans l'économie est renforcée. Aux États-Unis, à cette même époque, à la suite de la crise capitaliste de 1929, le New Deal émerge ; dans une partie de l'Europe, c'est le fascisme ; en Russie, le stalinisme. Le capitalisme mondial, en réponse à la crise son système, cherche la protection de cette forme d'administration qui, d'ailleurs, dans les conditions actuelles de la pandémie mondiale, tend à se renforcer davantage.
Le gouvernement Bolsonaro est-il fasciste ? La nécessité d'une approche historique
Bien qu'il évoque des aspects qui pourraient être associés au fascisme, tels qu'un anticommunisme ouvert ou un discours clairement raciste, l'existence d'un régime fasciste à l'époque actuelle n'est pas viable pour la bourgeoisie. En particulier parce que seule la démocratie est capable de combiner mystifications démocratiques et répression pour faire face à un développement de la lutte des classes contenu dans la situation historique actuelle.
Mais une telle perspective est-elle encore inscrite dans l'avenir ? Elle dépend de l'évolution du rapport de forces entre le prolétariat et la bourgeoisie.
Le prolétariat représente-t-il toujours une force au Brésil ? Et dans le monde entier ?
Certaines interventions ont exprimé un grand pessimisme à cet égard. Certains contacts soulignent qu'il n'existe pas de luttes autonomes au Brésil, que la gauche du capital est populaire - surtout face à la perspective antifasciste, que le discours de défense de la démocratie se renforce, que les idées de la Gauche communiste sont faibles, qu'elles ont peu d'influence au Brésil et en Amérique latine. Un regard fixé sur le seul Brésil et figé sur le présent ne peut que conduire à un tel pessimisme.
La lutte du prolétariat est internationale et sa dynamique l'est aussi. Contrairement à la période des années 1930 dont nous avons parlé dans la réunion, le prolétariat a quitté la période de la contre-révolution en 1968 avec les luttes en France qui ont été le déclencheur d'une dynamique internationale de lutte de classe, laquelle a culminé avec les luttes massives en Pologne en 1980. Malgré les grandes difficultés rencontrées par la lutte des classes depuis les années 1990, le prolétariat n'a pas subi une défaite comme celle qui a mis un terme à la première vague révolutionnaire mondiale. Une illustration de quelques pas faits par le prolétariat sur son terrain de classe : la situation fin 2019 - début 2020 a été marquée par des manifestations de combativité ouvrière au niveau international, notamment en Europe et en Amérique du Nord. En Europe : le mouvement en France contre la réforme des retraites, la grève de la poste et des transports en Finlande. Aux États-Unis : la grève la plus massive chez General Motors de ces cinquante dernières années, et la première aux États-Unis depuis 12 ans, après une période où la mobilisation internationale de la classe ouvrière était faible. La grève massive en janvier 2020 des 30 000 enseignants des écoles publiques de Los Angeles, la deuxième plus grande ville des États-Unis, la première en 30 ans. Il est vrai que les conditions données par la menace persistante de la pandémie constituent un véritable obstacle au développement de la lutte des classes, alors que les attaques économiques contre la classe ouvrière sont sans précédent depuis la Seconde Guerre mondiale. Mais nécessairement - nous ne savons pas encore comment et quand - la classe ouvrière reviendra sur le devant de la scène. Toutes les fractions mondiales du prolétariat sont confrontées à des difficultés, mais pas les mêmes. C'est dans le cœur du capitalisme, où les luttes historiques se sont davantage développées, que les conditions sont les plus favorables, précisément en raison de ces expériences et de cette tradition de lutte. Cependant, toute lutte du prolétariat dans le monde constitue une contribution à la lutte du prolétariat mondial. Ainsi, malgré les grandes difficultés qu'il rencontre actuellement, on ne peut ignorer les luttes passées du prolétariat brésilien. Notamment ses luttes massives en 1979, sa résistance et sa confrontation à la politique anti-ouvrière des gouvernements Lula et Dilma (rappelons-nous la mobilisation des contrôleurs aériens en février 2007 et sa répression par Lula).
Une vision immédiatiste de la lutte de classe contient le danger de quitter le terrain de la lutte de classe du prolétariat pour des mobilisations typiquement bourgeoises comme celles récentes autour de BLM (Black Lives Matter) avec un contenu clairement bourgeois, en exigeant un "capitalisme plus humain".
Un contact a demandé : comment mobiliser le prolétariat sans entrer dans ces fronts antifascistes ? Il ne faut pas penser qu'à tout moment le prolétariat peut entrer en lutte. Notamment, dans la situation actuelle de pandémie, les conditions d'une mobilisation de la classe ouvrière n'existent pas vraiment. Nous savons que le prolétariat a le défi de développer un combat à la hauteur des attaques économiques sans précédent dans le monde entier depuis la Seconde Guerre mondiale. Dans la situation présente, la responsabilité des révolutionnaires n'est pas de pousser les travailleurs à lutter à tout prix, mais de les inciter à discuter de ce qui est en jeu, à se regrouper pour en défendre la compréhension, même si c'est de façon très minoritaire.
Que penser de l'anticapitalisme prêché par certains groupes, notamment antifascistes ?
Y a-t-il, dans la situation actuelle, un chemin entre l'anticapitalisme et le futur communisme ? Aucun. Cependant, de plus en plus de classes moyennes, de petits bourgeois ruinés par le capitalisme, se déclareront "anticapitalistes". Même des parties importantes de la classe ouvrière, ayant de grandes difficultés pour reconnaître leur propre perspective révolutionnaire, peuvent adopter ce slogan de l'anticapitalisme. Cela exprime alors une grande faiblesse. Mais lorsqu'il s'agit d'une organisation politique qui défend et prêche l'anticapitalisme, alors ce n'est plus une faiblesse mais une tromperie. Ce n'est pas par hasard, comme cela a été souligné, si de nombreux groupes antifascistes, liés à l'extrême-gauche du capitalisme comme le trotskysme, se disent "anticapitalistes". C'est le cas en France d'une organisation trotskyste affiliée à la Quatrième Internationale qui s'appelle le Nouveau Parti Anticapitaliste.
Alberto (juillet 2020)
Questions théoriques:
- Démocratie [166]
Rubrique:
Le carburant des théories du complot est la décomposition du capitalisme
- 172 lectures
«Ce n'est pas la conscience des hommes qui détermine leur être, mais, au contraire, leur être social qui détermine leur conscience» comme le disait Marx. Aujourd'hui, la réalité de «l’être» de la plupart des gens à travers le monde se détériore de manière dangereuse et déconcertante : guerres, difficultés économiques, dégradation de l'environnement, migrations forcées et, cette année, en plus, un nouveau virus. Ces conditions matérielles de chaos et de confusion croissants - ajouté à cela l'absence apparente d'une alternative crédible - sont le terreau qui nourrit la prolifération des «théories du complot».
Alors que des millions de personnes sont infectées et que des centaines de milliers de personnes meurent dans le monde entier à la suite de la pandémie du Covid-19, des myriades d'explications sur la cause de ce fléau sont proposées, dont beaucoup prennent la forme de théories du complot. Malgré les déclarations d'organismes tels que l'Organisation Mondiale de la Santé et les Nations Unies1, selon lesquelles les origines de ces maladies résident dans la destruction d’habitats naturels entraînant un mélange non contrôlé des espèces animales et humaines (auquel s'ajoute le traitement intensif et sans aucune mesure élémentaire d’hygiène des viandes d’animaux à l'échelle industrielle), une grande partie de la population pense que la pandémie a été déclenchée délibérément par des individus, des mytérieuses cabales ou des pays malveillants pour réaliser leurs propres projets machiavéliques.
Ces « théories » vont de l'accusation du président des États-Unis, Donald Trump, selon laquelle la Chine « communiste » aurait à la fois fabriqué et propagé le virus Covid, à l'idée largement répandue que la pandémie est utilisée par les États pour ficher et contrôler leurs citoyens, par une diabolique « élite mondiale » ou par des individus tels que l'investisseur George Soros ou le multimillionnaire Bill Gates fondateur de Microsoft pour favoriser leurs propres projets de domination sur le monde.
Ces mêmes «théories» ne restent pas au niveau purement idéologique mais se manifestent dans la vie quotidienne, à travers des actions, des protestations, le lobbying et la diffusion dans les médias sociaux qui influencent le comportement de millions de personnes - particulièrement (mais pas exclusivement) en Amérique. En témoigne, par exemple, la montée en puissance du mouvement «anti-vaxxer», qui s'oppose à l'utilisation rendue obligatoire par l'État de vaccins utilisés pour prévenir les maladies et qui, en 2019, aurait contribué à la pire épidémie de rougeole depuis une génération en Amérique. En mai de cette année, une enquête a montré que près d'un quart des citoyens américains ont déclaré qu'ils refuseraient un vaccin contre le Covid-19, même s'il était efficacement mis au point ! En Australie, ce chiffre était plus proche de 50 %.
Plus inquiétant encore est le développement d'un esprit de pogrom, qui se manifeste par des agressions physiques contre des personnes au faciès asiatique tenues pour responsables de la propagation du virus. Les chaînes d'information télévisée indiennes, déjà réputées pour leur haine des musulmans, ont accusé les missionnaires musulmans de diffuser « délibérément » le COVID-19, les accusant de déverser de « méchants virus » et d’utiliser des « bombes humaines » en Inde. La vague orchestrée de violence antimusulmane à New Delhi a fait au moins 53 morts et plus de 200 blessés.
Le support médiatique ne fait pas le message
Il est certain que le développement de sites internet mondiaux tels que Facebook et YouTube a favorisé la croissance de toutes sortes de vidéos, chaînes et succursales d’adeptes d’une vision conspirative mettant en scène des personnages tels que David Icke ou Alex Jones d'InfoWars, passés maîtres dans l'art de colporter des visions du monde dans lesquelles des Juifs, des banquiers, des fanatiques ou de mystérieuses sociétés secrètes «mondialistes» dirigent et manipulent le monde – au moment même où les organismes internationaux s'occupant de commerce mondial, de santé mondiale, de limitation des armements ou d'accords climatiques sont mis de côté par le repli sur eux mêmes des Etats-nations.
Sur Internet vivent et s'organisent les adeptes du «bien-être» individuel dont le corps est considéré comme un temple inviolable qu’aucun vaccin promu par l'État ne doit « contaminer »; leur aversion pour les «grands gouvernements» ou les «grandes entreprises pharmaceutiques» est partagée par les «libertaires» de gauche ou de droite qui sont convaincus que la propagation du Covid-19 est une politique délibérée des principaux États du monde afin de ficher et de contrôler leurs populations. Ceux qui brûlent les tours de télécommunication 5G se retrouvent ici aussi. En marge de ces mouvements, le bras armé de la petite-bourgeoisie frustrée, comme la fraternité Boogaloo qui adore les armes et qui promeut la «guerre raciale», crée (dans sa vision faussée) un espace pour son type particulier de chaos autogéré. Le mythe de l'individu robuste farouche défenseur du chacun maître chez lui si répandu dans la culture américaine - parmi eux les mask refusniks (ceux qui refusent de porter des masques de protection)- n'est que le reflet de la division extrême du travail exercée par le capital, dans laquelle chaque personne semble être réduite à un individu sans espoir et sans défense, ses moyens de subsistance étant séparés des produits de son travail.
Mais ce n'est pas le développement de la technologie qui est responsable de la résurgence et de la prolifération de ce type de sectes, le support de communication ne doit pas être incriminé pour le message qu’il émet. Le vrai responsable, c’est la décomposition du capitalisme lui-même. Et la classe dirigeante est parfaitement capable d'utiliser l’enfoncement dans sa propre putréfaction pour retourner ses effets contre la population et son ennemi de classe.
Nous avons déjà mentionné le fait que le président Trump a cité la Chine comme étant la responsable de la création et de la propagation du nouveau virus. Cela cadre parfaitement avec les intérêts impérialistes américains qui encouragent la diffamation et l'affaiblissement de leur principal rival. Trump est encouragé dans cette voie par le candidat démocrate à la présidence, Biden. Des partisans de Trump comme ceux de QAnon2 sont, quant à eux, heureux de présenter l'Amérique et le monde sous l'emprise d'une bande de gangsters et de traîtres (qui comprend de nombreux anciens présidents américains, mais exclut curieusement Reagan et Kennedy) où Trump et «quelques hommes courageux» sont les seuls véritables patriotes...3. Pour cette clique au pouvoir, les théories conspiratives sont un écran de fumée utile afin d’abuser les plus naïfs : le Covid-19 est un « canular », une fausse nouvelle, tout comme les allégations de primes russes pour le meurtre de soldats américains. Les démocrates qui proposent un large éventail de solutions «alternatives» à la pandémie et à la crise économique - utilisent également des théories du complot pour présenter la clique de Trump comme la seule cause du déclin de l'Amérique dans le monde, Trump étant la marionnette de Poutine en Russie. Des groupes « rationalistes » tels que l'Alliance pour la science démystifient les anti-vaxxers et leurs conspirations... tout en encourageant la production à but lucratif de denrées alimentaires génétiquement modifiées.
La recherche d’un bouc émissaire dans l'histoire
Dans le passé, en périodes de fléaux, bien que se manifestait aussi une certaine solidarité sociale face à la tragédie, on a tenté à plusieurs reprises de chercher des boucs émissaires. «La peste noire de 1347-1351, la maladie la plus meurtrière et la plus dévastatrice d'Europe, a déclenché des violences de masse : le meurtre de Catalans en Sicile, de religieux et de mendiants à Narbonne et dans d'autres régions, et surtout les pogroms contre les Juifs, avec plus d'un millier de communautés en Rhénanie, en Espagne et en France, et à l'Est sur de vastes étendues de l'Europe les membres de leur communauté étaient enfermés dans des synagogues ou rassemblés sur des îles fluviales et brûlés vifs - hommes, femmes et enfants».4 En Italie, les Flagellants avaient accusé les Juifs ainsi qu'une hiérarchie ecclésiastique corrompue d'avoir provoqué la colère de Dieu. Pour éviter de leur donner des armes pour se défendre, le pape Clément VI a absous les Juifs (mais aussi Dieu et l'Église, bien sûr) et a désigné comme responsable un mauvais alignement des planètes...
Ainsi, en plus de cibler les «étrangers», «l'autre» ou les minorités, la responsabilité des maladies mortelles pouvait également être imputée à la classe dirigeante : Périclès a eu honte de mener les Athéniens affaiblis par le virus contre leurs rivaux spartiates pendant la Peste d'Athènes, entre 430 et 426 avant J.-C., et pendant la Pandémie Antonine (il y avait beaucoup de ces maladies mortelles répandues dans l'Empire romain) de 165 à 190 après J.-C., puis entre 170 et 300, des matrones aristocrates ont été "jugées" et exécutées pour avoir "empoisonné" des membres masculins de la classe dirigeante qui avaient été victimes de la peste. Cette attaque impuissante contre les «élites» est un aspect important qui dicte la forme et la fonction des théories du complot à l'époque actuelle de décomposition et de populisme politique.5
La montée de l'irrationalité
Malgré les connaissances limitées de l'Antiquité (par exemple avec l'intuition de l'historien Thucydide selon laquelle la peste athénienne «était causée par l'entassement des paysans dans d’étroites habitations et des baraques étouffantes»), il était impossible autrefois d'avoir une compréhension scientifique de l'origine et de la transmission des fléaux. D'où la chasse aux boucs-émissaires et la prolifération des explications irrationnelles.
Aujourd'hui, l'humanité comprend davantage -du moins en théorie- ce qui se passe. Le génome Covid-19 (l'ensemble complet des gènes ou du matériel génétique présents dans une cellule ou un organisme) a été cartographié quelques semaines après sa découverte officielle au début de l'année. L'acceptation généralisée de théories complotistes sur l'origine de la pandémie et face aux tentatives de la soigner semble donc encore plus anormale, même si l'on tient compte du fait qu'il s'agit d'un nouveau virus dont nombre de facteurs de propagation sont pour l'instant encore inconnus.
Cependant, les fléaux et les pandémies sont le résultat de conditions sociales spécifiques et leur impact dépend également du contexte historique particulier dans lequel se trouve une société donnée. La crise de Covid-19 est le produit de la profonde décadence du capitalisme et de ses immenses contradictions, résultant de la juxtaposition d'avancées stupéfiantes dans toutes les branches de la technologie et de l'apparition de pandémies, de sécheresses, d'incendies, de la fonte des calottes glaciaires et du brouillard de pollution urbain. Tout cela trouve son expression au niveau idéologique, tout comme les disparités manifestes entre une paupérisation et un chômage croissants d'une grande partie de la population de la planète et l'enrichissement d'une minorité d'exploiteurs.
Les théories du complot rivalisent aujourd'hui avec les religions dans leur tentative de décrire et d'expliquer la réalité complexe : comme la religion, elles offrent des certitudes dans un monde incertain. Les différents mouvements prétendant dévoiler la «vérité» mettent en oeuvre les processus cachés et impersonnels du grippage de l'accumulation capitaliste en braquant les projecteurs sur des individus ou des cliques mystérieuses et interconnectées. Ils semblent convaincants dans la mesure où leurs «critiques» contiennent souvent quelques vérités fondamentales, par exemple que l'État est déterminé à collecter, rassembler et stocker toujours plus de données sur ses citoyens, ou qu'il existe un "une face cachée de l'Etat" (avec ses "hommes de l'ombre") qui agit et dirige derrière la façade de la démocratie.
Mais les théories du complot placent ces évidences mal digérées dans des cadres totalement faux, comme l'idée qu'il serait possible d'éviter le regard froid de la surveillance étatique (en se coupant des réseaux) sans détruire l'appareil d'État lui-même ou, dans le cas de «l'État profond», qu'il est le produit d'une cabale coopérant internationalement dans l’ombre, plutôt que l'expression de la domination du capitalisme d'État et de son évolution, une expression directe de la nature compétitive du capitalisme, dictée par la volonté de dominer ou de détruire des États rivaux dans une série de guerres de plus en plus barbares que chacun mène contre tous. Les théories du complot deviennent ainsi non seulement une mauvaise interprétation du monde mais aussi un blocage contre le développement de la conscience nécessaire pour le changer.6
Le capitalisme instrumentalise la science
Issu de la même méfiance profonde à l'égard des « élites » dirigeantes qui a conduit au phénomène populiste de ces dernières années, le goût pour les explications irrationnelles de la réalité s'est accompagné d'un rejet croissant de la science. D'où la frustration du Dr Anthony Fauci, l’autorité médicale reconnue par Donald Trump : « Il y a un sentiment général d'anti-science, d'anti-autorité, d'anti-vaccins chez certaines personnes dans ce pays qui touche de façon alarmante un pourcentage relativement élevé de personnes », a déclaré le principal porte-parole médical des États-Unis au sein de la Task Force de la Maison Blanche sur les coronavirus. Cet aveu vient d’une personnalité qui donne cependant une caution scientifique à l'administration Trump, pourvoyeuse de théories de complot par excellence ! En Grande-Bretagne, une commission de la Chambre des Lords (eh oui, il subsiste encore des Lords pour administrer ce Royaume !) enquêtant sur le pouvoir des médias numériques a été informée d'une "pandémie de mésinformation et de désinformation ... Si on les laisse prospérer, ces vérités contrefaites entraîneront l'effondrement de la confiance du public, et sans confiance, la démocratie telle que nous la connaissons déclinera et perdra tout simplement sa signification. La situation est grave à ce point ".
Mais si la classe dirigeante utilise et instrumentalise la science pour donner de la crédibilité à ses politiques - comme nous l'avons vu clairement au Royaume-Uni, où le gouvernement a d'abord joué avec une version à moitié vérifiée de la théorie de «l'immunité collective» pour justifier sa réaction totalement désinvolte à la pandémie - il n'est pas surprenant que la science elle-même perde de plus en plus de sa crédibilité. Et si la montée des «fausses vérités» conduit également, comme le craint le rapport de la Chambre des Lords, à une perte de conviction dans l'idée de démocratie, cela pose des difficultés encore plus grandes pour la capacité de la classe dirigeante à maintenir le contrôle de la société grâce à un appareil politique largement accepté par la majorité de la population.
Le son du silence
Mais la perte de contrôle par la bourgeoisie ne contient pas en soi le potentiel d'un changement social positif. Sans le développement d'une alternative sérieuse à la domination bourgeoise, elle ne conduit qu'au nihilisme, à l'irrationalité et au chaos.
La cacophonie croissante des théories du complot - la prévalence de dénégations absurdes d'une réalité choquante et effrayante - ne repose pas seulement sur la perte de contrôle de la classe dominante sur son système économique et son propre appareil politique. Elle résulte avant tout d'un vide social, d'une absence. C'est l'absence de perspective - une vision alternative et dynamisante pour l'avenir mais ancrée dans le présent - découlant du relatif recul des luttes et de la conscience prolétarienne depuis une trentaine d'années qui contribue à la confusion sociale actuelle. En 1917, au milieu d'une guerre mondiale apparemment sans fin et expression de l'impasse dans lequel la société capitaliste plonge l’humanité, tuant des millions de personnes et détruisant des décennies de civilisation humaine accumulée, c'est la révolution russe, organisée et réalisée par la classe ouvrière elle-même, qui a inspiré une vague de mouvements révolutionnaires dans le monde entier, forçant la classe dirigeante à mettre fin à la guerre et offrant la possibilité d'une autre façon d'organiser le monde, fondée sur le besoin humain. L'humanité a payé au prix fort l'échec de l'extension du pouvoir soviétique né en Russie à travers le monde, le condamnant ainsi à la dégénérescence interne et à la contre-révolution.
Du point de vue de la classe dominante, la révolution prolétarienne n'est elle-même possible qu'à la suite d'une conspiration : la Première Internationale a été dénoncée comme la main cachée derrière toute expression de mécontentement de la classe ouvrière dans l'Europe du XIXe siècle ; l'insurrection d'Octobre n'était qu'un coup d'État de Lénine et des bolcheviks. Mais si les idées communistes ne sont la plupart du temps avancées que par une minorité du prolétariat, la théorie révolutionnaire peut à certains moments devenir évidente pour un grand nombre de personnes dès lors qu'elle commence à sortir de la torpeur où la maintient l'idéologie dominante, et se transforme ainsi en «force matérielle». Des changements aussi profonds dans la conscience des masses peuvent être encore très loin devant nous, mais la capacité de la classe ouvrière à résister aux attaques du capitalisme laisse également entrevoir cette possibilité dans le futur... Nous l'avons vu de manière embryonnaire au début de la pandémie, lorsque les travailleurs ont refusé d'aller «comme des agneaux à l'abattoir» dans des usines et des hôpitaux, sans protection au nom des profits du capitalisme. Et si les conditions actuelles de la maladie et l’orchestration de campagnes idéologiques bourgeoises comme celles du mouvement Black Lives Matter entravent la capacité du prolétariat international à s'unir, les terribles privations qui se déroulent actuellement - taux d'exploitation croissants pour les travailleurs, développement du chômage de masse dans le monde entier - l'obligeront à affronter toutes les fausses visions qui nuisent à sa conscience de ce qui doit être fait.
Robert Frank, 7 juillet 2020
1 Les pandémies résultent de la destruction de la nature, selon l'ONU et l'OMS, The Guardian, 17 juin 2020. [167]
2 NdT. Groupe composé de partisans de Donald Trump répandant la théorie selon laquelle existerait une conspiration secrète contre le président actuel des Etats-Unis d’Amérique.
3 Voir par exemple les vidéos de l'organisation QAnon, dont Le Plan pour sauver le monde.
4 Pandémies : vagues de maladie, vagues de haine de la peste d'Athènes au SIDA par Samuel K. Cohn. [168] L'auteur soutient de façon controversée que, malgré les boucs émissaires et les meurtres de masse de Juifs à l'époque de la peste médiévale et d'autres exemples cités par lui-même, cette «culture de la haine de l’autre» n'a pas encore fait pencher le fléau de la balance du côté négatif par rapport aux démonstrations de solidarité sociale face aux catastrophes provoquées par la maladie. Voir également les Epidémies de Cohn : Haine et compassion de la peste d'Athènes au SIDA, Oxford University Press
5 Voir notre article "L’élection de Trump et le délitement de l’ordre capitaliste mondial", Revue Internationale no 158, printemps 2017 [169]
6 Voir notre article en anglais « Marxism and conspirative theories » [170]
Rubrique:
ICConline - octobre 2020
- 59 lectures
Sur l'élément aventurier en Espagne
- 110 lectures
Un proche sympathisant du CCI lance un appel aux organisations du milieu prolétarien afin qu'elles prennent leur responsabilité en réponse aux dangereuses manoeuvres d'un aventurier.
Je voudrais exprimer mon soutien total au texte sur Gaizka publié par le CCI.[1] Avant toute chose, il faut souligner que le CCI n'a pas publié l'article sur Gaizka dans la perspective d'une attaque contre cette personne (son vrai nom a été soigneusement omis) mais comme l'identification d'un élément opportuniste et aventurier qui est en mesure de faire dérailler le milieu. Plus largement, l'article du CCI vise à mettre le doigt dans la plaie au regard de la faiblesse programmatique et organisationnelle du milieu dont l'acceptation de Nuevo Curso (NC) en son sein est une expression. Le dernier article, de pair avec celui sur l'histoire de la dénommée "Gauche Communiste Espagnole"[2], dévoile la nature frauduleuse de la politique de Nuevo Curso. Ses ouvertures au Trotskysme historique ont été critiquées de manière pertinente comme étant contraire aux positions programmatiques de la gauche communiste. Alors pourquoi publier un article sur l'élément moteur dans Nuevo Curso ? L'existence de NC démontre combien il est facile que le milieu soit séduit par des éléments aventuriers. Dans ce qui suit je veux mettre en évidence certaines des questions que la montée de Gaizka pose pour le milieu.
La nature des éléments aventuriers.
Notre but ici n'est pas de répéter ce qui a déjà été confirmé au regard de la nature de cet élément particulier en Espagne. Mais il me semble que la nature de ces éléments aventuriers doit être comprise dans une perspective historique. L'histoire du prolétariat et l'histoire de ses organisations politiques a été entachée par l'apparition de "grands leaders" qui ont essayé d'utiliser ces mouvements pour leur propre gloire personnelle. L'un des principaux exemples fut Lassale mais il y en a eu d'autres. Mais l'aventurisme doit trouver un terrain fertile pour pouvoir couver. Nous devons considérer les raisons pour lesquelles certains éléments éparpillés et faiblement politisés sont en mesure de créer un autre groupuscule se réclamant de la "Gauche Communiste" pouvant tout aussi bien se regrouper sous la direction de n'importe quel autre groupe appartenant au milieu. Et pourquoi d'autres groupes sont enclins à accepter l'existence de tendances qui sont clairement en contradiction avec leur propre programme ?
Historiquement, comme les textes publiés par le CCI sur l'aventurisme l'ont montré, la prédominance des éléments aventuriers est avant tout basée sur la faiblesse du milieu prolétarien à un moment historique donné. Cela ne veut pas dire que les organisations sont impuissantes à agir dans un moment historique difficile pour les communistes, mais il faut une solidité organisationnelle et théorique forte pour pouvoir aller contre le courant.
En d'autres termes, il est impératif que le milieu soit en mesure de faire face à une attaque sur les principes théoriques. Il devrait y avoir une réflexion globale sur pourquoi et comment nous sommes actuellement hantés par des éléments qui cherchent à s'écarter de la tradition de la Gauche Communiste. Globalement, le problème semble résider dans la faiblesse du milieu. Mais avant d'aller plus loin sur ce sujet, il pourrait être intéressant de comprendre comment une nouvelle organisation peut légitimement devenir partie intégrante du milieu. Ce faisant, nous défendons le concept de milieu, précisément parce qu'il nous empêche de mettre notre héritage entre parenthèses chaque fois qu'un nouveau groupe apparait et parce que cela délimite ce qui peut être légitimement retenu pour être considéré comme "communiste". Par ailleurs, cela permet d'exclure ce qui, sur les bases de l'expérience historique, ne pourra jamais être une position de la classe ouvrière.
On ne peut pas réinventer la roue
Et pourtant, il est possible de faire partie du milieu avec de nouvelles idées et de le rejoindre ou comme nouveau groupe, ou au sein de groupes déjà existants, avec des positions qui peuvent sembler déranger l’opinion commune. De fait, c'est précisément le combat féroce contre le dogme de la Seconde Internationale qui a permis aux Fractions de Gauche de rompre sur une base claire avec la vieille organisation et de maintenir le noyau prolétarien. Cependant, il ne peut y avoir de théorie qui ne se développe sans confrontation avec la réalité ni à travers le débat avec les autres groupes politiques déjà existants. Et nous ne pouvons pas ignorer ce qui a déjà été maintes fois prouvé par l'Histoire, par exemple le rôle réactionnaire des syndicats. Pour nous communistes, il ne peut y avoir de réinvention de la roue : à l'heure actuelle, au vu de la fragilité de notre courant politique et de la distribution démographique de nos militants et, plus important encore, le difficile moment politique dans lequel nous nous trouvons (avec les frontières, le populisme, les politiques de culpabilisation, etc...), tout germe de doute politique portant sur les principes de base est quasi-suicidaire. En défendant le milieu et les (non reconnus) points de consensus qu'il représente, il serait complètement impensable qu'un groupe représente à la fois une organisation communiste et une organisation bourgeoise.
Bien sûr, il est impossible de vivre et travailler sous le capitalisme sans en subir l’influence, mais il y a une différence notable avec le fait de travailler comme conseiller pour une personnalité politique en supportant activement un parti bourgeois et son idéologie. Si une telle double représentation des causes bourgeoise et communiste était acceptée, cela obscurcirait la signification du communisme et brouillerait la voie vers laquelle la classe ouvrière doit diriger son attention.
Comme cela a été dit précédemment, la rupture est nécessaire. Aucune de ces deux conditions, pourtant élémentaires, n'a été garantie par la figure dominante de Nuevo Curso. Nulle explication sur les oscillations politiques de Gaizka n'a été fournie et son organisation n'a pas non plus défini fondamentalement ses différences en relation avec les autres groupes. Et, devrions-nous noter, elle n'a pas fourni non plus une véritable défense de l'existence de la dénommée Gauche Espagnole. La clarté de la théorie communiste doit être assurée par le débat, en développant ouvertement un ensemble de positions partagées qui définissent la politique communiste. Malheureusement, le milieu semble incapable de cela.
Cela nous place dans une position politique particulièrement difficile, dans laquelle les éléments aventuriers sont en mesure de grandir de façon désinhibée et de gagner une légitimité non méritée. Il serait ridicule de dénier la possibilité de différences légitimes sur des points programmatiques entre groupes communistes. Mais il est d'une importance vitale de ne pas laisser les portes ouvertes aux manoeuvres des aventuriers et des positions gauchistes, ce qui ne semble guère acquis si nous laissons rentrer sans entraves des éléments tels que Nuevo Curso. Les groupes parasites comme le dénommé Groupe International de la Gauche Communiste (GIGC) persistera, sans aucun doute, à défendre l'exact opposé de la position du CCI en saluant l'apparition d'un nouveau courant parmi d'autres dans la mesure où cela sert leur objectif de faire imploser le milieu pour leurs propres buts qui sont de liquider la théorie et l'organisation. Cela démontre encore davantage leur objectif ultime et leur haine sous-jacente de la clarification, leur amour du "choix", c'est à dire la démocratie et leur incapacité à engager des discussions sans considérer leurs opinions comme leur propre propriété personnelle. Cette erreur les conduit à déformer les critiques actuelles à l’encontre de Nuevo Curso en les assimilant à de la diffamation et comme cela est leur propre modus operandi, ils sont de fait incapables d'envisager les choses sous un autre angle.
La faiblesse du milieu
Nous ne pouvons contester le fait que de nouveaux arguments ou des théories révisées ne pourraient pas être valides dans le débat politique entre groupes. L'invocation d'une soi-disante "Gauche Espagnole" est à la fois la conséquence et le symptôme d'un refus de débattre au sein du milieu, c'est à dire de tracer ce qui devrait légitimement subsister et cela est, par conséquent, un obstacle à la capacité du milieu d'avancer vers une plate-forme commune. La création d'une nouvelle tradition communiste revient à esquiver le débat et est l'expression de la nature fondamentalement parasitaire de ce groupe. Nous devons donc nous demander : qu'a fait le milieu jusque maintenant ? De manière générale, il a accepté l'existence de nouveaux éléments et a failli à engager la critique en partant de ses positions. Les textes traduits qui émanent de Nuevo Curso sont présentés par d'autres groupes avec peu ou pas de commentaires sur ses déviations politiques. Apparemment, pour certains éléments du milieu, la révérence envers le "miracle" de l'émergence de nouveaux éléments les conduit à adopter une attitude presque dévote envers tout nouveau élément qui apparait.
La période semble duper la plupart des groupes politiques actuels. Certains jeunes éléments, guidés par leur propre venue aux positions communistes, tendent à croire que le parti serait sur le point d'être fondé dans un futur (très) proche. L'erreur fondamentale est de penser que même si nous étions capables de regrouper la Gauche Communiste en une seule organisation, celle-ci deviendrait instantanément le "parti".
Ce ne peut être un parti car il n'a actuellement aucun impact sur la classe ouvrière : ce serait juste encore un autre parti, impossible à discerner de tous les autres petits partis gauchistes au contenu vide. Ce serait absurde de se "regrouper" juste pour se regrouper. Au contraire, ce qui est nécessaire pour le moment est une discussion théorique vigoureuse pour qu'à l'avenir un tel regroupement sur une solide base organisationnelle et théorique soit possible.
Je salue le travail effectué par le CCI pour identifier d'un point de vue théorique les racines de Nuevo Curso et pour détailler de quelle manière un aventurier tel que Gaizka a été capable, sous couvert d'une "nouvelle théorie", d'entrainer des éléments en recherche dans le marais entre le communisme et le gauchisme. Je peux seulement souhaiter de tout coeur que le milieu sera en mesure de surmonter ses faiblesses pour pouvoir commencer à réinitier les débats qui sont indispensables afin de commencer un processus de nécessaire solidification programmatique, et par conséquent, d'exclure des éléments qui ne se rapprochent pas activement de ces positions.
Merwe, 10-07-2020
Rubrique:
Quelles leçons tirer de la défaite ouvrière à Nissan ?
- 102 lectures
Les défaites sont toujours douloureuses pour le prolétariat. Cependant, en tant que classe exploitée et révolutionnaire à la fois, elle n'a pas d'autre école que de tirer les leçons de ses défaites. Ces leçons arment sa conscience, la renforcent et finissent par nourrir sa détermination et sa combativité. Comme l'a dit Rosa Luxemburg, pour le prolétariat, "Ses erreurs sont aussi gigantesques que ses tâches. Il n'y a pas de schéma préalable, valable une fois pour toutes, pas de guide infaillible pour lui montrer le chemin à parcourir. Il n'a d'autre maître que l'expérience historique. Le chemin pénible de sa libération n'est pas pavé seulement de souffrances sans bornes, mais aussi d'erreurs innombrables. Son but, sa libération, il l'atteindra s'il sait s'instruire de ses propres erreurs ».[1] La lutte chez Nissan a été une défaite : en échange de compensations et d'une vague promesse de "plans de réindustrialisation", 2500 travailleurs de l'usine de la Zone Franche de Barcelone perdent leur emploi et 20 000 travailleurs des entreprises sous traitantes voient leur emploi pratiquement supprimé. D'un coup de plume, le Capital a imposé 23 000 licenciements. C'est la dure réalité.
Les syndicats ont fidèlement servi le Capital
Les syndicats sont des appareils qui travaillent main dans la main avec les entreprises et les gouvernements pour imposer l'ordre capitaliste au travail. Cependant, leur fonction principale est de saboter de l'intérieur la lutte des travailleurs et ils le font en verrouillant le combat au sein de l'entreprise ou du secteur. De cette façon, les travailleurs sont isolés et tous les instruments de l'État capitaliste sont abattus sur eux, imposant finalement la démoralisation et la défaite. Chez Nissan, ils ont empêché les travailleurs de se tourner vers leurs camarades d'autres entreprises et ont détourné les actions vers le cassage des vitrines des concessionnaires Nissan ou vers une voie épuisante à Corrales de Buelna où l'entreprise avait auparavant promis de maintenir la production en opposant les travailleurs de cette usine à leurs camarades de Barcelone"[2]. Lorsqu'ils font taire la réaction des travailleurs, les syndicats signent ce que veulent les patrons, mais ils enjolivent leurs accords de miettes et de vagues promesses. Souvenons-nous que Sony, Delphi et bien d'autres entreprises ont promis de "nouveaux emplois" dans de "nouvelles entreprises" qui n'ont jamais été ouvertes[3].
Les syndicats ont célébré bruyamment "l'accord" de 23 000 licenciements. Le CCOO (syndicat Commissions Ouvrières) proclame qu'il "donne la priorité à la réindustrialisation des usines pour éviter les licenciements traumatisants et garantir un maximum d'emplois", l’UGT promet que "tous ceux qui le souhaitent auront un emploi", et que "les indemnités seront énormes, substantielles, au même niveau que les préretraites". La CGT, syndicat "radical", y voit la "première phase de la réindustrialisation de nos usines". Pour les anticapitalistes "critiques" de Podemos, l'accord "donne le temps de mettre en place un plan de reconversion durable pour assurer les 25 000 emplois". Ces démarches sont, d'une part, une promesse qui ne sera jamais tenue, mais, d'autre part, elles tendent un piège au prolétariat en l'attachant pieds et poings liés au char du capital.
Ils parlent de "futures entreprises", de "réindustrialisation". Ils veulent ainsi nous convaincre que notre vie dépend de l'accumulation, des investissements, des gains en capital et de l'économie nationale. Ils veulent que nous nous appropriions les besoins du capital, et ils ont le culot de se présenter comme des "anticapitalistes" et des "combattants du socialisme" ! Ils cachent la vérité : la vérité est que le capitalisme est en pleine crise brutale, peut-être la pire depuis 1929, et qu'avec la COVID 19 il menace nos vies, et dans ces conditions l'"horizon" de l'"industrialisation" et de la "création de nouvelles entreprises" est une utopie réactionnaire qui nous enchaîne à ce qui intéresse le capital, c'est-à-dire "être compétitif" dans la jungle du marché mondial. Etre "compétitif" signifie moins d'emploi, moins de salaire, moins de retraite, la dégradation des conditions de vie. Il n'y a pas d'autre moyen pour l'économie nationale et les entreprises de maintenir leurs profits et leurs positions sur le marché mondial ! Et ils cachent ce dont nous avons réellement besoin en tant que classe ouvrière : lutter pour nos besoins humains de manger, de vivre, de donner un avenir à nos enfants, défendre nos conditions de vie, ce qui nous amène nécessairement à affronter le capital et son État, à rechercher notre unité en tant que classe internationale et à développer la perspective de la révolution prolétarienne mondiale.
Courant Rouge : quelques vérités pour nous maintenir liés aux grands mensonges du capital
Dans l'appareil politique du capital, il y a un arc-en-ciel qui va de l'extrême droite à l'extrême gauche, en passant par toutes les couleurs intermédiaires comme le vert des écologistes. Du côté de l'extrême gauche, il y a des groupes comme Courant Rouge qui reconnaissent certaines vérités, mais au bout du compte, leur méthode finit par être le moyen de continuer à défendre le Capital parce qu'il ne faut pas oublier que le pire mensonge est une demi-vérité.[4] Dans un texte paru dans Kaosenlared[5], intitulé "Nissan : le pire dans une grande défaite est de la présenter comme une grande victoire", il dénonce qu'avec des promesses et des compensations, les syndicats nous ont fait avaler 23.000 licenciements. Il dénonce également le Front commun que les syndicats ont organisé contre les travailleurs de Nissan, l’ "indépendantiste" Torra, le ministre Reyes Maroto, le maire de Barcelone, Ada Colau et l'organisation patronale Fomento del Trabajo. Tous se sont unis contre la classe ouvrière. Il prévient que la défaite chez Nissan "laisse les patrons libres de procéder à des licenciements, des restructurations et à une dégradation générale des conditions de salaire et de travail. D'autant plus que les patrons ont vu la passivité complice avec Nissan du gouvernement du PSOE-UP et de la Generalitat de Torra et Aragon". Il dénonce le fait que les travailleurs des entreprises sous-traitantes vont descendre dans la rue dans des conditions bien pires que celles de leurs collègues de la société mère Nissan. Nous voulons ici dénoncer une pratique généralisée du Capital au cours des trente dernières années visant, entre autres, à nous DIVISER : dans les grandes usines de production, par exemple dans l'industrie automobile, oeuvrent non seulement les travailleurs du personnel de la grande entreprise (Nissan, Ford, GM etc.), mais aussi de nombreux autres travailleurs qui appartiennent à des centaines de petites entreprises. Mais en même temps, dans les parcs industriels voisins ou même dans d'autres pays, il existe un énorme réseau d'entreprises sous traitantes qui fabriquent des pièces automobiles. Tous ces travailleurs ont des conditions de travail bien pires que celles de leurs frères et sœurs de l’entreprise mère et, en cas de licenciement, leurs indemnités sont plus que misérables.
Cependant, les travailleurs des sociétés mères ne sont pas "privilégiés". La compensation, comme le dit Courant Rouge, est "du pain pour aujourd'hui et la faim pour demain" car les emplois détruits ne seront jamais remplacés ou s'ils le sont, c'est dans des conditions bien pires de rémunération, de travail, de retraite, de précarité, etc. Depuis 40 ans, nous assistons à une chute globale et permanente des conditions de travail et de vie de l'ensemble de la classe ouvrière mondiale, même si en cours de route tel ou tel travailleur individuel a "bénéficié" de compensations plus ou moins « juteuses »[6].
Ils parlent de "direction syndicale" pour cacher la nature capitaliste des syndicats
Tout ce que Courant Rouge dénonce est vrai, mais son piège, en premier lieu, réside dans l'"explication" qu'il donne des raisons pour lesquelles les syndicats ont vendu les travailleurs. A tout moment, il ne parle pas des syndicats mais de "directions syndicales". Il dénonce la "stratégie syndicale pour organiser la défaite" en disant qu'il s'agit d'une "stratégie des directions syndicales dirigée depuis le début pour organiser la défaite et sauver la face, un art dans lequel elles sont des spécialistes". Afin de redorer le blason des syndicats et de maintenir la confiance des travailleurs en eux, Courant rouge, les trotskystes, etc... parlent d'une "division" entre la "base" et la "direction". La base serait "ouvrière" et donnerait aux syndicats le caractère d'"organes prolétariens", tandis que la direction serait "bourgeoise", "traîtresse", "vendue", etc... Ce faisant, ils cachent le fait que les syndicats ont été intégrés à l'État dès la Première Guerre mondiale, devenant des appareils au service du Capital.[7] Ces derniers sont une prison où les travailleurs qui y entrent ne sont là que pour obtenir certains avantages individualistes (maisons de vacances, services juridiques, etc.) ou bien, s'ils veulent défendre leur classe, ils sont obligés de suivre une ligne directrice qui va à l'encontre et contre leurs intérêts de classe. La "base" ne fait pas du syndicat un organe ouvrier mais est la chair à canon, la masse de manœuvre, que le syndicat utilise pour soumettre les travailleurs au Capital et saboter leurs luttes.
Les directions syndicales sont la structure hiérarchique dont l'appareil syndical a besoin pour s'intégrer au service du Capital et de son État. C'est pourquoi les dirigeants seront toujours anti-ouvriers ! Les trotskystes, les gauchistes, présentent régulièrement des "candidats combatifs" qui entendent "renouveler le leadership" et le "mettre au service de la base". Il en résulte que certains élus deviennent encore plus bureaucratiques que les dirigeants syndicaux ou sont comme un embellissement "radical" de la politique syndicale. La preuve de la fausseté des "explications" de Courant Rouge sur la "direction perfide" est donnée par le fait que la CGT s'est comportée comme le grand syndicat "officiel" : "La CGT a eu une magnifique occasion de montrer qu'elle était un syndicat de classe et militant contre l'officialité. Mais ce que nous avons vu, c'est sa faillite en tant que syndicat alternatif" puisque "Au nom de l'"unité" d'en haut avec les bureaucrates, la CGT a signé tous les communiqués des comités d'entreprise, n'a pas organisé la lutte des ouvriers des entreprises sous-traitantes, n'a pas travaillé à l'organisation d'une grande manifestation centrale, ni au blocage de la zone franche, ni à la promotion d'une grève générale. Au contraire, dans le communiqué final, elle apporte son soutien à l'accord de fermeture.
Les syndicats ne pourront jamais être reconquis par la classe ouvrière ! C'est une autre illusion démoralisante vendue par Courant rouge, les trotskystes et autres gauchistes. Syndicats "officiels", syndicats "alternatifs", syndicats "d'assemblée", syndicats "anarchistes"... tous sont des syndicats et donc des appareils d'État au service du capital[8].
L'intérêt de l'"industrie" est la négation des intérêts des travailleurs
Le second mensonge de Courant Rouge, qui le place dans la même veine que les syndicats, le patronat, le gouvernement central et le gouvernement "pro-indépendance", est qu'il présente la lutte de Nissan comme la lutte "de toute l'industrie automobile et de toute la classe ouvrière catalane". Leur lutte a été un signal pour toute la classe ouvrière, les patrons et les gouvernements, et leur sort a été décisif pour l'avenir de l'automobile et de l'industrie. Courant Rouge dit la même chose que ses "critiques" : l'avenir de l'automobile et de l'industrie, l'avenir de la classe ouvrière "catalane". En d'autres termes, il enferme les travailleurs dans la prison des intérêts des secteurs productifs, de la nation catalane, de l'accumulation du capital. Courant Rouge ne parle pas du tout de l'avenir du prolétariat, de l'avenir terrible que le capitalisme en crise et en décomposition contient, ni de la défense des conditions de vie et de travail des travailleurs, de leur solidarité, de leur auto-organisation, de leur unité internationale... Tout cela est un langage que Courant Rouge ne veut pas que les travailleurs utilisent, de sorte qu'ils ne parlent que de "l'industrie", de "l'automobile", de la Catalogne... c'est-à-dire le langage du capital. Courant Rouge ne s'intéresse pas à l'intérêt de la classe ouvrière (qui est historiquement l'avenir de l'humanité) mais seulement au Capital espagnol, et cela se révèle lorsqu'il regrette que l'accord avec Nissan "laisse les mains libres au gouvernement Sanchez pour aller de l'avant avec un "plan de reconstruction" adapté aux besoins des entreprises de Ibex et des multinationales étrangères. Comme ceux de l'industrie automobile, qui condamnent les usines espagnoles à assembler des voitures à combustion, tout en réservant les activités de plus grande valeur technologique et la production de la voiture électrique à leurs pays d'origine". Il accuse le gouvernement Sanchez de ne pas être "très espagnol" et de laisser les "voitures à combustion" à l'Espagne. Courant Rouge est aussi espagnol que Vox !
Le piège de la nationalisation
La "solution" proposée par Courant Rouge est que "seule la nationalisation a permis non seulement de sauver tous les emplois menacés, mais aussi d'avoir une grande entreprise publique qui, sous le contrôle des travailleurs eux-mêmes, prendrait la tête de la tâche de reconversion écologique du secteur automobile et sauverait les emplois".
Qu'elle soit publique ou privée, la classe ouvrière continue à être exploitée, à être soumise au travail salarié, à produire de la plus-value, c'est-à-dire qu'elle continue à être soumise aux lois du capital. Dans l'article susmentionné sur les luttes en Espagne (voir note de bas de page n°2), nous avons exposé le piège des nationalisations faites par nos prédécesseurs de la Gauche communiste mexicaine. Les nationalisations sont un instrument du capitalisme d'État, une tendance universelle du capitalisme décadent pour affronter la crise et la classe ouvrière.
La confusion sophistiquée faite par les gauchistes et, en général, la gauche du capital, entre nationalisation et socialisme, repose d'abord sur la négation du caractère international de la révolution prolétarienne et de la monstruosité du "socialisme dans un seul pays". Avec le sophisme "nationalisation = socialisme", ils nous ont mis en tête que le socialisme défendrait la nation. Cette falsification est basée sur une erreur qui s'est répandue dans le mouvement ouvrier de la Deuxième Internationale et que la Troisième Internationale n'a pas réussi à combattre avec suffisamment de force : l'identification du capitalisme avec la propriété privée. Engels a déjà combattu cette grave erreur en soulignant que "l'État moderne, quelle que soit sa forme, est une machine essentiellement capitaliste, c'est l'État des capitalistes, le capitaliste collectif idéal. Et plus elle assume de forces productives dans la propriété, plus elle devient un capitaliste collectif et plus elle exploite ses citoyens. Les travailleurs sont toujours des ouvriers salariés, des prolétaires. Le rapport capitaliste, loin d'être aboli par ces mesures, est aiguisé"[9]. Si, contrairement à l'analyse d'Engels partagée par Marx[10], on part de cette identification que la propriété privée = le capitalisme, on finit par conclure que "toute modification visant à limiter cette propriété privée signifierait limiter le capitalisme, le modifier dans un sens non capitaliste, par opposition au capitalisme, anticapitaliste" comme le dit très clairement notre ancêtre de la Gauche Communiste de France[11] qui dénonce que "Tous les protagonistes "socialistes" des nationalisations, du dirigisme économique, et tous les faiseurs de "plans" et surtout les trotskystes pour qui "les nationalisations sont, en tout cas, un affaiblissement de la propriété privée capitaliste, pointent du doigt cette théorie de l'Etat capitaliste anti-capitaliste. Bien qu'ils ne les appellent pas - comme le font les staliniens et les socialistes - "îlots de socialisme" sous le régime capitaliste, ils sont néanmoins convaincus qu'ils sont "progressistes".
La classe ouvrière ne doit pas compter sur les nationalisations, les promesses d'investissement, les "plans d'État", elle doit compter uniquement sur sa lutte en tant que classe, pour les revendications des travailleurs, auto-organisés en Assemblées générales en dehors et contre les syndicats et autres serviteurs du capital, des luttes qui doivent chercher leur extension, construire l'unité de la classe ouvrière dans la perspective de la révolution prolétarienne mondiale, seule voie de sortie de la crise et de la barbarie du capitalisme.
Smolnys, Accion Proletaria (section du CCI en Espagne).
31-8-20
[1] Rosa Luxemburg, La crise de la Social Démocratie.
[2] Voir notre article en espagnol : « Luttes ouvrières en Espagne » [173].
[3] Sur la lutte ouvrière à Delphi voir nos tracts “Delphi: la force des travailleurs est la solidarité » [174] et « Fermeture de Delphi: Seule la lutte massive et solidaire est notre force » [175]
[4] Pour savoir qui est Courant rouge et ses procédures de tromperie "radicales", lisez notre article en espagnol "Courant rouge : un chat pour un lièvre". [176]
[5] [177]"Nissan : le pire dans une grande défaite est de la présenter comme une grande victoire" [177]
[6] Nous devons signaler que ces indemnisations ne sont nullement un cadeau. Ils viennent de la bourse énorme qu’est la plus-value qui est globalement volée aux ouvriers, même dans la majorité des cas si elles sont ’ils sont plus« généreuses » en c’est en tant qu’arme politique pour mieux diviser les ouvriers, mettre fin à leurs luttes ou pour éviter qu’elles aillent beaucoup plus loin.
[7] Voir notre série Les syndicats contre la classe ouvrière. [178] Ainsi que, en espagnol, les "Notes sur la question syndicale [179]".
[8] Voir notre article en espagnol : « Un nouveau syndicalisme est-il possible ? » [180]
[9] Voir F. Engels, Du socialisme utopique au socialisme scientifique.
[10] Voir Karl Marx, Critique du programme de Gotha ainsi que « Communisme contre le socialisme d’Etat » [181] dans notre série sur le communisme, Revue internationale n°78, 3e trimestre 1994.
Géographique:
- Espagne [16]
Questions théoriques:
- Syndicalisme [183]
Rubrique:
La misère des réfugiés de Moria montre le vrai visage de la classe dirigeante
- 48 lectures
Nous publions ci-dessous un autre article du CCI, traduit de l'anglais, sur la tragédie des migrants du camp de Moria.
Dans la nuit du mercredi 9 septembre, le camp de réfugiés de Moria à Lesbos a brûlé. Près de 13 000 réfugiés, dont un tiers de mineurs et environ la moitié d'enfants de moins de douze ans, ont dû fuir les flammes - désormais exposés à la nature et plus ou moins abandonnés à eux-mêmes. Le camp de réfugiés, qui a été conçu pour 2 900 détenus, a accueilli environ 13 000 réfugiés. Lorsque la nouvelle de l'infection au Coronavirus de certains détenus s'est répandue et qu'une quarantaine a été ordonnée par les autorités, l'incendie a éclaté peu après. Les autorités ont accusé les réfugiés qui ne voulaient pas être mis en quarantaine d'avoir provoqué l'incendie. Les politiciens parlent d'une catastrophe humanitaire, mais en réalité, ce sont eux qui ont jeté de l’huile sur le feu.
Le fait est que depuis des années, l'UE mène une politique de fermeture des frontières aux réfugiés en leur bloquant la route des Balkans, en les confinant dans des camps, en rapatriant ceux appréhendés illégalement, en dissuadant ceux qui veulent prendre les bateaux sur la Méditerranée, en n'acceptant pas ou en retardant l'accueil des rescapés etc. Cette politique de construction de murs, de bouclage et d'expulsions ne se limite pas à l'UE. Elle est menée par les États-Unis - bien avant que Trump ne promette son " mur" - ainsi que par d'innombrables autres pays. Selon les chiffres officiels, 80 millions de personnes dans le monde sont en fuite, à la recherche désespérée d'un endroit où vivre et d'un avenir. Entre-temps, les gigantesques camps de réfugiés permanents des Rohingyas au Bangladesh, les réfugiés somaliens au Kenya (Dadaab), au Soudan, en Libye, ou les camps de fortune plus petits, par exemple sur la côte française en face de l'Angleterre, sont devenus une réalité quotidienne - en plus des innombrables personnes qui ont fui en raison du chaos politique et économique croissant, comme au Venezuela, ou de la destruction de l'environnement et du désastre écologique, et qui contribuent à la croissance rapide des bidonvilles dans les mégapoles d'Afrique, d'Amérique du Sud et d'Asie. Les camps de réfugiés et les bidonvilles des métropoles sont les deux faces d'une spirale de destruction, de guerres, de barbarie. En outre, le règne de la terreur (par exemple contre les Ouïgours, les Kurdes, etc.) et les pogroms dans de nombreuses régions font de la vie un enfer pour de plus en plus de gens.
Seule une petite partie de cette masse de personnes déplacées a atteint les côtes de la Méditerranée ou les frontières des États-Unis, où elles espèrent trouver un moyen de rejoindre les pays industrialisés, presque toujours au péril de leur vie. Mais la classe dirigeante a fermé les frontières. Fini le temps où les esclaves étaient volés en Afrique et exploités sans limites dans les plantations aux États-Unis, fini le temps où ils payaient des primes pour la main-d'œuvre bon marché de la Méditerranée, comme dans les années 1950 et 1960. Aujourd'hui, l'économie mondiale gémit sous le poids de sa crise - et pas seulement depuis la pandémie de la Covid-19, où tout s'est à nouveau détérioré de façon spectaculaire. Aujourd'hui, ce sont surtout les travailleurs bien formés qui sont recrutés de manière très sélective... les autres sont censés survivre ou périr.
Le capitalisme ne peut rien offrir à cette armée de millions de personnes désespérées
Parce que la combinaison de différents facteurs (guerre, destruction de l'environnement, crise économique, répression, catastrophes de toutes sortes) pousse de plus en plus de personnes à fuir, et qu'un nombre considérable d'entre elles se dirigeront vers les centres industriels, les niveaux de dissuasion les plus élevés possibles ont été établis. Ainsi, le conseiller du gouvernement allemand Gerald Knaus de l'Initiative européenne pour la stabilité a déclaré le 10 septembre sur la radio d'État allemande Deutschlandfunk : "Le ministre grec des réfugiés Notis Mitarakis dit que les gens devraient rester à Moria ou à Lesbos. Le camp a brûlé, les gens n'ont pas d'abri, ils sont assis dans la rue, c'est la perte totale de contrôle. (...) Et pourtant, le gouvernement grec n'exige pas de soutien extérieur. Pourquoi ? La réponse est évidente. Ces mauvaises conditions sont délibérées. Il s'agit d'une politique de dissuasion. Sur l'île, les tensions sont énormes. Les nationalistes grecs ont attaqué les organisations d'aide humanitaire. Il y a des groupes radicaux qui s'attaquent aussi aux demandeurs d'asile. (...) Faire partir les gens rapidement est dans l'intérêt de l'île, dans l'intérêt des migrants. Pourquoi y sont-ils détenus alors qu'ils savent (...) qu'aucune de ces personnes ne sera renvoyée en Turquie. (...) Il n'y a pratiquement plus d'expulsions en raison des restrictions de la Covid. (...) Cela signifie que nous avons beaucoup, beaucoup de personnes qui ont besoin de protection et beaucoup, beaucoup de migrants en situation irrégulière (...) qui sont détenus pour une seule raison : pour être dissuadés". La fermeture de la route des Balkans vise à "empêcher les gens de quitter la Grèce par la frontière nord, ce qui n'a de sens que si l'on dit ensuite que les gens en Grèce devraient y connaître des conditions si mauvaises que l'afflux en Grèce, c'est-à-dire dans l'UE, s'arrête". Ceci a une conséquence évidente : des conditions insupportables non seulement dans les camps de réfugiés, mais aussi pour les habitants locaux, dont certains attaquent ensuite violemment les réfugiés. Les réfugiés sont alors confrontés aux fils barbelés, au pouvoir armé de l'État et à la violence des bandes nationalistes... La même politique est également menée au large des côtes italiennes, où les réfugiés sauvés de bateaux en mauvais état en Méditerranée doivent être empêchés d'atteindre le continent européen le plus longtemps possible.
Cette tactique de dissuasion est d'ailleurs présentée aux réfugiés potentiels dans les médias sociaux par les institutions gouvernementales allemandes et européennes en Afrique et dans d'autres centres de rétention des réfugiés. Le message est le suivant : "Nous vous détiendrons aussi longtemps que possible, aussi brutalement, aussi inhumainement que des prisonniers et vous laisserons mourir misérablement dans des camps de réfugiés encore pires qu'en Afrique et en Asie, entourés de fils barbelés et de fortifications ; restez où vous êtes, même si vous n'avez plus de maison". Lorsque les politiciens parlent de "catastrophe humanitaire" dans cette situation, ils dissimulent le fait que ces personnes sont en réalité les otages de la politique de ce système, qui est défendu par la classe dirigeante par tous les moyens et dans tous les pays.
Méditerranée orientale : l'impasse globale du capitalisme concentré dans une seule région
La Méditerranée orientale est également un foyer des tendances destructrices du capitalisme : il y a un siècle, la Turquie et la Grèce se sont affrontées dans une guerre qui a vu la première "purification ethnique" organisée ; aujourd'hui, les deux rivaux impérialistes se font à nouveau face à propos du différend sur les ressources en gaz et en pétrole de la région. Mais en plus de la menace de guerre locale, le capitalisme menace également les populations par la crise économique et les explosions comme celles de Beyrouth, des facteurs qui pousseront encore davantage de personnes à fuir.
Le caractère impitoyables des dirigeants cachée derrière de belles phrases
L'infamie dans l'attitude de la classe dirigeante n'est pas atténuée par la prétention de faire preuve d'un peu de "pitié" envers les "plus faibles" parmi les réfugiés. Ce n'est qu'après que certaines forces issues des propres rangs des partis bourgeois, préoccupées par la perte de prestige des démocraties occidentales, ont exercé des pressions, et après que les administrations locales ont montré leur volonté d'accepter un contingent limité, que la France et l'Allemagne ont demandé que 400 jeunes "non accompagnés" soient autorisés à entrer. Et après presque une semaine de manœuvres dilatoires, 1500 enfants et leurs familles seront autorisés à entrer en Allemagne. Les 10 000 restants de Moria languiront en Grèce - sans parler des nombreux autres milliers bloqués dans d'autres camps de réfugiés sur les îles grecques. Les dirigeants se cachent derrière leur peur des populistes ou des chefs d'État en Hongrie, en Pologne, aux Pays-Bas et en Autriche, qui ne sont pas disposés à accepter des réfugiés. Aucun pays ne veut assumer seul le sort des réfugiés - et sous ce prétexte, ils insistent sur une approche européenne uniforme.
En fait, ils ne veulent pas attirer une nouvelle vague de réfugiés comme en 2015, et ils ne veulent pas permettre aux populistes de continuer leur ascension. Le gouvernement grec préfère enfermer les réfugiés qui survivent actuellement en plein air dans des camps nouvellement construits plutôt que de les laisser entrer sur le continent, d'où les détenus des camps pourraient alors continuer à fuir. Les dirigeants de l'Union européenne se sont inspirés de tous les manuels sur la construction des camps de Guantanamo, de Sibérie, des camps spéciaux de la RDA ou du Xinjiang. Prévenir la fuite à tout prix, dissuader par tous les moyens ! Leurs actions ne sont pas guidées par la nécessité de protéger les miséreux, mais par leur besoin de s'accrocher au pouvoir. Et ils défendent cette règle par tous les moyens, que ce soit par la construction de frontières infranchissables et de camps de prisonniers, ou par les belles phrases de la démocratie et de l'humanitarisme. La répression des manifestants en Biélorussie, les escadrons d'assassins de Poutine ou les camps de prisonniers ouïgours du Xinjiang sont dénoncés par les Européens, mais ceux-ci coopèrent eux-mêmes avec ces régimes depuis des années, même si parfois la coopération - notamment les contrats d'armement - est reportée, voire annulée.
Aux États-Unis, les démocrates et les républicains main dans la main condamnent les méthodes dictatoriales de la Chine, qui à Hong Kong utilise des commandos masqués contre les manifestants, mais Washington envoie la Garde nationale assistée elle aussi par des escadrons masqués de la police américaine, qui enlèvent également les manifestants dans des voitures banalisées. Que ce soit Loukachenko en Biélorussie, Poutine en Russie, Erdogan en Turquie, Duterte aux Philippines, Mohammed ben Salman en Arabie Saoudite, Xi Jinping en Chine, Trump aux États-Unis, etc. - ils défendent tous le même système et leur pouvoir sans pitié et avec des moyens souvent identiques.
Les solutions humanitaires ne sont que du vent : il faut aller à la racine du problème !
Il est vain de compter sur la pitié des dirigeants, et c'est au mieux une dangereuse illusion de croire que les problèmes auxquels le capitalisme nous confronte peuvent être éradiqués par des opérations de sauvetage humanitaires.
La demande "Pas de frontières, pas de nation" est une préoccupation réelle, mais elle ne peut être réalisée que par une lutte révolutionnaire qui abolira tous les États. Il ne suffit donc pas de s'indigner des conditions barbares auxquelles sont confrontés les réfugiés. La première étape doit être de reconnaître d'où vient le mal, puis de le dénoncer. Ce n'est qu'alors que nous pourrons aller à la racine du problème, ce qui signifie qu'il faut s'attaquer au capitalisme comme un tout.
Toubkal, 15.09.2020
Rubrique:
Trump ou Biden: le faux choix de la “démocratie” capitaliste
- 131 lectures
Le capitalisme, le système de production qui domine la planète et tous les pays qui s’y trouvent, est en train de sombrer dans un état avancé de décomposition. Un siècle de déclin lui fait atteindre les dernières marches, menaçant la survie de l’humanité, dans une spirale de guerres insensées, de dépression économique, de désastres écologiques et de pandémies dévastatrices.
Chaque État-nation sur Terre s’est engagé à maintenir ce système mourant. Chaque gouvernement, qu’il soit revêtu des habits démocratiques ou dictatoriaux, qu’il soit ouvertement pro-capitaliste ou faussement socialiste, trouve sa raison d’être dans la défense des véritables objectifs du capital : le développement du profit aux dépens du seul futur possible pour notre espèce, une communauté mondiale dans laquelle la production aura un seul but : la satisfaction des besoins humains.
C’est pourquoi le choix du parti ou du président qui devrait se saisir des rênes du gouvernement est un faux choix, qui ne peut empêcher la civilisation capitaliste d’aller droit à la catastrophe. Cela vaut autant pour les élections à venir aux États-Unis que pour n’importe quel autre cirque électoral.
Trump n’est pas l’ami des ouvriers…
Il est acquis pour beaucoup de personnes que Trump est un défenseur déclaré de tout ce qui est pourri dans le capitalisme : depuis ses dénégations sur la réalité de Covid 19 et du changement climatique, jusqu’aux justifications des brutalités policières qu’il a mises en avant au nom de la défense de la loi et l’ordre, en passant par ses tweets pour mobiliser les meutes d’extrême droite et encourager le racisme, ou encore le traitement dégradant qu’il réserve aux femmes qui l’approchent. Mais le fait qu’il soit, selon les termes de son ancien “tueur à gages” attitré, Michael Cohen, “un menteur, un escroc et un raciste” n’empêche pas une fraction importante de la classe capitaliste de le soutenir, parce que sa défense d’une économie ouvertement nationaliste et d’une dérégulation des services environnementaux et de la santé servent à accroître leurs profits.
Lors des dernières élections, Trump a convaincu beaucoup d’ouvriers américains que le protectionnisme au non de l’America first, sauverait leurs emplois et relancerait les industries traditionnelles. Mais, même avant la crise de Covid, l’économie mondiale (y compris la Chine) allait déjà vers une nouvelle récession que les conséquences de la pandémie vont rendre encore plus brutale. Le protectionnisme est une illusion car aucune économie ne peut se couper des lois impitoyables du marché mondial et les promesses de Trump aux travailleurs se sont déjà révélées trompeuses bien avant le début de la récession de 2019.
… mais les Démocrates non plus !
Selon Trump, Joe Biden menace de transformer l’Amérique en “utopie socialiste”, parce qu’il ne serait qu’une simple marionnette entre les mains de la “gauche radicale” personnifiée par les proches de Bernie Sanders et l’équipe (le squad) autour de Alexandria Ocasio-Cortez, Ilhan Omar et compagnie. (1)
En réalité, Biden a été choisi comme candidat démocrate car il représente la continuité dans le courant dominant de la politique Démocrate d’Obama et Clinton, qui a beaucoup à voir avec celle de Trump : le “pivot vers l’Est”, pour affronter l’impérialisme chinois, a été initié sous Obama, qui était aussi connu comme “l’expulseur en chef”, en raison du traitement impitoyable qu’il réservait aux immigrants “illégaux”. Bien sûr, les Démocrates ont des différences avec Trump : ils sont plus étroitement liés aux institutions militaires et sécuritaires, qui se méfient énormément de l’approche courtisane de Trump à l’égard de la Russie de Poutine ; ces institutions sont également gênées par les ruptures imprudentes des alliances et traités internationaux qui minent la crédibilité diplomatique des États-Unis. Mais ce sont des différences qui concernent le choix de la stratégie la plus adaptées pour l’impérialisme américain. De même, ils s’opposent au peu de respect de Trump pour les normes de la “démocratie” parce qu’ils savent à quel point la mystification démocratique est importante pour la préservation de l’ordre social.
Le parti Démocrate n’a jamais été autre chose qu’un parti d’alternance pour le capitalisme américain. Il est vrai qu’au cours des dernières années, il y a eu une croissance des groupes de pression interne comme l’Alliance socialiste démocratique, et des partisans du Green New Deal, Black Lives Matter et diverses formes de politiques identitaires au sein ou autour du parti officiel. Mais cette “gauche radicale” n’offre qu’une version plus à gauche du capitalisme d’État, auquel, dans un monde ravagé par la crise et la guerre, toutes les factions de la classe dirigeante (y compris la droite et les fanatiques de la libre entreprise) sont obligées d’adhérer. Aucune des politiques de gauche ne remet en question l’existence de l’État-nation, la production pour le profit, le salariat, qui sont l’essence de l’exploitation capitaliste et la source de ses contradictions insolubles.
La classe ouvrière détient la clef de l’avenir
Aucun politicien ou parti capitaliste ne peut offrir une issue à la crise de leur système. L’avenir du monde est entre les mains du prolétariat, de la classe qui produit tout ce dont nous avons besoin pour vivre, qui est exploitée dans tous les pays et qui a partout les mêmes intérêts : s’unir pour défendre ses conditions de travail et de vie, développer l’auto-organisation et la conscience nécessaires pour affronter le système capitaliste et proposer sa solution perspective historique : le socialisme authentique, ou, comme Marx a préféré l’appeler, le communisme, où l’humanité sera enfin libérée de l’État, des frontières nationales et de l’esclavage salarié.
Cela peut sembler une perspective très lointaine. Dans son existence quotidienne, la classe ouvrière est divisée de mille manières différentes : dans la compétition pour l’emploi, par les frontières nationales, par “sexe” et par “race”, surtout dans un pays comme les États-Unis avec son héritage empoisonné d’esclavage et de racisme.
Mais la classe ouvrière est aussi la classe du travail associé, qui est obligée de produire collectivement. Lorsqu’elle relève la tête, elle a tendance à surmonter les divisions dans ses rangs, car elle n’a pas le choix si elle veut éviter la défaite. Le racisme et le nationalisme sont certainement des outils puissants pour diviser les travailleurs, mais ils peuvent et doivent être surmontés pour faire avancer la lutte de classe. Lorsque la pandémie de Covid-19 a frappé pour la première fois, les travailleurs américains ont protesté contre le fait d’être contraints de travailler sans protection dans les usines automobiles, les hôpitaux, les supermarchés ou les entrepôts ; et les travailleurs, “blanc”, “noir”, “latino” ou autre, se tenaient côte à côte sur les lignes des piquets de grève.
De tels moments d’unité vont directement à l’encontre des expressions “classiques” de la division raciale : la suprématie blanche et les mouvements fascistes qui suintent du corps pourri du capitalisme. Mais ils vont aussi dans une autre direction que le mouvement Black Lives Matter (BLM) qui, plaçant la race au-dessus de la classe, se situe ouvertement sur le terrain bourgeois et se voit donc complètement instrumentalisé par les Démocrates, par des intérêts commerciaux dominants comme Mac Donald ou Apple, par les syndicats. En somme par une partie importante de l’État lui-même. Les luttes fondées sur la race ne peuvent pas conduire à l’unification de la classe ouvrière : des parties de la classe dirigeante sont heureuses de “s’agenouiller” et de donner leur bénédiction au mouvement BLM parce qu’elles savent que cela peut être utilisé pour cacher la réalité fondamentale du capitalisme, société reposant sur l’exploitation d’une classe par une autre.
La classe ouvrière aux États-Unis est confrontée à un énorme assaut idéologique à l’approche des élections, avec des politiciens et des superstars des médias qui proclament haut et fort que son seul espoir réside dans le vote, alors que son véritable pouvoir ne se trouve pas dans l’isoloir mais dans la lutte sur le lieu de travail et dans la rue. Elle est également confrontée au danger réel d’être entraînée dans des conflits violents entre milices armées, noires et blanches, comme nous l’avons vu dans certaines manifestations récentes de BLM. La société américaine est plus divisée que jamais depuis la guerre du Vietnam entre les deux grands partis de la bourgeoisie. Le danger d’une guerre civile sur un terrain complètement bourgeois pourrait s’accentuer encore à la suite des élections, surtout si Trump refuse de reconnaître le résultat sorti des urnes, ce qu’il a déjà laissé entendre. Cela ne fait que souligner la nécessité pour les travailleurs de refuser les appels des sirènes de droite et de gauche, de rejeter les faux choix du supermarché démocratique et de se rassembler autour de leurs propres intérêts de classe en menant un combat déterminé pour la destruction du capitalisme.
Amos, 26 septembre 2020.
1 Voir l’article en anglais “Trump contre The Squad” (groupe de quatre femmes parlementaires démocrates anti-Trump, NDT) : la détérioration de l’appareil politique aux États-Unis”, World Revolution n° 384, (automne 2019).
Géographique:
- Etats-Unis [184]
Rubrique:
L'ACG rejette les politiques identitaires mais “accepte” un État d’Israël démocratique et laïque
- 133 lectures
Le Groupe Communiste Anarchiste rejette les politiques identitaires mais “accepte” un État d’Israël démocratique et laïque
Depuis que nous avons écrit sur les éléments qui allaient fonder le Groupe Communiste Anarchiste (ACG) en février 20181, cette organisation est passée par un processus de définition de son parcours et de détermination de son programme. Son principal objectif était de se détourner de la domination de la politique identitaire, telle qu’elle s’était développée dans la Fédération anarchiste et dans le milieu anarchiste en général, et de revenir à la lutte de classe comme base fondamentale de ses activités.
Après sa fondation, ce groupe a fait quelques pas, comme il l’a dit, « pour rompre avec le marais de l’anarchisme traditionnel"2 et dans la direction des positions de classe.
En juin 2018, il a pris l’initiative de lancer une campagne derrière le slogan « Pas de guerre, mais la guerre de classe » (NWBCW).
D’autres participants à cette initiative étaient également le Guildford Solidarity Group et une organisation de la Gauche Communiste : la CWO. Lors de l’inauguration de cette campagne, ces trois groupes ont organisé une réunion commune à Londres. L’année suivante, l’ACG a organisé différentes réunions publiques sur le sujet, dont certaines ont été organisées avec le CWO, comme en janvier et avril 2019.3
En différentes occasions, il a défendu la lutte de classe comme seule solution pour la libération de tous ceux qui sont soumis à l’oppression par le capitalisme, comme ce fut le cas lorsqu’un membre de l’ACG a fait une présentation dans une réunion du Rebel City Collective à l’Anti-University à Londres en juin 2018 : « Bien que la lutte contre les oppressions puisse être prioritaire pour les opprimés à différents moments, en fin de compte, elle ne parviendra à une libération totale des femmes de la classe ouvrière ou des personnes de couleur que lorsque les classes seront abolies"4.
Ceci dit, nous devons également établir que les tentatives du groupe de quitter le marais anarchiste n’ont pas vraiment réussi, car il y a trop de points sur lesquels il n’a pas pu faire de progrès significatifs vers des positions communistes. Un des exemples frappants est la façon dont il veut résoudre le problème de l’antisionisme dans l’article « Politique identitaire et antisémitisme à gauche"5.
La gauche et l’antisionisme
Depuis de nombreuses années, une campagne intense est menée en Grande-Bretagne contre les groupes et les individus gauchistes qui défendent une position antisioniste. La campagne a été dirigée en particulier contre l’aile gauche du parti travailliste qui a été ouvertement accusée d’antisémitisme. En réponse à cette campagne, certains anarchistes ont décidé de prendre le parti du parti travailliste.
En 2016, « Winter Oak », un groupe anarchiste particulièrement soucieux de l’écologie, n’a pas encore pris ouvertement parti pour le parti travailliste, mais a mis en garde contre « une nouvelle arme idéologique toxique [qui] a été déclenchée par le système capitaliste (…) : l’accusation d’ “antisémitisme” dans le cadre de la chasse aux sorcières. Ce phénomène a atteint son paroxysme au Royaume-Uni ces dernières semaines avec des accusations fébriles d'“antisémitisme” au sein du parti travailliste de Jeremy Corbyn, qui semble être considéré comme dangereusement radical ».6
David Graeber a cependant ouvertement défendu le parti travailliste contre cette campagne de diffamation. En décembre 2019, il a posté plusieurs messages sur Twitter, ciblant le reportage du Guardian sur l’antisémitisme institutionnalisé au sein du parti travailliste. « Si vous additionnez ce qui est faux et trompeur, 90 % de nouveaux articles du Guardian sur la controverse de l’IHRA7 ont été conçus pour tromper le lecteur en lui faisant croire à tort que le Labour était institutionnellement antisémite. C’était un crime historique contre la vérité. Qui étaient les rédacteurs ? Il faut leur faire honte pour cela"8.
Bien qu’il s’agisse d’une véritable campagne idéologique menée par diverses fractions bourgeoises, cela ne signifie pas que l’antisémitisme n’existe pas au sein du Parti travailliste. Corbyn et les trotskystes ont en effet fait et font encore cause commune avec les bandes islamistes les plus extrêmes comme le Hamas et le Hezbollah, et ce faisant, ils agissent comme « un véhicule non seulement d’un antisémitisme plus honteux, mais aussi de ses manifestations les plus ouvertes"9. L’ACG est capable de faire face à cette réalité lorsqu’il écrit que « beaucoup de ceux qui soutiennent la cause palestinienne (…) semblent véritablement incapables de faire la distinction entre critiquer Israël et semer la haine contre un peuple » et que « les idées de l’aile gauche sur l’antisionisme sont de plus en plus colonisées par des formes d’antisémitisme"10.
En raison de l’intensité de cette campagne, en Grande-Bretagne (et ailleurs), il est en effet devenu de plus en plus difficile de critiquer l’État d’Israël sans être accusé d’antisémitisme. Et tout élément ou groupe qui se considère comme faisant partie de la gauche en général – contrairement à la Gauche communiste révolutionnaire – est confronté à ce dilemme. Afin de contourner ce dilemme, l’ACG a donc décidé de ne plus parler d’antisionisme. Au lieu de cela, il affirme « qu’il est beaucoup plus sûr d’utiliser des expressions plus précises et sans ambiguïté comme s’opposer à l’État israélien, à ses polices ou à ses actions"11.
Selon l’ACG, « un problème se pose lorsque nous voyons les identités avant de voir les relations"12, en d’autres termes : avant de voir les classes. Si les classes étaient placées en premier et les identités en second, on serait, semble-t-il, libéré du problème de l’identification de l’antisionisme avec l’antisémitisme. Le problème de l’identification des deux a-t-il vraiment été résolu par cela ? Nous ne le pensons pas. La politique identitaire, qui est un piège pour la lutte de la classe ouvrière, comme l’AGC le reconnait à juste titre, est persistante et plus difficile à combattre que ne le pense l’ACG.
C’est ce que montre très clairement l’article de l’ACG dans lequel il lance un appel pour aider « le mouvement antiraciste dans ce pays et dans le monde » avec l’argument suivant : « le racisme, les autres préjugés et les systèmes d’oppression sont si étroitement liés qu’en luttant contre l’un d’entre eux, nous luttons aussi contre les autres"13. Ici, l’ACG fait à nouveau passer la race avant les classes puisqu’il part du principe que combattre le racisme signifie automatiquement combattre le capitalisme.
« Le racisme divise la classe ouvrière contre elle-même"14, écrit l’ACG, et c’est bien sûr vrai, mais il oublie que son soutien à l’antiracisme divise tout autant la classe ouvrière. Et la photo de l’article, avec sa publicité pour Black Lives Matter, une campagne qui place la race au-dessus de la classe, ne fait que le souligner.
Mais revenons à la question de l’antisionisme. Dans sa tentative d’éviter l’utilisation de ce mot, un autre problème est apparu : celui de l’acceptation de l’État d’Israël seulement s’il était « un État laïque, non discriminatoire et démocratique », puisque « les États existent, et nous devons travailler dans le cadre de la réalité que nous avons devant nous"15. Quel est le sens de cette déclaration, qui est indissociable des programmes de la gauche antisioniste ? Les anarchistes n’ont-ils pas toujours essayé de rejeter et de combattre l’État bourgeois en tant qu’organe répressif au service de la classe dominante ?
Dans les écrits plus généraux de l’ACG, il ne semble pas y avoir de confusion sur ce point. « L’État est le moyen par lequel la classe dirigeante conserve et renforce son pouvoir"16. « Tout système économique basé sur le travail salarié et la propriété privée nécessitera un appareil d’État coercitif pour faire respecter les droits de propriété et pour maintenir les relations économiques inégales qui en découleront inévitablement"17. Mais, si c’est vraiment la conception que l’ACG se fait de l’État, il doit au moins expliquer comment il concilie sa position anti-étatique avec la phrase selon laquelle, dans le cas d’Israël, « un État laïque, non discriminatoire et démocratique » est “acceptable” ?
La question de la politique identitaire ne peut être résolue en la rejetant par la porte pour la laisser entrer par la fenêtre. Même au-dessus de l’article, dans lequel l’ACG dit qu’il préfère ne plus utiliser le mot “sionisme”, il y a une image affichant le slogan : « Confrontez le sionisme, boycottez Israël », signé par le Réseau international juif antisioniste. Toute cette astuce avec le mot “sionisme” ne rapproche pas le groupe de la position internationaliste qu’il prétend défendre. Au contraire, il est toujours submergé dans la campagne internationale qui oblige chacun à soutenir ou à rejeter la “légitimité” de l’État sioniste.
Le chemin difficile de l’internationalisme
Il y a dix ans, nous avons écrit sur l’anarchisme internationaliste. Et nous avons défendu les tendances internationalistes au sein de l’anarchisme comme une expression de l’internationalisme prolétarien. Aujourd’hui, nous pensons qu’un groupe comme l’ACG défend globalement les positions internationalistes. Mais cette position n’est pas clairement et solidement établie et ne repose pas sur une approche de classe : sur le prolétariat en tant que classe qui ne peut s’émanciper lui-même qu’en émancipant l’ensemble de la population mondiale non exploitante du fléau de l’exploitation et de la répression au moyen d’une révolution mondiale.
C’est pourquoi nous avons également souligné que « Le mouvement anarchiste (…) reste un milieu très hétérogène. Tout au long de son histoire, une partie de ce milieu a sincèrement aspiré à la révolution et au socialisme, exprimant une réelle volonté d’en finir avec le capitalisme et l’exploitation. Ces militants se sont effectivement placés sur le terrain de la classe ouvrière lorsqu’ils ont affirmé leur internationalisme et se sont consacrés eux-mêmes à rejoindre son combat révolutionnaire ». Mais « privés de la boussole de la lutte de classe du prolétariat et de l’oxygène de la discussion et du débat avec les minorités révolutionnaires qui en émanent, des éléments qui tentent de défendre les principes de classe se sont souvent trouvés piégés dans les contradictions intrinsèques de l’anarchisme"18.
Et c’est exactement ce que nous voyons aujourd’hui avec l’ACG. Il n’est pas capable de défendre une position internationaliste consistante. Nous pouvons le voir avec leur position “acceptant” un Israël laïque et démocratique. Mais on le voit aussi, par exemple, dans sa déclaration concernant l’invasion de l’armée turque et la situation autour de l’Afrique : « Une position internationaliste ».
La déclaration commence par une dénonciation claire des différentes fractions bourgeoises dans le conflit impérialiste. « En tant que communistes anarchistes, nous ne soutenons aucune fraction dans une guerre inter-impérialiste (…). Nous ne soutenons pas non plus les partis politiques nationalistes qui ont pour but d’établir de nouveaux États, quelle que soit la rhétorique libertaire. Il peut y avoir des exemples d’auto-organisation dans les régions de Rojava mais (…) il ne s’agit pas d’un mouvement vers une véritable auto-organisation si vous êtes capable de le faire parce que le grand leader a dit que c’est ce que vous devriez faire"19.
Jusqu’à présent, tout va bien, mais l’ACG sort un lapin de son chapeau en terminant cette déclaration par ces mots : « la situation est très compliquée et (…) nous ne soutenons pas sans réserve les partis nationalistes tels que le YPD, qui ont pris la tête de la résistance"20, ce qui semble au moins impliquer qu’il apporte son soutien “critique” aux partis nationalistes tels que le YPD ; bien qu’il caractérise également ce parti dans le même article comme « l’un des partis politiques hautement disciplinaires et autoritaires"21.
Le soutien au « moindre mal » conduit à l’abandon de l’internationalisme
Pour l’ACG, il n’existe soi-disant pas de « moindre mal" : « Aucune fraction de la classe capitaliste ne mérite d’être soutenue et aucune n’est « un moindre mal »!22. Mais, d’après notre expérience, nous savons que l’anarchisme finit très souvent par choisir le « moindre mal ». Si les Kurdes sont attaqués par Saddam, il y a des anarchistes qui considèrent la cause des Kurdes comme un moindre mal et qui les soutiennent – surtout s’ils font la publicité d’une idéologie de « confédéralisme démocratique » et parlent d’une « révolution de Rojava ». Si les Catalans se soulèvent contre le régime autoritaire de Madrid en 2017, il y a des anarchistes qui considèrent la cause des Catalans comme un moindre mal et qui ont tendance à les soutenir.
Un exemple clair de cette politique du « moindre mal » est donné par l’article, récemment publié par un groupe aux Philippines sur le site web de l’ACG sans aucune critique, intitulé « Philippines : appel à la solidarité internationale ». Cet article se termine par un slogan qui dit : « Luttez pour la justice sociale ! Combattez le fascisme et le terrorisme d’État !"23. De plus, au-dessus de l’article, il y a une photo sur laquelle on peut lire « Détruisez le fascisme ». L’ACG prétend défendre la lutte du prolétariat sur son propre terrain de classe, mais ce slogan n’a rien à voir avec la lutte de la classe ouvrière et ne fait que détourner les travailleurs de leur terrain de classe. Les slogans appellent à la lutte pour la démocratie en général qui, en fin de compte, ne signifie rien d’autre que la démocratie bourgeoise. C’est un piège pour l’anarchisme qui remonte à sa politique des années 1930.
L’ACG ne considère pas les ministres de la CNT-FAI en 1936-1937 comme de véritables anarchistes et écrit que leur politique antifasciste « a ouvert la voie à la Seconde Guerre mondiale ».24. Mais comment l’ACG explique-t-il alors ce qui s’est passé après le 6 octobre 1934, lorsque Luís Companys avait déclaré un État catalan libre dans une République fédérale espagnole ? Car après la suppression de cette proclamation par l’armée espagnole et l’arrestation du gouvernement catalan, la CNT a publié un Manifeste dans lequel elle se présente elle-même « comme le meilleur rempart contre le fascisme et insiste sur son droit de contribuer à la lutte antifasciste. Contre toute la tradition de la CNT et contre la volonté de nombreux militants anarchistes, elle a abandonné le terrain de la solidarité ouvrière pour embrasser le terrain de l’antifascisme et du soutien “critique” au nationalisme catalan ».25
Pendant la Seconde Guerre mondiale, ce même antifascisme a attiré les anarchistes dans l’orbite des pays alliés. Les anarchistes ont formé des groupes de combat antifascistes dans toute l’Italie pour défendre le « moindre mal » contre le régime de Mussolini, même en hommage à Malatesta qui n’avait, lui, jamais trahi l’internationalisme : « À Gênes, les groupes de combat anarchistes opéraient sous les noms de la brigade “Pisacane”, de la formation “Malatesta”, de la SAP-FCL, de la Sestri Ponente SAP-FCL et des Escadrons d’action anarchiste d’Arenzano. (…) Les anarchistes ont fondé les brigades “Malatesta” et “Bruzzi”, qui comptaient 1300 partisans : elles opéraient sous l’égide de la formation “Matteotti” et ont joué un rôle de premier plan dans la libération de Milan"26.
Les exemples ci-dessus montrent clairement que, dans la pratique de la lutte quotidienne, il n’est pas si facile pour une organisation anarchiste de maintenir sa position internationaliste. Et la raison principale de cet échec est que l’anarchisme, et même le communisme anarchiste, n’ont pas une compréhension claire de ce qu’est le prolétariat ni une méthode historique pour clarifier ses tâches à des époques particulières. Sans une telle méthode, il est impossible d’élaborer un programme politique solide, universel et cohérent, tel qu’il a été élaboré notamment par les organisations de la Gauche communiste. Nous y reviendrons dans un autre article.
Dennis, juillet 2020
3Le groupe NWBCW semble avoir cessé d’exister. L’année dernière, il n’y a pas eu d’activité commune, en dehors de l’article de la Tendance Communiste internationale.
4« La classe est-elle toujours pertinente ? Une perspective communiste anarchiste »; ACG, 24 juin 2018. [187]
528 mai 2020 ; ACG. [188]
6« Chasse aux sorcières : la diffamation de l’antisémitisme est une guerre idéologique" ; Winter Oak ; avril 2016.
7Cette controverse portait sur le fait que le parti travailliste avait initialement refusé d’accepter la définition de l’antisémitisme élaborée par l’Alliance internationale pour la mémoire de l’Holocauste.
11Ibid.
12Ibid.
14Ibid.
16« La classe est-elle toujours pertinente ? Une perspective anarchiste communiste" ; ACG, 24 juin 2018. [187]
17Le communisme anarchiste – une introduction ; ACG, 13 novembre 2017.
18« Les anarchistes et la guerre » (partie 2) : la participation anarchiste à la Seconde Guerre mondiale » [192]; Révolution Internationale n° 326.
20Ibid.
21Ibid.
23ACG, 10 juin 2020. [195]
24« La dernière tentative de réaffirmer les intérêts des masses ouvrières a eu lieu pendant les journées de mai de 1937. La CNT et la FAI, avec ses ministres “anarchistes” en tête, ont mis fin à l’escalade de la guerre de classes et la révolution espagnole est morte. Les militants dissidents de la CNT-FAI, les Amis de Durutti, ont résumé la situation en disant que « c’est la démocratie qui a vaincu le peuple espagnol, pas le fascisme ». L’Espagne antifasciste avait détruit la révolution espagnole et ouvert la voie à la Seconde Guerre mondiale ». (in « La tradition : d’où vient notre politique ? » ; ACG, 14 novembre 2017)
25« L’échec de l’anarchisme pour empêcher l’intégration de la CNT à l’Etat bourgeois (1931-34)" [196]; Revue internationale n° 132 – 1er trimestre 2008.
26« Les anarchistes et la guerre » (partie 2) : la participation anarchiste à la Seconde Guerre mondiale » [192]; Révolution Internationale n° 326.
Rubrique:
ICConline - novembre 2020
- 57 lectures
Les prolétaires doivent s'opposer à la république bourgeoise et au capitalisme
- 127 lectures
Après le meurtre atroce du professeur Samuel Paty et, dix jours plus tard, de trois personnes dans l’église de Nice, la bourgeoisie française a bondi sur l’occasion pour tenter de récupérer ces crimes en appelant les « citoyens » à se mobiliser, comme ce fut le cas le dimanche 18 octobre, pour défendre la Démocratie, la République et ses « valeurs » telles que la « laïcité » et la « liberté d’expression ». Une nouvelle fois, la classe dominante joue la carte de « l’union nationale » qui tendrait à faire croire que, malgré les différences de conditions de vie, bourgeois et prolétaires appartiendraient à la même « communauté » et auraient tout à gagner à défendre, main dans la main, la patrie, le régime républicain et la démocratie. Il n’y a rien de plus faux ! Très loin de permettre aux exploités de s’émanciper, la démocratie et le régime républicain demeurent les formes politiques les plus subtiles de la domination capitaliste et de la bourgeoisie sur le reste de la société. Les lecteurs pourront trouver ci-dessous des articles déjà parus dans notre presse qui font échos aux évènements tragiques de ces deux dernières semaines :
-
“ [197]La liberté d’expression” et “de la presse” : l’illusion entretenue par le capital [197]
-
La laïcité, une arme idéologique contre la classe ouvrière (partie I) [198]
-
La laïcité, une arme idéologique contre la classe ouvrière (partie II) [199]
-
Attentats à Paris : À bas le terrorisme ! À bas la guerre ! À bas le capitalisme ! [200]
D’autre part, nous publions ci-dessous deux extraits de textes classiques du mouvement ouvrier : l’un tiré de l’ouvrage de Friedrich Engels L’origine de la famille, de la propriété privée et de l’État, l’autre tiré de L’État et la révolution de Lénine. Tous deux démontrant la vraie nature de la République démocratique et de l’Etat bourgeois.
Friedrich Engels, L’origine de la famille, de la propriété privée et de l’Etat, chapitre IX : « Barbarie et civilisation ».
« Comme l'État est né du besoin de refréner des oppositions de classes, mais comme il est né, en même temps, au milieu du conflit de ces classes, il est, dans la règle, l'État de la classe la plus puissante, de celle qui domine au point de vue économique et qui, grâce à lui, devient aussi classe politiquement dominante et acquiert ainsi de nouveaux moyens pour mater et exploiter la classe opprimée. C'est ainsi que l'État antique était avant tout l'État des propriétaires d'esclaves pour mater les esclaves, comme l'État féodal fut l'organe de la noblesse pour mater les paysans serfs et corvéables, et comme l'État représentatif moderne est l'instrument de l'exploitation du travail salarié par le capital. [...]
Dans la plupart des États que connaît l'histoire, les droits accordés aux citoyens sont en outre gradués selon leur fortune et, de ce fait, il est expressément déclaré que l'État est une organisation de la classe possédante, pour la protéger contre la classe non possédante. C'était déjà le cas pour les classes d'Athènes et de Rome établies selon la richesse. C'était le cas aussi dans l'État féodal du Moyen Age, où le pouvoir politique se hiérarchise selon la propriété foncière. C'est le cas dans le cens électoral des États représentatifs modernes. Pourtant, cette reconnaissance politique de la différence de fortune n'est pas du tout essentielle. Au contraire, elle dénote un degré inférieur du développement de l'État. La forme d'État la plus élevée, la république démocratique, qui devient de plus en plus une nécessité inéluctable dans nos conditions sociales modernes, et qui est la forme d'État sous laquelle peut seule être livrée jusqu'au bout l'ultime bataille décisive entre prolétariat et bourgeoisie, la république démocratique ne reconnaît plus officiellement, les différences de fortune. La richesse y exerce son pouvoir d'une façon indirecte, mais d'autant plus sûre. D'une part, sous forme de corruption directe des fonctionnaires, ce dont l'Amérique offre un exemple classique, d'autre part, sous forme d'alliance entre le gouvernement et la Bourse ; cette alliance se réalise d'autant plus facilement que les dettes de l'État augmentent davantage et que les sociétés par actions concentrent de plus en plus entre leurs mains non seulement le transport, mais aussi la production elle-même, et trouvent à leur tour leur point central dans la Bourse. En dehors de l'Amérique, la toute récente République française en offre un exemple frappant, et la brave Suisse, elle non plus, ne reste pas en arrière, sur ce terrain-là. Mais qu'une république démocratique ne soit pas indispensable à cette fraternelle alliance entre le gouvernement et la Bourse, c'est ce que prouve, à part l'Angleterre, le nouvel Empire allemand, où l'on ne saurait dire qui le suffrage universel a élevé plus haut, de Bismarck ou de Bleichröder1. Et enfin, la classe possédante règne directement au moyen du suffrage universel. Tant que la classe opprimée, c'est-à-dire, en l'occurrence, le prolétariat, ne sera pas encore assez mûr pour se libérer lui-même, il considérera dans sa majorité le régime social existant comme le seul possible et formera, politiquement parlant, la queue de la classe capitaliste, son aile gauche extrême. Mais, dans la mesure où il devient plus capable de s'émanciper lui-même, il se constitue en parti distinct, élit ses propres représentants et non ceux des capitalistes. Le suffrage universel est donc l'index qui permet de mesurer la maturité de la classe ouvrière. Il ne peut être rien de plus, il ne sera jamais rien de plus dans l'État actuel; mais cela suffit. Le jour où le thermomètre du suffrage universel indiquera pour les travailleurs le point d'ébullition, ils sauront, aussi bien que les capitalistes, ce qu'il leur reste à faire.
L'État n'existe donc pas de toute éternité. Il y a eu des sociétés qui se sont tirées d'affaire sans lui, qui n'avaient aucune idée de l'État et du pouvoir d'État. A un certain stade du développement économique, qui était nécessairement lié à la division de la société en classes, cette division fit de l'État une nécessité. Nous nous rapprochons maintenant à pas rapides d'un stade de développement de la production dans lequel l'existence de ces classes a non seulement cessé d'être une nécessité, mais devient un obstacle positif à la production. Ces classes tomberont aussi inévitablement qu'elles ont surgi autrefois. L'État tombe inévitablement avec elles. La société, qui réorganisera la production sur la base d'une association libre et égalitaire des producteurs, reléguera toute la machine de l'État là où sera dorénavant sa place: au musée des antiquités, à côté du rouet et de la hache de bronze. »
***
Lénine, L’État et la révolution, chapitre IV. « Explications complémentaires d’Engels ».
« Dans les considérations habituelles sur l'État, on commet constamment l'erreur contre laquelle Engels met ici en garde et que nous avons signalée plus haut en passant; on oublie constamment que la suppression de l'État est aussi la suppression de la démocratie, que l'extinction de l'État est l'extinction de la démocratie.
Une telle assertion paraît, à première vue, des plus étranges et inintelligibles; peut-être même certains craindront-ils que nous souhaitions l'avènement d'un ordre social où ne serait pas observé le principe de la soumission de la minorité à la majorité; car, enfin, la démocratie n'est-elle pas la reconnaissance de ce principe ?
Non. La démocratie et la soumission de la minorité à la majorité ne sont pas des choses identiques. La démocratie, c'est un Etat reconnaissant la soumission de la minorité à la majorité ; autrement dit, c'est une organisation destinée à assurer l'exercice systématique de la violence par une classe contre une autre, par une partie de la population contre l'autre partie.
Nous nous assignons comme but final la suppression de l'État, c'est-à-dire de toute violence organisée et systématique, de toute violence exercée sur les hommes, en général. Nous n'attendons pas l'avènement d'un ordre social où le principe de la soumission de la minorité à la majorité ne serait pas observé. Mais, aspirant au socialisme, nous sommes convaincus que dans son évolution il aboutira au communisme et que, par suite, disparaîtra toute nécessité de recourir en général à la violence contre les hommes, toute nécessité de la soumission d'un homme à un autre, d'une partie de la population à une autre; car les hommes s'habitueront à observer les conditions élémentaires de la vie en société, sans violence et sans soumission.
C'est pour souligner cet élément d'accoutumance qu'Engels parle de la nouvelle génération "grandie dans des conditions sociales nouvelles et libres" et qui sera "en état de se défaire de tout ce bric-à-brac de l'État", de tout État, y compris celui de la république démocratique. »
1 Le directeur de la banque berlinoise qui portait son nom.
Personnages:
- Samuel Paty [202]
Récent et en cours:
- Terrorisme [203]
- Démocratie et capitalisme [204]
- République bourgeoise [205]
Questions théoriques:
- Terrorisme [206]
Rubrique:
Manifestations dans le secteur de la santé en Grande-Bretagne : remettre en cause « l'unité nationale »
- 33 lectures
Le 8 août dernier et les week-ends suivants, nous avons vu des milliers de travailleurs de la santé britanniques descendre dans les rues des grandes villes pour protester avec colère contre les bas salaires, les frais de scolarité élevés, l'augmentation sans fin de la charge de travail et des horaires décalés, le manque d'équipements de protection individuelle (EPI) contre la propagation de Covid-19, le sous-financement chronique du secteur et la présentation par le gouvernement de leur "sacrifice héroïque" comme un fardeau mortel qu'ils porteraient avec enthousiasme.
Au cours des périodes précédentes, de telles expressions de combativité de la part de groupes de travailleurs tentant de défendre leurs conditions de vie et de travail pouvaient sembler chose courante. Cependant, dans la mesure où elles s’inscrivent dans un contexte particulier où les travailleurs montrent les premiers signes d’une reprise des luttes après un recul global de la combativité et de la conscience au cours des dernières décennies1 - et en particulier, en se produisant sur fond d'"unité nationale" exigée par les gouvernements face à la crise de Covid - ces expressions de lutte de classe sont remarquables.
Largement organisée au niveau local par les infirmières, les travailleurs des maisons de soins et d'autres personnels du secteur de la santé, mais coordonnée et encadrée par des comités syndicaux et des groupes en marge du Parti Travailliste, cette lutte a été menée à travers des dizaines de manifestations, notamment à Leeds, Liverpool, Manchester et Glasgow. Ces mobilisations visaient à dénoncer le stress provoqué par la mort de collègues et de patients (plus de 540 membres du personnel de santé avaient alors péri) et le fait de ne pas savoir s'ils étaient eux-mêmes infectés ou s'ils transmettaient des maladies à leurs familles. Mais également la lutte pour survivre devant les dettes contractées au cours de leurs études, où les sommes peuvent atteindre 60 000, voire 90 000 livres. Ou encore la nécessité de vivre avec des salaires réels qui, dans de nombreux cas, ont chuté de 20 % au cours des dix dernières années, malgré les grèves de 50 000 médecins en formation en 2016 et un "accord" de rémunération de trois ans pour les autres membres du personnel en 2018.
Surtout, les travailleurs étaient et restent furieux d'avoir été exclus des "compensations" salariales accordées en juillet par le gouvernement à quelque 900 000 travailleurs "clés" du secteur public, dont des membres des forces armées, des fonctionnaires, des éléments du système judiciaire et des médecins en chef pour leur participation à la "bataille" contre Covid, mais en ignorant les infirmières et les soignants. Nous reviendrons sur cet aspect plus loin.
La nature ad hoc des protestations - le fait que les travailleurs n'ont pas attendu que "leurs" syndicats expriment leur colère évidente - a été encore renforcée dans les cortèges des manifestants par des pancartes, en grande partie faites maison, portant des slogans tels que : "Héros à 0%", "Les applaudissements ne paient pas les factures", "Payez au NHS un salaire équitable - vous nous le devez" (NHS : National Health Service), "Certaines blessures ne guérissent pas", "Arrêtez d'applaudir et agissez" et "Une infirmière, c'est pour la vie, pas seulement pour Covid-19". Les manifestations (100 travailleurs à Cambridge, 100 à Bournemouth, 2000 à Londres et d’autres similaires dans tout le pays) ont attiré surtout des jeunes travailleurs qui n'avaient jamais manifesté ou entamé une lutte prolétarienne auparavant, ainsi que quelques "vieux", arrivant à la fin de leur service, qui voulaient montrer leur solidarité avec des collègues confrontés à des pressions de plus en plus intolérables. Ils ont surtout utilisé les médias sociaux tels que les groupes Facebook de travailleurs de la santé, qui revendique 80 000 membres sur ce site, avec des titres comme « Les travailleurs du NHS disent NON à l'inégalité salariale dans le secteur public ! », « le NHS doit payer les 15 % qui nous sont dûs » (un appel repris lors d'une manifestation du 26 août par les travailleurs des hôpitaux Guy et St. Thomas de Londres), et « Infirmières toutes unies », afin de rallier des soutiens. Les banderoles syndicales ont été largement remarquées par leur absence, bien que les groupes politiques "radicaux" ne manquaient pas, arguant que les manifestants devraient avoir pour objectif de rendre les syndicats "plus combatifs". De telles idées semblent avoir un écho car, à notre connaissance, aucun des groupes de manifestants n'a directement remis en cause les syndicats ou le syndicalisme.
Rejeter la paix sociale et le sacrifice
Pendant des mois, les travailleurs de la santé ont été abreuvés de discours sur leur participation à un "effort national" - y compris les unités de l'armée et le recrutement de milliers de "bénévoles" (à une époque où les contrats "zéro heure sup’" payée se multiplient et où le spectre du chômage massif se profile à l'horizon !) - en mettant leur vie en "première ligne" de la "guerre contre Covid", en faisant "tout le nécessaire". Il semble qu'ils aient fait d’interminables heures supplémentaires, renoncé aux vacances et aux instructions concernant les EPI (ou l'absence d'EPI) qui changeaient de jour en jour. Les manifestations de colère, bien qu'à petite échelle et limitées, ont donc montré une réelle résistance à la pression exercée par l'État pour travailler plus longtemps sans être payés davantage, "pour le bien et l’intérêt de la Nation". Elles ont atténué la tentative d'invoquer "l'esprit guerrier" et la militarisation des campagnes idéologiques du "nous sommes tous dans le même bateau". Ce faisant, les travailleurs de la santé se sont fait l'écho des luttes de millions d'autres personnes dans le monde qui tentent de s'opposer collectivement à l'exploitation croissante - et souvent à la répression - exigée par le capital. En voici quelques exemples :
- Sur le continent africain, des grèves de travailleurs de la santé ont été rapportées par la presse, entre autres, au Kenya, en Égypte, au Zimbabwe, au Nigeria, au Ghana et au Sierra Leone, avec des manifestations au Lesotho et au Malawi : "L'Afrique du Sud a connu et de loin, le plus grand nombre de grèves et de débrayages, où le gouvernement prévoit de réduire les salaires des infirmières dans le cadre d'un plan plus large visant à réduire les salaires du secteur public avant de se tourner vers le FMI pour obtenir un prêt".2 Les infirmières en grève ont été menacées de mesures "disciplinaires" et certaines ont été hospitalisées à cause de balles en caoutchouc et de grenades paralysantes utilisées par la police ;
- En Inde, en juin et juillet, le personnel de deux hôpitaux de la capitale, New Delhi, a manifesté contre le manque d'EPI et le licenciement de 84 collègues pour avoir soulevé des questions de sécurité. Ceci fut le prélude d'une grève nationale de deux jours au mois d'août, qui a rassemblé au moins 21 États et environ 3,5 millions de travailleurs de différents secteurs de l'économie, sous l'impulsion de quelque 600 000 membres de l'organisation exclusivement féminine Accredited Social Health Activists de la part « des travailleurs qui se rendent dans des zones rurales à faible revenu pour fournir des soins de santé essentiels ».3
- En Californie, aux États-Unis, « les revenus des hôpitaux ont diminué de plus d'un tiers depuis le début de la pandémie, et les pertes ont obligé les travailleurs de la santé à des réductions de salaire ou même des congés pour compenser dans certains cas ».4 Une grève de 700 travailleurs de la santé au Santa Rosa Memorial Hospital pour protester contre l'insuffisance des équipements de protection, la réduction des prestations et les "effectifs de personnels dangereux", n’était qu'une réaction régionale.
En effet, « Dans au moins 31 des pays étudiés par Amnesty International, les chercheurs et chercheuses ont constaté que le personnel de santé et des autres secteurs essentiels s’était mis en grève, avait menacé de faire grève ou avait manifesté à cause de ses conditions de travail dangereuses. Dans de nombreux pays, ce type d’actions a donné lieu à des représailles des autorités. »5 ;
- En Russie, les médecins qui se plaignaient d'un manque d'EPI étaient inculpés par les lois sur les fake news et risquaient des amendes et/ou un licenciement ;
- En Malaisie, « la police a dispersé un piquet de grève pacifique dans une entreprise de services d’entretien des hôpitaux ... et inculpé cinq personnes travaillant dans le secteur de la santé qui manifestaient, pour « rassemblement non autorisé » » ;
- En Égypte, « neuf personnes travaillant dans le secteur de la santé [ont été] détenues de façon arbitraire entre mars et juin pour des accusations vagues et trop larges de « diffusion de fausses nouvelles » et « terrorisme ». ».
Les manœuvres contre la classe ouvrière
Mais les représailles et la répression ne sont pas les principaux moyens utilisés par la classe dirigeante pour imposer son "état d'urgence" à la classe ouvrière. Dans les anciens centres du capitalisme - en Europe, aux États-Unis et ailleurs - la tendance générale est à un jeu politique de division et de domination, visant d'une manière ou d'une autre à faire des travailleurs de la santé un "cas particulier", à semer la division entre eux et à les séparer de leurs frères et sœurs de classe des autres industries.
En Belgique, le "décret sur les pouvoirs d'urgence n° 14" prévoyait d'obliger les employés des secteurs privé et public de la santé et d'autres secteurs à effectuer des heures supplémentaires non rémunérées, sans possibilité de congé compensatoire. Ces clauses ont été abandonnées après l'opposition de travailleurs en colère, mais ce sont les syndicats qui se sont renforcés en récupérant la lutte, menaçant de grèves qui ne se sont jamais concrétisées, alors que toutes les autres conditions de travail continuaient à se détériorer ;
En France, le plan du "Ségur de la Santé", récemment annoncé à grands cris pour "récompenser" les travailleurs du secteur de la santé, sépare en fait le personnel privé du personnel public, prévoit une diminution des temps de repos entre les équipes et constitue une nouvelle étape dans le démantèlement des responsabilités assumées par l'État en matière de santé.6
Au Royaume-Uni, la récompense mentionnée plus haut a été un coup dans les dents évident pour les infirmières, mais elle a également eu l'effet escompté de diviser les médecins débutants des médecins confirmés, des infirmières, des autres travailleurs du secteur public, etc.
La tendance à considérer le secteur de la santé comme "le tout et l’aboutissement" de la lutte - la malédiction du corporatisme qui a paralysé les grèves des mineurs et de la métallurgie au Royaume-Uni dans les années 1980 - est une véritable faiblesse exprimée par les manifestations du mois d'août au Royaume-Uni, même si un rassemblement a entonné un chant du type « les pompiers méritent aussi une augmentation de salaire ». Une autre tendance est celle consistant à incriminer le parti conservateur (les tories) pour la "privatisation des services de santé", alors qu'en fait tous les partis du monde entier ont réduit au minimum, pendant des décennies, les services de santé fournis pour assurer la reproduction élargie du capital et de la force de travail nécessaire à cette fin. C'est l'adoption et l'expansion de l'initiative de financement privé par le dernier gouvernement travailliste qui a véritablement mis le "NHS en pièces" et a érodé les conditions de vie des travailleurs.
La combativité exprimée au Royaume-Uni7 et ailleurs au cours de l'été contraste fortement avec l'atmosphère de peur et d'incertitude générée par la crise Covid et les licenciements et fermetures massives qui en ont découlé, facteurs qui ont renforcé le manque de confiance préexistant dans la classe. Ces luttes ont rappelé que la classe ouvrière n'a pas été écrasée par l'épuisement ni par les chants des sirènes de l'abnégation. La nécessaire politisation de cette lutte - la reconnaissance de ce qu'est historiquement la classe ouvrière et de ce qu'elle peut et doit devenir - reste une perspective ouverte à l’avenir pour l’ensemble du prolétariat.
RF, 10/09/2020
1 Voir le « Rapport sur la lutte de classe pour le 23e Congrès international du CCI (2019) : Formation, perte et reconquête de l’identité de classe prolétarienne [113] », Revue Internatonale no 164.
2 World Socialist Web Site, de juillet 2020 [207].
3 Workers World du 13 août [208].
4 San Francisco Chronicle du 20 juillet.
5 Site d’Amnesty international [209].
6 Voir « Ségur de la Santé : un nouveau coup porté à la classe ouvrière » [210], Révolution Internationale n° 484.
7 Parmi les autres secteurs en lutte au cours du printemps et de l'été, citons les professeurs d'université et les manifestations amères des employés de British Airways, dont des milliers ont été licenciés et d'autres réembauchés à des salaires et des conditions de travail inférieurs. Pour plus d'informations sur les grèves des travailleurs et la résistance au début de la pandémie, voir notre article "Malgré tous les obstacles, la lutte des classes forge son futur". [81]
Récent et en cours:
- Manifestations [211]
- National Health Service (NHS) [212]
Rubrique:
Participez aux permanences du CCI
- 105 lectures
Pendant toute la durée de la pandémie de Covid 19, le CCI continuera à tenir des permanences en ligne régulières au rythme d’une fois par mois. Ces permanences sont des lieux de débat ouverts à tous ceux qui souhaitent rencontrer et discuter avec le CCI. Nous invitons vivement tous nos lecteurs, contacts et sympathisants à venir y débattre, afin de rompre l’isolement imposé par la pandémie, poursuivre la réflexion sur la situation historique actuelle et confronter les points de vue.
Les lecteurs qui souhaitent participer aux permanences en ligne peuvent adresser un message sur notre adresse électronique [213] ou dans la rubrique “contact [214]” en signalant quelles questions ils voudraient aborder, afin de nous permettre d’organiser au mieux les débats. Les modalités techniques pour se connecter à la permanence seront communiquées par retour de courriel.
La prochaine permanence du CCI en langue française se tiendra le samedi 21 novembre de 15h à 18h.
Rubrique:
ICCOnline - décembre 2020
- 49 lectures
Divergences avec la résolution sur la situation internationale du 23e congrès
- 281 lectures
Au cours du 23e congrès, j’ai présenté un certain nombre d’amendements à la résolution sur la situation internationale. Cette contribution va se concentrer sur ceux de mes amendements qui ont été rejetés par le congrès et qui gravitent autour des deux principales divergences que j’ai avec les positions du congrès : sur les tensions impérialistes et sur le rapport de force global entre les classes, entre le prolétariat et la bourgeoisie. Il existe un fil conducteur entre ces désaccords et il tourne autour de la question de la décomposition. Bien que toute l’organisation partage la même analyse de la décomposition en tant que phase ultime du capitalisme décadent, appliquer ce cadre à la situation présente met en lumière des différences d’interprétation. Ce sur quoi nous sommes tous d’accord est que cette phase terminale non seulement a été initiée par, mais qu’elle a ses racines les plus profondes dans l’incapacité des deux classes principales de la société capitaliste à imposer leurs solutions antagoniques face à la crise du capitalisme décadent : la guerre généralisée (pour la bourgeoisie) ou la révolution mondiale (pour le prolétariat). Mais du point de vue de l’actuelle position de l’organisation, il pourrait exister une seconde cause essentielle et caractéristique de cette phase terminale, qui est la tendance au chacun-contre-tous : entre les États, au sein de la classe dominante, au sein de la société bourgeoise au sens large. Sur cette base, en ce qui concerne l’impérialisme, le CCI aujourd’hui tend à sous-estimer la tendance à la bipolarisation (et aussi à une éventuelle reconstitution des blocs impérialistes), et au danger grandissant de confrontations militaires entre les grandes nations elles-mêmes. Sur cette même base, le CCI aujourd’hui, sur la question du rapport de force entre les classes, tend à sous-estimer l’importance de la perte actuelle de la perspective révolutionnaire par le prolétariat, ce qui nous mène à penser qu’il peut recouvrer son identité de classe et commencer à reconquérir une perspective révolutionnaire, essentiellement à travers ses luttes ouvrières défensives.
Pour ma part, bien qu’étant d’accord avec l’idée que le chacun-contre-tous bourgeois est une très importante caractéristique de la décomposition (et a joué un rôle énorme dans l’ouverture de cette phase terminale lors de la désintégration de l’ordre impérialiste mondial de l’après-Seconde Guerre mondiale), je ne suis pas d’accord que ce soit l’une de ses causes principales. Au contraire, je reste convaincu que l’impasse entre les deux principales classes causée par leur incapacité à imposer leur propre perspective de classe en est la cause essentielle – et pas le chacun-contre-tous. Pour moi, le CCI s’éloigne de sa position originelle sur la décomposition en donnant au “chacun-contre-tous” une importance occasionnelle similaire à l’absence de perspective. Comme je le comprends, l’organisation évolue vers la position que, avec la décomposition, il y a un nouveau facteur qui n’existait pas dans les phases précédentes du capitalisme décadent. Ce facteur est la prédominance du chacun-contre-tous, des forces centrifuges, alors qu’avant la décomposition, la tendance à la discipline de bloc, les forces centripètes, tendaient à prendre le dessus. Pour moi, et en opposition à cela, il n’y a pas de tendance majeure dans la phase de décomposition qui n’existait pas déjà dans la phase de décadence. La qualité nouvelle de la phase de décomposition consiste en ce que les contradictions déjà existantes sont exacerbées. Il en est ainsi pour la tendance au chacun-contre-tous, qui est exacerbée dans la décomposition. Mais la tendance à la guerre entre puissances dominantes est également exacerbée, tout comme le sont toutes les tensions autour des manœuvres vers de nouveaux blocs, des tentatives des États-Unis pour supprimer tout nouveau concurrent, etc.
Les divergences sur l’impérialisme
C’est pourquoi j’ai soumis l’amendement suivant au point 15 de la résolution, rappelant la persistance de la bipolarisation impérialiste (le développement d’une rivalité principale entre deux grandes puissances) et les dangers que cela représente pour le futur de l’humanité :
“Pendant la période des blocs militaires après 1945, deux types de guerre étaient principalement à l’ordre du jour :
– une éventuelle Troisième Guerre mondiale, qui aurait probablement conduit à l’anéantissement de l’humanité ;
– […] des guerres locales plus ou moins bien contrôlées par les deux chefs de file de bloc.
Actuellement, bien que la Troisième Guerre mondiale ne soit pas à l’ordre du jour, cela ne signifie pas que la tendance à la bipolarité des antagonismes impérialistes ait disparu. La montée et l’expansion de la Chine, qui pourrait éventuellement défier les États-Unis, est actuellement la principale expression de cette tendance (pour l’instant encore clairement secondaire) à la formation de nouveaux blocs.
Quant au phénomène des guerres locales, elles se sont bien sûr poursuivies sans relâche en l’absence de blocs, mais ont une tendance beaucoup plus forte à échapper à tout contrôle, étant donné le nombre de puissances régionales et de grandes puissances impliquées, et le degré et l’étendue des destructions et du chaos qu’elles provoquent. Dans ce contexte, le danger de l’utilisation de bombes atomiques et d’autres armes de destruction massive est plus grand qu’auparavant, ainsi que le risque d’affrontements militaires directs y compris entre les grandes puissances elles-mêmes”.
Le rejet de cet amendement par le congrès est parlant. Nous tournons le dos à ce qui est probablement le plus important danger de guerre entre les grandes puissances dans les années à venir : que les États-Unis utilisent leur supériorité militaire encore existante contre la Chine pour tenter de stopper l’ascension de cette dernière. En d’autres termes, le danger actuel n’est effectivement pas celui d’une Guerre mondiale entre deux blocs impérialistes, mais celui d’aventures militaires visant soit à obtenir, soit à empêcher une remise en cause du statu quo impérialiste existant, et qui serait susceptible de devenir une conflagration mondiale incontrôlable très différente des deux guerres mondiales du XXe siècle. La rivalité sino-américaine actuelle ressemble à celle qui existait à l’époque de la Première Guerre mondiale entre l’Allemagne, qui était un nouveau challenger, et la Grande-Bretagne, puissance mondiale installée. Ce dernier conflit a entraîné le déclin des deux pays. Mais cela se passait à l’échelle européenne, alors qu’aujourd’hui, cela se passe à l’échelle mondiale, de sorte qu’il n’y a plus de tierce partie (comme l’Amérique pendant les deux guerres mondiales) attendant d’intervenir de l’extérieur pour en récolter les fruits. Aujourd’hui, le no future concerne très probablement tout le monde. Loin d’être exclus par notre théorie de la décomposition, les conflits contemporains ouverts entre les grandes puissances la confirment.
Dans une réponse sur notre site internet à une critique de cette partie de la Résolution du 23e congrès par un sympathisant du CCI (Mark Hayes), après avoir affirmé que “le militarisme et la guerre impérialiste sont toujours des caractéristiques fondamentales de cette phase finale de la décadence”, nous ajoutons “même si les blocs impérialistes ont disparu et ne vont probablement pas se reformer”. Dans la même réponse, nous affirmons : “La perspective est celle de guerres locales et régionales, leur propagation vers les centres mêmes du capitalisme par la prolifération du terrorisme, ainsi que le désastre écologique croissant, et la putrification générale”. Les guerres régionales, la prolifération du terrorisme, les catastrophes écologiques : oui ! Mais pourquoi excluons-nous si soigneusement de cette perspective le danger d’affrontements militaires entre les grandes puissances ? Et pourquoi affirmons-nous que les blocs impérialistes ne vont probablement pas se reformer ? En fait, ce que nous avons tendance à oublier, c’est que le “chacun pour soi” n’est qu’un des pôles d’une contradiction, dont l’autre pôle est la tendance à la bipolarité et aux blocs impérialistes.
La tendance au “chacun pour soi” et la tendance à la bipolarité existent toutes deux de façon permanente et simultanée dans le capitalisme décadent. La tendance générale est que l’une prenne le dessus sur l’autre, de sorte que l’une est primordiale et l’autre secondaire. Mais aucune des deux ne disparaît jamais. Même au plus fort de la guerre froide (lorsque le monde étit divisé en deux blocs qui sont restés stables pendant des décennies), la tendance au “chacun pour soi” n’a jamais complètement disparu (il y avait des deux côtés des confrontations militaires entre les membres d’un même bloc). Même à l’apogée du “chacun pour soi” et de la supériorité écrasante des États-Unis (après 1989), la tendance à la formation de blocs n’a jamais complètement disparu (comme le montre la politique de l’Allemagne dans les Balkans et en Europe de l’Est après sa réunification). De plus, la domination d’une tendance peut rapidement passer à l’autre, car elles ne s’excluent pas mutuellement. L’impérialisme du “chacun pour soi” des années 1920, par exemple (atténué seulement par la peur de la révolution prolétarienne) s’est transformé en la constellation de blocs de la Seconde Guerre mondiale. La bipolarité de l’après-guerre s’est rapidement transformée en un affrontement sans précédent de chacun contre tous en 1989. Tout cela n’est pas nouveau. C’est la position que le CCI a toujours défendue.
Le principal obstacle à la tendance à la bipolarité impérialiste dans le capitalisme décadent n’est pas le “chacun pour soi”, mais l’absence d’un candidat suffisamment fort pour lancer un défi mondial à la puissance dominante. C’était déjà le cas après 1989. Le renforcement de la tendance bipolaire ces dernières années est donc avant tout le résultat de la montée en puissance de la Chine.
À ce niveau, nous avons un problème d’assimilation de notre propre position. Si nous pensons que le “chacun pour soi” est une cause majeure de décomposition, l’idée même que le pôle opposé, celui de la bipolarité, est en train de se renforcer et pourrait même prendre le dessus un jour, apparaît nécessairement comme une “remise en cause de notre position sur la décomposition”. Il est vrai que, en 1989, c’est l’effondrement du bloc de l’Est (rendant son homologue occidental superflu) qui a inauguré la phase de décomposition, déclenchant la plus grande explosion du “chacun pour soi” de l’histoire moderne. Mais ce “chacun pour soi” était le résultat, et non la cause, de développements plus profonds : l’impasse entre les classes. Au cœur de ces développements, il y a eu la perte de perspective, le no future qui prévaut et qui caractérise cette phase terminale. Plus récemment, la vague actuelle de populisme politique est une autre manifestation de ce manque fondamental de perspective de la part de toute la classe dirigeante. C’est pourquoi j’ai proposé l’amendement suivant au point 4 de la Résolution :
“Le populisme contemporain est un autre signe clair d’une société qui se dirige vers la guerre :
– la montée du populisme lui-même n’est pas le moindre des produits de l’agressivité croissante et des pulsions de destruction générées par la société bourgeoise actuelle ;
– mais comme cette agressivité “spontanée” ne suffit pas à mobiliser la société pour la guerre, la classe dirigeante a besoin aujourd’hui de mouvements populistes à cette fin.
En d’autres termes, ils sont à la fois un symptôme et un facteur actif de la poussée vers la guerre”.
Cet amendement a également été rejeté par le congrès. Selon les termes de la commission d’amendement :
“Nous ne sommes pas en désaccord avec le fait que le populisme s’inscrit dans un climat de violence croissante dans la société, mais nous pensons qu’il y a une différence de conception sur la marche vers la guerre qui ne correspond pas à l’approche générale de la résolution”. C’est tout à fait exact. L’intention de l’amendement était de modifier, voire de corriger, la Résolution sur ce point. (La commission d’amendement a d’ailleurs donné le même argument pour son rejet de l’amendement au point 15, voir ci-dessus). Il voulait non seulement tirer la sonnette d’alarme par rapport au danger croissant de guerre, mais aussi montrer que l’irrationalité particulière du populisme n’est qu’une partie de l’irrationalité de la classe bourgeoise dans son ensemble. Cette irrationalité est déjà une caractéristique majeure du capitalisme décadent, bien avant sa décomposition : la tendance d’une partie croissante de la classe dirigeante à agir d’une manière préjudiciable à ses propres intérêts. Ainsi, toutes les grandes puissances européennes sont sorties affaiblies de la Première Guerre mondiale. Et le défi lancé au reste du monde par l’Allemagne et le Japon lors de la Seconde Guerre mondiale avait déjà quelque chose de suicidaire. Mais cette tendance n’était pas encore totalement dominante. En particulier, les États-Unis ont profité économiquement et militairement de leur participation aux deux guerres mondiales. Et l’on pourrait même dire que, pour le bloc occidental, la guerre froide s’est avérée avoir une certaine rationalité, puisque sa politique d’endiguement militaire et d’étranglement économique a contribué à l’effondrement de son homologue oriental sans Guerre mondiale. En revanche, dans la phase de décomposition, c’est la première puissance mondiale elle-même, les États-Unis, qui est à l’avant-garde de la création du chaos, de la fureur incontrôlable, et il est difficile de voir comment qui que ce soit pourrait tirer profit de guerres entre les États-Unis et la Chine. L’irrationalité et le no future sont les deux faces d’une même médaille, une tendance majeure du capitalisme décadent. Dans ce contexte, lorsque certains des courants populistes d’Europe occidentale continentale préconisent désormais de faire des affaires à l’avenir avec la Russie ou la Chine et sont prêts à rompre avec leurs ennemis “anglo-saxons” préférés (les États-Unis et la Grande-Bretagne), il s’agit clairement d’une expression de no future. Mais, en s’opposant à eux, la rationalité des gens comme Angela Merkel consiste à reconnaître que, si la polarisation entre l’Amérique et la Chine continue à s’accentuer comme à l’heure actuelle, l’Allemagne n’aurait d’autre choix que de prendre le parti des États-Unis, sachant qu’elle ne permettrait en aucun cas à l’Europe de tomber sous la domination “asiatique”.
Les divergences sur le rapport de force entre les classes
Si l’on passe à la Résolution sur la lutte des classes, on constate fondamentalement la même divergence sur l’application du concept de décomposition. Une partie essentielle de la Résolution est le point 5, puisqu’elle traite des problèmes de la lutte des classes dans les années 1980, la décennie à la fin de laquelle la phase de décomposition commence. Résumant les leçons de cette décennie, elle conclut comme suit :
“Mais pire encore, avec cette stratégie de division des travailleurs et d’encouragement du “chacun pour soi”, la bourgeoisie et ses syndicats ont pu présenter les défaites de la classe ouvrière comme des victoires.
Les révolutionnaires ne doivent pas sous-estimer le machiavélisme de la bourgeoisie dans l’évolution de l’équilibre des forces de classe. Ce machiavélisme ne peut que se poursuivre avec l’aggravation des attaques contre la classe exploitée. La stagnation de la lutte de classe, puis son recul à la fin des années 1980, résultent de la capacité de la classe dominante à retourner contre la classe ouvrière certaines manifestations de la décomposition de la société bourgeoise, notamment la tendance au “chacun pour soi”.”
Le point 5 souligne à juste titre l’importance de l’impact négatif du “chacun pour soi” sur les luttes des travailleurs aujourd’hui. Il est également juste de souligner le machiavélisme de la classe dominante dans la promotion de cette mentalité. Ce qui est frappant, cependant, c’est que le problème du manque de perspective est absent de cette analyse des difficultés de la lutte des classes. Ce qui est d’autant plus remarquable que les années 1980 sont entrées dans l’histoire comme la décennie du no future. C’est la même approche que nous avons déjà rencontrée concernant l’impérialisme. Les événements sont analysés avant tout du point de vue du “chacun pour soi”, au détriment du problème du manque de perspective. Afin de corriger cela, j’ai proposé l’amendement suivant, à ajouter à la fin du point :
“Toutefois, ces confrontations avec les syndicats n’ont en rien inversé, ni même stoppé, la régression au niveau de la perspective révolutionnaire. Cela a été encore plus le cas dans les années 1980 que dans les années 1970. Les deux luttes ouvrières les plus importantes et les plus massives de la décennie (Pologne 1980, mineurs britanniques) ont eu pour résultat un prestige accru des syndicats impliqués”.
Le congrès a rejeté cet amendement. L’argument invoqué par la commission d’amendement (CA) était le suivant :
“La régression dans la perspective révolutionnaire a commencé avec la chute des régimes staliniens en 1989. La Pologne de 1980 n’a pas eu les mêmes caractéristiques que la lutte des mineurs en Grande-Bretagne en 1984-1985. En Pologne, il y a eu une dynamique de grève de masse, avec l’extension géographique du mouvement et l’auto-organisation en assemblées générales souveraines (MKS) dans un pays stalinien, avant la fondation du syndicat Solidarnosc. La Pologne de 1980 a été le dernier mouvement de la deuxième vague de luttes. En raison de la perte de certains de nos acquis, nous devons relire nos analyses de la troisième vague de luttes”.
Cela a au moins le mérite d’être clair : avant 1989, il n’y a pas eu de régression dans la perspective révolutionnaire. Mais quelle est la corrélation avec notre analyse de la décomposition ? Selon cette analyse, c’est l’incapacité des deux classes principales à avancer leurs propres solutions qui a provoqué et conduit à la phase de décomposition. Si cette dernière commence en 1989, ce qui l’a provoquée doit déjà avoir existé auparavant : l’absence de perspective, que ce soit de la part de la bourgeoisie ou du prolétariat. La commission d’amendement, mais aussi le point 5 de la Résolution elle-même, citent la Pologne comme preuve qu’il n’y a pas eu de régression dans la perspective avant 1989. Mais la Pologne prouve le contraire. La première vague de luttes d’une nouvelle génération invaincue du prolétariat, qui a débuté en 1968 en France et en 1969 en Italie, a produit une nouvelle génération de minorités révolutionnaires. Le CCI lui-même est un produit de ce processus. En revanche, la vague de luttes de la fin des années 1970, qui a culminé avec la grève de masse de 1980 en Pologne, n’a rien produit de tel. Et ce qui a suivi, dans les années 1980, a été une crise qui a touché l’ensemble du milieu politique prolétarien existant. Aucune des grandes luttes ouvrières des années 1980 n’a produit ni un élan politique dans l’ensemble de la classe, ni un élan révolutionnaire parmi ses minorités révolutionnaires, comme celui de la décennie précédente. Ignorant cela, la Résolution présente les choses comme si chacune d’entre elles était la principale faiblesse, soigneusement séparée de la question de la perspective. Cette approche du congrès est également soulignée dans le rejet d’un autre amendement que j’ai formulé et qui disait que “déjà avant les événements historiques mondiaux de 1989, la lutte des classes était en train de “piétiner” au niveau de la combativité et de régresser par rapport à la perspective révolutionnaire”. L’argument de la commission d’amendement était : “Cet amendement introduit l’idée qu’il y avait une continuité entre les difficultés de la lutte des classes dans les années 1980 (piétinement) et la rupture provoquée par l’effondrement du bloc de l’Est”. Donc, il n’y a pas de “continuité” ? On peut bien sûr argumenter en ce sens. Mais cela a-t-il un rapport avec notre analyse de l’impasse dans laquelle se trouvent les classes, qui est à l’origine de la décomposition ? L’année 1989 a effectivement été une rupture, mais avec une préhistoire de la lutte des classes, ainsi que de la lutte impérialiste. Bien que cette idée du “chacun pour soi” comme étant au centre de la décomposition, au même titre que l’absence de perspective, ne soit pas (ou pas encore ?) la position officielle de l’organisation, je dirais qu’elle est au moins implicite dans l’argumentation de cette Résolution.
Au point 6 de la Résolution, les événements autour de 1989, et leur lien avec la lutte des classes, sont traités comme ceci :
“Alors que la troisième vague de luttes commençait à s’épuiser à la fin des années 1980, un événement majeur de la situation internationale, l’effondrement spectaculaire du bloc de l’Est et des régimes staliniens en 1989, a porté un coup brutal à la dynamique de la lutte des classes, modifiant ainsi de façon majeure l’équilibre des forces entre le prolétariat et la bourgeoisie au profit de cette dernière. Cet événement a annoncé haut et fort l’entrée du capitalisme dans la phase finale de sa décadence : celle de la décomposition. Lorsque le stalinisme s’est effondré, il a rendu un dernier service à la bourgeoisie. Il a permis à la classe dominante de mettre fin à la dynamique de lutte des classes qui, avec des avancées et des reculs, s’était développée pendant deux décennies.
En effet, dans la mesure où ce n’est pas la lutte du prolétariat mais la pourriture de la société capitaliste sur ses pieds qui a mis fin au stalinisme, la bourgeoisie a pu exploiter cet événement pour déclencher une gigantesque campagne idéologique visant à perpétuer le plus grand mensonge de l’histoire : l’identification du communisme avec le stalinisme. Ce faisant, la classe dominante a porté un coup extrêmement violent à la conscience du prolétariat. Les campagnes assourdissantes de la bourgeoisie sur la soi-disant “faillite du communisme” ont conduit à une régression du prolétariat dans sa marche vers sa perspective historique de renversement du capitalisme. Elles ont porté un coup majeur à son identité de classe”.
Ici les événements dramatiques de 1989 semblent n’avoir rien à voir avec l’équilibre global des forces de classe. Cette hypothèse est cependant en contradiction, non seulement avec notre théorie de la décomposition, mais aussi avec notre théorie du cours historique. Selon le CCI, c’est le bloc de l’Est, après 1968, qui, parce qu’il prenait de plus en plus de retard sur tous les plans, a dû chercher une solution militaire à la guerre froide. Attaquant en Europe avec des moyens de guerre “conventionnels” (où l’équilibre des forces ne lui était pas si défavorable), le Pacte de Varsovie devait placer ses espoirs dans le fait que son ennemi occidental (par peur de la MAD, “destruction mutuelle assurée”) n’oserait pas riposter au niveau nucléaire. Mais, dans les années 1979 et 1980, le bloc de l’Est n’a pas pu jouer cette carte, et l’une des raisons principales est qu’il ne pouvait pas compter sur l’immobilité de sa “propre” classe ouvrière. Cela était pourtant essentiel pour une guerre d’une telle ampleur. À ce niveau, la grève de masse de 1980 en Pologne a été une justification massive de notre analyse. Les troupes soviétiques, mobilisées à l’époque près de la frontière en préparation d’une invasion de la Pologne, se sont mutinées, les soldats refusant de marcher contre leurs sœurs et frères de classe en Pologne. Mais la Pologne 1980 a démontré non seulement que le prolétariat était un obstacle à la Guerre mondiale, mais aussi qu’il était incapable d’aller plus loin que ce blocage de son ennemi de classe pour faire avancer sa propre alternative révolutionnaire. La classe ouvrière à l’Ouest aurait dû s’engouffrer dans la brèche. Mais dans les années 1980, elle n’a pas pu le faire. Le décor était donc planté pour l’impasse qui allait déboucher sur la phase de décomposition de la fin de la décennie. La Résolution est tout à fait juste, l’effondrement du stalinisme en 1989, et l’utilisation maximale qui en a été faite par la propagande bourgeoise, a été le coup principal porté à la combativité, à l’identité de classe, à la conscience de classe du prolétariat. Ce que je conteste, c’est l’affirmation que cela n’avait pas été préparé auparavant par l’impasse entre les classes, et en particulier par l’affaiblissement de la présence de la perspective du côté du prolétariat. Apparemment sans s’en rendre compte, la Résolution elle-même admet l’existence de ce lien entre 1989 et avant quand elle écrit (point 6) que la bourgeoisie a pu exploiter cet événement “dans la mesure où ce n’est pas la lutte du prolétariat mais la pourriture de la société capitaliste sur ses pieds qui a mis fin au stalinisme”.
Les luttes ouvrières de la fin des années 1960 ont mis fin à la contre-révolution, non seulement parce qu’elles étaient massives, spontanées et souvent auto-organisées, mais aussi parce qu’elles ont permis de sortir de l’emprise idéologique de la guerre froide selon laquelle il fallait être du côté du “communisme” (le bloc de l’Est) ou de la “démocratie” (le bloc de l’Ouest). Avec le combat ouvrier des années 1960 est apparue l’idée d’une lutte contre la classe dominante à l’Est et à l’Ouest, du marxisme contre le stalinisme, d’une révolution par le biais de conseils ouvriers menant au communisme réel. Cette première politisation (comme le souligne la Résolution) a été contrée avec succès par la classe dominante au cours des années 1970. Face à la dépolitisation qui s’ensuivit, on espérait dans les années 1980 que les luttes économiques, en particulier la confrontation avec les syndicats, pourraient devenir le creuset d’une repolitisation, peut-être même à un niveau supérieur. Mais bien qu’il y ait eu des luttes massives dans les années 1980, bien qu’il y ait eu des confrontations avec les syndicats, et même avec le syndicalisme de base radical, principalement à l’Ouest, mais aussi, par exemple, en Pologne contre le nouveau syndicat “libre”, elles n’ont pas produit la politisation espérée. Cet échec est déjà reconnu par notre théorie de la décomposition, puisqu’elle définit la nouvelle phase comme une phase sans perspective, et cette absence de perspective comme la cause de l’impasse. La politisation prolétarienne est toujours politique par rapport à un objectif qui dépasse le capitalisme. En raison de la centralité de l’idée d’une sorte d’impasse entre les deux classes principales dans notre théorie de la décomposition, les différences d’évaluation des luttes des années 1980 sont particulièrement pertinentes pour l’estimation de la lutte des classes jusqu’à ce jour. Selon la Résolution, le combat prolétarien, malgré tous les problèmes auxquels il se heurtait, se développait fondamentalement de manière positive jusqu’à ce qu’en 1989, il soit arrêté dans sa course par un événement historique mondial qui lui était fondamentalement extérieur. Comme les effets de ces événements, même les plus accablants, sont voués à s’estomper avec le temps, nous devrions être assez confiants dans la capacité de la classe à reprendre son voyage interrompu sur le même chemin. Ce chemin est celui de sa radicalisation politique à travers ses luttes économiques. De plus, ce processus sera accéléré par l’aggravation de la crise économique, qui oblige les travailleurs à lutter et leur fait perdre leurs illusions, en leur ouvrant les yeux sur la réalité du capitalisme. C’est pourquoi la Résolution préconise le modèle des années 1980 comme la voie à suivre. En se référant à la grève de masse de 1980, elle dit :
“Cette lutte gigantesque de la classe ouvrière en Pologne a révélé que c’est dans la lutte massive contre les attaques économiques que le prolétariat peut prendre conscience de sa propre force, affirmer son identité de classe qui est antagonique au Capital, et développer sa confiance en soi”.
La Résolution pense peut-être à ces luttes économiques lorsqu’elle conclut le point 13 par une citation de nos Thèses sur la décomposition :
“Aujourd’hui, la perspective historique reste complètement ouverte. Malgré le coup que l’effondrement du bloc de l’Est a porté à la conscience prolétarienne, la classe n’a pas subi de défaites majeures sur le terrain de sa lutte. […] De plus, et c’est l’élément qui déterminera en dernière analyse l’issue de la situation mondiale, l’aggravation inexorable de la crise capitaliste constitue le stimulant essentiel de la lutte de classe et du développement de la conscience, la condition préalable de sa capacité à résister au poison distillé par la pourriture sociale. Car si l’unification de la classe dans les luttes partielles contre les effets de la décomposition n’est pas possible, sa lutte contre les effets directs de la crise constitue néanmoins la base du développement de sa force et de son unité de classe”.
C’est tout à fait vrai. Mais la lutte du prolétariat contre les effets de la crise capitaliste a une dimension non seulement économique, mais aussi politique et théorique. La dimension économique est indispensable : une classe incapable de défendre ses intérêts immédiats ne sera jamais en mesure de faire une révolution. Mais les deux autres dimensions ne sont pas moins indispensables. Cela est d’autant plus vrai aujourd’hui, alors que le problème central est le manque de perspective. Déjà dans les années 1980, la principale faiblesse de la classe ne se situait pas au niveau de ses luttes économiques, mais au niveau politique et théorique. Sans un développement qualitatif à ces deux niveaux, les luttes économiques défensives auront de plus en plus de difficultés à rester sur un terrain prolétarien de solidarité de classe. Ceci est d’autant plus vrai aujourd’hui que nous sommes arrivés à un stade où la dépolitisation, qui était déjà une caractéristique majeure dans les années 1980, est remplacée par différentes versions de la politisation putride telles que le populisme et l’anti-populisme, l’antimondialisation, les causes identitaires et les révoltes interclassistes. C’est sur la base de l’avancée de toutes ces politisations putrides au cours des dernières années que j’ai présenté au congrès l’analyse suivante de l’équilibre actuel des forces de classe :
“Cependant, ces premières réactions prolétariennes n’ont pas réussi à inverser le reflux mondial de la combativité, de l’identité de classe et de la conscience de classe depuis 1989. Au contraire, ce que nous vivons actuellement n’est pas seulement la prolongation, c’est même l’approfondissement de ce reflux. Au niveau de l’identité de classe, la modification du discours de la classe dominante est l’indication la plus claire de cette régression. Après des années de propagande sur la prétendue disparition de l’identité de classe prolétarienne dans les anciens foyers capitalistes, c’est aujourd’hui la droite populiste qui a “redécouvert” et “réhabilité” la classe ouvrière comme le “vrai cœur de la nation” (Trump)”.
Et :
“Au niveau de la perspective révolutionnaire, la manière dont même les représentants institutionnels classiques de l’ordre dominant (comme le Fonds monétaire international) rendent le capitalisme responsable du changement climatique, de la destruction de l’environnement ou du fossé croissant entre les revenus des riches et des pauvres, montre à quel point la bourgeoisie, en tant que classe dirigeante, est, pour l’instant, assise en sécurité et en confiance sur sa selle. Tant que le capitalisme est considéré comme faisant partie (de la forme contemporaine, pour ainsi dire) de la “nature humaine”, ce discours anticapitaliste, loin d’être l’indice d’une maturation, est le signe d’un nouveau recul de la conscience au sein de la classe”.
Le congrès a rejeté cette analyse de l’approfondissement du recul depuis 1989. Il n’a pas non plus partagé mon souci de rappeler que les luttes défensives, en elles-mêmes, sont tout sauf une garantie que la cause prolétarienne est sur la bonne voie :
“Cependant, la mesure dans laquelle la crise économique peut être l’alliée de la révolution prolétarienne et le stimulant de l’identité de classe dépend d’une série de facteurs, dont le plus important est le contexte politique. Au cours des années 1930, même les luttes défensives les plus militantes, les plus radicales et les plus massives (occupations d’usines en Pologne, manifestations de chômeurs aux Pays-Bas, grèves générales en Belgique et en France, grèves sauvages en Grande-Bretagne (même pendant la guerre) et aux États-Unis, et même un mouvement prenant une forme insurrectionnelle (Espagne) n’ont pas réussi à inverser la régression de la conscience de classe. Dans la phase actuelle, des défaites partielles de la classe, y compris au niveau de sa conscience de classe, sont tout sauf exclues. Elles entraveraient à leur tour le rôle de la crise en tant qu’alliée de la lutte de la classe.
Mais contrairement aux années 1920/1930, de telles défaites ne conduiraient pas à une contre-révolution, puisqu’elles n’ont été précédées d’aucune révolution. Le prolétariat serait encore capable de se remettre de telles défaites, qui auraient beaucoup moins de chances d’avoir un caractère définitif”. (amendement rejeté, fin du point 13).
Cette question de savoir s’il y a ou non un nouvel affaiblissement du prolétariat au niveau de l’équilibre actuel des forces de classe était l’une des deux divergences majeures du congrès concernant la lutte de classe. L’autre concernait la maturation souterraine qui, selon la résolution, se produit actuellement au sein de la classe. Il s’agit d’une maturation souterraine de la conscience, non encore visible, la fameuse “vieille taupe” dont parle Marx. La divergence au congrès ne portait pas sur la validité générale de ce concept de Marx, que nous partageons tous. Il ne s’agissait pas non plus de savoir si un tel processus peut ou non avoir lieu même lorsque les luttes ouvrières sont en recul, nous affirmons tous qu’il le peut. La question débattue était de savoir si un tel processus a lieu ou non en ce moment même. Le problème ici est que la Résolution ne peut fournir aucune preuve empirique à l’appui de cette affirmation. Soit son postulat est le fruit de vœux pieux, soit il relève d’une logique purement déductive, selon laquelle ce qui devrait se produire (d’après notre analyse) peut être supposé se produire. Les preuves fournies sont sans fondement : la persistance d’organisations révolutionnaires, l’existence de contacts de ces organisations. Bien que la vieille taupe s’enfouisse dans le sol, elle laisse des traces de sa présence à la surface. Je critique l’inadéquation des indications données dans la résolution :
“En ce sens, le développement qualitatif de la conscience de classe par les minorités révolutionnaires ne nous donne pas, en soi, une indication de ce qui se passe momentanément au niveau de la maturation souterraine au sein de la classe dans son ensemble – puisque cela peut avoir lieu aussi bien pendant une phase révolutionnaire que contre-révolutionnaire, aussi bien pendant les phases de développement que de reflux de la classe dans son ensemble. De même, l’émergence de petites minorités et de jeunes éléments à la recherche d’une perspective de classe et de positions communistes de gauche est également possible même pendant les heures les plus sombres de la contre-révolution, puisqu’elles sont avant tout l’expression de la nature révolutionnaire du prolétariat (qui ne disparaît jamais tant que la classe ouvrière existe). Il en serait autrement si toute une nouvelle génération de militants révolutionnaires commençait à apparaître. Mais il est encore trop tôt pour porter un jugement sur cette possibilité maintenant”. (amendement rejeté).
Et j’ai proposé les critères suivants :
“Il n’est, par définition, pas facile de détecter une maturation souterraine en dehors des périodes de lutte ouverte : difficile, mais pas impossible. Il y a deux indicateurs des activités souterraines de la vieille taupe auxquels nous devons particulièrement veiller :
a) la politisation de secteurs plus larges des éléments en recherche de la classe, comme nous l’avons vu dans les années 1960-1970 ;
b) le développement d’une culture de la théorie et d’une culture du débat (telles qu’elles ont commencé à s’exprimer avec naïveté depuis l’anti-CPE jusqu’aux Indignados) en tant que manifestations fondamentales du prolétariat, en tant que classe de la conscience et de l’association. Sur la base de ces deux critères, il est très probable que nous traversons actuellement une phase de “régression souterraine” (où la vieille taupe a fait une pause temporaire), caractérisée par un nouveau renforcement de la suspicion à l’égard des organisations politiques, par l’attraction inhérente à la petite bourgeoisie politique et par un affaiblissement de l’effort théorique et de la culture du débat”.
Sans son objectif au-delà du capitalisme, le mouvement ouvrier ne peut pas défendre efficacement ses intérêts de classe. Les luttes économiques en elles-mêmes (aussi indispensables soient-elles) ne peuvent pas non plus suffire pour retrouver la conscience de classe révolutionnaire (y compris sa dimension d’identité de classe). En fait, au cours du quart de siècle qui a suivi 1989, le facteur unique le plus important de la lutte de classe prolétarienne n’était pas celui des luttes de défense économique, mais le travail théorique et analytique des minorités révolutionnaires, surtout pour développer une compréhension profonde de la situation historique existante, et une réhabilitation profonde et convaincante de la réputation du communisme. Cette évaluation peut sembler étrange, étant donné que les minorités révolutionnaires ne sont qu’une poignée de militants, comparées aux plusieurs milliards qui composent le prolétariat mondial dans son ensemble. Cependant, au cours de l’histoire, de minuscules minorités ont régulièrement développé, sans aucune participation des masses, des idées capables de révolutionner le monde, capables de “conquérir les masses” à terme. Une des principales faiblesses du prolétariat dans les deux décennies qui ont suivi 1989 a été en fait l’incapacité de ses minorités à accomplir ce travail. Les groupes historiques de la Gauche communiste ont une responsabilité particulière dans cet échec. Le résultat a été que, lorsqu’une nouvelle génération de prolétaires politisés a commencé à apparaître (comme les Indignados en Espagne ou les différents mouvements “d’occupation” à la suite des crises “financière” et de l’ “Euro” après 2008), le milieu politique prolétarien existant n’a pas été en mesure de les armer suffisamment avec les armes politiques et théoriques dont ils auraient eu besoin pour s’orienter et se sentir inspirés pour faire face à la tâche d’inaugurer le début de la fin du reflux prolétarien.
Steinklopfer, 24 mai 2020
Réponse au camarade Steinkopfler sur la Résolution sur la situation internationale du 23e congrès
Les textes de discussion que nous publions ici sont le produit d’un débat interne au sein du CCI sur la signification et la direction de la phase historique de la vie du capitalisme décadent qui s’est définitivement ouverte suite à l’effondrement du bloc impérialiste russe en 1989 : la phase de décomposition, phase ultime de la décadence capitaliste. L’une des idées centrales du texte d’orientation que nous avons publié en 1991, les Thèses sur la décomposition [10], est que l’histoire n’est jamais figée : tout comme la période de décadence capitaliste a sa propre histoire, la phase de décomposition a la sienne, et il est essentiel pour les révolutionnaires d’analyser les changements les plus importants survenus en son sein. C’est la motivation que l’on trouve derrière le texte du camarade Steinkopfler, dont le point de départ est la reconnaissance (pour l’instant uniquement par le CCI) que nous vivons effectivement dans la phase de décomposition, et que ses racines se trouvent dans l’impasse sociale entre les deux principales classes de la société, la bourgeoisie et le prolétariat, dont aucune des deux, face à la crise économique permanente, n’a été capable d’imposer sa perspective à la société : pour la bourgeoisie, la guerre impérialiste, pour le prolétariat, la révolution communiste mondiale. Mais au cours du débat sur la décomposition, qui englobe l’évolution des rivalités impérialistes et l’équilibre des forces entre les classes, des divergences sont apparues qui, pensons-nous, sont maintenant suffisamment mûres pour que l’on puisse les publier vers l’extérieur de l’organisation. De notre point de vue, les positions actuelles du camarade Steinkopfler tendent à affaiblir notre compréhension de la signification de la décomposition, mais c’est quelque chose que nous devons démontrer à travers une confrontation franche des idées.
La contribution du camarade commence par avancer que (de façon implicite au moins, comme il le dit plus tard) le CCI révise sa position sur les causes de la décomposition ; qu’au même niveau que l’impasse sociale, une des causes fondamentales de la décomposition est la tendance grandissante au “chacun pour soi” : “du point de vue de l’actuelle position de l’organisation, il semble apparaître une seconde cause essentielle et caractéristique de cette phase terminale, la tendance au chacun-contre-tous : entre les États, au sein de la classe dominante, au sein de la société bourgeoise au sens large”.
La conséquence de l’ajout de cette seconde cause est ainsi résumée : “Sur cette base, en ce qui concerne l’impérialisme, le CCI tend aujourd’hui à sous-estimer la tendance à la bipolarisation (et ainsi à l’éventuelle reconstitution de blocs impérialistes), et avec cela le danger grandissant de confrontations militaires entre les grandes puissances elles-mêmes. Sur la même base, le CCI aujourd’hui, concernant le rapport de force entre les classes, tend à sous-estimer l’importance de l’actuelle perte de perspective révolutionnaire du prolétariat, ce qui nous amène à penser qu’il peut recouvrer son identité de classe et commencer à reconquérir une perspective révolutionnaire essentiellement à travers les luttes défensives ouvrières”.
Le camarade Steinkopfler semble donc penser qu’il est seul à considérer qu’ “il n’y a aucune tendance majeure dans la phase de décomposition qui n’existait déjà auparavant dans la phase de décadence. La qualité nouvelle de la phase de décomposition consiste dans le fait que toutes les contradictions qui existaient déjà sont exacerbées à un niveau jamais atteint”.
Avant de répondre à la critique du camarade de notre position sur les conflits impérialistes ou sur l’état de la lutte de classe, nous pensons nécessaire de dire qu’aucune de ses descriptions de la compréhension générale qu’a l’organisation de la décomposition n’est exacte.
Les Thèses sur la décomposition ont déjà présenté cette phase comme “la conclusion, la synthèse de toutes les contradictions successives et expressions de la décadence capitaliste” : nous pouvons ajouter qu’elle est aussi la “conclusion” de certaines caractéristiques-clé de l’existence du capitalisme depuis sa naissance, comme la tendance à l’atomisation sociale qu’Engels, par exemple, avait déjà pointée dans sa Situation de la classe laborieuse en Angleterre en 1844.
Déjà en 1919, lors de son premier congrès, l’Internationale communiste le notait également [215] : “L’humanité, dont toute la culture a été dévastée, est menacée de destruction. Il n’est plus qu’une force capable de la sauver, et cette force, c’est le prolétariat. L’ancien “ordre” capitaliste n’est plus. Il ne peut plus exister. Le résultat final des procédés capitalistes de production est le chaos, et ce chaos ne peut être vaincu que par la plus grande classe productrice, la classe ouvrière”.
Et bien entendu ce jugement a été entièrement validé lorsque nous considérons l’état des pays centraux du capitalisme au lendemain de la Première Guerre mondiale : des millions de cadavres, de réfugiés, l’effondrement économique et la famine (et une pandémie mortelle). Un cauchemar similaire a hanté l’Europe et une grande partie du globe au lendemain de la Seconde Guerre impérialiste. Mais si nous regardons la situation du capitalisme sur la plus grande partie de la période entre 1914 et 1989, nous pouvons voir que la tendance vers le chaos total a été dans une large mesure maîtrisée (même si, comme le reconnaît le camarade Steinkopfler, elle n’a jamais complètement disparu) par la capacité de la classe dominante à imposer ses solutions et perspectives à la société : le cours à la guerre dans les années 1930, le partage du monde après 1945 et la formation des blocs, une longue période de reconstruction économique. Avec la crise économique prolongée depuis la fin des années 1960 et l’impasse de plus en plus totale entre les classes, la tendance à la fragmentation et au chaos à tous les niveaux s’est déchaînée au point qu’elle prend aujourd’hui une qualité nouvelle. Au contraire de l’assertion du camarade Steinkopfler, nous n’en concluons pas qu’elle serait devenue une “cause” de la décomposition, mais elle est certainement devenue un facteur actif de son accélération. C’est cette compréhension du changement qualitatif qui s’opère dans la phase de décomposition qui manque selon nous dans le texte du camarade Steinkopfler.
Nous voulons qu’il soit clair que, tout comme les signes de la décadence étaient déjà de plus en plus apparents avant la Première Guerre mondiale (capitalisme d’État, corruption des syndicats, course aux armements entre grandes puissances…), le CCI a noté les signes de la décomposition dès avant 1989 : la victoire des mollahs en Iran en 1979, l’attaque terroriste à Paris en 1986, la guerre au Liban, les difficultés rencontrées par la lutte de classe et d’autres encore. Aussi l’effondrement du bloc de l’Est n’a en aucun cas été un éclair dans un ciel d’azur, mais le produit d’un long développement qui l’a précédé.
La divergence sur les antagonismes impérialistes
Si on regarde les différences concrètes au niveau des antagonismes impérialistes, nous sommes certainement en retard dans la compréhension de la signification de l’émergence de la Chine, mais ces dernières années nous avons clairement intégré ce facteur dans nos analyses des rivalités impérialistes générales et de l’évolution de la crise économique mondiale. Nous ne rejetons pas l’idée que même dans un monde dominé au niveau impérialiste par le “chacun pour soi”, on peut voir une tendance définie à la “bipolarisation”, c’est-à-dire que les rivalités entre les deux États les plus puissants deviennent un facteur majeur dans la situation mondiale. En fait, cela a toujours été notre position, comme on peut le voir dans notre texte d’orientation Militarisme et décomposition, écrit lors de l’ouverture de la nouvelle phase, où nous affirmions que “la situation actuelle implique, sous la pression de la crise et des tensions militaires, une tendance à la reformation de deux nouveaux blocs impérialistes”. (1) Nous avons donc envisagé la possibilité que d’autres puissances (Allemagne, Russie, Japon…) se posent en rivales des États-Unis et deviennent candidates au rôle de nouvelle tête de bloc. De notre point de vue, à ce stade, aucun de ces prétendants n’a les “qualifications” nécessaires pour jouer ce rôle, et nous en avons conclu qu’il est très probable qu’aucun nouveau bloc impérialiste ne se reformera jamais, tout en insistant que cela ne signifie aucunement une atténuation des conflits impérialistes. Au contraire, ces conflits devraient prendre la forme d’un “chacun pour soi” de plus en plus chaotique, une menace, par bien des aspects, beaucoup plus dangereuse pour l’humanité que la période précédente, où les conflits nationaux et régionaux étaient à un certain niveau limités par la discipline de blocs. Nous pensons que ce pronostic a été largement confirmé, comme nous pouvons le voir de façon évidente dans les actuels conflits à multiples facettes en Syrie et en Libye.
Bien sûr, à ce niveau, comme nous l’avons dit, nous avons sous-estimé la possibilité pour la Chine d’émerger en tant que puissance mondiale majeure et comme sérieux rival des États-Unis. Mais l’émergence de la Chine elle-même est un produit de la phase de décomposition (2) et alors qu’elle doit fournir une preuve définitive de la tendance à la bipolarisation, il existe une grande différence entre le développement de cette tendance et un processus concret menant à la formation de nouveaux blocs. Si nous regardons les deux pôles majeurs, les attitudes de plus en plus agressives de chacun d’entre eux tendent à saper ce processus plutôt qu’à le renforcer. La Chine fait l’objet d’une profonde méfiance de la part de tous ses voisins, notamment de la Russie qui souvent ne s’aligne sur la Chine que pour défendre ses intérêts immédiats (comme elle le fait en Syrie), mais est terrifiée à l’idée de se retrouver subordonnée à la Chine en raison de la puissance économique de cette dernière, et reste l’un des plus féroces opposants au projet de Pékin de “route de la soie”. L’Amérique entre-temps s’est activement employée à démanteler pratiquement toutes les structures de l’ancien bloc qu’elle avait auparavant utilisées pour préserver son “nouvel ordre mondial” et qui permettaient de résister aux glissements des relations internationales vers le “chacun pour soi”. Elle traite de plus en plus ses alliés de l’OTAN en ennemis, et en général (comme le camarade Steinkopfler lui-même l’affirme clairement) elle est devenue l’un des facteurs principaux d’aggravation du caractère chaotique des relations impérialistes actuelles.
Dans cette situation, le danger de guerre reflète ce processus de fragmentation. Nous ne pouvons évidemment pas exclure la possibilité de confrontations militaires entre les États-Unis et la Chine, mais nous ne pouvons pas non plus ignorer les conflits de plus en plus irrationnels entre l’Inde et le Pakistan, entre Israël et l’Iran, entre l’Iran et l’Arabie Saoudite, etc. Mais c’est précisément la signification, et la terrible menace, du “chacun pour soi” en tant que facteur d’aggravation de la décomposition et mettant en danger le futur de l’humanité. Nous continuons à penser que cette tendance non seulement est en avance sur la tendance à la reformation de blocs, mais qu’elle entre directement en conflit avec elle.
La divergence sur la lutte de classe
Comme nous l’avons vu, le camarade Steinkopfler suggère que la résolution sur le rapport de forces entre les classes du 23e congrès ne s’intéresse plus au problème de la perspective révolutionnaire, et que ce facteur a disparu de notre compréhension des causes (et conséquences) de la décomposition. En fait, la question de la politisation de la lutte de classe et des efforts de la bourgeoisie pour empêcher son développement est au cœur de la résolution. Le ton est donné dès le premier point de la résolution, lequel parle du renouveau de la lutte de classe à la fin des années 1960 et de la réapparition d’une nouvelle génération de révolutionnaires : “Confrontée à la dynamique vers la politisation des luttes ouvrières, la bourgeoisie (qui avait été surprise par le mouvement de Mai 68) a immédiatement déployé une contre-offensive sur une large échelle et à long terme pour empêcher la classe ouvrière d’apporter sa propre réponse à la crise historique de l’économie capitaliste : la révolution prolétarienne”. En d’autres termes : pour la classe ouvrière, la politisation signifie essentiellement poser la question de la révolution : c’est exactement la même question que la “perspective révolutionnaire”. Et la résolution poursuit en montrant comment, confrontée aux vagues de lutte de classe sur la période entre 1968 et 1989, la classe dominante a utilisé toutes ses ressources et mystifications pour empêcher la classe ouvrière de développer cette perspective.
En ce qui concerne la question des luttes en Pologne, qui joue un rôle central dans l’argumentation du camarade Steinkopfler : il n’y a aucun désaccord entre nous sur le fait que la Pologne de 1980 a été un moment-clé dans l’évolution du rapport de forces entre les classes sur la période ouverte par les événements de Mai 68 en France. Le camarade a raison d’affirmer que, contrairement à Mai 68 et à la vague internationale de mouvements de classe qui l’a suivi, dont l’épicentre a été l’Europe de l’Ouest, les luttes en Pologne n’ont pas fait émerger une nouvelle génération d’éléments politisés, dont une partie (à partir de 1968) avait trouvé le chemin des positions de la Gauche communiste. Mais elle a néanmoins posé un profond défi à la classe ouvrière mondiale : la question de la grève de masse, de l’organisation autonome et de l’unification des ouvriers pour former une force dans la société. Les ouvriers polonais se sont élevés eux-mêmes à ce niveau, même s’ils ont été incapables de résister aux chants des sirènes du syndicalisme et de la démocratie au niveau politique. Comme nous l’avons dit à l’époque, et pour paraphraser Rosa Luxemburg à propos de la Révolution russe, la question en Pologne ne pouvait être que posée. Elle ne pouvait être résolue qu’internationalement, et avant tout par les bataillons politiquement les plus avancés de la classe en Europe de l’Ouest. Les ouvriers de l’Ouest allaient-ils relever le gant et développer à la fois une auto-organisation et une unification afin d’offrir une perspective de nouvelle société ? Le CCI a contribué par de nombreux textes au début des années 1980 à évaluer ce potentiel. (3)
Plus spécifiquement, la nouvelle vague de luttes qui a commencé en Belgique en 1983 sera-t-elle capable de relever le défi ? Alors que le CCI notait d’importantes avancées au sein de cette vague de luttes (les tendances à l’auto-organisation et à la confrontation au syndicalisme de base en France et en Italie, par exemple), cette vitale étape de la politisation n’a pas été franchie, et la troisième vague a commencé à rencontrer des difficultés. Lors du 8e congrès du CCI en 1988, il y a eu un débat animé entre les camarades qui trouvaient que la troisième vague de luttes avançait inexorablement, et ce qui était alors une minorité qui mettait en avant que la classe ouvrière souffrait déjà de l’impact de la décomposition du fait de l’atomisation, de la perte de son identité de classe, de l’idéologie du “chacun pour soi” sous la forme du corporatisme, etc., tout cela étant le résultat de l’incapacité de la classe de développer une perspective pour le futur de la société. Ainsi, et ici nous devons nous opposer à une formulation utilisée par la commission d’amendements de la résolution sur la lutte de classe du 23e congrès, à laquelle le camarade Steinkopfler fait référence dans son texte, il y a bien entendu une continuité entre les difficultés de la classe dans les années 1980 et le recul de la période post-1989. Mais à notre avis, ici aussi, le camarade Steinkopfler sous-estime le changement qualitatif induit par les événements de 1989, qui ont l’apparence de descendre du ciel sur la classe ouvrière, même si en réalité ils fermentaient depuis longtemps au sein de la société bourgeoise. Ils ont entraîné un recul de la conscience de classe et de la combativité qui a été plus profond et a duré plus longtemps que nous le soupçonnions, même si nous avons été capables de le prévoir au lendemain de l’effondrement du mur de Berlin.
Populisme et mobilisation pour la guerre
Il n’y a aucun désaccord sur le fait que la classe ouvrière est entrée au cours des dernières décennies dans un long processus de déboussolement, caractérisé par la perte de son identité de classe et de sa perspective pour le futur. Nous sommes d’accord avec l’idée que certains mouvements qui ont eu lieu au cours de cette période de recul général ont montré la possibilité d’un renouveau de la lutte, en même temps qu’un niveau de combativité et qu’une conscience de l’impasse de la société capitaliste : ainsi que le dit le camarade Steinkopfler, nous avons vu dans ces mouvements “le développement d’une culture de la théorie et d’une culture du débat (tels qu’ils ont commencé à s’exprimer avec naïveté dans le mouvement anti-CPE et chez les Indignados) en tant que manifestations fondamentales du prolétariat en tant que classe consciente et associée”.
Cependant, nous sommes totalement en désaccord avec deux des conclusions du camarade sur les difficultés actuelles de la classe :
– que l’émergence du populisme est l’expression d’une société qui se tourne vers la guerre,
– que nous assistons aujourd’hui non pas à une maturation souterraine de la conscience, mais à une véritable “régression souterraine”.
Pour commencer, nous ne pensons pas que le populisme soit le produit de l’expression d’une claire course vers la guerre de la classe dominante des principaux pays capitalistes. Il s’agit certainement du produit d’un nationalisme aggravé et du militarisme, de la violence nihiliste et du racisme qui émanent de la décomposition de ce système. En ce sens, bien sûr, il a beaucoup de similitudes avec le fascisme des années 1930. Mais le fascisme était le produit d’une véritable contre-révolution, une défaite historique de la classe ouvrière, et il exprimait directement la capacité de la classe dominante à mobiliser le prolétariat pour une nouvelle guerre impérialiste à l’échelle mondiale. D’un autre côté, le populisme est le résultat du blocage entre les classes, lequel implique une absence de perspective non seulement pour une partie de la classe ouvrière, mais aussi pour la bourgeoisie elle-même. Il exprime une perte de contrôle de plus en plus importante de la bourgeoisie sur son appareil politique, une fragmentation grandissante à la fois au sein de chaque État national et au niveau des relations internationales. Si l’émergence du populisme signifiait réellement que la bourgeoisie a retrouvé la possibilité de mener la classe ouvrière vers la guerre, nous devrions en conclure que le concept de décomposition que nous avons défini n’est absolument plus valable. Cela impliquerait que la bourgeoisie a maintenant une “perspective” à offrir à la société, même si elle est totalement irrationnelle et suicidaire.
Le camarade Steinkopfler nous dit que “le populisme contemporain est un autre clair signe que la société évolue vers la guerre :
– l’émergence du populisme en elle-même n’est pas le moindre des produits de l’agressivité croissante et des pulsions destructrices générées par la société bourgeoise actuelle ;
– cependant cette agressivité “spontanée” n’est pas en elle-même suffisante pour mobiliser la société autour de la guerre, les mouvements populistes actuels sont nécessaires à cette fin à la classe dominante.
En d’autres termes, ils sont en premier lieu un symptôme et un facteur actif de la course à la guerre”.
Autrement dit, des phénomènes comme le Brexit en Grande-Bretagne ou comme le trumpisme aux États-Unis ne sont pas, d’abord et avant tout, le résultat d’une perte de contrôle de la bourgeoisie sur son appareil politique (et, de plus en plus, économique), une expression concentrée du court terme et de la fragmentation de la classe dominante. Au contraire : les factions populistes seraient les meilleurs représentants de la bourgeoisie, complètement unie derrière la mobilisation pour la guerre.
Compte tenu de sa vision du cours des événements, il n’est pas surprenant que le camarade Steinkopfler se méprenne en diagnostiquant une orientation de la bourgeoisie vers la guerre ou en soulignant de manière contradictoire les expressions de nature prolétariennes en 2006 et 2011, signes d’une maturation de la conscience et qui témoignent au contraire du fait que la bourgeoisie n’a pas en main toutes les cartes en sa faveur pour conduire la classe ouvrière à la guerre.
Certainement, comme le camarade nous le rappelle, nous avons toujours avancé que la conscience prolétarienne peut se développer en profondeur (largement, mais pas entièrement, du fait du nécessaire travail des organisations révolutionnaires en ce sens) même au cours d’une période de contre-révolution, alors qu’elle est sévèrement limitée en étendue, comme on l’a vu avec le travail des Fractions italienne et française de la Gauche communiste dans les années 1930 et 1940. Mais si elle se poursuit même au cours de telles périodes, que signifie le terme “régression souterraine” ? Cela n’implique-t-il pas que la situation aujourd’hui serait encore pire que celle des années 1930 ? Le texte du camarade ne nous dit pas clairement depuis combien de temps ce processus de régression souterraine dure : si nous voyons un développement de la conscience au sein de la jeune génération en 2006 et 2011, il est logique de dire que ces mouvements ont été précédés par un processus “souterrain” de maturation. En tout cas, nous sommes d’accord que sur le plan des luttes ouvertes et de l’étendue de la conscience de classe, ces avancées ont été, comme pour pratiquement chaque mouvement ascendant de la classe, suivis par une phase de recul : par exemple, quelques années après le mouvement des Indignés qui a été particulièrement fort à Barcelone, une partie des jeunes qui, en 2011, ont pris part aux assemblées et manifestations, qui ont mis en avant de véritables slogans internationalistes, sont maintenant tombés dans l’impasse absolue du nationalisme catalan.
Mais ça ne prouve pas que la Vieille Taupe aurait décidé elle-même de prendre des vacances, que ce soit en 2012 ou plus tôt. La période 2006/2011 a été accompagnée par l’émergence d’une minorité politisée qui s’est montrée très prometteuse, mais a en grande partie échoué dans le marais anarchiste ou moderniste, de sorte que leur contribution nette au développement réel du milieu révolutionnaire a été extrêmement limitée. Les minorités en recherche qui se sont développées ces dernières années, malgré leur jeunesse et de leur inexpérience, semblent démarrer à un niveau plus élevé que celles qui avaient émergé une décennie auparavant : en particulier, elles sont plus conscientes de la nature terminale du système capitaliste et de la nécessité de renouer avec la tradition de la Gauche communiste. De notre point de vue, de telles avancées sont précisément le produit d’une maturation souterraine.
D’après le camarade Steinkopfler, le fait que les récents mouvements qui se sont situés sur le terrain de “réformer” la société bourgeoise, comme les manifestations sur la question climatique, clament souvent avoir identifié le problème au niveau du système, de la société capitaliste elle-même, n’expriment rien moins que la confiance de la classe dominante, qui peut se permettre d’attiser le besoin d’aller au-delà du capitalisme précisément parce qu’elle ne craint aucunement que la classe ouvrière s’empare sérieusement d’un tel discours. Mais il n’est pas moins plausible que ce discours anti-capitaliste est un anticorps typique de la société bourgeoise, laquelle ressent un profond besoin de dévoyer tout questionnement naissant. En d’autres termes : alors que la nature apocalyptique de ce système devient toujours plus évidente, il devient de plus en plus nécessaire pour l’idéologie bourgeoise d’empêcher une véritable compréhension de ses racines et de sa véritable alternative.
À la fin du texte du camarade Steinkopfler, il est difficile de voir d’où pourrait venir le renouveau de l’identité de classe et de la perspective révolutionnaire, et nous restons sur l’impression qu’il est tombé dans un noir pessimisme. Le camarade n’a pas tort de mettre en avant que les luttes économiques, la résistance immédiate aux attaques des conditions de vie, ne sont pas suffisantes en soi pour générer une claire conscience de classe révolutionnaire, mais elles n’en sont pas moins absolument vitales si la classe ouvrière veut recouvrer la compréhension qu’elle est elle-même une force sociale distincte, surtout dans une période où l’agitation croissante de l’état de la société capitaliste est poussée vers une foule de mobilisations interclassistes et ouvertement bourgeoises. Dans les années 1930, au milieu de tout le battage autour des conquêtes révolutionnaires des travailleurs espagnols, les camarades de la revue Bilan se sont retrouvés presque seuls à affirmer que dans de telles conditions la plus petite grève autour de revendications économiques (avant tout dans les industries de guerre contrôlées par la CNT !) serait un premier pas de la classe ouvrière retrouvant son propre terrain. Les récentes grèves autour de la question des retraites en France, et dans de nombreux pays dans le secteur de la santé et de la sécurité au travail au début de la pandémie de Covid-19, ont été moins “médiatiques” que les “vendredi pour le climat” ou les marches de Black Lives Matter, mais elles ont apporté une véritable contribution à une future récupération de l’identité de classe, alors que ces marches ne peuvent que s’y opposer.
Nous sommes bien entendu d’accord avec le camarade Steinkopfler sur le fait que retrouver son identité de classe et développer une conscience révolutionnaire sont inséparables : pour que la classe ouvrière comprenne vraiment ce qu’elle est, elle doit aussi comprendre ce qu’elle doit être historiquement, comme l’a dit Marx : le porteur d’une nouvelle société. Et nous sommes également d’accord avec l’idée que les organisations de la Gauche communiste ont un rôle indispensable dans ce processus dynamique. Le camarade donne un jugement très sévère sur le rôle que ces organisations ont joué ces dix dernières années, et plus :
“Au cours de l’histoire, de minuscules minorités ont régulièrement développé, sans aucune participation des masses, des idées capables de révolutionner le monde, capables de “conquérir les masses” à terme. Une des principales faiblesses du prolétariat dans les deux décennies qui ont suivi 1989 a été en fait l’incapacité de ses minorités à accomplir ce travail. Les groupes historiques de la Gauche communiste ont une responsabilité particulière dans cet échec. Le résultat a été que, lorsqu’une nouvelle génération de prolétaires politisés a commencé à apparaître (comme les Indignados en Espagne ou les différents mouvements “d’occupation” à la suite des crises “financières” et de l’ “Euro” après 2008), le milieu politique prolétarien existant n’a pas été en mesure de les armer suffisamment avec les armes politiques et théoriques dont ils auraient eu besoin pour s’orienter et se sentir inspirés pour faire face à la tâche d’inaugurer le début de la fin du reflux prolétarien”.
Tout ceci n’est pas très clair sur comment, et avec quelles contributions théoriques, les organisations de la Gauche communiste auraient pu armer la nouvelle génération au point qu’elles auraient pu empêcher le recul qui a suivi les mouvements de 2011.
Mais il semble y avoir un problème méthodologique derrière ce jugement. Les organisations de la Gauche communiste peuvent très certainement critiquer très sévèrement les erreurs qu’elles ont commises face à la “nouvelle génération de prolétaires politisés”, erreurs avant tout de nature opportuniste. Cette critique est nécessaire parce qu’elle se place dans un ensemble d’enjeux sur lesquels les petits groupes révolutionnaires peuvent avoir une réelle influence : le regroupement de révolutionnaires, les étapes nécessaires pour construire un milieu révolutionnaire dynamique et responsable et ainsi de poser les fondations d’un parti du futur. Mais il semblerait que l’on frise le substitutionnisme4 en suggérant que nos efforts théoriques et politiques auraient pu, à eux seuls, stopper le reflux qui a suivi 2011, lequel a essentiellement été la poursuite d’un processus qui s’est vigoureusement développé depuis 1989. De futures discussions détermineront s’il s’agit ici d’une véritable divergence sur la question de l’organisation.
CCI
1 Revue internationale n° 64.
2 Voir en particulier les points 10 à 13 de la “Résolution sur la situation internationale, les conflits impérialistes, la vie de la bourgeoisie, la crise économique [62]”.
3 Voir, par exemple : “Grève de masse en Pologne : une nouvelle brèche s’est ouverte” [136], Revue internationale n° 26 (1981).
4 C’est-à-dire, l’idée selon laquelle l’organisation des révolutionnaires pourrait se substituer aux tâches révolutionnaires de la classe dans son ensemble.
Rubrique:
ICConline - 2021
- 356 lectures
ICCOnline - janvier 2021
- 65 lectures
Mobilisation contre la loi anti-IVG en Pologne: Seule la révolution prolétarienne peut garantir l’émancipation des femmes
- 110 lectures
Durant plusieurs semaines, la Pologne a connu un important mouvement de contestation suite à la décision du tribunal constitutionnel de Varsovie (saisi par le parti au pouvoir, “Droit et justice”) de quasiment interdire l’avortement pour les femmes enceintes de fœtus souffrant de malformations même graves et irréversibles. Les seuls cas d’IVG légaux seraient désormais justifiés en cas de viol, d’inceste ou de mise en danger de la vie de la mère. Cet arrêté ne concerne pourtant que 2 % des IVG réalisées l’an passé, alors qu’environ 200 000 femmes doivent déjà aller à l’étranger pour se faire avorter. Cette décision prise en pleine pandémie de Covid semble avoir été la goutte d’eau qui a fait déborder le vase et fait descendre dans les rues des grandes et petites villes des milliers de manifestants.
Les slogans expriment crûment le degré de révolte légitime de ces derniers : “Je ne veux pas qu’on m’oblige à accoucher d’un fœtus mort” ; “Ils te forcent à mener la grossesse à terme et à accoucher pour pouvoir administrer le baptême à l’enfant mort-né avant de l’enterrer” ; “Vous êtes des criminels, halte à la barbarie”.
L’obscurantisme de la bourgeoisie polonaise
Rappelons que la Pologne applique déjà une des législations les plus strictes en matière d’IVG et que cette dernière attaque du pouvoir s’inscrit dans une politique populiste visant à satisfaire les intérêts d’un de ses appuis : l’Église catholique polonaise. C’est dans ce sens que la Pologne s’est retirée de la convention d’Istanbul du Conseil de l’Europe, sur “la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique”.
Ce n’est pas la première fois que la bourgeoisie s’appuie sur la religion pour empêcher toute prise de conscience du prolétariat face à la crise. Sous le stalinisme et son athéisme d’État, l’Église représentait déjà une “opposition démocratique” initiée par le “syndicalisme chrétien” et reprise, par la suite, par le syndicat Solidarnosc et son mentor Lech Walesa, avec leurs fameuses “messes dominicales pour les travailleurs”. Rappelons que ce même syndicaliste devenu président a, par deux fois, imposé son veto à un assouplissement de la loi sur l’avortement initié par la gauche qui voulait réintroduire la notion de “conditions sociales difficiles pour la mère” (ancienne formule stalinienne adoptée en 1953 et abrogée en 1993). (1)
Pourquoi l’État polonais, alors qu’il est fortement critiqué pour son “improvisation” dans la gestion de la deuxième vague du Covid-19, a-t-il relancé un débat suranné sur l’avortement ? Il faut chercher les raisons de cette décision dans la putréfaction du pouvoir polonais qui se débat depuis plusieurs années entre populisme et obscurantisme et ne se maintient au pouvoir que par toujours plus de complaisance à l’égard des différentes cliques associées à l’administration de la société. En l’occurrence, la situation est devenue si explosive que le gouvernement a dû momentanément calmer le jeu. Pour l’instant, il a décidé de ne pas publier la décision du tribunal constitutionnel au journal officiel. Il n’en fallait pas plus pour que l’opposition et les associations féministes hostiles au gouvernement très conservateur parlent de “révolution des femmes”, idée d’ailleurs reprise par le journal français Libération qui titrait, le 9 novembre : “Pologne : vers la première révolution féministe ?”, relayant ainsi les propos de Bozena Przyluska, (2) l’une des organisatrices de la Manifestation nationale des femmes qui affirmait le 30 octobre : “ce n’est pas une protestation qui va s’épuiser. C’est une révolution. Le gouvernement ne semble pas le comprendre”.
Dès lors, ces manifestations sont à la fois l’expression de l’indignation face au sort ignoble réservé aux femmes en Pologne et partout ailleurs dans le monde, mais également l’illustration de l’impasse dans laquelle débouche ce type de mobilisations, impasse entretenant l’illusion que l’État capitaliste aurait le pouvoir d’améliorer les conditions d’existence des femmes si les “citoyennes” faisaient pression sur lui dans la rue et, surtout, dans l’isoloir.
L’oppression des femmes : un corollaire des sociétés de classes
L’oppression des femmes fait partie intégrante de l’exploitation et de l’oppression du prolétariat. C’est ce qu’Engels affirmait déjà en 1884 : “De nos jours, l’homme, dans la grande majorité des cas, doit être le soutien de la famille et doit la nourrir, au moins dans les classes possédantes ; et ceci lui donne une autorité souveraine qu’aucun privilège juridique n’a besoin d’appuyer. Dans la famille, l’homme est le bourgeois ; la femme joue le rôle du prolétariat”. (3) Depuis les origines des sociétés de classes, l’oppression des femmes a pris des formes multiples : “matrices reproductrices”, butin de guerre, garante de la sauvegarde du patrimoine familial et national, esclaves domestiques ou sexuelles via les mariages arrangés, les viols, la prostitution, etc.
À partir du XVIe siècle en Europe, le besoin irrépressible de main-d’œuvre éprouvé par le capitalisme naissant accentua considérablement l’oppression des femmes. L’Église catholique et les pouvoirs temporels persécutèrent les femmes et tout particulièrement les sages-femmes suspectées de pratiquer l’avortement. Ces “sorcières”, accusées de s’acoquiner avec Satan, furent soumises aux pires supplices et finirent sur les bûchers. La femme devint alors une simple machine à produire de futurs travailleurs.
Ainsi, contrairement à ce que cherche à nous faire croire le mouvement féministe, (4) la source de l’oppression féminine ne réside pas dans la volonté “naturelle” de domination du sexe masculin mais, comme l’a montré Engels, dans la dissolution du communisme primitif, et le développement de la propriété privée et de la société divisée en classes sociales antagoniques.
Depuis, la dépossession et l’exploitation du corps féminin se sont perpétuées. Les viols, les agressions sexuelles, les violences conjugales, le sexisme et la misogynie endémiques. Autrement dit, toutes les formes de violences physiques et psychologiques rythmant la société actuelle sont l’héritage de plusieurs millénaires de soumission et d’oppression exerceés à l’encontre des femmes. Le “droit à l’avortement” et à la contraception ne représentent, à ce titre, aucune “victoire des femmes enfin libres de disposer de leur corps”. Contrairement au droit à l’avortement obtenu dans la Russie révolutionnaire de 1920, il ne s’agit pour la bourgeoisie que de réguler les naissances, de rationaliser la reproduction de la force de travail dans une société capitaliste en crise.
La lutte contre le capitalisme : seule issue pour l’émancipation des femmes
Il est donc illusoire de croire que l’émancipation de la femme pourrait être le résultat d’une lutte à part entière au sein même de la société capitaliste. Ce credo féministe ne fait qu’entretenir l’illusion que la société capitaliste pourrait être plus juste.
Seule la lutte contre la société reproduisant inlassablement les conditions de l’oppression féminine, seule la lutte contenant la destruction de toutes les formes d’exploitation et d’oppression pourra ouvrir la voie à l’émancipation des femmes. La lutte du prolétariat contre la société capitaliste (la dernière société de classe de l’histoire), en unifiant les hommes et les femmes d’une même classe exploitée dans un seul et même combat, en œuvrant à l’émancipation de l’humanité tout entière, transformera le rapport entre les sexes. Comme l’affirmait Bebel dans La Femme et le socialisme : “Quelle place doit prendre la femme dans notre organisme social afin de devenir dans la société humaine un membre complet, ayant les droits de tous, pouvant donner l’entière mesure de son activité, ayant la faculté de développer pleinement et dans toutes les directions ses forces et ses aptitudes ? C’est là une question qui se confond avec celle de savoir quelle forme, quelle organisation essentielle devra recevoir la société humaine pour substituer à l’oppression, à l’exploitation, au besoin et à la misère sous leurs milliers de formes, une humanité libre, une société en pleine santé tant au point de vue physique qu’au point de vue social. Ce que l’on nomme la question des femmes ne constitue donc qu’un côté de la question sociale générale. Celle-ci agite en ce moment toutes les têtes et tous les esprits ; mais la première ne peut trouver sa solution définitive qu’avec la seconde”.
Adjish, 17 novembre 2020
1) Cf. “La religion au service de l’exploitation”, Révolution internationale n° 79 (novembre 1980).
2) Bozena Przyluska est une militante laïque polonaise qui a cofondé le Congrès de la laïcité. Elle devient membre fondatrice du Conseil consultatif créé le 1er novembre 2020 dans le cadre des manifestations polonaises d’octobre 2020.
3) Engels, L’origine de la famille, de la propriété privée et de l’État (1884).
4) Cf. “Le mouvement ouvrier et la question de l’oppression de la femme”, Révolution internationale n° 327 (octobre 2002).
Géographique:
- Pologne [216]
Rubrique:
Pandémie de Covid-19, assaut du capitole à Washington: deux expressions de l’intensification de la décomposition du capitalisme
- 178 lectures
L’année qui vient de s’écouler a été marquée, une nouvelle fois, par une série de catastrophes, dont une pandémie mondiale ayant fait à ce jour plus de 2 millions de morts et ayant provoqué un à-coup significatif de la crise du capitalisme, plongeant des millions de personnes dans la misère et la précarité. L’année 2021 vient à peine de commencer, qu’elle est aussitôt marquée par un nouvel événement de portée historique : l’assaut du Capitole par les hordes trumpistes fanatisées. Ces deux événements ne sont pas séparés l’un de l’autre. Au contraire, selon le CCI, ils révèlent tous les deux une intensification de la décomposition sociale, la phase ultime de la décadence du capitalisme. Cette réunion publique sera donc l’occasion d’exposer ce cadre d’analyse, d’en cerner la pertinence mais également de le questionner au prisme des faits et de l’évolution historique de la société capitaliste.
Afin de préparer cette réunion, les participants peuvent d’ores et déjà se référer au texte suivant :
“La décomposition, phase ultime de la décadence capitaliste [10]” (Revue internationale n° 107, 4e semestre 2001).
La réunion publique se tiendra en ligne le Samedi 30 janvier 2020 à 14H00.
Pour participer, veuillez bien envoyer un message sur notre adresse électronique ([email protected] [213]) ou dans la rubrique “contact” de notre site internet.
Rubrique:
Les graves faiblesses du PCI dans le mouvement contre la réforme des retraites (Partie 1)
- 192 lectures
Le mouvement de lutte contre la réforme des retraites en France, durant l’hiver 2019-2020, a été le dernier combat de classe significatif avant la crise brutale du Covid-19. Il est donc nécessaire d’en tirer les leçons. Les organisations du prolétariat issues de la Gauche communiste ont eu, au cours de cette lutte, des approches différentes et n’en ont pas tiré les mêmes enseignements. Les conditions de la lutte de classe, au regard de leur complexité, doivent selon nous être débattues et exposées pour conduire à la clarté au sein du milieu politique prolétarien. Nous proposons donc, dans cette optique militante, d’analyser de manière critique l’intervention du PCI (qui publie en France Le Prolétaire) lors de ce mouvement.
Contrairement aux organisations gauchistes et aux syndicats, défenseurs de l’État et chiens de garde du capitalisme, les organisations de la Gauche communiste ont véritablement combattu et dénoncé l’attaque inique contre le régime des retraites qui allait frapper de plein fouet le prolétariat. Leur objectif commun n’était pas limité à dénoncer uniquement la réforme, mais à combattre le capitalisme et ses défenseurs.
Une dénonciation du rôle des syndicats et des gauchistes
Dès le début du mouvement contre la réforme des retraites, Le Prolétaire a donc ainsi dénoncé le rôle politique des gauchistes et des syndicats, sa critique et son combat se portant sur le sabotage et des manœuvres dilatoires : “Lorsque la mobilisation est massive comme lors de la grève à la RATP, les syndicats brandissent la perspective d’une grève illimitée pour dans… 3 mois !” (1) Les camarades soulignent aussi le travail de sape de ces mêmes syndicats qui “ont saucissonné la mobilisation en multipliant les ‘journées d’action’ catégorie par catégorie”. (2) Lors du mouvement de grève spontanée au début à la SNCF, dans le technicentre de Châtillon, le PCI dénonçait les plus radicaux, comme le syndicat SUD-Rail : “Le syndicat SUD-Rail, réputé le plus combatif, qui avait reconnu avoir été surpris par la grève de Châtillon, s’est positionné en flèche dans la suite du mouvement – mais pour saboter l’extension de la lutte ! Il a agité la menace d’un appel à la grève illimitée sur ces centres “dés jeudi soir ou lundi”. Mais après avoir joué les fier-à-bras en posant une sorte d’ultimatum à la direction (“On a donné à la direction jusqu’à 18 heures pour répondre à nos revendications”), SUD a appelé à la reprise du travail : “On joue le jeu (du dialogue social). En attendant, le travail reprend, les rames vont sortir”. La direction a repris la balle au bond en programmant une réunion avec les syndicats, et SUD a cessé d’évoquer la possibilité d’une grève”. (3)
Juste après la manifestation du 17 décembre, Le Prolétaire mettait encore en évidence les manœuvres d’enfermement des syndicats qui laissaient pourrir la situation face au besoin d’unité et d’élargissement du mouvement : “l’intersyndicale réunie le soir même décida de… ne rien décider. Les travailleurs furent priés de se rabattre sur des initiatives locales – qui, inévitablement ont été peu suivies ; au moment où les prolétaires ont un besoin pressant de centraliser et d’unifier leur combat”. (4) Il n’a pas non plus échappé aux révolutionnaires, comme à la plupart des ouvriers d’ailleurs, que “l’annonce spectaculaire par le premier ministre du retrait (“provisoire” !) de l’âge pivot n’est qu’une manœuvre pour arrêter la lutte avec le concours de la CFDT de l’UNSA et de la CFTC, le gouvernement se réservant le droit de le réintroduire par ordonnance”. (5)
Parmi d’autres passages qui résument le mieux les conclusions du PCI sur la politique syndicale, on peut citer les formules qui rappellent que les “appareils syndicaux sont des défenseurs de l’ordre établi” et qu’ils sont “complètement intégrés dans le réseau bourgeois de maintien de l’ordre social”. (6)
Les contradictions du PCI sur la nature des syndicats
En dépit de ces caractérisations justes, de formules soulignant que les syndicats sont bien les “défenseurs de l’ordre établi”, on trouve malheureusement en parallèle un ensemble de propos contradictoires et totalement opposés à cette idée. La portée de l’intervention politique du PCI se trouve en effet pétrie de contradictions qui révèlent une démarche clairement opportuniste. (7) Ainsi, selon le PCI, l’ensemble du mouvement contre la réforme des retraites n’a été finalement qu’un “échec” qui proviendrait exclusivement de “l’orientation de la lutte décidée par l’intersyndicale”. (8) Il y a une part de vérité indéniable dans le fait que l’intersyndicale a apporté sa forte contribution pour saboter la lutte. Mais cette façon de poser le problème, selon nous, vient grandement affaiblir la dénonciation des syndicats. En ne voyant que l’action exclusive et quasi unilatérale d’une “décision” de “l’intersyndicale” alors que, de par leur fonction, les syndicats dans toute leur globalité ne pouvaient faire autre chose que de saboter et entraver la lutte de classe, le PCI ne peut aller plus loin que de s’enliser dans la contradiction en voyant simplement le jeu d’un “compromis” de la part des “directions” liées à une simple “collaboration” avec l’État. Pour le PCI, les syndicats, qu’il qualifie d’un côté de “défenseur de l’ordre établi”, sont en même temps jugés de manière contradictoire “collaborationnistes”. Par exemple, il est dit que : “La politique défaitiste des appareils syndicaux dans les luttes ouvrières est la conséquence inévitable de leur pratique de collaboration de classe”. (9) Cela signifie que le PCI défend une position, encore une fois, totalement contradictoire sur la nature de classe de ces organes qui devraient, finalement, si on suit sa logique jusqu’au bout, “cesser de collaborer” ou “cesser d’être défaitistes”. Mais pourquoi le leur demander s’ils sont “défenseurs de l’ordre établi” ? Autant demander directement à un loup affamé de protéger des agneaux !
Du fait de sa démarche opportuniste, le PCI ne peut voir ses contradictions, ses incohérences et comprendre que ces organes sont en réalité des ennemis de classe, qu’ils sont eux-mêmes devenus des organes bourgeois, totalement intégrés à l’appareil d’État et parfaitement institutionnalisés dans le droit du travail. En polarisant ainsi exclusivement sur les “directions syndicales”, bien qu’elles aient effectivement joué le rôle anti-ouvrier le plus visible, le PCI estime possible de voir émerger en “opposition” une sorte de réaction “à la base”, avec également la possibilité, finalement, d’une sorte de “syndicalisme rouge”. (10) Tout cela le conduit, certes de façon critique, à soutenir in fine l’activité syndicale la plus radicale, “à la base”, sans percevoir la logique politique qui recouvre toutes les formes du syndicalisme devenues réactionnaires. Cet aveuglement occulte le rôle essentiel du syndicalisme et sa nature bourgeoise depuis la Première Guerre mondiale, de même que ses acteurs de premier plan, notamment les gauchistes, qui au plus près du terrain ne cessent de magouiller et d’étouffer, de stériliser et enfermer d’emblée toute expression ou étincelle de vie prolétarienne. C’est notamment le cas de LO, que le PCI juge “centriste” et non pas bourgeois, dont l’entrisme pousse bon nombre de militants à être très actifs au sein même de la CGT.
Le PCI se retrouve malheureusement de facto à la remorque des gauchistes quand il proclame avec les loups que : “L’apparition de comités de grève, d’AG interpro et de coordinations pendant le mouvement actuel constitue un premier pas pour que les travailleurs prennent leur lutte en main et surmontent leurs divisions”. (11) Pour le CCI au contraire, très loin d’être “un premier pas” positif, les “AG-interpro” du mouvement contre la réforme des retraites n’avaient rien de spontané. Ce n’étaient que des coquilles vides, artificiellement proclamées, suscitées et verrouillées par les syndicats. Les comités de grève étaient en effet dès le départ aux mains de syndicalistes ou de gauchistes professionnels particulièrement expérimentés dans l’action du sabotage de la lutte. On peut aussi évoquer les simulacres d’extensions (avec l’envoi de délégations gauchistes ou syndicales par-ci et par là, acquises à la même logique que les grandes centrales syndicales dont elles faisaient en réalité la promotion). Cela, il était de la responsabilité d’une organisation ouvrière de le dénoncer.
La démarche la plus juste n’était donc pas de suivre les expressions radicales du syndicalisme, mais de mettre en exergue les conditions de la lutte de classe, de montrer, comme a cherché à le faire le CCI, la réalité d’une réflexion souterraine s’exprimant par un besoin de solidarité, que justement les syndicats et toute la bourgeoisie cherchaient à dénaturer. Il était nécessaire de replacer la lutte dans son contexte d’émergence d’une reprise de la combativité et répondre politiquement au besoin de réflexion au sein de la classe.
Que devons nous conclure de la démarche du PCI ? Comme nous le disons depuis déjà longtemps : “ce que le PCI met en évidence, c’est son manque de clarté et de fermeté sur la nature du syndicalisme. Ce n’est pas ce dernier qu’il dénonce comme arme de la classe bourgeoise, mais tout simplement les “appareils syndicaux”. Ce faisant, il ne réussit pas, malgré ses dires, à se démarquer et à se distinguer de la vision trotskiste : on peut maintenant trouver dans la presse d’un groupe comme Lutte Ouvrière le même type d’affirmations. Ce que Le Prolétaire, se croyant fidèle à la tradition de la Gauche communiste italienne, refuse d’admettre, c’est que toute forme syndicale, qu’elle soit petite ou grande, légale et bien introduite dans les hautes sphères de l’État capitaliste ou bien illégale (c’était le cas de Solidarnosc pendant plusieurs années en Pologne, des Commissions Ouvrières en Espagne sous le régime franquiste) ne peut être autre chose qu’un organe de défense du capitalisme […] C’est justement la leçon que le bordiguisme n’a jamais voulu tirer après des décennies de”trahison” de tous les syndicats, quelle que soit leur forme, leurs objectifs initiaux, les positions politiques de leurs fondateurs, qu’ils se disent “réformistes” ou bien “de lutte de classe”, voire “révolutionnaires””. (12)
Quelles leçons face aux syndicats et au syndicalisme ?
Les contradictions du PCI ne sont pas nouvelles et l’empêchent encore aujourd’hui de tirer les véritables leçons des luttes. Alors que tout un combat a été mené par la classe ouvrière contre l’encadrement syndical, notamment au cours des trois grandes vagues de luttes dans les années 1980 et contre ses expressions ou sous-marins radicaux que furent les coordinations, constituant des expériences politiques riches et très importantes comme pièges sophistiqués de la bourgeoisie, le PCI n’a vu que de simples tentatives de nature ouvrières, alors que les coordinations et les syndicats menaient de concert un sabotage en règle contre la lutte. Face au discrédit croissant des syndicats à la fin des années 1980, les coordinations exprimaient, comme celles qui ressurgissent aujourd’hui sous une même appellation, une adaptation des forces bourgeoises d’encadrement contre la lutte ouvrière. Les camarades du PCI voyaient naïvement à l’époque ces structures comme une simple tentative “d’organisation indépendante” des ouvriers. Dans une ancienne polémique (13) avec le CCI sur le sujet, les camarades affirmaient ainsi à propos des coordinations que “la conclusion n’est pas qu’il faut tourner le dos à ces organisations, mais que l’action en leur sein des révolutionnaires est indispensable pour qu’elles ne “manquent pas leur but”, pour qu’elles servent de “levier” à la lutte d’émancipation, de “courroie de transmission” du parti de classe”. Or, loin d’avoir été “un levier à la lutte”, toutes les coordinations (comme à l’époque également les “Cobas” en Italie) n’ont été en réalité que des instruments radicaux aux mains de la réaction pour saboter les expressions ouvrières en les étouffant dans la logique syndicale de l’enfermement et du corporatisme. Le CCI a toujours été dans le sens de le mettre en évidence et de les dénoncer pour permettre que puisse se développer une lutte consciente et une prise en main réelle du combat par les ouvriers à l’époque. La cécité du PCI sur le problème a pour racine son approche de la question syndicale, avec l’illusion que les syndicats, autant que tout autre type de structures “intermédiaires” et “permanentes” pourraient être “indépendantes”, pourraient échapper à la logique de l’intégration et de l’institutionnalisation propres au capitalisme d’État dans la phase de décadence du capitalisme. Le PCI se retrouve de ce fait en deçà de certaines avancées de la Troisième internationale (IC), puisqu’il nie la réalité de la décadence du capitalisme alors que dans son Premier congrès, l’IC, même si de manière encore insuffisamment fondée, intégrait en substance cette notion politique : “une nouvelle époque est née. Époque de désagrégation du capitalisme, de son effondrement intérieur. Époque de la Révolution communiste du prolétariat”. (14) Le fait pour l’IC que les “contradictions du système mondial” se soient exprimées en “une formidable explosion” soulignait que le capitalisme était désormais entré dans “l’ère des guerres et des révolutions”. Cela se retrouvait dans l’idée que “l’État national, après avoir donné une impulsion vigoureuse au développement capitaliste, est devenu trop étroit pour l’expansion des forces productives”. (15) Pour les camarades du PCI, qui ignorent cette phase de déclin capitaliste, aucune implication ne pouvait donc logiquement être déduite puisque pour eux le capitalisme ne perdure qu’au rythme de simples “crises cycliques”. De ce fait, il est impossible pour le PCI de comprendre que malgré le fait que la question syndicale n’était par encore réellement tranchée, l’IC ne pouvant être en mesure de tirer toutes les implications de la décadence, ses expressions les plus claires liées à l’expérience de la Gauche allemande pouvaient souligner déjà que les syndicats étaient devenus des organes périmés et contre la classe ouvrière. Bien que la question était en débat, elle était un acquis pour les révolutionnaires les plus conscients. Malgré tout un effort de clarification qui perdurera après la guerre, repris par Bilan et la Gauche communiste en France, puis par le CCI, ces leçons ne seront pas prises en compte par le PCI qui, finalement, sur cette question comme pour bien d’autres, se retrouvera embourbé dans les ornières de l’opportunisme, à l’image de l’IC par la suite, notamment lors de son IVe congrès, dont le PCI se revendique également, et qui marquait à l’époque une très forte régression politique, comme on peut le constater dans ces lignes que ne saurait renier le PCI “les communistes doivent, à l’intérieur des syndicats de toutes tendances, s’efforcer de coordonner leur action dans la lutte pratique contre le réformisme…” (16) Tout cela, en lien avec l’optique d’une Internationale Syndicale Rouge. Le PCI restera de manière acritique prisonnier de cette logique régressive de l’IC. Pour le PCI : “Le parti […] affirme la nécessité qu’existe entre lui et la classe des organisations de lutte immédiate comprenant en leur sein un réseau émanant du parti, non seulement dans la période révolutionnaire mais dans toutes les phases qui voient un accroissement de son influence sur la classe”. (17) De même, le PCI pense que “dans les périodes défavorables le parti a la tâche de prévoir et d’encourager la formation de ces organisations de lutte immédiate, qui pourront à l’avenir revêtir les formes les plus variées et les plus nouvelles”. Pour le CCI, à l’inverse, voir la nécessité et la possibilité d’un combat dans les syndicats empêche le prolétariat de développer son combat et de pouvoir mesurer les pas en avant que ce dernier, malgré un recul de ses luttes suite à l’effondrement du bloc de l’est, à pu effectuer depuis mai 1968 (et même depuis la vague révolutionnaire les années 1920) et tout dernièrement. Bien sûr, les camarades du PCI rappellent la nécessité de défendre un ensemble de principes, des méthodes de luttes propres à la classe, dont celle liée à défendre “l’autonomie de classe du prolétariat”. Mais c’est justement à ce niveau que les failles du PCI et ses inconséquences sur la question syndicale sont les plus préjudiciables et finissent en fin de compte par entretenir de très graves confusions dans la mesure où le clivage entre syndicats et classe n’est pas clairement établi. De même, si les méthodes de lutte invoquées peuvent en soi être validées à première vue, le PCI ne perçoit pas la réalité concrète de l’action des gauchistes et des syndicalistes “radicaux” et finit par tout mettre sur le même plan sans pouvoir clairement s’en démarquer de manière tranchante. Il ne peut pas voir par exemple que la question de poser les conditions politiques pour faire émerger dans le futur de véritables AG souveraines est central et déterminant pour une véritable prise en main de la lutte, qu’il s’agit d’un élément fondamental pour des décisions permettant l’extension mais aussi la prise de conscience dans un mouvement qui doit s’opérer face aux ennemis que sont les syndicats. Une démarche aux antipodes des pratiques des AG-interpro de cet hiver où FO, la CGT et consorts, les gauchistes de tous poils nageaient comme des poissons dans l’eau du fait d’une absence de vie politique dans ces assemblées. Pour le CCI, il est nécessaire d’en tirer les leçons et de voir comment procède la réalité de la lutte de classe, en particulier sur le plan de sa conscience et de son autonomie dans la lutte.
Dans un prochain article, nous reviendrons sur la question de la lutte de classe et sur la façon justement de défendre “l’autonomie de classe”, ce que cela peut signifier pour tenter d’aller davantage aux racines de nos divergences sur le sujet.
WH, 20 octobre 2020
1Le Prolétaire n° 534 (septembre – octobre 2019).
2Tract du PCI (30 novembre 2019).
3Le Prolétaire, n° 535, (décembre 2019 – janvier 2020).
4Idem.
5Tract du PCI (14 janvier 2020).
6Le Prolétaire, n° 535, (décembre 2019 – janvier 2020).
7“L’opportunisme est une sorte de “maladie” qui existe dans le camp prolétarien révolutionnaire et qui peut s’avérer mortelle. En tant que manifestation de la pénétration de l’idéologie bourgeoise dans les organisations prolétariennes, l’opportunisme s’exprime notamment par :
– un rejet ou une occultation des principes révolutionnaires et du cadre général des analyses marxistes ;
– un manque de fermeté dans la défense de ces principes ;
– du centrisme en tant que forme particulière de l’opportunisme caractérisée par :
. une phobie à l’égard des positions franches, tranchantes, intransigeantes, allant jusqu’au bout de leurs implications ;
. l’adoption systématique de positions médianes entre les positions antagoniques ;
. un goût de la conciliation entre ces positions ;
. la recherche d’un rôle d’arbitre entre celles-ci ;
. la recherche de l’unité de l’organisation à tout prix y compris celui de la confusion, des concessions sur les principes, du manque de rigueur, de cohérence et de continuité dans les analyses”. (“L’opportunisme et le centrisme dans la période de décadence”, Revue internationale n° 44 – 1er trimestre 1986).
8Le Prolétaire, n° 536 (février – mars – avril 2020).
9Tract du PCI (5 janvier 2020).
10Selon la conception du PCI, il s’agit de syndicats “communistes”, “révolutionnaires”, perçus comme des “courroies de transmission” du Parti.
11Le Prolétaire n° 536 (février – mars – avril 2020).
12Voir “L’opportunisme du PCI sur la question syndicale conduit à sous-estimer l’ennemi de classe”, Revue internationale n° 86 (1996).
13Le Prolétaire n° 401 (mai – juin 1989).
14Plate-forme de l’IC (Premier congrès)
15Manifeste de l’IC aux prolétaires du monde entier (Premier congrès)
16Thèses sur l’action communiste dans le mouvement syndical au point 19 (quatrième congrès).
17Cf. “Ce qui nous distingue” (pcint.org)
Courants politiques:
- Gauche Communiste [163]
Questions théoriques:
- Syndicalisme [183]
Rubrique:
L’expérience des conseils ouvriers en 1917: Les combats du passé nous arment pour l’avenir
- 71 lectures
En dépit des difficultés liées à la pandémie, de la situation profondément dégradée par la crise du capitalisme qui vient obscurcir le futur, il existe une alternative, une issue vers une autre société, sans exploitation, ni misère sociale : la société communiste. Contrairement aux mensonges de la bourgeoisie qui depuis des décennies a voulu nous faire croire que la classe ouvrière s’était évaporée suite à l’effondrement du bloc de l’Est.
Le prolétariat, comme l’a révélé la crise sanitaire, n’a nullement disparu ! C’est ce qu’est obligé de reconnaître la bourgeoisie face aux exploités qu’elle expose sans scrupule au virus pour assurer la continuité de la production : les infirmiers, médecins ou personnels d’entretien dans les hôpitaux, les ouvriers d’usine comme les employés du commerce ou de bureau, toutes les “petites mains” sont sur le “front”, sacrifiés sur l’autel de l’économie nationale et donc du profit, quand elles ne sont pas jetées dans les queues des demandeurs d’emplois. Face à toute la propagande bourgeoisie et à l’impasse dans laquelle elle nous entraîne, nous devons nous appuyer sur l’expérience du mouvement ouvrier et de nouveau regarder vers le futur, sortir de la prison de l’immédiat. Non seulement, il est indispensable de tirer les leçons des combats du passé pour préparer ceux de l’avenir, mais ces expériences démontrent aussi que la classe ouvrière est bien la seule classe en mesure de renverser le capitalisme, qu’elle porte en elle un futur pour l’humanité.
Dans ce cadre, l’extrait de l’ouvrage de David Mandel, Les Soviets de Petrograd, que nous publions ci-dessous, fait apparaître clairement deux choses essentielles que nous voulons souligner ici :
- contrairement au mensonge selon lequel la prise du pouvoir en Russie, notamment à Petrograd, ne serait qu’un vulgaire “coup d’État” sanguinaire de Lénine (transformé par le bourrage de crâne de la classe dominante en dictateur tyrannique) et sa “clique”, nous voyons au contraire la détermination et de l’implication politique de la classe ouvrière, pleinement actrice de l’histoire.
- En lisant les résolutions rédigées au cœur des usines par les ouvriers eux-mêmes, on ne peut que constater leur intransigeance et leur esprit de combat, notamment contre les faux amis de gauche. Le haut niveau de conscience révolutionnaire des masses au sein des comités ouvriers (soviet), vastes assemblées et organes du pouvoir prolétarien, est palpable.
En publiant les extraits ci-dessous émaillés de résolutions, nous souhaitons porter l’attention sur l’expérience extraordinaire que fut la vague révolutionnaire mondiale du siècle dernier, notamment au sein du foyer ardent que fut “Pétrograd la Rouge”. Cette expérience reste pour tous les révolutionnaires et le prolétariat une expérience majeure donnant tout son sens à son combat de classe.
“À l’inverse de l’intelligentsia, la majorité des ouvriers de Petrograd ont accueilli l’insurrection avec enthousiasme. Des résolutions d’appui ont été adoptées par les usines de tous les types et dans toutes les couches ouvrières, des métallurgistes de l’arrondissement de Vyborg aux ouvriers du textile de l’arrondissement Nevski, et par presque tous les ouvriers de l’imprimerie. La résolution suivante, adoptée à l’unanimité, est typique de la position des métallurgistes :
“Nous, les ouvriers de l’usine Rozenkrantz au nombre de 4 000, envoyons nos salutations au Comité militaire révolutionnaire du soviet des députés et des soldats de Petrograd et au Congrès pan-russe des Soviets, qui a pris le chemin de la lutte, et non de l’accommodement, avec la bourgeoisie – ces ennemis des ouvriers, des soldats et des paysans les plus pauvres –, et pour cela nous déclarons : camarades, continuez sur ce chemin, aussi dur que cela puisse être. Sur cette voie, nous mourrons ensemble avec vous ou nous sortirons vainqueurs”.
Plus intéressant, toutefois, des résolutions semblables ont été adoptées par les ouvriers des entreprises d’État qui avaient longtemps été des fiefs défensistes. À l’usine de tuyaux Promet, dont la main-d’œuvre était essentiellement féminine, les élections du 17 octobre au soviet de Petrograd avaient apporté 963 voix aux bolcheviks, 309 aux mencheviks et 326 aux SR [socialistes révolutionnaires]. Mais le 27 octobre, l’assemblée générale de l’équipe de jour de la même usine adopta la résolution suivante à l’unanimité (avec 18 abstentions) :
“Nous, ouvriers de l’usine Promet […] comptant 1230 personnes, après avoir entendu le rapport du camarade Krolikov sur le second congrès pan-russe (des Soviets) des députés des ouvriers et des soldats et sur la formation d’un nouveau gouvernement socialiste du peuple, adressons à celui-ci nos salutations, lui exprimons notre confiance pleine et entière, et l’assurons de notre soutien sans faille dans sa difficile mission pour accomplir le mandat du congrès.
Nous protestons contre la formation des SD-mencheviques et les SR défensistes du comité national de salut (le considérant) comme un obstacle à la mise en place des mesures que les larges masses d’ouvriers, de soldats et de paysans attendent avec une impatience croissante”.
Les ouvriers de chemin de fer eux aussi des partisans de longue date des SR, ont répondu de façon semblable, de même que les ouvriers (principalement des femmes) des fabriques textiles, de l’alimentation et des usines de caoutchouc.
Encore plus parlant, chez les ouvriers de l’imprimerie, la base s’opposait aux positions de l’exécutif du syndicat. La résolution d’une assemblée commune des imprimeries Orbit et Rabotchaïa Pechat du 28 octobre déclarait :
“Nous, ouvriers de ces imprimeries, ayant entendu le rapport du camarade Venediktov sur la réunion des délégués du 27 octobre au cours de laquelle, a-t-il dit, l’exécutif avait mal informé les imprimeurs participant à la réunion (des délégués) qui s’est tenue et où, en raison de la représentation incomplète, une résolution vile, proposée par un certain Rubin, a été adoptée de façon erronée, (et) qui blâmait le Comité révolutionnaire pour avoir prétendument interdit la presse socialiste”.
Après discussion sur le rapport, la résolution suivante a été adoptée :
“Nous, les ouvriers des imprimeries indiquées, protestons contre les actions de l’exécutif de notre syndicat qui a mal infirmé les ouvriers et la réunion des délégués à venir, et pour cette raison, nous certains établissements d’imprimerie de l’arrondissement Petrogradski, n’étant pas au fait de la réunion, n’avons pas pu y participer, et par conséquent, nous n’assumons pas de responsabilité pour la décision du conseil des délégués. De plus, ayant entendu la résolution adoptée à la réunion des délégués et (qui a été) imprimée dans le journal Delo naroda du 28 octobre, nous déclarons qu’elle nous met profondément en colère et nous la considérons comme indigne d’ouvriers-imprimeurs et nous protestons contre elle dans les termes les plus véhéments. Nous déclarons que le genre de conseil de délégués qui adopte de telles résolutions ne peut pas exprimer notre volonté, mais seulement la volonté des assassins bourgeois du peuple. Par conséquent, nous exprimons notre complet manque de confiance envers l’exécutif du syndicat, qui a délibérément mal annoncé la réunion, de même qu’envers les délégués du conseil pour cette résolution, et, nous adressant aux prolétaires de Petrograd, nous déclarons que nous marchons avec eux et non avec ceux du genre de cet exécutif et de ce conseil de délégués.
Vive le soviet des députés des ouvriers et des soldats !
Vive le peuple révolutionnaire !
À bas les traîtres à la classe ouvrière, comme les Rubin et consorts !”
Un incident révélateur s’est produit dans l’entreprise où le journal menchevique-internationaliste Novaïa Zhizn était imprimé. L’édition du 29 octobre du journal publia une plainte des rédacteurs contre les typographes, car ces derniers avaient refusé d’imprimer un certain nombre de documents, parmi lesquels les ordres de Kerenski, l’appel du général Krasnov aux cosaques et un rapport de la Douma municipale. Les mencheviks-internationalistes avaient adopté une position de neutralité dans la guerre civile naissante, mais les rédacteurs du journal étaient absents quand les typographes, avec l’appui du commissaire de l’arrondissement qu’ils avaient convoqué, s’étaient opposés aux techniciens, qui pour leur part exigeaient l’impression des documents. Le lendemain, les ouvriers se réunirent en assemblée générale et décidèrent de condamner la majorité de l’exécutif du syndicat des imprimeurs, qu’ils accusaient d’avoir propagé parmi les imprimeurs de la ville de fausses informations sur les activités du Comité militaire révolutionnaire, et d’appeler à saboter la décision du”gouvernement révolutionnaire des ouvriers et des paysans portant sur l’interdiction d’imprimer des appels de type pogrom, et de diffuser de fausses informations qui provoquent la panique et, par conséquent, des effusions de sang.
“Nous jugeons scandaleuse cette activité criminelle d’une partie de notre “exécutif”, qui entraîne la division dans nos rangs prolétariens et ne servira qu’à nos ennemis de classe. Nous déclarons haut et fort que nous soutiendrons de toutes nos forces le gouvernement révolutionnaire des ouvriers et paysans qui nous guidera vers la paix et l’Assemblée constituante.
En un temps où le peuple détruit les racines pourries du système capitaliste et donne le pouvoir à ses véritables représentants, nous, imprimeurs, nous ne pouvons pas voir notre labeur servir à imprimer les ordres de Kerenski, qui a été renversé par le peuple, et, par conséquent, nous estimons justifiées les actions de nos camarades typographes. Et, si à l’avenir, notre aide est requise par le Comité militaire révolutionnaire, nous serons toujours prêts à la lui accorder”.
Une seule personne vota contre la résolution et cinq s’abstinrent. Le mécontentement envers la majorité défensiste de l’exécutif syndical conduisit rapidement à une majorité menchevique-internationaliste dans cet exécutif, puis, pour une courte période, à la majorité bolchevique.
Après la révolution d’Octobre, les mencheviks et les SR, et ensuite de nombreux historiens occidentaux, ont souligné qu’en octobre, contrairement à février, les masses n’étaient pas dans les rues. Cela fut cité comme preuve que la révolution n’était pas une révolution populaire mais un coup d’État militaire et sans légitimité populaire. “Regardez dans les rues” écrivait le journal menchevique-defensiste Rabotchaia gazeta. “Dans les arrondissements ouvriers elles sont vides. On ne voit pas les marches triomphales, pas de drapeaux rouges se portant à la rencontre des vainqueurs… les bolcheviks tiendront à peine une semaine”. (1) Le socialiste-populaire Melgounov, historien et populiste de droite, fait de même observer que les usines ont continué à travailler le 25 octobre […].
Mais la comparaison avec la révolution de Février ignore délibérément les circonstances très différentes des événements d’Octobre. La révolution de Février était un mouvement spontané, qui a vu des masses d’ouvriers désarmés se jeter contre le régime, lequel avait d’importantes forces de répression à sa disposition. Les grèves et les manifestations des ouvriers y ont joué un rôle décisif, mais celui d’une force morale qui a permis aux ouvriers de faire basculer les soldats de leur côté. Les grèves de masse et les manifestations de rues ont créé un climat qui a permis aux soldats de comprendre que leur participation au mouvement pouvait aboutir au renversement du régime et non pas s’achever devant un tribunal militaire et par leur exécution. Les batailles de rue auxquelles les ouvriers ont participé ont eu lieu pour la plupart pendant les deux derniers jours de la révolution et leur principal objectif était de désarmer la police. En octobre, au contraire, les principales forces armées avaient été gagnées avant l’insurrection ; la tâche des insurgés était d’occuper les immeubles stratégiques et de désarmer les derniers soutiens de l’ancien régime. Des actions de masse n’étaient donc pas nécessaires.
Mais plus spécifiquement, après huit mois de déceptions et de frustrations, et gardant à l’esprit la catastrophe économique toujours plus rapprochée et la menace militaire qui pesait, doit-on s’étonner que les ouvriers ne forment pas de processions triomphales dans les rues ? Ils étaient bien conscients que les chances de réussir n’étaient pas élevées. La révolution d’octobre a bel et bien soulevé les espoirs des ouvriers ; sinon ils ne l’auraient pas appuyée. Mais en même temps, il s’agissait d’un acte désespéré pour sauver la révolution de février et de la menace d’une contre-révolution. (2)
Enfin, ceux qui insistent sur l’absence de participation de masse à la révolution d’Octobre, dans le but de lui dénier toute légitimité populaire, négligent le fait que les dirigeants de l’insurrection ne voulaient pas que les masses descendent dans la rue. Trotsky a écrit qu’après l’exprience traumatisante de juillet, les dirigeants craignaient toute effusion de sang inutile, qui aurait pu démoraliser les ouvriers. Et en réalité, les bolcheviks ont déployé beaucoup d’efforts pour persuader les ouvriers de rester au travail pendant l’insurrection. Un appel aux ouvriers signé conjointement par le Soviet de Petrograd, le Conseil des syndicats de Petrograd et le Soviet central des comités d’usine fut publié en caractères gras à la Une de la Pravda du 27 octobre :
“Les grèves et les manifestations des masses ouvrières dans Petrograd ne font que porter préjudice. Nous vous demandons de mettre immédiatement un terme à toutes les grèves économiques et politiques. Tout le monde devrait être au travail et produire en bon ordre. Le nouveau gouvernement des soviets a besoin du travail des usines et de toutes les entreprises, car toute interruption du travail crée de nouvelles difficultés, et nous en avons déjà assez comme ça. Tout le monde à son poste ! En ces jours, la meilleure façon de soutenir le nouveau gouvernement des soviets est de faire son travail. Vive la ferme retenue du prolétariat !”
[…] Certains auteurs soulignent l’absence de férocité et la présence même d’une certaine douceur ou d’amabilité de la part des Gardes rouges ouvriers vis-à-vis de leurs adversaires. Cela, disent-ils, indique que le soutien au soulèvement, même parmi les participants les plus actifs, était timoré. Cette modération était en réalité une caractéristique plutôt remarquable des ouvriers qui ont pris part à l’insurrection. Un officier de l’armée, qui participa à la défense du Palais d’Hiver, a laissé ce compte rendu de la “prise d’assaut” :
“Des petits groupes de Gardes rouges ont commencé à pénétrer dans le Palais d’Hiver (pour faire de la propagande parmi ses défenseurs). Tant que les groupes de Gardes rouges n’étaient pas nombreux, nous les désarmions et cela se faisait de façon amicale sans aucun heurt. Cependant, les Gardes rouges étaient de plus en plus nombreux. Les marins et les soldats du régiment Pavlov ont fait leur apparition. Le désarmement a commencé en sens inverse. – celui des junkers, et de nouveau cela se passa plutôt de façon pacifique. (Quand le véritable assaut a commencé) des masses de Gardes rouges, de marins, de Pavolvtsky, etc. ont pénétré dans le Palais d’Hiver. Ils ne voulaient pas d’effusion de sang. Nous étions forcés de nous rendre”.
Skorinko, le jeune Garde rouge de l’usine Poutilov, se souvient du traitement clément que les Gardes rouges réservaient aux prisonniers blancs qu’ils avaient capturés durant les combats qui avaient eu lieu à l’extérieur de Petrograd à la fin du mois d’octobre : “Les exécutions nous étaient une chose étrangère. Nous considérions avec dégoût les soldats qui en réclamaient. Plus tard, les ouvriers et les paysans allaient en payer le prix de leur sang. Le général Krasnov, qui avait été relâché après avoir donné sa parole d’honneur, s’enfuit rejoindre le Don et récompensa notre noblesse de la manière qui convient à un général : il organisa une armée blanche”.
[…] Dans leurs discours du 25 octobre, Lénine et Trotsky ont tous les deux souligné qu’il n’y avait “pas eu la moindre effusion de sang” pendant l’insurrection. I.P. Flerovski, un marin bolchevique du navire de guerre Aurora, se souvient comment, le jour fatidique du 25 octobre, l’équipage”décida d’attendre encore un quart d’heure avant de faire feu sur le Palais d’Hiver, sentant par instinct la possibilité d’un changement de circonstances”. Trotsky commenta ce fait : “par “instinct”, on doit entendre l’espoir obstiné que l’affaire puisse être réglée uniquement par des moyens démonstratifs”. […]
La sauvagerie et la terreur de la guerre civile restaient encore à venir. Malgré la profonde polarisation sociale, l’attitude des ouvriers au niveau personnel était souvent étonnamment tolérante…”
(Extraits du livre de David Mandel, Les Soviets de Petrograd, éd. Syllepse)
1Rabotchaia Gazeta du 27 octobre 1917.
2En fait, contrairement à l’auteur, nous pensons qu’il ne s’agissait nullement “d’un acte désespéré”, mais bien le produit d’une maturation de la conscience au sein du prolétariat et de l’évolution des conditions objectives de la révolution depuis février qui rendaient possibles la prise du pouvoir de la classe ouvrière (note de la rédaction).
Histoire du mouvement ouvrier:
- Révolution Russe [217]
Rubrique:
ICCOnline - février 2021
- 52 lectures
Courrier de lecteur (partie 1): Pourquoi le CCI a-t-il abandonné le concept de "cours historique"?
- 142 lectures
Nous publions ci-dessous de larges extraits du courrier d’un de nos lecteurs, suivi de notre réponse. Ce courrier critique notre “Rapport sur la question du cours historique”, adopté au 23e Congrès du CCI et publié dans la Revue internationale n° 164. Le camarade aborde également une autre question : celle de la perspective, toujours possible, d’une guerre nucléaire généralisée. Nous répondrons sur ce dernier aspect ultérieurement, dans une deuxième partie.
“Mes lectures multiples du rapport sur le cours historique paru dans la Revue Internationale numéro 164 me laissent très perplexe et dubitatif. J’ai beaucoup de mal à me faire une opinion précise et définitive sur ce texte. Plutôt que prendre position je préfère vous faire part de remarques un peu décousues et disparates. J’espère que ces remarques permettront de faire avancer le débat éventuellement dans un courrier des lecteurs du journal.
La première remarque consiste en un certain étonnement quant à l’apparition maintenant de cette remise en cause. En effet, le CCI même s’il se défend de toute invariance à la “bordiguiste”, ne pratique jamais un changement à 180° de cette façon. Je n’ai pas d’autre exemple de la remise en cause d’une position “pilier” de cette importance depuis 45 ans (date de la création du CCI). Éclairez-moi s’il y a eu un ou des précédents ? […]
La deuxième porte sur le moment où apparaît cette “révolution” historique, c’est-à-dire 30 ans après l’effondrement de l’URSS et de son bloc impérialiste. Quel événement interne ou externe au CCI a provoqué ces derniers mois cette remise en cause d’un de ses piliers programmatique ? 30 ans après 1989. Le seul événement “interne” était la nécessité de faire le bilan des 40 ans CCI et de revoir une analyse qui n’était plus adaptée Je me souviens de multiples discussions dans des réunions publiques ces 30 dernières années où cette affirmation du cours historique contre des questionnements de sympathisants sur l’état de la classe ouvrière était un argument décisif dans l’argumentation.
Troisième remarque : le distinguo entre cours historique et rapport de force entre les classes m’apparaît difficile à saisir et ne me convainc pas. Une première compréhension de ma part de ce texte est le caractère évolutif dans un seul sens contenu dans l’expression cours historique opposé à une perception du rapport de force entre les classes comme une situation bloquée, indécise et finalement aléatoire quant à son évolution.
pour illustrer ma position, je reprendrai l’expression d’Albert Einstein dans ses critiques des postulats de la mécanique quantique : “Dieu ne joue pas aux dés”. Finalement la notion de cours historique est plus pertinente pour moi car dans le rapport de force entre les classes “mesuré” à un moment, il y a une tendance de fond, un mouvement (qui peut s’inverser) qui est continuellement à l’œuvre et qui ira jusqu’à son aboutissement. Pour conclure cette remarque, j’ai l’impression d’une évolution “pessimiste” de l’appréciation du cours historique par le CCI tout au long de ces 50 dernières années. On est passé d’un cours à la “révolution” dans les années 70 et 80, puis par un cours “aux affrontements de classe” des années 90 et 2000 pour finir par une perception actuelle d’un cours vers une défaite annoncée du prolétariat.
Dernière remarque que je vais développer davantage car mes idées sont plus claires et cela concerne un argument avancé par le CCI pour justifier son abandon d’un cours historique à l’œuvre. Cet argument c’est l’inexistence actuelle de blocs militaires et l’absence de mouvement de rapprochement de différents pays en vue de la constitution de tels blocs. Contrairement aux alliances précédent la Première Guerre mondiale entre la France, le Royaume-Uni, et la Russie d’un côté, l’Allemagne, l’Autriche-Hongrie, et la Turquie de l’autre ou bien aux alliances précédent la Seconde entre la France, le Royaume-Uni et la Pologne cette fois et l’Allemagne, l’Italie et l’URSS (pacte Molotov-Ribbentrop !) en face ; il n’y a pas eu depuis l’effondrement de l’URSS des alliances de ce type. Outre la question des armements nucléaires à longue portée, il y a en ce moment un pays qui n’a pas besoin d’avoir constitué un bloc uni et parfaitement tenu et soutenu pour se lancer dans une guerre qui, si elle n’est pas mondiale, ne sera pas cantonné à un théâtre d’opération limité dans le temps et dans l’espace (comme par exemple les deux guerres contre Saddam Hussein). Ce pays c’est bien sûr les États-Unis qui ont la puissance économique, la suprématie militaire et les bases néanmoins pour une intervention partout dans le monde. Pour qu’une guerre avec des batailles dans différents endroits de la planète, qui se produisent simultanément et qui s’étalent sur une période assez longue (plusieurs années) se produise il suffit qu’une autre puissance qui elle constitue des états vassalisés par le commerce extérieur et les investissements économiques, se dote de bases militaires à l’étranger dans ces états vassaux, commence à construire des porte-avions et généralement une marine de guerre efficace et nombreuse pour qu’à un certain moment le risque de conflit généralisé devienne une probabilité non négligeable. Ce pays existe déjà, c’est la Chine qui risque grâce à l’épidémie de Covid-19 de bientôt dépasser les États-Unis au niveau économique mondial. La possibilité d’un “dérapage” dans les années à venir sur la question de Taïwan, dégénérant en un affrontement généralisé entre ces deux pays dans différents endroits obligeant d’autres états à se positionner et donc prendre parti pour l’un ou l’autre (par exemple France, Royaume-Uni et Allemagne pour les États-Unis dans le cadre de l’OTAN et Russie pour la Chine) est une possibilité qui n’est pas du tout farfelue. Des batailles dans les pays de l’Est, des bombardements dans l’Europe de l’Ouest pourraient découler de cette situation. Je pense que la question de la guerre n’est pas du tout évacuée par la théorie de la décomposition qui remplace la théorie du cours historique.
Pour conclure sur cette dernière remarque, le hasard a fait que j’ai lu récemment deux articles dans la presse qui apportent de l’eau à mon moulin. Dans l’Obs, dans un petit article sur l’évolution de l’économie mondiale il est remarqué que la puissance qui a été à l’origine de cette pandémie est la seule paradoxalement qui verra une croissance positive en 2020. L’article se termine ainsi : “Quand la crise sera terminée, il faudra faire un nouvel état des lieux des forces en présence. Mais d’ores et déjà, on peut annoncer que la Chine se rapproche dangereusement des États-Unis.” Dans le Canard Enchaîné sont rapportés les propos du responsable des armes nucléaires des États-Unis Charles Richard : “il est temps que les États-Unis révisent et mettent à jour leur doctrine nucléaire, car la nation n’a pas pris au assez sérieux, jusqu’à présent, la possibilité qu’elle puisse être engagée à l’occasion d’une compétition armée direct face à des adversaires dotés de l’armement nucléaire. Durant 30 ans le Pentagone a considéré qu’il n’existait pas de menaces. Ce discours post-guerre froide est terminé. Nous devons assumer la perspective qu’une guerre nucléaire puisse un jour avoir lieu. Nos adversaires ont profité de cette période pour dissimuler leur comportement agressif, accroître leur potentiel militaire et reconsidérer leurs tactiques et stratégies. Nous ne pouvons plu attendre de nos adversaires qu’ils respectent les contraintes que chacun s’imposait jusqu’à maintenant selon que la guerre pourrait être conventionnelle ou nucléaire qui ont désormais une conception de la dissuasion différente de la nôtre”
J’espère que ces quelques remarques pourront être utiles dans le développement de la discussion sur la question essentielle de l’abandon de la notion de cours historique par le CCI.
D.
Notre réponse
Tout d’abord, nous tenons à vivement saluer l’effort du camarade D. et la réflexion qu’il a menée sur la notion de “cours historique”, permettant d’alimenter et enrichir le débat.
Le camarade se pose, en premier lieu, la question suivante : comment se fait-il que le concept de “cours historique” qui a toujours été un des “piliers” de l’analyse du CCI depuis sa fondation soit aujourd’hui remis en cause et abandonné dans le “Rapport que la question du cours historique” de notre 23e Congrès ? Le camarade nous demande également : le CCI a-t-il abandonné ou rectifié d’autres positions ?
À la première question, nous devons renvoyer le camarade à ce qu’affirme très explicitement l’article de la Revue internationale : “En effectuant le changement nécessaire de notre analyse, nous avons repris la méthode de Marx et du mouvement marxiste, depuis sa création, consistant à changer de position, d’analyse, et même de programme complet, dès lors qu’ils ne correspondaient plus à la marche de l’histoire, et cela pour être fidèles au but même du marxisme comme théorie révolutionnaire. Un exemple célèbre est celui des modifications importantes que Marx et Engels ont apportées successivement au Manifeste communiste lui-même, résumées dans les préfaces ultérieures qu’ils ont ajoutées à cette œuvre fondamentale, à la lumière des changements historiques intervenus. Les générations suivantes de marxistes révolutionnaires ont adopté la même méthode critique : “Le marxisme est une vision révolutionnaire du monde qui doit appeler à lutter sans cesse pour acquérir des connaissances nouvelles, qui n’abhorre rien tant que les formes figées et définitives et qui éprouve sa force vivante dans le cliquetis d’armes de l’autocritique et sous les coups de tonnerre de l’histoire” (“Critique des critiques”, 1916, Rosa Luxemburg).
L’insistance de Rosa, à cette époque, sur la nécessité de reconsidérer les analyses antérieures afin d’être fidèle à la nature et à la méthode du marxisme, en tant que théorie révolutionnaire, était directement liée à la signification changeante de la Première Guerre mondiale. La guerre de 1914-1918 a marqué le tournant du capitalisme en tant que mode de production, de sa période d’ascension ou de progrès à une période de décadence et d’effondrement, laquelle a fondamentalement changé les conditions et le programme du mouvement ouvrier. Mais seule la gauche de la 2e Internationale commença à reconnaître que la période précédente était définitivement révolue et que le prolétariat entrait dans l’“époque des guerres et des révolutions”.
C’est donc en adoptant la même démarche que celle du mouvement ouvrier du passé que nous avons été amenés à remettre en question le concept de “cours historique”. Un concept que nous estimons dépassé depuis l’effondrement du bloc de l’Est en 1989, ouvrant une nouvelle phase au sein de la période historique de la décadence du capitalisme, sa phase ultime : celle de la décomposition, phase ultime de la décadence du capitalisme. De même que l’entrée du capitalisme dans sa période de décadence avaient rendu obsolètes les luttes de libération nationale, défendues par les marxistes au XIXe siècle, l’analyse du “cours historique” permettant de comprendre dans quel sens évolue la société, est devenue caduque. L’alternative historique n’est plus aujourd’hui “Guerre mondiale ou révolution prolétarienne” (comme c’était le cas dans le passé) mais “Destruction de l’humanité dans un chaos généralisé ou révolution prolétarienne”.
Le “cours historique” et le rapport de force entre les classes au XXe siècle
Notre article de la Revue internationale n° 164 explique de façon très approfondie la différence entre le concept de “cours historique” et celui de “rapport de force entre les classes”. Nous avions commis l’erreur d’identifier dans le passé ces deux notions alors qu’il s’agit de deux concepts distincts. Au XIXe siècle, dans la période ascendante du capitalisme, le concept de “cours historique” n’avait pas été utilisé par les révolutionnaires car nous n’étions pas encore entrés dans “l’ère des guerres et des révolutions” (comme le disait l’Internationale communiste en 1919). Ni l’échec de la révolution de 1848, ni l’écrasement de la Commune de Paris en 1871, n’avaient débouché sur une guerre impérialiste, bien que le rapport de force entre la bourgeoisie et le prolétariat ait été inversé en faveur de la classe dominante.
Avec l’entrée du capitalisme dans sa période de décadence, la question du “cours historique” est adoptée par les révolutionnaires pour comprendre dans quelle direction générale va la société. En 1914, la défaite idéologique du prolétariat (avec le vote des crédits de guerre par la social-démocratie et la trahison des partis ouvriers) avait permis l’embrigadement de dizaines de millions de prolétaires dans la Première Guerre mondiale. Le rapport de force entre les deux classes fondamentales de la société était en faveur de la bourgeoisie qui avait réussi à envoyer le prolétariat sur les champs de bataille la fleur au fusil. Pour la première fois dans l’Histoire, était posée l’alternative : “socialisme ou barbarie”, “révolution prolétarienne ou destruction de l’humanité dans la Guerre mondiale”. Puis en 1917, avec le triomphe de la Révolution russe et son impact dans d’autres pays (notamment en Allemagne), le rapport de force entre les classes est inversé au profit du prolétariat mettant fin à la Guerre mondiale. Le “cours historique” est pour la première fois, un cours vers la Révolution prolétarienne mondiale, posant la question du renversement du capitalisme, ce qui s’est manifesté par une véritable vague révolutionnaire qui s’est développée à travers le monde entre 1917 et 1923, et encore en 1927 en Chine. Mais avec l’écrasement sanglant de la Révolution en Allemagne et de la contre-révolution stalinienne sous couvert du “socialisme dans un seul pays”, la bourgeoisie a pu reprendre le dessus. Cette défaite physique du prolétariat a été suivie par une profonde défaite idéologique qui avait permis son embrigadement derrière les drapeaux de l’antifascisme et de la défense de la “patrie socialiste”. Le rapport de force entre les classes ayant été inversé en faveur de la bourgeoisie, un nouveau cours historique s’est affirmé dans les années 1930 : la société s’acheminait inexorablement vers une Deuxième Guerre mondiale. La classe dominante avait pu soumettre la classe ouvrière à la chape de plomb d’une longue période de contre-révolution en se donnant tous les moyens pour empêcher le prolétariat de renouveler l’expérience révolutionnaire de 1917-18. Cette période de contre-révolution victorieuse n’avait donc pas permis au prolétariat d’inverser le cours historique en affirmant de nouveau sa perspective révolutionnaire. Une telle situation ne pouvait donc que laisser les mains libres à la bourgeoise pour imposer sa propre réponse à la crise historique de son système : la Guerre mondiale.
C’est seulement après un demi-siècle de contre-révolution que le prolétariat, en reconstituant progressivement ses forces, a pu de nouveau relever la tête : à la fin des années 1960, avec le resurgissement de la crise économique et l’épuisement du “boom” économique des “Trente Glorieuses”, le prolétariat réapparaît de nouveau sur la scène de l’Histoire. La vague de luttes ouvrières qui a secoué le monde, notamment en mai 1968 en France et lors de “l’automne chaud” en Italie en 1969, a révélé que le prolétariat n’était pas disposé à accepter la détérioration de ses conditions de vie. Comme nous l’avons toujours affirmé, un prolétariat qui n’accepte pas les sacrifices imposés par la crise économique n’est pas prêt à accepter le sacrifice ultime de sa vie sur les champs de bataille. Avec l’usure des mystifications bourgeoises qui avaient permis son embrigadement dans la Deuxième Guerre mondiale (celle de l’antifascisme et du stalinisme), la classe ouvrière a repris le dessus à la fin des années 1960. En faisant obstacle au déchaînement d’une nouvelle Guerre mondiale, la reprise internationale des combats de classe avait mis fin à la période de contre-révolution et ouvert un nouveau cours historique : un cours vers des affrontements de classe généralisés remettant à l’ordre du jour la perspective de la révolution prolétarienne.
L’histoire du XXe siècle a donc montré la dynamique du capitalisme et l’évolution de la société en fonction du rapport de force entre les classes. C’est ce rapport de force qui détermine le “cours historique”, c’est-à-dire dans quelle direction se dirige la société face à la crise permanente du capitalisme : soit vers la guerre mondiale, soit vers la révolution prolétarienne.
Bien que le “cours historique” soit tributaire, en dernière instance, du rapport de force entre les classes, ces deux notions ne sont pas identiques. Pour les marxistes, le “cours historique” n’est pas figé. Il est fondamentalement déterminé par la réponse que la bourgeoisie et le prolétariat apportent, à un moment donné, à la crise de l’économie capitaliste. “Nous avons eu tendance, sur la base de ce que la classe ouvrière a connu au cours du XXe siècle, à identifier la notion d’évolution du rapport de force entre les classes entre la bourgeoisie et le prolétariat à la notion de “cours historique”, alors que ce dernier indique un résultat alternatif fondamental, la guerre ou révolution mondiale, une sanction du rapport de force entre les classes. D’une certaine manière, la situation historique actuelle est similaire à celle du XIXe siècle : le rapport de force entre les classes peut évoluer dans une direction ou dans une autre sans affecter de manière décisive la vie de la société”. (1)
L’incompréhension de cette notion de “cours historique” avait d’ailleurs conduit certains révolutionnaires du passé à se fourvoyer dangereusement. Ce fut le cas notamment de Trotsky qui, dans les années 1930 et alors que le prolétariat des pays centraux était embrigadé derrière les drapeaux bourgeois de l’antifascisme et de la défense des “acquis ouvriers” en URSS, n’avait pas compris que la société s’acheminait de façon irrémédiable vers la Guerre mondiale. Trotsky n’avait pas compris que la guerre d’Espagne était le laboratoire de la Deuxième Guerre mondiale. En voyant dans le soulèvement du prolétariat espagnol contre le franquisme une “révolution” se situant dans la continuité de celle d’Octobre 1917 en Russie, Trotsky avait fini par pousser prématurément à la fondation d’une Quatrième Internationale, alors que les conditions historiques étaient marquées par la défaite et que la “tâche de l’heure” était, pour les révolutionnaires, de tirer le bilan et les leçons de l’échec de la révolution russe et de la première vague révolutionnaire.
Pourquoi remettre en cause le concept de “cours historique” aujourd’hui ?
Notre lecteur nous fait la critique suivante : il exprime “un certain étonnement quant à l’apparition maintenant de cette remise en cause. Quel événement interne ou externe au CCI a provoqué ces derniers mois cette remise en cause d’un de ses piliers programmatique, 30 ans après 1989 ? […] Seul événement “interne” était la nécessité de faire le bilan des 40 ans du CCI et de revoir une analyse qui n’était plus adaptée. Je me souviens de multiples discussions dans des réunions publiques ces 30 dernières années où cette affirmation du cours historique contre des questionnements de sympathisants sur l’état de la classe ouvrière était un argument décisif dans l’argumentation”.
La première question à laquelle nous voulons répondre au camarade D. est la suivante : l’effondrement du bloc de l’Est en 1989 est-il un événement d’une portée historique telle qu’il justifie que nous examinions dans quel sens se dirige la société ? Comme nous l’avons mis en évidence dans notre presse, l’effondrement des pays staliniens a mis définitivement un terme au mythe de la “patrie du socialisme”. C’est tout un pan du monde capitalisme qui s’est effondré, non pas grâce à l’action révolutionnaire du prolétariat, mais sous les coups de boutoir de la crise économique mondiale. La disparition du bloc de l’Est avait donc mis fin à la Guerre froide et à l’alternative de la bourgeoise d’une Troisième Guerre mondiale comme seule réponse que la classe dominante puisse apporter à la crise de son système. De ce fait, le bloc de l’Ouest a fini par se disloquer, puisque la menace de l’“Empire du mal” avait disparu. La perspective d’une Troisième Guerre mondiale opposant l’URSS et les États-Unis avait donc elle-même disparue, sans pour autant céder la place à l’alternative de la Révolution prolétarienne. Comment avons-nous expliqué ce “vide” laissé dans le cours de l’Histoire ? Notre analyse était la suivante : ni le prolétariat, ni la bourgeoisie n’ayant été en mesure d’affirmer leur propre réponse à la crise économique à la fin des années 1980, l’alternative historique “Guerre ou Révolution prolétarienne mondiale” a été “bloquée”. Si le capitalisme est entré dans sa phase de décomposition, c’est parce que la classe ouvrière n’a pas été en mesure de passer à l’offensive, de politiser ses combats pour les hisser à la hauteur de la gravité des enjeux de la situation historique. La dynamique de la lutte de classe ne peut plus être analysée dans le cadre du “cours historique”. Cette analyse du “cours historique” devait donc être réexaminé puisque la perspective d’une nouvelle Guerre mondiale s’était éloignée, de même que celle de la révolution prolétarienne.
L’évolution de la situation historique nous imposait de faire un examen critique des 40 ans du CCI afin de vérifier la validité de nos analyses. C’est ce que nous avions commencé à faire lors de notre 21e Congrès dont les travaux ont été exclusivement consacrés à ce bilan critique. C’est donc à partir de ce Congrès que nous avons mené une réflexion sur le cours historique et avons actualisé notre analyse à la lumière de la nouvelle situation mondiale ouverte avec l’effondrement du bloc de l’Est. Cet événement majeur, le plus important depuis la Seconde Guerre mondiale, avait provoqué un recul de la conscience et de la combativité du prolétariat du fait de l’impact qu’a eu la gigantesque campagne de la bourgeoisie prétendant que l’effondrement des régimes staliniens signifiait la “faillite du communisme”. La bourgeoisie avait pu ainsi retourner cette manifestation majeure de la décomposition de son système contre la conscience de la classe ouvrière, obstruant ainsi sa perspective révolutionnaire et rendant plus difficile, plus lente et plus heurtée sa marche en avant vers des affrontements de classe généralisés.
Par ailleurs, au cours de ce Congrès, nous avions affirmé que la reconstitution de nouveaux blocs impérialistes (qui est une condition objective indispensable pour une Troisième Guerre mondiale) n’était pas à l’ordre du jour. Avec la fin de la discipline de bloc, la dynamique de l’impérialisme était désormais caractérisée par la tendance croissante au “chacun pour soi”, une tendance qui n’exclue d’ailleurs pas que des alliances entre États puissent se constituer. Mais ces alliances sont marquées par une certaine instabilité. Le “chacun pour soi” dans la vie de la bourgeoisie ne peut qu’aggraver le chaos mondial, notamment dans des guerres localisées toujours plus meurtrières. Le “chacun pour soi” est également une manifestation de la décomposition du capitalisme. Il se vérifie encore aujourd’hui à travers la gestion calamiteuse de la pandémie de Covid-19 par chaque bourgeoisie nationale comme en ont témoigné la “guerre des masques” et la course concurrentielle aux vaccins.
C’est donc en s’appuyant sur la méthode marxiste d’analyse de l’évolution historique que le CCI a estimé que le concept de “cours historique” est devenu obsolète. La dynamique de la lutte de classe et du rapport de force entre les classes ne peut plus se poser aujourd’hui dans les mêmes termes que par le passé. Face à une situation historique nouvelle (et inédite depuis le début de la décadence du capitalisme), il nous appartenait de revoir une analyse qui avait été pendant 40 ans, comme le dit le camarade D. un de nos “piliers programmatiques”. Ce qui n’est d’ailleurs pas tout à fait juste : l’analyse du “cours historique” n’est pas une position faisant partie intégrante de notre plateforme programmatique (comme l’analyse de la décadence du capitalisme et ses implications sur les luttes de libération nationale, la participation aux élections ou encore la nature des syndicats et de l’ex-URSS).
La “théorie de la décomposition” ne remplace donc pas “la théorie du cours historique”, comme l’affirme le camarade D. Il ne s’agit pas du même paradigme. Une nouvelle Guerre mondiale n’est pas aujourd’hui une condition nécessaire pour la destruction de l’humanité. Comme nous l’avons mis en évidence dans nos “Thèses sur la décomposition”, la décomposition du capitalisme peut avoir les mêmes effets que la guerre : elle peut conduire, à terme, à la destruction de l’humanité et de la planète si le prolétariat ne parvient pas à renverser le capitalisme.
L’autocritique : une nécessité vitale pour les organisations révolutionnaires
Pour conclure, il nous faut répondre brièvement, à cette autre question posée par le courrier du camarade D., toujours à propos de notre remise en cause du concept de “cours historique” : : “Je n’ai pas d’autre exemple de la remise en cause d’une position “pilier” de cette importance depuis 45 ans (date de la création du CCI). Éclairez-moi s’il y a eu un ou des précédents”.
Il y a eu en effet quelques “précédents”. Le premier est signalé par le camarade lui-même : nous avions remis en cause la notion de “cours à la révolution” pour la remplacer par celle de “cours aux affrontements de classe”, dans les années 1980. En effet, la notion de “cours à la révolution” était fortement marquée par un certain immédiatisme de notre part. La reprise historique de la lutte de classe à la fin des années 1960 ne signifiait pas qu’une nouvelle vague révolutionnaire allait surgir rapidement. C’est l’analyse du rythme lent de la crise économique dans les années 1970 qui nous avait permis de comprendre que cette reprise de la lutte de classe ne pouvait pas encore déboucher immédiatement sur un soulèvement révolutionnaire du prolétariat comme c’était le cas face à la barbarie de la Première Guerre mondiale.
On peut citer comme autre exemple de rectification nécessaire de nos analyses, la question de l’émergence de la Chine comme seconde puissance mondiale. Par le passé, nous avions en effet défendu l’idée que, dans la période de décadence du capitalisme, il n’y avait aucune possibilité pour les pays du “Tiers monde” (dont la Chine) de sortir du sous-développement. C’est à la lumière des conséquences de l’effondrement du bloc de l’Est avec l’ouverture des pays du glacis soviétique et leur intégration dans l’“économie de marché” que nous avions été amenés à revoir cette analyse devenue obsolète. Néanmoins, cette nouvelle analyse ne remettait nullement en cause le cadre historique de la décadence du capitalisme.
Tout comme les révolutionnaires du passé, le CCI n’a jamais eu peur ni de reconnaître et rectifier ses erreurs, ni d’adapter ses analyses aux nouvelles données de la situation mondiale. Si nous n’étions pas capables de critiquer nos propres erreurs, nous ne serions pas une organisation fidèle à la méthode du marxisme. Comme l’affirmait encore Rosa Luxemburg en septembre 1899, “Il n’existe sans doute pas d’autre parti pour lequel la critique libre et inlassable de ses propres défauts soit, autant que pour la social-démocratie, une condition d’existence. Comme nous devons progresser au fur et à mesure de l’évolution sociale, la modification continuelle de nos méthodes de lutte et, par, conséquent, la critique incessante de notre patrimoine théorique, sont les conditions de notre croissance. Il va cependant de soi que l’autocritique dans notre Parti n’atteint son but de servir le progrès, et nous ne saurions trop nous en féliciter, que si elle se meut dans la direction de notre lutte. Toute critique contribuant à rendre plus vigoureuse et consciente notre lutte de classe pour la réalisation de notre but final mérite notre gratitude” (“Liberté de critique et de la science”)
C’est en ce sens que nous devons également saluer le courrier du camarade D. et ses remarques critiques. Sa contribution participe à alimenter le débat public que nous ne pouvons qu’encourager. En ouvrant les colonnes de notre presse, comme nous l’avons toujours fait, à tout lecteur désireux de critiquer nos analyses et positions, notre objectif vise à développer la culture du débat au sein de la classe ouvrière et du milieu politique prolétarien.
(À suivre)
Sofiane
1“Rapport sur la question du cours historique”, Revue internationale n° 164 (premier semestre 2020).
Rubrique:
Bicentenaire de la naissance de Friedrich Engels
- 75 lectures
Le 28 novembre 1820, naissait Friedrich Engels dans l’ancienne ville de Barmen en Rhénanie. Pour l’occasion, les lecteurs pourront trouver ci-dessous un article paru dans la presse du CCI à l’occasion du centième anniversaire de sa mort.
FRIEDRICH ENGELS : il y a cent ans disparaissait un « grand forgeron du socialisme » [218]
Rubrique:
Résolution sur la situation en France (2020 - Partie 1): La bourgeoisie française face à l’aggravation de la décomposition
- 105 lectures
Nous publions ci-dessous la résolution sur la situation en France adoptée lors du 24e congrès de la section en France du CCI. La première partie traite de l’analyse de la vie politique de la bourgeoisie française et des enjeux auxquels elle est confrontée, tout particulièrement depuis le surgissement de la pandémie de Covid-19.
La deuxième partie aborde le rapport de force entre les classes à travers notamment l’analyse du mouvement interclassiste des Gilets jaunes et de la lutte contre la réforme des retraites survenue entre la fin de l’année 2019 et le début de l’année 2020.
La pandémie actuelle marque une accélération de la décomposition sociale. Covid-19 a pu se répandre, provoquer une hécatombe et paralyser l’économie mondiale parce que la bourgeoisie a été incapable d’anticiper, de prendre des mesures adaptées et d’accorder ses décisions à l’échelle internationale. La concurrence exacerbée entre les États, l’anarchie, l’irrationalité et l’incurie ont fait flamber l’épidémie. La seule politique mise en place pour tenter d’y faire face, celle du confinement, tout droit sortie du Moyen Âge, révèle à elle-seule la nature obsolète et la faillite du capitalisme.
L’incapacité de la bourgeoisie à faire face à Covid-19 est en train d’aggraver la récession mondiale amorcée en 2019 et de lui donner une ampleur dévastatrice. En 2008, lors de “la crise des subprimes”, la bourgeoisie avait su réagir de façon coordonnée à l’échelle internationale. Les fameux G7, G8,… G20 (qui faisaient “la Une” de l’actualité) symbolisaient cette capacité des États à s’entendre a minima pour tenter de répondre à la “crise de la dette”. 12 ans plus tard, la division, la “guerre des masques” puis la “guerre des vaccins”, la cacophonie régnant dans les décisions de fermetures des frontières contre la propagation de Covid-19, l’absence de concertation à l’échelle internationale (hormis l’Europe qui tente difficilement de se protéger contre ses concurrents) pour limiter l’effondrement économique, signent l’avancée du chacun pour soi et la plongée des plus hautes sphères politiques du capitalisme dans une gestion de plus en plus irrationnelle du système.
En revenant sur les deux dernières années de “macronie”, la résolution ci-dessous examine la politique de la bourgeoisie française pour essayer d’évaluer ses forces et ses faiblesses face à cette dynamique mondiale.
1. Avec déjà plus de 80 000 morts, la France est l’un des pays les plus touchés par la pandémie. Pourtant, la France avait la réputation de posséder l’un des systèmes de soin les plus performants et développés au monde. La réalité des 40 dernières années de réduction continue des budgets et des effectifs dans les hôpitaux, sous les gouvernements de droite comme de gauche, vient d’éclater au grand jour : partout il manque des médecins, des infirmiers, des lits, des respirateurs et même des blouses, des gants, des masques… au point que la seule solution contre l’épidémie a été le confinement. La bourgeoisie a montré son vrai visage cynique, en présentant comme inévitable, la nécessité de faire des choix parmi les malades (ceux de Covid, et les autres), donc de laisser mourir des personnes pour en sauver d’autres.
En Italie du Nord, en mars, l’embolie des hôpitaux a entraîné une politique du tri : refuser un malade de 60 ans pour pouvoir prendre en charge un de 40. Le personnel de santé a été laminé physiquement et psychologiquement. Toutes les bourgeoisies d’Europe ont constaté ces dégâts et ont craint qu’en se généralisant, une telle situation entraîne une explosion de colère dans la population et le chaos social. Qui plus est, avec une épidémie si massive et incontrôlée, les salariés auraient été trop nombreux à ne plus pouvoir travailler. Partout en Europe, y compris en France, le confinement généralisé a donc été décrété à la fin de l’hiver 2020, provoquant une récession de plus de 10 % en quelques semaines.
Aujourd’hui, face simultanément à une récession inconnue depuis l’après-guerre et une deuxième vague de la pandémie qui s’annonce plus haute et meurtrière encore, la bourgeoisie française veut éviter à tout prix un second arrêt de l’activité sur les lieux de production : il s’agit donc pour elle d’éviter la saturation des hôpitaux en limitant la vie sociale et familiale et en sacrifiant l’activité économique des couches intermédiaires (petits commerces, artisanat…).
2. Lorsque la bourgeoisie se préoccupe de la santé des travailleurs, c’est toujours pour pouvoir mieux exploiter une main d’œuvre en “état de marche”. En rognant, décennie après décennie, les capacités de soins, l’État français scie donc la branche sur laquelle il est assis. Les coupes claires dans le système hospitalier au nom des “exigences d’équilibre budgétaire” témoignent d’une politique de plus en plus à courte vue de la part de la bourgeoisie française. Le poids immédiat de la crise économique exige des mesures amputant toujours plus la viabilité du système à long terme.
3. Cet état calamiteux des hôpitaux n’est pas une exception : dans les écoles, les professeurs absents ne sont que rarement remplacés ; dans les transports, le manque de trains et de métros impose aux voyageurs de s’entasser, et les infrastructures ne sont plus suffisamment entretenues, provoquant pannes et accidents ; dans les usines, les cadences sont infernales et la “flexibilité” la règle.
4. La fraction de la bourgeoisie au pouvoir, Macron et son gouvernement, sont pris dans des contradictions insolubles :
-
Conscients que la division au sein de l’Union Européenne favorise la propagation du virus et aggrave la crise économique, Macron s’est positionné en faveur d’une entente européenne. Mais si le “plan de relance” consenti par l’Allemagne, est une victoire au regard de l’absence de concertation partout ailleurs sur la planète, il n’est pas possible d’en prévoir encore les effets par rapport à la gravité de la récession actuelle et à venir. Pire, la France a participé elle aussi activement à la cacophonie généralisée et au développement du chacun pour soi : fermeture de ses frontières le plus tardivement possible face à la première vague afin de profiter de l’arrêt de l’activité économique de ses voisins et réouverture prématurée ; aux avant-postes de la “guerre des masques” ; au front de la “guerre des vaccins”.
-
Conscients que l’état de délabrement du système de soins est une entrave au bon fonctionnement de l’économie nationale, et afin de calmer la colère des agents hospitaliers, Macron a lancé son “plan Ségur”. Mais derrière les promesses d’augmentation de salaire et des embauches se cache un plan de “modernisation des hôpitaux” : augmentation de la productivité, plus grande charge de travail et de responsabilités pour les médecins libéraux… Cette nouvelle dégradation à venir du système de soins montre l’impasse du capitalisme sous le poids de sa crise économique historique et insoluble.
-
Conscients de l’arrivée de l’épidémie depuis la Chine, Macron et son gouvernement n’ont rien fait pour préparer les services de soins : aucune anticipation des achats de masques par exemple, contrairement ce qu’avait fait la bourgeoisie française craignant la grippe A en 2009 (achats de masques et vaccins par millions). Ce qui montre une nette détérioration des capacités de gestion et d’anticipation de l’État français en une décennie.
5. En 2017, la victoire d’Emmanuel Macron à la présidentielle représentait une certaine réussite pour la bourgeoisie française. Alors que les bourgeoisies américaines et anglaise n’étaient pas parvenues à endiguer la montée du populisme jusqu’au plus haut sommet de l’État (Trump aux États-Unis, Brexit en Grande-Bretagne…), la bourgeoisie française avait contourné le rejet de la droite et de la gauche “classiques”, et contré la poussée du Rassemblement National, par la création d’un nouveau parti “ni de droite ni de gauche” et la mise en avant d’un “homme hors système”. Macron portait même une vision plus adaptée que ses prédécesseurs aux besoins de l’économie française et des restructurations nécessaires : défense des secteurs de haute technologie et de la recherche, refonte profonde de l’État par des réformes systémiques (retraites, chômage), développement de la “flexibilité” à outrance (“l’ubérisation” de la société)… L’aura du président Macron, surnommé alors “Jupiter”, poussait la bourgeoisie française à aspirer de nouveau à un certain leadership européen et à prétendre rééquilibrer son “couple” avec l’Allemagne.
Seulement, “l’homme neuf” manquait aussi d’expérience, ou plus exactement de “sens politique”, sur la question sociale. Face à la colère des Gilets Jaunes, la féroce répression de ce mouvement interclassiste, à coups de flash-ball et d’œil crevé, n’a fait qu’exaspérer et radicaliser les plus déterminés, témoignant ainsi de la difficulté croissante du gouvernement à maintenir l’ordre dans une société dont le tissus social tend à se disloquer. Fin 2018, Macron était le président le plus haï de l’histoire de la Ve République. En proclamant dans la foulée que “sa” réforme des retraites toucherait tout le monde, Macron a aussi facilité le sentiment d’unité de la classe ouvrière, au moment même où tous les syndicats soulignaient une poussée de la combativité ouvrière.
Mais cette fraction de la bourgeoisie française sait aussi tirer les leçons de ses erreurs. Dès le début de l’épidémie, Macron a annoncé le report de la réforme des retraites sine die. Puis ce fut le tour de la réforme du chômage d’être repoussée. Le but est clair : apaiser le climat social, éviter d’attiser la colère qui gronde partout. Avec cette épidémie, l’État et sa police jouent aussi un rôle très différent : en veillant au port du masque dans les rues et au respect des règles du confinement, ils se présentent maintenant comme soucieux de la santé de la population, comme des agents protecteurs du peuple. D’ailleurs, avec la recrudescence des attentats terroristes, la bourgeoisie présente l’État et ses flics comme les seuls remparts contre la barbarie. Néanmoins, le gouvernement profite de ce contexte pour renforcer considérablement l’appareil policier et judiciaire de l’État à travers notamment le vote de “la loi de sécurité globale”. Si la bourgeoisie ne manque jamais une occasion pour renforcer ses outils de coercition dans la perspective des luttes futures du prolétariat, elle est également confrontée à une exacerbation de la violence sociale et à la tendance au chaos qu’elle tente de limiter.
6. Le but principal de l’arrivée de la fraction Macron au pouvoir est la lutte de la bourgeoisie française contre l’influence du populisme incarné par le Rassemblement National de Marine Le Pen. Après la victoire de LREM aux présidentielles, les élections européennes sont venues confirmer cette capacité.
Traditionnellement, les élections européennes sanctionnent le pouvoir en place au niveau national, c’est souvent une sorte de “référendum anti-gouvernement”. Pour éviter un résultat-sanction, le parti présidentiel En marche a transformé ces élections en duel Macron-LePen, agitant l’épouvantail de la “menace fasciste” et jouant de la nécessité de “faire barrage” à l’extrême – droite. Si le Rassemblement National est tout de même arrivé en tête (23,34 %), son score a baissé par rapport aux élections européennes précédentes (-1,52 points) avec En marche juste sur ses talons (22,42 %). Les élections municipales ont encore confirmé cette stagnation du Rassemblement National. De façon plus générale, le duel Macron/Le Pen permet de renforcer les illusions démocratiques : les divergences de ses deux fractions font croire à un enjeu pour la classe ouvrière ; le discours du “chaque vote compte” prend donc plus de poids.
Mais avec les ravages de la Covid-19, la perte de confiance en la science (décuplée par l’instrumentalisation politique des scientifiques) et la peur grandissante de l’avenir, l’irrationnel, l’obscurantisme et la haine ne peuvent que croître, ce qui constitue le terreau le plus fertile aux idées populistes. Toute la bourgeoisie française est donc préoccupée par les prochaines présidentielles en 2022.
Afin de ne pas laisser au Rassemblement National le monopole de leur exploitation politique au plan électoral, Macron est contraint d’adopter et de s’approprier certains thèmes propres au populisme. C’est en particulier le cas concernant la défense des “valeurs qui fondent l’identité nationale de la France Républicaine, de la Laïcité” à travers l’adoption de la Loi sur le Séparatisme pour lutter contre l’islamisme… que le RN a dû lui-même soutenir “comme un premier pas”.
C’est pourquoi Macron tient d’ores et déjà un discours des plus rassembleurs. Face à la décapitation de Samuel Paty en pleine rue par un jeune djihadiste pour avoir, en tant que professeur, présenté en classe avec ses élèves des caricatures de Mahomet publiées par Charlie Hebdo, Macron a déclaré “Nous ne renoncerons pas aux caricatures, aux dessins, même si d’autres reculent”. Ainsi, le Président français ratisse large : à droite par son intransigeance face à l’islamisme, quitte à se mettre à dos le président de la Turquie Erdogan et nombre de pays “musulmans” ; à gauche par sa défense des “professeurs de la République” et de la laïcité.
Cependant, si Macron a pour le moment freiné la montée en puissance du Rassemblement National, il n’a pas réussi à empêcher le développement des idées populistes de se diffuser dans des parties de la population, notamment dans les couches petites-bourgeoises, le contraignant à adopter des mesures de type populiste.
7. Mais pour l’heure, si Macron garde sa place et sa stature présidentielle, d’autres ambitions à l’affût peuvent l’affaiblir face aux échéances de 2022, ce qui inquiète la bourgeoisie qui cherche à freiner la montée du populisme :
-
La droite fait face à un double problème : son usure suite à des décennies au pouvoir (en alternance avec la gauche) et la politique déjà très “droitière” et “gaulliste” de Macron. De plus, soumise à des luttes de cliques très violentes, qui la rend incapable pour le moment, de dégager une personnalité capable de s’imposer dans son camp et de rivaliser avec Macron. La marge de manœuvre de ce camp politique pour faire émerger un candidat crédible s’avère donc d’autant plus délicate et difficile.
-
La gauche, elle aussi, est usée par ses successives gouvernances. Le PS, discrédité depuis des décennies aux yeux de la classe ouvrière, du fait de sa participation au gouvernement avec l’arrivée de Mitterrand au pouvoir en 1981, tente de s’appuyer sur les écologistes qui, s’ils ont le vent en poupe pour se présenter sous un nouveau jour, semblent de nouveau en proie à des ambitions personnelles non réglées. Mélenchon peine à incarner l’homme de l’unité (il a d’ailleurs décidé de faire cavalier seul pour les présidentielles). Son positionnement “très à gauche” est en plus très précieux à la bourgeoisie dans son rôle d’opposition afin d’encadrer idéologiquement la classe ouvrière, tout particulièrement auprès de la jeunesse, comme l’a montré l’investissement très important de la France Insoumise lors du mouvement contre la réforme des retraites, aux côtés des syndicats “radicaux”.
-
D’ailleurs, syndicats et extrême-gauche, conscients de la montée de la combativité ouvrière, mettent de plus en plus en avant le “combat de classe”, afin de mieux happer vers eux les prolétaires en recherche d’une perspective et coller aux préoccupations de la classe ouvrière.
-
La seule autre force politique qui semble pouvoir potentiellement contrebalancer le binôme RN/En Marche, ce sont Les Verts, dont les discours radicaux séduisent une grande partie de la jeunesse. Ce courant politique, pur produit de la décomposition du capitalisme, divisé et traversé d’antagonismes importants, précisément en ce qui concerne son positionnement envers le pouvoir gouvernemental en place, offre de ce fait différentes options possibles pouvant être mises à profit par la bourgeoisie. Celle-ci a notamment compris l’intérêt de promouvoir l’idéologie écologiste afin d’enfermer la réflexion ouvrière dans le carcan du réformisme et l’illusion d’un possible capitalisme peint en vert. L’exhibition de la jeune Greta Thunberg sur tous les plateaux de télé et à l’Assemblée Nationale, plébiscite “la marche du siècle” pour le climat au printemps 2018. Présentée comme “radicale”, l’association Extinction Rebellion a “sauvé” Nicolas Hulot d’un trop fort discrédit par sa bruyante démission… Ce faisant, elle a donné un nouvel élan à la démocratie et offre un levier permettant à la bourgeoisie de mobiliser la population sur le terrain électoral et ainsi lutter contre l’abstention : la participation aux élections européennes (50,1 %) a été la plus forte depuis 1994, avec une poussée des partis écologistes (en troisième position des résultats avec 13,48 %) et de l’intérêt des jeunes électeurs.
8. Au moment où la “seconde vague” de la pandémie frappe l’Europe, que des centaines de milliers de morts sont encore annoncées, la crise économique connaît elle aussi une nouvelle brutale accélération.
La prévision d’une récession de -13,8 % (selon l’OCDE) pour l’année 2020, fait du capital français l’un des plus touchés du vieux continent. Le fait que d’importants piliers sur lesquels se fonde sa puissance économique (le tourisme, la construction aéronautique, l’automobile et les transports) comptent parmi les secteurs ayant partout le plus souffert de la crise sanitaire explique ce repli, bien supérieur à la moyenne européenne et de la zone euro (-7 %).
La politique du “quoiqu’il en coûte” d’aides et de soutien massifs apportés par l’État aux entreprises, contraint de parer au plus pressé en vue de préserver l’appareil de production du capital français, a poussé l’endettement de l’État à un niveau colossal, historiquement inégalé (près de 120 % du PIB), sans qu’il soit encore possible de juger de son efficacité au plan de la relance de l’activité économique et de la défense de son rang de 6éme puissance économique mondiale.
9. Les deux années à venir vont être marquées par une brutale dégradation des conditions de vie et de travail de toute la classe ouvrière.
Ainsi, si les réformes des retraites et de l’assurance-chômage sont repoussées et que le gouvernement réfléchit à la façon la plus prudente de les faire passer avec le moins de remous possibles, les attaques économiques contre la classe ouvrière ne vont pas en être moins violentes pour autant. En particulier, le gouvernement et les entreprises vont orchestrer ensemble les inexorables plans de licenciement à venir, en divisant un maximum la classe ouvrière, paquet par paquet, secteur par secteur. Évidemment, les syndicats seront aux avant-postes de ce saucissonnage en règle. Le chômage de masse va donc s’accroître encore. Nous ne pouvons pas encore prévoir quand, ni comment la classe ouvrière en France va de nouveau faire exploser sa colère et sa combativité, compte tenu du coup de massue qu’elle a pris sur la tête avec la pandémie. Mais ce qui est certain, c’est que la bourgeoisie ne va pas la ménager pour lui faire payer les effets de l’accélération de la crise économique. Reste à savoir comment la classe dominante va pouvoir naviguer et gouverner pour faire avaler à la classe exploitée la dégradation de toutes ses conditions de vie à court et moyen terme. D’autant que la pilule de la réforme des retraites (à laquelle la bourgeoisie n’a pas renoncé) ne passera pas aussi facilement.
Ce qui est également certain, c’est que la clique bourgeoise au pouvoir va s’atteler à contenir le populisme du Rassemblement National et empêcher Marine Le Pen de gagner les élections de 2022. Malgré la tendance à la perte de maîtrise de son jeu politique avec l’aggravation de la décomposition du capitalisme, la classe dominante en France va tout mettre en œuvre pour sauver les meubles d’ici les échéances présidentielles de 2022. Bien qu’il soit impossible de faire des pronostics dès à présent sur la façon dont la bourgeoisie française va disposer ses cartes dans la perspective des prochaines présidentielles, ce qui est tout aussi certain, c’est qu’avec l’aggravation de la crise économique, quelle que soit l’équipe au pouvoir, c’est encore plus de misère, de chômage, d’austérité, d’exploitation accrue qui attendent la classe ouvrière, en France comme dans tous les pays.
Rubrique:
Résolution sur la situation en France (2020 - Partie 2): Mouvements sociaux en France et rapport de force entre les classes
- 72 lectures
1. L’arrivée et l’expansion de la pandémie mondiale de Covid-19 a eu un impact considérable sur tous les aspects de la vie de la société et sur tous les plans : économique, politique et social. La crise sanitaire, comme manifestation majeure et inédite de l’accélération de la décomposition du capitalisme, va nécessairement avoir des conséquences sur la dynamique des combats de classe dans les deux années à venir. Le prolétariat en France, comme dans tous les pays, a subi de plein fouet le choc de cette pandémie. Cette catastrophe sanitaire a provoqué, de façon immédiate, un sentiment d’effroi, de sidération générale rendant très improbable, à court terme, toute mobilisation de la classe ouvrière, sur son propre terrain, contre les effets dévastateurs de la crise économique. Aujourd’hui, c’est tout le prolétariat mondial, comme l’ensemble de la société, qui est ébranlé par la gravité et les conséquences de cette pandémie. Cependant, il existe une grande hétérogénéité au sein de la classe ouvrière. Il est donc très difficile pour les révolutionnaires de dégager, dès à présent, une tendance générale valable pour tous les pays. La classe ouvrière en France n’a pas la même histoire, ni la même expérience que celle des États-Unis, par exemple. Elle n’est pas touchée par la même arriération politique que le prolétariat de la première puissance mondiale, fortement imprégnée par la montée du populisme.
Pour évaluer le rapport de force entre les classes, et poser un cadre politique permettant de comprendre l’évolution de ce rapport de force, il convient de revenir sur deux mouvements sociaux qui ont marqué la situation en France ces deux dernières années : le mouvement des Gilets Jaunes et celui contre la réforme des retraites. Ceci afin d’en tirer les principaux enseignements dans le contexte historique actuel d’accélération de la décomposition sociale et de la crise économique.
2. Le mouvement des Gilets Jaunes était une explosion de mécontentement contre une nouvelle baisse du pouvoir d’achat avec la hausse des taxes sur le carburant. Cette mesure du gouvernement Macron a frappé particulièrement les petits patrons et les ouvriers des zones rurales, contraints de prendre leur voiture pour se déplacer ou aller travailler. Les franges les plus misérables du prolétariat, très dispersées et inexpérimentées, ont été particulièrement vulnérables aux influences de la petite-bourgeoisie. Ce mouvement social s’est ainsi développé sur un terrain interclassiste, un terrain où les revendications ouvrières étaient mêlées et pouvaient se confondre avec celles des petits patrons et artisans. Il n’était donc pas une émanation de la lutte du prolétariat, mais un produit de la décomposition sociale résultant de la paupérisation croissante des couches intermédiaires. Ce mouvement se concevait comme une lutte des “pauvres” contre les “riches” et non pas comme celle d’une classe exploitée – le prolétariat – contre une classe exploiteuse – la bourgeoisie. C’est pour cela que la colère des Gilets Jaunes s’était focalisée contre la personne de Macron. Ils voulaient faire tomber le “Président des riches” qui avait supprimé l’impôt sur la fortune.
Le fait que le gouvernement Macron ait lâché du lest en débloquant plus de 10 milliards d’euros n’était pas un recul face à la force pseudo-“révolutionnaire” des Gilets Jaunes. Cette concession avait deux objectifs. D’une part, il s’agissait pour le gouvernement de limiter le chaos social provoqué par les violences urbaines et les saccages, notamment dans les “beaux quartiers” de la capitale. Par ailleurs, l’autre objectif, plus idéologique, visait à faire croire que les Gilets Jaunes auraient trouvé une forme de lutte plus “moderne”, plus “originale” et “efficace” face au caractère “dépassé” et “stérile” des vieilles méthodes de la classe ouvrière. Il s’agissait pour la bourgeoisie et ses medias d’instiller l’idée que seul ce type de mouvement interclassiste, du “peuple citoyen”, peut constituer une menace pour la classe dominante.
Malgré sa très grande sympathie envers les travailleurs les plus pauvres et précaires, la classe ouvrière ne s’est pas mobilisée dans le mouvement des Gilets Jaunes. Elle ne se reconnaissait ni dans leurs méthodes de lutte, ni dans un mouvement qui avait été soutenu par les partis bourgeois et notamment la droite et l’extrême-droite. Elle ne se reconnaissait pas dans une protestation sociale fortement imprégnée par l’idéologie nationaliste (avec aussi quelques relents minoritaires et nauséabonds de populisme, notamment de xénophobie) où de nombreux Gilets Jaunes brandissaient le drapeau tricolore et chantaient la Marseillaise à tue-tête dans leurs manifestations.
3. Le mouvement contre la réforme des retraites, qui a surgi un an après celui des Gilets Jaunes, a dévoilé au grand jour que la lutte de classe était toujours d’actualité. Ce mouvement a démontré la capacité du prolétariat en France à se mobiliser sur son propre terrain en s’affirmant comme classe autonome antagonique au capital. La reprise de sa combativité a été illustrée par les manifestations hebdomadaires regroupant dans la rue, semaine après semaine, un nombre croissant de travailleurs en colère. C’est cette combativité montante qui avait obligé les syndicats à prendre les devants pour encadrer la classe ouvrière, quadriller tout le terrain de sa mobilisation en collant aux besoins de la lutte. Ses besoins se sont clairement exprimés par la recherche de l’unité et de la solidarité entre tous les secteurs et toutes les générations.
Le retour de la lutte de classe en France a mis en évidence que, durant la dernière décennie de calme social, une maturation souterraine s’est opérée au sein du prolétariat. Cette maturation était à la fois la conséquence de l’aggravation de la crise économique, de l’accumulation des attaques de la bourgeoisie, et du discrédit croissant des partis politiques de la classe dominante. En mettant en avant ses propres revendications, son besoin d’unité et de solidarité dans la lutte, le prolétariat en France a montré également sa capacité à retrouver son identité de classe, même si cette dynamique était encore très embryonnaire.
4. Après deux mois d’effervescence, le mouvement contre la réforme des retraites devait nécessairement atteindre ses propres limites qui ont fait apparaître les difficultés de la classe ouvrière à développer et unifier sa lutte. Les travailleurs du secteur privé, du fait de la crainte des licenciements, notamment chez les ouvriers précaires et en Contrats à durée déterminée, ne se sont pas mobilisés dans ce mouvement. Par ailleurs, seuls les ouvriers du secteur des transports (SNCF et RATP) sont entrés en grève pendant près de deux mois. Malgré la volonté générale d’en découdre avec le gouvernement, la grande majorité des travailleurs ont délégué la lutte et l’ont remise entre les mains des seuls cheminots, présentés comme l’avant-garde “héroïque” du mouvement. La “grève par procuration” a ainsi révélé une hésitation de la classe ouvrière à engager massivement le combat. Cette difficulté a permis aux syndicats de dévoyer son besoin de solidarité à travers la mise en place de “caisses de solidarité” financières, destinées à permettre aux cheminots de “tenir”, c’est-à-dire de rester isolés dans une grève longue, coûteuse et épuisante.
La principale faiblesse du mouvement a été l’incapacité du prolétariat à étendre la lutte immédiatement dès le début en mettant en place des Assemblées Générales massives ouvertes à tous les travailleurs, actifs, retraités, chômeurs ou étudiants. La nécessaire extension géographique de la lutte, les moyens de la mettre en œuvre, ne pouvait être discutée et décidée que dans des AG souveraines, véritable poumon de tous les combats de la classe ouvrière. L’absence de tels organes unitaires a permis aux syndicats de tenir le haut du pavé, d’organiser ce mouvement de A à Z et d’en garder la totale maîtrise. Ils ont pu faire leur sale travail de sabotage grâce à une radicalisation de leurs discours, à un partage des tâches en leur sein en jouant la carte de la division syndicale. Il revenait ainsi à la CFDT (qui avait accepté la retraite à points) de jouer le rôle de syndicat “réformiste” et “collaborationniste”, tandis que FO et surtout la CGT (appuyé par SUD et les gauchistes) ont joué le rôle de syndicats radicaux, de “combat”, “jusqu’au boutistes”. En même temps que leurs discours “radicaux” exigeaient le retrait de l’ensemble de la réforme des retraites, ils ont enfermé les travailleurs de la SNCF et de la RATP dans une grève longue et isolée. Ils n’ont appelé à l’extension de la lutte (en réalité à l’extension de la défaite !) qu’à la fin du mouvement, lorsque les cheminots ont commencé à voter la reprise du travail, après avoir perdu près de deux mois de salaire. C’est à partir de cette reprise du travail dans le secteur des transports que le mouvement a commencé à refluer. Avant même l’arrivée de la pandémie de Covid-19, ce combat contre la réforme des retraites s’était donc déjà essoufflé.
L’extinction de ce mouvement n’a pas débouché, cependant, sur un sentiment général d’impuissance, d’amertume et de démoralisation. D’une part, parce que cette mobilisation n’était qu’un premier combat dans lequel toute la classe ouvrière n’était pas engagée derrière les manifestations appelées, programmées et encadrées par les syndicats. D’autre part, la défaite a été atténuée par le fait que le principal “gain” de cette lutte était la lutte elle-même. Une lutte marquée par la joie et l’enthousiasme de se retrouver enfin tous ensemble, solidaires et unis après une décennie d’immobilisation et d’atomisation. Ce mouvement s’est terminé, non pas sur le sentiment que lutter ne sert à rien, mais sur une question clairement exprimée dans les manifestations : comment continuer le combat et construire un rapport de force pour obliger le gouvernement à retirer cette réforme des retraites ?
5. C’est dans ce contexte qu’est survenue la pandémie de Covid-19, mettant un coup d’arrêt momentané à la dynamique de reprise de la lutte de classe en France. Malgré l’énorme colère suscitée par l’incurie du gouvernement face à la crise sanitaire (de même que par la remise au travail de nombreux prolétaires, sans aucune protection efficace contre le risque de contamination), la bourgeoisie a tenté dès le début de retourner cette manifestation de la décomposition de son système contre la classe ouvrière. Ainsi, Emmanuel Macron, dans son discours martial (“Nous sommes en guerre”) annonçant le premier confinement à la fin de l’hiver 2020, n’a cessé de mettre en avant la nécessité de l’union nationale contre l’ “ennemi intérieur” : la Covid-19. La bourgeoisie et ses médias aux ordres n’ont cessé de promouvoir l’idéologie du “civisme”, de la “citoyenneté”, et la “solidarité” avec les soignants, présentés comme des héros et de bons “soldats” prêts à tous les sacrifices dans l’intérêt de la nation, toutes classes confondues. Par la suite, la multiplication des attentats terroristes en octobre 2020, comme autre manifestation de la décomposition du capitalisme, a donné lieu également à un renforcement de l’appel à l’union sacrée, et des discours bellicistes du gouvernement contre un autre “ennemi intérieur” invisible, pouvant frapper n’importe quel citoyen à tout moment et n’importe où. La classe ouvrière est ainsi appelée aujourd’hui à s’en remettre à l’État et son gouvernement comme uniques et seuls “protecteurs” du “peuple français” et de ses “valeurs républicaines”.
L’emprise de l’État sur l’ensemble de la société civile a été renforcée par la mobilisation martiale du personnel soignant dans les hôpitaux, de même que par le déploiement des forces de répression dans la rue et tous les lieux publics, par les couvre – feux et autres mesures de contrôle policiers censées protéger la population contre la circulation du virus (avec lequel chacun devrait “apprendre à vivre”). Cette restriction de la vie sociale, aggravée par les mesures moyenâgeuses de confinement, ne pouvait que provoquer une nouvelle situation de paralysie momentanée de la classe ouvrière.
6. En France, comme dans tous les pays, la pandémie de Covid-19 a eu comme conséquence une explosion du chômage avec des faillites en chaîne, obligeant de nombreuses entreprises à jeter sur le pavé un nombre croissant de prolétaires. Dans la période actuelle, cette explosion du chômage n’est pas un élément favorisant l’unification des luttes de la classe ouvrière mais, au contraire, un facteur de leur division et dispersion. Les grèves contre les licenciements peuvent prendre la forme de “combats du désespoir”, du fait également de l’absence de perspective pour les chômeurs de retrouver un emploi stable et durable. En attaquant la classe ouvrière aujourd’hui paquets par paquets, la bourgeoisie, son gouvernement et son patronat laissent le terrain libre aux syndicats pour enfermer les prolétaires dans le corporatisme, la défense de “leur” entreprise, “leur” secteur, comme on a pu le constater dans l’aéronautique, les transports aériens, certaines usines automobiles, les PME, etc. Ce regain de l’enfermement corporatiste s’est également révélé dans les manifestations récentes des travailleurs des hôpitaux, bien encadrés par les syndicats et les gauchistes.
7. Dans cette situation extrêmement difficile, encore dominée par la peur, l’atomisation et l’angoisse face à un avenir incertain, le prolétariat va devoir surmonter de nombreux obstacles, se dégager de cette chape de plomb pour développer ses combats et les maintenir sur son propre terrain de classe. Du fait que la pandémie menace toutes les couches de la société, cette catastrophe sanitaire est un terrain particulièrement favorable à l’émergence de mouvements interclassistes véhiculés par certaines franges de la petite-bourgeoisie. Comme nous l’avions mis en avant dans nos “Thèses sur la décomposition”, “Seul le prolétariat porte en lui une perspective pour l’humanité et, en ce sens, c’est dans ses rangs qu’il existe les plus grandes capacités de résistance à cette décomposition. Cependant, lui-même n’est pas épargné, notamment du fait que la petite-bourgeoisie qu’il côtoie en est justement le principal véhicule”.
L’accélération de la décomposition du capitalisme risque de faire surgir également des mouvements sociaux qui peuvent exploser sur un terrain bourgeois. En ont témoigné, en pleine crise sanitaire, les manifestations aux États-Unis contre les violences policières frappant particulièrement les Noirs et dont la principale revendication était celle d’une police moins raciste, d’une plus grande “justice” et “égalité” dans le cadre de la démocratie bourgeoise. Ainsi, le mouvement Black Live Matters, hypermédiatisé à l’échelle internationale, a pu trouver un écho et un prolongement en France avec les manifestations et rassemblements contre le meurtre d’Adama Traoré par les forces de répression.
Ce type de mouvement populaire, appelé par toutes sortes d’associations “citoyennes”, sont un piège pour la classe ouvrière, en particulier pour ses jeunes générations révoltées par la barbarie du capitalisme et spontanément attirées par “tout ce qui bouge”. Une telle barbarie ne peut que provoquer une indignation légitime contre le racisme et les violences policières. Mais c’est uniquement en luttant sur son propre terrain de classe, et en tant que classe, que le prolétariat pourra affirmer ses propres valeurs morales dans son combat contre un système économique décadent à l’origine de tous les fléaux de la société.
8. Malgré toutes les difficultés que le prolétariat rencontre aujourd’hui, la situation reste toujours ouverte. Sa colère et sa combativité ne se sont pas étiolées. Au contraire, son mécontentement n’a fait que se renforcer face à l’incurie de la bourgeoisie et sa gestion calamiteuse de la crise sanitaire, dont la “guerre des masques”, l’absence de coopération internationale et même la concurrence effrénée entre les États dans la recherche d’un vaccin, ont constitué le point d’orgue. C’est justement parce que la combativité du prolétariat en France n’a pas été étouffée que le gouvernement Macron a décidé de suspendre sa réforme des retraites et de l’assurance-chômage. Contrairement au mouvement spectaculaire des Gilets Jaunes, le mouvement contre la réforme des retraites n’était pas un petit feu de paille déjà éteint par l’ouragan de la pandémie de Covid-19.
Par ailleurs, il existe dans la classe ouvrière une mémoire collective qui ne peut que favoriser la recherche d’une perspective face à la menace de destruction de l’humanité et de la planète. Le prolétariat en France a une longue histoire, une longue tradition de luttes. Depuis la révolution bourgeoise de 1789, c’est “le prolétariat des barricades” et des manifestations de rue. Sa mémoire historique est toujours marquée par l’expérience de la Commune de Paris de 1871 et plus récemment celle de Mai 68. Ce n’est pas un hasard si, dans le mouvement des jeunes générations contre le Contrat Première Embauche en 2006, la référence à la Commune de Paris ait été présente dans certaines universités et dans de nombreuses AG. Ce n’est pas un hasard non plus si, dans le dernier mouvement contre la réforme des retraites, de nombreux manifestants avaient clairement affirmé : “c’est une grève générale et un nouveau Mai 68 qu’il nous faut !”. De même, dans les cortèges et sur les trottoirs de la capitale, on a pu entendre de nombreux manifestants chanter L’Internationale, couvrant ainsi la voix de quelques petits groupes de Gilets Jaunes qui entonnaient encore La Marseillaise ! Du fait de sa longue expérience et de son énorme potentiel de combativité, le prolétariat en France pourra continuer à apporter dans le futur, comme il l’avait fait à plusieurs reprises dans le passé, une contribution très importante aux combats de ses frères de classe dans les autres pays du monde.
Dans la mesure où la classe ouvrière n’a pas subi de défaite décisive, la crise économique reste aujourd’hui encore sa “meilleure alliée”. Elle contient aussi, en germe, un antidote à la décomposition du capitalisme.
En France, comme dans tous les pays, le chemin vers des luttes massives ouvrant une perspective révolutionnaire est encore long et parsemé d’embuches, mais il n’y en a pas d’autre.
La gravité des enjeux de la situation historique actuelle, exige des minorités les plus conscientes de la classe ouvrière qu’elles ne cèdent ni au scepticisme, ni à l’impatience. Face à l’atmosphère sociale du “no future” alourdie encore plus par la pandémie de Covid-19, la confiance des révolutionnaires dans l’avenir et dans les potentialités de la classe porteuse du communisme, sont au cœur de leurs convictions et de leur activité sur le long terme.
Rubrique:
Courrier de lecteur (partie 2): La perspective d’une guerre nucléaire généralisée est-elle à l’ordre du jour?
- 84 lectures
Dans la première partie de la réponse à ce courrier de lecteur, nous avons répondu aux critiques émises par le camarade D. au “Rapport sur la question du cours historique”, adopté au 23e Congrès du CCI et publié dans la Revue internationale n° 164. Dans cette deuxième partie, nous souhaitons traiter une autre question abordée par le camarade dans son courrier : celle de la perspective éventuelle d’une guerre nucléaire généralisée.
Les conditions pour le déclenchement d’une guerre généralisée
Le camarade D. affirme dans son courrier que “la question de la guerre n’est pas du tout évacuée par la théorie de la décomposition qui remplace la théorie du cours historique”.
Outre le fait que la classe dominante n’a pas été en mesure depuis 1989 de reconstituer de nouveaux blocs impérialistes, le camarade oublie que la deuxième condition pour le déclenchement d’une nouvelle guerre mondiale est la capacité de la bourgeoise à embrigader le prolétariat derrière les drapeaux nationaux, en particulier dans les pays centraux du capitalisme. Ce qui n’est nullement le cas aujourd’hui. Comme nous l’avions toujours affirmé, un prolétariat qui n’est pas disposé à accepter les sacrifices imposés par l’aggravation de la crise économique n’est pas prêt à accepter de faire le sacrifice ultime de sa vie sur les champs de batailles. Après la longue période contre-révolutionnaire qui avait notamment permis aux États d’envoyer à la mort des millions de prolétaires sous les drapeaux du fascisme et de l’anti-fascisme pendant la Seconde Guerre mondiale, la classe ouvrière est revenue sur la scène de l’histoire à la fin des années 1960 (Mai 68 en France, l’automne chaud en Italie, etc.). La bourgeoisie avait été empêchée de déclencher une troisième boucherie planétaire durant la Guerre froide parce qu’elle n’était pas en mesure d’embrigader un prolétariat qui, bien qu’il n’ait pas su développer ses luttes sur un terrain révolutionnaire, était à la fois très combatif et absolument pas disposé à se faire tuer ou à massacrer ses frères de classes. Malgré toutes les difficultés que rencontre la classe ouvrière depuis 1989 pour développer massivement ses luttes, la situation historique est toujours ouverte. Le prolétariat n’ayant pas subi de défaite décisive et définitive, l’aggravation de la crise économique ne peut que le pousser à se battre pied à pied pour défendre ses conditions d’existence, comme nous l’avons vu encore récemment avec le mouvement contre la réforme des retraites en France au cours de l’hiver 2019-2020. Et dans sa capacité de résistance aux attaques du capital, nous avons pu voir également une tendance à la recherche de la solidarité dans la lutte entre tous les secteurs et toutes les générations. Bien évidemment, cela ne signifie nullement que la bourgeoisie ne puisse plus jamais infliger à la classe ouvrière une défaite historique et décisive. Mais, comme nous l’avons affirmé dans nos “Thèses sur la décomposition” (Revue internationale numéro n° 107), la décomposition sociale peut détruire toute capacité de la classe ouvrière à renverser le capitalisme et conduire à la destruction de l’humanité et de la planète.
Vers une reconstitution des blocs impérialistes ?
Pour étayer son analyse des potentialités actuelles d’un conflit militaire de grande ampleur, le camarade D. indique : “Outre la question des armements nucléaires à longue portée, il y a en ce moment un pays qui n’a pas besoin d’avoir constitué un bloc uni et parfaitement tenu et soutenu pour se lancer dans une guerre qui, si elle n’est pas mondiale, ne sera pas cantonné à un théâtre d’opération limité dans le temps et dans l’espace (comme par exemple les deux guerres contre Saddam Hussein). Ce pays, c’est bien sûr les États-Unis qui ont la puissance économique, la suprématie militaire et les bases néanmoins pour une intervention partout dans le monde. Pour qu’une guerre avec des batailles dans différents endroits de la planète, qui se produisent simultanément et qui s’étalent sur une période assez longue (plusieurs années) se produise, il suffit qu’une autre puissance qui elle constitue des États vassalisés par le commerce extérieur et les investissements économiques, se dote de bases militaires à l’étranger dans ces états vassaux, commence à construire des porte-avions et généralement une marine de guerre efficace et nombreuse pour qu’à un certain moment le risque de conflit généralisé devienne une probabilité non négligeable. Ce pays existe déjà, c’est la Chine qui risque, grâce à l’épidémie de Covid-19, de bientôt dépasser les États-Unis au niveau économique mondial”.
Il est vrai que c’est autour de l’opposition entre ces deux superpuissances que se concentre la bataille stratégique pour un “nouvel ordre mondial”. La Chine, avec son vaste programme de “route de la soie” a pour objectif de s’ériger en puissance économique de premier plan à l’horizon 2030-50 et de se doter d’ici 2050 d’une “armée de classe mondiale capable de remporter la victoire dans toute guerre moderne”. De telles ambitions provoquent une déstabilisation générale des relations entre puissances et poussent les États-Unis à tenter depuis 2013 de contenir et de briser l’ascension de la puissance chinoise qui la menace. La riposte américaine, débutée avec Obama (reprise et amplifiée par Trump), représente un tournant dans la politique américaine. La défense de leurs intérêts en tant qu’État national épouse désormais celle du chacun pour soi qui domine les rapports impérialistes : les États-Unis passent du rôle de gendarme de l’ordre mondial à celui de principal agent propagateur du chacun pour soi et du chaos et de remise en cause de l’ordre mondial établi depuis 1945 sous leur égide. D’autre part, l’idée induite par ce que dit le camarade, c’est qu’il existe une tendance à la bipolarisation, puisque d’un côté les pays européens, dans le cadre de l’OTAN, prendraient le parti des États-Unis, tandis que la Chine, non seulement pourrait s’appuyer sur ses États vassaux mais aurait un allié de taille, la Russie.
Or, l’émergence de la Chine elle-même est un produit de la phase de décomposition, au sein de laquelle la tendance à la bipolarisation est battue en brèche par le chacun pour soi régnant entre chaque puissance impérialiste. De même, il existe une grande différence entre le développement de cette tendance et un processus concret menant à la formation de nouveaux blocs. Les attitudes de plus en plus agressives des deux pôles majeurs tendent à saper ce processus plutôt qu’à le renforcer. La Chine fait l’objet d’une profonde méfiance de la part de tous ses voisins, notamment de la Russie qui souvent ne s’aligne sur la Chine que pour défendre ses intérêts immédiats (comme elle le fait en Syrie), mais est terrifiée à l’idée de se retrouver subordonnée à la Chine en raison de la puissance économique de cette dernière, et reste l’un des plus féroces opposants au projet de Pékin de “route de la soie”. L’Amérique entre-temps s’est activement employée à démanteler pratiquement toutes les structures de l’ancien bloc qu’elle avait auparavant utilisées pour préserver son “nouvel ordre mondial” et qui permettaient de résister aux glissements des relations internationales vers le “chacun pour soi”. Elle traite de plus en plus ses alliés de l’OTAN en ennemis, et en général, elle est devenue l’un des acteurs principaux d’aggravation du caractère chaotique des relations impérialistes actuelles.
Une guerre nucléaire est-elle envisageable dans la période actuelle ?
En définitive, en évacuant une des conditions essentielles pour le déclenchement d’une nouvelle guerre mondiale (la nécessité de l’embrigadement idéologique du prolétariat), le camarade D. avance une autre hypothèse. Il se réfère à des articles de la presse bourgeoise (L’Obs et Le Canard enchaîné) pour affirmer qu’une guerre nucléaire est tout à fait possible, notamment entre les États-Unis et la Chine (devenue une puissance industrielle et impérialiste faisant face à la première puissance mondiale).
Comme nous l’avons toujours affirmé, l’impérialisme à sa propre dynamique et fait partie intégrante du mode de vie du capitalisme dans sa période de décadence. Et comme le disait Jaurès, “le capitalisme porte avec lui la guerre comme la nuée porte l’orage”. Aucune puissance économique ne peut rivaliser avec les autres, et s’affirmer comme telle sur la scène mondiale, sans développer des armes toujours plus sophistiquées. La guerre commerciale entre les États est donc toujours accompagnée d’une exacerbation des tensions impérialistes. S’il est vrai que l’armement nucléaire ne constitue plus seulement un moyen de “dissuasion” comme c’était le cas durant la “Guerre froide”, aujourd’hui, cette course aux armements est un moyen de chantage et de marchandage entre les États détenant l’arme nucléaire. L’exacerbation des tensions impérialistes ne débouche pas toujours sur une conflagration directe, comme on a pu le voir, par exemple, en 2017 avec les tensions militaires entre les États-Unis et la Corée du Nord (qui avaient d’ailleurs donné lieu à des discours alarmistes dans la presse bourgeoise). Après plusieurs mois de tractations, ce conflit s’est terminé (au moins momentanément) par de chaleureuses embrassades entre Trump (président des États-Unis) et Kim Jong-un (président de la Corée du Nord).
Plus la bourgeoisie est acculée face à la faillite de son système et à l’accélération de la guerre commerciale, plus chaque puissance cherche à avancer ses pions dans l’arène impérialiste mondiale pour le contrôle de positions stratégiques face à ses adversaires. Avec l’enfoncement du capitalisme dans la décomposition sociale, la bourgeoisie apparaît de plus en plus comme une classe suicidaire. Des dérapages incontrôlés sur le plan impérialiste ne sont pas à exclure dans le futur, si le prolétariat ne relève pas le défi posé par la gravité de la situation historique. Mais pour le moment, la perspective d’une conflagration nucléaire entre la Chine et les États-Unis n’est pas à l’ordre du jour. De plus, quel intérêt ces deux puissances auraient-elles à gagner à larguer massivement des bombes nucléaires sur le sol de leur rival ? Les destructions seraient telles qu’aucune troupe d’occupation du pays vaincu ne pourrait être envoyée sur ces champs de ruines. Nous avons toujours rejeté la vision de la guerre “presse bouton” où la bourgeoise pourrait déclencher un cataclysme nucléaire mondial en appuyant simplement sur un bouton, sans aucune nécessité d’un embrigadement du prolétariat. La classe dominante n’est pas complètement stupide, même si des chefs d’États irresponsables et complètement fous peuvent accéder au pouvoir de façon ponctuelle. Il ne s’agit pas de sous-estimer la dangerosité des tensions impérialistes entre les grandes puissances nucléaires comme la Chine et les États-Unis, ni d’écarter totalement la perspective d’une conflagration entre ces deux puissances dans l’avenir, mais d’en mesurer les répercussions catastrophiques au niveau mondial : aucune des puissances belligérantes ne pourraient en tirer profit. Contrairement aux discours alarmistes de certains médias et aux prévisions des géopoliticiens, nous devons nous garder de jouer les Nostradamus. Si la dynamique de l’impérialisme (dont nous ne pouvons prévoir l’issue aujourd’hui) conduit à une telle situation, l’origine se trouvera dans la perte de contrôle total de la classe dominante sur son système en pleine décomposition. Nous n’en sommes pas encore là et devons nous garder de crier trop vite “Au loup !”
Les révolutionnaires ne doivent pas céder à l’atmosphère sociale du “no future”. Ils doivent au contraire garder confiance dans l’avenir, dans la capacité du prolétariat et de ses jeunes générations à renverser le capitalisme avant qu’il ne détruise la planète et l’humanité. En abandonnant aujourd’hui notre analyse passée du “cours historique”, nous n’avons pas, comme le pense le camarade D., une vision “pessimiste” de l’avenir. Nous misons toujours sur la possibilité d’affrontements de classe généralisés permettant au prolétariat de retrouver et d’affirmer sa perspective révolutionnaire. Nous n’avons jamais évoqué, dans aucun de nos articles, une quelconque “défaite annoncée” du prolétariat, comme l’affirme le courrier de notre lecteur.
Sofiane
Rubrique:
ICCOnline - mars 2021
- 58 lectures
Pandémie de Covid 19, assaut du capitole à Washington: deux expressions de l’intensification de la décomposition du capitalisme
- 34 lectures
Nous publions ci-dessous l’exposé introductif réalisé pour les dernières réunions publiques tenues par les différentes sections du CCI.
Depuis un an, le monde a été secoué par deux événements inédits et d’une extrême importance dans la vie du capitalisme : la pandémie du Covid-19 et, tout récemment, l’assaut contre le Capitole à Washington après les élections américaines qui ont sanctionné la défaite de Donald Trump. Ces deux événements ne sont ni anodins ni séparés l’un de l’autre. Ils ne peuvent être compris que dans un cadre historique que nous allons exposer dans cette présentation.
La crise sanitaire que nous vivons aujourd’hui est l’événement le plus grave depuis l’effondrement du bloc de l’Est.
Cette pandémie s’est répandue à toute vitesse, comme une trainée de poudre, à partir d’un foyer de contamination en Chine l’hiver dernier. Le virus a traversé toutes les frontières et tous les continents. Il a fait aujourd’hui déjà plus de 2 millions de victimes. Partout, dans tous les pays, c’est l’état d’urgence sanitaire, la course contre la montre pour vacciner la population afin d’éviter une hécatombe planétaire.
Quelle est l’origine de cette pandémie ? Ce virus redoutable nous aurait été transmis, semble-t-il, par des espèces animales introduites dans l’environnement humain (le pangolin et la chauve-souris). Contrairement aux épidémies d’origine animale du passé (comme la peste introduite au Moyen Âge par les rats) aujourd’hui, cette pandémie est due essentiellement à l’état de délabrement de la planète. Le réchauffement climatique, la déforestation, la destruction des territoires naturels des animaux sauvages, de même que la prolifération des bidonvilles dans les pays sous-développés, ont favorisé le développement de toutes sorte de nouveaux virus et maladies contagieuses.
La pandémie de Covid-19 n’est donc pas une catastrophe imprévisible qui répondrait aux lois obscures du hasard et de la nature ! Le responsable de cette catastrophe planétaire, de ces millions de morts, c’est le capitalisme lui-même. Un système basé non pas sur la satisfaction des besoins humains, mais sur la recherche du profit, de la rentabilité par l’exploitation féroce de la classe ouvrière. Un système basé sur la concurrence effrénée entre les entreprises et entre les États. Une concurrence qui empêche toute coordination et coopération internationale pour éradiquer cette pandémie. C’est ce qu’on voit aujourd’hui avec la « guerre des vaccins », après la « guerre des masques » au début de la pandémie.
Jusqu’à présent, c’étaient les pays les plus pauvres et sous-développés qui étaient régulièrement frappés par des épidémies. Maintenant, ce sont les pays les plus développés qui sont ébranlés par la pandémie de Covid-19. C’est le cœur même du système capitaliste qui est attaqué et plus particulièrement la première puissance mondiale.
Aux États-Unis, on compte aujourd’hui au moins 25 millions de contaminés, et plus de 410 000 morts. Il y a eu plus de morts du Covid que de soldats américains tués lors de la Seconde Guerre mondiale ! Au mois d’avril dernier, le nombre de morts avait déjà dépassé celui des morts pendant la guerre du Vietnam !
La propagation de la pandémie s’est encore aggravée avec la mutation du virus. Dans la grande métropole de Los Angeles, un habitant sur 10 est contaminé ! En Californie, les hôpitaux sont pleins à craquer. Au début de la crise sanitaire, toute la population américaine a été frappée par les immenses tranchées où on a entassé des morts « non réclamés » dans l’État de New-York, sur Hart Island.
Avec la politique irresponsable de Trump, la gestion calamiteuse de cette pandémie a été encore pire que dans les autres pays. L’ancien Président avait misé sur l’immunité collective, sans port du masque, sans gestes barrière. Trump est même allé jusqu’à évoquer l’idée, complètement délirante, de s’injecter du gel hydroalcoolique dans les veines pour tuer le virus.
Dans le pays le plus développé du Monde, à l’avant-garde de la science, toutes sortes de théories complotistes ont fleuri. Alors que la pandémie avait déjà commencé à déferler sur le continent américain, une grande partie de la population aux États-Unis s’imaginait que le Covid-19 n’existait pas et que c’était un complot pour torpiller la réélection de Trump !
Aujourd’hui, avec 2 vaccins disponibles, chaque État américain fait sa propre cuisine dans la désorganisation et la pagaille la plus totale. En Europe, face à la remontée de l’épidémie et les variants du virus, c’est l’hécatombe en Grande-Bretagne. Partout la classe dominante vaccine à toute allure et doit gérer maintenant la pénurie, en attendant que les laboratoires accélèrent la production des vaccins.
L’explosion de cette pandémie mondiale a révélé :
1)- une perte de contrôle de la classe dominante sur son propre système.
2)-une aggravation sans précédent du « chacun pour soi » avec une concurrence effrénée entre les laboratoires pour être le premier à trouver un vaccin et le vendre sur le marché mondial. Dans cette course aux vaccins, le Spoutnik russe a été dépassé par ceux des États-Unis qui sont arrivés en tête avec le Pzifer-BionTech et le Moderna. Et si l’État d’Israël a pu obtenir autant de doses pour pouvoir vacciner toute sa population, c’est parce qu’il a acheté le vaccin Pfizer 43 % plus cher que le prix négocié par l’Union Européenne.
Il est clair que la principale préoccupation de la bourgeoisie de tous les pays, c’est de sauver avant tout le capital national face aux concurrents.
Si tous les États se démènent autant pour produire des vaccins, ce n’est certainement pas par souci pour la vie humaine. La seule chose qui intéresse la classe dominante c’est de préserver la force de travail de ceux qu’elle exploite pour prolonger encore l’agonie du système capitaliste.
Cette pandémie et l’incapacité de la classe dominante à l’endiguer, est d’abord la manifestation la plus évidente de la faillite totale du capitalisme. Face à l’aggravation de la crise économique, dans tous les pays, les gouvernements de droite comme de gauche, n’ont cessé depuis des décennies de réduire les budgets sociaux, les budgets de la santé et de la recherche. Le système de santé n’étant pas rentable, ils ont supprimé des lits, fermé des services hospitaliers, supprimé des postes de médecins, aggravé les conditions de travail des soignants. En France, le laboratoire Sanofi (lié à l’Institut Pasteur) a supprimé 500 postes de chercheurs depuis 2007. Toutes les recherches scientifiques et technologiques de pointe aux États-Unis ont été consacrées essentiellement au secteur militaire, avec y compris la recherche d’armes bactériologiques. De son côté, la Chine vend ses propres vaccins, aux pays du Maghreb et d’Afrique orientale. Le marché des vaccins chinois suit donc la Route de la soie. Une hypothèse est même émise aujourd’hui : le Covid-19 serait peut-être un virus échappé d’un laboratoire ! L’OMS a donc constitué une équipe pour mener une enquête en Chine afin de trouver quelle est l’origine de ce virus.
Cette pandémie mondiale incontrôlable confirme que le capitalisme est devenu, depuis le cataclysme de la Première Guerre mondiale, un système décadent qui met en jeu la survie de l’humanité.
Après un siècle d’enfoncement dans la décadence, ce système est entré dans la phase ultime de cette décadence : celle de la décomposition.
Nous allons maintenant expliquer brièvement pourquoi le capitalisme est entré dans sa phase de décomposition et quelles en sont les principales manifestations.
En 1989, après vingt ans de crise économique mondiale, un événement majeur, le plus important depuis la Seconde Guerre mondiale, avait ébranlé le monde : l’effondrement du bloc de l’Est et des régimes staliniens. C’était la manifestation la plus spectaculaire de la décomposition du capitalisme. Cette situation a provoqué aussi une dislocation du bloc occidental avec une tendance au développement du chacun pour soi.
Cette décomposition du capitalisme était due au fait qu’aucune des deux classes fondamentales de la société, ni la bourgeoisie ni le prolétariat, n’a pu apporter sa propre réponse à la crise économique : soit une nouvelle guerre mondiale (comme c’était le cas avec la crise des années 1930), soit la révolution prolétarienne. La bourgeoisie n’a pas réussi à embrigader le prolétariat derrière les drapeaux nationaux pour l’envoyer se faire massacrer sur les champs de bataille. Mais le prolétariat, de son côté, n’a pas pu développer des luttes révolutionnaires pour renverser le capitalisme. C’est cette absence de perspective qui a provoqué le pourrissement sur pied de la société capitaliste depuis la fin des années 1980.
Depuis 30 ans, cette décomposition s’est manifestée par toutes sortes de calamités meurtrières : la multiplication des massacres y compris en Europe avec la guerre dans l’ex Yougoslavie, le développement des attentats terroristes aussi en Europe, les vagues de réfugiés (hommes, femmes et enfants) qui cherchent désespérément un asile dans les pays de l’espace Schengen, les catastrophes dites naturelles à répétition, les catastrophes nucléaires comme celles de Tchernobyl en 1986 en Russie et celle de Fukushima en 2011 au Japon. Et plus récemment, la catastrophe qui a complètement détruit le port de Beyrouth au Liban, le 4 août 2020. Et la liste est longue.
Maintenant, nous avons une catastrophe sanitaire mondiale qui n’épargne plus aucun pays, aucun continent avec une hécatombe effarante. Face à la saturation des morgues pendant la première vague de la pandémie, certains États d’Europe, comme l’Espagne, ont même dû entasser des cadavres dans les patinoires !
La bourgeoisie doit imposer partout des mesures moyenâgeuses avec les confinements, les couvre-feux, la distanciation sociale. Tous les visages humains doivent être masqués avec des contrôles policiers à chaque coin de rue. Les frontières sont verrouillées, tous les lieux publics et culturels sont fermés dans la plupart des pays d’Europe. Jamais l’humanité, depuis la Seconde Guerre mondiale, n’avait vécu une telle épreuve. La pandémie de Covid-19 est donc bien aujourd’hui la principale manifestation de l’accélération de la décomposition du capitalisme.
C’est encore cette décomposition qui explique la montée des idéologies les plus irrationnelles, réactionnaires et obscurantistes. La montée du fanatisme religieux a provoqué la création de l’État islamiste avec de plus en plus de jeunes kamikazes embrigadés dans la “Guerre sainte” au nom d’Allah. La barbarie des attentats terroristes frappe régulièrement les populations en Europe, et notamment en France.
Toutes ces idéologies réactionnaires ont été aussi le fumier qui a permis le développement de la xénophobie et du populisme dans les pays centraux et surtout aux États-Unis.
L’arrivée de Trump au pouvoir, puis le refus d’admettre sa défaite électorale aux dernières présidentielles, a provoqué une explosion effarante du populisme. À Washington, ses troupes de choc avec leurs commandos, leurs milices armées complètement fanatisées, ont pris d’assaut le Capitole le 6 janvier dernier, sans que les forces de sécurité, censées protéger ce bâtiment, n’aient pu les en empêcher. Cette attaque ahurissante contre le temple de la démocratie américaine a donné au monde entier une image désastreuse de la première puissance mondiale. Le pays de la Démocratie et de Liberté est apparu comme une vulgaire république bananière du Tiers-Monde (comme le reconnaissait l’ex-président George Bush lui-même) avec le risque d’affrontements armés dans la population civile.
La montée de la violence sociale, de la criminalité, la fragmentation de la société américaine, les violences racistes contre les noirs, tout cela montre que les États-Unis sont devenus un concentré et le miroir du pourrissement de la société bourgeoise.
Même si le nouveau Président, Joe Biden, va essayer de contenir autant que possible la gangrène du populisme (avec l’ambition de “réconcilier le peuple américain”, comme il dit), il ne pourra pas stopper la dynamique générale de la décomposition. Il va faire tout ce qu’il peut pour réparer les dégâts considérables provoqués par Trump dans la gestion de la crise sanitaire. Mais le chaos est tel que la pandémie va continuer à faire encore des ravages et de nombreuses victimes. Et cela malgré la découverte des vaccins qui ne permettent pas aujourd’hui, et pour de nombreux mois encore, d’immuniser toute la population. L’OMS a d’ailleurs annoncé qu’il n’y aura pas d’immunité collective en 2021.
L’accumulation de toutes ces manifestations de la décomposition, à l’échelle mondiale et sur tous les plans de la société, montre que le capitalisme est bien entré, depuis trente ans, dans une nouvelle période historique : la phase ultime de sa décadence, celle de la décomposition. Toute la société tend à se disloquer dans un déchaînement de violence inouïe. Le système capitaliste devient complètement fou. Partout il sème la mort et la désolation. Entraîné dans une spirale infernale, il exhale une atmosphère sociale de plus en plus irrespirable et nauséabonde.
Cette situation de chaos généralisé donne une vision apocalyptique du monde.
Mais l’avenir est-il complètement bouché ? Notre réponse est : NON !
Au fond du gouffre de la décomposition, il existe une force sociale capable de renverser le capitalisme pour construire un monde nouveau, une véritable société humaine unifiée. Cette force sociale, c’est la classe ouvrière. C’est elle qui produit l’essentiel des richesses du monde. Mais c’est elle aussi qui est la principale victime de toutes les catastrophes engendrées par le capitalisme. C’est elle qui va encore faire les frais de l’aggravation de la crise économique mondiale.
La crise sanitaire ne peut qu’aggraver encore plus la crise économique. Et on le voit déjà avec les faillites d’entreprises, les charrettes de licenciements depuis le début de cette pandémie.
Face à l’aggravation de la misère, à la dégradation de toutes ses conditions de vie dans tous les pays, la classe ouvrière n’aura pas d’autre choix que de lutter contre les attaques de la bourgeoisie. Même si, aujourd’hui, elle subit le choc de cette pandémie, même si la décomposition sociale rend beaucoup plus difficile le développement de ses luttes, elle n’aura pas d’autre choix que de se battre pour survivre. Avec l’explosion du chômage dans les pays les plus développés, lutter ou crever, voilà la seule alternative qui va se poser aux masses croissantes de prolétaires et aux jeunes générations !
C’est dans ses combats futurs, sur son propre terrain de classe et au milieu des miasmes de la décomposition sociale, que le prolétariat va devoir se frayer un chemin, pour retrouver et affirmer sa perspective révolutionnaire.
Malgré toutes les souffrances qu’elle engendre, la crise économique reste, aujourd’hui encore, la meilleure alliée du prolétariat. Il ne faut donc pas voir dans la misère que la misère, mais aussi les conditions du dépassement de cette misère. L’avenir de l’humanité appartient toujours à la classe exploitée.
CCI, 29 janvier 2021
Vie du CCI:
- Réunions publiques [219]
Rubrique:
Le capitalisme britannique mis à terre à la fois par le Covid et le Brexit
- 41 lectures
Il y a plus de cent millions de cas de Covid-19 de par le monde, avec un nombre de décès d’au moins deux millions, qui continue d’augmenter. C’est l’impact de la pandémie au niveau humain, avec des hôpitaux débordés, des vies en suspens pendant le confinement, des personnes isolées et une plus grande pauvreté, une situation incertaine avec l’imprévisibilité et l’incompétence des politiques de nombreux gouvernements et malgré l’arrivée des vaccins.
Pour le capitalisme, l’effet de la crise sanitaire est fortement ressenti au niveau économique. Le FMI a estimé que l’économie mondiale s’est contractée de 4,4 % en 2020, et que ce déclin était le pire depuis la Grande Dépression des années 1930. Bien que ce soit un coup dur pour le capitalisme au niveau international, il a eu également un effet massif sur la classe ouvrière. L’Organisation Internationale du Travail (OIT) estime que les travailleurs du monde entier ont perdu jusqu’à 2700 milliards de livres sterling de revenus.
Si tous les grands pays ont été touchés, la crise n’a pas eu un impact uniforme. Le Royaume-Uni, par exemple, avec plus de 100 000 décès, a l’un des taux de mortalité par le coronavirus, les plus élevés du monde. En outre, tout au long de l’année 2020, l’ombre du Brexit a plané sur l’économie, les négociations se poursuivant pendant des mois jusqu’à ce que la bourgeoisie brise enfin les “chaînes” de l’UE au début de l’année 2021. La combinaison de la pandémie et du Brexit frappe un pays qui a déjà connu l’une des plus faibles reprises après la crise financière de 2008.
Récession, déficit et chômage
Mesurée par les fluctuations du PIB, l’économie britannique est probablement déjà entrée en récession, la première fois depuis les années 1970. Au deuxième trimestre de l’exercice en cours, le PIB a chuté de 19 %, la plus forte chute de son histoire. Même après quelques mois de croissance, on estime actuellement que l’économie est toujours inférieure de 8,5 %, à son niveau d’avant la pandémie. Le FMI estime à 10 % la contraction de l’économie britannique pour l’année dernière, soit la plus forte baisse de tous les pays du G7. Quels que soient es chiffres, l’économie n’a d’ores et déjà jamais connu une telle situation depuis le Grand Hiver de 1709, quand le PIB britannique avait chuté de 13 % (et il avait mis plus de 10 ans à se redresser).
Quant à la dette publique, les chiffres de l’Office des Statistiques Nationales (ONS) montrent que les emprunts du gouvernement britannique ont été les plus élevés jamais enregistrés en décembre, les dépenses ayant augmenté en raison du coronavirus et de la baisse des recettes fiscales. “Les emprunts ont atteint 34,1 milliards de livres sterling le mois dernier, soit environ 28 milliards de plus que le même mois de l’année précédente. Cette augmentation a porté le déficit budgétaire du gouvernement…à près de 271 milliards de livres pour les premiers mois de l’exercice financier, soit une hausse de plus de 212 milliards de livres par rapport à la même période l’année dernière. L’Office for Budget Responsibility… a estimé que les emprunts atteindraient 394 milliards de livres sterling d’ici la fin de l’exercice financier en mars, ce qui constituerait le déficit le plus élevé de l’Histoire en temps de paix… L’emprunt de décembre a fait passer la dette nationale – la somme totale de tous les déficits – à 2,1x1018 £ à la fin du mois de décembre, soit environ 99,4 %du PIB, le taux d’endettement le plus élevé depuis 1962”. (The Guardian 22/01 /21).
En 2019, le FMI avait déjà souligné que le niveau d’endettement des entreprises au Royaume Uni était si élevé que près de 40 % d’entre elles ne seraient pas en mesure de survivre en cas de récession deux fois moins profonde que celle de 2007-2008. Au cours de cette crise du Covid-19, l’hôtellerie a été particulièrement touchée et des avertissements ont été lancés sur le risque que des dizaines de milliers de pubs, restaurants, bars et hôtels disparaissent. En plus des autorisations d’ouverture, le gouvernement a adopté différentes mesures et mis en œuvre des solutions pour maintenir les entreprises à flot. Comme pour toute autre mesure capitaliste d’État (généralement soutenue par la gauche et les gauchistes), tôt ou tard, quelqu’un devra payer, c’est-à-dire la classe ouvrière en premier lieu. Si, par exemple, les plans de sauvetage Covid-19 sont liquidés, cela pourrait signifier que quelque 1,8 million d’entreprises au Royaume-Uni risquent de devenir insolvables, dont 336 000 risquent de faire faillite. Chaque fois que la permission d’ouvrir est supprimée, rien ne dit quelles industries seront capables de renaître.
Avant que le gouvernement ne fasse volte-face en décembre pour prolonger les vacances d’emplois, il y a eu un nombre record de licenciements, avec 370 000 personnes licenciées rien que pour la période août-octobre 2020. Les prévisions de centaines de milliers d’emplois menacés à la fin des vacances sont monnaie courante.
Depuis novembre 2020, le nombre de vacances d’emplois a doublé pour atteindre environ 5 millions. Ces 5 millions de personnes ne sont actuellement pas employées. Les prévisions pour la période suivant la fin du régime de chômage dû à la situation sanitaire sont que le chômage atteindra un pic de 7,5 % soit 2,6 millions de personnes. En février 2020, avant l’arrivée de la pandémie, le chiffre officiel du chômage était de 4 %. Selon ces chiffres officiels, la taux de chômage est passé à 5 % dans les trois mois précédant la fin novembre 2020, ce qui représente plus de 1,7 million de personnes – le plus haut niveau depuis août 2016. Mais les chiffres réels du chômage sont bien plus élevés que les chiffres officiels. On estime qu’au moins 300 000 personnes n’apparaissent pas dans les chiffres du chômage (leur existence étant attestée par d’autres indicateurs) et beaucoup ont renoncé à se déclarer au chômage par découragement. Parmi ceux qui ne bénéficient pas du régime de congé dû à la pandémie, des millions ont du mal à joindre les deux bouts, même avec les aides du Crédit Universel. Ainsi, lorsqu’on lit que le chômage a atteint son niveau le plus haut depuis plus de quatre ans au Royaume-Uni, on sait que le chiffre réel est beaucoup plus élevé.
Le Brexit signifie plus de taxes et des obstacles au commerce
Avant même que l’accord final ne soit conclu entre la Grande-Bretagne et l’UE en décembre 2020, les milliers de camions bloqués dans le Kent donnaient un avant-goût éloquent du fait que le Brexit ne serait pas synonyme d’échanges faciles. Au début de l’année 2021, les entreprises signalaient des retards dans les livraisons et les clients se plaignaient de droits de douane supplémentaires, de la TVA et d’autres frais supplémentaires sur les articles achetés dans l’UE. Il aurait pu y avoir un accord de non tarification avec l’UE, mais il existe des obstacles non tarifaires importants au commerce avec l’UE. Le chef des libéraux-démocrates a déclaré : “c’est le seul accord commercial de l’histoire qui érige des barrières commerciales au lieu de les supprimer ; il laisse à la Grande-Bretagne une frontière commerciale à la fois dans la Mer du Nord, la Manche et la Mer d’Irlande ; il signifie la fin des échanges commerciaux sans heurts avec l’UE et nécessite beaucoup de paperasse et de bureaucratie ainsi que de nombreuses commissions mixtes pour superviser son fonctionnement”. Lorsque l’accord a été conclu, il n’y avait pratiquement pas de mesures convenues pour simplifier les vérifications et contrôles douaniers.
En outre, l’accord ne couvre pas les services, qui représentent 80 % de l’économie britannique, dont 12 % sont destinés à l’UE. Tout ce que nous savons, c’est que les négociations vont se poursuivre. Cela montre que la célébration par le gouvernement d’un “grand” accord est une illusion : aucun des problèmes en suspens ne sera géré facilement et résolu à court terme.
Selon l’agence Moody (l’agence de notation du crédit), l’accord passé à la veille de Noël est biaisé en faveur de l’UE.
Selon les estimations du gouvernement britannique, grâce à l’accord conclu entre l’UE et le Royaume-Uni, la production ne sera inférieure que de 5 % dans 15 ans. Les économistes de Citigroup pensent cependant que l’économie britannique produira 2 à 2,5 % de moins en 2021 que si elle était restée dans l’UE et si elle avait renforcé ses liens avec celle-ci. Globalement, ils s’attendent à ce que le Royaume-Uni soit au moins en meilleure position qu’il ne l’aurait été en cas de Brexit “dur”, dans lequel le Royaume-Uni et l’UE auraient utilisé les règles de l’OMC pour le commerce. L’Organisation de Coopération et de Développement Économique (OCDE) a, quant à elle, présenté des perspectives plus pessimistes. Elle prévoit que l’économie britannique connaîtra une croissance de 3,5 % inférieure à ce qu’elle aurait connu si elle était restée dans l’UE.
Les plus optimistes sont d’accord sur un point : l’économie britannique commencera à se redresser quand les vaccins seront disponibles en abondance. Mais avec un commerce qui coûte plus cher et qui est noyé par la “paperasserie” et une immigration en baisse, l’impact du Brexit aura des effets profonds et prolongés, et révélera toute la faiblesse du capitalisme britannique. Nicolas Bloom, un économiste de Stanford, a déclaré : “le Brexit c’est comme être tué par mille coups de couteau”. En comparaison, “le Covid, c’est comme être frappé trois fois par une batte de base-ball. Si on raisonne à long terme, le Brexit est bien pire que le Covid”.
Les conséquences économiques de la pandémie sont considérables, mais les effets négatifs du Brexit se poursuivront encore plus longtemps. Ensemble, ils posent d’énormes problèmes à la bourgeoisie et à la classe ouvrière. Les deux sont le produit de la période de décomposition, ce qui n’est un facteur positif pour aucune des deux classes. Pour l’avenir, nous pouvons nous attendre à ce que la classe dominante s’attaque davantage aux conditions de vie de la classe exploitée. La seule perspective pour la classe ouvrière est : répondre par une lutte unifiée, consciente, basée sur des exigences défensives immédiates, mais ouvrant une perspective au-delà de celles-ci.
Car, 28 janvier 2021
Géographique:
- Grande-Bretagne [47]
Récent et en cours:
- Coronavirus [55]
- COVID-19 [56]
Rubrique:
Grève des ouvriers de l’agro-industrie au Pérou
- 39 lectures
Cet article a comme objectif de faire connaître les positions de la Gauche communiste sur la récente grève des travailleurs agricoles, qui, selon nous, se situe sur le terrain de classe du prolétariat alors qu’elle se produit dans le contexte des manifestations citoyennes médiatisées par la bourgeoisie en défense de la démocratie bourgeoise et de l’ordre constitutionnel.1 Les travailleurs, de leur côté, se sont mobilisés pour la défense de leurs conditions de vie, contre les bas salaires et les conditions de travail précaires qu’ils subissent.
Les conditions de vie des travailleurs du secteur agro-industriel
Suite à la réforme agraire mise en œuvre par le gouvernement militaire à la fin des années 19602, nous assistons depuis le milieu des années 1990 à un processus de reconcentration des terres en une série de groupes industriels bourgeois, au commerce lucratif, de l’agro-alimentaire (exportation de fruits et légumes vers les marchés nord-américains et européens. Les principales entreprises sont localisées au nord (La Libertad, Lambayeque, Ancash) et au sud de Lima (Ica). Actuellement, ces capitalistes agraires sont propriétaires de quasi un demi-million d’hectares et des ressources en eau de ces régions, profitant de surcroît de subventions et d’allégements fiscaux octroyés par les différents gouvernements qui se sont succédés. L’agro-industrie péruvienne est devenue « l’enfant gâté » au sein de cette “vitrine” de l’économie nationale (rôle traditionnellement tenu par l’industrie minière) et c’est celui qui aujourd’hui, génère les plus importants profits et jouit d’abondantes subventions financières et de juteux allègements fiscaux de la part de lÉtat.
Les ouvriers qui travaillent dans ces fabriques et sur ces terres proviennent de l’immigration et des villages qui entourent les propriétés et, à mesure que le secteur prospérait, le recrutement de « main d’œuvre » a augmenté. Il y a eu tellement d’ouvriers recrutés que la bourgeoisie parlait d’Ica comme d’une « région modèle de plein emploi », une sorte de paradis économique, digne d’être imité dans le reste du pays. Cependant, la propagande d’État et les capitalistes agro-industriels cachaient les conditions scandaleuses d’exploitation des ouvriers agraires. Salaires misérables de 39 soles (un peu moins de 9 euros), voire moins, par jour ; pas de CTS3 ni de gratifications ; pression et chantage pour augmenter la productivité et les quotas de production. Les longues journées commencent à 3 heures du matin jusqu’à la tombée de la nuit sous un soleil brûlant, les tâches et les postures sont néfastes pour la santé et il faut de plus supporter les cris et les mauvais traitements des contremaîtres qui obligent les ouvriers à travailler en silence, leur interdisant toute forme d’aide ou de solidarité entre eux. Le besoin de main d’œuvre a même amené les capitalistes à recruter des enfants pour la récolte. Bien évidemment, tout cela accompagné de la menace permanente de licenciement ou le non paiement de la journée de travail à la moindre réclamation contre ces misérables conditions de travail.
Le chômage de ce secteur dans la conjoncture politique péruvienne actuelle
Depuis la vacance du pouvoir occasionnée par le départ de Pedro Pablo Kuczynski à la fin de 2017 jusqu’à aujourd’hui, 4 présidents ont été nommés par le Congrès. L’avant-dernier est seulement resté une semaine au pouvoir. De plus, l’actuel « gouvernement de transition » qui ne compte même pas un mois d’exercice a déjà vu passer trois ministres de l’Intérieur. Les faits de corruption qui ne font que croître, tout comme un cancer qui ronge les institutions bourgeoises, et que “dénoncent” tant les médias, ne sont rien de plus qu’une des expressions signifiatives de la phase historique de décomposition du système capitaliste4 [3]. Alors que tout cela se produit, les profits des grands capitaux péruviens augmentent, atteignant des niveaux qui font que leurs potentats ne se plaignent en rien de la pandémie.
La prolongation de cette situation dans le temps, à laquelle s’ajoutent l’impact économique et social de la pandémie, l’incapacité de développer une stratégie sanitaire capable de freiner la vague de contaminations et finalement, les manœuvres des factions bourgeoises qui s’affrontent au Congrès et se sont achevées avec le départ de l’ex-président Martin Vizcarra ont été la goutte d’eau qui a fait déborder le vase. L’explosion de l’indignation sociale a conduit aux événements du 14 janvier avec la mort de deux jeunes, ce qui a augmenté la pression sur la direction gouvernementale qui n’aurait pas hésité à poursuivre les assassinats, si cela avait été nécessaire. Dans cette ambiance de protestation et de revendications, s’ajoute le poids du chômage dans l’agricuture. Tout porte à croire que ce moment fut mis à profit pour soulever les problèmes qui probablement couvaient dans ce secteur de la production. De plus, il faut noter que, malgré le fait que le système capitaliste est en train de sombrer dans la crise économique et que la bourgeoisie péruvienne n’échappe pas à ses effets, celle-ci a pu, pour le moment, maintenir un certain contrôle sur la situation sociale. Il est certain que l’une des tendances dominantes du capitalisme en décomposition est que la bourgeoisie perd le contrôle sur ses forces politiques, comme nous l’avons expliqué au début de ce paragraphe ; néanmoins, la bourgeoisie péruvienne] a compris rapidement que la situation pourrait prendre une autre tournure que celle observée dans d’autres pays comme le Chili5 par exemple. L’attitude obstinée, prédominante jusqu’au bref gouvernement de Merino, a fait place à une position plus “conciliante”, plus « à l’écoute des demandes du peuple ». Au lieu d’envisager le projet d’une nouvelle Constitution ou sa réforme comme palliatif immédiat, se profile l’idée qu’il faudra attendre pour mener le « gouvernement de transition » jusqu’au terme des élections de l’année prochaine. Pour le moment, le gouvernement actuel véhicule le mensonge que les revendications des travailleurs seront écoutées, que les injustices commises les plus flagrantes seront corrigées. Il est évoqué l’éventuelle abrogation de la Loi de Promotion Agraire pour éviter, de surcroît, que les conflits sociaux soient menés par les travailleurs eux-mêmes, l’approbation par le parlement de la restitution de l’argent à ceux qui côtisent au système de pensions (ONP), le vote de la loi d’officialisation des taxis colllectifs tout comme celui de l’abrogation de l’immunité parlementaire, option politique bourgeoise qui a surgi bien avant l’arrivée de la pandémie. A cela s’ajoutent d’autres faits comme la réforme de la police nationale et la retraite opérée par le haut commandement de la police. Cela semble indiquer que la fraction bourgeoise qui est actuellement à la tête de l’État et quelques partis au parlement, font front commun dans une stratégie aux relents populistes, de manière à assurer une stabilisation de la situation et à récupérer des sièges dans les élections de l’année prochaine. Pour résumer, cela indique que les factions bourgeoises sont capables de mettre momentanément de côté leurs différends et d’agir de manière coordonnée lorsque les travailleurs entrent en scène et lorsque ses avantages et ses profits se voient menacés. Cela montre également que l’arsenal idéologique et les tromperies ne sont pas épuisés et que les ouvriers ne doivent pas tomber dans leurs pièges ni croire en leurs promesses. Bien que la bourgeoisie ait réussi à suivre le sens du vent, nous devons êtres conscients qu’au final, elle ne sera pas capable de répondre aux graves problèmes sociaux et elle ne renoncera pas non plus à exploiter le prolétariat. Elle ne sera pas non plus en mesure d’éviter les confrontations en son sein, chaque faction continuera de défendre bec et ongles sa part de pouvoir. Seule une action prolétarienne unie et organisée, mettant en pratique les méthodes de lutte inhérentes au mouvement ouvrier, permettra de mettre un terme au cauchemar du capitalisme en décomposition.
La grève ouvrière s’est située pleinement sur un terrain de classe
Nous affirmons que, à la différence des mobilisations citoyennes à Lima, cette grève des ouvriers des entreprises agro-industrielles a affiché un net caractère de classe. Le prolétariat a démontré sa force et sa capacité lorsqu’il assume directement sa lutte contre l’exploitation. Les ouvrières et ouvriers d’Ica ont commencé à protester contre leurs très pénibles et insupportables conditions de travail et tout en cessant l’activité, ils allaient bloquer l’autoroute Panamércaine pour se faire entendre.
Les forces du mouvement :
– La grève est la principale arme de lutte des travailleurs. C’est ce qu’ont compris les ouvriers des diverses entreprises du secteur qui ont à la fois paralysé la production en se mobilisant massivement et sont sortis de l’enfermement dans leur entreprise pour manifester dans les rues.
Les ouvriers et ouvrières ont également dirigé directement et sans intermédiaires la lutte, celle-ci prenant des formes diverses d’auto-organisation comme organiser des piquets de grève ou des soupes populaires. A Ica, l’inexistence de syndicats a empêché tout type de manœuvre ou de subordination des grévistes au sabotage et au boycott de la lutte, propres au syndicalisme.
– Une claire identité de classe s’est manifestée ainsi que des appels à ce que d’autres travailleurs se solidarisent et se joignent à la lutte. On a pu entendre des phrases comme : “Nous autres, les ouvriers, produisons les richesses pour qu’ils en profitent”; ou “à bas l’exploitation”, “augmentation des salaires”, etc. Tout cela marque une nette différence, par exemple, avec les mobilisations citoyennes à Lima, deux semaines auparavant. Toutes les revendications et pancartes des travailleurs agitaient des consignes dirigées CONTRE L’EXPLOITATION CAPITALISTE. Aucun appel propre à la litanie démocratique comme réclamer une “Nouvelle constitution”, invoquer les “droits du peuple” ou la “défense de la patrie” ne s’est fait entendre durant les cinq jours de cette lutte ouvrière.
Et malgré la brièveté de la grève, les ouvriers d’Ica ont été soutenus par la solidarité de leurs frères de classe des vallées de Moche et Viru au Nord, lesquels, à leur tour ont déclenché une grève dans leur région qui s’est soldée par l’assassinat d’un ouvrier par les hordes policières.
Les faiblesses du mouvement :
– Malgré le fort instinct de classe qui a marqué la grève, les faiblesses dont souffre actuellement le prolétariat mondial se sont manifestées également dans cette lutte. Par exemple, l’illusion légaliste et démocratique de croire que l’abrogation de la Loi de Promotion Agraire constituerait une “victoire” quand en réalité, un changement de loi ne changera jamais la situation objective de l’exploitation dont la racine est la division en classes, l’exploitation salariée, l’État bourgeois, le capitalisme. Rien de cela n’a été perçu. La grève n’a pas réussi à dépasser un stade revendicatif, nécessaire certes, mais pas suffisant pour avancer vers la solution des graves problèmes qui affectent l’ensemble du prolétariat mondial et toute l’humanité opprimée.
– Il y a eu quelques manifestations du poids du nationalisme comme l’apparition de quelques drapeaux péruviens sur les barricades mais cela était peu de choses en comparaison de l’orgie patriotique exhibée par les manifestants des marches citoyennes à Lima. En résumé, bien que ces manifestations du secteur agraire partagent un contexte politique et social marqué par les conflits entre factions bourgeoises ainsi que l’impact économique et social de la pandémie, elles se différencient de celles qui ont eu lieu autour du 14 novembre. En ce sens, elles n’ont rien à voir avec la protestation stérile et impuissante du mouvement citoyen, avec le ressentiment des secteurs de la petite-bourgeoisie qui se sentent frustrés et menacés par la crise, qui se voient s’approcher toujours plus de la pauvreté qui frappe les autres couches exploitées et qui placent leurs espoirs sur une impossible “régénération morale” de l’élite politique pourrie. La lutte du prolétariat ne ressemble en rien aux pleurnicheries de toute cette bande de journalistes, intellectuels et politiciens demandant des institutions “fortes” pour “qu’elles remettent de l’ordre” et qu’elles répriment toute manifestation de protestation ou d’indignation de la population dans le feu et le sang. Elle ne ressemble pas non plus aux actions désespérées et stériles du terrorisme ou du putschisme, fruits de prédilection du volontarisme fanatique des idéologies petite-bourgeoises qui souhaitent également imposer leurs propres intérêts et assumer le pouvoir d’État afin de perpétuer l’exploitation des travailleurs. Au fond, l’objectif final du prolétariat est de détruire le système capitaliste avec toutes ses institutions et non de remplacer un bourreau par un autre, une gestion par une autre, ce qui laisserait intacte la machine qui perpétue la misère sociale et qui menace la survie même de l’humanité.
La répression de l’État ne s’est pas faite attendre.
Au moment où nous terminons cet article, les travailleurs agraires sont revenus à la charge, cette fois-ci pour réclamer le rejet par le parlement d’un texte qui légifère un nouveau Code du travail. De nouvelles actions visant à bloquer l’autoroute Panaméricaine sud durant la journée se sont développées, car ce qui avait été demandé n’a pas été satisfait, c’est-à-dire une rémunération basée sur une augmentation de 45 % du salaire mensuel, ce qui signifie 73 soles par journée de travail hors gratifications et CTS. Ce piège de la mobilisation sur le terrain de la défense de la légalité est mis en avant par la bourgeoisie, qui permet d’écarter le danger en enfermant la lutte dans un labyrinthe bureaucratique jusqu’à l’épuiser, de démoraliser les travailleurs et de leur ôter toute initiative, est une manœuvre bien connue, avec le concours et la participation active des syndicats.
S’il y a bien eu une expression d’auto-organisation, il y a eu des faiblesses. On note une grande détermination à lutter mais il n’y a pas eu d’assemblées générales et/ou de comité de grève qui centralise la lutte. La négociation a été confiée à des “dirigeants” et les ouvriers en ont passivement attendu 15 jours le “résultat”.
Lorsqu’ils ont vu que le parlement n’approuvait pas leur demande d’augmentation des salaires, les ouvriers ont immédiatement affirmé qu’on était en train de les duper et ils ont repris la grève.
Désormais, les travailleurs demandent également la destitution de l’actuel président et l’affrontement a laissé jusque maintenant 26 policiers blessés ; de plus, le Ministère de l’Intérieur a demandé aux manifestants de cesser le blocage de l’autoroute et des voix s’élèvent pour demander une plus grande fermeté. Dans un acte de provocation, des infiltrés dans la manifestation ont brûlé une ambulance, ce qui fait partie de la stratégie appuyée par les médias, de faire naître au sein de la population une réaction qui condamne le mouvement. Finalement, le gouvernement de Sagasti a déchaîné une brutale répression contre les travailleurs, asphyxiant avec des gaz lacrymogène les communautés voisines de la manifestation, causant des blessés, utilisant des hélicoptères et des chars de combat pour appuyer un énorme contingent de forces policières et militaires qui n’ont pas hésité à déchaîner leur furie contre une population sans défense, affirmant que les manifestations ont été fomentées et orchestrées par des “vandales” qui veulent s’en prendre aux véhicules et en même temps aux propriétés des grands entrepreneurs. Les entreprises agricoles ont suspendu leurs opérations, demandant le “rétablissement de l’ordre public, la sécurité et la libre-circulation” dans La Libertad et à Ica, signalant que l’arrêt de la production se maintiendra “jusqu’à ce que soit rétabli l’État de droit”. Ces actions sont destinées, en premier lieu, à créer une image de la protestation qui soit chaotique, désastreuse et dénuée de sens, de façon à la diaboliser et en plus à diviser les ouvriers entre eux en utilisant le chantage que la paralysie des activités signifiera une perte de revenus et d’emplois pour environ 100 000 travailleurs. Sans pour autant s’arrêter là, les grandes entreprises tentent de détourner tout le ressentiment qu’éprouvent les ouvriers vis-à-vis de leur exploitation vers des entreprises de taille plus modeste en disant que “beaucoup de travailleurs agricoles ont vu leurs droits violés durant de nombreuses années à cause de chefs d’entreprises malhonnêtes”6, tentant de dissimuler leur responsabilité directe dans la précarisation des conditions salariales et d’existence des ouvriers ; cela en plus de leur hypocrisie manifeste, vu qu’ils passent sous silence la réduction des coûts de production à travers le recours à ces petites entreprises intermédiaires.
Il faut souligner que l’un des aspects centraux de la stratégie de la bourgeoisie est de maintenir les travailleurs empêtrés dans le fétichisme démocratique7, dans la vision erronée qui considère l’État non pas comme l’appareil de domination des capitalistes sur la classe laborieuse mais comme une sorte d’arbitre, de pouvoir neutre au-dessus des classes qui pourrait, en faisant pression sur lui, intervenir en leur faveur en promulguant des lois qui reconnaitraient le bien-fondé des améliorations des conditions de travail et des augmentations salariales. Cette vision est bien entendue alimentée par toutes les organisations de la gauche du capital comme les Fédérations et syndicats agraires, les ONG comme CONVEAGRO, la CGTP, les députés de gauche et quelques dirigeants des ouvriers en lutte qui, en véritables pompiers, négocient avec les patrons et le Ministère du Travail ; négociations dans lesquelles tous sont d’accord pour épargner au maximum les profits de la bourgeoisie agro-industrielle, limitant le salaire à 54 soles, ce qui a eu pour conséquence que les ouvriers indignés sortent de nouveau de leur usine pour reprendre la lutte comme à Ica et dans les vallées du nord. Les ouvriers ont compris que, dans la négociation avec les hautes sphères, on mijote de nouvelles escroqueries à leur encontre, qu’on est en train de les berner, sans comprendre que ces groupuscules qui négocient en leur nom font aussi partie de la classe exploiteuse.
Bien que les travailleurs ne puissent renoncer aux luttes revendicatives, moments qui peuvent être mis à profit pour débattre et tirer des leçons, ils doivent comprendre que rester sur ce terrain est un piège qui mènera toujours à une impasse s’ils ne sortent pas du domaine légal et du respect de la Constitution. La véritable libération des travailleurs viendra lorsqu’ils feront voler en éclats l’ordre bourgeois avec ses lois, ses constitutions et ses syndicats, projetant ainsi une véritable transformation qui libère également l’humanité de ce système social en putréfaction.
Internacionalismo, section au Pérou du Courant Communiste International, 24/12/2020
1Voir sur notre site en Espagne : “Peru : frente a la crisis politica de la burgusia, autonomia et internacionalismo proletario” [220], ICCOnline, noviembre 2020.
2Gouvernement du général Velasco Alvarado (1968-75) qui s’est présenté comme un « gouvernement du peuple » avec une forte démagogie nationaliste et populiste.
3CTS : la Compensation pour Temps de Service, est une indemnisation pour licenciement ou fin de contrat de travail. Le montant est misérable.
4“Ainsi la phase décomposition de la société capitaliste ne se présente pas seulement comme celle faisant suite aux phases caractérisées par le capitalisme d’Etat et la crise permanente
Dans la mesure où les contradictions et manifestations de la décadence du capitalisme qui, successivement, marquent les différents moments de cette décadence, ne disparaissent pas avec le temps, mais se maintiennent, et même s’approfondissent, la phase de décomposition apparaît comme celle résultant de l’accumulation de toutes ces caractéristiques d’un système moribond, celle-ci parachève et chapeaute trois quarts de siècle d’agonie d’un mode de production condamné par l’histoire […] Les manifestations de l’absence totale de perspectives de la société actuelle sont encore plus évidentes sur le plan politique et idéologique. Ainsi : l’incroyable corruption qui croît et prospère dans l’appareil politique, le déferlement de scandales dans la plupart des pays tels le Japon (où il devient de plus en plus difficile de distinguer l’appareil gouvernemental du milieu des gangsters […]”. “Thèses sur la décomposition”, Revue internationale n°107 [10].
5Voir la série d’articles sur les événements au Chili : “El dilema no es dictadura – democracia sino barbarie capitalista o lucha de clases proletaria” [221]
6“Firmas agrícolas suspenden operaciones para evitar violencia contra sus instalaciones” [222], site du journal El commercio, (23 décembre 2020).
7“Cette vision idyllique et naïve de la “démocratie” est un mythe. La « démocratie est le paravent idéologique qui sert à masquer la dictature du Capital dans ses pôles les plus développpés. Il n’y a pas de différence fondamentale de nature entre les divers modèles que la propagande capitaliste oppose les uns aux autres pour les besoins de ses campagnes idéologiques de mystification. Tous les systèmes soi-disant différents par leur nature, qui ont servi de faire-valoir à la propagande démocratique depuis le début du siècle sont des expressions de la dictature de la bourgeoisie, du capitalisme. La forme, l’apparence peuvent varier, pas le fond. […]Dans sa forme la plus sophistiquée de la dictature du capital qu’est la “démocratie”, le capitalisme d’État doit parvenir à la gageure de faire croire que règne la plus grande liberté. Pour cela, à la coercition brutale, à la répression féroce doit le plus souvent, lorsque c’est possible, se substituer la manipulation en douceur qui permet d’aboutir au même résultat sans que la victime s’en aperçoive ». “Comment est organisée la bourgeoisie ? Le mensonge de l’Etat “démocratique” [223], Revue internationale n°76.
Géographique:
- Pérou [224]
Rubrique:
Les dérives du PCI dans le mouvement contre la réforme des retraites (Partie 2)
- 87 lectures
Après avoir exposé nos critiques sur le contenu de l’intervention du PCI (qui publie le journal Le Prolétaire en France) suite au mouvement de lutte contre la réforme des retraites, nous proposons dans ce second article de poursuivre la polémique en revenant sur le cœur de ce qui fait nos divergences sur le sujet.
Dans notre précédent article (1), nous avons souligné et critiqué une approche que nous avions jugée opportuniste de la part du PCI lors de son intervention dans le mouvement contre la réforme des retraites. Le PCI, en effet, même s’il se situe dans le camp prolétarien, n’a pas été en mesure de défendre l’autonomie du combat de la classe ouvrière. Selon nous, il est nécessaire de revenir sur ses approches, sur les fondements théoriques de notions essentielles (notamment l’analyse du rapport de force entre les classes et la question de la conscience de classe) pour clarifier la méthode avec laquelle nous devons défendre l’autonomie de la lutte du prolétariat.
Où en est la classe ouvrière ?
La perception qu’a le PCI de la dynamique de la lutte de classe aujourd’hui, peut être exposée à l’aune de ce qu’il a écrit ces dernières décennies. Selon les camarades, le fait qu’il n’y a pas eu de vague révolutionnaire après la Seconde Guerre mondiale fait que la classe ouvrière aurait été entièrement “dominée par le réformisme”. Ainsi, pour le PCI “la situation du prolétariat aujourd’hui, en particulier dans les pays capitalistes les plus développés, reste encore une situation de paralysie de ses grandes masses, encore sous l’emprise du réformisme et du collaborationnisme interclassiste”. (2) Si les camarades reconnaissent que des grèves et des luttes assez dures ont pu exister, comme en Mai 68, rien sur le fond ne permet à leurs yeux de souligner une différence fondamentale ou qualitative par rapport à la période qui a suivi la terrible défaite du prolétariat après la vague révolutionnaire des années 1920. (3) Autrement dit, et contrairement à l’analyse du CCI, Mai 68 ne marquerait nullement une modification dans le rapport de force entre les classes. A fortiori, les luttes du mouvement contre la réforme des retraites de l’hiver dernier en France, pas davantage. Rien n’aurait donc changé de manière significative à partir de 1968.
Or, les luttes de Mai 68 en France et celles qui ont immédiatement suivi de part le monde (Italie et Argentine en 1969, Pologne en 1970…), ont non seulement marqué le réveil international de la lutte d’un prolétariat qui n’était pas prêt à accepter l’austérité, mais également une forte dynamique de résistance face à la perspective, bien réelle durant la guerre froide, d’une nouvelle boucherie mondiale entre les blocs de l’Est et de l’Ouest, et d’un cataclysme nucléaire. Les camarades du PCI, évinçant le prolétariat en tant que sujet conscient de la scène durant toute cette période, n’y voient qu’une masse “réformiste”, sous le joug d’une sorte de “condominium russo-américain sur le monde”. (4)
La négation de l’expérience issue de tout un processus de luttes après 1968 ne pouvait qu’empêcher les camarades de saisir la dimension politique des vagues de luttes des années 1980. Durant cette période, le combat s’est accompagné d’une maturation de la conscience de la classe ouvrière, notamment par la confrontation croissante aux syndicats, aux forces de l’État cherchant par la propagande à encadrer et à soumettre idéologiquement les ouvriers.
Inversement, alors qu’avec l’effondrement du bloc de l’Est toute une offensive médiatique, un véritable bourrage de crâne sur la “victoire de la démocratie”, la “disparition de la classe ouvrière” et la prétendue “faillite du communisme” allait avoir un impact négatif puissant, provoquant un recul dans les luttes à l’aube des années 1990, le PCI notait que l’effondrement de l’URSS avait “retiré un obstacle de grande ampleur à la reconstitution du mouvement de classe prolétarien”. (5) Le CCI soulignait, au contraire (et les faits nous ont donné raison), que le prolétariat allait être exposé aux campagnes idéologiques les plus mensongères et les plus dangereuses, aux miasmes exhalés par l’entrée du capitalisme dans sa phase historique ultime de décomposition. Nous avions à cette époque défendu que le prolétariat allait subir un recul significatif de ses luttes. Les camarades du PCI ne signalaient par contre rien de nouveau, mis à part le caractère prétendument “positif” de l’effondrement de l’URSS !
Il n’est donc pas surprenant aujourd’hui de constater que les camarades ne perçoivent pas la signification politique du mouvement de la lutte, l’hiver dernier, contre la réforme des retraites en France. Après quasiment une décennie d’atonie au sein du prolétariat, les camarades notaient certes une lente reprise de la combativité, mais sans être en mesure de prendre en compte la signification du changement opéré, de même que ce qui s’était développé également entre temps depuis le mouvement de 2003 : une maturation souterraine de la conscience de classe qui, malgré un reflux de la lutte lié à la brusque irruption du Covid-19, n’en constitue pas moins une réelle expérience, une aspiration non brisée à plus de solidarité et, en ce sens, un jalon pour faire émerger les prémices d’une reconquête de l’identité de classe.
En fin de compte, si le PCI n’est pas en mesure de percevoir les évolutions plus ou moins en dents de scie du rapport de force entre les classes, ses facteurs subjectifs, c’est que pour lui : “on ne peut parler de lutte de classe au sens marxiste du terme, que quand existe le parti de classe, que lorsqu’il dirige effectivement la lutte d’une fraction au moins du prolétariat”. (6) Bien entendu, vu sous cet angle, toute évolution ne peut s’avérer qu’insignifiante et sans objet tant que n’existe pas le parti du prolétariat !
Que signifie l’autonomie de classe ?
Cela est d’autant plus évident que le PCI ne place la conscience ouvrière qu’exclusivement dans le Parti, totalement séparée de la classe elle-même : “Le parti de classe […] est l’incarnation de la conscience de classe du prolétariat : lui seul possède la théorie révolutionnaire, le programme communiste, c’est-à-dire la perspective de la lutte prolétarienne poussée jusqu’à son objectif final qui est la société communiste”. (7) La maturation de la conscience du prolétariat ne pourrait se réaliser autrement que par l’unique vecteur du Parti, elle ne “s’incarnerait” que dans la perspective d’adhésion au Parti détenteur d’une vérité programmatique immuable qui est ainsi transformé en une sorte de Messie porté par ses Saintes Écritures et ses Tables de la Loi. Pour le PCI, la classe ouvrière possèderait, en définitive, un simple “instinct” de classe lui permettant de lutter uniquement pour la défense de ses conditions de travail et d’existence mais elle serait incapable de dépasser par elle-même une vision purement trade-unioniste. Si tel était le cas, comment pourrait-elle à un moment donné reconnaître le rôle fondamental du “parti” ou plus généralement des organisations révolutionnaires pour la victoire de son combat révolutionnaire ? Par la parole révélée du parti frappant de plein fouet l’esprit de la classe peut-être ?… En réalité, toute réflexion réelle se développant au sein de la classe échappe à l’attention des camarades, soit parce qu’ils l’ignorent par principe, soit parce qu’ils en négligent la portée.
Le PCI affirme pourtant qu’une des tâches majeures des révolutionnaires consiste à “œuvrer en toutes circonstances pour l’indépendance de classe du prolétariat”. (8) Bien que nous partagions totalement cet objectif, nous pensons qu’il est nécessaire, pour le défendre, de partir de la dynamique réelle du combat de la classe ouvrière, en tenant compte justement du développement de sa conscience, de ses initiatives et des conditions historiques dans lesquelles elles s’expriment. Mais ce processus, comme nous l’avons vu, le PCI le nie au sein de la classe et ne le voit que dans le seul Parti !
Or, ce qu’a montré l’histoire du mouvement ouvrier, c’est que la classe ouvrière, comme le disait Trotsky, est capable de prendre en main elle-même “sa destinée” de manière consciente, tout comme Marx disait lui-même que le communisme ne peut être que “l’œuvre des travailleurs eux-mêmes”. Le prolétariat n’est pas un simple poids mort, à la remorque d’un Parti qui lui serait “extérieur” et qui serait “omniscient”, voire infaillible. L’histoire de la révolution russe, au moment même où le capitalisme entrait sa phase de déclin, a bien montré comment, par toute une maturation politique, le prolétariat pouvait se hisser lui-même à des sommets, en faisant surgir par son propre combat et sa réflexion politique les soviets (conseils ouvriers), la “forme enfin trouvée de la dictature du prolétariat”, comme l’écrivait Lénine. Cette “découverte”, peu avant et dans le contexte de l’effervescence d’une vague de luttes révolutionnaires mondiale, d’une véritable ébullition politique, témoignait justement de la capacité d’organisation et d’inventivité des masses elles-mêmes, leur moyen d’exprimer une authentique autonomie face aux autres classes ou couches sociales de la société, alors que le Parti mondial n’était par encore constitué et que les bolcheviks n’avaient au départ que très peu d’influence. On peut dire que c’est cette dynamique même de réflexion autonome dans la classe qui posait les conditions devant permettre à l’avant-garde du prolétariat de se hisser à la hauteur des nécessités politiques en s’armant théoriquement elle-même pour prendre le pouvoir et tenter d’étendre la révolution. Le PCI néglige donc le fait que le prolétariat est capable de développer sa propre conscience pour accéder à la connaissance théorique de ses buts, de ses moyens et de ses principes : “la théorie peut s’emparer des masses”, comme le disait Marx. Cela conduit les camarades du PCI à retarder, et finalement à se couper de tout processus conscient qui existe au sein de la classe ouvrière.
Cette question de la conscience était pourtant bien défendue au sein du mouvement ouvrier dès l’époque de l’Internationale communiste (IC), pour qui il était important de combattre pour “l’action de masse du prolétariat” et pour “conquérir à l’intérieur des soviets une majorité sûre et consciente”. (9) Une telle politique était conforme avec la conception en devenir selon laquelle les révolutionnaires n’ont pas à “organiser la classe” mais à œuvrer pour favoriser sa prise de conscience politique. Si la révolution ne peut être assurée sans le rôle indispensable d’orientation du Parti, elle ne saurait vaincre sans une prise de conscience politique en profondeur au sein des masses ouvrières elles-mêmes, qui ne peuvent suivre de manière aveugle le Parti (loin d’être infaillible comme l’a montrée l’histoire). Dans ce cadre, il est bien évident que si les ouvriers peuvent naturellement s’organiser, ce n’est pas dans une structure “permanente”, comme le pense le PCI, mais par un effort conscient, certes distinct, mais profondément lié à celui du Parti qui pourra surgir, dans un rapport unitaire et lié aux conseils ouvriers. Cela, contre toutes les influences des autres couches ou classes réactionnaires de la société.
Comment défendre l’autonomie de classe aujourd’hui ?
Dans la période actuelle de décadence de capitalisme, en dehors de toute phase révolutionnaire, l’organisation des prolétaires est nécessairement éphémère et liée au rythme de la lutte elle-même. Elle “est constituée par les assemblées générales des ouvriers en lutte, des comités de grève désignés par ces assemblées et révocables par elles, des comités centraux de grève composés de délégués des différents comités de grève. Par nature, ces organisations existent par et pour la lutte et sont destinées à disparaître une fois que la lutte est achevée. Leur principale différence avec les syndicats, c’est justement qu’elles ne sont pas permanentes et qu’elles n’ont pas l’occasion, de ce fait, d’être absorbées par l’État capitaliste”. (10) Telles sont les principes et méthodes de lutte éprouvées dans les années 1980, notamment lors du combat des ouvriers en Pologne, lorsqu’ils ont pu en 48 heures seulement, étendre leur mouvement à tous les grands centres industriels du pays en basant leur réflexion et leur activité solidaire à partir des MKS (assemblées générales massives) pour décider eux-mêmes au plan politique des modalités de la lutte. Ce sont ces organes politiques qui ont été des creusets de conscience et d’organisation pour la classe ouvrière, même s’ils ont été immédiatement dans le collimateur de l’État qui les a torpillés, particulièrement au moyen du syndicat “libre” Solidarnosc qui en avait pris rapidement le contrôle pour mener la lutte à la défaite et la livrer à la répression.
Ce sont ces mêmes méthodes de luttes, bien qu’à moindre échelle, qui ont été mises en œuvre par les assemblées générales souveraines lors de la lutte de 2006 contre le CPE en France et qui ont obtenu le retrait de cette attaque, chose inédite depuis de longues années. Ces assemblées commençaient à élargir le combat des étudiants, majoritairement filles et fils de prolétaires, à l’ensemble des salariés, des jeunes précaires, des chômeurs et des retraités. Ces assemblées autonomes et souveraines avaient été capables de prendre en main le combat en opposition aux syndicats, du moins au début, avec un débat franc et ouvert à tous les exploités, pour réfléchir à la façon de mener la lutte. Une démarche que craignaient la bourgeoisie et le gouvernement Villepin de l’époque, obligés et forcés de reculer.
Nous avons retrouvé, quelques années plus tard, ces mêmes approches prolétariennes lors des assemblées générales ouvertes à tous du mouvement Occupy et celui des Indignados, en dépit de faiblesses et fragilités importantes.
Si la prise en main de véritables assemblée souveraines n’a pas été possible lors du mouvement contre la réforme des retraites l’hiver dernier (contrairement à ce que pense le PCI qui vante les mérites des AG syndicales interprofessionnelles) ce mouvement était plutôt guidé par une aspiration de solidarité et une volonté de combattre. Cela s’est vérifié par la mobilisation et l’état d’esprit dans les manifestations, même si ces dernières restaient sous emprise syndicale.
Cette volonté de se battre s’exprimait également dans un contexte ou des minorités tendent à se rapprocher, même avec de grandes difficultés et confusions, des positions de la Gauche communiste. Ce processus, fragile, certes moléculaire, témoigne du fait que la réflexion politique existe bien dans les tréfonds du prolétariat. Les organisations du milieu politique prolétarien doivent le reconnaître et stimuler cette dynamique pour conduire à davantage de clarté et de conviction révolutionnaire : “Ainsi, de la même manière que la conscience de classe n’est pas une conscience sur quelque chose d’extérieur au prolétariat mais la conscience que le prolétariat a de lui-même en tant que classe révolutionnaire, les révolutionnaires n’entrent pas en relation avec le prolétariat sur base d’une origine différente. Les révolutionnaires vivent comme une partie de la conscience du prolétariat et servent à homogénéiser celle-ci. Rien de plus normal, dans cette mesure, de les voir entrer dans la même lutte que l’ensemble de leur classe, participer à la même pratique globale, élaborer et enrichir le même programme. Les communistes ne possèdent pas de théorie qui soit leur trésor personnel, le fruit de leurs brillants cerveaux. Concevoir le programme communiste comme une table des dix commandements est donc une idiotie. Le programme révolutionnaire ne possède aucune origine mystique et il n’est pas un code invariant. Il est au contraire une œuvre concrète de la classe elle-même ; une arme de sa lutte. Il n’est pas seulement un énoncé abstrait des buts finaux de la société et de la lutte ouvrière, mais aussi une analyse minutieuse et concrète du développement réel précédent, de la situation économique, sociale et politique, avec toutes ses particularités bien matérielles”. (11) Cette analyse “minutieuse” nécessaire, lors du mouvement contre la réforme des retraites en France, a échappé en grande partie au PCI du fait de son opportunisme.
La profondeur de la pandémie planétaire de Covid-19, l’inquiétude sociale, les attaques présentes et à venir, dans la réalité de la phase actuelle de décomposition du capitalisme, générant toutes sortes de miasmes et de catastrophes, vont probablement avoir un impact négatif et jouer un rôle paralysant durant tout un temps, en pourrissant les consciences. Mais il n’empêche que ce mouvement contre la réforme des retraites en France aura laissé des traces durables et une expérience positive pour le futur. Il est indispensable pour les révolutionnaires de prendre cela en compte pour mener le combat, d’autant plus que la défense de l’autonomie de classe constitue aujourd’hui un enjeu vital face au danger de luttes sur un terrain interclassiste comme on l’a vu avec le mouvement des “gilets jaunes” en France ou face au mécontentement général lié aux mesures contre la pandémie, voire sur le terrain carrément bourgeois au nom de l’antiracisme comme Black Lives Matter aux États-Unis.
WH, 17 octobre 2020
1Voir sur notre site : “Les graves faiblesses du PCI dans le mouvement contre la réforme des retraites (Partie 1)” [225]
2“Ce qui nous distingue [226]” sur le site : pcint.org.
3La révolution d’Octobre 1917 en Russie marque le début d’une vague révolutionnaire internationale, que l’échec, en particulier lors de la révolution en Allemagne en 1919-23, a condamné à une rapide dégénérescence. L’arrivée au pouvoir de la clique bourgeoise stalinienne fut le coup de grâce porté à cette vague révolutionnaire et marqua le début de la contre-révolution triomphante dans le monde entier, à la fois sur le plan physique (arrestations, exécutions, massacres…) et idéologique. Cette dernière devait durer près de 50 ans.
4“Sur la période historique actuelle et les tâches des révolutionnaires”, Programme communiste n° 103 (janvier 2016).
5Idem.
6“Ce qui nous distingue [226]” sur le site : pcint.org.
7Idem.
8“Sur la période historique actuelle et les tâches des révolutionnaires”, Programme communiste n° 103 (janvier 2016).
9“Thèses sur la démocratie bourgeoise et la dictature du prolétariat” rédigées par Lénine pour le premier congrès de l’IC.
10“L’opportunisme du PCI sur la question syndicale le conduit à sous-estimer l’ennemi de classe”.
11Voir notre brochure : Organisation communiste et conscience de classe.
Questions théoriques:
- Syndicalisme [183]
Rubrique:
Face à la pandémie et à la crise économique: quelle réponse de la classe ouvrière?
- 97 lectures
Il n’y a donc pas d’autre alternative pour échapper au chaos et à la barbarie que de détruire de fond en comble le capitalisme. Mais qui peut le faire ? Qui peut libérer l’humanité du joug de l’exploitation et de l’accumulation capitaliste et établir une nouvelle société basée sur la satisfaction des besoins humains ? Cet espoir pour l’humanité n’est-il pas déjà fatalement disparu ?
La réunion publique se tiendra en ligne le samedi 27 mars 2021 à 14H00.
Nos réunions publiques sont des lieux de débat ouverts à tous ceux qui souhaitent rencontrer et discuter avec le CCI. Nous invitons vivement tous nos lecteurs, contacts et sympathisants à venir y débattre, afin de rompre l’isolement imposé par la pandémie, poursuivre la réflexion sur la situation historique actuelle et confronter les points de vue. Les lecteurs qui souhaitent participer à cette réunion publique en ligne peuvent adresser un message sur notre adresse électronique ([email protected] [213]) ou dans la rubrique “contact” de notre site internet.
Rubrique:
Il y a cent ans, le soulèvement de Kronstadt
- 245 lectures
Après la révolution russe en 1917, la révolution en Allemagne en 1918, la création de l’Internationale communiste en 1919, le CCI revient aujourd’hui sur le centième anniversaire du tragique écrasement de la révolte des marins, soldats et ouvriers de Kronstadt en mars 1921 avec la republication d’un document Les leçons de Kronstadt [227] paru dans la Revue internationale n° 3 afin de tirer les leçons essentielles de cet événement pour les luttes futures.
Au mois de mars 1921, l’État soviétique, dirigé par le parti bolchevik, met fin par la force militaire au soulèvement des marins et des soldats de la garnison de Kronstadt, sur l’île de Kotline dans le golfe de Finlande, à 30 km de Petrograd (aujourd’hui Saint-Pétersbourg). Les 15 000 soldats et marins insurgés sont assaillis par 50 000 soldats de l’Armée rouge, dès le 7 mars au soir. Après dix jours de combats acharnés, le soulèvement de Kronstadt est écrasé. Un chiffre fiable du nombre de victimes n’est pas disponible, mais on estime à plus de 3 000 le nombre de morts et exécutés du côté des insurgés et à plus de 10 000 morts du côté de l’Armée rouge. Selon un communiqué de la Commission extraordinaire datant du 1er mai 1921, 6 528 rebelles ont été arrêtés, 2 168 exécutés (un tiers), 1 955 condamnés au travail obligatoire (dont 1 486 pour cinq années), et 1 272 libérés. Les familles des rebelles ont été déportées en Sibérie. Et 8 000 marins, soldats et civils réussissent à s’échapper vers la Finlande.
Moins de 4 ans après la prise de pouvoir par la classe ouvrière en Russie en octobre 1917, ces événements expriment de façon tragique le processus de dégénérescence d’une révolution isolée et à bout de souffle. En effet, cette révolte ouvrière est celle de partisans du régime des Soviets, de ceux qui en 1905 et en 1917 étaient à l’avant-garde du mouvement et qui pendant la révolution d’Octobre étaient considérés comme “l’honneur et la gloire de la révolution”. En 1921, les révoltés de Kronstadt exigent la satisfaction de revendications rejoignant celles des ouvriers de Petrograd en grève depuis le mois de février : libération de tous les socialistes emprisonnés, fin de l’état de siège, liberté d’expression, de la presse et de réunion pour tous ceux qui travaillent, une ration égale pour tous les ouvriers… Mais ce qui souligne l’importance de ce mouvement et exprime son profond caractère prolétarien, c’est non seulement la réaction face aux mesures de restriction mais surtout la réaction face à la dépossession et à la perte du pouvoir politique des conseils ouvriers au profit du Parti et de l’État, qui se substituent à eux et sont censés dès lors représenter l’orientation et les intérêts du prolétariat. Ceci est exprimé dès le premier point de leur résolution : “Étant donné que les soviets actuels n’expriment pas la volonté des ouvriers et des paysans, d’organiser immédiatement des réélections aux soviets au vote secret en ayant soin d’organiser une libre propagande électorale”.
La bourgeoisie, en se référant à la répression des révoltés par l’Armée rouge, a toujours essayé de prouver aux prolétaires qu’il y a un fil ininterrompu reliant Marx et Lénine à Staline et au goulag. L’objectif de la bourgeoisie est de faire en sorte que les prolétaires se détournent de l’histoire de leur classe et ne se réapproprient pas ses propres expériences. Les thèses des anarchistes en arrivent aux mêmes conclusions en s’appuyant sur la prétendue nature autoritaire et contre-révolutionnaire du marxisme et des partis agissant en son nom. Les anarchistes portent en fait un regard abstraitement “moral” sur les événements. Partant du postulat de l’autoritarisme inhérent du parti bolchevik, ils sont incapables d’expliquer le processus de dégénérescence de la révolution en général et de l’épisode de Kronstadt, en particulier : une révolution qui s’épuise après sept années de guerre mondiale et de guerre civile, avec une infrastructure industrielle en ruines, une classe ouvrière décimée, affamée, confrontée à des insurrections paysannes dans les provinces. Une révolution dramatiquement isolée, pour qui la perspective de l’extension internationale est de moins en moins probable après l’échec de la révolution en Allemagne, sur tous ces problèmes auxquels furent confrontés la classe ouvrière et le parti bolchevik, les anarchistes ferment les yeux.
La principale leçon historique, fondamentale pour la perspective d’une révolution prolétarienne mondiale, de la répression de la révolte de Kronstadt concerne la violence de classe. Si la violence révolutionnaire est une arme du prolétariat pour abattre le capitalisme face à ses ennemis de classe, sous aucun prétexte, elle ne peut être utilisée et s’exercer au sein même de la classe ouvrière, contre d’autres prolétaires. Ce n’est pas par la force et la violence qu’on impose le communisme au prolétariat parce que ces moyens s’opposent catégoriquement au développement du caractère conscient de sa révolution qu’il ne peut acquérir que par sa propre expérience et l’examen critique constant de cette expérience. La décision par le parti bolchevik de réprimer Kronstadt ne peut se comprendre que dans le contexte de l’isolement international de la révolution russe et de la terrible guerre civile qui frappait alors la région. Une telle décision n’en demeure pas moins une erreur tragique en s’exerçant contre des ouvriers qui s’étaient dressés pour défendre leur principale arme de transformation politique consciente de la société et le véritable organe vital de la dictature de prolétariat : le pouvoir des Soviets.
Voir aussi sur le même sujet dans la Revue Internationale et dans notre journal Révolution Internationale :
– “ [227]Les leçons de Kronstadt”, Revue internationale n° 3 (4e Trimestre 1975). [227]
– “ [228]Le communisme n’est pas un bel idéal, il est à l’ordre du jour de l’histoire [8° partie]”, [228]Revue internationale n° 100 (1er semestre 2020). [228]
– “ [229]1921 comprendre Kronstadt”, [229]Revue internationale n° 104, (1er trimestre 2006). [229]
– “ [230]Le soulèvement de Kronstadt”, [230]Révolution internationale n° 84 (avril 1981). [230]
– “ [231]Kronstadt : contre les thèses anarchistes, les leçons tirées par la Gauche communiste”, [231]Révolution internationale n° 310 (mars 2001). [231]
Histoire du mouvement ouvrier:
- Révolution Russe [217]
Conscience et organisation:
- Troisième Internationale [119]
Evènements historiques:
- Kronstadt [232]
Rubrique:
Il y a trente ans disparaissait notre camarade Marc Chirik
- 199 lectures
Marc Chirik nous a quittés il y a 30 ans, en décembre 1990. En hommage aux précieuses contributions de notre camarade, de ce grand révolutionnaire dans la lignée de Marx, Engels, Lénine et Rosa Luxemburg, nous republions ci-dessous la série de deux articles parus dans la Revue internationale n° 65 et 66, juste après sa mort. Ces deux articles retracent les grandes lignes de sa vie et rappellent ses apports inestimables à la cause du mouvement ouvrier et à la défense de la méthode marxiste.
Dans cette courte présentation de ces textes, nous voudrions seulement souligner trois aspects essentiels qui ont caractérisé sa vie et son activité révolutionnaire.
D’abord, au cours d’une vie militante active de plus de 70 ans, il a été, de sa jeunesse jusqu’à son dernier souffle, un lutteur acharné, un combattant inlassable pour la cause révolutionnaire du prolétariat et du communisme. Il consacra toute son énergie à la défense intransigeante et ferme des principes internationalistes prolétariens et du marxisme. Il n’a jamais cessé d’être à la pointe du combat en mettant à profit toute son expérience politique, théorique et organisationnelle. Le militantisme révolutionnaire a été une boussole constante dans sa vie. Même au cours de la terrible période de contre-révolution, Marc n’a jamais cessé d’œuvrer à l’élaboration et la clarification des positions de la Gauche communiste avec patience et détermination. Dans ces années terribles, il a inlassablement combattu contre les trahisons du camp prolétarien mais il a aussi lutté au sein de toutes les organisations dans lesquelles il a milité, contre les manœuœuvres et dérives opportunistes, contre les attitudes centristes, en combattant fermement les conceptions et les dérives académistes comme activistes. Il a su garder le même cap et poursuivre le même combat avec la même détermination en prenant activement part au ressurgissement du prolétariat sur la scène historique en Mai 1968 avec un enthousiasme débordant, en s’impliquant totalement dans le regroupement des forces révolutionnaires qui ont donné naissance à l’actuel CCI. Il a apporté toute son énergie militante, sa conviction et son expérience dans l’orientation et la contruction de cette organisation comme ensuite dans les tentatives de regroupement et de clarification des positions des organisations du milieu politique prolétarien dans les années 1980.
Un autre trait fondamental de son tempérament fut sa capacité à maintenir vivant les acquis théoriques du mouvement révolutionnaire en particulier ceux produits par la fraction de gauche du Parti communiste d’Italie. Il put ainsi s’orienter de façon critique et lucide dans l’analyse de l’évolution de la situation mondiale. Ce “flair” politique, fondé sur l’analyse globale du rapport de forces entre les classes, lui permit de remettre en cause certains “dogmes” du mouvement ouvrier, sans pour autant s’écarter de la démarche et la méthode marxiste du matérialisme historique mais en l’ancrant au contraire dans la dynamique de l’évolution de la réalité historique concrète. A la fin de sa vie, il apporta une dernière contribution théorique en étant un des premiers dans le CCI à déceler que le capitalisme était entré dans la phase terminale de sa période de décadence, celle de sa décomposition. Il mit ainsi en avant que le prolétariat ne pouvait nullement utiliser à son profit ce pourrissement sur pied du système capitaliste mais que cette situation impliquait de nouveaux enjeux décisifs pour le prolétariat et pour la survie de l’humanité.
Le dernier élément que que nous voulons mettre en exergue est sa détermination à transmettre les leçons du mouvement ouvrier et l’expérience organisationnelle des révolutionnaires à de nouvelles générations afin de former de nouveaux militants et de permettre au CCI d’assurer la continuité politique dans les futurs combats de classe. Il était convaincu au plus haut point du besoin indispensable de l’organisation révolutionnaire pour le prolétariat, comme du besoin d’un pont reliant le passé, le présent et le futur de la lutte de classe comme de la nécessité vitale de la préservation d’une continuité organique vivante des organisations révolutionnaires. Il était conscient de représenter lui-même ce fil ténu qui reliait la continuité organique et historique de l’expérience de la classe et la mémoire vivante du mouvement ouvrier. Tout en mettant constamment en avant que “le prolétariat sécrète des organisations révolutionnaires et non pas des individus révolutionnaires”, il insistait aussi beaucoup sur les responsabilités individuelles de chaque militant et sur le sentiment de solidarité et de respect entre eux.
Rien ne saurait mieux exprimer la vie de Marc que ce que Rosa Luxemburg synthétisait en une simple phrase : “J’étais, je suis, je serai”.
– “MARC : De la révolution d'octobre 1917 à la deuxième guerre mondiale [233]”
– “MARC : II - De la deuxième guerre mondiale à la période actuelle [234]”
Personnages:
- Marc Chirik [235]
Courants politiques:
- Gauche Communiste [163]
Rubrique:
Bas les pattes sur la Commune !
- 269 lectures
Il y a 150 ans, le 18 mars 1871, débutait le premier assaut révolutionnaire du prolétariat, donnant naissance à la Commune de Paris. Face à la guerre totale que lui déclara la bourgeoisie, la Commune résista pendant 72 jours, jusqu’au 28 mai 1871 : sa répression impitoyable coûta la vie à 20 000 prolétaires. Depuis, pour la classe ouvrière, de génération en génération, la Commune de Paris est un exemple, une référence, un patrimoine appartenant aux exploités du monde entier ; sûrement pas à son bourreau, la bourgeoisie, qui multiplie aujourd’hui les commémorations indécentes pour falsifier son histoire et jeter aux oubliettes les précieuses leçons que le mouvement ouvrier a su en tirer.
Durant plusieurs semaines, les journaux, les chaînes de télévisions et de radio verront défiler historiens, journalistes, hommes politiques, écrivains qui, tous, s’attacheront à faire leur sale travail de propagande au service de leur classe. De la droite à la gauche, en passant par l’extrême gauche, toute la bourgeoisie ira de ses mensonges des plus flagrants aux plus subtils.
Les communards, des sauvages sanguinaires pour la droite
Si la droite s’est indignée de la timidité avec laquelle l’État prévoyait de “commémorer” le bicentenaire de la mort de Napoléon Ier, elle a bien sûr montré toute sa morgue à propos des communards, (1) ces “assassins”, ces “fauteurs de trouble”, ces “agents du désordre” qui n’auraient qu’à rester là où ils sont, c’est-à-dire six pieds sous terre. Il faut remonter à 2016 pour voir Le Figaro, journal français de droite bien connu, avancer crûment ce que le “parti de l’ordre” a toujours pensé sur le fond, et ce sans équivoque : “Les communards ont détruit Paris, massacrés les gens honnêtes et même affamé Paris en détruisant les immenses magasins du grenier de l’abondance, grenier des réserves de céréales qui approvisionnait les boulangers de Paris”. La crapulerie et l’ignominie sont ici sans limites. C’est ainsi que les insurgés, déjà traités à l’époque comme de la vermine, devenaient responsables de leur propre famine et par la même occasion les affameurs des “honnêtes gens”. Autrement dit, si la classe ouvrière à Paris fut réduite à manger des rats, ce fut de sa faute ! Comme à son habitude, et notamment depuis les lendemains de l’événement, la droite, qui a toujours été terrorisée par les “classes dangereuses”, répète à l’envi son discours haineux assimilant les communards à des sauvages sanguinaires.
Mais cette campagne d’accusations grossières, menée avec de trop gros sabots, manquant cruellement de finesse, connaît très vite ses limites aux yeux de la classe ouvrière. Il revient donc aux forces de gauche du capital de mener l’essentiel et le véritable travail de falsification la signification de la Commune de Paris.
La Gauche s’approprie la Commune pour mieux la dévoyer
À partir du 18 mars prochain et durant 72 jours, la mairie de Paris va organiser pas moins de cinquante événements pour prétendument célébrer les 150 ans de la Commune. Le ton sera donné dès le 18 mars dans le square Louise Michel (18e arrondissement de Paris), en présence d’Anne Hidalgo, la maire “socialiste” de la capitale.
Ce lieu n’est pas choisi au hasard. Louise Michel a été l’une des combattantes les plus connues et héroïque de la Commune qui, lors de son jugement, refusa même la pitié des bourreaux de la Commune en leur lançant au visage : “Puisqu’il semble que tout cœur qui bat pour la liberté n’ait droit qu’a un peu de plomb, j’en réclame ma part, moi ! Si vous n’êtes pas des lâches, tuez-moi”. Alors qui sont ces gens qui, aujourd’hui, veulent mettre en scène d’une façon totalement tronquée la mémoire de la Commune ? Qui sont Madame Hidalgo et tout son conseil municipal “socialiste” ? Rien de moins que les descendants des traîtres social-démocrates qui passèrent irrémédiablement dans le camp de la bourgeoisie au cours de la Première Guerre mondiale.
Depuis ce temps, dans l’opposition ou au gouvernement, les “socialistes” ont toujours agi contre les intérêts de la classe ouvrière. C’est donc en toute hypocrisie et à des fins de récupération politique que le premier adjoint d’Anne Hidalgo lors des vœux de 2021 pouvait cyniquement instrumentaliser la mémoire de Louise Michel en la citant : “Chacun cherche sa route, nous cherchons la nôtre et nous pensons que le jour ou le règne de la liberté et de l’égalité sera arrivé le genre humain sera heureux”. Pour les communards, ces mots signifiaient la fin de l’esclavage salarié, la fin de l’exploitation de l’homme par l’homme, la destruction de l’État bourgeois. Voilà quel était pour eux le sens des mots “liberté” et “égalité”. Voilà pourquoi à la place du drapeau tricolore des Versaillais qui flotte aujourd’hui sur le toit de l’Hôtel de Ville de Paris, les communards y avaient dressé le drapeau rouge, symbole du combat des ouvriers du monde entier ! Mais pour cette classe d’exploiteurs et de massacreurs, le “règne de la liberté” n’est rien de plus que le règne du commerce, de la domination et de l’exploitation des prolétaires dans les bagnes industriels.
Le Parti socialiste peut bien multiplier les spectacles à la gloire de la démocratie bourgeoise aux quatre coins de la capitale, les intellectuels, écrivains, cinéastes de gauche peuvent bien sortir films et ouvrages à profusion pour diluer le caractère révolutionnaire de la Commune, la presse peut bien, à l’image du Guardian, (2) la faire passer pour une “lutte du peuple” et la comparer au mouvement interclassiste des “gilets jaunes” afin d’en nier le caractère indubitablement prolétarien, la Commune de Paris ne fut ni un combat pour la mise en œuvre des valeurs et de la démocratie bourgeoise, cette forme la plus sophistiquée de la domination de classe et du capital, ni un combat du “peuple de Paris”, voire de la “petite-bourgeoisie artisanale”. Elle incarnait au contraire une lutte à mort pour abattre le pouvoir de la classe bourgeoise dont le parti socialiste et tous les notables de “gauche” sont aujourd’hui les dignes représentants.
L’extrême gauche du capital complète le sale travail
Les gauchistes ne sont pas en reste quand il s’agit d’apporter leur petite pierre à l’édifice de la falsification des expériences du mouvement ouvrier. Il s’agit d’ailleurs le plus souvent des déformations les plus insidieuses.
Ainsi, les trotskistes du NPA enfourche le cheval de la “démocratie directe” pour dénaturer la signification de la Commune. Ces gauchistes reconnaissent bien que les communards se sont attaqués à l’État, mais pour en déduire de fausses leçons, pour tirer des conclusions inoffensives pour le capital qu’ils défendent avec zèle. Le NPA du Loiret, par exemple, dans un bulletin publié le 13 mars dernier, ouvre ses colonnes à l’historien Roger Martelli (3) dont la prose est un véritable plaidoyer pour la démocratie bourgeoise : “Sans doctrines figées, sans même un programme achevé, la Commune a fait en quelques semaines ce que la République va mettre bien du temps à décider. Elle a ouvert la voie à une conception du “vivre ensemble”, fondé sur l’égalité et la solidarité. Elle a enfin esquissé la possibilité d’une demande moins étroitement représentative, plus directement citoyenne. En bref elle a voulu mettre concrètement en œuvre ce “gouvernement du peuple par le peuple” dont le président Lincoln avait annoncé l’avènement des années plus tôt”. Quelle honte ! Martelli crache sans aucun scrupule sur la tombe des communards ! Le NPA, de manière totalement ouverte et “décomplexée”, fait passer la Commune pour une simple réforme démocratique radicale habillée de participation populaire. En fin de compte, l’avenir que préfigurait la Commune est ramené à l’idéal bourgeois démocratique !
Jean Jaurès, malgré ses préjugés réformistes, avait au moins l’honnêteté intellectuelle, contrairement aux falsificateurs du NPA, de dire que : “la Commune fut dans son essence, elle fut dans son fond la première grande bataille rangée du travail contre le capital. Et c’est même parce qu’elle fut cela avant tout qu’elle fut vaincue, qu’elle fut égorgée”. (4)
De son côté, Lutte ouvrière (LO), l’autre principal parti trotskiste français, contribue avec son langage faussement radical à cette campagne de falsification en feignant d’opposer la démocratie parlementaire (à laquelle LO participe sans rechigner depuis des décennies) à la dictature du prolétariat, c’est-à-dire, à ses yeux, une forme plus radicale de démocratie bourgeoise. C’est ce que ce parti électoraliste expliquait en 2001 : “Dans un programme qu’ils n’eurent pas le temps de développer, les communards proposaient que toutes les communes des grandes villes aux plus petits hameaux de campagne s’organisent selon le modèle de la Commune de Paris et qu’elles constituent la structure de base d’une nouvelle forme d’État vraiment démocratique”. (5) C’est la raison pour laquelle, LO s’empresse de préciser : “Cela ne signifie pas que les communistes révolutionnaires sont indifférents aux libertés dites démocratiques, bien au contraire, ne serait-ce que parce qu’elles permettent aux militants de défendre plus ouvertement leurs idées”. (6)
Les organisations de la gauche du capital jouent sans conteste le rôle le plus perfide, consistant à présenter la Commune comme une expérience de démocratie “radicale”, qui n’aurait pas eu d’autres horizons que d’améliorer le fonctionnement de l’État. Rien de plus ! 150 ans après, la Commune de Paris a de nouveau à faire à la Sainte alliance de toutes les forces réactionnaires bourgeoises, comme elle a eu à faire en son temps à la Sainte alliance de l’État prussien et de la République française. Ce sont les trésors politiques légués par la Commune que la classe bourgeoise cherche à cacher et enterrer.
La Commune appartient à la classe ouvrière
En réalité, comme l’ont affirmé haut et fort Marx et Engels au lendemain de l’événement, la Commune de Paris s’est lancée dans le premier assaut révolutionnaire du prolétariat en voulant détruire l’État bourgeois. La Commune chercha immédiatement à asseoir son pouvoir en supprimant l’armée permanente et les administrations d’État, en instaurant la révocabilité permanente des membres de la Commune, responsables devant l’ensemble de ceux qui les avaient élus. Bien avant les révolutions de 1905 et 1917 en Russie, alors que les conditions historiques n’étaient pas mûres, les communards se sont engagés sur le chemin de la formation des conseils ouvriers, “la forme enfin trouvée de la dictature du prolétariat” comme le disait Lénine. Ce n’est donc pas la construction d’un État “réellement démocratique” auquel s’attelaient ainsi les communards, mais à la remise en cause de la domination de la classe bourgeoise. La Commune de Paris a démontré que la “classe ouvrière ne peut pas se contenter de prendre la machine de l’État toute prête et de la faire fonctionner pour son propre compte”. (7) C’est une des leçons essentielles que Marx et le mouvement ouvrier ont tiré de cette expérience tragique.
Si la Commune de Paris était un assaut prématuré qui s’est conclu par le massacre de la fine fleur du prolétariat mondial, il ne demeure pas moins qu’elle fut un combat héroïque du prolétariat parisien, une contribution inestimable à la lutte historique des exploités. Pour cette raison, il reste fondamental que la classe ouvrière du XXIe siècle soit en mesure de s’approprier et de faire vivre l’expérience de la Commune et les leçons inestimables que les révolutionnaires en ont tiré.
Paul, 18 mars 2020.
Pour approfondir les leçons de la Commune de Paris, nous conseillons la lecture des articles suivant :
– “La Commune de Paris, premier assaut révolutionnaire du prolétariat [236]”.
– “1871 : la première révolution prolétarienne : le communisme, une société sans État [237]”, huitième partie de notre série : “Le communisme n’est pas un bel idéal mais une nécessité matérielle”.
– “Glorification du Sacré-Cœur : un nouveau crime contre la Commune de Paris [238]”.
1 Au Conseil de Paris, les élus de droite se sont opposés à la célébration des 150 ans de la Commune, menant une campagne assourdissante sur la légitimité et même le devoir national de célébrer la mort de Napoléon Bonaparte.
2 “Vive la Commune? The working-class insurrection that shook the world”, The Guardian (7 mars 2021).
3Lié au courant rénovateur du parti stalinien en France, le PCF, désormais proche du parti de gauche, La France insoumise, au discours nationaliste très musclé.
4Jean Jaurès, Histoire Socialiste.
5“Démocratie, démocratie parlementaire, démocratie communale”. Cercle Léon Trotski intitulé n° 89 (26 janvier 2001). Dans cet article qui en dit très long sur l’idéologie démocratise de LO, le parti trotskiste ajoute d’ailleurs sans sourciller : “Parmi toutes les institutions bourgeoises, les municipalités [c’est-à-dire les rouages de la démocratie bourgeoise où LO a le plus de chance d’obtenir des élus] restent encore aujourd’hui, potentiellement, les plus démocratiques, parce qu’elles sont les plus proches de la population, les plus soumises à son contrôle”. Sans commentaire…
6“La Commune de Paris et ses enseignements pour aujourd’hui”, Lutte de classe n° 214 (mars 2021).
7 Marx et Engels, Préface du Manifeste du Parti communiste (24 juin 1872).
Histoire du mouvement ouvrier:
- Commune de Paris - 1871 [239]
Rubrique:
ICCOnline - avril 2021
- 53 lectures
La vérité est révolutionnaire - Pour une histoire véridique de la Gauche communiste (Correspondance avec la TCI)
- 509 lectures
En décembre dernier, le CCI a écrit à la TCI pour lui demander de publier un correctif portant sur de sérieuses falsifications concernant notre organisation, publiées sur le site de la TCI dans un article intitulé « Sur le quarante-cinquième anniversaire de la fondation de la CWO[1] ».
Le CCI ne demanderait pas semblables rectifications d’un groupe bourgeois. Nous n’attendons que mensonges de ce côté-là, et nous dénonçons simplement de telles diffamations qui sont la marque de fabrique de la classe ennemie.
Si nous demandons à la TCI de corriger d’importantes diffamations concernant le CCI, c’est parce que nous considérons que la TCI, malgré nos divergences politiques avec cette tendance, fait partie du camp prolétarien internationaliste, et nous avons un intérêt commun à rectifier d’importantes déviations de la vérité sur l’histoire de la Gauche communiste[2].
Nous espérions que la TCI reconnaîtrait ces importantes inexactitudes et en même temps accepterait de les rectifier, ou nous apporterait des preuves permettant de réfuter nos corrections.
Malheureusement, la TCI a répondu avec colère à notre demande, refusant de publier quelque correctif que ce soit, et suggérant que notre demande serait une « provocation » ou un « jeu politicien ». Elle a déclaré dans sa réponse que c’était son dernier mot sur le sujet et que cette correspondance était maintenant close[3].
Néanmoins, malgré cette rebuffade, le CCI a de nouveau écrit en espérant produire un changement d’état d’esprit, expliquant que notre demande de rectification n’était pas une provocation ou un jeu, ni une polémique sur l’interprétation par la CWO de sa propre histoire ou une tentative d’essayer d’imposer notre propre interprétation de celle-ci, mais une volonté de rétablir des faits importants. Et nous avons noté dans notre seconde lettre que, malgré le furieux refus de la TCI de publier notre correctif, sa réponse ne réfutait pas les faits en question, qui étaient bien tels que nous les décrivions. Mais la TCI a été conséquente sur un point : elle s’en est tenue à son unilatérale fin de non-recevoir, et trois mois après n’avait toujours pas répondu à notre seconde lettre.
Si nous publions aujourd’hui cette correspondance avec la TCI, c’est parce qu’il est visiblement impossible de parvenir à un accord négocié de concert avec elle, et du fait que nous considérons les falsifications comme suffisamment sérieuses pour nécessiter un correctif public. Du fait du refus de la TCI de discuter en privé d’un rectificatif public mutuellement acceptable, ce que nous aurions préféré, nous sommes contraints de rendre nous-mêmes les faits publics.
Notre première lettre :
Le CCI à la TCI
08/12/2020
Chers camarades,
Nous vous demandons de publier le présent correctif sur votre site web :
« Nous avons constaté qu’un article sur votre site web, « Sur le quarante-cinquième anniversaire de la fondation de la CWO », contient un certain nombre de mensonges qui diffament notre organisation. Trois sont particulièrement saillants et doivent être corrigés :
Premièrement, l’article déclare que le CCI a « calomnié » Battaglia Comunista en ce qui concerne ses origines au sein du Parti Communiste Internationaliste en 1943 : « Nous avons également découvert que les calomnies du CCI selon lesquelles il [le PCInt] aurait travaillé « au sein des Partisans » étaient fausses, le fait étant que le PCInt a travaillé partout où la classe ouvrière était présente ».
Une lettre de Battaglia Comunista au CCI reprise dans l’article « Les ambiguïtés sur les «partisans» dans la constitution du Parti Communiste Internationaliste en Italie », publié dans le numéro 8 de la Revue Internationale en 1977, disait :
« Les camarades qui l'ont constitué [le Parti Communiste Internationaliste] provenaient de cette Gauche qui avait la première dénoncé, aussi bien en Italie qu'à l'étranger, la politique contre révolutionnaire du bloc démocratique (comprenant les partis staliniens et trotskistes) et avait été la première et la seule à agir au sein des luttes ouvrières dans les rangs mêmes des Partisans, appelant le prolétariat contre le capitalisme quel que soit le régime dont il se recouvre.
Les camarades, que RI voudrait faire passer pour des "résistants", étaient ces militants révolutionnaires qui faisaient un travail de pénétration dans les rangs des Partisans pour y diffuser les principes et la tactique du mouvement révolutionnaire et qui, pour cet engagement, sont même allés jusqu'à payer de leur vie. ».
Le Parti Communiste Internationaliste dont Battaglia Comunista est issu a agi et pénétré les rangs des Partisans, d’après son propre témoignage. Ainsi, l’affirmation et la critique de ce fait par le CCI ne sont aucunement des calomnies.
Deuxièmement, l’article dit :
« en 1980, la troisième Conférence de la Gauche Communiste Internationale (à Paris) a mené à l’abandon des conférences par le CCI et d’autres petits groupes ».
Affirmer que le CCI a abandonné les conférences est une pure falsification de la réalité, une falsification qui est en fait contredite par ce qui est écrit auparavant dans votre article :
« Lors de la réunion [de la Troisième Conférence], la CWO et le GCI belge ont annoncé séparément qu’ils ne participeraient pas à la conférence suivante. La CWO n’a pas consulté le PCInt [c’est-à-dire Battaglia Comunista] avant cela, mais le PCInt, en tant qu’initiateur des conférences, a cherché à en sauver quelque chose en proposant un nouveau critère pour la conférence suivante qui satisferait (du moins le pensait-il) certains éléments comme la CWO et le GCI, et qui forcerait le CCI à prendre une position plus claire. Ça ne s’est pas passé comme le CCI l’avance, à savoir que la résolution n’avait pour but que de l’exclure. Il a tenté d’obtenir du PCInt une modification des termes du critère afin de continuer à entretenir le flou sur la question du Parti. Le PCInt en est resté à la formulation originelle et la délégation de la CWO a décidé de le soutenir. »
Ainsi ce n’est pas le CCI mais la CWO qui voulait abandonner les Conférences. Le PCInt, afin de « sauver quelque chose », a introduit un nouveau critère (qu’il a refusé de modifier, mais que la CWO a soutenu) pour la participation à la conférence, critère que le CCI ne pouvait pas accepter. Le débat sur la nature du parti entre les groupes présents aux Conférences a été artificiellement clos. Le CCI a de fait été exclu par les deux groupes, il n’a pas abandonné les Conférences.
Troisièmement, l’article dit ceci :
« Lorsque le CCI a commencé à s’introduire par effraction dans des logements privés (soi-disant pour récupérer ce qui lui appartenait), y compris chez JM qui était parti en même temps que les scissionnistes, Aberdeen l’a menacé d’appeler la police ».
L’affirmation que le CCI « aurait commencé à s’introduire par effraction dans des logements privés » est un mensonge malveillant répété à satiété par des parasites comme le défunt « Communist » Bulletin Group d’Aberdeen, lui permettant de justifier le vol de matériel du CCI, et pour excuser ses menaces d’appeler la police contre le CCI. L’insinuation de l’article, qui utilise l’adverbe « soi-disant », sous-entendant par là que la récupération de son matériel par le CCI n’était qu’un prétexte visant l’intimidation, est un autre mensonge mis en avant par les parasites pour excuser leurs propres vilenies.
L’un des principes qui a permis de différencier la tradition de la Gauche Communiste du stalinisme et du trotskisme, c’est de dire la vérité et de démasquer les mensonges de la contre-révolution, en particulier la falsification des faits historiques par cette dernière. Ce principe d’être factuellement précis est particulièrement important dans l’histoire de la Gauche Communiste. Les falsifications de l’article doivent être corrigées afin de donner une image véridique de cette histoire pour les nouvelles générations de militants communistes.
L’article est présent depuis déjà un certain temps sur votre site web, et il peut avoir été vu par de nombreux lecteurs, c’est pourquoi nous demandons que le correctif ci-dessus paraisse dans les deux semaines avec le texte en bonne place sur votre site.
Salutations communistes,
Le CCI »
Notre seconde lettre
Même si elle a refusé de publier cette lettre, la TCI a effectivement corroboré nos rectifications, comme nous l’avons mis en avant dans notre seconde lettre :
- « Nous avons pris bonne note que dans votre lettre vous confirmez la validité des corrections que nous vous avions demandées :
- Ce n’est pas une calomnie du CCI de dire que le PCInt est entré chez les Partisans à la fin de la Seconde Guerre mondiale en Italie ; « des membres du PCInt sont entrés chez les Partisans pour gagner des ouvriers contre l’antifascisme, le stalinisme (et le CLN) ».
- Ce n’est pas le CCI qui a abandonné les Conférences de la Gauche communiste : « [le PCInt] ne voulait certainement pas que les invitations concrètes à participer aux Conférences soient réduites au seul CCI ». (en d’autres termes, il n’y avait aucune chance que le CCI refuse de participer aux Conférences).
- Le CCI n’a commis aucune « effraction » lors de la récupération de son matériel politique en 1981 : « En ce qui concerne les « effractions », vous avez raison. ».
Les faits en question, ceux que nous rectifions dans notre première lettre et confirmons dans la seconde, et que la TCI ne conteste pas mais refuse de rectifier publiquement, ne sont clairement pas des broutilles, mais concernent directement des aspects majeurs de l’intégrité des positions du CCI. L’article de la CWO suggère que les différences de comportement entre le PCInt vis-à-vis des Partisans en Italie au cours de la Seconde Guerre mondiale – qui permettent de comprendre la trajectoire différente des ancêtres du CCI, la Gauche Communiste de France, et de ceux du PCInt au cours des années 1940 – est construite sur une « calomnie ».
Ensuite l’article dit que nous avons abandonné les Conférences Internationales de la Gauche Communiste des années 1970 alors même que nous les avons défendues bec et ongles. L'impact négatif de l'échec de ces conférences se fait encore sentir aujourd'hui. Et finalement, l’article prétend que le CCI, qui a toujours défendu l’organisation révolutionnaire et son comportement honnête, aurait utilisé le même type de comportement de voyou que ceux qui ont tenté de le détruire par le vol, la calomnie et la menace d’appeler la police. En un mot, de façon totalement contraire aux faits, c’est nous qui dans l’article passons pour des calomniateurs, des voyous et des déserteurs.
Il n’est pas question ici d’exagération polémique, mais d’affabulations qui nous diffament.
Il est évident que le CCI est contraint de se défendre publiquement contre de tels dénigrements.
La CWO a voulu que son histoire permette aux nouveaux membres et contacts de connaître le « fondement de notre conscience et de nos perspectives politiques actuelles ». Et en tant que telle son histoire ne pouvait qu'avoir un côté polémique puisque son passé recoupe en de nombreux points celui du CCI. Mais c’est une raison de plus pour en rester aux faits afin de permettre aux nouveaux militants de connaître l’histoire réelle de ses divergences avec d’autres tendances. La profonde conviction des nouveaux militants dans les positions de la TCI, ou de toute autre tendance de la Gauche Communiste, ne peut se fonder sur la base de dénigrements et falsifications des autres tendances. Au contraire, la formation de nouveaux militants de la Gauche Communiste demande une connaissance des faits.
Malheureusement, comme le montre le sort de la demande du CCI à la TCI, la détermination collective à défendre la vérité au sein de l’ensemble de la Gauche Communiste – une partie de sa tradition historique – malgré ses désaccords politiques mutuels est de plus en plus oubliée, et la tentative de rectifier des falsifications est considérée par la TCI comme une tentative de « jouer un jeu ». Par exemple, la demande par le CCI d’être factuellement honnête est elle-même considérée comme étant malhonnête. Et donc refusée.
Ce misérable mépris de rétablir les faits est cependant une déviation assez récente de la tradition de la gauche marxiste et de la Gauche Communiste en particulier.
« La vérité est révolutionnaire » – Marx
La nature révolutionnaire de la vérité a un sens général pour le marxisme en ce sens que la séquence des changements historiques d’un mode de production à un autre au cours de l’histoire de l’humanité ne peut qu’être scientifiquement et donc fidèlement comprise que comme le résultat de la lutte des classes. Et elle a une signification particulière pour la lutte de la classe ouvrière, laquelle cherche à démasquer les mensonges que la classe capitaliste utilise pour justifier son règne d’impitoyable exploitation, de crise économique et de misère, de guerre sans fin et de catastrophes. Du fait que la perspective communiste du prolétariat révolutionnaire n’est pas de justifier une nouvelle forme d’exploitation, mais d’abolir les classes et de créer une société de libre association des producteurs, la recherche de la vérité est l’arme politique et théorique principale de la classe ouvrière et de ses minorités communistes, à la fois contre la bourgeoisie et pour renforcer ses propres rangs.
Le développement théorique, politique et organisationnel de la tradition marxiste a été mené principalement par le biais de polémiques factuellement exactes. On se souvient des polémiques fameuses menées par Marx et Engels contre les Hégéliens de gauche (La Sainte famille, L’Idéologie allemande), contre Proudhon (Misère de la philosophie), l’Anti-Dühring, la Critique du programme de Gotha, la polémique de Rosa Luxemburg contre Eduard Bernstein (Réforme sociale ou révolution ?), celle de Lénine contre les Populistes russes dans Ce que sont les « Amis du peuple » et comment ils luttent contre les social-démocrates, etc. Elles sont toutes basées sur des citations étendues d’écrits et de compte-rendus précis et probants des actions de ceux qui sont critiqués, et n’en sont de ce fait que plus fortes et véhémentes. À l’inverse, la tradition marxiste a été déterminée à répondre publiquement aux allégations sur sa politique, et plus particulièrement à mettre au jour les calomnies et manœuvres servant le camp ennemi, comme le livre de Marx sur l’espion policier Herr Vogt, ou le rapport de la Première Internationale sur la conspiration de Bakounine.
Ces principes de précision et d’honnêteté ont commencé à s’affaiblir dans le camp marxiste avec la dégénérescence opportuniste de la Seconde Internationale. Après l’effondrement de cette dernière en 1914 et le soutien de la plupart des partis sociaux-démocrates à la guerre impérialiste, puis la haine active contre la vague révolutionnaire qui a émergé en 1917, les calomnies contre la gauche marxiste internationale se sont intensifiées et ont été le prélude à la tentative d’exterminer ses militants. Les dénigrements contre Rosa Luxemburg dans la presse sociale-démocrate, par exemple, ont créé le climat permettant son assassinat en 1919. Lénine et Trotsky ont échappé au même sort au cours de l’été 1917 après avoir été traités d’agents allemands par les mencheviks et d’autres.
La longue contre-révolution stalinienne qui a suivi la vague révolutionnaire de 1917-23 a intensifié cette attaque contre les principes et l’honneur de l’avant-garde révolutionnaire, au nom du marxisme et de la classe ouvrière, une hypocrisie sans précédent dans l’histoire. Les attaques staliniennes, présentées sous couvert de « polémiques marxistes », avaient pour but la destruction de ceux qui conservaient le cœur internationaliste du programme marxiste face à la dégénérescence de la Révolution d’Octobre et de l’Internationale Communiste, c'est-à-dire l'Opposition de Gauche de Trotsky mais surtout les Gauches Communistes d'Allemagne et d'Italie. Les falsifications de l’histoire, les mensonges et dénigrements ont constitué le terreau des expulsions, emprisonnements, tortures, procès-spectacles et assassinats.
Trotsky a tenté de maintenir la véritable tradition marxiste avec la Commission Dewey qui, en 1936, a révélé les machinations des procès de Moscou à l’aide de preuves systématiques et circonstanciées.
Mais le trotskisme a rejoint le camp bourgeois lors de la Seconde Guerre mondiale en abandonnant l’internationalisme, et dans ce processus ses méthodes sont devenues peu ou prou celles de la contre-révolution stalinienne et sociale-démocrate. Mentir et calomnier sont devenus des comportements normaux au sein de la gauche et de l’extrême-gauche de la contre-révolution bourgeoise. Seule la Gauche Communiste est restée aux côtés du prolétariat et de la défense de la vérité au cours de la boucherie impérialiste de 1939-45. Et aujourd’hui encore, la Gauche Communiste doit faire face et se démarquer nettement des méthodes ignobles de la gauche contre-révolutionnaire.
Lors du resurgissement de la tradition de la Gauche Communiste après 1968, malgré le poids du sectarisme au sein des différents groupes et la difficulté pour de nouveaux militants à rompre avec les mœurs du gauchisme, la nécessité d’un effort commun pour rétablir la vérité a été mutuellement reconnue par les différents groupes. Comme la lettre du CCI à la CWO le montre, le CCI a publié en 1977 dans sa Revue Internationale la demande de Battaglia Comunista (c’est-à-dire le PCInt/TCI) d’une correction de l’article sur les Partisans et les origines du PCInt. Et à ce moment-là la demande du PCInt se réfère au principe révolutionnaire de vérité historique, un épisode que nous rappelons dans notre seconde lettre à la TCI :
« En 1976, le camarade Onorato Damen, au nom de l’Exécutif du Partito Comunista Internazionalista, a adressé une lettre à notre section en France en demandant que soient rectifiées certaines affirmations contenues dans une polémique avec le PCI bordiguiste publiée dans le n°29 de notre journal Révolution Internationale. Il a protesté, en particulier, contre ce que nous avions écrit sur la politique du Partito à propos de la question des Partisans. Et il concluait sa lettre par les lignes suivantes :
« nous souhaitons que tous les révolutionnaires sachent mener un sérieux examen critique des positions sur les principaux problèmes politiques de la classe ouvrière aujourd’hui, en se documentant avec le sérieux propre précisément aux révolutionnaires, lorsqu’il s'agit de revenir (et c'est là quelque chose qui est toujours nécessaire) sur les erreurs du passé. ». Nous avons publié la totalité de la lettre dans la Revue Internationale n°8, avec, bien sûr, notre propre réponse.
La question que nous vous posons est celle-ci : pensez-vous que le camarade Damen et l’Exécutif du PCInt s’étaient engagés dans une quelconque provocation, un « jeu politique », en nous demandant de publier un rectificatif ?
Bien sûr, il peut y avoir polémique sur la réalité des faits. Dans la Revue Internationale n°87 par exemple, nous avons publié une lettre de la CWO (une « provocation » ou un « jeu politique » ?) qui affirmait qu’il y avait des falsifications dans une ancienne polémique avec le CCI. Nous avons soutenu qu’en fait les éléments en question étaient vrais. »
Plus récemment, au cours de la dernière décennie, cette tradition révolutionnaire rappelée par Onorato Damen a été oubliée, en partie du fait de la faillite des Conférences de la Gauche Communiste dont nous avons parlé plus haut, et à cause de l’émergence d’une mentalité, pourtant combattue de toutes ses forces par le CCI, de « chacun-contre-tous », dans laquelle le principe d’honnêteté au sein de la Gauche communiste a été de plus en plus oublié. Le principe de discussion mutuelle et d’action commune établis par Marx dans la Première Internationale, tout comme l’éthique de toutes les tendances au sein du mouvement prolétarien, ont été de plus en plus ignorés. Concomitamment à cette faillite, et l’exacerbant, il y a eu une prolifération de groupes, souvent rien d’autre que des blogueurs mécontents qui se réclament verbalement de la Gauche Communiste, mais dont la fonction réelle n’a été que dénigrer et calomnier cette tradition organisée du Communisme de Gauche. Cependant, ce dernier dans son ensemble n'a pas réussi jusqu'à présent à serrer les rangs contre ce phénomène malin qui affaiblit encore plus le principe d'honnêteté au sein de la Gauche Communiste[4]
L’affaire du Circulo
La contamination par les pratiques malhonnêtes du gauchisme, dont les symptômes apparaissent avec les falsifications de la CWO dans son dernier article sur son histoire, est une réminiscence d’un épisode précédent du même type, l’infâme scandale de « l’affaire du Circulo », lorsque la TCI (qui s’appelait encore Bureau International pour le Parti Révolutionnaire, BIPR) avait republié sur son site web, sans l’ombre d’une critique, une litanie de calomnies contre le CCI, dont l’origine était un groupe imaginaire d’Amérique Latine appelé « Circulo de Comunistas Internacionalistas ».
Au début des années 2000, le CCI a commencé à discuter avec un groupe en Argentine, sur les positions et principes organisationnels de la Gauche Communiste, et sur l’analyse du mouvement des piqueteros dans ce pays en décembre 2001. En conséquence, ce groupe, le Nucleo Comunista Internacionalista, a lancé un appel international aux groupes de la Gauche Communiste pour organiser des discussions, appel auquel malheureusement seul le CCI a répondu positivement. Le NCI a également écrit une prise de position condamnant les actions d’un groupe parasitaire contre le CCI[5].
Cependant les difficultés que les nouveaux groupes approchant la Gauche Communiste doivent affronter ont été mises au jour par un épisode étrange et destructeur.
Un individu ambitieux au sein du NCI (que nous allons nommer le Citoyen B) a développé un comportement clairement aventuriste au sein du groupe, prenant des allures de gourou, et a demandé péremptoirement une intégration immédiate dans le CCI. Lorsque les conditions de cette demande ont été rejetées, il s’est vengé en prétendant que le NCI s’était transformé lui-même en un groupe politique imaginaire, le « Circulo de Comunistas Internacionalistas »! Cette scandaleuse usurpation a été menée sans que les autres membres du NCI en aient la moindre connaissance.
Au nom de ce groupe fantôme qu’était le « Circulo », le Citoyen B a commencé à publier des prises de position sur Internet et sur son propre compte personnel, renversant ainsi les précédentes positions du NCI contre le parasitisme, et a ainsi soutenu les attaques de ce dernier contre le CCI.
La première de ces prises de position, distribuée sous forme papier lors d’une réunion publique de la TCI à Paris par le groupe parasitaire GIGC[6], déclarait :
- « C’est la voix unilatérale du CCI qui, adoptant les leçons néfastes du stalinisme en 1938 pour liquider la vieille garde bolchevique, tente aujourd'hui de faire la même chose : liquider politiquement les camarades révolutionnaires pour le simple fait de ne pas être d'accord avec sa ligne politique. »
Et on n’a pas seulement Staline, mais aussi Goebbels :
- « Il est nécessaire de mettre un terme à la calomnie et à la politique de Goebbels de mentir et mentir encore et encore, pour qu’il en reste quelque chose. »
Toutes ces ordures calomniatrices contre le CCI, qui viennent des prises de position de ce « Circulo » bidon, sans la moindre preuve pour les étayer, ont été publiées sans commentaire et sans la moindre tentative de les vérifier, en plusieurs langues, sur le site web de la TCI. L’inexistant Circulo a même été salué comme un véritable apport dans les rangs des révolutionnaires.
Le CCI, alarmé par le fait que de pareilles calomnies soient publiées sur le site web d’un groupe de la Gauche Communiste contre une autre tendance de la Gauche Communiste, a immédiatement écrit à la TCI en lui fournissant des preuves que le Circulo n’était que la grotesque invention d’un aventurier, et a demandé que son texte de rectification contre ces scandaleuses calomnies soit publié par la TCI. Il a fallu trois lettres du CCI et trois semaines avant que cela soit fait. Mais le problème ne s’arrête pas là.
Le CCI a contacté les autres membres du NCI pour corroborer les faits et a constaté que les camarades étaient abasourdis d’apprendre l’usurpation et les calomnies du Citoyen B et de son Circulo, et ont décidé d’écrire eux-mêmes une prise de position dénonçant cette imposture et soutenant les faits tels que présentés par le CCI[7].
Tirant la leçon de ce contact, le Citoyen B a redoublé les calomnies de son premier texte, et a produit une seconde tirade.
- «
ces appels téléphoniques n'étaient pas innocents. Ils avaient l'intention sournoise de détruire notre petit noyau, ou ses militants individuels, en provoquant une méfiance mutuelle et en semant les graines de la division dans les rangs de notre petit groupe.
L’actuelle politique du CCI provoque le doute et une atmosphère interne de mutuelle méfiance. Elle utilise la tactique stalinienne de la « terre brûlée », c’est-à-dire non seulement la destruction de notre petit et modeste groupe, mais également une opposition active à toute tentative de regroupement révolutionnaire qui ne serait pas mené par le CCI à travers sa politique sectaire et opportuniste. Et pour cela, il n’a pas hésité à user de toute une série de manœuvres répugnantes dont l’objectif principal était de démoraliser ses opposants, et en ce sens, éliminer tout « ennemi potentiel ».
Le Citoyen B s'est tellement laissé entraîner dans ses manœuvres et ses calomnies qu’il s’est retrouvé à accuser le CCI de détruire un groupe qu’il avait lui-même cherché à remplacer par un autre groupe complètement fictif sorti de son imagination ! Mais quand cette seconde déclaration calomnieuse du « Circulo » est apparue sur le site web de la TCI, cette dernière a refusé de publier la déclaration du NCI qui exposait complètement d’une part la fraude du « Circulo », et d’autre part permettait de clarifier et vérifier tout l’épisode de façon indépendante. La TCI ne l’a pas fait non plus avant que les faits ne deviennent évidents et que le Circulo et le Citoyen B ne disparaissent sans laisser de trace, elle n’a publié aucune rétractation ou mise au point expliquant pourquoi ces calomnies sont apparues sur son site web, ni reconnu les dommages qu’elles ont pu faire sur la réputation non seulement du CCI, mais aussi de toute la Gauche Communiste. La déclaration mensongère du Circulo est même restée plusieurs semaines sur le site web de la TCI avant d’être finalement retirée, comme si rien ne s’était passé.
Le CCI a par la suite écrit une lettre ouverte aux militants de la TCI sur l’extrême gravité qu’il y a à faciliter l’infiltration de méthodes pourries du gauchisme dans le comportement de la Gauche Communiste. Nous avons promis dans cette lettre ouverte que toute action du même type que le scandale du Circulo serait exposée au grand jour, particulièrement si la TCI essayait à nouveau de se sortir du scandale en traitant nos lettres par le silence[8]. Le présent article est la concrétisation de cette promesse.
Plutôt que de tirer les leçons de cette expérience et de reconnaître les attaques du Circulo pour ce qu’elles étaient, ainsi que leur propre grave erreur consistant à les republier, la TCI a répondu à l’époque en ajoutant l’insulte au préjudice subi par le CCI. Au lieu de dénoncer la fraude du Circulo, elle a dénoncé le CCI comme une organisation paranoïaque en plein processus de désintégration, et au lieu de ça s’est présentée en victime des attaques « vulgaires et violentes » du CCI.
Le crime de ce fiasco du Circulo, cependant, d’après ce scénario, n’était pas que la TCI ait facilité une attaque malsaine contre un autre groupe de la Gauche Communiste, mais le fait que le CCI a réagi à ce scandale et dénoncé cette fraude pour ce qu’elle était.
L’impudence ne s’est pas arrêtée là. Après avoir joué un rôle important en étant à l’origine du gâchis du Circulo, la TCI a prétendu être alors trop occupée pour aider à le régler et pour répondre aux critiques du CCI. Cela voulait dire que son important travail vis-à-vis de la lutte de classe signifiait qu’elle n’avait pas de temps à accorder aux disputes entre petits groupes, comme si la tentative de traîner un groupe de la Gauche Communiste dans la boue était une préoccupation mineure.
Si nous rappelons cette histoire du Circulo dans cet article, c’est pour montrer les leçons qui n’ont pas été apprises et les mêmes erreurs dommageables qui sont toujours commises. D’une façon similaire à l’épisode du Circulo, les récentes affabulations diffamatoires concernant le CCI contenues dans l’article sur l’histoire de la CWO sont toujours présentes sur son site web. Non seulement la TCI a refusé de publier la réfutation du CCI, mais elle a aussi refusé toute discussion sur la question avec le CCI, quand bien même en privé elle ne réfute pas les faits en question.
Dans sa lettre la TCI en effet répond à notre demande de rétablir les faits par des insultes similaires à celles qu’elle nous avait lancées en 2004. A l’écouter, le problème ne serait pas les falsifications dans l’article, mais le CCI qui sème le trouble en demandant qu’elles soient publiquement corrigées. La CWO prétend que le CCI joue un jeu politique pour la discréditer. Et elle fait semblant d’être trop occupée pour poursuivre sur cette question, ciao !
En réalité, le « jeu politique » se trouve dans cette tentative de masquer les falsifications contenues dans l’article en les aggravant encore. Le principal discrédit se trouve là. La rectification publique des falsifications originales aurait en fait été portée au crédit de la CWO.
La Gauche Communiste : des positions révolutionnaires + un comportement révolutionnaire
L’implication des réponses de la TCI à notre critique est que le CCI n’est pas lui-même concerné par la lutte de classe, mais seulement par les conflits entre groupes révolutionnaires. Un coup d’œil au travail du CCI sur son site depuis 45 ans révèle immédiatement que ce n’est pas vrai.
Il ne sert à rien de prétendre, pour cacher ses propres manquements à cet égard, que la question d’un comportement honnête des organisations révolutionnaires entre-elles est secondaire, ou sans intérêt par rapport aux buts politiques généraux, aux analyses et interventions de la Gauche Communiste. L’honnêteté organisationnelle de cette dernière dans la classe ouvrière est indispensable à son succès final. Inversement, adopter, ou excuser, des comportements qui sont voisins du gauchisme ne peut que risquer de démoraliser ceux qui rompent avec la gauche contre-révolutionnaire pour s’approcher des positions internationalistes.
Si le Citoyen B et son Circulo ont échoué à faire disparaître immédiatement le NCI en 2004 comme il le souhaitait, le NCI n’a malgré tout pas survécu à cet épisode entièrement frauduleux qui était, comme nous l’avons expliqué, plus proche du gauchisme dont il venait de s’échapper que du milieu de la Gauche Communiste qu’il croyait avoir rejoint. L’expérience a eu sur ses membres des effets démoralisateurs à long terme.
Aujourd’hui, sans un comportement révolutionnaire des groupes de la Gauche Communiste, il existe un réel danger de détruire le potentiel de nouveaux militants qui s’approchent des positions de classe.
Sans un comportement révolutionnaire, les nouveaux militants révolutionnaires auront du mal à distinguer non seulement la Gauche Communiste de toutes les strates du gauchisme, mais la véritable Gauche Communiste de la fausse. Les innombrables micro-groupes, aventuriers, individus pleins de rancœur, qui aujourd’hui prétendent faire partie de la tradition de la Gauche Communiste alors qu’ils se consacrent à la discréditer, comme cet infâme Circulo, sont la preuve que la plate-forme internationaliste est davantage qu’un document, c’est un mode de vie, d’intégrité organisationnelle.
Cependant, si les différents groupes respectaient un commun standard de comportement, cela renforcerait la présence du milieu Communiste de Gauche au sein de la classe ouvrière toute entière.
Le programme politique de la Gauche Communiste, c’est-à-dire l’élaboration dans la classe ouvrière de la vérité révolutionnaire de la lutte prolétarienne, dépend d’un comportement organisationnel cohérent avec ces idées politiques. Le combat pour l’unité internationale du prolétariat contre les mensonges de l’impérialisme et de tous ses thuriféraires, par exemple, ne peut être mis en œuvre avec les mêmes valeurs morales que ces derniers et leur mépris de la vérité.
Ce n’est pas un appel à une idée morale éternelle, mais la reconnaissance que la fin et les moyens d’une organisation révolutionnaire, le but et le mouvement, sont inséparables et en constante interaction.
Le CCI, en mettant en lumière les falsifications de l’article sur l’histoire de la CWO, ne joue pas un « jeu ». Il est très sérieux et continuera à faire de la question de l’honnêteté révolutionnaire et de la précision un aspect central de l’intervention communiste.
- « Participer au combat de la Gauche communiste ne signifie pas seulement défendre ses positions politiques. Cela signifie aussi dénoncer des comportements politiques tels que les rumeurs, le mensonge, la calomnie, le chantage qui tournent le dos aux principes du combat du prolétariat pour son émancipation. [9] »
[1] Communist Workers Organisation, groupe affilié à la TCI en Grande-Bretagne, « On the Forty-Fifth Anniversary of the Founding of the CWO [240] », sur leftcom.org.
[2] Au côté de la CWO, la principale organisation de la TCI est le Parti Communiste Internationaliste (Partito Comunista Internazionalista / Battaglia Comunista) en Italie. Tout comme le CCI, elles sont les héritières de la tradition de la Gauche communiste, surtout connue pour ses positions internationalistes pendant la Seconde Guerre mondiale. Entre 1984, lorsque le regroupement formel de la CWO et du PCInt s’est amorcé, et 2009, la TCI s’est appelée BIPR (Bureau International pour le Parti Révolutionnaire).
[3] La réponse de la TCI a été envoyée par « le Comité Exécutif de la CWO ».
[4] Cela ne veut pas dire que le PCInt/TCI a été incapable de réagir à de telles calomnies contre lui-même. En 2015, une prise de position est parue sur le site web de la TCI, « Réponse à une vile calomnie », dénonçant les mensonges d’anciens militants contre des membres de la TCI :« Leurs accusations ne nous auront rien épargné : peur, couardise, trahison, opportunisme individuel, jusqu’aux accusations de liens avec les services de l’État bourgeois. Ils n’ont jamais produit l’ombre d’une preuve. Mais vu que ceux qui profèrent des accusations ont la charge de la preuve, l’absence totale de telles preuves concrètes est aussi la preuve de la malhonnêteté de ces individus et de leurs manœuvres…
Dans l’histoire de notre Parti, nous n’avons vu pareille chose, sous une forme plus sérieuse, que pendant la Seconde Guerre mondiale, lorsque des militants internationalistes ont été ciblés par les malfrats de Togliatti, qui ont justifié leurs campagnes de persécution allant jusqu’à l’assassinat par l’accusation d’être « au service de la Gestapo ». »
Cependant la TCI a refusé de généraliser cette expérience et d’en tirer les évidents parallèles qui existent dans les attaques similaires contre le CCI. Elle a été de ce fait incapable de défendre le milieu de la Gauche Communiste dans son ensemble contre un milieu hostile de calomniateurs et de dénigreurs. Pire, la TCI a fait la grosse erreur de tenter de recruter de nouveaux membres et sections au sein de tels cloaques, et elle a inévitablement été infectée par ce dernier, au détriment de la Gauche communiste comme un tout.
Le CCI pour sa part a toujours tenté de défendre les autres groupes de la Gauche Communiste contre la calomnie, même si la solidarité du CCI n’a jamais été réciproque. Il soutient ainsi la TCI dans sa « Réponse à une vile calomnie » : Communiqué de solidarité avec la TCI [241]. Le CCI a fait de même lorsque le groupe Los Angeles Worker’s Voice a lancé une campagne visant à dénigrer la TCI (voir Révolution internationale n° 325 : Milieu politique prolétarien - Une attaque parasitaire contre le BIPR [242]).
[5] Voir Le Núcleo Comunista Internacional : Un effort de prise de conscience du prolétariat en Argentine [243] pour un historique de ce groupe.
[6] GIGC, groupe appelé auparavant FICCI. Pour une histoire de ce groupe, voir L'aventurier Gaizka a les défenseurs qu'il mérite : les voyous du GIGC [244]
[7] Les camarades du NCI ont également essayé de rencontrer face à face le Citoyen B à Buenos Aires, pour le confronter aux faits. Mais il est resté injoignable.
Vie du CCI:
- Polémique [246]
Courants politiques:
- Gauche Communiste [163]
- TCI / BIPR [247]
Rubrique:
Lettre ouverte du CCI aux militants du BIPR (Décembre 2004)
- 1891 lectures
Nous republions une lettre que nous avions adressée au BIPR en décembre 2004 suite à l'apparition sur son site d'une déclaration émanant d'un mystérieux "Cercle des Communistes Internationalistes", comportant une série d'accusations extrêmement graves contre le CCI. Malgré les protestations de notre organisation dont il n'avait pas tenu compte, le BIPR n'avait alors pas entrepris la moindre vérification de la réalité du groupe ni du contenu des accusations en question. Il avait alors fallu que la réalité de l'imposture devienne tellement évidente pour que le BIPR (maintenant TCI) commence à retirer progressivement de son site, et en catimini, les accusations mensongères et calomnieuses à l'encontre de notre organisation qu'il avait complaisamment relayées.
Les raisons de la présente republication de ce document sont liées au fait que de nouveau nous sommes confrontés à un problème de comportement politique de la part de la TCI.[1]
Paris, le 7 décembre 2004
***
Camarades,
Depuis le 2 décembre, on a assisté à de discrètes modifications sur le site Internet du BIPR. Tour à tour la version anglaise puis la version espagnole de la « Déclaration du Cercle des Communistes Internationalistes contre la méthodologie nauséabonde du CCI » du 12 octobre qui s’y trouvaient depuis plus d’un mois et demi ont disparu (très curieusement, la version française de cette déclaration est encore présente au moment où nous vous envoyons cette lettre : le BIPR aurait-il une politique différente suivant les pays et suivant les langues ? ([2]). Par ailleurs, sur les pages en Italien de votre site, le chapeau précédant la « Prise de position du Cercle des Communistes Internationalistes sur les faits de Caleta Olivia » a été réduit des trois quarts en perdant le passage suivant : « Récemment, le Noyau Communiste Internationaliste d’Argentine a rompu avec le Courant communiste international, que, depuis longtemps, nous considérons comme une survivance désormais inutile d’une vieille politique indiscutablement non adaptée pour contribuer à la formation du Parti international. L’organisation argentine a également changé de nom en prenant celui de Cercle des Communistes Internationalistes. » (“Recentemente il Nucleo Comunista Internazionalista di Argentina ha rotto con la Corrente Comunista Internazionale, che da tempo indichiamo come ormai inutile sopravvivenza di una vecchia politica sicuramente non adeguata a contribuire alla formazione del Partito internazionale. L'organizzazione argentina ha anche cambiato nome assumendo quello di Circolo di Comunisti Internazionalisti.”).
Ces modifications démontrent que le BIPR commence (peut-être ?) à prendre conscience du guêpier dans lequel il s’est fourré en prenant pour argent comptant et en publiant sans la moindre précaution ce que le prétendu « Circulo » a raconté dans ses différentes « déclarations », notamment à propos du comportement du CCI. En d’autres termes, le BIPR n’est plus en mesure de se cacher à lui-même, ni surtout de cacher aux lecteurs de son site Internet, ce que le CCI a affirmé depuis près de deux mois : les accusations portées contre notre organisation sont de purs mensonges inventés par un élément trouble, un imposteur mythomane et sans scrupule. Cela dit, l’effacement discret et progressif de ces « déclarations » n’efface ni ne répare en aucune façon la faute politique considérable, pour ne pas dire le comportement inqualifiable, dont s’est rendue responsable votre organisation. Bien au contraire.
C’est pour cela que cette lettre se veut un appel solennel aux militants du BIPR face à un comportement de leur organisation absolument scandaleux et incompatible avec tout ce qui fonde une démarche de classe prolétarienne.
Un bref rappel des faits :
Vers la mi-octobre, le BIPR publie en plusieurs langues sur son site Internet cette fameuse « Déclaration contre la méthodologie nauséabonde du CCI » du soi-disant « Circulo de Comunistas Internacionalistas » qui se présente comme le successeur du « Nucleo Comunista Internacional » avec qui le CCI a entretenu des discussions depuis plusieurs mois (avec notamment deux rencontres en Argentine même entre le NCI et des délégations du CCI).
Que contient en substance cette « Déclaration » ? Il s'agit d'une série d'accusations extrêmement graves contre notre organisation :
- le CCI utilise des « pratiques qui ne correspondent pas à l'héritage légué par la Gauche communiste, mais bien plutôt aux méthodes propres à la gauche bourgeoise et au stalinisme » avec « l'intention sournoise de détruire [notre petit noyau] (c'est-à-dire le « Circulo », nouvelle appellation du NCI), ou ses militants de manière individuelle en provoquant la méfiance mutuelle et en semant les germes de la division dans les rangs de notre petit groupe » ;
- le CCI « s'est engagé dans une dynamique de destruction non seulement contre ceux qui se risquent à défier les ‘lois et théories immuables’ des gurus de ce courant mais aussi contre tous ceux qui essaient de penser par eux-mêmes et disent NON aux chantages du CCI » ;
- le CCI utilise « la tactique stalinienne de 'terre brûlée', c'est-à-dire non seulement la destruction de notre petit et modeste groupe, mais aussi l'opposition active à toute tentative de regroupement révolutionnaire dont le CCI ne serait pas à la tête, par ses politiques sectaires et opportunistes. Et pour cela, il n'hésite pas à utiliser toute une série de ruses répugnantes avec pour objectif central celui de démoraliser ses opposants et, ainsi, de pouvoir éliminer un 'ennemi potentiel' » ;
- « manquant d'adhésion à ses positions qui n'ont rien à voir avec la tradition révolutionnaire, le CCI essaie de saboter toute tentative de regroupement révolutionnaire comme ce fut le cas lors de la Réunion Publique [du BIPR] du 2 octobre 2004 à Paris (France) et (…) il cherche aujourd'hui à détruire notre petit groupe d'Argentine ».
N'importe quel lecteur averti des questions concernant les groupes de la Gauche communiste (ou qui s'en réclament) aura reconnu le style de calomnies que la FICCI déverse depuis plusieurs années sur notre organisation. Mais l'analogie ne s'arrête pas là. On la retrouve aussi dans l'aplomb avec lequel les mensonges les plus gros sont assénés :
- « Sur leur demande unanime, les camarades que le CCI a appelés au téléphone pour semer les germes de la méfiance et de la destruction de notre petit groupe, proposent à l'ensemble des membres du Cercle de communistes internationalistes le rejet total de la méthode politique du CCI qu'ils considèrent comme typiquement stalinienne et dont l'objectif central, objectif de la direction actuelle du CCI, est d'empêcher le regroupement révolutionnaire pour lequel divers courants et groupes luttent ; et ils proposent de dénoncer ces agissements devant l'ensemble des courants qui se déclarent dans la continuité de la Gauche communiste.»
La réalité est très différente, comme nous l'avons rapporté déjà dans d'autres textes et comme c'est dit dans la déclaration du NCI datée du 27 octobre : Effectivement, nous avons appelé un camarade du NCI mais ce n'était nullement pour tenter de « détruire [le NCI] ou ses militants de manière individuelle ».
Le but de notre premier appel était d’essayer de comprendre comment s’est constitué ce « Circulo de Comunistas Internacionalistas » et pourquoi des camarades qui avaient témoigné quelques semaines auparavant une attitude extrêmement fraternelle à notre délégation et qui n’avaient manifesté aucun désaccord avec le CCI (notamment à propos des comportements de la FICCI), adoptaient maintenant, le 2 octobre, une « Déclaration » particulièrement hostile à notre organisation et tournant le dos à tout ce qu’ils avaient défendu jusqu’à présent. Dès ce moment-là, nous nous doutions que l’ensemble des camarades du NCI n’étaient pas associés à cette « Déclaration » (malgré ce qui y était affirmé sur « l’unanimité » de cette démarche parmi les membres du NCI). Les discussions que nous avons eues par téléphone avec les camarades du NCI nous ont permis de les informer de ce qui était en train de se passer : l’apparition d’un « Circulo » qui se présentait comme le continuateur du NCI et qui déchaînait des attaques contre le CCI. Nous avons pu également vérifier que ces camarades n’avaient aucune connaissance de cette nouvelle politique menée par le citoyen B. (le seul à pouvoir accéder à l’Internet) dans leur dos et en leur nom. Quand nous avons demandé au camarade que nous avions pu joindre en premier s’il souhaitait qu’on le rappelle, il a répondu par l’affirmative en insistant pour que ces appels soient les plus fréquents possibles et il a suggéré que nous le rappelions au moment où il se trouverait en compagnie des autres camarades pour que nous puissions leur parler également. Voilà ce qu’il en est « de la demande unanime des camarades que le CCI a appelés » : ils n’ont nullement « proposé à l’ensemble des membres du ‘Cercle’ le rejet total de la méthode politique du CCI » mais l’ont chaleureusement approuvée. Et la méthode « qu’ils considèrent comme typiquement stalinienne » est celle de Monsieur B.
Cet intéressant personnage, au début de sa déclaration du 12 octobre nous avertit : ce qu’il affirme sur la « méthodologie du CCI » peut « sembler un mensonge ». Effectivement, les « déclarations » de Monsieur B. peuvent « sembler un mensonge ». Et il y a une bonne raison à cela : c’est réellement un mensonge, un pur mensonge. Évidemment, la FICCI a immédiatement cru ce mensonge qui ressemblait à un mensonge. Tout ce qui peut lui permettre de jeter de la boue sur notre organisation est pain béni pour elle et peu lui importe si l’accusation « peut sembler un mensonge ». Après tout, le mensonge est sa seconde nature, sa marque de fabrique (à côté du chantage, du vol et du mouchardage). Mais ce qui est en revanche absolument invraisemblable, qui « semble un mensonge », c’est qu’une organisation de la Gauche communiste, le BIPR ait pris le même chemin que la FICCI en publiant sur son site Internet, sans le moindre commentaire, donc en les cautionnant totalement, les élucubrations infâmes de Monsieur B.
Le BIPR aime bien faire la leçon aux autres, par exemple en donnant sa propre interprétation des crises du CCI en croyant sur parole les mensonges de la FICCI et sans même se donner la peine d’examiner sérieusement l’analyse qu’en fait le CCI lui-même (voir par exemple « Éléments de réflexion sur les crises du CCI » sur le site Internet du BIPR). En revanche, il n’apprécie pas qu’on lui fasse des suggestions sur sa façon de se comporter : « nous rejetons comme ridicule les ‘mises en garde’ de la part [du CCI] », « Ce n’est pas au CCI, ni à aucun autre que nous devons rendre compte de notre façon d’agir politique et la prétention du CCI à relancer de présumées traditions de la gauche communiste semble seulement pathétique » (voir Réponse aux accusations stupides d’une organisation en voie de désintégration, sur le site Internet du BIPR). Malgré cela, nous nous permettons de lui dire comment aurait agi le CCI s’il avait reçu une déclaration comme celles du « Circulo » mettant gravement en cause le BIPR.
La première chose que nous aurions faite, aurait été de contacter le BIPR et de lui demander son avis sur de telles accusations. Nous aurions également vérifié la crédibilité et l’honnêteté de l’auteur de ce type d’accusation. S’il s’était avéré que l’accusation était mensongère, nous aurions immédiatement dénoncé ce comportement en apportant notre solidarité au BIPR. Si l’accusation avait été fondée, et que nous avions estimé nécessaire de la faire connaître par nos moyens de presse, nous aurions demandé au BIPR sa propre position afin de la publier à côté du document l’accusant.
Vous pouvez peut être estimer que ce sont là des paroles platoniques et que dans la réalité nous aurions fait tout autre chose. Les lecteurs de notre presse en tout cas savent que c’est là la façon d’agir du CCI que nous avons d’ailleurs déjà mise en pratique lorsque la ‘LA Workers Voice’ s’est lancée dans une campagne de dénigrement du BIPR (voir Internationalism n° 122).
Comment a agi le BIPR quand il a reçu la « Déclaration du ‘Circulo’ » ? Non seulement il s’est contenté de la cautionner en la publiant en plusieurs langues sur son site sans la moindre vérification de son authenticité, mais il a refusé pendant plus d’une dizaine de jours de publier le démenti que nous lui avions demandé à plusieurs reprises (voir nos lettres des 22, 26 et 30 octobre) d’adjoindre à la déclaration du « Circulo ».
La publication de notre démenti était le minimum que pouvait faire le BIPR (et que n’importe quel journal bourgeois accepte en général) et il a fallu cependant trois lettres pour qu’il y parvienne, trois lettres et un certain nombre de faits qui commençaient à démontrer le caractère mensonger de la « déclaration ». L’insertion de notre démenti était le minimum mais c’était encore nettement insuffisant puisque, en ne prenant pas position sur la déclaration du « Circulo » le BIPR continuait à cautionner ses mensonges. C’est pour cela que dans nos lettres du 17 et du 21 novembre nous vous avons demandé « de publier immédiatement (c'est-à-dire dès réception de ce courrier) sur votre site Internet la Déclaration du NCI du 27 octobre qui se trouve sur notre propre site dans toutes les langues correspondantes », une déclaration n’émanant pas du CCI, dont on pouvait toujours laisser entendre qu’il racontait n’importe quoi, mais des principaux témoins de l’imposture et des mensonges calomnieux de Monsieur B. A ce jour, vous n’avez toujours pas publié cette déclaration du NCI (qui vous l’a adressée de Buenos Aires par courrier postal) dont vous savez pertinemment qu’elle est véridique puisque vous avez entrepris de retirer progressivement et discrètement de votre site la déclaration du « Circulo ».
Pendant des semaines, vous avez « fait le mort » devant les demandes du CCI afin que soit rétablie la vérité. Maintenant que celle-ci éclate de plus en plus (et ce n’est pas grâce à vous), vous choisissez la méthode la plus hypocrite possible pour tenter d’éviter qu’elle ne vous éclabousse : vous retirez un document qui pendant près de deux mois a déversé sur notre organisation des tombereaux de boue avec le même silence qui avait accompagné sa mise en circulation par vous.
Camarades, êtes-vous conscients de la gravité de vos comportements ? Êtes-vous conscients que cette attitude n’est pas digne d’un groupe qui se réclame de la Gauche communiste mais appartient aux méthodes du trotskisme dégénéré, voire du stalinisme. Vous rendez-vous compte que vous faites la même chose que Monsieur B. (dont les tractations récentes avec le site « Argentina Roja » font la preuve qu’il revient à ses anciennes amour staliniennes) qui a passé son temps à faire apparaître et disparaître des documents sur son site Internet afin d’essayer de masquer ses coups tordus ?
En tout cas, puisque vous avez mis vos moyens de communication au service de la calomnie contre le CCI, il ne suffit pas d’escamoter discrètement cette calomnie comme si rien ne s’était passé. Vous avez commis une faute politique d’une extrême gravité et il faut maintenant la réparer. Le seul moyen digne d’une organisation du prolétariat est de déclarer sur votre site Internet que le document qui s’y est trouvé pendant près de deux mois est une collection de mensonges et de dénoncer les agissements de Monsieur B.
Nous comprenons l’amère déception que vous avez dû ressentir en découvrant la vérité : le NCI n’a pas rompu avec le CCI et le « Circulo » sur qui vous fondiez les plus grands espoirs (voir votre article dans Battaglia Comunista d’octobre « Anche in Argentina qualcosa si muove ») n’est pas autre chose qu’une imposture sortie de l’imagination de Monsieur B. Néanmoins, ce n’est pas une raison pour esquiver toute prise de position sur les méthodes de cet imposteur. C’est aussi une question de solidarité élémentaire avec les militants du NCI qui ont été les premières victimes des manipulations infâmes de cet élément qui a usurpé leur nom.
De même, nous comprenons qu’il vous soit pénible de reconnaître publiquement, une nouvelle fois (après votre communiqué du 9 septembre 2003 sur les « Communistes radicaux d’Ukraine »), que vous avez été victimes d’une imposture. Lorsque cette mésaventure vous est arrivée, le CCI n’a pas fait le moindre commentaire. Plutôt que de remuer le couteau dans la plaie, nous avons pensé qu’il vous appartenait, puisque vous êtes une « force dirigeante responsable » (suivant vos propres termes), de tirer les leçons de cette expérience. Pourtant celle-ci ne nous a pas surpris après les déboires que vous aviez rencontrés, notamment avec le SUCM et le LAWV, malgré nos mises en garde que vous aviez « rejetées comme ridicules ». Mais aujourd’hui, le problème va bien plus loin que le ridicule d’avoir été le dindon de la farce. Derrière la touchante naïveté avec laquelle vous avez cru sur parole un escroc mythomane, il y a la duplicité avec laquelle vous avez accueilli sur votre site les infamies de cet individu. C’est un comportement absolument indigne d’une organisation qui se réclame de la Gauche communiste.
Le BIPR affirme que le CCI a « perdu toute capacité/possibilité de contribuer positivement au procès de formation de l'indispensable parti communiste international » (« avendo cioè perso ogni capacità/possibilità di contribuire positivamente al processo di formazione dell'indispensabile partito comunista internazionale », Battaglia comunista d’octobre 2004, « Anche in Argentina qualcosa si muove »). Contrairement au BIPR (et aux différentes petites chapelles du courant bordiguiste), le CCI n’a jamais considéré qu’il était la seule organisation capable de contribuer positivement à la formation du futur parti révolutionnaire mondial, même si, évidemment, il estime que sa propre contribution à cette tâche sera la plus décisive. C’est pour cela que, depuis qu’il est réapparu en 1964 (donc bien avant la fondation du CCI proprement dite), notre courant a repris l’orientation qui était celle de la Gauche communiste de France et a toujours défendu la nécessité du débat fraternel et de la coopération (évidemment dans la clarté) entre les forces de la Gauche communiste. Avant même que Battaglia Comunista en fasse la proposition en 1976, nous avions déjà, à plusieurs reprises, mais en vain, proposé à cette organisation d’organiser des conférences internationales des groupes de la Gauche communiste. C’est pour cela que nous avons répondu avec enthousiasme à l’initiative de Battaglia et que nous nous sommes impliqués avec sérieux et détermination dans cet effort. C’est pour cela également que nous avons regretté et condamné la décision de Battaglia et de la CWO de mettre fin à cet effort à la fin de la 3e conférence en 1980.
Effectivement nous considérons que certaines des positions du BIPR sont confuses, erronées ou incohérentes et qu’elles peuvent créer ou entretenir des confusions au sein de la classe. C’est pour cela que nous publions régulièrement dans notre presse des polémiques critiquant ces positions. Cependant, nous pensons que le BIPR, par ses principes fondamentaux, est une organisation du prolétariat et qu’il apporte une contribution positive au sein de celui-ci face aux mystifications bourgeoises (notamment quand il défend l’internationalisme face à la guerre impérialiste). C’est pour cela que nous avons toujours considéré jusqu’à présent qu’il était de l’intérêt de la classe ouvrière de préserver une organisation comme le BIPR. Ce n’est pas votre analyse concernant notre propre organisation puisque après avoir affirmé dans votre réunion avec la FICCI de mars 2002 que « si nous sommes amenés à conclure que le CCI est devenu une organisation 'non valable', alors notre but sera de tout faire pour pousser à sa disparition » (Bulletin de la FICCI n° 9) vous avez maintenant entrepris effectivement de tout faire pour atteindre ce but.
Le fait que vous estimiez que le CCI constitue un obstacle à la prise de conscience de la classe ouvrière et qu’il est préférable pour le combat de celle-ci qu’il disparaisse ne nous pose pas en soi de problème. Après tout, c’est la position qu’ont toujours défendue les différentes chapelles du courant bordiguiste. De même, cela ne nous pose pas de problème que vous vous donniez les moyens de parvenir à cet objectif. La question est : quels moyens ? La bourgeoisie également est intéressée à la disparition du CCI, comme à la disparition des autres groupes de la Gauche communiste. C’est pour cela, notamment, qu’elle a déchaîné des campagnes répugnantes contre ce courant en l’assimilant au courant « révisionniste » complice de l’extrême droite. Pour la classe dominante TOUS les moyens sont bons, y compris et surtout, le mensonge et la calomnie. Mais tel n’est pas le cas pour une organisation qui prétend lutter pour la révolution prolétarienne. Au même titre que les autres organisations révolutionnaires du mouvement ouvrier qui l’ont précédée, la Gauche communiste ne se distingue pas seulement par des positions programmatiques, tel l’internationalisme. Dans son combat contre la dégénérescence de l’IC et contre la dérive opportuniste du trotskisme qui l’a conduit dans le camp bourgeois, la Gauche a toujours revendiqué une méthode basée sur la clarté, et donc la vérité, notamment contre toutes les falsifications dont le stalinisme s’est fait le pourvoyeur. Marx disait « la vérité est révolutionnaire ». En d’autres termes, le mensonge, et encore plus la calomnie, ne sont pas des armes du prolétariat mais de la classe ennemie. Et l’organisation qui en fait un de ses instruments de combat, quelle que soit la validité des positions inscrites dans son programme, prend le chemin de la trahison ou, en tout cas, devient un obstacle décisif à la prise de conscience de la classe ouvrière. Dans un tel cas, effectivement, et bien plus qu’au motif de la présence d’erreurs dans son programme, il est préférable, du point de vue des intérêts du prolétariat, qu’une telle organisation disparaisse.
Camarades,
Nous vous le disons franchement : si le BIPR persiste dans la politique du mensonge, de la calomnie et, pire encore du « laisser dire » et du silence complice devant les agissements des groupuscules dont c’est la marque de fabrique et la raison d’exister, tels le « Circulo » et la FICCI, alors il fera la preuve qu’il est devenu lui aussi un obstacle à la prise de conscience du prolétariat. Ce sera un obstacle non pas tant pour le discrédit qu’il pourra apporter à notre organisation (les derniers événements ont montré que nous étions capables de nous défendre, même si vous estimez que « le CCI est en voie de désagrégation »), mais par le discrédit et le déshonneur que ce type de comportements inflige à la mémoire de la Gauche communiste d’Italie, et donc à sa contribution irremplaçable. Dans ce cas, effectivement, il sera préférable que le BIPR disparaisse et « notre but sera de tout faire pour pousser à sa disparition » comme vous le dites si bien. Il est clair, évidemment, que pour atteindre ce but nous emploierons exclusivement des armes appartenant à la classe ouvrière en nous interdisant, cela va de soi, le mensonge et la calomnie.
Un dernier point :
La déclaration du 12 octobre du « Circulo », de même que l’article de la FICCI dans son Bulletin 28, évoque nos prétendues « tentatives de sabotage » lors de votre réunion publique du 2 octobre à Paris. Vous-mêmes n’êtes pas étrangers à ce type d’accusations puisque dans la première version de votre prise de position sur cette réunion publique parue uniquement en italien (et non en français – encore un mystère du BIPR !) vous évoquiez « le avanguardie rivoluzionarie anche laddove scarseggiano, ostacolate nel loro emergere dai miasmi prodotti da una organizzazione in via di disfacimento, come la Cci a Parigi. E' per questo che il Bipr continuerà il suo lavoro anche su Parigi, prendendo tutte le misure necessarie a prevenire ed evitare sabotaggi, da qualunque parte essi vengano. »(les avant-gardes révolutionnaires même si elle sont réduites, et entravées dans leur émergence par les miasmes produits par une organisation en voie de désagrégation, comme le CCI à Paris. C’est pour cela que le BIPR poursuivra son travail même sur Paris, en prenant toutes les mesures nécessaires pour prévenir et éviter des sabotages, d’où qu’ils viennent. »). Par la suite, vous avez retiré la fin de ce passage (preuve que vous n’étiez pas très sûrs de vous), et notamment la référence à nos « sabotages ». Cela dit, un certain nombre de visiteurs de votre site et les contacts abonnés à vos communiqués par Email ont pu prendre connaissance de ces accusations. De même, la FICCI et le « Circulo » continuent de les afficher sur leur propre site sans que vous les démentiez.
Camarades, si vous estimez que nous avons essayé de saboter votre réunion publique à Paris, alors dites-le franchement, en expliquant pourquoi. Nous pourrons alors en discuter avec des arguments au lieu d’être confrontés à une rumeur sournoise.
Une toute dernière chose. La présente lettre est centrée autour d’une seule question : la publication sur votre site Internet d’une « Déclaration » infâme calomniant le CCI. Cela dit, l’usage (de façon active ou passive) du mensonge et de la calomnie comme moyen de « combat » contre le CCI ne s’arrête pas là. Nous vous rappelons que nous vous avons écrit deux lettres dans lesquelles nous vous demandons entre autres une prise de position sur une question de la plus haute importance (à moins que les mots n’aient pas de sens) : « Pensez-vous, comme n'a cessé de le répéter la FICCI, que le CCI serait sous la coupe d'agents de l'État capitaliste (appartenant à sa police ou à une secte franc-maçonne) ? »
Nous vous rappelons également qu’à ce jour, même si vous justifiez le vol par la FICCI de notre fichier des abonnés, vous n’avez pas fourni d’explication au fait que ces derniers ont reçu par la poste une invitation à votre réunion publique, même lorsqu’ils ne vous avaient pas communiqué leur adresse. La seule « explication » que nous ayons eue est celle d’un membre du présidium de votre réunion publique du 2 octobre à Paris qui a dit : « nous n’étions pas au courant de l’envoi de ces invitations et nous ne sommes pas d’accord ».
- Si ce n’est pas le BIPR qui a fait ces envois, alors qui les a faits ?
- Pourquoi n’approuvez pas cette initiative puisque vous approuvez le vol de notre fichier des abonnés ?
Si vous n’avez pas envie de fournir ces explications au CCI, nous vous demandons d’avoir au moins la correction de les fournir à nos abonnés, lesquels ne sont pas nécessairement des sympathisants du CCI.
Voici donc un ensemble de questions qui pour nous ne sont pas closes. Et nous les remettrons sur le tapis chaque fois que nécessaire si vous décidez d’appliquer votre politique traditionnelle du silence face à nos courriers.
Recevez, camarades, nos salutations communistes.
Le CCI
[1] Lire notre article "La vérité est révolutionnaire - Pour une histoire véridique de la Gauche communiste (Correspondance avec la TCI) [248]".
[2] C’est une question qui ne se pose pas seulement à propos de la date du retrait de la « Déclaration » du 12 octobre mais également à propos de son insertion dans le site du BIPR. En effet, cette déclaration n’est jamais parue en italien alors que dans cette langue ont été publiés deux autres textes du Circulo « Presa di posizione del Circolo di Comunisti Internazionalisti sui fatti di Caleta Olivia » (« Prise de position du Cercle des Communistes Internationalistes sur les faits de Caleta Olivia ») et « Prospettive della classe operaia in Argentina e nei paesi periferici » (« Perspective du prolétariat Argentin et dans les nations périphériques ») lesquels, paradoxalement, n’ont pas été publiés dans d’autres langues par le BIPR. Comprenne qui pourra. Nous espérons au moins que les militants du BIPR connaissent les raisons de ces choix surprenants.
Vie du CCI:
Courants politiques:
- Gauche Communiste [163]
- TCI / BIPR [247]
Rubrique:
Le CCI a-t-il modifié son analyse à l’égard des “gilets jaunes”? (Partie 1)
- 174 lectures
Nous publions ci-dessous le courrier d’un camarade à propos de notre traitement du mouvement des “gilets jaunes”, suivi de notre réponse. Dans l’esprit de débat fraternel qui a toujours animé le CCI, nous invitons nos lecteurs à suivre l’exemple du camarade et à nous envoyer questions ou divergences. Nous ne pouvons naturellement publier l’ensemble des courriers, mais nous nous efforçons de répondre aux principales préoccupations et aux questions centrales pour le développement de la conscience de classe.
“La lecture du journal est toujours intéressante et enrichissante mais ce courrier est destiné à donner mon sentiment sur un article particulier de ce numéro : “Hordes trumpiste et gilets jaunes, un amalgame pour criminaliser toute révolte contre la misère”.(1)
En effet, je trouve que le ton général de cet article resitue bien le mouvement des gilets jaunes dans le contexte de son apparition : “un mouvement de révolte contre la misère et la pauvreté” comme il est dit dans le dernier paragraphe de l’article.
Dans les articles du journal parus “à chaud” pendant le mouvement, fin 2018 à mi-2020, le ton était beaucoup plus agressif vis-à-vis des participants. Comme il est rappelé dans le n° 486, c’était “les secteurs les plus pauvres du prolétariat (les zones rurales et péri-urbaines”. En plus de cette localisation géographique, on peut ajouter la surreprésentation des retraités, des femmes élevant seules leurs enfants, des chômeurs, des précaires. J’ai eu l’impression à cette époque qu’il n’y avait aucune empathie de la part des camarades qui écrivent les articles pour ces secteurs peut-être faibles du prolétariat, mais en en faisant partie quand même. J’ai ressenti à ce moment un ton du journal dénué de compassion, sur un ton professoral, condescendant, donneur de leçons. Ce ton m’avait gêné à l’époque même si je ne vous en avais pas fait part
Dans l’article du n° 486, les faiblesses de ce mouvement sont redites, mais pas de la même façon. Il est réaffirmé deux fois qu’il y avait une composante ouvrière dans les gilets jaunes qui est sortie du piège de l’interclassisme en “faisant valoir ses propres revendications”.
J’espère que l’article du n° 486 marque une évolution dans l’évaluation du mouvement des gilets jaunes qui me convient beaucoup mieux. Les articles précédents me laissant un goût amer. En étant excessif, je dirais qu’ils me rappelaient la réflexion du personnage d’artiste joué par Jean Gabin dans le film La traversée de Paris : “salauds de pauvres !”.
Amitiés.
D.”
Notre réponse
Tout d’abord, nous voulons saluer le courrier que nous adresse le camarade. En effet, il est toujours très important d’exprimer ses doutes et désaccords afin d’avancer dans la clarification des questions politiques qui sont posées à la classe ouvrière. Nous saluons d’ailleurs la confiance du camarade envers le CCI pour l’expression de ses questionnements et de ses critiques face à une situation complexe qui touche aux difficultés actuelles de la classe ouvrière.
Dans ce courrier, deux questions sont posées à notre avis :
– Le CCI aurait modifié sa position concernant le mouvement des “gilets jaunes” ou, tout du moins, aurait modifié son analyse concernant la participation d’ouvriers dans ce mouvement.
– Le CCI aurait fait preuve, précédemment, d’un certain “mépris” à l’égard des prolétaires ayant participé au mouvement.
Sur la première question, la position du CCI a toujours été la même dans le fond comme dans la forme : le mouvement des “gilets jaunes” était un mouvement interclassiste et non prolétarien, même s’il a entraîné dans son sillage un certain nombre d’ouvriers excédés par les augmentations de taxes sur les carburants, réagissant à toute la pression étatique et se sentant “délaissés” par un pouvoir, pour le coup, méprisant.
Sur le fond, ce mouvement a largement été initié par des petits patrons, auto-entrepreneurs et petits-bourgeois réclamant plus de considération de la part de l’État, réclamant une plus grande justice fiscale favorable à leur petite entreprise, une meilleure gestion du système économique capitaliste, un fonctionnement plus démocratique de l’État, avec des revendications économiques et politiques, relevant pour beaucoup d’une vision nationaliste petite-bourgeoise, souvent chauvine et même xénophobe par moments ! Cela au point que même la droite et l’extrême-droite on pu exprimer sans sourciller leur soutien au mouvement.
Un certain nombre d’ouvriers particulièrement issus des zones péri-urbaines, provinciales, excédés certes, mais très peu politisés et sans véritables expériences de luttes collectives et massives sur un terrain prolétarien, se sont effectivement agrégés à ce mouvement en y ajoutant des revendications salariales noyées dans toutes les autres revendications et, à aucun moment, reprises sérieusement à leur compte par l’ensemble du mouvement. Rapidement, ces revendications sont d’ailleurs entrées en contradictions avec les intérêts des petits patrons qui ne voulaient surtout pas entendre parler d’augmentation du salaire minimum.
La présence d’ouvriers n’a donc jamais donné un caractère prolétarien au mouvement des “gilets jaunes”, n’a jamais “transformé” de manière prolétarienne ni le terrain de lutte ni les moyens de lutte qui sont restés typiquement petit-bourgeois, l’expression même de l’impuissance de la petite bourgeoisie à avoir une perspective historique et une vision collective et associée de sa lutte…
Sur ce plan, notre position n’a jamais changé. Jamais nous n’avons laissé entendre que la présence de prolétaires était porteuse de “potentialités” de transformation du mouvement lui-même. Ce mouvement était, au contraire, comme nous l’avons toujours mis en avant dans notre intervention, une impasse pour tous les ouvriers qui s’y sont impliqués. À aucun moment, il ne pouvait y avoir l’espoir d’une transformation du mouvement en quelque chose de plus “prometteur”, la transformation d’une révolte, d’une “confusion”, en un mouvement plus conscient et plus clair.
Nous en venons ainsi à la deuxième question : est-ce à dire que le CCI aurait été méprisant ou manquait d’empathie à l’égard des ouvriers illusionnés par la combativité spectaculaire du mouvement des “gilets jaunes”, galvanisés par la confrontation souvent violente à l’État, mais totalement impuissants à faire valoir une véritable perspective prolétarienne ? Le camarade D. semble exprimer une idée sous-jacente : nous aurions “enfin” entendu en quoi le mouvement des “gilets jaunes” était “un mouvement de révolte contre la misère et la pauvreté”. Pourtant, dès novembre 2018, nous écrivions que “malgré la colère légitime des “gilets jaunes”, parmi lesquels de nombreux prolétaires qui n’arrivent pas à “joindre les deux bouts”, ce mouvement n’est pas un mouvement de la classe ouvrière”.
Nous avons clairement fait le constat de la profondeur des attaques qui touchent les prolétaires en “gilet jaune”, nous l’avons comprise. À aucun moment, nous n’avons pris de haut et méprisé les ouvriers ayant participé à ce mouvement. Au contraire, c’est avec une profonde confiance dans le rôle historique de la classe ouvrière, la conscience de ce qui est de sa responsabilité pour l’avenir de l’humanité, que nous avons largement insisté sur les dangers que représente un tel mouvement interclassiste (et ceux à venir !) pour l’autonomie de la classe ouvrière. Depuis novembre 2018, nous avons défendu qu’un tel “mouvement interclassiste où les revendications ouvrières se sont mêlées à celle de la petite bourgeoisie ne pouvait conduire qu’à diluer les secteurs les plus fragiles et marginalisés du prolétariat dans “le peuple”, sans aucune distinction de classe. C’est pour cela que le mouvement des “gilets jaunes” a été immanquablement marqué par l’idéologie et les méthodes de la petite bourgeoisie victime de déclassement, de la paupérisation liée aux ravages de la crise économique et portée par le sentiment de frustration et de revanche sociale” (mars 2021). “Malgré la colère légitime de nombreux prolétaires”, le mouvement des “gilets jaunes” n’avait aucune perspective et ne pouvait pas faire réellement reculer les attaques du gouvernement et du patronat.
La solidarité et surtout la responsabilité des révolutionnaires envers la classe ouvrière s’expriment inlassablement dans la mise en lumière des pièges qui jalonnent tout son combat et qui, hélas, vont le jalonner encore longtemps. Le mouvement interclassiste des “gilets jaunes” n’est, en effet, pas un évènement ponctuel ou exceptionnel. Avec l’approfondissement de la crise et la plongée dans la décomposition généralisée de l’ensemble de la société, de nombreuses couches sociales, non exploiteuses certes mais non révolutionnaires, vont être amenées à réagir, à se révolter, sans avoir la capacité à offrir une perspective politique à la société. Sur le terrain de ces révoltes multiformes, radicales peut-être mais stériles, le prolétariat ne peut être que perdant. Seule, la défense de son autonomie de classe exploitée et révolutionnaire est porteuse d’une véritable confrontation à la classe dominante et à son État, peut lui permettre d’élargir toujours plus sa lutte et d’agréger, à terme, d’autres couches à son propre combat contre le capitalisme. Cette intransigeance dans la défense de cette autonomie n’est en aucun cas un “mépris” ou une vision “élitiste” du combat de notre classe : elle est la seule capable de contribuer à une véritable maturation de la conscience ouvrière, la seule capable de contribuer à construire un rapport de forces pour l’éclosion de la révolution prolétarienne.
SJ, 4 avril 2021
1“Hordes trumpistes et “gilets jaunes”: Un amalgame pour criminaliser toute révolte contre la misère ! [251]” Révolution internationale n° 486 (janvier février 2021). NdR
Vie du CCI:
- Courrier des lecteurs [252]
Récent et en cours:
- Gilets jaunes [253]
Rubrique:
ICCOnline - mai 2021
- 43 lectures
La Commune appartient à la classe ouvrière !
- 102 lectures
– Pour le 65e anniversaire de la Commune de Paris, Bilan n°29 (mars-avril 1936) [254]
– La Semaine sanglante de mai 1871: La sauvagerie de la répression bourgeoise [255]
– Bas les pattes sur la Commune ! [256]
– Le marxisme, défenseur de la Commune [257]
– 1871 : la première révolution prolétarienne [237] (8e partie de la série : Le communisme n'est pas un bel idéal mais une nécessite matérielle)
Histoire du mouvement ouvrier:
- Commune de Paris - 1871 [239]
Rubrique:
Permanence en ligne, samedi 15 mai
- 80 lectures
Permanence en ligne, le samedi 15 mai 2021 de 14 h à 18 h.
Lors de la dernière réunion publique du CCI, un certain nombre de participants ont souhaité que soit discuté la question : “qu’est-ce que la classe ouvrière ?”, nous proposons que cette question soit abordée lors de cette permanence.
Conseils de lecture :
Vie du CCI:
- Réunions publiques [219]
Rubrique:
Conflit israélo-palestinien: les guerres et les pogroms sont l’avenir que nous réserve le capitalisme
- 171 lectures
Ce n’est pas la première fois que le Hamas ou d’autres groupes djihadistes font pleuvoir les roquettes sur les civils des villes israéliennes, tuant sans discrimination. Parmi les premières victimes figuraient un père arabe et sa fille, habitants de la ville israélienne de Lod, pulvérisés dans leur voiture. Ce n’est pas non plus la première fois que les forces armées israéliennes ont répondu par des raids aériens et des tirs d’artillerie dévastateurs, ciblant les dirigeants et les stocks d’armes du Hamas, mais semant aussi la mort parmi les civils des immeubles et des rues bondées de Gaza, avec un nombre de victimes des dizaines de fois supérieur aux “dommages” des roquettes du Hamas. Ce n’est pas non plus la première fois qu’Israël est sur le point d’envahir militairement la bande de Gaza, ce qui ne manquera pas d’entraîner de nouveaux décès, des sans-abri et des traumatismes pour les familles palestiniennes. Nous avons déjà vu les mêmes scènes en 2009 et en 2014.
Mais c’est la première fois qu’un effort militaire aussi important s’accompagne dans plusieurs villes israéliennes d’une vague d’affrontements violents entre Juifs et Arabes israéliens. Il s’agit essentiellement de pogroms : des bandes d’extrême droite brandissant l’étoile de David et criant “Mort aux Arabes”, faisant la chasse aux Arabes pour les tabasser et les assassiner. Dans le même temps, les attaques se sont multipliées contre des Juifs et des synagogues incendiées par des foules “inspirées” par l’islamisme et le nationalisme palestinien. Tout cela évoque les souvenirs sinistres des Cent-Noirs de la Russie tsariste ou de la Nuit de cristal dans l’Allemagne de 1938 !
La bourgeoisie suscite la guerre et les pogroms
Le gouvernement israélien de Netanyahou a, dans une large mesure, semé les graines de cette dynamique néfaste : par le biais de nouvelles lois renforçant la définition d’Israël en tant qu’État juif, et par la politique d’annexion de l’ensemble de Jérusalem comme capitale. Cette dernière est une claire déclaration selon laquelle la “solution à deux États” est morte et enterrée, et que l’occupation militaire de la Cisjordanie est désormais une réalité permanente. L’étincelle immédiate des émeutes d’Arabes palestiniens à Jérusalem (la menace d’expulser les résidents arabes de Jérusalem-Est et de les remplacer par des colons juifs) découle de cette stratégie d’occupation militaire et de nettoyage ethnique.
Les “démocraties” d’Europe et des États-Unis déversent leurs habituelles larmes de crocodile devant l’escalade du conflit militaire et du désordre civil (même Netanyahou a appelé à la fin de la violence de rues entre Juifs et des Arabes). Mais les États-Unis sous la présidence de Trump avaient déjà approuvé les politiques ouvertement annexionnistes d’Israël qui font partie d’un projet impérialiste plus large visant à rassembler Israël, l’Arabie saoudite et d’autres États arabes dans une alliance contre l’Iran (ainsi que contre de grandes puissances comme la Russie et la Chine). Si Biden a, par exemple, pris une certaine distance par rapport au soutien sans critique de Trump au régime saoudien, sa première préoccupation dans la crise actuelle a été d’insister sur le fait qu’ “Israël a le droit de se défendre”, car l’État sioniste, malgré toutes ses aspirations à jouer son propre jeu au Moyen-Orient, reste un élément clé de la stratégie américaine dans la région.
Mais l’État israélien n’est pas le seul à agir de façon provocatrice. Le Hamas a répondu à la répression des émeutes de Jérusalem en lançant une salve ininterrompue de roquettes contre les civils en Israël, sachant pertinemment que cela amènerait un torrent de fer et de feu sur la population non protégée de Gaza. Il a également fait tout son possible pour encourager les violences ethniques en Israël. C’est une caractéristique de la guerre, à l’époque de la décadence du capitalisme, que les premières victimes sont les populations civiles, surtout la classe ouvrière et les opprimés. Tant Israël que le Hamas agissent dans la logique barbare de la guerre impérialiste. Face à la guerre impérialiste, les révolutionnaires ont toujours appelé à la solidarité internationale des exploités contre tous les États et proto-États capitalistes. La solidarité est le seul rempart possible face à l’enfoncement de la société dans la guerre et la barbarie.
Mais les classes dirigeantes du Moyen-Orient ont, avec leurs plus puissants soutiens impérialistes, longtemps attisé les flammes de la division et de la haine. Il y a eu des pogroms contre des colons juifs en Palestine en 1936, attisés par une direction politique palestinienne qui cherchait à s’allier avec l’Allemagne nazie contre la puissance dominante de la région, la Grande-Bretagne. Mais ces événements ont été éclipsés par le nettoyage ethnique massif de la population arabe qui a accompagné la “guerre d’indépendance” de 1948, créant l’insoluble problème des réfugiés palestiniens qui a été systématiquement instrumentalisé par les régimes arabes. Une succession de guerres entre Israël et les États arabes environnants, les incursions israéliennes contre le Hamas et le Hezbollah, la transformation de Gaza en une vaste prison… Tout cela a approfondi la haine entre Arabes et Juifs au point de n’apparaître que comme du “bon sens” des deux côtés du fossé. Dans ce contexte, les exemples de solidarité entre les travailleurs arabes et juifs en lutte sont extrêmement rares, tandis que les expressions politiques organisées de l’internationalisme y ont été quasiment inexistantes.
Le danger d’une spirale incontrôlée de la violence
Les actions provocatrices de l’État israélien sont également le produit d’autres éléments contingents. Netanyahou, le Premier ministre par intérim, n’a pas été en mesure de former un gouvernement après une série d’élections générales peu concluantes, et fait toujours face à un certain nombre d’accusations de corruption. Il pourrait certainement tirer profit de son rôle d’homme fort dans cette nouvelle crise nationale. Mais des tendances plus profondes sont à l’œuvre et pourraient échapper au contrôle de ceux qui tentent de tirer profit de la situation actuelle.
Les grandes guerres israélo-arabes des années 1960 et 1970 ont été menées dans le contexte de la domination de la planète par deux blocs impérialistes : Israël soutenu par les États-Unis, les États arabes soutenus par l’URSS. Mais depuis l’éclatement du système des blocs à la fin des années 1980, la tendance innée à la guerre impérialiste dans le capitalisme décadent a pris une forme beaucoup plus chaotique et potentiellement incontrôlée. Le Moyen-Orient, en particulier, est devenu le terrain de jeu d’un certain nombre de puissances régionales dont les intérêts ne coïncident pas nécessairement avec les projets des grandes puissances mondiales : Israël, la Turquie, l’Iran, l’Arabie saoudite… Ces puissances sont déjà fortement impliquées dans les conflits sanglants qui ravagent la région : l’Iran utilise son pion, le Hezbollah, dans le conflit multiforme en Syrie, et l’Arabie saoudite est profondément impliquée dans la guerre au Yémen contre les alliés houthis de l’Iran. La Turquie a étendu sa guerre contre les peshmergas kurdes à la Syrie et à l’Irak (tout en maintenant une intervention militaire dans une Libye déchirée par la guerre). En plus de réduire des pays entiers à la ruine et à la famine, ces guerres comportent un risque réel de devenir incontrôlables et de propager la destruction à travers tout le Moyen-Orient.
Ce chaos croissant au niveau militaire est une expression de la décomposition globale du système capitaliste. Ainsi, un autre élément, étroitement lié, se joue au niveau social et politique, à travers l’intensification des affrontements entre factions politiques bourgeoises, des tensions entre groupes ethniques et religieux, des pogroms contre les minorités. Il s’agit d’une tendance mondiale, caractérisée, par exemple, par le génocide au Rwanda en 1994, la persécution des musulmans au Myanmar et en Chine, l’accentuation du clivage racial aux États-Unis. Comme nous l’avons vu, les divisions ethniques en Israël et en Palestine ont une longue histoire, mais elles sont aggravées par l’atmosphère de désespoir et d’impuissance générée par le “problème palestinien” apparemment insoluble. Et si les pogroms sont souvent déclenchés en tant qu’instruments de la politique de l’État, dans les conditions actuelles, ils peuvent s’intensifier au-delà des objectifs des organismes d’État et accélérer un glissement général vers l’effondrement social. Le fait que cela commence à se produire dans un État hautement militarisé comme Israël est un signe que les tentatives du capitalisme d’État totalitaire de freiner le processus de désintégration sociale peuvent finir par l’aggraver encore plus.
Les guerres et les pogroms sont l’avenir que le capitalisme nous réserve partout si la classe ouvrière internationale ne retrouve pas ses propres intérêts et sa propre perspective : la révolution communiste. Si les prolétaires du Moyen-Orient sont, pour l’instant, trop dépassés par les massacres et les divisions ethniques, il appartient aux fractions centrales du prolétariat mondial de reprendre le chemin de la lutte, seul chemin qui mène hors du cauchemar de cet ordre social putréfié.
Amos, 14 mai 2021
Géographique:
Récent et en cours:
Rubrique:
Pour le 65e anniversaire de la Commune de Paris, Bilan n°29 (mars-avril 1936)
- 83 lectures
Nous publions ci-dessous un article de la Gauche communiste, du groupe Bilan, célébrant les 65 ans de la Commune de Paris. L’intérêt de cet article, en pleine période de contre-révolution et de marche vers la Seconde Guerre mondiale, est de mettre en évidence la continuité historique entre la Commune de 1871 et la révolution d’Octobre 1917. L’article illustre à la fois le caractère prolétarien de ces deux expériences révolutionnaires, leur portée internationale et la tragédie de leur défaite. Il met surtout en exergue, face aux faux amis et à la politique chauvine des “fronts populaires”, que le prolétariat doit apprendre de ses expériences en sachant, comme le soulignait déjà en son temps Rosa Luxemburg, que c’est de “défaites en défaites” que progresse la lutte du prolétariat pour affirmer et développer sa conscience révolutionnaire.
Entre le Paris de la glorieuse Commune de 1871 et le Paris du Front Populaire existe un abîme qu’aucune phraséologie ne peut dissimuler. L’un s’est annexé les travailleurs du monde entier, l’autre a vu traîner dans la boue de la trahison le prolétariat français. Nous voulons, pour reprendre les profondes expressions de Marx, que “le Paris des ouvriers en 1871, le Paris de la Commune” soit “célébré comme l’avant-coureur d’une société nouvelle” et non comme un simple épisode “national”, un moment de défense de la patrie, de la lutte contre le “Prussien” ainsi que voudront inévitablement le présenter les valets du Front populaire.
Certes, les circonstances historiques dans lesquelles elle surgit pourraient permettre pareilles spéculations. Marx lui-même n’avait-il pas écrit : “Tenter de renverser le nouveau gouvernement en la présente crise, lorsque l’ennemi est presque aux portes de Paris, serait un acte de pure folie. Les ouvriers doivent remplir leur devoir civique”. Mais lorsqu’en mars 1871 apparut la Commune, c’est Marx le premier qui en dégagea le profond caractère internationaliste en écrivant : “Si la Commune représentait vraiment tous les éléments sains de la société française, si elle était par conséquent le véritable gouvernement national, elle était en même temps un gouvernement ouvrier et, à ce titre, en sa qualité d’audacieux champion du travail et de son émancipation, elle avait un caractère bien marqué d’internationalisme”.
La grandeur de la Commune réside dans le fait qu’elle sut surmonter les préjugés de l’époque, inévitables dans la phase de la formation des États capitalistes, pour s’affirmer, non comme le représentant de la “Nation” ou celui de la République démocratique (“on croit, dit Engels dans sa préface à la “Commune” de Marx, avoir déjà fait un progrès tout à fait hardi si l’on s’est affranchi de la croyance en la monarchie héréditaire pour jurer en la République démocratique. Mais, en réalité, l’État n’est pas autre chose qu’une machine d’oppression d’une classe par une autre, et cela tout autant dans une république démocratique que dans une monarchie”), mais celui du prolétariat mondial. Marx écrit d’ailleurs très justement : “le secret de la Commune le voici : elle était, par-dessus tout, un gouvernement de la classe ouvrière, le résultat de la lutte entre la classe qui produit et la classe qui s’approprie le produit de celle-ci ; la forme politique, enfin trouvée, sous laquelle il était possible de réaliser l’émancipation du travail”.
C’est cette signification historique, dégagée génialement par Marx au feu des événements mêmes, qui est restée de l’insurrection des travailleurs parisiens et qui lui donna l’importance colossale qu’elle eut pour le développement du mouvement ouvrier. Il s’agissait de l’apparition de “la forme politique, enfin trouvée, sous laquelle il était possible de réaliser l’émancipation du travail”. Quoi d’étonnant si, jusqu’en 1914, le mouvement international vécu sur le souvenir héroïque de la Commune, s’y nourrit, mais dut aussi, avec le triomphe de l’opportunisme, en estomper la signification réelle.
La bourgeoisie française aidée par Bismarck devait écraser par le fer et par le feu la Commune, laquelle dans les conditions de développement économiques et sociales de l’époque, ne pouvait avoir de perspectives. Ce n’est qu’après de longues années que la bourgeoisie, aidée par l’opportunisme réussit à brouiller parmi les travailleurs la portée immense de cet événement. Mais là où la violence échoua, devait réussir la corruption. En 1917, il apparut que seuls les bolcheviks russes avaient appris à l’école de la Commune, qu’eux seuls en avaient maintenu la signification et au travers de sa critique s’étaient habilités aux problèmes insurrectionnels. Sans la Commune, la révolution d’octobre 1917 n’aurait pas été possible. Ici, il s’agissait d’un de ces moments historiques où “la lutte désespérée des masses, même pour une cause perdue, est nécessaire à l’éducation ultérieure de ces masses et à leur préparation aux luttes futures” (Lénine), d’un premier fruit
d’une expérience sanglante, d’un pas concrètement posé vers la révolution mondiale. La Commune fut grande et le restera parce que les ouvriers parisiens se laissèrent ensevelir sous ses décombres plutôt que de capituler. Aucune menace de Thiers, aucune violence ne vient à bout de leur héroïsme. Il fallut les massacres de Mai 1871, ceux du Père-Lachaise pour rétablir l’ordre et le triomphe de la bourgeoisie. Et même les opportunistes de la IIe Internationale qui écartèrent délibérément les enseignements de la Commune, durent s’incliner devant son héroïsme. Avant la guerre, les partis socialistes durent glorifier la Commune pour mieux en écarter les leçons historiques. Mais cette attitude comportait une contradiction fondamentale en ce qu’elle faisait des insurgés parisiens un foyer permanent de la lutte révolutionnaire internationale où d’authentiques marxistes vinrent apprendre.
La Commune russe de 1917 n’aura pas connu ce sort glorieux. Sa transformation en un foyer de contre-révolution, sa désagrégation sous l’action de la corruption du capitalisme mondial en a fait un élément de répulsion d’où l’on retire avec peine des enseignements. Soviet pour l’ouvrier ne signifie plus un pas en avant par rapport à la Commune, mais un pas en arrière. Au lieu de périr sous ses propres décombres, face à la bourgeoisie, le Soviet a écrasé le prolétariat. Son drapeau est aujourd’hui celui de la guerre impérialiste. Mais autant et dans la même mesure où il n’y aurait pas eu d’Octobre 1917 sans la Commune de 1871, il n’y aurait pas de possibilité de révolution triomphante sans la fin lamentablement tragique de la révolution russe.
Qu’importe après tout si la Commune sert aux battages chauvins du Front populaire, si la Russie est devenue un instrument puissant pour la préparation de la guerre impérialiste : c’est le destin des grands événements de l’Histoire d’être asservis aux intérêts de la conservation capitaliste, dès qu’ils ont cessé d’être une menace pour sa domination. La seule chose que personne au monde ne peut effacer de la Commune, c’est son caractère de pionnier de la libération des travailleurs. La seule chose qui reste des Soviets russes, c’est l’expérience gigantesque de la gestion d’un État prolétarien (1) au nom et pour le compte du prolétariat mondial.
Là résident les fondements de ces événements que le renouveau des batailles révolutionnaires doit faire ressurgir sur l’arène politique. Les formes historiques importent peu : Commune ou Soviet (plutôt Commune que Soviet), le prolétariat mondial ne pourra répéter les erreurs historiques de l’une ou de l’autre, car, comme le dit si bien Marx, il n’a pas à “réaliser un idéal, mais à dégager les éléments de la nouvelle société que la vieille société bourgeoise elle-même porte en ses flancs”. Nous n’avons pas à opposer un idéal utopique et abstrait à ces deux expériences historiques, à nous égarer dans un enthousiasme vide ou une répulsion sentimentale, mais à dégager de la phase historique où a sombré la révolution russe “les éléments de la nouvelle société”, ainsi que le fit Lénine au sujet de la Commune. Comme le prouve lumineusement la Commune hongroise de 1919, en dehors de ce travail, l’on assiste inévitablement à la répétition d’erreurs, d’échecs, qui, parce qu’existe une expérience antérieure, compromettent pour de longues années la lutte du prolétariat.
Les ouvriers ne peuvent pas “répéter” au cours de leur lutte émancipatrice, mais doivent innover, précisément parce qu’ils représentent la classe révolutionnaire de la société actuelle. Les inévitables défaites qui surviennent dans ce chemin ne sont alors que des stimulants, de précieuses expériences qui déterminent, par la suite, l’essor victorieux de la lutte. Par contre, si nous répétions demain une seule des erreurs de la révolution russe, nous compromettrions pour longtemps le destin du prolétariat qui se pénétrerait de la conviction qu’il n’a plus rien à tenter.
Laissons donc, pendant que le prolétariat est battu dans tous les pays, les traîtres falsifier la portée de la Commune. Laissons la Russie suivre son cours. Mais veillons à préserver les enseignements de ces deux expériences, à préparer les armes nouvelles pour la révolution de demain, à résoudre ce devant quoi la révolution russe a échoué, car si “le grand acte socialiste de la Commune, ce fut son existence même et son propre fonctionnement” (Marx), le mérite de la révolution russe fut d’avoir abordé les problèmes de la gestion d’une économie prolétarienne en liaison avec le mouvement ouvrier de tous les pays et sur le front de la révolution mondiale. Le “grand acte” de la Commune s’est terminé dans des massacres, la gestion de l’État russe a fini avec “le socialisme dans un seul pays”. Nous savons aujourd’hui qu’il vaut mieux que les prochaines révolutions finissent comme la Commune parisienne plutôt que dans la honte de la trahison. Mais nous travaillons, non avec une perspective de défaite, mais avec la volonté de préparer les conditions de la victoire.
Deux Communes ont vécu. Vive les Communes du prolétariat mondial.
Bilan n° 29 (mars-avril 1936)
1 Cette notion “d’État prolétarien” témoigne du fait que toutes les leçons de l’échec de la Révolution russe et de la dégénérescence de la IIIe internationale n’avaient pu être tirés à l’époque. Aujourd’hui encore, certains groupes du milieu politique prolétarien conservent une telle confusion sur la nature de l’État. En réalité, il ne peut y avoir d’État prolétarien dans la mesure où cet appareil, qui s’impose comme expression de la société divisée en classes, s’oppose radicalement à la nécessaire autonomie du prolétariat et à son projet qui est justement de le faire dépérir jusqu’à la disparition complète des classes elles-mêmes. (Note de la rédaction)
Histoire du mouvement ouvrier:
- Commune de Paris - 1871 [239]
Rubrique:
Permanence en ligne du samedi 12 juin 2021
| Fichier attaché | Taille |
|---|---|
| 175.67 Ko |
- 93 lectures
La prochaine permanence du CCI se tiendra le samedi 12 juin de 14h à 18h. Outre les questions que chaque participant pourra bien sûr aborder, nous proposons de discuter des deux thèmes suivants :
1- poursuite du débat commencé à la dernière permanence sur la question de l’uberisation du travail autour de la question : qu’est-ce que la classe ouvrière en lien avec la question du travail associé ;
2- le récent conflit israélo palestinien : thème que nous n’avons pas eu le temps d’aborder lors de notre dernière permanence. Nous souhaiterions que soit discutée la position du CCI face aux manifestations en soutien au “peuple palestinien”, et nos divergences avec les autres groupes de la Gauche communiste, notamment le PCI qui publie le journal Le Prolétaire.
Les lecteurs qui souhaitent participer à cette permanance peuvent nous écrire à l'adresse suivante : [email protected] [264] ou dans la rubrique "contact [214]".
Sur la question du conflit israélo palestinien voir :
- Notre article : “Conflit israélo-palestinien: les guerres et les pogroms sont l’avenir que nous réserve le capitalisme” [265]
- L’article de la Tendance communiste internationaliste : “Ni Israël, ni la Palestine : Pas de guerre mais guerre de classe [266]”
- Le tract du PCI-Le Prolétaire en pdf ci-dessus.
Vie du CCI:
- Réunions publiques [219]
Rubrique:
ICCOnline - juin 2021
- 46 lectures
Accident de téléphérique à Stresa (Italie): Un nouveau drame sur l’autel du profit
- 48 lectures
Quatorze personnes sont mortes à Stresa en Italie, dimanche 23 mai, après la chute de leur cabine de téléphérique. Comme d’habitude après de telles catastrophes, les larmes de crocodiles ont coulé à flot et l’État, responsables politiques en tête, s’est offusqué qu’un tel drame puisse exister. Puis les boucs émissaires ont rapidement été désignés : “Il y avait un dysfonctionnement sur le téléphérique, l’équipe de manutention n’a pas résolu le problème, ou seulement en partie. Pour éviter l’interruption de la liaison, ils ont choisi de laisser en place la fourchette qui empêche l’entrée en fonction du frein d’urgence”, a expliqué sur Radiotre un responsable des carabiniers. Selon la procureure chargée de l’enquête, Olimpia Bossi, citée par plusieurs médias italiens, ces trois responsables savaient que la cabine du téléphérique circulait sans frein d’urgence depuis le 26 avril, jour de la réouverture de l’installation. L’analyse des débris trouvés sur place, a ainsi permis de démontrer que “le système de freinage d’urgence de la cabine tombée dans le vide avait été trafiqué”. Selon les enquêteurs, il s’agit d’un acte “matériel fait de manière consciente”, pour “éviter des interruptions et l’arrêt du téléphérique”, alors que “l’installation présentait des anomalies qui auraient requis une intervention plus radicale avec un arrêt conséquent” de l’installation.
Pourquoi cette “intervention plus radicale” n’a-t-elle pas été effectuée ? Bien évidemment, les trois propriétaires ont une lourde part de responsabilité. Il n’y a aucun doute sur leur faute ignoble. Mais comment des professionnels de la sécurité peuvent-ils être amenés à désactiver un système de freinage sur une telle infrastructure ? Tout simplement pour la faire fonctionner à plein régime durant la période estivale avec une unique préoccupation : assurer le maximum de rentabilité ! Après pratiquement deux saisons à l’arrêt en raison des restrictions sanitaires dues au Covid-19, cette station de ski alpin était en grande difficulté financière (perte de plusieurs millions d’euros de chiffre d’affaires) et s’est empressée de rouvrir ses infrastructures au mépris des règles élémentaires de sécurité…
Ce téléphérique est un atout de poids dans cette région. Sa fermeture était très mal vécue par les autorités locales et la société d’exploitation qui ont poussé à la roue pour le faire fonctionner “coûte que coûte” en ignorant volontairement les principes de base de sécurité. Si les trois “coupables” désignés ont agi de la sorte, c’est fortement incités par les contingences économiques, en l’occurrence de l’industrie touristique.
Maintenant, les exploiteurs, particulièrement la bourgeoisie italienne, ont le beau rôle en se déchargeant de toute responsabilité dans cette tragédie. Ils ont trois “coupables” sur mesure à donner en pâture aux médias et à la justice. Mais au-delà des apparences, le vrai coupable, c’est le capitalisme qui, dans sa logique de rentabilité pour générer toujours plus de profit, n’hésite pas à bafouer toutes les règles basiques de sécurité ou à contraindre ses exécutants à les enfreindre. Cette tragédie de téléphérique n’est malheureusement pas la première : plusieurs “accidents” meurtriers de téléphériques, télécabines et funiculaires ont eu lieu depuis cinquante ans en Europe. Ce sont les mêmes responsables, gestionnaires, financeurs, instances locales et nationales qui, lorsque les tragédies “prévisibles” se produisent, viennent se répandre en condoléances et versent des larmes de crocodile devant les médias en feignant la surprise et l’incompréhension !
Adjish, le 29 mai 2021
Géographique:
- Italie [28]
Rubrique:
Les “travailleurs ubérisés” font-ils partie de la classe ouvrière ?
- 153 lectures
Nous publions ci-dessous deux courriers de sympathisants du CCI visant à prolonger la réflexion ayant surgi dans notre dernière permanence du 15 mai 2020 sur le sujet de la nature et la composition de la classe ouvrière. Au cours de cette discussion, des participants se sont interrogés sur le rôle de l’ubérisation du travail sur la composition de la classe ouvrière. Autrement dit, les “travailleurs ubérisés” appartiennent-ils à la classe ouvrière ? Nous saluons l'effort de réflexion des camarades et leur souci de vouloir confronter leurs arguments. Les courriers des camarades forment donc deux contributions à ce débat qui se poursuivra lors de la prochaine permanence du CCI qui se déroulera le samedi 12 juin à partir de 14 H. A l’issue de la permanence, le CCI s’engage à développer sa position sur ce sujet à travers un article qui sera publié dans notre presse.
Contribution à la réflexion sur : « qu’est-ce que la classe ouvrière, qui fait partie de la classe ouvrière? » (L.)
D’une manière générale, les conditions de production de la richesse n’ont pas changé depuis le XIX°siècle, moment de l’apparition du capitalisme dans les pays occidentaux (au XVIII° siècle pour la Grande Bretagne). La classe ouvrière est donc toujours la classe qui produit toutes les richesses et elle existe toujours, tant qu’il y a production de plus-value. La définition de Marx précise que la classe ouvrière ne possède pas les moyens de production, elle n’a que sa force de travail pour produire de la plus-value, contre un salaire, de manière associée. Cependant, au XIX°siècle, le prolétariat était surtout concentré dans les secteurs primaire (collecte et exploitation des ressources naturelles) et secondaire (transformation en marchandises des matériaux de base). Les ouvriers travaillaient côte à côte, ils pouvaient échanger et s’organiser facilement.
La composition du prolétariat a changé depuis l’ascendance du capitalisme, liée au développement d’autres secteurs. Le secteur tertiaire, qui comprenait les fonctionnaires chargés d’administrer et d’organiser la vie de la société selon les intérêts du système capitaliste, comprend aujourd’hui beaucoup plus d’ouvriers, qui participent à la valorisation des marchandises, sont payés le moins possible et n’ont plus l’espoir de monter facilement dans la hiérarchie sociale ; il en est ainsi du secteur de la Poste (qui comprend de moins en moins d’ouvriers avec le statut de fonctionnaires), l’Enseignement, la Santé, les Transports Publics (où le statut de fonctionnaire disparaît également).
La bourgeoisie cherche toujours comment pressurer davantage la classe ouvrière, « sans que cela se voie » : ainsi, en Grande-Bretagne, se développe la politique du « fire and rehire » (griller et réembaucher), qui permet de supprimer les contrats de travail précédents et de les remplacer par des contrats beaucoup moins « avantageux » pour les ouvriers. Un article de ICC online (the working class bears the brunt of the pandemic) évoque ce nouveau tour de passe-passe, utilisé par Tesco, British Telecom, British Gas et des compagnies de bus. C’est en Grande Bretagne également que se sont développées en premier le statut de « travailleur » indépendant, travaillant pour Uber, Deliveroo, autres entreprises de livraison de courrier, colis, etc.
Lors de la dernière permanence, il était tout à fait juste de défendre l’appartenance à la classe ouvrière de ces travailleurs « indépendants ». Même s’ils ne travaillent pas de manière associée, ils participent à la valorisation de la marchandise force de travail, en livrant des repas à des ouvriers, transportant des colis, nettoyant les bureaux, etc.
Des luttes ont eu lieu, également en Grande Bretagne, dans différents secteurs, dont les ouvriers intérimaires. « En mars 2021, 150 porteurs, nettoyeurs, standardistes et personnels de restauration employés à l’hôpital du comté de Cumberland par la société d’équipement Mitie, ont mené une première journée d’action avec Unison [un syndicat] en raison d’un défaut de paiement des heures supplémentaires... »
Aujourd’hui, il y a de moins en moins d’ouvriers d’industrie, machinisme aidant, cependant les techniciens qui font marcher et entretiennent les machines sont des ouvriers, puisqu’ils participent aussi à la production de valeur.
Comme le capitalisme s’est étendu à toute la planète, les petites exploitations agricoles existent de moins en moins, il y a une concentration des anciennes petites exploitations en grands groupes agricoles qui sont gérés d’une manière industrielle ; les ouvriers agricoles font partie de la classe ouvrière.
La classe ouvrière a toujours été hétérogène, les ouvriers des pays périphériques n’ont pas l’expérience historique des ouvriers des pays centraux et sont plus susceptibles d’écouter les sirènes démocratiques de se battre pour avoir un syndicat ou des élections.
Les luttes des ouvriers des pays centraux seront déterminantes pour entraîner les ouvriers du monde entier vers le développement d’une situation pré-révolutionnaire.
Des individus issus des autres classes peuvent rejoindre le combat de la classe ouvrière en se rapprochant des groupes révolutionnaires et être convaincus que seule la révolution communiste peut apporter un futur viable à l’humanité.
L’expérience a montré que l’idée d’occuper les usines n’était plus un bon moyen de lutte et que l’enfermement dans l’usine n’est pas une force. Au contraire, l’extension de la lutte, la communication vers d’autres secteurs donne de la force à la lutte.
Le dernier mouvement contre la réforme des retraites en France, par exemple, a vu converger dans la rue des secteurs très divers, public, privé, intérimaires, CDD, avocats, chômeurs, etc.
Même si certains ouvriers ne travaillent pas de manière associée dans de grandes entreprises, l’attaque contre le système de retraites était (et sera) un puissant facteur de rassemblement.
En conclusion, aujourd’hui, époque de la décomposition du capitalisme, font partie de la classe ouvrière tous les travailleurs traditionnellement producteurs associés de plus-value, dans les usines, mais aussi, les travailleurs intérimaires, les ouvriers de l’enseignement primaire et secondaire, les agents administratifs de base, les ouvriers précaires : auto-entrepreneurs qui travaillent de façon isolée mais peuvent être entraînés dans des grands mouvements, tous ceux qui participent de la valorisation de la marchandise à un degré ou à un autre. La bourgeoisie fait tout ce qu’elle peut pour empêcher les ouvriers d’être « ensemble », elle essaie de les séparer, mais l’intérêt commun des ouvriers, la lutte pour défendre les salaires, le droit à la retraite, les indemnités de maladie, le temps de travail, les vacances, pour refuser les licenciements, bref empêcher l’augmentation de l’exploitation, les rassemble inexorablement.
L, 19/05/2021
Courrier de lecteur du camarade Patche
A l'occasion de la dernière permanence du CCI (samedi 15 mai), des camarades se sont interrogés sur la question de la nature de la classe ouvrière dans une société qui voit l'émergence depuis environ une décennie d'un phénomène qualifié d'ubérisation (du nom de l'entreprise Uber qui fut pionnière dans ce secteur) ou de gig economy (économie de partage). Il importe de se demander si ces nouveaux travailleurs appartiennent au prolétariat ou s'ils sont l'émanation de classes étrangères à ce dernier, appartenant à la petite bourgeoisie, car de la réponse à cette question découle un grand nombre de considérations notamment politiques. Il s'agit ainsi de savoir si lorsque l'on choisit de défendre ces travailleurs, nous nous situons sur le terrain de la classe ouvrière ou sur un terrain qui lui est étranger.
Selon le CCI, dans sa Résolution sur le rapport de force entre les classes (2019), « L’aggravation du chômage et de la précarité a également fait apparaître le phénomène d’"uberisation" du travail. En passant par l’intermédiaire d’une plateforme Internet pour trouver un emploi, l’ubérisation déguise la vente de la force de travail à un patron en une forme "d’auto-entreprise", tout en renforçant la paupérisation et la précarité des "auto-entrepreneurs". L’ubérisation du travail individuel renforce l’atomisation, la difficulté de faire grève, du fait que l’auto-exploitation de ces travailleurs entrave considérablement leur capacité à lutter de façon collective et à développer la solidarité face à l’exploitation capitaliste »
Plusieurs points sont importants dans cette résolution. Tout d'abord, il y est écrit que l'ubérisation « déguise la vente de la force de travail à un patron ». Selon le CCI, cette forme d'auto-entreprenariat n'est qu'un artifice juridique. D'ailleurs, en Grande-Bretagne, la Cour suprême a décidé de requalifier les chauffeurs Uber en tant que salariés, montrant ainsi que même les organes juridiques de l'État bourgeois ne sont pas dupes d'une telle mascarade. Si les travailleurs uber ne sont pas considérés comme des auto-entrepreneurs et que par ailleurs, ils vendent leur force de travail à un patron, ne peut-on pas les considérer comme appartenant à la classe ouvrière ? La suite de la résolution est moins claire sur cette question.
Elle affirme que « l'ubérisation du travail individuel renforce l'atomisation, la difficulté de faire grève » et « entrave considérablement la capacité à lutter de façon collective » contre l'exploitation capitaliste. Il est indéniable que la nature de la tâche à accomplir, variable selon les plate-formes mais dont les principales résident dans la livraison de repas ou dans le fait de travailler comme chauffeur, ainsi que la croyance mystifiée selon laquelle les travailleurs Uber sont leurs propres patrons et n'ont de compte à rendre à personne d'autre qu'à eux-mêmes, joue un rôle d'atomisation de la classe et brise la nécessaire solidarité entre les travailleurs. Rappelons que pour Marx le capitalisme, par la concentration et la centralisation du capital, aboutit au travail associé ce qui, in fine, renforce la conscience de classe des travailleurs qui sont confrontés collectivement à la même réalité de l'exploitation sauvage. C'est fondamentalement ce qui distingue le prolétariat de la petite paysannerie, également exploitée, mais dispersée sur le territoire, l'empêchant de nouer des liens de solidarité.
Mais si les travailleurs Uber sont atomisés et dispersés, s'il leur est extrêmement difficile de nouer des liens de solidarité et de mener des luttes collectives ou des grèves, ne font-ils pas néanmoins partie de la classe ouvrière, du prolétariat ? Le fait d'être à l'arrière-garde de la classe ouvrière du fait des conditions de travail et de la précarité ne permet pourtant pas de dénier à ces travailleurs leur qualité de prolétaires exploités, séparés des moyens de production et condamnés à vendre leur force de travail pour subsister, ce qui est la définition du prolétaire selon Marx. Les modalités de leur exploitation pourraient d'ailleurs être rapprochées de celle du salaire aux pièces analysé par Marx dans le livre 1 du Capital (au chapitre 21), la rentabilité de leur tâche se calculant non en heures de travail mais en nombre de tâches réalisées, renforçant d'autant plus la concurrence entre travailleurs, chacun cherchant à accomplir le plus de tâches possibles dans la journée.
Avant de conclure, il s'agit de s'intéresser à la combativité réelle ou non des travailleurs uberisés. Nous l'avons dit, leur atomisation, la mise en concurrence dans la forme moderne du salaire aux pièces, mine constamment la solidarité entre ces travailleurs. Pourtant, en plusieurs endroits du globe, nous avons vu surgir des formes de lutte spontanées, sans la constitution ou la participation de syndicats, appareils de collaboration avec l'État bourgeois et de défense du mode de production capitaliste. A Los Angeles, des travailleurs Uber se sont mis spontanément en grève pour lutter contre leurs conditions de travail. C'est également le cas dans d'autres pays et avec d'autres entreprises, en Italie, au Royaume-Uni, etc. Certes, il arrive à ces travailleurs de constituer des syndicats ou de demander l'appui de centrales déjà existantes. Ce sont des impasses qui doivent être rejetées par les communistes, qui insistent au contraire sur les outils spécifiques de la lutte des classes, notamment la grève sauvage, sans médiation syndicale. Mais ces erreurs ne doivent pas suffire à rejeter les travailleurs ubérisés en-dehors du prolétariat, et à les assigner à la petite-bourgeoisie.
Depuis les dernières années, la précarité s'est aggravée. La classe ouvrière a été victime de ce processus, et l'uberisation des travailleurs en a été l'un des produits. Considérer que les travailleurs ubérisés, du fait de leur atomisation, de leurs difficultés à se placer sur le terrain de la classe ouvrière, n'appartiennent pas au prolétariat mérite une profonde et sérieuse discussion, basée sur les analyses marxistes. Car ce n'est que par la confrontation polémique mais fraternelle que la classe ouvrière sera en mesure de déjouer les pièges tendus par la bourgeoisie et ses idéologues et contribuer à la lutte pour le renversement du capitalisme et l'émancipation du prolétariat.
Salutations fraternelles,
Patche
Vie du CCI:
- Courrier des lecteurs [252]
Rubrique:
La grève de février 1941 aux Pays-Bas: solidarité de classe contre persécution raciste
- 83 lectures
Dans de récents articles1, nous avons démontré que le mouvement Black Lives Matter (BLM) se situe sur un terrain complètement bourgeois, concrétisé dans de vagues revendications comme “l’égalité des droits”, “un traitement équitable” ou certaines plus spécifiques comme “définancer la police”. En aucun cas ce mouvement de protestation ne fut capable, même de manière la plus minime qui soit de remettre en question les rapports capitalistes de production qui établissent la subordination et l’oppression de la classe ouvrière comme l’un des piliers de la domination capitaliste.
Mais cela signifie-t-il que la classe ouvrière ne puisse offrir aucune alternative aux autres couches non exploiteuses ou minorités discriminées de la société capitaliste qui sont sujettes à des formes particulièrement violentes d’oppression ? Au contraire, tout au long de son histoire, la classe ouvrière, aux États-Unis tout comme dans d’autres parties du monde, a démontré sa capacité à prendre des mesures significatives pour dépasser les barrières de la division ethnique, à condition qu’elle lutte sur son propre terrain de classe et avec ses propres perspectives prolétariennes.
L’une des premières manifestations de véritable solidarité ouvrière avec une minorité ethnique s’est produite en 1892 à la Nouvelle-Orléans lorsque trois syndicats ont réclamé de meilleures conditions de travail. Le “Bureau du Commerce de la Nouvelle-Orléans” tenta de diviser les travailleurs sur la base de critères raciaux en invitant à négocier les deux syndicats à majorité blanche, tout en rejetant le syndicat à majorité noire. En réponse à cette manœuvre du Bureau, les trois syndicats lancèrent un appel à la grève commune qui fut suivi unanimement.
Un autre moment important fut la défense organisée de la classe ouvrière en Russie contre les progroms antisémites en octobre 1905, durant l’année de la première révolution en Russie. Durant ce mois, les dénommés Cent-Noirs, des gangs organisés soutenus par la police secrète du tsar, tuèrent des milliers de personnes et mutilèrent des dizaines de milliers d’autres dans une centaine de ville du pays. En réponse à ces massacres, le Soviet de Petrograd lança un appel aux ouvriers du pays tout entier afin qu’ils prennent les armes pour défendre les districts ouvriers contre de futurs pogroms.
Un autre exemple héroïque de la solidarité prolétarienne se produisit en février 1941 aux Pays-Bas, il y a 80 ans de cela. La cause immédiate fut l’enlèvement de 425 hommes juifs à Amsterdam et leur déportation dans un camp de concentration en Allemagne. Ce premier raid aux Pays-Bas sur une frange de la population persécutée et terrorisée provoqua une forte indignation parmi les ouvriers d’Amsterdam et des villes environnantes. L’attaque sur les Juifs fut vécue comme une attaque contre l’ensemble de la population prolétarienne d’Amsterdam. L’indignation surpassa la peur.
La réponse fut : “Mettons-nous en grève !”
Aux Pays-Bas les Juifs n’étaient pas vus comme des étrangers. En particulier à Amsterdam, où l’immense majorité de la population juive vivait, ils étaient considérés comme partie intégrante de la population. De plus, Amsterdam possédait le plus important prolétariat juif d’Europe occidentale, comparable seulement à celui de Londres après les pogroms russes. L’orientation d’une partie significative de ce prolétariat juif allait vers le mouvement ouvrier et au tournant du siècle, beaucoup d’entre eux embrassèrent le socialisme. Dans la première moitié du XXe siècle, plusieurs de ces prolétaires jouèrent un rôle important dans les organisations ouvrières hollandaises.
Comme nous le montrons dans le livre La Gauche hollandaise2, dans les semaines qui précédèrent la grève, un groupe internationaliste, le Front Marx-Lénine-Luxemburg (Front MLL) avait déjà clairement exprimé ses positions au regard des atrocités perpétrées par les gangs fascistes et appelé les ouvriers à se défendre eux-mêmes. “Dans tous les districts ouvriers, des milices d’auto-défense devront être constituées. La défense contre la brutalité des bandits nationaux-socialistes doit être organisée. Mais les ouvriers devront également utiliser leur arme sur le terrain de l’économie. Il faut répondre aux actes scandaleux des fascistes par des grèves de masse.” (Spartacus no 2, mi-Février 1941 ; cité par Max Perthus, Henk Sneevliet)
La grève qui éclata le mardi 25 février fut une démonstration unique de solidarité avec les Juifs persécutés. Elle était sous le contrôle complet des travailleurs et la bourgeoisie n’avait aucune chance de l’utiliser pour ses objectifs guerriers, comme elle le fit avec la grève des chemins de fer en 1944. La grève n’était pas dirigée vers la libération des Pays-Bas de l’occupation allemande. La position du Front MLL n’était pas que la grève soit orientée vers le sabotage de la machine de guerre allemande ou l’alignement avec la Résistance nationale. Elle était censée être une déclaration de la classe ouvrière, une démonstration de sa force et de ce fait elle fut limitée dans le temps. Après deux jours, les ouvriers ont décidé unanimement de mettre fin à la grève.
Au milieu de la barbarie de la Seconde Guerre mondiale et dans un contexte de défaite historique de la classe ouvrière, la grève ne pouvait mener à une mobilisation générale de la classe ouvrière en Hollande ou à des réactions prolétariennes dans le reste de l’Europe, mais elle eut pourtant une signification politique internationale, dépassant de loin les frontières des Pays-Bas. La résistance des ouvriers en février 1941 contre la déportation de Juifs dans des camps de concentration, nous montre que le prolétariat n’est en rien impuissant ou condamné à l’inaction quand des groupes ethniques particuliers sont pris comme boucs émissaires et deviennent en conséquence victimes de pogroms, voire de génocides.
Le Front MLL a très bien compris cela. Par conséquent, il salua chaleureusement la grève comme une expression d’authentique indignation prolétarienne contre la persécution des Juifs, hommes, femmes et enfants. Pour le Front MLL, la grève contre la brutalité anti-juive était inconditionnellement liée au combat général contre le système capitaliste tout entier. La grève hollandaise de février 1941 a montré que, afin de défendre des groupes ethniques persécutés, la classe ouvrière doit rester sur son propre terrain et ne peut pas se permettre d’être entraînée sur le terrain bourgeois, comme cela est arrivé avec le mouvement BLM par exemple. Le terrain de la classe ouvrière est celui où la solidarité n’est pas restreinte par les divisions que le capitalisme a imposées à la société et où elle devient vraiment universelle. La solidarité prolétarienne est par définition l’expression de la classe dont la lutte autonome est destinée à développer une alternative fondamentale au capitalisme.
Dans la mesure où elle annonce la nature de la société pour laquelle elle lutte, elle est à même d’embrasser et d’intégrer la solidarité de l’humanité toute entière. C’est ce qui fait que la solidarité prolétarienne et la grève de février 1941 aux Pays-Bas revêtent une telle importance pour nous aujourd’hui.
CCI, avril 2021
1Voir : « Les groupes de la Gauche Communiste face au mouvement Black Lives Matter : une incapacité à identifier le terrain de la classe ouvrière » [267].
2La Gauche hollandaise, “chapitre X : Disparition et renaissance du communisme de conseil – Du “Marx-Lenin-Luxemburg Front” au “Communistenbond Spartacus” (1939-1942)”, pages 246-249. Cette brochure ne figure pas en intégralité sur notre site web. Il est possible de l’acheter en écrivant à l’adresse suivante : [email protected] [268]
Evènements historiques:
Rubrique:
La classe ouvrière prend de plein fouet le choc de la pandémie
- 75 lectures
“Reconstruire mais en mieux !”: voilà le dernier slogan qui sonne creux de la bourgeoisie britannique, destiné à faire croire, comme le slogan précédent “Redressons-nous !”, qu’une société équitable et juste sera nécessaire et possible après la pandémie. Ce que ces deux expressions reconnaissent quasi implicitement, c’est que la société continue d’être divisée en classes sociales et que “nous” ne sommes certainement pas “tous dans le même bateau”. Qu’il s’agisse de la santé, de l’éducation ou des revenus, les statistiques de la classe dirigeante confirment que la classe ouvrière, qui a déjà subi des décennies d’austérité, a été la plus durement touchée au cours des douze derniers mois d’épidémie. Dans cette perspective, il faut voir que la crise économique et les privations sociales accélérées par le Covid-19 ont des racines profondes dans la décadence et la déchéance du capitalisme en général et le déclin de la Grande-Bretagne en particulier. Nous verrons également que des sections du prolétariat, dans les conditions les plus difficiles, ont néanmoins tenté de défendre les intérêts fondamentaux de la classe.
La santé – un déclin historique
La pauvreté a un impact négatif absolu sur la santé de la population. Prenons par exemple la question de l’espérance de vie, telle qu’elle avait déjà été rapportée par Sir Michael Marmot avant le début de la pandémie : “L’espérance de vie a stagné pour la première fois en plus de cent ans et s’est même inversée pour les femmes les plus démunies de la société, (…) ce qui montre que le fossé des inégalités de santé est encore plus béant qu’il y a dix ans, en grande partie à cause de l’impact des coupes liées aux politiques d’austérité du gouvernement.”
L’étude de Sir Michael Marmot, dix ans après avoir averti que les inégalités croissantes dans la société entraîneraient une détérioration de la santé, révèle une image choquante de l’Angleterre qui, selon lui, n’est pas différente de celle du reste du Royaume-Uni et aurait pu être évitée… “Les réductions réelles des revenus des gens nuisent à la santé de la nation à long terme. Non seulement l’espérance de vie diminue, mais les gens vivent plus longtemps en mauvaise santé… Ces dégâts sur la santé de la nation n’auraient pas dû se produire. C’est choquant”, a déclaré M. Marmot, directeur de l’Institute of Health Equity de l’UCL (University College London).1
La nouvelle étude de Marmot, publiée en février 20202, prévoyait “une différence de 15 à 20 ans dans l’espérance de vie en bonne santé entre les régions les plus riches et les plus pauvres du Royaume-Uni”3. Pour les hommes vivant dans les zones les plus pauvres, “vous pouvez vous attendre à vivre neuf ans de moins qu’une personne vivant dans l’une des zones les plus riches”4
Ainsi, lorsque le Covid-19 puis le confinement ont frappé en février-mars 2020, ils ont surtout touché “ceux qui vivent dans les régions les plus pauvres de Grand-Bretagne, [qui] ont plus de chance de souffrir de maladies cardiaques et pulmonaires, et leurs enfants ont deux fois plus de chances d’être obèses que ceux des régions riches. Les personnes condamnées à vivre dans des logements insalubres sont plus susceptibles de souffrir de maladies telles que l’asthme, et la santé mentale étant endommagées de manière disproportionnée par le stress de la pauvreté, les hommes les plus pauvres sont jusqu’à dix fois plus exposés au risque de suicide que les plus riches.”5
Les mauvaises conditions de logement, de santé et d’alimentation – qui sont le lot d’une grande partie du prolétariat britannique – sont devenues des terrains propices à la propagation du Covid et ont favorisé les répercussions les plus pernicieuses.
“Dans certaines des zones les plus défavorisées d’Angleterre, janvier 2021 a été le mois le plus meurtrier depuis le début de la pandémie. En janvier, le taux de mortalité lié au Covid à Burnley (Lancashire) était deux fois supérieur à la moyenne anglaise et les décès, toutes causes confondues, étaient 60 % plus élevés que la moyenne anglaise” 6.
Et pas seulement dans le nord de l’Angleterre : la capitale, Londres, a accueilli ce qu’on appelle le “triangle du Covid”, composé des trois arrondissements :“Barking & Dagenham, Redbridge et Newham se disputaient le taux d’infection le plus élevé de tout le pays. Dans Barking & Dagenham, une personne sur 16 serait infectée… Dans cette zone, la main-d’œuvre est principalement constituée de personnel essentiel qui ne peut rester à la maison… ou en situation de travail précaire… Alors que le virus mutant, plus contagieux, a fait monter en flèche le taux de mortalité au niveau local, il a également mis en évidence un réseau complexe de problèmes plus profonds, qui se sont accumulés pendant de nombreuses années. En particulier, l’exposition accrue au virus s’est ajoutée aux problèmes rencontrés par une population déjà vulnérable, dont beaucoup de membres souffraient de comorbidités et d’une mauvaise santé.”
Les niveaux élevés de privations et précarité du travail, les grandes inégalités de revenus, la discrimination en matière de logement et les disparités médicales ont depuis longtemps un impact sévère sur l’enchevêtrement de communautés et de minorités ethniques qui vivent dans ces arrondissements. Mais, lorsqu’ils sont combinés à la nécessité de se déplacer pour travailler, de prendre les transports en commun et de partager l’espace dans des logements trop petits, ils constituent également le terrain idéal pour un virus mortel. L’effet domino allait s’avérer catastrophique.7
La description ci-dessus, tirée du “journal des patrons”, le Financial Times, explique très clairement qu’il ne s’agit pas simplement d’une minorité “ethnique” ou d’une autre minorité qui souffre, mais que sa souffrance fait partie intégrante de la détérioration généralisée des conditions de vie de la classe ouvrière.
Les indemnisations légales des arrêts-maladie des travailleurs britanniques – auxquelles les plus bas salaires n’ont même pas droit – sont parmi les plus basses d’Europe. Par nécessité, de nombreux travailleurs n’ont pas passé le test de dépistage du Covid – un facteur qui a contribué à rendre inefficace le système de test et de dépistage “mondialement reconnu”. Une étude menée conjointement par le King’s College de Londres et le ministère de la Santé publique d’Angleterre a révélé que, parmi les personnes ayant signalé qu’elles avaient les symptômes du Covid, seules 18 % s’étaient auto-isolées. “Notre étude a indiqué […] que les contraintes financières et les responsabilités liées aux soins sont des obstacles courants à l’adhésion à cette mesure”.8
La destruction historique par la bourgeoisie du salaire social – les paiements destinés à soutenir les individus dans le besoin et à garder opérationnels les hôpitaux et les centres de soins – est donc un facteur primordial dans le fait que le taux d’infection par le Covid en Grande-Bretagne “ait battu un record du monde”.
Pour les travailleurs mis au chômage, renvoyés chez eux avec des salaires réduits ou obligés de se rétablir de la maladie à domicile, la vie peut être pénible. Les écoles étant fermées à tous, sauf aux enfants des “travailleurs indispensables”, les parents, dont beaucoup travaillent chez eux pendant de longues heures, sont obligés de devenir des enseignants, coupés par le confinement des réseaux de soins familiaux ou de voisinage (non rémunérés). Le prolétariat dans son ensemble a souffert d’une façon disproportionnée. Le terme “pauvreté numérique” a été inventé pour expliquer pourquoi de nombreux enfants de la classe ouvrière n’avaient pas d’ordinateur portable pour l’enseignement à distance, ni même de connexion internet à la maison.
“A la fin de l’année 2020, 23 % de la population du Royaume-Uni vivait dans la pauvreté. Parmi les 700 0000 personnes plongées dans la précarité à cause de la pandémie, on compte 120 000 enfants. L’augmentation du niveau de pauvreté est due à plusieurs facteurs. Les personnes qui restent à la maison ont fait grimper le coût de la vie, les ménages payant davantage pour le gaz et l’électricité et dépensant plus pour la nourriture des enfants, qui auraient eu en temps normal des repas gratuits à l’école. A cela s’ajoute la montée en flèche du chômage, les fermetures ayant rendu difficile le fonctionnement de secteurs comme l’hôtellerie et la vente au détail. Le taux de chômage au Royaume-Uni a atteint 5,1 % fin 2020, ce qui signifie que 1,74 million de personnes étaient sans emploi. Les chiffres du Bureau de Statistiques Nationales ont relevé une augmentation de 454 000 personnes depuis un an, ce sont les chiffres les plus élevés depuis 2016.”9
Ce rapport du magazine Big Issue a également indiqué que les trois quarts des enfants vivant dans la pauvreté provenaient de ménages dont l’un des parents travaille ou cherche un emploi. A Noël 2020, l’organisation caritative UNICEF a lancé une intervention d’urgence nationale au Royaume-Uni pour la première fois en 70 ans d’histoire, afin d’aider les enfants touchés par la crise du Covid-19 !
Le British Medical Journal (BMJ) a mis en garde contre les conséquences probables de la pandémie : “il s’agit notamment de la dépression, du syndrome de stress post-traumatique, du désespoir, des sentiments d’enfermement et de pénibilité, de la toxicomanie, de la solitude, de la violence domestique, de la négligence ou de la maltraitance des enfants, du chômage et d’autres formes d’insécurité financière. Des services appropriés doivent être mis à la disposition des personnes en crise et de celles qui ont des problèmes de santé mentale nouveaux ou déjà présents. L’effet des dommages économiques causés par la pandémie est particulièrement préoccupant. Une étude a rapporté qu’après la crise économique de 2008, les taux de suicide ont augmenté dans deux tiers des 54 pays étudiés, en particulier chez les hommes et dans les pays où les pertes d’emploi sont les plus élevées.”10 Comme nous l’avons vu, loin de fournir les “services appropriés” réclamés par le BMJ, l’État britannique les a rognés au cours des 30 dernières années.
Face à une paupérisation croissante, près de neuf millions de personnes ont emprunté plus d’argent l’an dernier, en raison de l’impact du coronavirus. “Depuis juin 2020, la proportion de travailleurs empruntant 1000 £ ou plus est passée de 35 % à 45 %, a indiqué l’Office national de statistiques. Les travailleurs indépendants étaient plus susceptibles d’emprunter de l’argent que les salariés. On a également constaté une forte augmentation de la proportion de personnes handicapées empruntant des sommes similaires.”11 L’image de centaines de personnes faisant la queue dans la neige devant une soupe populaire à Glasgow est devenue virale, alors que la demande pour des banques alimentaires a explosé au cours de l’hiver.
Certains n’ont même pas eu un toit au-dessus de la tête pendant la première année de la pandémie. Malgré les tentatives de l’État pour “nettoyer les rues” en ouvrant certains foyers et hôtels aux sans-abri, “près de 1000 décès de sans-abri ont eu lieu l’an dernier au Royaume Uni…”. Le Museum of Homelessness (musée communautaire de justice sociale) a déclaré que ce chiffre avait augmenté de plus d’un tiers par rapport à l’année précédente et a demandé que davantage de mesures soient prises pour mettre un terme à ces “terribles pertes de vies”.12
Mourir au travail
Nous avons vu comment, pour de nombreux travailleurs mis au chômage ou en congé maladie à salaire réduit, la vie “à la maison” ou dans la rue était et reste pleine de dangers. Pour beaucoup, cette option n’existait pas et n’existe toujours pas : malades ou en danger, la nécessité de gagner un salaire les obligeait à travailler. Il n’est donc pas étonnant de découvrir que le Covid ait fait des ravages dans les zones traditionnellement occupées par la classe ouvrière.
Compte tenu des pénuries concernant les EPI (Equipements de Protection Individuelle), de la difficulté à respecter la distanciation sociale et de l’évacuation sans ménagement des personnes âgées non testées, des hôpitaux vers des maisons de retraite mal équipées13, ce sont les infirmières, le personnel soignant et les autres employés en “première ligne” qui ont été les plus touchés. Les chiffres de l’Office national de statistiques montrent que les travailleurs des maisons de retraite et les infirmières figurent parmi les professions les plus susceptibles de mourir d’un coronavirus, aux côtés des réparateurs ou chargés d’entretien des machines, des aides à domicile, des chefs cuisiniers, des restaurateurs et des chauffeurs de bus.
Comme la maladie, l’épuisement rend les travailleurs vulnérables aux infections virales et, au début de la pandémie, le NHS (service sanitaire national) comptait quelque 100 000 postes vacants, dont 20 000 dans le secteur des soins infirmiers. A mesure que la surpopulation et les maladies du personnel faisaient des ravages, de moins en moins de personnel médical et de soutien s’occupait de patients de plus en plus nombreux, ce qui augmentait leur propre risque d’infection. Les hôpitaux eux-mêmes sont devenus des bouillons de culture pour le virus. En janvier 2021, “52000 employés du NHS sont en arrêt maladie à cause du Covid. Plus de 850 travailleurs de la santé britannique seraient morts du Covid entre mars et décembre 2020”14. Une personne sur quatre ayant été hospitalisée aurait été contaminée à l’hôpital !
Les usines de transformation alimentaire britanniques – y compris les abattoirs – étaient également des lieux à haut risque viral, tandis que les chauffeurs de bus se sont révélés particulièrement exposés, notamment en raison du retard pris dans l’installation d’écrans de protection pour les chauffeurs. Les effets à long terme des traitements hospitaliers annulés, associés à des services défaillants pour les personnes vulnérables, handicapées ou souffrant de maladies mentales, n’ont pas encore été calculés, bien que près de cinq millions de patients du NHS aient été, début avril 2021, en attente d’un traitement annulé ou retardé “à cause du Covid”. La classe ouvrière en général n’a pas les moyens de se procurer des traitements “alternatifs” ou “privés”.
L’attitude de l’Etat envers la classe ouvrière en Grande-Bretagne
La bourgeoisie britannique a jugé prudent, face à sa pire crise économique depuis les années 1930, d’ “investir” environ 400 milliards de livres sterling dans diverses formes de plans de “sauvetage”, y compris des indemnités de licenciement et une extension temporaire du crédit universel. Ce déboursement par la dette de la valeur précédemment créée par la classe ouvrière, ou fondé sur son exploitation future, n’a pas été fait par altruisme mais pour préserver des industries et des entreprises entières de la faillite, pour maintenir une main-d’œuvre minimale et pour assurer un minimum de cohésion sociale. En ce sens, la situation actuelle – qui se reflète dans la plupart des grands pays industriels – présente certaines similitudes avec l’ancien Empire Romain qui, à son époque décadente, était obligé de nourrir ses esclaves, plutôt que d’être nourri par eux.
Cependant, déterminé à montrer qu’en dépit des mesures d’ “allègement”, l’État n’est pas un “tendre”, le gouvernement de Boris Johnson – celui qui a inventé “reconstruire en mieux” et “redressons-nous” – a insisté pour que les “héros” d’hier, le personnel du NHS, y compris les infirmières, “bénéficient” d’une augmentation de salaire limitée à 1 %, soit environ 60 pence par jour après déduction d’impôts. Cette mesure était froidement calculée pour envoyer un signal à la classe ouvrière dans son ensemble : “si les infirmières méritantes n’ont pas une belle augmentation, vous non plus n’y aurez pas droit”
Cette idée a été renforcée par un arrêt très médiatisé de la Cour Suprême en mars 2021, selon lequel le personnel soignant du Royaume-Uni, qui dort sur son lieu de travail au cas où on aurait besoin de lui, n’a pas droit à une augmentation de salaire minimum pour l’ensemble de son service.
Et, au cas où le message ne serait pas assez clair, des dizaines de milliers d’autres travailleurs risquent de voir leurs contrats de travail actuels annulés et remplacés par un régime d’exploitation beaucoup plus dur – la politique de généralisation des contrats d’intérim, portail vers l’extension du travail précaire, les contrats à zéro heure et la gig economy (économie des petits boulots). Tesco, British Telecom, British Gas et diverses compagnies de bus font partie des entreprises qui emploient cette “tactique”. Un travailleur sur dix serait concerné par ces plans d’emplois intérimaires. Tout cela au nom d’une plus grande “productivité” et d’une plus grande “efficacité”. C’est la classe ouvrière qui se voit présenter une facture de 400 milliards de livres.
Tout cela est soutenu par la menace de l’État d’une plus grande répression, inscrite dans le projet de loi sur la police, la criminalité, les peines et les tribunaux, qui a déjà suscité des manifestations dans tout le pays15. Sabotant la lutte de l’intérieur, les syndicats se préparent à se poser en défenseurs “naturels” de la classe ouvrière, face à ces nouvelles attaques – la menace de grève du Royal College of Nurses (RCN) et la revendication d’un salaire de 12 % pour contrer l’offre de 1 % du gouvernement n’étant que l’exemple le plus évident.
La résistance de la classe ouvrière
Les traditions et les leçons tirées des grandes luttes de la classe ouvrière (comme celles de 1972 et 1984 en Grande-Bretagne), ont été largement enterrées au cours des 30 dernières années et les récents confinements nécessités par la pandémie imposent de nouvelles restrictions à la capacité des travailleurs de défendre leurs intérêts. Cependant, il y a eu des expressions de la colère de la classe ouvrière et des tentatives d’auto-organisation, y compris les manifestations de l’été dernier par les travailleurs de la santé à travers la Grande-Bretagne16, les récentes grèves des loyers des étudiants en Grande-Bretagne et les manifestations d’étudiants en France17.
Dans le secteur de la santé, comme nous l’avons mentionné plus haut, le syndicat des infirmières RCN et le syndicat Unison “représentant” les autres employés du NHS ont été obligés de parler de l’organisation d’une grève ou d’une action de protestation face à la colère croissante suscitée par les bas salaires et les conditions de vie dangereuses dans les services et les théâtres. Au moins une manfestation (à Manchester le 7 mars 2021) pour une augmentation plus importante des salaires a connu des ordres de dispersion et des arrestations “pour avoir enfreint les règles de distanciation sociale”. Pour l’instant, ces actions syndicales semblent avoir contribué à retarder toute initiative spontanée et à désamorcer la mobilisation, sans parvenir à apaiser les ressentiments et la colère des infirmières et des autres membres du personnel NHS.
D’autres incidents de lutte dans ce secteur ont été signalés par le blog AngryWorkersWorld Blog du 5 mars, notamment : “En janvier 2021, les portiers ont démarré une grève de 11 jours organisée par Unison contre la politique de recours aux emplois d’intérim par le NHS du trust Heartlands à Birmingham. En mars 2021, plus de 150 brancardiers, d’employés des services de nettoyage, de standardistes et le personnel de restauration employés au centre de soins de Cumberland par la société d’équipement Mitie, ont mené une première journée d’action avec Unison, en raison d’un défaut de paiement des heures supplémentaires. Les ouvriers de Mitie ont également engagé une action avec le syndicat GMB contre l’hôpital Epsom & St Helier Trust pour des salaires impayés. Ces conflits touchent principalement la frange externalisée (les entreprises sous-traitantes du sytème de santé)”18.
Le 6 avril, environ 1 400 travailleurs des bureaux d’immatriculation des véhicules du gouvernement (DVLA) à Swansea, ont entamé une grève de quatre jours pour protester contre les dispositions de sécurité inadéquates contre le Covid, qui étaient responsables de plus de 500 cas d’infection dans deux sites. Dans le même temps, une grève “a durée illimitée”de près de 500 travailleurs des bus de la compagnie Go North West à Manchester, est entrée dans sa sixième semaine, face au projet de l’entreprise d’imposer un contrat intérimaire impliquant des pertes de salaires allant jusqu’à 2500 £ par an et des réductions massives au niveau des indemnités-maladie. Dans la capitale, plus de 2000 chauffeurs de bus des compagnies London United, London Sovereign et Quality Line ont entamé une grève “reconductible” depuis la fin du mois de février, pour s’opposer au programme de remplacer les emplois fixes par des contrats intérimaires. Environ un tiers des chauffeurs auraient rejeté l’accord proposé par le syndicat Unite avec les patrons et des piquets de grève ont été dressés dans les dépôts de bus.
Au début du mois de mars, des milliers de techniciens de terrain de British Gas ont organisé une grève de quatre jours – la dernière d’une série d’actions en opposition aux propositions de la direction de généraliser les contrats d’intérim. Le 1er avril, l’entreprise a envoyé des lettres de licenciement à près de 1000 travailleurs refusant de signer le nouvel accord. Le 5 avril, des centaines de chauffeurs Deliveroo – dont certains gagnent à peine 2 £ de l’heure et dont les conditions de service précaires incarnent la gig economy – se sont mis en grève et ont organisé une manifestation devant le siège de l’entreprise à Londres. La colère de près de 50 000 techniciens et employés d’entretien de British Telecom face aux fermetures de sites, aux 1000 suppressions d’emplois proposés et aux signatures de nouveaux contrats intitutionnalisant la précariation de l’emploi a jusqu’à présent été contenue par une double attaque : celle de l’entreprise, qui propose des incitations financières en espèces entre 1000 et 1500 £ (à condition d’accepter le nouveau contrat), et celle du syndicat des Communications, qui s’est engagé dans une série de scrutins et de pourparlers avec la direction afin de calmer la situation.
Les actions ci-dessus – qui ne constituent en aucun cas un compte-rendu exhaustif – montrent que les ouvriers n’ont pas été intimidés par la pandémie, ni par la propagande du gouvernement, mais aussi que, en général, leur résistance a été jusqu’à présent relativement bien encadrée et désamorcée par les syndicats et qu’ils ont été largement incapables de résister à l’austérité proposée ou imposée. Les attaques contre les conditions et le niveau de vie des travailleurs ne peuvent que s’intensifier dans la période à venir, quel que soit le stade atteint par la pandémie. La résistance de la classe ouvrière à ces attaques sera plus nécessaire que jamais.
Robert Frank, 17/04/2021
1Austerity blamed for life expectancy stalling for first time in century” [270], The Guardian, (25 février 2020). En outre, le British Medical Journal “a rapporté, début 2019 que les coupes dans les budgets de la santé et des soins sociaux entre 2010 et 2017 ont conduit à environ 120 000 décès précoces au Royaume-Uni, “un constat assez choquant”, selon l’auteur Bill Bryson dans son livre “The body…” publié par les éditions Doubleday en 2019.
2Health Equity in England : The Marmot Review 10 Years On” [271], The Health foudation, (février 2020).
3The Guardian, 25 février 2020.
4“The combination of Covid and class has been devastating for Britain's poorest” [272], The Guardian, (26 janvier 2021).
5The Guardian, 26 janvier 2021
6“Il y a des gens ‘trop pauvres pour mourir” [273], BBC News, (6 mars 2021).
7“Inside The Covid Triangle”, The Financial Times, (5 mars 2021).
8“Effective test, trace and isolate needs better communication and support” [274], Centre d’information du King’s College de Londres, (25 septembre 2020).
9“UK poverty : The facts, figures and effects”, (3 mars 2021).
10“Trends in Suicide During the Cocid-19 Pandemic”, BMJ, (12 novembre 2020).
11“Covid : Nine million people forced to borrow more to cope”, BBC News, (21 janvier 2021).
12“Terrible loss of life’ as almost 1,000 UK homeless deaths recorded in 2020”, The London Economic, (22 février 2021).
13Voir notre article : “The British government's « Herd Immunity » policy is not science but the abandonment of the most sick and vulnerable” [275], ICConline, (may 2020).
14“Ministers under fresh pressure over PPE for NHS heroes on coronavirus frontline”, Daily Mirror, (20 janvier 2021).
15Voir notre article : “Workers have no interest in defending capitalism’s “democratic rights”” [276], ICConline, (april 2021).
En vérité, l’État démocratique’ n’a pas besoin d’une nouvelle législation pour persécuter et attaquer pénalement la véritable lutte de classe : les révélations d’une conspiration infâme entre la police, les médias, les patrons, les syndicats, le système judiciaire et les gouvernement contre les ‘piquets volants’ (c’est-à-dire les ouvriers qui cherchent à étendre la lutte vers d’autres ouvriers) lors de la grève des mineurs britanniques, et les condamnations de 24 ouvriers (‘les 24 de Shrewsbury’) qui en ont découlé, n’ont été annulées qu’en mars de cette année… un demi-siècle après les événements ! Ainsi, tout en marquant une réelle extension des pouvoirs de la police, le nouveau projet de loi présenté au Parlement sert également d’avertissement spécifique à la population et aux travailleurs pour qu’ils “restent dans les clous”.
16Voir notre article : “Manifestations dans le secteur de la santé en Grande-Bretagne : remettre en cause “l’unité nationale” [277], ICConline, (novembre 2020).
17Voir l’introduction de : “Mobilisation des étudiants : Confrontée à la misère, la jeunesse ne se résigne pas !” [278], Révolution internationale n°487, (mars-avril 2021).
18“1 %? Up yours ! We need health workers' and patients' power !” [279], Libcom.org, (mars 2021) Voir aussi : “A Sign of Things to Come”, sur le site de la Tendance Communiste Internationaliste Leftcom.
Récent et en cours:
- Coronavirus [55]
- COVID-19 [56]
Rubrique:
ICCOnline - juillet 2021
- 36 lectures
Des réactions au document sur les problèmes sanitaires dans la Russie d’Octobre 1917
- 82 lectures
Deux lectrices ont réagi à la publication d’un document (disponible sur notre site internet [280]) sur l’évolution de la situation sanitaire dans la Russie des soviets en 1919. Il s’agit d’un rapport du Commissariat de l’hygiène publique qui rend compte de son travail un an après sa mise sur pied. Nous remercions les camarades pour leurs remarques critiques. Celles-ci sont indispensables pour nous permettre de corriger des erreurs ou d’améliorer notre façon d’exposer nos positions, elles permettent aussi de poursuivre des discussions commencées dans le cadre des permanences ou des réunions publiques.
Comme nous l’indiquons dans l’introduction, il ne s’agit pas de se faire des illusions sur la situation sanitaire en Russie, alors que les difficultés économiques, scientifiques, militaires et politiques assaillent le jeune bastion prolétarien. Notre but était de montrer le contraste entre deux méthodes mises en œuvre : celle de la dictature du prolétariat d’une part, celle de la dictature de la bourgeoisie dans le cadre de la pandémie actuelle où l’incurie domine, du fait de la concurrence et des priorités accordées uniquement à la production dans les secteurs les plus rentables. Comme l’écrit la camarade R., il faut bien constater la supériorité de la méthode inspirée par les intérêts du prolétariat, malgré des moyens limités : « Ce qui saute aux yeux, c’est l’avancée de la réflexion médicale en termes de prévention, de suivi des épidémies, de campagnes de vaccination, etc. Le texte nous fournit la liste des épidémies sévissant à l’époque : choléra, grippe espagnole, typhus, dysenterie, maladies infantiles, etc., et fait le constat suivant : “Les épidémies, de tout temps et en tout lieu, exercent surtout leurs ravages parmi les pauvres, parmi les classes laborieuses”. Comment ne pas faire le parallèle avec la situation sanitaire due au Covid-19 où les prolétaires les plus précaires sont touchés en grand nombre et, faute de soins adéquats, vont grossir les décomptes funèbres quotidiens : sur ce point il faudra attendre plusieurs mois de pandémie pour que quelques scientifiques alertent sur la forte mortalité parmi les populations précaires !!! »
Cependant, on ne peut manquer de ressentir un certain scepticisme chez nos deux camarades qui semblent se poser des questions sur la valeur d’un tel document dont certaines formulations leur rappellent les déclarations euphoriques de la propagande stalinienne. La camarade R. écrit : « De prime abord, on est un peu surpris par l’enthousiasme de ce rapport rédigé en juillet 1919 ». La camarade L. conclut son message ainsi : « Il me semble qu’on ne peut pas évoquer les plans rationnels qui avaient été construits afin de soulager la population et l’aider à tenir bon sans parler des forces contraires qui sapaient le travail des bolcheviks, ni les forces négatives qui se développaient déjà au sein du parti bolchevik ». Il est vrai que l’isolement de la Russie révolutionnaire (le blocus économique et plus encore l’isolement politique après l’échec de la révolution en Allemagne et en Hongrie) va conduire très vite vers un processus de dégénérescence de la révolution. Pris à la gorge, les bolcheviks vont aggraver le problème en fusionnant le parti communiste et l’État de la société transitoire. Au moment où le document paraît, les Conseils ouvriers avaient perdu pratiquement tout leur pouvoir et une bureaucratie d’État se développait avec son lot habituel de corruption. Mais les camarades seront probablement d’accord avec nous pour faire la différence entre la phase de dégénérescence de la révolution où l’opportunisme mène la bataille pour s’imposer et la période de contre-révolution qui s’installe à partir de 1924, lorsque Staline a pris le contrôle du parti, de l’État et de l’Internationale communiste, et qu’il impose la théorie (bourgeoise par nature) du « socialisme dans un seul pays ». Dans une telle période de dégénérescence, la vie révolutionnaire et l’enthousiasme prolétarien s’expriment encore malgré les difficultés. Certaines ambiguïtés du document reflètent ces difficultés, comme celle-ci : « Seule une génération saine de corps et d’esprit peut préserver les conquêtes de la Grande Révolution socialiste de Russie et amener le pays à une complète réalisation du régime communiste » (1)
Il est très important de faire cette distinction, car des leçons positives peuvent être tirées de l’expérience d’une révolution prolétarienne, y compris dans sa phase de dégénérescence, alors que plus rien ne concerne l’expérience révolutionnaire du prolétariat dans une période de contre-révolution. C’est la raison pour laquelle nous avons toujours défendu que la répression du soulèvement de Kronstadt en 1921 ne signait pas la fin de la révolution. Bien qu’entraînés dans les impasses du centrisme (qui se situait entre la droite de Boukharine et la Gauche communiste), Lénine et Trotsky ne franchissent pas la frontière de classe malgré la catastrophe qu’a représenté l’écrasement de Kronstadt pour le prolétariat mondial. C’est pourquoi la Gauche communiste d’Italie a pu en tirer une leçon fondamentale pour le futur : le rejet de toute violence au sein de la classe ouvrière pendant la phase de la dictature du prolétariat.
Pour appuyer son argumentation, la camarade L. écrit : « Emma Goldman est allée en Russie dans années 1919-1920 et a été choquée par la situation sanitaire, les enfants abandonnés dans les rues, les difficultés à organiser la prise en charge des soins, la pénurie de médicaments, le poids de la bureaucratie, la difficulté à obtenir les autorisations pour se déplacer ; la classe ouvrière avait pris le pouvoir, mais déjà la bureaucratie gênait la mise en œuvre des mesures nécessaires, les forces de l’Entente bouclaient la Russie et empêchaient les livraisons de produits de première nécessité ». La camarade a tendance ici à perdre de vue la réalité du pouvoir prolétarien en 1919 et ne voit plus que les contre-tendances (démoralisantes mais bien réelles) qui vont dans le sens de la dégénérescence. D’ailleurs, si Emma Goldman a fini par rejeter en entier la révolution russe d’Octobre 1917 du fait de ses positions anarchistes, elle était très ouverte dans les premières années après son arrivée en Russie et a continué à soutenir les bolcheviks. Elle savait faire la différence entre tendances et contre-tendances : « C’est vrai que les bolcheviks ont tenté là le maximum en ce qui concerne l’enfant et l’éducation. C’est aussi vrai que, s’ils n’ont pas réussi à parer aux besoins des enfants de Russie, la faute en incombe beaucoup plus aux ennemis de la révolution russe qu’à eux. L’intervention et le blocus ont pesé plus lourdement sur les frêles épaules d’enfants innocents et de malades ». (2) C’est ainsi qu’elle a gardé son enthousiasme révolutionnaire devant les efforts titanesques du prolétariat, avant que celui-ci ne s’incline devant l’acharnement de la bourgeoisie stalinienne et mondiale.
Cette expérience irremplaçable et toutes les leçons qu’on doit en tirer pour l’avenir, on peut le ressentir dans le document que nous avons publié, par exemple cette conception prolétarienne de la justice : « Pour la première fois dans le monde entier et uniquement dans la Russie soviétiste, il fut décrété, dès le début de 1918, que les enfants âgés de moins de 18 ans ayant transgressé la loi ne peuvent être reconnus criminels, bien que pouvant être socialement dangereux et même nuisibles à la société. Ces enfants sont les tristes victimes des conditions anormales d’autrefois, de la société bourgeoise et n’ont besoin que d’une rééducation ». La Commune de Paris n’a duré que quelques semaines et pourtant le marxisme révolutionnaire en a tiré des leçons décisives quant au but et aux moyens de la révolution prolétarienne. Que dire alors de la Révolution russe de 1917-1923 ? C’est un trésor que le prolétariat devra encore et toujours étudier pour être en mesure de vaincre demain.
La camarade R. pose une question importante : « Le rapport décrit tout le protocole de mise en place de la prévention, des soins, de l’éducation sanitaire, etc., grâce au moyen d’un système de santé centralisé : question ? Comment interpréter cette centralisation ? Était-ce une partie du “centralisme” dédiée à la santé ? Était-ce un plan de centralisation des compétences médicales pour tenter de faire face à la détresse sanitaire et à la mortalité dans les rangs populaires ? Cette question en entraîne une autre : en elle-même, la centralisation n’est pas la garantie d’un réel pouvoir des masses sur la gestion d’un service ou plus encore des affaires de l’État ? » Il est bien vrai que si on prend « la centralisation » en soi, de façon abstraite, on n’arrivera à rien. On y verra déjà beaucoup plus clair en examinant le rapport dialectique entre centralisation et unité. La petite bourgeoisie et les couches sociales intermédiaires, effrayées par le prolétariat qui lui rappelle la menace du déclassement, irritées par la bourgeoisie dont l’État central les accule à la faillite, n’ont jamais pu s’unir pour se défendre, encore moins pour porter un projet révolutionnaire, elles ont toujours rejeté la centralisation au profit de l’autonomie locale et du fédéralisme.
Il en va tout autrement des classes historiques. La bourgeoisie révolutionnaire s’est appuyée sur un État centralisé et sur l’unité nationale pour se lancer à la conquête du marché mondial. Sans ces atouts, un pays comme l’Allemagne a pris un retard considérable par rapport à la France qui s’était débarrassée violemment du féodalisme en 1789. La bourgeoisie est effectivement capable de s’unir et de centraliser son action sur les champs de bataille militaires ou économiques, et tout particulièrement face à son ennemi de classe. Mais elle est minée par la concurrence économique, les rivalités impérialistes et les rivalités de cliques. Seul l’État est en mesure d’assurer la centralisation, un État toujours monolithique et totalitaire enveloppé dans les limbes de l’idéologie et de la religion. La situation est toute différente pour le prolétariat qui n’a pas d’intérêts économiques divergents, qui est par excellence une classe internationale. Certes, les ouvriers se font concurrence sur le marché du travail et ne connaissent pas la même situation selon les secteurs économiques et selon les pays. Certes, ils subissent de plein fouet la domination idéologique de la bourgeoisie, et c’est bien pourquoi ils doivent lutter à la fois contre l’ennemi de classe et pour conquérir leur unité, et cela n’est possible que dans une révolution. Tout ce qui les divise est un héritage de leur appartenance à la classe exploitée, cependant ils portent en eux une autre société qui se caractérise par la solidarité et, pour la première fois dans l’histoire, l’unité de l’espèce humaine. Cette société ne peut émerger que sur la base de la socialisation internationale de la production mise en œuvre par la bourgeoisie mais les contradictions de son système d’exploitation basé sur la concurrence freine cette socialisation. Seule la classe ouvrière pourra la mener plus loin. En se débarrassant des classes et de l’État, la société communiste aura résolu la contradiction entre l’individu et la communauté. Ainsi, le prolétariat comme classe révolutionnaire est capable de mener un combat acharné et violent contre la bourgeoisie, tout en unissant et centralisant ses forces au sein des Conseils ouvriers où toute forme de contrainte violente a disparu. Cette supériorité de la centralisation prolétarienne s’exprime également dans l’organisation révolutionnaire et le Parti. Sinon l’organisation d’avant-garde ne serait qu’un cercle de bavards et son action serait réduite à l’impuissance.
Les camarades de la Gauche communiste d’Italie rappelaient dans les années 1930 comment la question a été clarifiée par le marxisme : « En s’inspirant des travaux de Marx sur la Commune de Paris et développés par Lénine, les marxistes ont réussi à faire la nette démarcation entre le centralisme exprimant la forme nécessaire et progressive de l’évolution sociale et ce centralisme oppressif cristallisé dans l’État bourgeois. Tout en s’appuyant sur le premier, ils luttèrent pour la destruction du second. C’est sur cette position matérialiste indestructible qu’ils ont vaincu scientifiquement l’idéologie anarchiste ». (3)
La centralisation mise en œuvre par le Commissariat de l’hygiène publique représentait effectivement un atout qui a porté ses fruits, même dans le contexte limité que l’on connaît, car elle portait la marque d’un pouvoir authentiquement prolétarien.
RI, 1er juillet 2021
1 Conclusion du rapport du Commissariat de l’hygiène publique, sur notre site
2 Citée dans « Emma Goldman et la Révolution russe : Réponse tardive à une anarchiste révolutionnaire », Revue internationale n° 160.
3 « Problèmes de la période de transition (5). Quelques données pour une gestion prolétarienne », Bilan n° 37, (novembre-décembre 1936). L’article a été republié dans la Revue internationale n° 132, (1er trimestre 2008).
Vie du CCI:
- Courrier des lecteurs [252]
Histoire du mouvement ouvrier:
- Révolution Russe [217]
Rubrique:
Centrale nucléaire de Taishan: Le capitalisme menace de nous détruire
- 45 lectures
À nouveau, le spectre de l’accident nucléaire vient frapper les esprits. Après la catastrophe de Tchernobyl et celle de Fukushima, les nombreux incidents nucléaires répertoriés ou passés sous silence, ce qui s’est produit mi-juin dans le sud de la Chine dans un réacteur de nouvelle génération EPR de la centrale de Taishan vient nous rappeler qu’au-delà de l’omerta et des discours rassurants sur la fiabilité des réacteurs de type EPR, un des “fleurons” de la technologie française, le danger des catastrophes reste devant nous. Quand bien même l’incident, présenté par les autorités comme une “fuite de gaz radioactif dans le circuit primaire”. serait, nous dit-on, sans réelle conséquence, cela n’a rien de rassurant pour autant.
En effet, depuis les années 1990, nous ne pouvons que constater l’incurie de plus en plus évidente des “autorités” et l’accroissement des catastrophes en tout genre, de plus en plus graves et fréquentes : catastrophes dites “naturelles”, comme les inondations à répétition, les cyclones, les sécheresses, les incendies, ou “technologiques”, comme l’explosion à Beyrouth du 4 août 2020 et celle de Lubrizol en France, se multiplient.
Tout cela témoigne du fait que les dangers face auxquels les hommes semblent chaque jour plus démunis alors que les technologies ne cessent de progresser et que tous les moyens existent pour s’en protéger, prennent désormais une allure systémique et dévastatrice. À l’instar d’une pandémie comme celle que nous traversons, une catastrophe nucléaire sérieuse aurait nécessairement une dimension planétaire aux répercussions dramatiques, comme ce fut le cas en partie pour Tchernobyl en 1986, mais qui pourrait passer pour une bagatelle face aux dangers qui menacent avec le vieillissement d’une majorité des centrales dans le monde. Bien que passées largement sous silence, les conséquences de Tchernobyl ou de Fukushima continuent de frapper, notamment par l’augmentation des cancers de la thyroïde, sans compter les régions et les millions de mètres cube d’eau contaminés. Mais là encore, malgré la gravité, le pire n’a pas encore eu lieu tant la menace est grande.
Tous ces phénomènes n’ont rien de fortuit, contrairement à ce qu’on veut nous faire croire. Leur augmentation et leur accélération ne fait que traduire l’impasse historique du système capitaliste en décomposition. Après plus d’un siècle de déclin historique et d’obsolescence, le système capitaliste agonisant, miné par ses contradictions et par sa recherche effrénée du profit coûte que coûte, poursuit sa quête de manière accélérée par sa politique de terre brûlée et menace désormais l’humanité de destruction à petit feu. Seul un combat acharné et conscient du prolétariat international pour défendre ses conditions de vie face à la paupérisation et aux menaces que fait peser ce système pourra libérer le monde de l’impasse capitaliste et de ses dangers mortels.
WH, 19 juin 2021
Géographique:
- Chine [281]
Rubrique:
Ceuta: Les migrants, otages des sordides rivalités capitalistes
- 36 lectures
Nous publions ci-dessous des extraits d’un article publié sur notre site en espagnol.
Afin de fermer l’accès à la Méditerranée, l’Union Européenne déploie une force navale nommée Frontex qui, en 10 ans, a refoulé de manière expéditive plus de 60 000 migrants et a été dénoncée pour effectuer des renvois directs dans des îles grecques en crise.
De plus, à côté de la répression propre des États membres l’UE confie “la sale besogne” de traque, de répression et de retour au pays d’origine à la Turquie à l’est, à la Libye au centre et au Maroc à l’ouest. […]
Le cynique marchandage de l’État marocain
Le capital marocain se charge à la perfection de cette “sous-traitance” puisque ses forces de répression ont une réputation bien méritée de brutalité et d’absence de scrupules en matière de “droits humains”. Depuis 2005, la police marocaine enferme, assassine, viole, bat, renvoie les migrants et réalise même quelque chose d’encore plus atroce en les faisant monter dans les autobus pour les abandonner en plein désert. 1 […]
Cependant en assumant ces fonctions généreusement rétribuées par l’UE, le Maroc, tout comme son homologue turc, dispose d’une formidable arme de pression et de chantage sur l’Europe et plus particulièrement sur l’Espagne, porte sud de la Méditerranée.
Le capital marocain utilise dans son intérêt le drame de l’émigration. Il se fait rémunérer sous forme de subventions, d’investissements, d’accords commerciaux, d’avantages impérialistes, etc. Lorsque le Maroc souhaite obtenir quelque avantage impérialiste (particulièrement au sujet du Sahara occidental) ou économique (par exemple avec la pêche) ou simplement recevoir plus de subventions. Mais quand il désire exercer une pression plus forte, il n’hésite pas à ouvrir sa frontière avec l’Espagne. C’est le jeu sinistre du chat et de la souris. Sa manœuvre habituelle est de laisser passer les migrants à travers les “points chauds” espagnols : Canaries, Melilla et Ceuta.
C’est le cas de la récente crise à Ceuta durant laquelle en deux jours, 10 000 personnes sont entrées dans la ville avec les encouragements des autorités marocaines. Après avoir laissé les portes ouvertes le lundi et le mardi, le mercredi 19 mai le Maroc a fermé de nouveau les frontières et les matraques, les tabassages et les détentions sont réapparus.
Plus de 1500 enfants et des familles entières sont entrés en nageant ou en passant par des trous dans les clôtures frontalières.
Au Maroc, la jeunesse est désespérée par le chômage, les atroces conditions de travail et la répression du régime : “La pandémie de Covid-19 a contracté l’économie de 7,1 % et a fait s’envoler le chômage des jeunes à près de 40 %. La pauvreté dans les villes a été multipliée par 7 durant la dernière année. En février, au moins 24 personnes, pour la plupart des femmes, sont mortes noyées à cause d’une inondation dans une cave de Tanger qui fonctionnait comme fabrique textile illégale”2. […]
Dans le même temps au nord du Maroc, se concentrent des milliers de migrants qui fuient en débandade la situation qui règne dans la grande majorité des pays africains.
Pour l’UNHCR (agence dec l’ONU sur la question des réfugiés), […] “la majeure partie des migrants est victime ou témoin d’exactions brutales aux mains des trafiquants, des contrebandiers, des milices ou des autorités étatiques qui les soumettent à des tortures impensables comme des brûlures à l’huile, au métal brûlant, ou au plastique fondu ; des décharges électriques et des immobilisations dans des postures douloureuses en plus de les battre et de les obliger à réaliser des travaux forcés, voire de les assassiner”.
Selon ce même rapport, “dans 47 % des cas les victimes ont déclaré que ces violences émanaient des autorités policières, ce qui écarte l’idée que les responsables sont toujours des contrebandiers ou des trafiquants”. “Au moins 1750 personnes sont mortes en 2018 et en 2019 après avoir migré de nations d’Afrique occidentale ou orientale”.
Cela a débouché sur les incidents de Castillejos, une ville marocaine voisine de Ceuta, où des centaines de jeunes se sont défendus contre la gendarmerie à coups de pierres. C’est une manipulation sanglante qui montre le capital tel qu’il est : un système assassin commandé par des assassins patentés.
L’hypocrisie et la barbarie de la démocratie espagnole
Le capital espagnol, un impérialisme de second plan, aime exhiber ses muscles chaque fois qu’il a un contentieux avec son voisin du Sud. En 2002, le gouvernement de droite d’Aznar avait déployé une opération militaire disproportionée afin de déloger une demi-douzaine de soldats marocains qui avaient fait une incursion sur Perjil, en face des côtes de Ceuta. En 2005 le gouvernement “socialiste” de Zapatero a déployé ses troupes de légionnaires et la garde civile afin de repousser brutalement une ruée de migrants que le Maroc avait laissé passer par Melilla. Cinq migrants sont morts. Désormais, c’est le gouvernement de la “gauche progressiste” de Sanchez (dont fait partie “l’ami des migrants” Podemos), qui lance les tanks sur la plage du Tarajal et déploie l’armée et la garde civile. Les migrants ont souffert de ce déploiement puisque se sont produites “des agressions sur mineurs de la part des membres de l’armée, le non-respect du devoir de protection à l’enfance, des renvois immédiats sans un minimum de garanties, la criminalisation des personnes migrantes. Au moins un homme est décédé. Le gouvernement espagnol a refoulé plus de 4000 personnes”.3 […]
Le capital espagnol joue un double jeu avec les pays du Maghreb en tentant d’arbitrer et de tirer profit des tensions entre deux ennemis irréconciliables : le Maroc et l’Algérie. Cette dernière supporte le Polisario, “mouvement de libération du Sahara occidental” occupé par le Maroc ainsi l’hospitalisation en Espagne du leader de ce groupe atteint du Covid a provoqué les représailles marocaines. Cependant, la réponse armée du capital espagnol a pris les migrants comme cibles. C’est la réalité de toutes les guerres : les capitaux nationaux s’affrontent en utilisant les masses humaines comme chair à canon.
L’État espagnol qui prétend être “démocratique”, “humanitaire” et “avancé” a tenté de dissimuler la barbarie de sa réponse avec la répétition en boucle d’images humanitaires : un garde civil qui sauve un bébé, des soldats prenant un migrant par l’épaule ou les équipes du personnel sanitaire s’occupant de femmes et d’enfants transis de froid.
Le cache-sexe hypocrite du gouvernement “le plus progressiste de l’histoire espagnole” occulte le désespoir de centaines de migrants qui déambulent dans Ceuta, se cachant de la police et de l’armée pour ne pas être renvoyés ou internés : selon la presse locale, “Les enfants, les jeunes qui arrivent sur le territoire de Ceuta sont refoulés sans que personne ait parlé avec eux, dorment dans la rue et sont victimes de tirs de carabine de plomb dans les rues”. À Ceuta, des femmes d’origine marocaine, aidées par des familles espagnoles et de Gibraltar, ont organisé de leur propre initiative, devant la totale inaction des organismes officiels, des services de douches, de distribution de nourriture et de vêtements aux migrants noirs ou arabes. D’après leurs témoignages, ils sont quelques milliers à venir chaque jour, apeurés, “refusant d’aller à l’hôpital universitaire de Ceuta car ils ont peur que la police ne les embarque et les renvoie au Maroc”. […] Les CIES (centres d’internement pour étrangers) sont des prisons dans lesquelles les migrants peuvent être enfermés plus de 60 jours sans avoir commis le moindre délit, théoriquement en attente d’être déportés. Il y en a huit en Espagne dans lesquels on a entassé jusqu’à 14 000 migrants alors que la capacité officielle est de 1472 personnes ! En mai 2020 ils ont été vidés à cause des révoltes et des protestations car ils ne recevaient aucune attention face au danger de contamination par le Covid. Cependant ils ont été réouverts en septembre 2020 et plus de 1000 personnes se retrouvent ainsi enfermées dans des conditions sanitaires, alimentaires et de traitement inhumaines.
S’y ajoutent les campements dans trois îles des Canaries (Fuerteventura, Gran Canaria et Tenerife) dans lesquels, en pleine pandémie, le gouvernement a entassé plus de 9000 migrants venant des côtes africaines dans des conditions de logement infâmes, avec de la nourriture de mauvaise qualité et en petite quantité et en leur faisant subir des traitements dégradants.
Ceux qui “jouissent de liberté” se voient forcés à dormir à la merci des intempéries sur des terrains, dans des maisons abandonnées ou dans le meilleur des cas, dans des appartements de fortune dans lesquels ils s’entassent jusqu’à 14 dans des logements de 3 pièces.
Avec des emplois informels, travaillant comme vigiles dans les parkings, laveurs de vitres aux feux rouges, vendeurs à la sauvette toujours prêts à ramasser les marchandises et à courir avant l’arrivée de la police.
De fait, derrière l’attaque scandaleuse des migrants par le capital espagnol se cache la poursuite de l’attaque frontale des conditions de vie de tous les travailleurs, natifs ou étrangers car les conditions des travailleurs “autochtones” s’apparentent toujours plus à celles de leurs frères de classe migrants. Le salaire moyen en Espagne a connu en 2020 une chute de 3,1 %, la plus importante depuis un demi-siècle. […] La précarité de l’emploi connaît une escalade irréversible affectant tout particulièrement les jeunes générations alors même que sévit une nouvelle vague énorme de licenciements.
Il faut repousser autant les loups (Vox, PP) qui disent défendre les travailleurs espagnols face aux immigrés que les loups déguisés en agneaux (Podemos, PSOE) qui prétendent défendre tout le monde sans discrimination.
Les uns un comme les autres n’ont qu’un seul but : renforcer l’exploitation capitaliste en accroissant l’enfoncement dans la misère de tous les prolétaires par tous les moyens.
Marjane/Omar, 31 mai 2021
1Voir l’article « Ceuta, Mellila : l’hypocrisie criminelle de la bourgeoisie démocratique » [282], Révolution internationaleI n° 362, (novembre 2005).
2“El regreso al pasado del rey de Marruecos”, article du quotidien bourgeois La Vanguardia du 20/05/2021.
3Selon Kaosenlared du 21 mai 2021 (site sur les réseaux sociaux se réclamant de la « gauche anticapitaliste »).
Géographique:
- Maroc [283]
Rubrique:
Le prolétariat lutte-t-il pour un idéal de justice?
- 117 lectures
Une sympathisante du CCI nous a fait part dans son courrier de préoccupations concernant directement l’avenir de la lutte de classe. Comme nous ne pouvons ici répondre à tous les aspects abordés par la camarade, nous souhaitons limiter notre réponse à une idée qui nous paraît important d’approfondir et clarifier.
La camarade avance l’idée suivante : « Quand on lutte pour davantage de justice ou d’égalité, ou contre la violence, on peut finir par comprendre que l’origine des inégalités, des injustices et des violences c’est le capitalisme ». La camarade poursuit en posant cette question : « Pourquoi, quand on lutte contre les injustices, contre les violences et pour l’égalité, est-ce un terrain bourgeois ? » (1)
La décomposition sociale, phase ultime de la décadence du capitalisme, marquée par l’incapacité des deux classes fondamentales de la société a donné une perspective à la société, a accru considérablement les injustices, les inégalités et les violences de toutes sortes, mais aussi et inéluctablement les guerres, la destruction de la planète, la misère et barbarie. Cette société entraîne le monde dans l’abîme. Telle est la réalité et le constat que nous devons faire et qui semble irrémédiable. De plus, cette période historique marquée par l’atomisation des individus et la fragmentation sociale débouche sur le repli vers « sa » communauté. Tous ces éléments pèsent donc sur la capacité de la classe ouvrière à recouvrer son identité (c’est-à-dire prendre conscience de son existence en tant que classe exploitée) et à développer ses luttes sur son propre terrain alors que les luttes parcellaires et interclassistes, souvent basées sur un idéal de justice et d’équité justement, tendent à se multiplier et mieux semer le trouble au sein de la classe ouvrière. Par conséquent, sur quelle base la classe ouvrière peut-elle lutter pour la transformation de ce monde ? Ce combat se fonde-t-il sur un idéal de justice ?
Le capitalisme a créé les conditions matérielles de son propre dépassement
Les sociétés de classes ont toujours connues l’inégalité, l’injustice et la violence. Malgré les révoltes des classes exploitées qui se sont succédées tout au long de l’histoire, comme celle de Spartacus contre la domination romaine, ou celle des paysans allemands et la secte chrétienne anabaptiste contre l’ordre féodal au XVIe siècle. Mais aucun des maux de l’exploitation n’a jamais disparu et ne pouvait disparaître. Aucune des classes exploitées du passé n’était réellement en mesure d’abattre l’exploitation de la société dans laquelle elle évoluait.
Contrairement aux modes de production l’ayant précédé, le capitalisme a pu développer les forces productives à un niveau suffisant pour dépasser la pénurie qui caractérisait les sociétés du passé. Le capitalisme ne produit pas pour satisfaire les besoins humains (c’est-à-dire des « valeurs d’usage ») mais pour créer des marchandises (ou « valeur d’échange »), à tel point qu’il est aujourd’hui empêtré dans une crise de surproduction généralisée et inéluctable.
Pourquoi ? Pour produire ses marchandises, le capitaliste achète aux travailleurs leur force de travail, la seule marchandise que les prolétaires peuvent vendre. Mais pour tirer un bénéfice suffisant lui permettant d’« accumuler du capital » (c’est-à-dire de nouvelles machines, plus nombreuses et plus performantes, lui permettant de produire de façons moins coûteuses et de rester compétitif face à la concurrence), il rétribue les prolétaires moins que la valeur réelle des marchandises produites. Or, comment acheter la totalité des marchandises produites si les salaires des prolétaires (et éventuellement la rémunération personnelle du capitaliste) lui sont inférieurs ? C’est ainsi que le capitalisme s’est répandu, tant dans les campagnes des premiers centres de productions capitalistes (en Europe occidentale) qu’aux quatre coins de la planète, à la recherche de nouveaux marchés en mesure d’acheter les marchandises. Ce faisant, il a peu à peu intégré ces marchés et leur population dans le processus de production de marchandises, aggravant davantage ses besoins en débouchés qui, du fait des limites objectives de la planète, sont devenus de moins en moins nombreux. C’est la raison pour laquelle les soubresauts de l’économie mondiale tendent à devenir toujours plus catastrophiques.
Comme le capitalisme a poussé à son terme le développement des forces productives en vue de produire des valeurs d’échange, la réponse à ses contradictions ne peut en aucun cas être le dépassement du capitalisme par une nouvelle société d’exploitation accroissant davantage la masse de marchandises. Le seul moyen de surmonter les contradictions du capitalisme réside donc dans l’abolition de ce qui constitue le cœur de celles-ci : la marchandise elle-même, en particulier, celle à partir de laquelle toutes les autres marchandises sont produites : la force de travail, c’est-à-dire le salariat. Dans la mesure où l’abolition de l’exploitation se confond, pour l’essentiel, avec l’abolition du salariat, seule la classe qui subit cette forme spécifique d’exploitation, c’est-à-dire le prolétariat, est en mesure de porter un projet révolutionnaire. (2)
La lutte pour la « justice » est une mystification
Étant à la fois une classe exploitée et une classe révolutionnaire, le but historique du prolétariat consiste donc à l’émancipation de l’humanité toute entière par la remise en cause du capitalisme comme un tout.
La lutte pour la « justice sociale », (comme faire payer davantage d’impôts aux « plus riches ») ou pour plus d’égalité (3) entre les individus dans tel ou tel domaine, quelle que soit leur classe sociale (comme le droit de vote pour tous par exemple), consiste seulement à « faire pression » sur le gouvernement bourgeois pour qu’il améliore la société capitaliste. Elles ne visent donc qu’à vouloir « refonder » ou « améliorer » une société par essence « inégalitaire », « injuste » et en pleine faillite.
Par conséquent, ces revendications ne peuvent pas former un facteur actif à l’identification du capitalisme comme cause de toutes les formes d’oppressions, d’aliénations et de ségrégations au sein de la société.
C’est déjà la critique portée par Marx et Engels dans le Manifeste communiste à l’égard des illusions idéalistes drainées par le courant socialiste utopique : « Certes les inventeurs de ces systèmes aperçoivent l’antagonisme des classes, ainsi que l’action des éléments dissolvants dans la société dominante elle-même. Toutefois, ils n’aperçoivent du côté du prolétariat aucune initiative historique, aucun mouvement politique qui lui soit propre. La forme rudimentaire de la lutte de classes tout comme leur propre situation dans la vie les portent cependant à se croire au-dessus des oppositions de classes. Ils voudraient améliorer l’existence de tous les membres de la société, même des plus privilégiés. C’est pourquoi ils lancent sans cesse leur appel à l’ensemble de la société sans distinction, et même de préférence à la classe dominante. […] C’est pourquoi ils rejettent toute action politique, et surtout toute action révolutionnaire. Ils veulent atteindre leur but par des moyens pacifiques, et ils essaient de frayer un chemin au nouvel évangile social par la force de l’exemple, par des expériences limitées, qui, naturellement, se terminent par un échec. […] Et pour donner corps à tous ces châteaux en Espagne, ils sont forcés de faire appel à la charité des cœurs et des bourses de la bourgeoisie ». (4)
Aujourd’hui, comme au milieu du XIXe siècle, le problème sur cette question se pose peu ou prou dans les mêmes termes :
– Les luttes contre les injustices et pour davantage d’égalité, en entretenant l’illusion que la société capitaliste, par essence inégalitaire, pourrait être améliorée, ne visent pas à mettre en cause le capitalisme comme un tout.
– Ce faisant, en appelant à réformer le système plutôt que de le transformer de fond en comble, ces revendications sèment les illusions et se placent résolument sur les terrains bourgeois ou petit-bourgeois.
Sur quoi est basée la lutte révolutionnaire du prolétariat ?
Depuis que le capitalisme l’a fait surgir, le prolétariat se bat (par la grève, les assemblées, etc.), pour réduire les effets de l’exploitation et se défendre face aux souffrances engendrées par l’esclavage salarié. Par conséquent, la classe ouvrière rentre en lutte, avant toute chose, par nécessité matérielle.
La plupart des luttes révolutionnaires du prolétariat ont ainsi commencé par la défense de besoins vitaux et un refus d’accepter passivement le développement de la misère et de la souffrance, de la guerre ou encore de la répression brutale exercée par la police ou l’armée. Tel fut le cas lors de la Commune de Paris, les révolutions de 1905 et 1917 en Russie et toute la vague révolutionnaire internationale après 1917-1918. Tel fut encore le cas lors de la plus grande grève ouvrière de l’histoire en 1968 en France. Tous ces épisodes de l’histoire du mouvement ouvrier montrent que le prolétariat ne déploie pas sa force révolutionnaire sur la base d’un idéal de justice ou d’égalité mais sur la base de son exploitation et des souffrances que le capitalisme lui fait subir.
Mais, dans le contexte de la décadence du capitalisme et de la concurrence toujours plus acharnée que se livre chaque capital pour écouler ses marchandises, la bourgeoisie est incapable d’accorder la moindre réforme durablement positive à la classe ouvrière. A part faire reculer ponctuellement telle ou telle attaques de la bourgeoisie, le prolétariat ne peut plus rien obtenir de la classe dominante. C’est ainsi que dans ses luttes « défensives », le prolétariat se heurte aussi aux limites objectives de la société capitaliste. Fertilisée par l’intervention de la minorité révolutionnaire, ces luttes « défensives » sont donc le terreau sur lequel le prolétariat est amené à développer sa conscience politique et sa lutte pour la destruction des causes mêmes de l’exploitation. Comme l’affirmait Lénine, la nature par essence révolutionnaire de la lutte du prolétariat implique que « derrière toute grève se dresse l’hydre de la révolution ».
Boris, 1er juillet 2021
1Nous bornerons notre réponse à la question des luttes contre les injustices et contre les inégalités.
2Pour davantage de précisions à ce sujet voir : « Perspective du communisme (III) : Pourquoi la classe ouvrière est la seule classe révolutionnaire », Révolution internationale n° 342.
3Rappelons d’ailleurs que le principe d’égalité ne fait pas partie des bases de la société communiste qui ne vise pas à mettre tous les individus au même niveau mais de s’établir en fonction des capacités et des besoins de chacun. Marx a d’ailleurs critiqué les errements de Babeuf et du courant babouviste durant la Révolution française à ce sujet. Voir notamment : « Du communisme primitif au socialisme utopique », Revue internationale n° 68.
4K. Marx, F. Engels, Le Manifeste communiste, « III. Littérature socialiste et communiste », 1848.
Vie du CCI:
- Courrier des lecteurs [252]
Rubrique:
Inondations, sécheresses, incendies… Le capitalisme conduit l’humanité vers un cataclysme planétaire!
- 197 lectures
En à peine quelques semaines, partout sur la planète, les catastrophes climatiques se sont enchaînées à un rythme effroyable. Aux États-Unis, au Pakistan, en Espagne ou au Canada, les températures ont avoisiné les 50°C. Dans le Nord de l’Inde, les fortes chaleurs ont causé plusieurs milliers de décès. 800 000 hectares de forêts sibériennes, l’une des régions les plus froides du monde, sont déjà partis en fumée. En Amérique du Nord, la désormais traditionnelle saison des incendies de forêts géants a déjà commencé : plus de 150 000 hectares ont déjà brûlé pour la seule Colombie britannique ! Dans le sud de Madagascar, une sécheresse sans précédent a plongé 1,5 million de personnes dans la famine. Des centaines de milliers de gamins crèvent, parce qu’ils n’ont plus rien à manger, ni rien à boire, dans une indifférence presque unanime ! Le Kenya et plusieurs autres pays africains connaissent la même situation dramatique.
Mais tandis qu’une partie du monde suffoque, des pluies diluviennes se sont abattues sur le Japon, la Chine et l’Europe provoquant des inondations sans précédents et des glissements de terrain meurtriers. En Europe de l'Ouest, en Allemagne et en Belgique particulièrement, les inondations, à l’heure où nous écrivons ces lignes, ont causé la mort de plus de 200 personnes et des milliers de blessés. Des milliers de maisons, des villages entiers, des agglomérations, des rues ont été emportés par les eaux. Dans l’ouest de l’Allemagne, le réseau routier, les lignes électriques, les conduites de gaz, les réseaux de télécommunication et les chemins de fers sont dévastés. De nombreux ponts ferroviaires et routiers se sont effondrés. Jamais cette région n’avait été frappée par des inondations d’une telle ampleur.
En Chine, dans la ville de Zhengzhou, capitale de la province centrale de Henan et peuplée de 10 millions d’habitants, il est tombé en trois jours l’équivalent d’un an de précipitations ! Des rues se sont transformées en torrents déchaînés, avec des scènes hallucinantes de dévastation et de chaos : routes effondrées, bitume fracassé, véhicules emportés par les eaux… Des milliers d’usagers du métro se sont retrouvés coincés dans les stations, les rames ou les tunnels, avec souvent de l’eau jusqu’au cou. Il est fait état d’au moins 33 morts et de nombreux blessés. 200 000 personnes ont été évacuées. L’approvisionnement en eau, en électricité, en nourriture ont été brutalement interrompus. Personne n’avait été prévenu. Les dommages agricoles se chiffrent en millions. Au sud du Henan, le barrage du réservoir d’eau de Guojiaju a cédé et deux autres menacent également de s’effondrer à tout moment.
Les conclusions effroyables du pré-rapport du GIEC qui a « fuité » dans la presse ont de quoi nous glacer le sang : « La vie sur Terre peut se remettre d’un changement climatique majeur en évoluant vers de nouvelles espèces et en créant de nouveaux écosystèmes. L’humanité ne le peut pas ». Depuis des décennies, les scientifiques alertent sur les dangers du dérèglement climatique. Nous y sommes ! Il ne s’agit plus seulement de la disparition d’espèces ou de catastrophes localisées ; les cataclysmes sont désormais permanents… et le pire est à venir !
L’incurie de la bourgeoisie face aux catastrophes
Depuis de nombreuses années, les canicules, les incendies, les ouragans et les images de destruction se multiplient. Mais si les carences et l’incompétence des États les plus pauvres dans la gestion des catastrophes ne surprennent malheureusement plus personne, l’incapacité croissante des grandes puissances à faire face est particulièrement significative du niveau de crise dans laquelle s’enfonce le capitalisme. Non seulement, les phénomènes climatiques sont de plus en plus dévastateurs, nombreux et incontrôlables, mais les États et les services de secours, sous le poids de décennies de coupes budgétaires, sont de plus en plus désorganisés et défaillants.
La situation en Allemagne est une expression manifeste de cette tendance. Si le système européen d’alerte pour les inondations (EFAS), mis en place après les inondations de 2002, a bien anticipé les crues des 14 et 15 juillet, comme l’a déclaré l’hydrologue Hannah Cloke : « les avertissements n’ont pas été pris au sérieux et les préparatifs ont été insuffisants ». (1) L’État central s’est, en effet, débarrassé des systèmes d’alerte en les confiant aux États fédéraux, voire aux municipalités, sans procédures standardisées, ni moyens conséquents. Résultat : alors que les réseaux électriques et de téléphonie s’étaient effondrés, empêchant d’alerter la population et de procéder à des évacuations, la protection civile n’a pu faire hurler les sirènes… que là où elles fonctionnent encore ! Avant la réunification, l’Allemagne de l’Ouest et de l’Est comptait environs 80 000 sirènes ; il n’en reste désormais que 15 000 en état de fonctionnement. (2) Faute de moyens de communication et de coordination, les opérations des forces de secours se sont également déroulées dans le plus grand désordre. En d’autres termes, l’austérité et l’incompétence bureaucratique ont largement contribué à ce fiasco !
Mais la responsabilité de la bourgeoisie ne s’arrête pas aux défaillances des systèmes de sécurité. Dans ces régions urbanisées et densément peuplées, la perméabilité des sols est fortement réduite, accroissant les risques d’inondations. Pendant des décennies, pour mieux concentrer la main d’œuvre par souci de rentabilité, les autorités n’ont jamais hésité à autoriser la construction de nombreuses habitations en zones inondables !
La bourgeoisie impuissante face aux enjeux du dérèglement climatique
Une grande partie de la bourgeoisie ne pouvait évidemment qu’admettre le lien entre le réchauffement climatique et la multiplication des catastrophes. Au milieu des décombres, la chancelière allemande déclarait solennellement : « Nous devons nous dépêcher. Nous devons aller plus vite dans la lutte contre le changement climatique ». (3) De la pure tartufferie ! Depuis les années 1970, les sommets internationaux et autres conférences s’enchaînent presque chaque année avec leur lot de promesses, d’objectifs, d’engagements. À chaque fois, les « accords historiques » se révèlent n’être que des vœux pieux, tandis que les émissions de gaz à effet de serre ne cessent d’augmenter d’année en année.
Par le passé, la bourgeoisie a pu se mobiliser sur des enjeux ponctuels du point de vue de son économie, comme la diminution drastique des gaz fluorés responsables du « trou » dans la couche d’ozone. Ces gaz étaient notamment utilisés dans les climatiseurs, les réfrigérateurs ou les bombes aérosols. Un effort, certes important face aux risques que fait encore peser la dégradation de la couche d’ozone, mais qui n’a jamais nécessité un bouleversement drastique de l’appareil de production capitaliste. Les émissions de CO2 représentent un enjeu autrement plus considérable sur ce plan !
Les gaz à effet de serre, ce sont les véhicules qui transportent travailleurs et marchandises, c’est l’énergie qui fait tourner les usines, c’est aussi la production de méthane et la destruction des forêts induites par l’agriculture intensive. Bref, les émissions de CO2 touchent au cœur de la production capitaliste : la concentration de la main d’œuvre dans d’immense métropole, l’anarchie de la production, l’échange de marchandises à l’échelle planétaire, l’industrie lourde… C’est la raison pour laquelle la bourgeoisie est incapable de trouver de véritables solutions à la crise climatique. La recherche de profit, la surproduction massive de marchandises, comme le pillage des ressources naturelles, ne sont pas une « option » pour le capitalisme : c’est la condition sine qua non de son existence. La bourgeoisie ne peut que promouvoir l’accroissement de la production en vue de l’accumulation élargie de son capital, sans quoi elle met en péril ses propres intérêts et ses profits face à une concurrence mondialisée exacerbée. Le fond inavouable de cette logique est la suivante : « après moi le déluge » ! Les phénomènes climatiques extrêmes ne se contentent plus d’impacter les populations des pays les plus pauvres, ils perturbent désormais directement le fonctionnement de l’appareil de production industriel et agricole dans les pays centraux. La bourgeoisie est ainsi prise dans l’étau de contradictions insolubles !
Aucun État n’est en mesure de transformer radicalement son appareil de production sans subir un recul brutal face à la concurrence des autres pays. La chancelière Merkel peut bien clamer qu’il faut « aller plus vite », il n’en demeure pas moins que le gouvernement allemand n’a jamais voulu entendre parler de réglementations environnementales trop strictes pour protéger des secteurs stratégiques comme ceux de l’acier, de la chimie ou de la voiture. Merkel a aussi réussi à repousser pendant des années l’abandon (pourtant très progressif) du charbon : l’exploitation à ciel ouvert du charbon de Rhénanie et d’Allemagne de l’Est demeure pourtant l’un des plus gros pollueurs d’Europe. En d’autres termes, le prix de la forte compétitivité de l’économie allemande, c’est la destruction sans vergogne de l’environnement ! La même logique implacable s’applique aux quatre coins de la planète : renoncer à émettre du CO2 dans l’atmosphère ou à détruire les forets, ce serait, pour « l’atelier du monde » qu’est la Chine comme pour l’ensemble des pays industrialisés, se tirer une balle dans le pied.
La « green economy », une mystification idéologique
Face à cette expression criante de l’impasse du capitalisme, la bourgeoisie instrumentalise les catastrophes pour mieux défendre son système. En Allemagne, où la campagne pour les élections fédérales de septembre bat son plein, les candidats rivalisent de propositions pour lutter contre le dérèglement climatique. Mais tout cela n’est que de la poudre aux yeux ! La « green economy », censée créer des emplois par millions et favoriser une prétendue « croissance verte », ne représente en rien une issue pour le capital, ni sur le plan économique, ni sur le plan écologique. Aux yeux de la bourgeoisie, la « green economy » a surtout une valeur idéologique destinée à feindre la possibilité de réformer le capitalisme. Si de nouveaux secteurs à coloration écologique émergent, comme la production de panneaux photovoltaïques, de bio carburants ou de véhicules électriques, non seulement ils ne pourront jamais servir de véritable locomotive à l’ensemble de l’économie compte tenu des limites des marchés solvables, mais leur impact catastrophique sur l’environnement n’est plus à démontrer : destruction massive des forêts pour en extraire des terres rares, recyclage plus que déplorable des batteries, agriculture intensive du colza, etc.
La « green economy » est aussi une arme de choix contre la classe ouvrière, justifiant les fermetures d’usines et les licenciements, comme en témoigne les propos de Baerbock, la candidate écologiste aux élections allemandes : « Nous ne pourrons éliminer progressivement les combustibles fossiles [et les travailleurs qui vont avec] que si nous disposons de cent pour cent d’énergies renouvelables » (4) Il faut dire qu’en matière de licenciements et d’exploitation de la main d’œuvre, les Verts en connaissent un rayon, eux qui, pendant sept ans, ont contribué activement aux ignobles réformes du gouvernement Schröder !
L’impuissance de la bourgeoisie face aux effets de plus en plus dévastateurs, sur le plan humain, social et économique du dérèglement climatique, n’est cependant pas une fatalité. Certes, parce qu’elle est prise dans l’étau des contradictions de son propre système, la bourgeoisie ne peut conduire l’humanité qu’au désastre. Mais la classe ouvrière, à travers sa lutte contre l’exploitation en vue du renversement du capitalisme, est la réponse à cette évidente contradiction entre, d’un côté, l’obsolescence des méthodes de production capitaliste, sa complète anarchie, la surproduction généralisée, le pillage insensé des ressources naturelles, et, de l’autre, le besoin impérieux de rationaliser la production et la logistique en vue de répondre à des besoins humains urgents et non à ceux du marché. En débarrassant l’humanité du profit et de l’exploitation capitaliste, le prolétariat aura, en effet, la possibilité matérielle de mener un programme radical de protection de l’environnement. Si le chemin est encore long, le communisme est plus que jamais nécessaire pour la survie de l'humanité !
EG, 23 juillet 2021
1 « Allemagne : après les inondations, premières tentatives d’explications [284] », Libération.fr (17 juillet 2021).
2 « Warum warnten nicht überall Sirenen vor der Flut ? [285] », N-TV.de (19 juillet 2021).
3 « Choquée par les dégâts “surréalistes”, Angela Merkel promet de reconstruire [286] », LeMonde.fr (18 juillet 2021).
4 « Klimaschutz fällt nicht vom Himmel, er muss auch gemacht werden [287] », Welt.de (22 juillet 2021).
Géographique:
Récent et en cours:
- environnement [289]
Questions théoriques:
- "Ecologie" [290]
Rubrique:
ICCOnline - août 2021
- 69 lectures
Permanence en ligne du 21 août 2021
- 72 lectures
Révolution Internationale, section en France du Courant Communiste International, organise une permanence en ligne le samedi 21 août 2021 à partir de 14h.
Ces permanences sont des lieux de débat ouverts à tous ceux qui souhaitent rencontrer et discuter avec le CCI. Nous invitons vivement tous nos lecteurs, contacts et sympathisants à venir y débattre afin de poursuivre la réflexion sur les enjeux de la situation et confronter les points de vue.
Les lecteurs qui souhaitent participer aux permanences en ligne peuvent adresser un message sur notre adresse électronique ([email protected] [213]) ou dans la rubrique “contact [214]” de notre site internet, en signalant quelles questions ils voudraient aborder, afin de nous permettre d’organiser au mieux les débats. Les modalités techniques pour se connecter à la permanence seront communiquées par retour de courriel.
Vie du CCI:
- Permanences [291]
Rubrique:
Le populisme accélère le chacun pour soi et les divisions au sein de la société
- 62 lectures
Après quinze mois durant lesquels les pays du G7 ont essayé de se renvoyer mutuellement ainsi que vers leurs rivaux les plus faibles, la responsabilité de la pandémie, après des millions de morts liés au coronavirus, après un chaos politique sans précédent aux États-Unis dont le point culminant fut l’invasion du Capitole, tout cela conjugué avec l’accélération de la crise climatique, l’aggravation des tensions internationales, les nouvelles embardées de l’économie mondiale, le sommet du G7 qui a eu lieu à Cornwall en juin, a donné une façade d’unité et de détermination entre les rivaux impérialistes. Derrière cette mascarade, le G7 est toujours un repaire de brigands. Le fait que la Chine, la seconde puissance économique mondiale n’était pas invitée au sommet en dit long sur la profondeur des tensions entre les puissances rivales. Les pays du G7 sont enfermés dans une lutte à mort pour dépecer et ravager la planète, ce afin de tenter désespérément de trouver et de contrôler les matières premières vitales pour « l’économie verte ». La seule chose qui a changé pour le G7 est que le remplacement de Trump par Biden signifie que les États-Unis ont rejoint la campagne unie de préoccupation hypocrite pour la nature et l’humanité et dans le but de jeter de la poudre aux yeux des travailleurs.
Un des éléments qui ont miné cette prétendue unité est la guerre que le gouvernement britannique mène avec l’Union européenne au sujet des saucisses, nuggets et autres viandes surgelées qui traversent la mer d’Irlande vers l’Irlande du Nord. La dispute au sujet de l’accord du Brexit a menacé de faire imploser la coquille vide du G7 et de son unité de façade. Boris Johnson a choisi d’ignorer les avertissements explicites que Biden a émis avant le meeting à cause de la tentative du Royaume-Uni d’utiliser le sommet afin de menacer de rompre le protocole d’accord sur l’Irlande du Nord si le gouvernement britannique ne pouvait pas agir à sa guise. Cette similitude avec les bouffonneries de Trump n’était pas un hasard. La Grande-Bretagne est devenue l’œil du cyclone populiste parmi les grandes puissances.
Des tensions grandissantes avec les gouvernements décentralisés
Aux États-Unis, les plus lucides factions de la bourgeoisie ont pour le moment réussi à écarter Trump du pouvoir. En Grande-Bretagne, des fractions similaires n’ont pas été capables de prendre de telles mesures afin de mieux contrôler leur appareil politique. Au lieu d’endiguer la marée populiste, le référendum de 2016 a ouvert les vannes. L’appareil politique tout entier a été paralysé dans la lutte sur le Brexit. La crise a donné naissance au gouvernement Johnson, dirigé par un politicien haï par beaucoup au sein de son propre parti pour ses mensonges, son irresponsabilité et son inclination prononcée pour la trahison. Le Parti travailliste, sous la direction de Keir Starmer, est entré dans une spirale de défaites électorales et de guerres intestines, laissant la classe dominante sans réelle alternative à ce stade pour remplacer ou agir comme modérateur face à Johnson.
Le prix à payer pour le maintien de ce gouvernement était clairement visible avec sa réponse initiale face au Covid. À un niveau beaucoup plus profond, la perte de contrôle de la bourgeoisie britannique sur son propre jeu politique menace d’accélérer les tensions, mettant en péril l’intégrité même de l’État britannique. Cela se remarque à travers le poids grandissant du Parti National écossais et ses appels à l’indépendance ainsi que les menaces grandissantes venant d’Irlande du Nord de rompre avec la Grande-Bretagne ou d’être jetée dans une violente tourmente à cause du Brexit.
Avant les élections locales de mai, l’un des principaux porte-paroles des factions anti-populistes de la bourgeoisie, The Economist, a lancé ce sinistre avertissement :
« Briser l’union d’un pays ne devrait jamais être fait à la légère car c’est un processus douloureux politiquement, économiquement et émotionnellement. Demandez aux Indiens, aux Pakistanais, aux Bangladais, aux Serbes ou aux anciens citoyens de Yougoslavie. Très peu de séparations se produisent aussi pacifiquement et avec autant de facilité que celle qu’ont connu les Tchèques et les Slovaques. Bien qu’il semble inconcevable que les citoyens du Royaume-Uni d’aujourd’hui commencent à s’entre-tuer, c’est exactement ce qu’ils ont fait durant les troubles en Irlande du Nord qui se sont terminés il y a moins d’un quart de siècle ».
La guerre civile n’est pas à l’ordre du jour mais la dynamique de fragmentation est bien réelle. Cela est particulièrement clair en Écosse où l’effort désastreux de contenir le populisme avec le référendum sur le Brexit n’a pas seulement ouvert les portes au populisme en lui permettant d’infecter le parti conservateur mais a donné une immense impulsion au nationalisme écossais. Le feu nationaliste a été alimenté, par ailleurs, par les déclarations provocantes du gouvernement Johnson s’opposant à l’indépendance et par sa gestion de la pandémie. La perspective de ne pas avoir de changement imminent dans l’équipe dirigeante à Londres fournit plus de munitions au parti national indépendantiste. Johnson est si toxique en Écosse que son propre parti lui a interdit de faire campagne là-bas car sa présence aurait augmenté le potentiel électoral du parti national.
Le Brexit a également mis à nu un profond problème pour l’État britannique en relation avec l’Irlande du Nord : son manque de contrôle total sur l’une de ses propres régions. L’accord du Vendredi Saint en 1998 imposé à l’impérialisme britannique par l’impérialisme américain, était basé sur l’hypothèse que le Royaume-Uni continuerait à faire partie de l’Union européenne. Il a donné aux rivaux du capitalisme britannique en Europe une influence au sein de son propre territoire : ils ont fourni de l’argent et furent les arbitres en fin de compte dans les disputes entre l’État britannique et les différentes forces du nationalisme irlandais. Parmi eux, le Sinn Fein et surtout sa branche armée, l’IRA, ont bien accueilli l’accord parce qu’il leur donnait une part de pouvoir politique dans le Nord et laissait intact son contrôle des zones nationalistes. La bourgeoisie unioniste (et ses forces paramilitaires) fut forcée de partager le pouvoir et l’État britannique dut faire face à ses rivaux, les États-Unis, l’Allemagne, la France et la République irlandaise, empiétant sur le contrôle d’une partie de son propre territoire.
Le Brexit a réouvert cette blessure du côté de l’État britannique, le laissant encore plus exposé aux ingérences de ses rivaux. La bourgeoisie britannique a été mise dos au mur par l’Union européenne dès le début des négociations sur le Brexit. Bien que les deux parties se soient mises d’accord sur le fait que l’Irlande du Nord reste dans l’union douanière jusqu’à un accord commercial définitif, une frontière physique serait rétablie, ce qui menacerait de raviver les troubles. C’est ce qui était au cœur du fameux filet de sécurité irlandais de Teresa May. Johnson et la ligne dure des Brexiters ont torpillé cela mais ils ont été confrontés au même problème et furent forcés de signer un accord encore pire.
En cela, Johnson a imprudemment trahi le Parti unioniste démocrate (DUP) et le reste des forces unionistes en Irlande du Nord. Lorsque le DUP a appuyé sa candidature à la tête du parti en 2018, il leur a dit qu’aucun Premier ministre ne pourrait signer un accord qui érigerait une frontière maritime entre l’Irlande du Nord et le reste du royaume. Ainsi lorsque Johnson a signé le Protocole, il a saboté l’influence politique du DUP et a affaibli sa crédibilité envers les factions loyalistes, forces paramilitaires incluses, et a fait croître les tensions au sein du DUP. Cela a conduit à l’éviction d’Arlene Foster comme Première ministre, au court intérim d’Edwin Poots et à son remplacement par Jeffery Donaldson.
Cette sensation d’être menés en bateau par l’État britannique a déjà provoqué des émeutes chez les loyalistes et les marches orangistes durant l’été pourraient créer une poudrière susceptible de générer encore plus de violence. Les paramilitaires loyalistes ont déjà averti qu’ils pourraient attaquer le commerce entre le Sud et le Nord car ils voient dans l’augmentation des échanges cette année entre la République d’Irlande et l’Irlande du Nord un pas vers l’unification qu’ils refusent.
En mai, le ministre chargé du Brexit et le secrétaire d’État pour l’Irlande du Nord ont pris contact avec les paramilitaires loyalistes et il se pourrait qu’ils aient encouragé leurs menaces de violences contre des agents des douanes de l’UE dans les ports d’Irlande du Nord. Mais ils jouent avec le feu. Les paramilitaires ne font pas confiance au gouvernement et se sentent de plus en plus isolés.
La bourgeoisie nationaliste irlandaise a été encouragée par l’évidente faiblesse de l’État britannique et par l’affaiblissement des partis unionistes. L’accord du Vendredi Saint contient la possibilité d’un référendum sur l’unification avec le Sud. L’intégration d’une population de paramilitaires loyalistes armés et furieux au sein même de son territoire, placerait l’État irlandais dans une situation identique à celle de l’État britannique. Cependant, l’irrationalité et le chaos grandissants dans la société pourraient amener les nationalistes dans le Nord à demander un référendum, ouvrant ainsi une nouvelle boîte de Pandore.
Des évolutions dangereuses pour la classe ouvrière
La posture ridicule du gouvernement Johnson au sujet de l’exportation de viande surgelée depuis la Grande-Bretagne vers l’Irlande du Nord résume juste à quel point la classe dominante britannique a été affaiblie et humiliée par le Brexit. Elle a été réduite à menacer de rompre un traité international, juste pour être autorisée par des rivaux à transporter des saucisses sur son propre territoire. Johnson n’a réussi qu’à se couvrir de ridicule dans sa tentative de rivaliser avec Biden sur ce sujet durant le sommet du G7 mais peu importe la faction au pouvoir, elle serait confrontée au même dilemme : ou risquer de remettre le feu aux poudres en Irlande du Nord en rompant le Protocole ou accepter l’interférence de rivaux impérialistes au sein de son propre territoire.
Les contradictions insurmontables de cette situation vont générer des tensions massives. Au vu de l’irresponsabilité politique et de la vision à court terme qui caractérisent les mesures du gouvernement Johnson, la possibilité que la situation devienne hors de contrôle est bien réelle. Cela pourrait mener à l’unification de l’Irlande et entraîner un nouveau cycle de terreur sectaire et de guérilla en Irlande du Nord qui pourrait s’étendre en Grande-Bretagne.
Le prolétariat en Grande-Bretagne est dans une situation difficile. L’accélération des forces centrifuges qui expriment la profondeur de la crise économique et la perte de contrôle grandissante de la bourgeoisie sur sa vie politique offrent aux travailleurs une perspective déroutante. De toutes les grandes nations, seul le prolétariat en Espagne est confronté à des pressions similaires conduisant à un danger de fragmentation et à une division concurrentielle en son sein derrière des factions bourgeoises. La capacité de la classe ouvrière à résister à ces pressions dépend du fait de mettre en avant ses intérêts de classe comme une classe antagoniste au capital : la solidarité de classe parmi toutes ses composantes contre les attaques grandissantes du capitalisme, la compréhension que l’ennemi est le système capitaliste et non les travailleurs des autres nationalités, la reconnaissance du besoin d’étendre les luttes, au-delà des frontières, des secteurs d’activité ou des régions, sont les seuls moyens de dépasser ces pressions grandissantes. C’est seulement en comprenant qu’il est une force sociale autonome qui contient l’unique alternative révolutionnaire au capitalisme, que le prolétariat pourra finalement renverser le système en rejetant toutes ces divisions.
Phil, 30 juin 2021
(traduction d'un article paru dans World Revolution, organe de presse du CCI au Royaume-Uni)
Géographique:
- Grande-Bretagne [47]
Personnages:
- Boris Johnson [292]
Récent et en cours:
- Populisme [293]
Rubrique:
Les travailleurs ne doivent pas prendre parti dans les conflits entre cliques capitalistes
- 42 lectures
Pour les populistes britanniques et partisans du Brexit, les rêves nostalgiques d’un Empire qui couvrait un quart de la surface du globe terrestre et où le soleil ne se couchait jamais, se transforment en cauchemars. Et la campagne sur la « Global Britain » ne pourra pas l’empêcher.
En 2021, le paysage géopolitique a fondamentalement changé pour le Royaume-Uni. La Grande-Bretagne a perdu en grande partie son statut de puissance mondiale. Ses relations avec le continent, sa position au sein de l’OTAN et ses liens avec le Commonwealth sont tous remis en question. La relation particulière avec les États-Unis donnait au moins au Royaume-Uni un rôle influent en tant qu’intermédiaire entre Washington et Bruxelles. En se coupant de l’Europe, le Royaume-Uni s’est tiré une balle dans le pied : « Nous ne sommes plus un pont irremplaçable entre l’Europe et l’Amérique. Nous sommes désormais moins pertinents pour l’un comme pour l’autre » (John Major). Lors des négociations relatives au Brexit, le Royaume-Uni a agi en partant du principe qu’il occupait une place équivalente aux autres puissances internationales sur la scène mondiale. Mais le Brexit a confirmé que la bourgeoisie britannique se berçait d’illusions. Depuis la conclusion des négociations, elle évolue désormais dans un monde dominé par les États-Unis, la Chine et l’Union européenne (UE), un monde où elle se trouve à présent isolée.
Dans les conditions géopolitiques actuelles, le Royaume-Uni devra rétablir ses relations politiques avec les principaux pays du monde. Il devra se frayer un chemin jusqu’à la table diplomatique, surtout depuis que l’administration américaine commence à redynamiser ses relations avec l’OTAN, l’ONU et d’autres organisations multilatérales.
En mars, le gouvernement britannique a lancé sa stratégie pour une « Global Britain in a competitive age ». (1) Ce projet expose les nouvelles ambitions britanniques en matière d’opportunités commerciales et de voies d’influence mondiale. Mais cette version remise à neuf de la « Revue intégrée de sécurité, de défense, d’aide au développement et de politique étrangère » de 2015 ne va pas résoudre les problèmes fondamentaux du Royaume-Uni après sa sortie de l’UE.
Tensions et fractures internes au Royaume-Uni
Le déclin de sa position sur la scène internationale a également alimenté des conflits croissants au sein même du Royaume-Uni, notamment avec les gouvernements régionaux d’Écosse et d’Irlande du Nord.
Le référendum sur le Brexit de 2016 « a donné une énorme impulsion au nationalisme écossais ». (2) Depuis, les appels à l’indépendance écossaise se renforcent d’année en année. Au début de l’année 2021, 54 % des Écossais étaient favorables à une Écosse indépendante, soit 8 % de plus qu’en 2014. De récents sondages d’opinion dans les principaux États membres de l’UE montrent que le soutien à une Écosse indépendante et membre de l’UE augmente.
Au cours de la dernière décennie, les forces en Irlande du Nord qui cherchent à se détacher du Royaume-Uni se sont renforcées. Le protocole nord-irlandais (3) n’a fait que jeter de l’huile sur le feu, en isolant davantage l’Irlande du Nord du reste du Royaume-Uni. Les tensions croissantes dans les six comtés (4) « menacent l’intégrité de l’État britannique lui-même ». (5) La fragmentation nationale pourrait devenir une réalité. Entre-temps, l’administration américaine a averti Johnson de ne pas violer le protocole nord-irlandais et de respecter l’accord du Vendredi saint (6) : la frontière ouverte entre le Nord et le Sud doit être protégée.
Au sein de l’establishment politique londonien, la tension monte également, au point que des ministres en concurrence, des conseillers politiques sont engagés dans une sordide guerre d’influence. Au cours des deux derniers mois, dans une atmosphère de doute, de jalousie et de suspicion, les accusations entre Johnson, Hancock et Cummings (7) ont volé dans tous les sens. La dernière expression de ces conflits a été le pilonnage du gouvernement par Dominic Cummings dans « une campagne massive sur les réseaux sociaux ». (8)
Classe contre classe
Ces tensions et ces fractures croissantes au sein du Royaume-Uni et les luttes qui en découlent entre factions bourgeoises présentent de grands dangers pour la classe ouvrière. Elles mettent les travailleurs face à « une perspective de désorientation ». (9) Mais ils doivent résister à la pression de soutenir l’une ou l’autre des cliques bourgeoises. La capacité des travailleurs à résister à de telles pressions ne peut être réalisée que lorsqu’ils luttent « en tant que classe antagoniste au capital ». (10) La seule perspective est de lutter sur un terrain de classe.
Au cours des derniers mois, les ouvriers du Royaume-Uni et d’ailleurs ont démontré qu’ils possèdent encore cette capacité, comme l’a montré une récente grève sauvage de 30 à 40 ouvriers sur le chantier de l’entrepôt Amazon de Gateshead. Les travailleurs y ont protesté pendant deux jours contre leur licenciement brutal. La persévérance et la solidarité de la classe ouvrière ont porté leurs fruits, puisque tous les travailleurs licenciés ont été réintégrés le troisième jour de la grève.
La même capacité a été démontrée le 3 juillet lorsque des dizaines de marches ont eu lieu à travers la Grande-Bretagne pour protester contre la proposition du gouvernement de n’augmenter que de 1 % les salaires des travailleurs du NHS (11), ce qui a été largement décrié par les travailleurs de la santé.
Ces luttes de petite envergure ne sont peut-être pas spectaculaires, mais elles sont les graines de l’autonomie future de la classe ouvrière contre le capital.
WR, section du CCI au Royaume-Uni 4 juillet 2021
1 « La Grande-Bretagne globale dans une ère de compétition [294] » est le titre du rapport remis par le gouvernement britannique en mars 2021, censé présenter la nouvelle doctrine impérialiste du Royaume-Uni (Note du traducteur).
2 Cf. « Royaume-Uni : Le populisme accélère le chacun pour soi et les divisions au sein de la société [295] », World revolution n° 389 (Été 2021).
3 Difficilement négocié avec l’UE et censé officiellement empêcher le retour d’une frontière physique entre la République d’Irlande et l’Irlande du Nord (Note du traducteur).
4 Il existe 32 comtés traditionnels en Irlande : 26 comtés appartiennent à la République d’Irlande et les six autres, qui n’ont aujourd’hui plus de réalité administrative, forment l’Irlande du Nord (Note du traducteur).
5 Ibid.
6 Cet accord a été signé en 1998 mettant fin à trois décennies de conflits entre nationalistes et unionistes d’Irlande du Nord (Note du traducteur).
7 Matt Hancock, ministre de la santé, a dû récemment présenter sa démission après une affaire de mœurs et de conflit d’intérêt. Dominic Cummings est un ancien conseiller politique que Johnson a limogé en novembre 2020 dans le cadre de lutte d’influence au sein du gouvernement. Depuis, Cummings est entré en conflit avec Johnson et multiplie les accusations.(Note du traducteur).
8 Cf. « Cummings “revelations”: Bourgeois vendettas and the distortion of science [296] », World revolution n° 389 (Été 2021).
9 Cf. « Royaume-Uni : Le populisme accélère le chacun pour soi et les divisions au sein de la société [295] », World revolution n° 389 (Été 2021).
10 Ibid.
11 Le National Health Service est le système de la santé publique du Royaume-Uni. (Note du traducteur).
Géographique:
- Grande-Bretagne [47]
Personnages:
- Boris Johnson [292]
Rubrique:
Manifestations à Cuba : Ni "la patrie ou la mort", ni "la patrie et la vie" ... les prolétaires n'ont pas de patrie !
- 59 lectures
Les 11 et 12 juillet de cette année, les plus grandes manifestations de rue à Cuba depuis 62 ans ont eu lieu, que le gouvernement cubain et tout l'appareil de gauche de la bourgeoisie tentent d'expliquer comme étant le résultat du prétendu "blocus économique" et de la manipulation du gouvernement américain contre le "communisme". D'autre part, les médias idéologiques de droite le présentent comme un soulèvement du peuple contre le "communisme". Les deux positions ont pour fondement le même présupposé selon lequel Cuba serait un pays socialiste ou communiste. C'est un mensonge ! Cuba n'est rien d'autre qu'un résidu des régimes staliniens, qui sont une forme extrême de la domination universelle du capitalisme d'État, exprimant la décadence de ce système moribond et mortel pour l'humanité. La gauche et la droite cachent dans leurs arguments que Cuba est un pays dont l'économie est régie par des lois capitalistes, dans lequel il y a des classes sociales opposées et une exploitation féroce des travailleurs, de sorte que, comme dans tout autre pays, il y a des expressions de mécontentement de la part des exploités, rejetant la vie misérable qu’offre ce système.(1) Cependant, la reconnaissance de l'existence à Cuba de classes sociales aux intérêts opposés et dans un rapport de forces permanent (bourgeoisie et prolétariat), ne signifie nullement que toute manifestation de mécontentement ou de colère dans la population soit le signe d’une réponse consciente du prolétariat, même si initialement elle montre les besoins réels des exploités, car le processus de prise de conscience et d'autonomie de la lutte du prolétariat n'est ni immédiat ni mécanique, surtout parce que les travailleurs doivent continuellement se confronter au poids de l'idéologie dominante et à l'atmosphère de confusion qu’approfondit encore le capitalisme en pleine putréfaction.
Les mobilisations au Chili et en Équateur en 2019, où l'interclassisme a empêché l'avancée de la combativité et l'action consciente des travailleurs, en sont un exemple.(2) En mai 2020, aux États-Unis, des manifestations ont également eu lieu pour protester contre l'assassinat de George Floyd, mais la classe ouvrière y apparaît diluée et contrôlée par la même bourgeoisie. Il y avait sans aucun doute un mécontentement à l'égard de l'action criminelle de la police ; de nombreux travailleurs individuels ont rejoint les manifestations et, cependant, la bourgeoisie, à partir du mouvement "Black Lives Matter", a réussi à focaliser la rage sur la question du "racisme" et à la stériliser en la poussant dans l’illusion démocratique, en exigeant une meilleure police et un système judiciaire plus démocratique, ce qui l'a même conduit à l'utiliser dans son cirque électoral.(3)
En Afrique du Sud, les premiers jours de juillet ont également été marqués par des émeutes au cours desquelles la répression de la police a fait plus de 200 morts et a donné lieu à des centaines d'arrestations. Les manifestations étaient sans aucun doute animées par des exploités laissés pour compte et ce sont ces mêmes personnes qui ont donné leur vie, mais les raisons pour lesquelles ils étaient dans les rues n'avaient aucun rapport avec la défense de leurs intérêts. La lutte au sein du parti au pouvoir, le Congrès national africain, qui a conduit à l'emprisonnement de l'ancien président Jacob Zuma (accusé de corruption), a été l'occasion pour une faction de la bourgeoisie de lancer une campagne de propagande (via les réseaux sociaux), enflammant l'animosité chauvine et raciale de la population zouloue, jeter les masses appauvries et désespérées dans une impasse sans perspectives, en profitant du mécontentement permanent qui existe et qui, dans le cadre de la pandémie, est marqué par l'impuissance et l'incertitude.
Pour comprendre les révoltes qui ont eu lieu à Cuba, il est nécessaire d'analyser leurs motifs, leurs effets et, surtout de savoir si le prolétariat y a pris part de manière active ou non, en tenant compte du fait que ces mouvements de protestation se sont déroulés à un moment où le système marque une accélération dans sa décomposition, ce qui a provoqué un nouvel effondrement dans la paupérisation, aggravant les conditions de vie des prolétaires, en raison de la pénurie de produits de première nécessité, mais aussi de la négligence des soins médicaux nécessaires pour combattre la pandémie.(4)
Les causes matérielles de l'agitation sociale à Cuba
Comme dans le reste du monde, à Cuba, la crise économique a aggravé la détérioration des conditions de vie des travailleurs, mais lorsqu'elle se mêle à la pandémie, la traînée de mort et de misère qu'elle laisse dans son sillage augmente de façon spectaculaire. La propagation du virus Covid-19 a révélé le grand mensonge répandu par le gouvernement cubain et repris en choeur par toutes les canailles de la gauche et l'extrême gauche du capital, sur l'existence d’un système de santé cubain exemplaire, qu'ils fondent sur le fait qu'il y aurait plus de 95 mille médecins, ce qui signifie qu'il y aurait pratiquement près de 9 médecins pour 1 000 habitants. Pourtant se reproduisent les mêmes cas de négligence et de pénurie que l'on retrouve dans le mode entier et qui prennent ici un tour encore plus dramatique, comme le confirme le fait que la grande majorité de la population n'est pas vaccinée (le taux de vaccination n'est que de 22%), et aussi du fait que les médecins ne disposent pas non plus de médicaments, d'oxygène, d'antigènes, de gel ou de seringues, etc.
La crise de 2008 avait laissé des séquelles latentes que la pandémie a ravivées et relancées avec plus d'ampleur. La difficulté à réactiver les investissements est un problème présent dans tous les pays et bien que la fermeture d'une grande partie de la production l'ait aggravé, la vérité est qu'il était déjà apparent avant même la propagation du virus Covid-19, et dans le cas de Cuba, en raison de son instabilité chronique, les conflits sont encore plus grands lorsque les activités touristiques (dont l'État tire ses principaux bénéfices) sont fermées, réduisant ainsi son PIB de 11% en 2020 et diminuant ses importations de 80%.
Depuis les années 1960, dans le cadre de la "guerre froide", l'île de Cuba était intégrée dans la sphère de domination du bloc impérialiste dirigé par l'URSS. Ainsi, répondant aux intérêts impérialistes, l'État cubain a été intégré dans la confrontation avec le bloc d'opposition dirigé par les États-Unis, qui, dans le cadre de cette confrontation, ont imposé certaines restrictions commerciales (décrites par la propagande de Castro comme un "blocus économique" complet, alors que le gouvernement américain le définit comme un simple "embargo"(5), Néanmoins, l'URSS a soutenu l'île sur le plan économique et politique, dans la mesure où elle était le principal acheteur de ses rares produits exportés, couvrait 70 % de ses importations, l'équipait militairement, mais lui transférait également une grande quantité de capitaux. Ainsi, lorsque le bloc stalinien s'est effondré à la fin des années 1980, Cuba s'est retrouvé sans sponsor et son économie s'est effondrée.
Entre 1990 et 1993, le PIB de Cuba a chuté de 36 %, ce qui l'a fait entrer dans ce que l'on a appelé une "période spéciale", qui s'est traduite par une détérioration brutale des conditions de vie de la population et, si elle a réussi à survivre, c'est grâce à son rapprochement avec des capitaux d'origine européenne (principalement espagnols) qui ont investi dans le tourisme et des projets financiers, et plus tard, avec le soutien qu'elle a obtenu de l'État vénézuélien, elle avait réussi à endiguer l'effondrement. Le gouvernement Chávez, profitant des hauts revenus perçus du pétrole, dans un cadre de collaboration impérialiste, a réalisé des projets politiques et commerciaux avec l'État cubain ; cependant, les flux monétaires obtenus du pétrole vénézuélien se sont arrêtés en 2015, mettant en faillite l'économie cubaine en même temps que l'économie vénézuélienne, les deux économies atteignant des niveaux d'insolvabilité.
L'une des mesures mises en œuvre par le gouvernement de Castro en 1994, dans le cadre de la "période spéciale", a été l'utilisation d'une double monnaie : le peso cubain (CUP), dans lequel les travailleurs recevaient leurs salaires, et le peso convertible (CUC), utilisé pour le commerce touristique. De cette manière, l'État contrôlait la gestion de toutes les devises étrangères entrantes, qu'il s'agisse de touristes ou de transferts de fonds.
Il est pertinent de mentionner ce projet car en décembre 2020, le gouvernement de Díaz Canel, successeur de la famille Castro, a décrété l'unification monétaire, accompagnant le décret de la formation de magasins avec paiement exclusif en devises, appelés MLC (Moneda Libremente Convertible), qui concentrent les quelques biens de subsistance et rendent obligatoire le paiement en devises, rendant ainsi plus difficile l'acquisition de ces biens par les travailleurs. Mais en plus, cet "ajustement monétaire" a mis à jour des niveaux d'inflation si graves que les salaires ont dû être augmentés de 450% et les pensions de 500%, ce qui n'a pas amélioré pour autant les conditions de vie des travailleurs, puisque les prix des produits alimentaires de base comme ceux de l'électricité et des transports publics(6), ont augmenté immédiatement dans les mêmes proportions. La paralysie de l'économie et la rareté de l'activité productive (qui ne suffit pas à couvrir la demande interne) ont entraîné une pénurie chronique de nourriture et de médicaments, obligeant ceux qui peuvent encore payer à faire la queue en moyenne 6 heures par jour. Les pénuries de carburant ont entraîné un manque de transports publics mais ont également provoqué des coupures de courant quotidiennes pouvant atteindre 12 heures.
Dans ce climat, qui est devenu encore plus explosif à mesure que le nombre de cas de Covid-19 augmentait(7), le désespoir et l'exaspération ont grandi et encouragé les protestations, qui sont apparues initialement dans la ville de San Antonio de los Baños. Quelques centaines de personnes sont descendues dans la rue en criant "Liberté et nourriture !" et "A bas le MLC !"... pendant près d'une heure, ces manifestations ont été retransmises sur les réseaux sociaux, jusqu'à ce que le gouvernement bloque l’accès à internet et aux réseaux sociaux et lance la police dans la répression, mais à ce moment-là, les manifestations s’étaient propagées dans 40 villes et villages et même à La Havane. Dans tous les endroits où les manifestations ont eu lieu, les gaz lacrymogènes ont été la première arme des attaques de la police, puis sont venues les balles de la police et de l'armée, qui ont fait un mort (un habitant d'un des quartiers les plus pauvres de La Havane), des dizaines de blessés et, pour couronner le tout, les arrestations massives. Le premier jour de la manifestation, 150 personnes ont été arrêtées, les jours suivants leur nombre a augmenté et pour entretenir le climat de peur et d’intimidation, les détenus ont été mis à l’isolement et maintenus dans la condition de "disparus".
Le prolétariat cubain sous le feu croisé du "socialisme" et de l'espoir de la "démocratie"
L'un des grands mythes entretenus par la bourgeoisie par rapport à Cuba est la prétendue existence du socialisme. Avec cet argument, elle a pu non seulement confondre et soumettre les exploités à l'intérieur de Cuba, mais même au niveau mondial, l'appareil de gauche de la bourgeoisie l'a largement exploité pour brouiller la conscience du prolétariat, en identifiant le stalinisme au communisme, alors qu'en réalité le stalinisme représente une frauduleuse et totale falsification idéologique du marxisme et du communisme. Mais tous les États et leurs médias utilisent également ce grand mensonge, en faisant passer les politiques répétées pendant des années à Cuba, comme le rationnement et les actions tyranniques de l'État, pour la base sur laquelle se construit le projet communiste. Ces visions largement diffusées, comme nous l'avons dit au début, empêchent de comprendre ce qui se passe avec le prolétariat à Cuba.
D'après les informations récupérées, le mécontentement de la grande majorité de la population cubaine est dû au manque de nourriture et de médicaments, aux prix élevés des produits, aux pannes d'électricité constantes(8) et, sans aucun doute, à la lassitude existante à l'égard de la tyrannie stalinienne. Il n'est pas du tout surprenant que, dans plusieurs villes, les manifestations se soient concentrées devant les locaux du parti "communiste" cubain. Cependant, il est également très clair que, dans toute cette révolte, le prolétariat est politiquement dilué, confus et dominé par le nationalisme et l'espoir de la démocratie.
Dans toutes les manifestations, nous avons vu des drapeaux nationaux brandis et des discours nationalistes dominants, utilisés par les porte-parole de l'État cubain pour justifier la répression, mais aussi par la bourgeoisie et la petite bourgeoisie impliquées dans les groupes d'opposition "anti-Castro" (qui ont immédiatement pris possession de l'espace de protestation), invoquent le nationalisme pour appeler à la démocratisation, et même les groupes associés à des fractions de la bourgeoisie américaine (opérant principalement depuis Miami), pour "sauver" la nation, appellent à l'invasion militaire de l’île... Dans ce chaos social, le prolétariat cubain se trouve désorienté, incapable de reconnaître sa nature et son identité de classe et donc incapable d'agir de manière autonome, ce qui permet à son mécontentement d'être exploité par des factions bourgeoises et petites-bourgeoises(9).
Une caractéristique de Cuba a été l'absence d'une tradition de lutte de la part de la classe ouvrière, nous pouvons nous rappeler que même lorsque des conditions d'exploitation sauvages ont été établies depuis le XIXe siècle, la classe ouvrière a eu un rapprochement politique très étroit avec le mouvement libéral bourgeois (dirigé par Martí) qui, bien qu'il puisse être politiquement explicable dans cette phase de développement capitaliste, plus tard, au cours du XXe siècle, avec le caractère décadent du système capitaliste déjà défini, la classe ouvrière a continué à espérer dans la recherche de la "libération nationale" promise par tous les partis bourgeois.(10) Ensuite, ces difficultés pour le prolétariat sont aggravées par l'impossibilité de récupérer les expériences et l'élan de la vague révolutionnaire qui avait pour centre les révolutions en Russie (1917) et en Allemagne (1919), ce qui est confirmé par le fait que la formation du Parti communiste (PC) a lieu jusqu'en 1925, à un moment où la vague révolutionnaire mondiale est en déclin et où la IIIe Internationale et avec elle les PC, entrent dans un processus de dégénérescence, abandonnant les principes internationalistes.
Et pour couronner le tout, le fait que le prolétariat cubain vive sous une tyrannie stalinienne qui se présente comme communiste, crée un environnement de confusion très compliqué pour le développement de sa conscience. Pendant plus de 60 ans du régime de Castro, les travailleurs ont vécu dans l'isolement, la tromperie, la répression et la faim, ce qui n'est pas un environnement qui leur permet de récupérer les expériences des luttes de leurs frères et sœurs de classe dans d'autres régions et de pouvoir exposer leur force en tant que classe. Pour cette raison, la situation politique des travailleurs cubains dans chaque révolte est souvent similaire.
Dans la révolte de 1994, connue sous le nom de "Maleconazo", le déclencheur était également la pénurie de nourriture, de médicaments et d'électricité, et de la même manière, les travailleurs ont été capturés dans l'illusion de la démocratie interne ou de la "liberté" attendue à Miami. Ni en 1994, ni aujourd'hui, il n'y a de possibilité de réflexion de masse des prolétaires dans les assemblées générales. Ce manque de réflexion en fait une proie facile pour les positions bourgeoises dominantes, dirigées depuis le gouvernement et le parti officiel ou depuis les différents "groupes d'opposition" intégrés à Cuba et aux États-Unis, qui ont rapidement conduit les expressions de mécontentement sur le terrain trompeur de la démocratie ou encore plus sur celui des disputes impérialistes, plaçant cette masse mécontente comme chair à canon pour les intérêts bourgeois.
La responsabilité du prolétariat des pays centraux du capitalisme
Lorsque nous insistons sur la vulnérabilité des travailleurs de Cuba aux poisons nationalistes et démocratiques, ce n'est pas pour minimiser leurs protestations ou pour décourager leur lutte pour leurs revendications ; au contraire, la dénonciation de ces poisons est indispensable pour armer la lutte prolétarienne à Cuba et dans le monde.
Il est vrai qu'une grave erreur de l'Internationale communiste, qui a pesé lourdement sur les luttes de la classe ouvrière au siècle dernier jusqu'à aujourd'hui, en particulier en Amérique latine, était la "théorie du maillon faible", qui place la plus grande possibilité de révolution prolétarienne dans les pays où le capitalisme est le plus faible. Notre article, "Le prolétariat d'Europe occidentale au centre de la généralisation de la lutte de classe" critique sans concession cette dangereuse vision erronée, en soulignant que "les révolutions sociales n'ont pas lieu là où l'ancienne classe dominante est la plus faible ou là où sa structure est la moins développée, mais au contraire, là où sa structure a atteint la plus grande maturité compatible avec les forces productives, et où la classe porteuse des nouveaux rapports sociaux et appelée à détruire les anciens, est la plus forte"(11). Alors que Lénine cherchait et insistait sur le point de plus grande faiblesse de la bourgeoisie, Marx et Engels cherchaient et insistaient sur les points où le prolétariat est le plus fort, le plus concentré et le plus capable d'apporter une transformation sociale.
Les travailleurs cubains sont confrontés à un État brutal, sans mécanismes syndicaux et démocratiques de mystification sociale, ne recourant qu'à une terreur permanente et grotesque, dans les pays du soi-disant "socialisme" (aujourd'hui réduits à la Chine, à Cuba, au Vietnam, à la Corée du Nord et au Venezuela), le poids de la contre-révolution sous la forme d'un régime politique totalitaire, sans doute rigide et fragile, pèse encore lourdement, mais précisément à cause de cela, le prolétariat a beaucoup plus de mal à surmonter les mystifications démocratiques, syndicales, nationalistes et même religieuses. Dans ces pays, des explosions ouvrières violentes se développeront, comme cela a été le cas jusqu'à présent, accompagnées chaque fois que nécessaire par l'émergence de forces destinées à les désorienter, comme cela a été le cas avec Solidarnosc(12), mais elles ne peuvent être le théâtre du développement de la conscience ouvrière la plus avancée. Ce sera la lutte de leurs frères et sœurs dans les pays centraux du capitalisme qui leur montrera que la démocratie, les syndicats "libres", etc. sont une vile tromperie qui renforce et rend l'exploitation plus oppressive. Ce sera la lutte de ces sections cruciales du prolétariat qui montrera que le problème de l'humanité n'est pas les magasins vides ou les files d'attente pour un kilo de riz - expressions caricaturales de la barbarie globale du capitalisme décadent - mais la SURPRODUCTION GÉNÉRALISÉE qui provoque la faim et la misère avec des supermarchés débordant de nourriture et des centres commerciaux saturés de marchandises invendables. C'est cette lutte qui donnera un sens et une direction aux efforts de résistance à l'exploitation, aux tentatives de conscientisation qui auront lieu dans ces pays. Comme nous l’affirmons dans l'article de la Revue internationale déjà citée(13) : "Cela ne signifie pas que la lutte des classes ou l'activité des révolutionnaires est dénuée de sens dans d'autres régions du monde. La classe ouvrière est une. La lutte des classes existe partout où prolétaires et capital s'affrontent. Les leçons des différentes manifestations de cette lutte, où qu'elles se produisent, sont valables pour l'ensemble de la classe. En particulier, l'expérience des luttes dans les pays de la périphérie influencera la lutte dans les pays centraux. La révolution sera également mondiale et touchera tous les pays. Les courants révolutionnaires de la classe seront précieux partout où le prolétariat affronte la bourgeoisie, c'est-à-dire dans le monde entier."
Revolucion Mundial, organe de presse du CCI au Mexique / 28 juillet 2021
[1] Quelques articles de référence qui développent nos arguments sur le caractère bourgeois du gouvernement cubain et la non-existence d'une révolution communiste ou socialiste à Cuba :
En français :
- "Bilan de 70 ans de luttes de "libération nationale" Partie II : Au 20e siècle, la "libération nationale", un maillon fort de la chaîne impérialiste" [297] , Revue internationale n°68, (1er trimestre 1992).
- "Che Guevara : mythe et réalité (à propos d'une correspondance)" [298], Révolution internationale n°384, (novembre 2007).
-"Mort de Fidel Castro: en 2017 la bourgeoisie perdait l’un des siens", Révolution internationale n°462, (janvier-février 2017).
En espagnol :
- "Comme dans tous les pays capitalistes, à Cuba, les travailleurs paient la crise" [299], Revolucion mundial n°120, (janvier-février 2011).
- Fidel Castro prend sa retraite... l'exploitation et la misère des travailleurs cubains continuent" [300], Revolucion mundial n°103, (mars-avril 2008).
[2] Lire notre article : "Face à l'aggravation de la crise économique mondiale et de la misère, les "révoltes populaires" représentent une impasse" [104], Revue internationale n°163, (2e trimestre 2019) :
[3] Voir notre article, "La réponse au racisme n’est pas l’antiracisme bourgeois, mais la lutte de classe internationale" [301], Révolution internationale n°483, (juillet-août 2020).
[4]Cuba a récemment commencé la production hâtive de deux vaccins "nationaux" (Abdala et Soberana 2), tout en rejetant le programme Covax. Non conformes aux normes internationales de vérification, leur efficacité ne peut être connue, d'autant plus que Cuba manque notairement de moyens de réfrigération pour les conserver et de seringues pour les injecter, bien que le gouvernement cubain ne cesse d'en faire un argument de propagande. Après les manifestations, l'ancien parrain russe a envoyé deux avions chargés de plus de 88 tonnes de nourriture, de matériel de protection médicale et d'un million de masques.
[5] Nous ne nous étendrons pas sur cette question pour le moment, mais signalons que, bien qu'il existe des mécanismes d'intimidation de la part du gouvernement étasunien pour empêcher les opérations commerciales avec le gouvernement cubain, il n’empêche que 6,6 % des importations totales de Cuba proviennent bien des États-Unis.
[6] Non seulement ces transports publics sont rares, mais ils ont augmenté de 500 %.
[7] Cette situation montre que la bourgeoisie du monde entier (y compris Cuba) applique partout une politique de recherche du profit, en démantelant les parties de son activité qui ne sont pas rentables, comme les services de santé. C'est pourquoi elle aggrave considérablement l'impuissance des États face à des problèmes comme ceux que l'on connaît actuellement avec la pandémie.
[8] Il faut savoir que Porto Rico, pays "associé" aux États-Unis, souffre également de coupures d'électricité systématiques pendant plusieurs heures, bien qu'il ait récemment privatisé cette activité, de même que dans de nombreuses régions du Mexique, par exemple. Ce qui montre sans aucun doute que l'inaptitude du système à couvrir les besoins de la population est un problème général du capitalisme. Cependant, le cas de Cuba se distingue car il est devenu un phénomène quotidien et ce durant une période prolongée.
[9] Il n’a été rapporté nulle part, à notre connaissance, l’existence d’assemblées ou d’autres formes de mobilisations ouvrières dans ces événements.
[10] Fidel Castro lui-même s'est présenté comme un continuateur de la pensée libérale de Martí et Chivás. Une fois Castro et sa clique installés dans la Sierra Maestra, il donne une interview au journaliste américain Robert Taber, qui lui demande : "Êtes-vous un communiste ou un marxiste ?" et la réponse est : "Il n'y a pas de communisme ou de marxisme dans nos idées. Notre philosophie politique est celle d’une démocratie représentative d’une justice sociale dans le cadre d'une économie planifiée...". (avril 1957). Il a répété la même réponse à plusieurs reprises lors de sa visite aux États-Unis en avril 1959. Ce n'est qu'en décembre 1961, sous la pression de l'invasion ratée promue par le gouvernement américain, que le régime de Cuba s’est autoproclamé "communiste", pour justifier un rapprochement de ses intérêts impérialistes avec le bloc opposé aux États-Unis.
[11] Lire "Le prolétariat d'Europe occidentale au centre de la généralisation de la lutte de classe" [152], Revue internationale n°31, 1er trimestre 1982
[12] Concernant la grève de masse des travailleurs en Pologne en 1980 et le sabotage effectué par le syndicat Solidarnosc, lire notamment les articles :
_ "Pologne (août 1980) : Il y a 40 ans, le prolétariat mondial refaisait l’expérience de la grève de masse" [151], Révolution internationale n°483, (juillet-août 2020).
_ "La grève de masse en Pologne 1980 : des leçons pour l'avenir" [302], ICCOnline, (juillet 2020).
[13] Cf. note 11.
Récent et en cours:
- Cuba [303]
Questions théoriques:
- Démocratie [166]
Rubrique:
L'internationalisme signifie le rejet des deux camps impérialistes
- 88 lectures
Le déclenchement d'une guerre impérialiste a toujours été un test pour ceux qui prétendent être du côté de la classe ouvrière mondiale contre le capitalisme. En 1914, il a clairement séparé ces "socialistes" et "anarchistes" qui se sont ralliés à la défense de leur propre classe dominante de ceux qui, même au prix de l'isolement et de la répression, ont maintenu fermement le principe selon lequel les ouvriers n'ont pas de patrie.
En même temps, si ces lignes de démarcation étaient très claires, il y avait aussi un "centre", un "marais" composé d'éléments qui, pour des raisons diverses, étaient incapables de prendre une position sans ambiguité pour ou contre la guerre, soit parce qu'ils utilisaient des phrases creuses sur la paix et la justice pour cacher leur propre dérive vers un accommodement avec le capitalisme, soit parce qu'ils faisaient des efforts sincères mais confus pour se diriger dans la direction opposée, c'est-à-dire vers le camp prolétarien.
Dans les réactions au conflit actuel en Israël/Palestine, nous pouvons observer des schémas similaires. Dans les principales villes d'Europe et des États-Unis, nous avons vu de nombreuses manifestations nous appelant à choisir un camp contre l'autre : principalement ceux brandissant des drapeaux palestiniens et soutenus par un ensemble de libéraux, de sociaux-démocrates, de trotskistes, d'islamistes et autres. Ces marches avaient pour fonction de canaliser l'indignation réelle provoquée par l'assaut brutal d'Israël contre Gaza au service d'un conflit impérialiste plus large. Les slogans "Palestine libre" et "Nous sommes tous le Hamas" non seulement déclarent leur soutien aux bandes nationalistes visant à établir un nouvel État capitaliste, mais coïncident également avec les objectifs impérialistes de l'Iran, du Qatar, de la Russie et de la Chine. En face d'eux se trouvaient des groupes plus restreints de sionistes purs et durs pour qui Israël ne peut rien faire de mal et qui, s'ils critiquent la politique américaine au Moyen-Orient, ne font qu'exiger un soutien américain encore plus flagrant à l'expansion impérialiste d'Israël. Dans les deux cas, il s'agit de mobilisations pro-guerre.
Mais il y a aussi ceux qui rejettent ces rassemblements au nom de l'internationalisme de la classe ouvrière. Par exemple, le site libcom.org offre un espace à ceux - principalement, mais pas seulement, des groupes ou des individus qui se qualifient d'"anarchistes de lutte de classe" - qui s'opposent au soutien aux luttes de libération nationale ou à la création de nouveaux États bourgeois.
Un examen du fil de discussion "Jérusalem et Gaza"(1) fournit un échantillon de l'éventail de groupes et d'opinions qui disent ne s'identifier à aucun des deux camps dans le conflit. Ou plutôt, il révèle que parmi ceux qui se réclament de la position internationaliste sur cette guerre et d'autres semblables, il y a de nouveau un "centre", un terrain marécageux dans lequel des positions prolétariennes se mêlent à des concessions à l'idéologie dominante, et donc à des justifications de la guerre impérialiste.
Aujourd'hui, la plupart des courants politiques qui composaient ce "centre" pendant la Première Guerre mondiale ont soit disparu, soit fait une paix définitive avec la bourgeoisie, beaucoup d'entre eux retournant dans les partis sociaux-démocrates qui, au début des années 1920, étaient clairement devenus des auxiliaires de l'État capitaliste. Dans les conditions actuelles, les divers groupes et tendances anarchistes sont les composants que l’on retouve les plus fréquemment dans la mouvance de ce marais : à une extrémité, ils fusionnent ouvertement avec l'aile gauche du capital, à l'autre, ils défendent des positions internationalistes bien définies. Cela a été clairement démontré dans la réaction des anarchistes à la guerre en Israël/Palestine.
D'une part, nous avons des organisations anarchistes qui ne se distinguent quasiment pas des trotskistes. L'article de notre section en France identifie l'Organisation Communiste Libertaire comme un exemple de ce type d'anarcho-gauchisme : « " Face au déchaînement de violence orchestré par un régime israélien en pleine crise politique, porté par un Netanyahou à bout de souffle et prêt à sacrifier les Palestiniens pour assurer sa pérennité au pouvoir, les condamnations timorées (ou pire, les déclarations renvoyant Israéliens et Palestiniens dos à dos) ne suffisent pas. Le droit international doit être appliqué". On ne saurait être plus clair ! »(2). Un exemple édifiant d'anarchistes faisant appel à la fiction bourgeoise du "droit international" !
Sur le fil de discussion de libcom, la déclaration d'un certain nombre de "groupes anarchistes communistes" d'Océanie adopte une position similaire. Tout en prétendant dénoncer le nationalisme, elle nous appelle à prendre parti pour une "résistance palestinienne" qui lui est en quelque sorte extérieure. "L'occupation israélienne est une forme nue d'oppression coloniale, et ses victimes palestiniennes ont tout à fait le droit d'y résister par tous les moyens qui sont en accord avec le but final de la libération. (...) Il n'y a pas de zone grise, il n'y a pas deux camps égaux en guerre. Les masses palestiniennes résistent à l'oppression."(3) À la fin du tract, un appel est lancé pour que les gens participent à une série de manifestations "Palestine libre" organisées dans toute l'Australie.
Aux États-Unis, la Workers Solidarity Alliance manie également un double langage. D'une part : "Nous soutenons une vision d’ouvriers, de paysans et d'opprimés juifs et palestiniens qui remettent en question et finissent par rompre avec les imaginaires et les idéologies suprématistes, nationalistes et militaristes, et qui s'unissent dans une lutte commune pour venir à bout du pouvoir, des privilèges et de la haine en établissant une entraide, une solidarité intercommunautaire et une autogestion collective". Et dans la phrase suivante, il est dit : "à l'extérieur, nous saluons les ouvriers américains qui soutiennent boycott, désinvestissement et sanctions contre Israël, et qui protestent publiquement contre la violence en cours en Palestine occupée". Les campagnes de boycott de tel ou tel État suivent la même logique que les "sanctions" imposées par un État à un autre pour avoir bafoué le "droit international" ou les "droits de l'homme".
Les choix effectués par les promoteurs de ces campagnes sont significatifs en soi. Par exemple, le régime syrien d'Assad, soutenu par la Russie, est directement responsable du plus horrible massacre de la population syrienne, mais vous ne trouverez jamais de gauchistes organisant des marches pour dénoncer ce carnage - certains groupes trotskistes considèrent même Assad comme une force anti-impérialiste. Israël, en revanche, est régulièrement défini par l'aile gauche du capital comme un État qui n'a pas le droit d'exister - comme si, du point de vue de la classe ouvrière, tout État capitaliste avait le droit "légitime" d'imposer son exploitation et son oppression.
En revanche, le fil de discussion contient également des déclarations de la CNT-FAI (avec celles de son affiliée britannique, la Solidarity Federation) et de son affiliée russe, le KRAS, qui évitent cet appel à prendre parti dans le conflit et défendent les bases d'une réponse internationaliste. Le KRAS (dont nous avions déjà publié les déclarations contre la guerre dans le Caucase) affirme que les problèmes en Israël/Palestine "sont générés par les intérêts des dirigeants et des capitalistes de tous bords pour le pouvoir et la propriété ; ces problèmes ne peuvent être éliminés qu’en éliminant les responsables – éliminés par une lutte commune et, finalement, par la révolution sociale conjointe des travailleurs juifs et arabes, des Palestiniens et des Israéliens ordinaires.
Le chemin vers cette décision est difficile et long. Trop de désespoir, trop fraîche l’odeur du sang versé, l’esprit des gens ordinaires est trop empoisonné par les nationalismes israélien (sioniste) et arabe, les émotions font trop rage aujourd’hui. Mais il n’existe pas d’autre voie vers la paix dans cette région qui souffre depuis longtemps, et il ne peut y en avoir. […]
NON A LA GUERRE !
NON AU NATIONALISME, AU MILITARISME ET AU FANATISME RELIGIEUX DE TOUS LES CÔTÉS !
NI ISRAËL, NI PALESTINE, MAIS UNE LUTTE DE CLASSE COMMUNE DES TRAVAILLEURS DANS LA RÉGION !"
La déclaration de l’Anarchist Communist Group au Royaume-Uni est également relativement claire sur le rejet des solutions nationales :
"Parce qu'une solution au conflit ne peut finalement être qu'une société commune, sans classe et sans État, dans laquelle des personnes de différentes origines religieuses (et non religieuses) et ethniques peuvent coexister pacifiquement. Et le moyen d'y parvenir ne peut être que la lutte de classe, avec les ouvriers s'unissant des deux côtés pour améliorer leur situation et surmonter ainsi de vieux ressentiments. C'est la tâche du mouvement anarchiste et communiste libertaire de faire pression en ce sens"(4).
L'idée de la "résistance" palestinienne : une fenêtre ouverte sur la trahison de l'internationalisme
Il se trouve que le fil de discussion libcom n'a pas été lancé par un anarchiste, mais par un membre du Socialist Party of Great Britain (SPGB). Ce groupe, un survivant semi-fossilisé de l'époque où la Deuxième Internationale était une organisation prolétarienne, maintient ses profondes illusions dans une "voie parlementaire" vers le socialisme, mais il n'a jamais soutenu les guerres capitalistes ou les luttes nationalistes. L'auteur du message originel, ajjohnstone, renvoie au blog officiel du SPGB qui fait une critique éloquente non seulement du sionisme mais aussi du nationalisme palestinien : "Il est facile de voir pourquoi les pauvres dans les camps de réfugiés palestiniens pourraient considérer la promesse d'un gouvernement autonome palestinien comme une réponse. Malheureusement, comme les sionistes, les Palestiniens ont succombé à un dangereux mythe du passé ; dans leur cas, le mythe selon lequel la Palestine leur appartenait. Ce n'était pas le cas : la plupart des Palestiniens se débattaient sur de minuscules parcelles de terre, sous le poids de dettes massives, exploités par une classe de propriétaires terriens. La Palestine n'appartenait pas aux Palestiniens, pas plus que l'Israël moderne n'appartient aux Israéliens de la classe ouvrière. En 1930, la famille rurale moyenne en Palestine était endettée à hauteur de 27 livres sterling, ce qui représentait approximativement le revenu annuel de cette famille. Selon les chiffres de 1936, un cinquième d’un pour cent de la population (soit 0,2%) possédait un quart des terres ! Il est clair que la Palestine préisraélienne n'appartenait pas aux paysans palestiniens : en 1948, ils ont été chassés de terres qui n'étaient pas les leurs.
Ils ne le réalisent pas encore, mais les ouvriers de la région - indépendamment des frontières nationales où ils vivent aujourd'hui - ont une identité d'intérêt. Espérons qu'ils parviendront à reconnaître leurs intérêts communs et à rejeter le nationalisme et le fanatisme religieux qui engendrent de fausses divisions, la violence et la haine raciale. En ce qui concerne la ferveur nationaliste et religieuse, il n'y a rien à quoi nous puissions nous identifier en tant que socialistes, car les deux sont des abstractions qui ont imprégné les ouvriers de la région d'une fausse conscience qui les empêche d'identifier leurs véritables intérêts de classe"(5).
En même temps, les messages de ce camarade sur le fil de discussion de libcom, après avoir chassé le nationalisme palestinien par la porte, semblent le laisser revenir par la fenêtre à travers l'idée que les manifestations et les émeutes des Palestiniens à l'intérieur d'Israël pendant le conflit constituent un mouvement de "résistance" qui offre un signe d'espoir pour l'avenir. Le camarade parle de "l'évolution significative des Palestiniens-Israéliens qui participent désormais plus pleinement à la résistance. Après tout, ce sont les lois de type apartheid appliquées à Cheikh Jarrah et les attaques contre la mosquée principale qui ont déclenché l'agitation actuelle... Si ce mouvement palestino-israélien contre la discrimination se développe et commence à exercer un pouvoir politique en dehors de la Knesset, je ne peux que le considérer comme une tournure positive des événements pour saper l'influence de l'idéologie sioniste dominante"(6). Il est vrai que de nombreux jeunes Palestiniens sont descendus dans la rue en réaction aux tentatives d'expulsion de familles arabes à Jérusalem-Est, ou aux pogroms de l'extrême droite sioniste, mais étant donné l'absence totale de réponse prolétarienne à la guerre en Israël/Palestine, étant donné la longue histoire des divisions nationalistes attisées par une guerre presque continue, ces mobilisations n'ont fait que renforcer les affrontements ethniques et l'atmosphère de pogrom en Israël, et se sont ouvertement alignées sur la réponse militaire du Hamas depuis la bande de Gaza. Elles n'offrent en aucun cas la base d'une future unification des ouvriers arabes et juifs contre leurs exploiteurs.
Cette fenêtre dangereuse a également été ouverte par un groupe comme l'ACG (Anarchist Communist Group), dont nous avons critiqué les confusions sur la "légitimité" de l'État sioniste dans un article précédent(7). Dans ce cas, l'ACG voit quelque chose de positif dans le fait que les manifestations et la "grève générale" palestiniennes ont été organisées par des comités de base dans les quartiers plutôt que par les organisations palestiniennes traditionnelles : "Les masses palestiniennes doivent être auto-organisées et échapper au contrôle du Hamas ou des factions de l'OLP - dans une certaine mesure, c'est déjà le cas..." L'ACG cite ensuite le + 972 Magazine : "Une caractéristique extraordinaire des manifestations est qu'elles sont principalement organisées non pas par des partis ou des personnalités politiques, mais par de jeunes activistes palestiniens, des comités de quartier et des collectifs de base."
Cela ravive les souvenirs de la réaction anarchiste dominante pendant la guerre d’Espagne dans les années 1930, lorsque les anarchistes ont considéré que, parce que les industries et les exploitations agricoles étaient "autogérées" par les ouvriers, il y avait bien là une révolution en cours, alors que la réalité était que ces structures étaient entièrement intégrées dans l'effort de guerre "antifasciste" - un conflit impérialiste des deux côtés qui a préparé le terrain pour la guerre de 1939-45.
Contrairement à ces attitudes ambiguës, les positions des groupes de la Gauche communiste vers lesquelles pointent des liens dans le fil de discussion - le CCI(8) et la TCI(9) - sont sans équivoque. Alors que peu de groupes anarchistes ont une vision claire de la notion d'impérialisme, les deux organisations de la Gauche communiste dénoncent les manœuvres impérialistes dans la région ainsi que les machines de guerre d'Israël et du Hamas, qui ne peuvent que servir leurs propres objectifs impérialistes ou ceux d’autres. La déclaration de la TCI commence par le slogan "ni Israël, ni Palestine" et reconnaît, comme l'article du CCI, que l'atmosphère de pogrom existe des deux côtés, dans chaque camp : "La solution du gouvernement israélien consiste à laisser des groupes fascistes comme "La Familia" se déchaîner dans les quartiers arabes de villes comme Lod en criant "Mort aux Arabes". […] La jeunesse arabe a riposté et attaqué des cibles juives. Ils reprennent l'appel des fascistes en criant "Mort aux Juifs", un appel qui a valu à la presse israélienne d'utiliser l'accusation chargée d'émotion de "pogrom". Mais il y a maintenant des pogroms des deux côtés de la "violence communautaire"."
Il y a aussi une déclaration des Angry Workers of the World (AWW), un groupe "ouvriériste" ou "autonomiste" qui est assez clair dans sa position internationaliste et qui réfute lucidement toute illusion sur les mobilisations dans les quartiers palestiniens, et la grève générale en particulier :
"La grève générale du 18 mai… a été encensée par les gauchistes du monde entier qui n'avaient pas examiné son contenu réel. La simple expression "grève générale" suffisait, pour eux, à démontrer qu'une véritable action de la classe ouvrière avait eu lieu. Mais la grève elle-même était appelée "d'en haut" et interclassiste jusqu'à la moelle. Bien que des masses d’ouvriers aient fait grève (seuls 150 des 65 000 travailleurs de la construction se sont présentés, 5 000 travailleurs du nettoyage et 10 % des chauffeurs de bus étaient absents, etc.) elle a aussi été largement embrassée par les représentants de la classe moyenne. Elle a d'abord été appelée par le Higher Monitoring Committee, le représentant de facto de la classe moyenne arabe en Israël, et a été reprise avec enthousiasme par le Fatah et le Hamas, qui ont ordonné à leurs propres travailleurs du secteur public de s'y joindre. Ces partis n'étaient pas intéressés par la construction du pouvoir de la classe ouvrière, en fait ils s'y sont toujours activement opposés. Le grand succès de la grève, de l'avis de tous ses dirigeants et de tous les journalistes, a été la démonstration de l'unité du "peuple palestinien", mais elle avait aussi pour objectif plus profond de lier plus étroitement la classe ouvrière aux institutions bourgeoises qui la dirigent"(10).
Il est noté sur le fil de discussion que les déclarations de la TCI et des AWW semblent avoir suscité beaucoup d’injures et de haine en ligne. Mais les internationalistes ne dénoncent pas les guerres capitalistes pour être populaires. Tant en 1914-18 qu'en 1939-45, la minorité internationaliste qui est restée ferme sur ses principes a dû faire face à la répression de l'État et à la persécution des voyous nationalistes. La défense de l'internationalisme ne se juge pas d’après ses résultats immédiats mais par sa capacité à fournir une orientation qui puisse être reprise à l'avenir par des mouvements qui constituent réellement une résistance prolétarienne à la guerre capitaliste. Ainsi, ceux qui se sont opposés à la sombre vague de chauvinisme en 1914, comme les bolcheviks et les spartakistes, ont préparé le terrain pour les soulèvements révolutionnaires de la classe ouvrière de 1917-18.
Amos, 30 juin 2021
[2] “Contre le poison nationaliste, solidarité internationale de tous les travailleurs ! [305] ” , Révolution internationale n° 489, juillet - août 2021.
[3] "Freedom for Palestine!" Statement from Anarchist-Communist Groups in Oceania – Red and Black Notes (redblacknotes.com)
[6] Posts 4 et 7 sur le fil de discussion de libcom.
[7] L'ACG rejette les politiques identitaires mais “accepte” un État d’Israël démocratique et laïque [308], ICConline, octobre 2020.
[8] Conflit israélo-palestinien : les guerres et les pogroms sont l’avenir que nous réserve le capitalisme [265], ICConline, mai 2021.
Vie du CCI:
- Polémique [246]
Géographique:
Questions théoriques:
- Internationalisme [311]
Rubrique:
ICCOnline - septembre 2021
- 46 lectures
Permanence en ligne du 18 septembre 2021
- 42 lectures
Révolution Internationale, section en France du Courant Communiste International, organise une permanence en ligne le samedi 18 septembre à partir de 14h.
Ces permanences sont des lieux de débat ouverts à tous ceux qui souhaitent rencontrer et discuter avec le CCI. Nous invitons vivement tous nos lecteurs, contacts et sympathisants à venir y débattre afin de poursuivre la réflexion sur les enjeux de la situation et confronter les points de vue.
Les lecteurs qui souhaitent participer aux permanences en ligne peuvent adresser un message sur notre adresse électronique ([email protected] [213]) ou dans la rubrique “contact [214]” de notre site internet, en signalant quelles questions ils voudraient aborder, afin de nous permettre d’organiser au mieux les débats. Les modalités techniques pour se connecter à la permanence seront communiquées par retour de courriel.
Vie du CCI:
- Permanences [291]
Rubrique:
Polarisation des tensions et instabilité des alliances
- 105 lectures
Polarisation des tensions en mer de Chine
L’administration Biden maintient non seulement les mesures agressives économiques contre la Chine, mises en œuvre par Trump, mais elle a surtout accentué la pression sur le plan politique (défense des droits des Ouïghours et de Hong Kong, rapprochement avec Taïwan avec qui elle négocie pour le moment un accord commercial, accusations de piratage informatique) et également au niveau militaire en mer de Chine, et ceci de façon assez spectaculaire depuis début avril :
- le 7 avril, les États-Unis déployaient un groupe de porte-avions (l’USS Theodore Roosevelt, accompagné de sa flottille) dans la mer de Chine du Sud et le destroyer lance-missiles USS John S. McCain a transité par le détroit de Taïwan (situé entre la Chine et Taïwan) ;
- le 11 mai, Des navires américains, français (le porte-hélicoptères amphibie (PHA) Tonnerre et la frégate Surcouf), japonais et australiens ont commencé des exercices militaires conjoints (ARC21) en mer de Chine orientale, les premiers du genre dans cette zone stratégique, non loin des Senkaku, îlots inhabités, administrés par le Japon en mer de Chine orientale, revendiqués par Pékin, qui les appelle Diaoyu. Avant ces exercices-là, les bâtiments français avaient participé aux exercices La Pérouse dans le golfe du Bengale avec des navires américains, australiens, indiens japonais. Ensuite, le Tonnerre est passé au sud de Taïwan pour rejoindre le Japon, tandis que le Surcouf optait aussi pour le détroit de Taïwan ;
- La présence française au Japon doit être suivie, en 2021, de celle de la frégate allemande Hessen, Berlin exprimant en 2020 son souhait d’être plus présent dans l’Indo-Pacifique, et l’archipel accueillera en 2022 le groupe aéronaval britannique Queen Elizabeth.
- En septembre, les États-Unis, la Grande-Bretagne et l'Australie ont annoncé un nouvel accord de défense, connu sous le nom d'"Aukus", qui vise à étendre la présence militaire de ces pays dans les mers entourant la Chine. Les trois pays partageront des renseignements militaires et des connaissances technologiques qui permettront à l'Australie de construire des sous-marins à propulsion nucléaire. Le pacte Aukus constitue une gifle pour la France, l'Australie annulant le contrat du siècle contrat de plus de 50 milliard[1] d’euros avec la France pour la construction d'une flotte de sous-marins. Réagissant avec fureur, la France a rappelé ses ambassadeurs des États-Unis et d'Australie. La Chine a dénoncé le pacte comme le début d'une nouvelle guerre froide, même si elle se réjouit sans doute de ces nouvelles divisions entre ses rivaux occidentaux[2].
La Chine pour sa part a réagi furieusement à ces pressions politiques et militaires, particulièrement celles qui concernent Taïwan :
- début avril, face à la présence de la flotte US, le porte-avions Liaoning accompagné de 5 navires de guerre a opéré dans les eaux à l’est de "l’île rebelle". Des chasseurs taïwanais ont dû décoller en catastrophe pour repousser l’entrée de quinze avions chinois dans la zone d’identification de la défense aérienne de Taiwan ;
- le 19 mai, un think tank basé à Hong Kong et affilié au Parti communiste chinois a rendu publique une étude soulignant que les tensions dans le détroit de Taïwan étaient devenues si fortes qu’elles indiquent un risque de guerre "qui n’a jamais été aussi élevé" entre la Chine continentale et Taïwan.
- le 15 juin, en réponse à la réunion de l’OTAN marquant une certaine concordance entre les États-Unis et l’Union européenne sur le dossier chinois, vingt-huit avions de combat chinois sont entrés dans la Zone d’identification de défense aérienne de l’ancienne Formose, soit la plus grande incursion de chasseurs et de bombardiers de l’Armée populaire de libération jamais enregistrée ;
- début juillet, le magazine chinois Naval and Merchant Ships a diffusé un projet d’attaque surprise contre Taïwan en trois étapes, qui conduirait à une défaite totale des forces armées de la "province rebelle".
Fin août, le rapport annuel du ministère taïwanais de la Défense alertait que la Chine "peut maintenant combiner des opérations numériques de son armée qui auraient pour conséquences, dans un premier temps, de paralyser nos défenses aériennes, les centres de commandement en mer et nos capacités de contre-attaquer, ce qui constitue une menace gigantesque pour nous" (P.-A. Donnet, La Chine en mesure de paralyser la défense taïwanaise, selon Taipei, Asialyst, 02.09.21).
Mises en garde, menaces et intimidations se sont donc succédé ces derniers mois en mer de Chine. Elles soulignent la pression croissante exercée par les USA sur la Chine. Dans ce contexte, les États-Unis font tout pour entraîner derrière eux d’autres pays asiatiques, inquiets des velléités expansionnistes de Pékin ("L’exercice ARC21 est un moyen de dissuasion face au comportement de plus en plus agressif de la Chine dans la région", juge Takashi Kawakami, directeur de l’Institut d’études internationales de l’université Takushoku (Japon), cité le 14 mai par le quotidien Les Echos). Les USA tentent ainsi de créer une sorte d’ OTAN asiatique, le QUAD, réunissant les États-Unis, le Japon, l’Australie et l’Inde. D’autre part et dans le même sens, Biden veut raviver l’OTAN dans le but d’entraîner les pays européens dans sa politique de pression contre la Chine.
Pour compléter le tableau, les tensions entre l’OTAN et la Russie ne doivent pas être négligées non plus : après l’incident du vol Ryanair détourné et intercepté par le Belarus pour arrêter un dissident, réfugié en Lituanie, il y a eu en juin les manœuvres de l’OTAN en Mer Noire au large de l’Ukraine, où un accrochage s’est produit entre une frégate anglaise et des navires russes, et, en septembre, des manœuvres conjointes entre armées russe et biélorusse aux frontières de la Pologne et des Pays Baltes.
Ces événements confirment que la montée des tensions impérialistes génère une certaine polarisation entre les USA et la Chine d’un côté et entre l’OTAN et la Russie de l’autre, ce qui pousse par contrecoup la Chine et la Russie à renforcer leurs liens réciproques afin de faire face aux USA et l’OTAN.
La décomposition engendre l’instabilité
Cependant, la "débâcle de Kaboul" (cf. notre article "Derrière le déclin des États-Unis, le déclin du monde capitaliste [312]" sur notre site) souligne combien la décomposition et la déstabilisation persistante accélérée par la crise du Covid-19 stimulent les forces centrifuges, exacerbent le "chacun pour soi" des divers impérialismes, contrecarrant ainsi constamment toute stabilisation des alliances :- Le retrait US précipité d’Afghanistan, conçu pour concentrer les forces militaires face à la Chine, s’est fait sans concertation des alliés, alors que Biden avait promis quelques mois auparavant au sommet du G7 et à la réunion de l’OTAN le retour de la concertation et de la coordination ; ce retrait signifie de fait aussi l’abandon par les USA de leurs alliés sur place (cf. déjà auparavant le lâchage des Kurdes et le refroidissement des relations avec l'Arabie saoudite) et ne peut que renforcer la méfiance de pays comme l’Inde ou la Corée du Sud face à un allié qui se montre peu fiable, ainsi que la détermination européenne de créer des structures de défense plus indépendantes des USA.
- D’autre part, le retour au pouvoir des Talibans constitue un danger potentiel sérieux pour les infiltrations islamistes en Chine (via le "problème Ouïghours"), surtout que leurs alliés, les Talibans pakistanais (les TTP) sont engagés dans une campagne d’attentats contre les chantiers de la "nouvelle route de la soie", ayant déjà entraîné la mort d’une dizaine de "coopérants" chinois. Cela incite la Chine à intensifier ses tentatives de s’implanter dans les anciennes républiques soviétiques d’Asie centrale (Turkménistan, Tadjikistan et Ouzbékistan) pour contrer le danger. Mais ces républiques font traditionnellement partie de la zone d’influence russe, ce qui augmente le danger de confrontation avec cet "allié stratégique", avec lequel de toute façon ses intérêts à long terme l’opposent fondamentalement : la nouvelle route de la soie contourne la Russie et cette dernière se méfie de l’emprise économique croissante de la Chine sur ses territoires sibériens ;
- Le chaos et le chacun pour soi impérialiste dans le monde accentuent constamment l’imprédictibilité du positionnement des divers États : les USA se voient obligés de maintenir la pression par des bombardements aériens réguliers sur des milices chiites qui harcellent leurs forces en Irak ; les Russes doivent "jouer aux pompiers" dans la confrontation armée entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan, instillée par le chacun pour soi impérialiste de la Turquie ; l’extension du chaos dans la Corne de l’Afrique à travers la guerre civile en Éthiopie, avec l’implication du Soudan et de l’Égypte qui soutiennent la région du Tigray et l’Érythrée le gouvernement central éthiopien, bouleverse en particulier les plans chinois qui faisaient de l’Éthiopie un point d’appui pour leur "Belt and Road project" en Afrique du Nord-Est et avaient dans ce but installé une base militaire à Djibouti.
- L’expansion incontrôlée de la pandémie liée à la généralisation du variant delta demande une attention plus grande des États pour la situation intérieure qui peut avoir un impact imprédictible sur leur politique impérialiste. Ainsi, la stagnation de la vaccination aux USA, après un départ initial en force, provoque une nouvelle vague de contamination dans les États du centre et du sud. Ceci engendre de nouvelles mesures coercitives de l’administration Biden qui ravivent à leur tour les récriminations des partisans de Trump. De même en Russie, le gouvernement est confronté avec une recrudescence de l’épidémie, alors que la vaccination piétine et que la population est extrêmement méfiante envers les vaccins russes, ce qui a amené le maire de Moscou (où 15% de la population est vaccinée) à prendre des mesures rendant la vaccination quasi obligatoire.
En Chine, où le gouvernement mise sur l’immunité collective avant d’ouvrir le pays, la situation sanitaire préoccupante demande une attention constante. D’une part, en attendant d’atteindre celle-ci, la Chine impose des lock-down stricts chaque fois que des infections sont identifiées, ce qui entrave lourdement les activités commerciales. Ainsi, en mai dernier, après l’infection de quelques dockers du port de Yantian, le troisième port de conteneurs du Monde avait été totalement isolé pendant une semaine, les travailleurs étant forcés de passer la quarantaine sur place. Aujourd’hui à nouveau, des régions entières sont confinées à cause de l’expansion du variant delta, l’éruption la plus forte depuis Wuhan en décembre 2019. Ensuite, cette recherche de l’immunité collective a poussé un certain nombre de provinces et de villes chinoises à imposer de lourdes sanctions aux récalcitrants. Ces initiatives ont soulevé de nombreuses critiques sur les réseaux sociaux chinois de sorte qu’elles ont été stoppées par le gouvernement, car elles tendaient à "mettre en péril la cohésion nationale". Enfin, le problème le plus grave est sans doute les données de plus en plus convergentes sur l’efficacité limitée des vaccins chinois.
Dans un tel contexte, la montée des tensions guerrières est inéluctable. D’un côté, elle indique une certaine polarisation, surtout entre les USA et la Chine, soulignée par une agressivité croissante des USA, qui savent que, malgré les investissements énormes de la Chine pour la modernisation de ses forces armées, ces dernières ne peuvent encore rivaliser avec la puissance militaire des États-Unis, en particulier dans les airs, les mers et au niveau de l’arsenal nucléaire.
Cependant, le chaos et le chacun pour soi exacerbé rendent constamment toute alliance instable, stimulent les appétits impérialistes tous azimuts et poussent plutôt les puissances majeures à éviter une confrontation directe entre leurs armées, avec engagement massif de militaires sur le terrain ("boots on the ground"), comme l’illustre le retrait des soldats US d’Afghanistan. Elles ont plutôt recours à des sociétés militaires privées (organisation Wagner par les Russes, Blackwater/Academi par les USA, …) ou encore à des milices locales pour mener des actions sur le terrain : utilisation des milices sunnites syriennes par la Turquie en Lybie et en Azerbaïdjan, des milices kurdes par les USA en Syrie et Irak, du Hezbollah ou de milices chiites irakiennes par l’Iran en Syrie, de milices soudanaises par l’Arabie Saoudite au Yémen, ….
Dès lors, la forme que prend l’expansion de ces tensions annonce une multiplication de confrontations guerrières toujours plus sanglantes et barbares dans un environnement marqué par instabilité et le chaos.
18.09.21/ R. Havanais
[1] https://www.rfi.fr/fr/asie-pacifique/20210917-australie-apr%C3%A8s-la-rupture-du-contrat-du-si%C3%A8cle-avec-la-france-la-question-du-co%C3%BBt-de-ce-revirement [313]
[2] Nous analyserons la signification et les implications de ce nouveau pacte dans un prochain article.
Rubrique:
Les fruits amers de la "guerre contre le terrorisme"
- 70 lectures
À l'occasion du 20e « anniversaire » des attentats du 11 septembre à New York, nous attirons l'attention de nos lecteurs sur notre article principal de la Revue internationale n° 107 : « A New York comme ailleurs: le capitalisme sème la mort ». L'article dénonce le massacre de milliers de civils, en majorité des prolétaires, comme un acte de guerre impérialiste, mais expose en même temps les larmes hypocrites versées par la classe dirigeante. Comme le dit l'article, « l'attaque de New York n'était pas une “attaque contre la civilisation”, elle était l'expression de la “civilisation” bourgeoise ». Les terroristes qui ont détruit les tours jumelles sont de petits assassins insignifiants si l'on compare leur action au nombre gigantesque de morts que tous les États légalement reconnus ont infligé à la planète depuis une centaine d'années, au cours de deux Guerres mondiales et d'innombrables conflits locaux et régionaux depuis 1945.
En ce sens, le 11 septembre était dans la continuité des bombardements de Guernica, Coventry, Dresde, Hiroshima et Nagasaki dans les années 1930 et 1940, du Vietnam et du Cambodge dans les années 1960 et 1970. Mais c'était aussi un signe clair que le capitalisme décadent était entré dans une nouvelle phase terminale, la véritable « dislocation intérieure » prédite par l'Internationale communiste en 1919. L'ouverture de cette nouvelle phase a été marquée par l'effondrement du bloc impérialiste russe en 1989 et la fragmentation du bloc américain qui en a résulté, et a vu l'inévitable tendance du capitalisme à la guerre prendre des formes nouvelles et chaotiques. Le fait que l'attaque ait été menée par Al-Qaida, une faction islamiste qui avait été amplement soutenue par les États-Unis dans leurs efforts pour mettre fin à l'occupation russe de l'Afghanistan, mais qui s'est retournée pour mordre la main qui l'a nourrie, en est un symbole particulier (même l'implication d'Al-Qaida était plus sujette à caution au moment où l'article a été écrit). Le « nouvel ordre mondial » proclamé par George Bush père, après la chute de l'URSS, s'est rapidement révélé être un monde de plus en plus désordonné, où les anciens alliés et subordonnés des États-Unis, des États développés d'Europe aux puissances de second et troisième rangs comme l'Iran et la Turquie, en passant par les petits seigneurs de la guerre comme Ben Laden, étaient de plus en plus déterminés à poursuivre leurs propres objectifs impérialistes.
L'article montre ainsi comment les États-Unis ont pu instrumentaliser les attentats, non seulement pour attiser le nationalisme à l'intérieur du pays (accompagné, comme il est vite devenu évident, d'un renforcement brutal de la surveillance et de la répression étatiques, incarnées par le Patriot Act adopté dès le 26 octobre 2001), mais aussi pour lancer leur attaque contre l'Afghanistan, dont les premiers pas étaient déjà constatés au moment de la rédaction de cet article (3 octobre 2001). Bien entendu, l'Afghanistan occupe depuis longtemps une place stratégique sur l'échiquier impérialiste mondial, et les États-Unis avaient des raisons spécifiques de vouloir renverser le régime des talibans, qui entretenait des liens étroits avec Al-Qaïda. Mais l'objectif global de l'invasion américaine (suivie deux ans plus tard par l'invasion de l'Irak et le renversement de Saddam Hussein) était de se diriger vers ce que les « néo-conservateurs » du gouvernement de Bush Junior appelaient la « Full Spectrum Dominance ». En d'autres termes, il s'agissait de s'assurer que les États-Unis restent la seule « superpuissance » en mettant un terme au chaos croissant dans les relations impérialistes et en empêchant l'émergence de tout concurrent sérieux au niveau mondial. La « guerre contre le terrorisme » devait être le prétexte idéologique de cette offensive.
20 ans plus tard, nous pouvons constater que le plan n'a pas très bien fonctionné. Les dernières troupes américaines ont dû quitter l'Afghanistan et sont en passe de quitter l'Irak. Les talibans sont de nouveau au pouvoir. Loin d'endiguer la marée du chaos impérialiste, les invasions américaines en sont devenues un facteur d'accélération. En Afghanistan, la victoire précoce contre les talibans a tourné court, car les islamistes se sont regroupés et, avec l'aide d'autres États impérialistes, ont fait en sorte que l'Afghanistan reste dans un état permanent de guerre civile, caractérisé par des atrocités sanglantes des deux côtés. En Irak, le démantèlement du régime de Saddam a conduit à la fois à la montée de l'État islamique et au renforcement des ambitions iraniennes dans la région, alimentant les guerres apparemment sans fin en Syrie et au Yémen. L'avancée de la décomposition à l’échelle planétaire a été le terreau du retour en force de l'impérialisme russe, et surtout de la montée en puissance de la Chine comme principal rival impérialiste des États-Unis. Les différentes stratégies visant à « rendre à nouveau sa grandeur à l'Amérique » (« Make America great again »), des « néo-cons » de Bush au populisme de Trump, n'ont pas été en mesure d'inverser le déclin inexorable de la puissance américaine, et Biden, bien qu'il ait affirmé que « l'Amérique est de retour », a maintenant dû présider à la plus grande humiliation de l'Amérique depuis le 11 septembre.
En analysant la manière dont les États-Unis ont cherché à « tirer profit du crime » du 11 septembre, l'article montre les similitudes entre le 11 septembre et le bombardement japonais de Pearl Harbour, qui a également été utilisé par l'État américain pour mobiliser la population, y compris les sections réticentes de la classe dirigeante, en faveur de l'entrée des États-Unis dans la Seconde Guerre mondiale. Il cite des preuves bien documentées que l'État américain a « permis » à l'armée japonaise de lancer l'attaque, et avance provisoirement l'hypothèse que l'État américain, à un certain niveau, a eu la même politique de « laissez-faire » dans la période qui a précédé l'action d'Al-Qaida, même s'il n'était peut-être pas pleinement conscient de l'ampleur de la destruction que cela entraînerait. Cette comparaison est développée dans l'article publié dans la Revue internationale n° 108 : « Pearl Harbour 1941, Twin Towers 2001 : le machiavélisme de la bourgeoisie américaine ». Nous reviendrons sur cette question dans un autre article, où nous discuterons de la différence entre la reconnaissance marxiste de la bourgeoisie comme la classe la plus machiavélique de l'histoire (naturellement rejetée par la bourgeoisie elle-même comme une forme de « théorie du complot ») et la pléthore actuelle de « théories du complot » populistes qui prennent souvent comme article de foi l'idée que le 11 septembre était un « travail de l'intérieur ».
WR, section du CCI au Royaume-Uni (11 septembre 2021)
– « À New York comme ailleurs: le capitalisme sème la mort [314] », Revue internationale n° 107 (4e trimestre 2001).
– « Pearl Harbor 1941, Twin Towers 2001 : Le machiavélisme de la bourgeoisie [315] », Revue internationale n° 108 (1er trimestre 2002).
Récent et en cours:
- 11 septembre 2001 [316]
Rubrique:
Nouvelles “marches pour le climat”: Le capitalisme détruit la planète!
- 112 lectures
Depuis plusieurs mois, les catastrophes climatiques s’enchaînent à un rythme effréné aux quatre coins de la planète : sécheresses, gigantesques incendies, pluies diluviennes, coulées de boue, inondations… Alors que les victimes de la crise environnementale se comptent en millions chaque année et que même les États les plus puissants s’avèrent toujours plus incapables de faire face aux catastrophes, le dernier rapport du GIEC est venu confirmer que le dérèglement climatique atteindra dans la prochaine décennie des proportions hors de contrôle.
Dans notre presse, nous avons régulièrement mis en avant que les racines du réchauffement climatique sont à chercher dans le fonctionnement même du capitalisme. Non seulement, les catastrophes climatiques sont de plus en plus dévastatrices, nombreuses et incontrôlables, mais les États, sous le poids de décennies de coupes budgétaires, sont de plus en plus désorganisés et défaillants dans la protection des populations, comme nous avons pu le voir récemment en par exemple en Allemagne, aux États-Unis ou en Chine. La bourgeoisie ne peut plus nier l’ampleur de la catastrophe, mais elle ne cesse, particulièrement à travers ses partis écologistes, d’expliquer que les gouvernements devraient enfin prendre des mesures vigoureuses en faveur de l’environnement. Toutes les factions de la bourgeoisie ont leur petite solution : green economy, décroissance, production locale, etc. Toutes ces prétendues solutions ont un point commun : le capitalisme pourrait être « réformé ». Mais la course au profit, le pillage des ressources naturelles, la surproduction délirante de marchandises ne sont pas des « options » pour le capitalisme, ce sont les conditions sine qua non de son existence !
Face à la catastrophe annoncée, l’indignation et l’inquiétude sont immenses, comme l’ont démontré les « marches pour le climat » de 2019 rassemblant des millions de jeunes de nombreux pays. À l’époque, nous mettions toutefois en avant que ces marches se déroulaient sur un terrain totalement bourgeois : les « citoyens » étaient, en effet, appelés à faire « pression » sur l’État bourgeois, cette machine monstrueuse dont la raison d’être est la défendre des intérêts capitalistes à l’origine de la détérioration sans précédent de l’environnement. En réalité, le problème du climat ne peut se résoudre qu’à l’échelle mondiale et le capitalisme, où s’affrontent impitoyablement les nations, est incapable d’apporter une réponse à la hauteur des enjeux : les grandes conférences environnementales, où chaque État cherchent cyniquement à protéger ses sordides intérêts sous couvert de défense de l’environnement en sont des illustrations criantes. La seule classe qui puisse affirmer un véritable internationalisme et mettre fin à l’anarchie de la production, c’est la classe ouvrière et la société contenue dans ses propres entrailles : le communisme !
Après un été 2021 annonciateur de futures catastrophes, les partis écologistes et de la gauche du capital (trotskistes, stalinien, anarchistes, sociaux démocrates, etc) vont tenter de remettre les marches pour le climat sur le devant de la scène. Il s’agit d’une nouvelle tentative de la bourgeoisie pour canaliser la colère vers les mêmes impasses politiques : la dilution de la classe ouvrière dans le « peuple », les illusions sur la capacité de l’État « démocratique » à « changer les choses ». C’est pourquoi nous invitons nos lecteurs à lire ou à relire le tract international que nous avions distribué lors des premières marches de 2019 et qui conserve aujourd’hui toute sa validité.
Récent et en cours:
- environnement [289]
- Marche pour le climat [318]
Rubrique:
Usine AZF (Toulouse): La catastrophe, c’est le capitalisme!
- 34 lectures
À l’occasion du 20e anniversaire de l’explosion de l’usine AZF à Toulouse, nous invitons nos lecteurs à lire ou à relire l’article que nous avions publié à l’époque. Depuis cette catastrophe, les « accidents » industriels n’ont cessé de se multiplier, signes parmi d’autres du délitement accéléré du capitalisme et de l’incapacité croissante de la bourgeoisie à assurer la direction de la société. Les catastrophes de Fukushima (2011) ou de Beyrouth (2020) ont suffisamment démontré la validité de notre analyse : « La catastrophe de Toulouse est un pas de plus dans l’horreur d’un capitalisme de plus en plus décadent et destructeur ».
– Explosion de l’usine AZF à Toulouse : L’État bourgeois est responsable de la catastrophe [319]
Evènements historiques:
- AZF [320]
Rubrique:
ICCOnline - octobre 2021
- 39 lectures
Grèves dans les hôpitaux: Contre la division syndicale, la classe ouvrière doit lutter sur son propre terrain!
- 60 lectures
Cet été, alors que le gouvernement mettait la pression sur la population pour accélérer la campagne vaccinale, Macron annonçait, avec un ton martial, l’obligation vaccinale pour les personnels hospitaliers et des maisons de retraite, sous peine de licenciement. Des contraintes identiques ont été imposées dans d’autres pays, comme en Grèce ou en Italie. Ces mesures, stigmatisant une partie de la population que la bourgeoisie faisait pourtant applaudir en « héros » un an plus tôt, n’ont pas manqué de faire réagir alors que l’épuisement et la colère sont immenses face aux coupes budgétaires et aux suppressions de lits qui se poursuivent. (1)
Profitant des manifestations anti-vax et anti-pass, les syndicats, CGT et Sud-Santé en tête, ont sauté sur l’occasion pour semer davantage la confusion sur le terrain pourri de la « liberté de choix ». Les syndicats ont ainsi lancé des grèves « massives et illimitées » (c’est-à-dire divisées par établissement, voire par service !) dans un secteur fragilisé et un contexte de relatif déboussolement.
En réalité, les syndicats savaient parfaitement que leurs mots d’ordre louvoyants « contre les modalités d’obligation inscrites dans la loi » (CGT) avaient pour seul effet de semer la division dans les rangs des travailleurs, entre ceux qui sont vaccinés et ceux qui ne le sont pas : « Le secrétaire général de la section cadres de santé à la CGT, Laurent Laporte s’inquiète des conséquences sur le climat de travail dans les cliniques et hôpitaux. “On parle d’un sujet très clivant qui va diviser les travailleurs, même si ça n’est pas 50 % pour et 50 % contre”, craint-il ». (2) Les mobilisations, en plus d’être enfermées dans le seul secteur de la santé, étaient logiquement minoritaires et ont, en effet, générées de nombreuses tensions.
Ces faux choix et « débats », où chaque citoyen est prié de se positionner sur les orientations politiques de la bourgeoisie, sont du pain béni pour les syndicats et leur basse œuvre de sabotage des luttes ouvrières ! De fait, avec leurs discours hypocrites contre l’obligation vaccinale, les syndicats ont poussé une partie de la classe ouvrière à rejoindre des mouvements réactionnaires de colère pour la défense des « libertés démocratiques », terrain où se côtoient tous les individus ulcérés par la politique du gouvernement : des ouvriers isolés et déboussolés aux militants d’extrême droite et autres anti-vax ! Finalement, la classe ouvrière a laissé le terrain social à des protestations pourries. Et les syndicats n’ont cessé de nourrir les « manifestations du samedi » en prenant d’hypocrites distances pour ne pas trop se décrédibiliser en grenouillant ouvertement avec des complotistes souvent liés à des groupuscules d’extrême droite.
Dans les hôpitaux, comme dans tous les secteurs, la lutte est en effet indispensable… mais seulement sur le terrain de la classe ouvrière ! Le prolétariat doit donc se mobiliser face aux conditions de travail qui se dégradent, aux licenciements et suppressions de postes qui touchent tous les secteurs, comme face aux nouveaux désastres annoncés par la poursuite du démantèlement du système de santé. Ce n’est pas isolé, secteur par secteur, entreprise par entreprise, que le prolétariat pourra faire reculer la bourgeoisie et son État. C’est, au contraire, en développant son unité et ses méthodes de lutte : les assemblées souveraines où tous les ouvriers de tous les secteurs, au chômage, à la retraite, peuvent se réunir, prendre en main la direction des luttes et réfléchir à la nature de leur exploitation comme aux perspectives pour le futur.
EG, 2 octobre 2021
1 Voir : « Et pendant la pandémie… l’État détruit toujours les hôpitaux ! [321] » disponible sur le site Internet du CCI.
2 « Passe sanitaire et obligation vaccinale : grève chez les soignants ce lundi » [322], Le Figaro (8 août 2021).
Situations territoriales:
Récent et en cours:
- Coronavirus [55]
- COVID-19 [56]
Rubrique:
Et pendant la pandémie… l’État détruit toujours les hôpitaux!
- 46 lectures
Il y a un an, lors de la première vague de Covid-19, toute la bourgeoisie française, son gouvernement, ses partis, ses médias, appelaient à applaudir aux fenêtres les soignants, « héros de la nation » en « première ligne » exposée à un virus meurtrier. Et de leur promettre, la main sur le cœur, considération, moyens et augmentation.
Cette campagne de fausse solidarité n’avait pour but que de masquer la réelle responsabilité de la catastrophe sanitaire : la fermeture des lits, la réduction des effectifs et des moyens, décennie après décennie, de gouvernements de droite en gouvernements de gauche. Avec quel résultat ? Un système de soin exsangue, incapable de faire face à l’épidémie. Chambres, infirmiers, médecins, gants et blouses, matériel respiratoire, tout manquait en février 2020. La seule solution pour éviter une saturation des hôpitaux avec des milliers de malades mourant chez eux (comme cela fut le cas en Italie au tout début de l’épidémie) a été de tout bloquer, tout arrêter, d’enfermer la population et de demander aux soignants de travailler jusqu’à épuisement. L’explosion de dépressions et de maladies mentales qui suivi est la conséquence d’une telle mesure moyenâgeuse et inhumaine qu’a été le confinement.
Mais alors, ces promesses ? Les leçons ont-elles été tirées ? Les moyens ont-ils afflué vers les hôpitaux ?
D’abords, les soignants ont reçu une médaille. Même pas en chocolat. Et ensuite ? Plus de 5700 lits d’hospitalisation ont été fermés en 2020. La France compte désormais moins de 3000 hôpitaux et cliniques. 25 établissements publics et privés ont donc été fermés l’an dernier ! Non seulement la bourgeoisie française poursuit le démantèlement du système de soin, mais elle profite même de cette sombre période pour l’accélérer !
Le capitalisme est décadent. Système obsolète, il n’a plus rien à offrir à l’humanité, et peu importe quelle fraction de la bourgeoisie est aux affaires pour gérer le pays. De l’extrême-droite à l’extrême-gauche, ils ne peuvent qu’attaquer inlassablement les conditions de vie et de travail pour tenter de maintenir désespérément la compétitivité nationale et les profits. Dans tous les secteurs, les hôpitaux, les écoles, les administrations, les usines, partout, les mots de « réforme », de « restructuration », de « réorganisation » riment avec de nouvelles dégradations des conditions de travail, de nouvelles réductions des effectifs, fermetures, augmentations des cadences… Le traitement infligé au secteur hospitalier n’est que le reflet de l’impasse dans laquelle s’enfonce le capitalisme tout entier, un système d’exploitation à abolir.
Pawel, le 1er octobre 2021.
Situations territoriales:
Récent et en cours:
- Coronavirus [55]
- COVID-19 [56]
Rubrique:
Rapport du GIEC: La nécessité d’une transition… vers le communisme
- 106 lectures
Il y a 20 ans, en 2001, le rapport du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat mettait en exergue un document du Groupe du scénario global, réuni par l’Institut de l’environnement de Stockholm, décrivant trois scénarios possibles pour l’avenir de l’humanité résultant de la crise climatique :
« Le cadre du GSG comprend trois grandes catégories de scénarios pour analyser l’avenir : « Mondes conventionnels », « Barbarisation » et « Grande transition », avec des variantes au sein de chaque catégorie. Tous sont compatibles avec les modèles et les tendances actuels, mais ont des implications très différentes pour la société et l’environnement au XXIe siècle… Dans les scénarios « Mondes conventionnels », la société mondiale se développe progressivement à partir des modèles actuels et des tendances dominantes, le développement étant principalement tiré par des marchés en croissance rapide, les pays en développement convergeant vers le modèle de développement des pays industriels avancés (« développés »). Dans les scénarios de « barbarisation », les tensions environnementales et sociales engendrées par le développement conventionnel ne sont pas résolues, les normes humanitaires s’affaiblissent et le monde devient plus autoritaire ou plus anarchique. Les « Grandes Transitions » explorent des solutions visionnaires au défi de la durabilité, qui décrivent l’ascension de nouvelles valeurs, de nouveaux modes de vie et de nouvelles institutions ». (1)
En 2021, après ou accompagné de vagues de chaleur sans précédent du Canada à la Sibérie, d’inondations en Europe du Nord et en Chine, de sécheresses et de feux de forêt en Californie, de nouveaux signes de fonte des glaces de l’Arctique, la première partie du rapport du GIEC, celle qui se concentre sur l’analyse scientifique des tendances climatiques, a clairement indiqué que la poursuite « conventionnelle » de l’accumulation capitaliste nous conduit vers la « barbarie ». En vue de la conférence sur le climat COP26 qui se tiendra à Glasgow en octobre-novembre, le rapport affirme avec force que, sans une action mondiale drastique et concertée pour réduire les émissions au cours des prochaines décennies, il ne sera pas possible de limiter la hausse des températures à 1,5 degré au-dessus des niveaux préindustriels, seuil considéré comme nécessaire pour éviter les pires conséquences du changement climatique. Et ce n’est pas tout : le rapport fait référence à une série de « frontières planétaires » ou de points de basculement qui pourraient entraîner une accélération incontrôlable du réchauffement planétaire, rendant de grandes parties de la Terre incapables d’accueillir la vie humaine. Selon de nombreux experts cités dans le rapport, quatre de ces limites ont déjà été franchies, notamment au niveau du changement climatique, de la perte de biodiversité et des méthodes agricoles non durables, et plusieurs autres, comme l’acidification des océans, la pollution plastique et l’appauvrissement de la couche d’ozone, menacent d’entraîner des spirales de renforcement mutuel avec les autres facteurs. (2)
Le rapport précise également que ces dangers découlent avant tout de l' « intervention humaine » (qui, en substance, signifie la production et l’extension du capital) et non de processus naturels tels que l’activité solaire ou les éruptions volcaniques, explications qui sont souvent le dernier recours des négationnistes du changement climatique, de plus en plus discrédités.
La partie du rapport traitant des moyens possibles de sortir de la crise n’a pas encore été publiée, mais tous les rapports précédents nous ont appris que, même s’il parle de « transitions » vers un nouveau modèle économique qui cessera de rejeter des gaz à effet de serre à des niveaux totalement insoutenables, le « Groupe d’experts intergouvernemental » n’a d’autre réponse que d’appeler les gouvernements, c’est-à-dire les États capitalistes, à revenir à la raison, à travailler ensemble et à convenir de changements radicaux dans le fonctionnement de leurs économies. En d’autres termes, le mode de production capitaliste, dont l’implacable course au profit est au cœur de la crise, doit devenir ce qu’il ne pourra jamais être : une communauté unifiée où l’activité productive est régulée non pas par les exigences du marché mais par ce dont les êtres humains ont besoin pour vivre.
Cela ne veut pas dire que les institutions capitalistes sont totalement inconscientes des dangers posés par le changement climatique. La prolifération des conférences internationales sur le climat et l’existence même du GIEC en témoignent. Les catastrophes qui en résultent étant de plus en plus fréquentes, il est évident qu’elles auront des coûts énormes : économiques, bien sûr, par la destruction des habitations, de l’agriculture et des infrastructures, mais aussi sociaux : appauvrissement généralisé, nombre croissant de réfugiés fuyant les régions dévastées, etc. Et tous les politiciens et bureaucrates, à l’exception des plus illusoires, comprennent que cela va peser lourdement sur les caisses de l’État, comme l’a clairement montré la pandémie de Covid (qui est également liée à la crise environnementale). Les entreprises capitalistes individuelles réagissent également : pratiquement toutes les entreprises affichent désormais leurs références écologiques et leur engagement en faveur de nouveaux modèles durables. L’industrie automobile en est un bon exemple : conscients que le moteur à combustion interne (et l’industrie pétrolière) est une source majeure d’émissions de gaz à effet de serre, presque tous les grands constructeurs automobiles passeront aux voitures électriques au cours de la prochaine décennie. Mais ils ne peuvent pas cesser de se faire concurrence pour vendre le plus grand nombre possible de leurs « voitures vertes », même si la production de voitures électriques a ses propres conséquences écologiques importantes – notamment en raison de l’extraction des matières premières, comme le lithium, nécessaires à la production des batteries des voitures, qui repose sur des projets miniers massifs et sur le développement des réseaux de transport mondiaux. Il en va de même au niveau des économies nationales. La conférence COP prévoit déjà qu’il sera très difficile de persuader les économies « en développement » comme la Russie, la Chine et l’Inde de réduire leur dépendance aux combustibles fossiles afin de réduire les émissions. Et elles résistent à ces pressions pour des raisons capitalistes parfaitement logiques : parce que cela réduirait considérablement leur avantage concurrentiel dans un monde déjà surchargé de matières premières.
Le monde n’est plus assez grand pour le capitalisme
Depuis l’époque du Manifeste Communiste, les marxistes ont insisté sur le fait que le capitalisme est poussé par ses crises de surproduction et la recherche de nouveaux marchés à « conquérir la terre », à devenir un système mondial, et que cette « tendance universalisante » crée la possibilité d’une nouvelle société dans laquelle le besoin humain, le plein développement de l’individu, devient le but de toute activité sociale. Mais en même temps, cette même tendance contient aussi les germes de la dissolution, de l’autodestruction du capital, et donc la nécessité impérieuse d’une transition vers une nouvelle communauté humaine, vers le communisme. (3) Et à l’époque de la Première Guerre mondiale, des marxistes tels que Boukharine et Luxemburg ont montré plus concrètement comment cette menace d’autodestruction se concrétiserait : plus le capitalisme deviendrait global, plus il se consumerait dans une compétition militaire mortelle entre des nations impérialistes déterminées à se tailler de nouvelles sources de matières premières, une main-d’œuvre moins chère et de nouveaux débouchés pour leur production.
Mais si Marx, Engels et d’autres ont pu constater très tôt que le système capitaliste empoisonnait l’air et épuisait le sol, ils n’ont pas pu voir toutes les conséquences écologiques d’un monde dans lequel le capital avait pénétré dans presque toutes les régions dans les quatre directions, subordonnant la Terre entière à son urbanisation galopante et à ses méthodes toxiques de production et de distribution. L’expansion capitaliste, motivée par les contradictions économiques contenues dans la relation entre le capital et le travail salarié, a poussé à l’extrême l’aliénation de l’humanité par rapport à la nature. De même qu’il existe une limite à la capacité du capitalisme à réaliser la plus-value qu’il extrait des travailleurs, la spoliation des ressources naturelles de la Terre par le profit crée un nouvel obstacle à la capacité du capitalisme à nourrir ses esclaves et à perpétuer son règne. Le monde n’est plus assez grand pour le capitalisme. Et loin de faire entendre raison aux États capitalistes et de les faire travailler ensemble pour le bien de la planète, l’épuisement des ressources et les conséquences du changement climatique auront tendance à exacerber encore plus les rivalités militaires dans un monde où chaque État cherche à se sauver face à la catastrophe. L’État capitaliste, qu’il soit ouvertement despotique ou recouvert du vernis de la démocratie, ne peut qu’appliquer les lois du capital qui sont à l’origine des menaces profondes qui pèsent sur l’avenir de l’humanité.
Le capitalisme, si on le laisse perdurer, ne peut que plonger le monde dans une « barbarisation » accélérée. La seule « transition » qui peut empêcher cela est la transition vers le communisme, qui, à son tour, ne peut être le produit d’appels aux gouvernements, de votes pour des partis « verts » ou de protestations de « citoyens concernés ». Cette transition ne peut être prise en main que par la lutte commune et internationale de la classe exploitée, le prolétariat, qui sera le plus souvent la première victime de la crise climatique comme c’est déjà le cas pour la crise économique. La lutte des travailleurs face aux attaques contre leurs conditions de vie contient à elle seule les germes d’un mouvement révolutionnaire généralisé qui demandera des comptes au capitalisme pour toutes les misères qu’il inflige à l’espèce humaine et à la planète qui la fait vivre.
Amos
1 Extrait de la page 140 du rapport 2001 du groupe de travail 3 du GIEC sur l’atténuation.
3 Voir la citation des Grundrisse de Marx dans notre récent article Growth as déclin | Courant Communiste International (internationalism.org) [325]
Récent et en cours:
- GIEC [326]
- environnement [289]
Rubrique:
Décès de Bernard Tapie, le “Bel-Ami” du mitterrandisme
- 89 lectures
L’hommage « spontané » des supporters de l’OM au « boss », Bernard Tapie, aura donc été le point d’orgue des surréalistes commémorations de la bourgeoisie à l’un des siens. Tous ont encensé « l’homme aux mille vies » et sa « capacité hors norme à rebondir après chaque défaite ». « Nanard » s’était en effet régulièrement recyclé en homme d’affaire, acteur, pilote de course, chanteur, politicien, présentateur de télévision, patron de presse, dirigeant de club de football, écrivain… Mais derrière ses mille et un masques de carnaval, le « boss » aura conservé sa vie durant le même visage, celui d’une sorte d’escroc opportuniste et sans scrupule, écrasant tout sur son passage. Avant même que son destin ne l’appelle, le jeune Bernard Tapie avait déjà mené une longue carrière de bonimenteur et de spéculateur véreux. Ses prédispositions ne le quitteront jamais.
Comme on ne dit pas du mal des morts (sauf quand ils menacent l’ordre établi), la presse française a donc multiplié les contorsions et les euphémismes pour ne pas prononcer les mots qui fâchent, parlant plutôt de la « part sombre » du personnage ou de son côté « filou ». Mais, après plusieurs décennies de péripéties juridico-politiques, les innombrables magouilles de Tapie ont tout de même refait surfaces : les châteaux de Bokassa en 1981, l’affaire OM-VA en 1995, l’affaire Testut en 1996, celles du Phocéa en 1997, les comptes de l’OM en 1998, l’interminable affaire Tapie-Crédit Lyonnais… pour ne citer que les plus emblématiques.
Le « redresseur » d’entreprise
Il y a cependant un aspect central de la carrière du « boss » que la presse a quasiment passé sous silence (probablement pour ne pas gâcher l’émouvant adieu du « peuple phocéen reconnaissant ») : la spécialité de l’affairiste marseillais, l’appropriation d’entreprises en dépôt de bilan. Car derrière le « redresseur » de boites en difficulté, se cachait bien difficilement le négrier spécialiste du « dégraissage » et de l’exploitation sauvage des ouvriers.
Après quelques années de tambouille et d’investissements de gagne-petit, le premier « gros coup » de Tapie fut la tentative de rachat de l’entreprise de vente par correspondance, Manufrance, en 1980. Les promesses de relance et de « sauvegarde de l’emploi » font rapidement place à la dure réalité : après un plan de restructuration et le démantèlement de la société, Manufrance est liquidé en 1985. La même année, Tapie achète pour une bouchée de pain les 250 boutiques de l’enseigne bio, La Vie Claire. Après la fermeture de la moitié des magasins et le licenciement du personnel qui va avec, « Nanard » revend finalement à bon prix une société au bord de la faillite. En 1981, c’est au tour de Terraillon, fabriquant de pèse-personne, de faire les frais de sa « capacité hors norme à rebondir » : cinq fois moins de salariés plus tard, il revend les usines avec un bénéfice de 33 millions de francs. En 1983, le « boss » rachète Look Cycle pour 1 franc symbolique et lui administre le même traitement de choc : il revend la société pour 260 millions. Rebelote en 1984 avec les piles Wonder : il ferme sans ciller quatre usines et licencie 600 salariés pour empocher 470 millions de francs. Bon appétit, Monsieur Tapie !
Mais c’est en 1990 que « Nanard » espère réaliser « l’affaire de sa vie » avec l’achat du fabriquant de vêtements de sport, Adidas, au bord du gouffre. Il restructure l’entreprise à la sulfateuse et envoie une partie de la production en Asie pour « comprimer les coûts de fabrication ». En clair : les gamins asiatiques, ça coûte beaucoup moins cher !
L'affaire tourne court : Adidas et Tapie s’endettent avec une perte, en 1992, de 500 millions de francs. Surtout, le Parti socialiste au pouvoir a décidé de lancer le « golden boy français » en politique. Pressenti au ministère de la Ville, Tapie ne peut pas s’encombrer d’un tel fardeau. Il revend donc Adidas au Crédit Lyonnais (alors banque publique) dans des conditions plus que troubles : sans avoir investi un seul centime, il revend pour 2 milliards de francs une entreprise en déroute à la banque qui lui avait prêté, sans jamais être remboursée, 1,6 milliards de franc pour son achat. L’opération étant bien entendu réalisée sous l’autorité de François Mitterrand, protecteur de Bernard Tapie et chef de l’État qui contrôlait le Crédit Lyonnais.
Le « missile » politique du Parti socialiste
En 1987, Mitterrand est en campagne. Il cherche à se faire réélire pour un second septennat. L’heure est à « l’ouverture à la société civile » et l’homme d’affaire médiatique, propriétaire de l’OM, est parfait pour le rôle. D’autant que le PS, discrédité par cinq années d’attaques économiques infligées au prolétariat, cherche à faire gonfler les scores du FN pour, non seulement, affaiblir le parti de droite, mais aussi se présenter en « rempart de la démocratie » face au « péril fasciste ». Dans cette mise en scène électorale, Mitterrand fera jouer à Tapie un de ses plus cyniques numéros.
Côté pile, « Nanard » va jouer les durs face à l’extrême droite pour mieux la crédibiliser, sermonnant les militants du FN à Orange ou affrontant Le Pen-père dans deux shows télévisés dans lesquels le « Menhir » a, une fois n’est pas coutume, asséné une vérité indiscutable à propos de son adversaire, l’accusant de n’être qu’un « matamore, un tartarin, un bluffeur ».
Car, en effet, côté face, Tapie se révèle aussi être une pièce d’importance dans la connivence entretenue entre le PS et le FN. Les témoignages venus de la coulisse sont accablants, en particulier celui d’un proche collaborateur de Le Pen, Lorrain de Saint Affrique. (1) En 1989, il affirme qu’il y a « entre les dirigeants de la fédération départementale des Bouches-du-Rhône du Front et l’entourage de Bernard Tapie des contacts permanents pour examiner ensemble tel ou tel cas, se coordonner, s’épauler. Avec la bénédiction de Le Pen ». À l’occasion de l’élection de Tapie aux législatives de 1993, il affirme également que « Le Pen, en bureau politique, va s’abriter derrière la consigne générale : maintenir partout les candidats qui ont atteint la barre des 12,5 % requise par le code électoral pour être présent au second tour. Tapie est élu [grâce à une triangulaire qui a affaibli le candidat de droite]. Au Front, où Tapie figure parmi les têtes de Turc […], les militants vivent très mal ce maintien et les conditions dans lesquelles Le Pen a pris sa décision. Ils flairent quelque chose. […] On parle d’un accord, d’un volet financier, d’une rencontre sur le Phocéa, le yacht de Tapie ». L’ancien attaché parlementaire de Tapie, Marc Fratani, confirmera également l’existence de telles rencontres sous la protection du « milieu » corso-marseillais, et au moins un rendez-vous entre les deux hommes au domicile de Le Pen pour mettre au point des arrangements électoraux. (2)
Tapie a également servi de pion à Mitterrand pour contrecarrer les prétentions de Michel Rocard, son principal rival au sein du PS. N’appartenant pas au sérail socialiste, n’ayant pas pris la peine de franchir tous les échelons de la nomenklatura, Tapie a tout de même été catapulté ministre. À la mort de son protecteur Mitterrand, la lutte de succession au sein du PS s’engage. Alors que les barons socialistes cherchent à lui faire payer très cher sa réussite de parfait parvenu, il leur coupe l’herbe sous le pied en abdiquant toute forme de prétention politique nationale. L’affaire OM-VA (dans laquelle il est convaincu de corruption lors d’un match de foot truqué) achèvera de couper court à ses ambitions politiques.
Mais celui qui se demandait, à la fin des années 1980, s’il valait mieux être de gauche ou de droite pour conquérir la mairie de Marseille, ne cessera de manger à tous les râteliers : se plaçant sous la protection de Sarkozy en 2007, il a bénéficié d’un arbitrage totalement frauduleux dans l’affaire Adidas, empochant au passage 400 millions d’euros. En 2012, il se tourne à nouveau vers ses « amis socialistes » pour que Claude Bartolone (l’ex-président de l’Assemblée nationale) et François Hollande interviennent en sa faveur dans le rachat du journal La Provence… journal qui eut donc l’insigne honneur de subir en 2020, les ultimes licenciements du « boss ». On ne se refait pas !
EG, 9 octobre 2021
1 Dans l’ombre de Le Pen (1998).
2 « “J’ai accompagné Tapie chez Le Pen”, Marc Fratani raconte la rencontre de 1993 » [327], Le Monde (2 mars 2019).
Situations territoriales:
Personnages:
- Bernard Tapie [329]
- Mitterrand [330]
Rubrique:
Violences dans les stades de football: la barbarie du capitalisme a le sport qu’elle mérite!
- 95 lectures
Jets de projectiles envers des joueurs à Montpellier, bagarres entre supporters et joueurs à Nice, jets de briques sur la pelouse après une décision arbitrale à Ajaccio, siège arraché et jeté sur un enfant de 11 ans à Paris, pelouse envahie par des supporters à Lens, guet-apens tendu à l’encontre de supporters à Montpellier, bagarres entre supporters à Angers… Le retour du public dans les stades de football en ce début de saison de Ligue 1 en France est marqué par une accumulation de heurts.
L’illustration d’une société à l’agonie
La violence dans les stades est congénitale au sport moderne. Celle-ci avait d’ailleurs trouvé son paroxysme dans les années 1980 et 1990 dans plusieurs pays d’Europe à travers le hooliganisme, ces hordes d’individus pour qui les rencontres sportives étaient une occasion de se défouler brutalement et semer la terreur dans et autour des stades. Le spectacle d’horreur du Heysel le 29 mai 1985 puis celui d’Hillsborough en 1989 obligèrent les États et les instances sportives, principaux responsables de ces « massacres », (1) à prendre des mesures afin de canaliser ce phénomène de violence aveugle et nihiliste, sans pour autant éradiquer sa racine évidemment. Celle-ci résidant dans la dégradation matérielle et la dépravation morale engendrées par la crise économique du capitalisme et la spirale mortifère dans laquelle celui-ci entraîne la civilisation. (2)
Ainsi, les violences entre supporters sont restées une constante au cours des dernières années avec des moments paroxystiques, comme durant le Mondial 98 et l’Euro 2016 en France ou encore dans les travées du Parc des Princes dans les années 2000 où les « ultras » parisiens ont souvent fait régner la terreur. Le regain de violences de ces dernières semaines n’est donc pas fortuit. C’est la conséquence du pourrissement de la société capitaliste que la pandémie de Covid-19 (et ses dégâts sociaux et psychologiques) n’a fait qu’amplifier drastiquement.
Une société au sein de laquelle des individus toujours plus atomisés, écrasés, broyés, humiliés trouvent dans l’appartenance à ces bandes, et les rixes auxquelles elles s’adonnent, un moyen de se défouler, d’avoir le sentiment « d’exister », « d’être quelqu’un » en crachant leurs pulsions de haine et d’agressivité.
La « condamnation » par les médias de ces individus montre toute l’hypocrisie de la bourgeoisie quand on sait que la presse sportive, les dirigeants, les États et les gouvernements sont les premiers à galvaniser ces hordes d’individus en faisant du sport-spectacle l’arène de la rivalité, de la concurrence, du chauvinisme, du nationalisme, de la victoire à tout prix !
Comme l’exprimait l’écrivain George Orwell : « pratiqué avec sérieux, le sport n’a rien à voir avec le fair-play. Il déborde de jalousie haineuse, de bestialité, du mépris de toute règle, de plaisir sadique et de violence ; en d’autres mots, c’est la guerre, les fusils en moins ».
Une bonne occasion de renforcer la répression
« Il faut être ferme. Ce sont des gens qui abîment l’image du sport, qui renversent ce que le sport doit être, c’est-à-dire la fraternité entre les citoyens » (Blanquer),
« Moi je suis un supporter de football, je ne veux pas que quelques-uns emmerdent la grande majorité des supporters ». (Darmanin).
Voici un condensé de toute la campagne menée par la classe dominante : répression face à la démocratie en danger ! D’où les sempiternelles propositions de mesures que les responsables politiques ou représentants des institutions sportives ont dégainé par la suite : « Matchs à huis clos », « perte de points pour les clubs », « interdictions de stade ou de déplacements de supporters », « identification et fichage des individus », « renforcement de la vidéo-surveillance », « sanctions pénale », etc.
Elles visent toutes à braquer les projecteurs sur l’insuffisance (réelle) des dispositifs de sécurité mis en place par les clubs et sur la culpabilité des hooligans. Tout cela pour mieux cacher que ce regain de violence, dans les stades comme ailleurs, est le produit de la société capitaliste en pleine agonie !
Surtout, cette campagne permet une nouvelle fois de justifier le renforcement des forces de répression et le durcissement de l’appareil judiciaire dans l’ensemble de la vie sociale. Elle contient également, en creux, l’amalgame implicite entre les hooligans et les black-blocs ayant comme mode d’expression la même violence aveugle et nihiliste.
Ce qui ne peut que contribuer à intimider tous ceux qui voudraient participer à des mobilisations ou des manifestations ouvrières.
Voilà dans le fond, le sens de ce type de campagne : déboussoler, terroriser et prévenir toute expression collective de colère ouvrière.
Vincent, 2 octobre 2021
2 Voir « Les Thèses sur la décomposition », Revue internationale n°107.
Situations territoriales:
Récent et en cours:
- Sport [332]
Rubrique:
Permanence en ligne du 23 octobre 2021
- 46 lectures
Révolution Internationale, section en France du Courant Communiste International, organise une permanence en ligne le samedi 23 octobre 2021 à 14h.
Ces permanences sont des lieux de débat ouverts à tous ceux qui souhaitent rencontrer et discuter avec le CCI. Nous invitons vivement tous nos lecteurs, contacts et sympathisants à venir y débattre afin de poursuivre la réflexion sur les enjeux de la situation et confronter les points de vue. N'hésitez pas à nous faire part des questions que vous souhaiteriez aborder.
Les lecteurs qui souhaitent participer aux permanences en ligne peuvent adresser un message sur notre adresse électronique ([email protected] [213]) ou dans la rubrique “contact [214]” de notre site internet, en signalant quelles questions ils voudraient aborder, afin de nous permettre d’organiser au mieux les débats. Les modalités techniques pour se connecter à la permanence seront communiquées par retour de courriel.
Vie du CCI:
- Permanences [291]
Rubrique:
Le CCI a-t-il modifié son analyse à l’égard des “gilets jaunes”? (partie 2)
- 89 lectures
Nous publions ci-dessous un extrait du courrier adressé par notre camarade D au sujet de l’analyse du mouvement des « gilets jaunes » et de notre réponse à son premier courrier [333].
Chers camarades
[…] En relisant la réponse de SJ du 4 avril à ma précédente lettre, je suis tout à fait d’accord avec la réaffirmation du caractère inter-classiste de ce mouvement et de l’impossibilité de son évolution en tant que mouvement vers des positions franches de la classe ouvrière. Néanmoins, comme je suis d’accord avec l’impossibilité d’évolution d’un groupe trotskyste en tant que tel (BPA, LO, lambertistes) vers une transformation en groupe ou parti utile à la classe ouvrière dans une période prérévolutionnaire, je suis également d’accord avec une position “historique” du CCI : c’est-à-dire la possibilité de sécrétion d’un petit groupe issu de ces partis bourgeois qui émergerait sur des positions de classes. [...] Il reste dans la mouvance des gilets jaunes des personnes susceptibles d’évoluer de façon positive et s’il n’est pas question de brosser ces personnes dans le sens du poil, il ne faut pas commettre d’erreurs d’expressions littérales péjoratives qui seraient des freins à la poursuite de cette évolution positive. Je vous encourage à bien faire attention aux mots utilisés si des personnes de cette mouvance surgissaient en se posant des questions intéressantes et à bien différencier le fond (la fermeté sur l’interclassisme) et la forme (un ton positif). Je vous envoie en annexe un article du journal local qui s’intéresse à ceux qui se réclament encore de ce mouvement. Si les illusions démocratiques sont majoritaires, à part un travailleur indépendant les autres intervenants sont des salariés ou à la retraite. Cela indique que c’est cette composante d’ouvriers qui reste fidèle à ce mouvement de contestation. […]
Bon courage, amitiés
D.
Comme nous pouvons le constater, il y a un accord avec le camarade D sur la nature interclassiste de ce mouvement, mais le camarade n’a, semble-t-il, pas été convaincu par nos arguments sur une partie de notre intervention qui n’aurait pas été suffisamment « positive » et pourrait même être un « frein » pour « l’évolution positive » (nous comprenons sur des positions de classes) d’éléments ayant participé à ce mouvement. Encore une fois, il ne nous semble pas avoir fait preuve d’un « ton agressif » ou de condescendance vis-à-vis des éléments de la classe ouvrière prisonniers de ce mouvement, aussi stérile et nocif qu’il ait été pour le développement de la conscience de classe. D’autre part, notre intervention s’adressait non pas à tel ou tel élément participant ou non aux « gilets jaunes » mais à l’ensemble de la classe ouvrière, en la mettant en garde contre le danger que font peser les luttes interclassistes. Si le CCI a été amené à utiliser un certain nombre de termes (tels que « zones périurbaines » ou encore « secteurs les plus pauvres ») pour dessiner les contours de la composante ouvrière participant à ce mouvement, c’était uniquement pour mettre en évidence qu’il s’agissait essentiellement des franges les plus précaires et écrasées du prolétariat, des parties extrêmement vulnérables à l’idéologie bourgeoise et petite-bourgeoise et donc plus enclines à se faire embarquer dans des mobilisations qui ne font pas partie du combat du prolétariat. Comme l’indiquait la Gauche communiste de France dans un article paru dans la revue Internationalisme en 1947, (1) « dans de telles luttes [celles qui renforcent le capitalisme] les révolutionnaires n’ont pas à pousser des “hourra !” ni à se frotter les mains d’aise en clamant “dans le monde entier les ouvriers entrent en lutte”, mais à expliquer sans cesse aux ouvriers le rôle de dupes et de victimes qu’ils jouent réellement. Seules les luttes dont les objectifs sont la défense des intérêts immédiats et historiques des ouvriers présentent un caractère de lutte de classe du prolétariat et peuvent être prises pour mesure de l’intensité de la lutte et seules de telles luttes engendrent les conditions pour la constitution du Parti de classe ».
Si les échanges d’arguments entre le camarade D et le CCI sur cet aspect ne sont, pour le moment, pas parvenus à une pleine clarification, cela ne signifie pas pour autant que le débat soit clôt. Nous invitons donc nos lecteurs à prendre part à cette discussion en apportant leur contribution par courriers.
CCI
1 « Problèmes actuels du mouvement ouvrier : les conditions historiques de la formation du parti », Internationalisme n°19 (1947).
Vie du CCI:
- Courrier des lecteurs [252]
Récent et en cours:
- Gilets jaunes [253]
Rubrique:
Macron à Kigali: le Président français digne représentant de l’impérialisme en déplacement géopolitique
- 60 lectures
Nous publions, ci-dessous, le courrier d’une lectrice après la visite de Macron à Kigali et la reconnaissance des « fautes » de la France lors du génocide des Tustsis au Rwanda en 1994. Dans son courrier, la camarade dénonce très justement l’hypocrisie et le cynisme de l’impérialisme français et de son représentant, Macron, face à un massacre abominable dans lequel la France a joué un rôle actif et déterminant. Elle revient également sur les racines profondes du massacre : « c’est toujours le même système barbare qui est aux manettes sous différentes étiquettes, selon les périodes, le contexte géopolitique et les enjeux à court et moyen termes ».
Nous invitons nos lecteurs à relire notre article paru en juin 1994 [334] suite à plusieurs massacres abominables perpétrées par la bourgeoisie, et republié récemment dans le cadre de l’anniversaire du génocide des Tutsis au Rwanda [335].
Suite à la republication de l’article paru en juin 1994 sur le « génocide rwandais », je mesure que déjà à l’époque des faits, d’ailleurs que partiellement connus, le CCI avait analysé la situation avec beaucoup de perspicacité alors que l’ensemble des médias bourgeois se contentaient de rester dans la sidération voire pis dans le déni comme si c’était un massacre ethnique en dehors des velléités impérialistes que se livraient notamment la France et les États-unis. L’actualité remet cet épisode sur le devant de la scène avec le déplacement de Macron à Kigali et comme le précise l’introduction à l’article, il s’agit pour Macron de « solder un secret de polichinelle ». En effet de nombreux livres, rapports, témoignages attestent de la réalité de la complicité de la France, il n’est plus possible de nier l’évidence alors il lui faut être le chef d’orchestre de la reconnaissance de la responsabilité de la France. C’est le prix à payer pour assurer le retour économique et stratégique de la France dans ce pays. Et cerise sur le gâteau : ces révélations accablantes sur la participation active de la France à la réalisation de ce génocide permet à Macron de tordre le coup à la gauche mitterrandienne en se posant comme démocrate humaniste…
RWANDA : 27 mai 2021 « La France a un rôle, une histoire et une responsabilité politique au Rwanda », elle est restée « de fait aux côtés d’un régime génocidaire » mais « n’a pas été complice », voilà ce qu’a déclaré le président français au Mémorial de Kigali, vingt-sept ans après le génocide de 1994.
Dans son discours très attendu au Mémorial du génocide de Kigali, où reposent les restes de 250 000 des plus de 800 000 victimes de l’un des drames les plus meurtriers du XXe siècle, le président français, Emmanuel Macron, est venu « reconnaître [les] responsabilités » de la France dans le génocide de 1994 au Rwanda. La France « n’a pas été complice », mais elle a fait « trop longtemps prévaloir le silence sur l’examen de la vérité », a-t-il déclaré, en ajoutant que « seuls ceux qui ont traversé la nuit peuvent peut-être pardonner, nous faire le don de nous pardonner ». Tout ce charabia en langage soutenu pour permettre aux gouvernants Rwandais, d’une part, d’être satisfait d’un tel discours « qui vaut plus que des excuses », et Français, d’autre part, d’apparaître comme l’homme humaniste de la société du XXIe siècle loin de la France-Afrique et des vestiges de la colonisation. Gagnant-Gagnant, en fait.
Qu’on ne se méprenne pas : Macron ne s’est pas déplacé à Kigali dans le but de faire avancer l’Histoire dans ce qui a été le plus grand génocide des dernières décennies. Non, Macron n’a pas rendez-vous avec l’histoire au Rwanda en ce jour de souvenir mais est venu après quatre longues années de rapprochement économique entériner une série d’accords économiques (pas moins de dix hommes et femmes d’affaires l’accompagnent). Ceci dit, il ne pouvait pas se dispenser de quelques reconnaissances de responsabilités, mais il était illusoire de penser qu’il pouvait présenter les excuses de la France. D’ailleurs, à quoi s’apparenteraient de telles excuses ? Reconnaître que la France a formé les troupes Hutu au combat (L’ « opération insecticide ». Pas étonnant que les Hutus appelaient les Tutsis « cancrelats », « cafards », « vermines ») dans la perspective d’imposer leur domination pour finir par leur projet d’extermination. Reconnaître que c’est dans l’ambassade de France que s’est constitué le gouvernement Hutu au lendemain de l’attentat de l’avion du président ? Reconnaître que les ordres étaient donnés depuis Paris via la cellule de l’Élysée uniquement dirigée par Mitterrand et son comité privé. Ordres verbaux donc sans trace… Les courriers entre Mitterrand et son fils Jean-Christophe : Monsieur Afrique de l’époque, ont disparu et n’ont pas pu être examinés par les différentes commissions d’enquête… Reconnaître que l’armée française (exceptés quelques militaires effarés par l’ampleur des massacres et leur « complicité ») a été aux côtés des génocidaires en leur permettant de continuer leur besogne meurtrière avec les armes et machettes achetées et livrées sur le tarmac de l’aéroport de Kigali, le lendemain de l’assassinat du président rwandais… Reconnaître que Mitterrand et Habyarimana entretenaient une relation fraternelle : Mitterrand appréciait le côté cultivé du Président rwandais qui connaissait tous les grands classiques francophones… Comme quoi l’érudition n’est pas une garantie d’humanité ! Cette amitié entre le président français et le président rwandais a facilité la mise en place du système génocidaire en gestation depuis les années 90. À quoi il faut ajouter la rivalité impérialiste qui se jouait entre la France et les États-Unis qui eux avaient fait le choix d’armer les rebelles Tutsi réfugiés au Burundi et en RDC. Après le discours de la Baule en 1990, il est clair que la volonté suprématiste Hutue est lancée et que la France va y contribuer activement. Mitterrand veut faire du Rwanda un laboratoire africain et toute sa clique est à l’ouvrage : Pour n’en citer que deux : Jean-Christophe Mitterrand, son fils, conseiller Afrique était en liaison permanente et occupait une position déterminante à l’EMP (État-Major Particulier) cellule « privée » de l’Élysée en charge du dossier rwandais. Hubert Védrine, secrétaire général de l’Élysée à partir d’octobre 1990 est lui aussi un très proche de Mitterrand et est à la tâche ! Les premières commissions d’enquête n’avaient pas abouti à démontrer leurs responsabilités et pour cause les documents étaient classés secret-défense. Aujourd’hui, une partie est communiquée mais à quoi bon puisqu’on sait pertinemment que l’essentiel des ordres et instructions étaient à l’oral via un système de communication cryptée. Les assassins peuvent continuer à dormir tranquilles…
Sur la connaissance médiatique du déroulement du génocide, comment peut-on encore soutenir qu’on ne savait pas alors que rien n’était dissimulé, voire pis, puisque les consignes des massacres étaient données chaque matin via la radio « Les mille collines » partout dans le pays ? Les tueurs étaient encouragés à la radio et avaient pour tâche quotidienne de couper du matin au soir le plus de Tutsis possible. Le soir, les « vaillants » coupeurs avaient le loisir de s’abreuver jusqu’à plus soif après avoir affûté leur machette de travail pour le lendemain. On apprendra que ce travail a été très « efficace » et aboutira à l’extermination de près d’un million de personnes en cent jours. Je ne sais pas si on peut s’imaginer la mort par machette. Sans tomber dans la description glauque tout le monde comprend bien qu’il ne s’agit pas d’une mort immédiate et que des centaines de milliers de personnes démembrées, éventrées, tailladées ne sont mortes qu’après de longues agonies. Passer le stade de la sidération, c’est l’analyse politique des faits qui peut nous permettre de comprendre comment un tel génocide « artisanal » (j’emploie cet adjectif car pour cette extermination pas de matériel sophistiqué, pas d’arme chimique, non de simples machettes ou marteaux cloutés) a pu se produire ? La question qui m’a longtemps hantée n’est pas celle du rôle de la France dans ce génocide (aucune illusion sur le fait qu’elle ait été à l’origine de cette extermination par sa politique impérialiste sur le terrain depuis des décennies de colonisation et par sa complicité à permettre cette chasse à l’homme.) Non ma perplexité, que je ne considère pas naïve, porte sur cette déshumanisation qu’il a fallu secréter dans la moitié de la population rwandaise pour qu’elle accepte aux heures de bureau d’aller taillader l’autre moitié. Cet ignoble besogne n’a pas pu se décider comme ça un beau matin d’avril 94, non il a fallu de longues années de préparation mentale s’infiltrant dans l’administration, la police et toutes les structures de la société civile pour parvenir à l’ancrer dans la tête des tueurs parce que leur tâche était d’épurer le Rwanda de ces vermines… On rejoint ici la démarche de tous les génocides : déshumaniser l’autre pour rendre possible voire indispensable de l’exterminer… Les textes forts d’Hannah Arendt, notamment son concept de la banalité du mal résonne fort et nous rappelle qu’il faut une préparation à la déshumanisation pour parvenir à ces cruautés massives. C’est dans ce sens qu’il faut comprendre la responsabilité de la France.
Et l’histoire ne s’arrêtera pas là, car on passe presque sous silence l’exode des rescapés, mais aussi la fuite des tueurs en RDC puis leur retour et l’incroyable phase de réconciliation qui va contraindre les rescapés à cohabiter avec leurs bourreaux souvent même en leur ayant abandonné leur logement. Alors effectivement que Macron présente ou non des excuses, demande au rwandais de faire le don du pardon… relève uniquement du cynisme politique et de la diplomatie.
Cette tragédie nous impose me semble-t-il de bien considérer que le capitalisme ne règne qu’en répandant la barbarie et cette attaque commence par l’anéantissement cérébral. Souvent on reprend ce slogan : Socialisme ou Barbarie. Le génocide rwandais nous en donne une triste illustration. Ce ne sont pas que des concepts mais la perspective à grande échelle si la classe ouvrière n’est pas en mesure de se positionner sur le terrain politique. Le capitalisme, c’est la barbarie.
Pour conclure sur ce déplacement de Macron, si on se place au niveau de la bourgeoisie, le président français a réalisé un bon oral en se positionnant sur le terrain de la reconnaissance des fautes de Mitterrand. C’est bien joué : il fait porter la responsabilité sur la gauche de l’époque (c’est toujours intéressant de trouver un coupable en dehors de son parti) et se positionne dans la modernité d’un monde à construire sur de nouvelles bases de coopération économique. La France et le Rwanda y travaillent depuis plusieurs années et des projets importants (dans le numérique, l’industrie cinématographique, etc.) sont en cours de réalisation : le « laboratoire africain » dont avait rêvé Mitterrand de façon coloniale et sanguinaire est en train de se profiler sous l’aire Macron sous une forme plus policée sur les cadavres du génocide. Qu’on ne s’y trompe pas, c’est toujours le même système barbare qui est aux manettes sous différentes étiquettes, selon les périodes, le contexte géopolitique et les enjeux à court et moyen termes.
Aïcha, 31 mai 2021
Vie du CCI:
- Courrier des lecteurs [252]
Géographique:
Rubrique:
ICCOnline - novembre 2021
- 46 lectures
Permanence en ligne du 18 décembre 2021
- 167 lectures
Révolution Internationale, section en France du Courant Communiste International, organise une permanence en ligne le samedi 18 décembre 2021 à partir de 14h.
Ces permanences sont des lieux de débat ouverts à tous ceux qui souhaitent rencontrer et discuter avec le CCI. Nous invitons vivement tous nos lecteurs, contacts et sympathisants à venir y débattre afin de poursuivre la réflexion sur les enjeux de la situation et confronter les points de vue. N'hésitez pas à nous faire part des questions que vous souhaiteriez aborder.
Les lecteurs qui souhaitent participer aux permanences en ligne peuvent adresser un message sur notre adresse électronique ([email protected] [213]) ou dans la rubrique “nous contacter” de notre site internet, en signalant quelles questions ils voudraient aborder, afin de nous permettre d’organiser au mieux les débats.
Enfin pour la facilité du débat et si tu souhaites y participer indique nous sous quel nom ou pseudonyme tu te connecteras lors de cette permanence.
Les modalités techniques pour se connecter à la permanence seront communiquées ultérieurement.
Vie du CCI:
- Réunions publiques [219]
Rubrique:
“Un désir de communisme” de Bernard Friot et Judith Bernard: Un vulgaire désir de stalinisme!
- 260 lectures
Récemment paru, le livre d’entretiens entre le sociologue Bernard Friot (1) et la syndicaliste enseignante (encartée à SUD-Éducation), également présentatrice d’émissions de télévision, Judith Bernard, s’intitule : Un désir de communisme. Ce livre et ses auteurs entendent poser la question du communisme sous un jour particulier, celui du « salaire à la qualification personnelle », indépendant de l’ancienneté et de la loi du marché, et garanti à vie. Ce salaire serait payé par des cotisations sur le principe de la Sécurité sociale : il s’agirait de reprendre le principe « révolutionnaire », selon Friot, de la Sécurité sociale et de l’étendre en versant à tous un salaire sur la base des qualifications que chacun possède individuellement, validées par un « jury » composé de syndicalistes, sur le modèle des négociateurs des conventions collectives. Le principe de cette rémunération serait indépendant même de la réalité d’un travail, il existerait de droit. Les salaires seraient versés par une « caisse de salaires », et l’investissement serait réalisé par des « caisses d’investissement », également financées par des cotisations, « instances où de la monnaie est disponible pour financer les investissements dans les entreprises » en les subventionnant, sans crédit.
Une falsification nationaliste du communisme
Tout au long de l’ouvrage, les auteurs n’envisagent de développer leur programme « communiste » qu’à l’échelle de la France, sous l’angle strictement national. L’internationalisme prolétarien n’est pourtant pas une option pour les communistes : il est, au-delà des divisions nationales que lui impose la bourgeoisie, l’affirmation du caractère unitaire du prolétariat, la base de ce qui constitue la grande force de la classe ouvrière : son unité. Dans ses Principes du communisme (1847), à la question : « Cette révolution se fera-t-elle dans un seul pays ? », Engels répondait : « Non. […] Elle est une révolution universelle ; elle aura, par conséquent, un terrain universel ». Ce que Friot et Bernard nous proposent n’a rien à voir, ni de près ni de loin, avec le communisme. C’en est une falsification pure et simple et une négation : les frontières nationales sont un héritage politique, économique et social de la bourgeoisie, les nations sont nées quand la bourgeoisie est devenue la classe dominante, le rôle de la révolution prolétarienne est donc de les détruire !
On peut constater ainsi qu’ils s’opposent complètement à la vision développée par le mouvement ouvrier de la société communiste, et dans ce cadre, ce qu’ils appellent « communisme » n’est rien d’autre qu’une actualisation de la mystification et du verbiage staliniens, qui proclamait « la construction du socialisme dans un seul pays ».
Un « communisme » très capitaliste…
Le moins que l’on puisse dire, c’est qu’on est, dans cet ouvrage, très loin de ce qu’est le communisme : une société sans classe où l’économie et la loi de la valeur laissent la place à la « libre administration des choses » (Marx). Friot et Bernard se disent, d’ailleurs, résolument opposés à une société future sans classes, qualifiée « d’illusion magique », de la même façon qu’ils s’affirment contre une société « sans valeur économique, sans monnaie, dans laquelle il y aurait une transparence des valeurs d’usage ».
Le système que Friot nous décrit est un système salarial à visée égalitaire, même si c’est en fonction des « qualifications personnelles » ; des « jurys » détermineraient le niveau de qualification des salariés, leur offrant un revenu à vie en fonction de ce qu’ils savent faire pour se rendre utiles à la société, y compris en cas de non-activité. Nous sommes au regret d’apprendre à M. Friot que le Capital fait très bien la même chose : les DRH sont là pour ça !
Mais attention !, nous dit M. Friot : la logique n’est pas celle du profit que l’on peut tirer d’un salarié, mais de son utilité pour le bien commun. Ce que cela change n’est d’aucun intérêt pour la classe ouvrière : que la logique de l’exploitation salariale soit une « qualification » pour le bien de la société toute entière ou pour le plus grand profit de l’économie nationale, l’exploitation par le salariat est ce qui définit le caractère de classe exploitée du prolétariat ! Lorsque les exploits de Stakhanov étaient mis en scène par le capital national « soviétique », c’était aussi soi-disant « pour le bien commun » du « paradis des travailleurs » ; mais dans la réalité, ça n’a jamais, à aucun moment, amélioré la condition du prolétariat russe. Au contraire ! La seule qui a profité de cette mise en scène de la surexploitation ouvrière, c’est la bourgeoisie « soviétique », qui a utilisé Stakhanov pour augmenter drastiquement les normes de productivité en URSS !
Du reste, Friot n’est aucunement opposé aux « gains de productivité », qu’il considère comme « [n’ayant] pas d’effet négatif sur la qualification et le salaire des personnes », puisque le salaire qu’il envisage serait garanti à vie. Ce que cette affirmation contient n’est rien d’autre qu’une falsification de ce qu’est le salaire, puisque la bourgeoisie peut tout à fait, elle aussi, augmenter la productivité sans baisser les salaires : l’augmentation de la charge de travail, le chronométrage, les heures supplémentaires obligatoires et l’accélération des cadences sont des moyens que la bourgeoisie utilise constamment pour augmenter la productivité de la classe ouvrière sans toucher formellement aux salaires. Là encore, l’exemple de Stakhanov et son utilisation par la bourgeoisie russe pour intensifier la productivité du prolétariat en URSS et ailleurs montre qu’il est totalement mensonger d’affirmer que c’est sans « effet négatif » sur les conditions de vie et de travail des prolétaires !
La nostalgie de l’âge d’or du stalinisme…
Tout le système relooké par Friot évoque irrésistiblement ce qui existait en URSS et dans les Pays de l’Est jusqu’à l’effondrement de ce capitalisme d’État caricatural : salaire à vie, dont le montant était basé sur des critères étrangers au marché (ce qui aboutissait au fait qu’un ouvrier était mieux payé qu’un ingénieur), prise en charge de tous les aspects sociaux de la vie par les instances étatiques en grande partie gérées par les syndicats, les salariés ayant la propriété théorique du capital (comme dans les kolkhozes et les coopératives « soviétiques »). La seule différence est que Friot nous affirme qu’il est pour la disparition de l’État ; mais vu qu’il nous assène à côté de ça, « qu’il n’y a, effectivement, aucune possibilité de faire une société sans une violence concernant ce qui vaut », et qu’« il y a forcément des conflits aussi entre l’entreprise et les caisses d’investissement, entre l’entreprise et les caisses de salaire, il y aura tout une série de conflits » dans sa société « communiste », nous pouvons être sûrs d’une chose, c’est que dans le capitalisme stalino-syndical que nous vante Friot, il y aura nécessairement un État ! Qu’il nous affirme en même temps et de façon totalement contradictoire qu’ « il faut qu’une puissance publique impose qu’on ne fasse pas telle ou telle chose, ou au contraire promeuve telle ou telle chose » (sans nous dire qu’il s’agit d’une définition de l’État) et « je suis pour le dépérissement de l’État », n’est qu’une démonstration de plus du maquillage et de la falsification qu’il nous propose !
Se revendiquant du « Programme du Conseil National de la Résistance » porté notamment par le PCF, Friot considère que la Sécurité sociale est l’outil d’émancipation de la classe ouvrière. (2) Pour les révolutionnaires, la création de la Sécurité sociale n’a jamais rien eu de prolétarien, et 1945 est une année noire, de défaite idéologique totale, pour la classe ouvrière mondiale, et pas seulement française : le prolétariat est alors partout embrigadé dans la défense nationale, derrière l’État capitaliste et la bannière de l’antifascisme. La création de la Sécurité sociale a permis de réaliser un vieux rêve de la bourgeoisie française, contre lequel la classe ouvrière s’est longtemps battue, comme lors des grandes grèves du Creusot en janvier et mars 1870 : la mainmise de la bourgeoisie sur les caisses de secours ouvrier, la récupération par le Capital de la solidarité ouvrière à ses propres fins d’exploitation. (3)
C’est de cette période noire pour les exploités que Bernard Friot et Judith Bernard sont en fait nostalgiques, lorsque la classe ouvrière devait « retrousser ses manches », sous le talon de fer de la bourgeoisie et notamment du tandem PCF/CGT, trimait sans fin pour reconstruire l’économie nationale, pour le plus grand profit de la bourgeoisie toute entière et de l’impérialisme français, lequel allait donner sa mesure en Indochine, en Algérie et ailleurs(4). Tout leur livre n’est qu’une apologie du stalinisme, du totalitarisme étatique contre la classe ouvrière, une défense d’un capitalisme prétendu « social » contre la lutte de la classe ouvrière pour son émancipation de l’esclavage salarié et de la tutelle de l’État.
Toute l’histoire du mouvement ouvrier est une lutte constante pour une société sans classes ni exploitation, pour la disparition de l’économie de pénurie, de la loi de la valeur et pour la satisfaction des besoins humains. Ce que les auteurs nous proposent, c’est de remettre au goût du jour l’économie capitaliste étatisée telle que le stalinisme nous l’a toujours vantée. C’est non seulement la nostalgie de la pire période de la contre-révolution, mais aussi une falsification éhontée de ce qu’est le communisme : l’émancipation de la classe exploitée, la fin des frontières, des nations, des États, de l’économie de marché, de la loi de la valeur et du travail salarié, sous toutes leurs formes.
HD, 22 novembre 2021
1 Bernard Friot est membre du PCF et de la CGT se revendiquant également chrétien.
2 Sur la nature du Conseil National de la Résistance, lire : « Quelle est la véritable nature du conseil national de la résistance », Révolution internationale n°431, (avril 2012) [337].
3 Voir notre article « La bourgeoisie « fête » 60 ans de sécurité sociale en Belgique Belgique Belgique », Internationalisme n°319 [338].
4 Sur la politique menée par le tandem PCF/CGT à la fin de la Seconde Guerre mondiale, lire dans notre brochure Comment le PCF est passé au service du Capital : « Le PCF au gouvernement défend le capital national contre la classe ouvrière (1944-1947) » [339].
Courants politiques:
- Stalinisme [340]
Rubrique:
Pas de futur sans renversement du capitalisme
- 67 lectures
Une pandémie globale qui a tué des millions de personnes et qui est loin d’être terminée, une spirale de catastrophes climatiques (incendies, sécheresses, inondations) avec le dernier rapport du GIEC prédisant que le monde fait face à la véritable menace d’une accélération exponentielle du réchauffement climatique, des guerres depuis l’Afghanistan jusqu’à l’Afrique impliquant trois, quatre, voire cinq camps adverses et une aggravation des tensions impérialistes entre les deux plus grandes puissances impérialistes, les États-Unis et la Chine, une économie mondiale qui était déjà plongée dans une crise quasi permanente depuis la fin des années 1960 et qui subit désormais des convulsions encore plus sévères à cause de la pandémie et du confinement, entraînant l’augmentation de l’inflation ainsi qu’une combinaison apparemment paradoxale de chômage et de pénurie de main-d’œuvre. Rien d’étonnant à ce que les visions apocalyptiques se développent toujours plus, qu’elles s’expriment ouvertement dans des termes religieux à travers la montée des fondamentalismes : islamiques, chrétiens ou autres ; ou bien à travers un panel de visions dystopiques de science-fiction sur le futur de la Terre. À un certain niveau, de telles visions font partie de la montée en puissance du nihilisme et du désespoir ou bien expriment la vaine espérance de surmonter le découragement en retournant à un passé qui n’a jamais existé ou en s’échappant vers « un nouveau Ciel et une nouvelle Terre » (Révélation 21 :1), donnés aux croyants par des puissances extérieures à eux et à la nature. Mais ces idéologies sont également un miroir déformant reflétant ce qui est réellement en train de se passer dans la civilisation actuelle.
Dans le passé, les prophéties sur la « fin des temps » se répandaient avant tout dans les périodes de déclin d’un mode de production dans son ensemble comme durant la décadence de Rome ou le déclin du féodalisme au Moyen Âge. Le Livre de la Révélation, le dernier livre du Nouveau Testament, avec sa symbolique des quatre cavaliers de l’Apocalypse pointe en effet les caractéristiques essentielles d’une société en phase terminale : dirigés par la Mort, les trois autres cavaliers sont la Guerre, la Pestilence et la Famine (cette dernière portant une balance indiquant que le prix du pain est devenu prohibitif pour les pauvres). Durant leur longue agonie, la société antique esclavagiste et le féodalisme étaient en effet dévastés par d’incessantes guerres entre fractions de la classe dominante, par des épidémies comme la Peste Noire, la famine et (même si ces sociétés n’étaient pas marchandisées comme le capitalisme) par l’inflation et la dévaluation des monnaies . (1)
Il n’est pas difficile de voir que les quatre Cavaliers sont de retour en combinant leurs effets destructeurs. La guerre donne naissance à la famine comme au Yémen et en Éthiopie. La destruction de la nature fait surgir de nouvelles maladies comme la Covid et fait planer la menace de famine terribles et de guerres à cause de la raréfaction des ressources. Tous ces spectres sont une conséquence des contradictions sous-jacentes de l’accumulation capitaliste, intensifiant la crise économique globale jusqu’à un degré jamais atteint depuis les années 1930.
La « fin des temps » prévue dans les apocalypses antiques et médiévales signalaient véritablement la fin d’un mode de production particulier qui devait être remplacé par un nouveau mode de production, une nouvelle forme de domination de classe. Mais le capitalisme est la dernière société de classe et sa plongée tête baissée vers des abysses met l’humanité face à une seule alternative : révolution communiste ou destruction de l’humanité. Le capitalisme est le système le plus dynamique, le plus productif mais aussi le plus destructeur de l’histoire et avec son terrifiant arsenal nucléaire et son incapacité à enrayer la dévastation de l’environnement, il peut véritablement entraîner la fin du monde, de l’espèce humaine et peut-être même de la vie sur Terre.
Le capitalisme ne peut être contrôlé.
Certaines parties de la classe dominante se retranchent dans le déni : la Covid est juste une petite grippe (Bolsonaro), le changement climatique est un canular chinois (Trump). Les fractions les plus intelligentes de la bourgeoisie voient cependant le danger : d’où les énormes sommes sacrifiées dans les confinements et injectées dans la course aux vaccins ; d’où les nombreuses conférences internationales sur le changement climatique comme la COP 26 qui doit se dérouler à Glasgow en novembre et durant laquelle peu de participants contesteront ouvertement les funestes scénarios qui leurs seront présentés par le rapport du GIEC.
Au sein de la population en général, il y a une préoccupation croissante pour ces problèmes même si, pour le moment, le danger posé par la guerre et le militarisme a été éclipsé par la menace du Covid et du changement climatique. Mais les protestations effectuées par des organisations comme Extinction Rebellion, Insulate Britain et Youth for Climate sont une impasse, car elles ne vont jamais plus loin que demander aux gouvernements du monde de commencer à agir raisonnablement, de mettre de côté leurs différents et de présenter un plan global sérieux.
Or, les gouvernements, les États et la classe dominante sont eux-mêmes des expressions du système capitaliste et ils ne peuvent pas abolir les lois qui mènent à la guerre et à la destruction écologique. Comme à l’époque des Empereurs romains et des monarchies absolues, la décadence du capitalisme est également marquée par une grotesque hypertrophie de la machine d’État, dont le but est de soumettre les lois de la concurrence capitaliste à un certain niveau de contrôle (et aussi à réprimer tous ceux qui remettent en question sa domination). Finalement le capital ne peut être contrôlé. Par définition c’est un pouvoir qui, bien que créé par des mains humaines, se tient au-dessus des besoins humains et va à leur encontre. Par définition, c’est une relation sociale essentiellement anarchique qui ne peut s’épanouir qu’à travers la concurrence pour le plus haut profit. Les machines d’État que certains voient comme détenant la réponse aux problèmes du monde ont gonflé jusqu’à atteindre leur taille présente avant tout par le besoin de lutter contre les autres États sur le marché mondial, au niveau économique et militaire. Le capitalisme ne pourra jamais devenir une « communauté internationale » et dans la phase terminale de son déclin, la tendance vers la désintégration, le chacun pour soi et le chaos ne peuvent que se renforcer.
En 1919, la plateforme de l’Internationale communiste insistait sur le fait que la Guerre mondiale impérialiste de 1914-18 annonçait l’entrée du capitalisme dans « l’époque de désagrégation du capitalisme, de son effondrement intérieur. Époque de la révolution communiste du prolétariat ». Mais elle a également insisté sur le fait que « l’ancien “ordre” capitaliste n’est plus. Il ne peut plus exister. Le résultat final des procédés capitalistes de production est le chaos. Et ce chaos ne peut être vaincu que par la plus grande classe productrice, la classe ouvrière. C’est elle qui doit instituer l’ordre véritable, l’ordre communiste ».
L’apocalypse capitaliste n’est pas inévitable. La société bourgeoise a libéré les forces productives qui pourraient être transformées et mises au service de la réalisation du vieux rêve de l’humanité, celui d’une véritable communauté humaine et d’une nouvelle réconciliation avec la nature. Alors que les précédentes sociétés de classe sombraient dans des crises de sous-production, le capitalisme souffre d’une crise de surproduction, une absurdité qui met en évidence la possibilité de dépasser la pénurie et par conséquent d’éliminer une fois pour toutes l’exploitation d’une classe par une autre. En créant le prolétariat, il a créé la « force productive » qui a un intérêt matériel à la création d’une société sans classes.
Il existe un fossé immense entre l’état présent de la classe ouvrière qui a largement oublié sa propre existence comme force antagonique au capital et le mouvement de classe révolutionnaire qui a donné naissance à la révolution d’Octobre en 1917 et à l’Internationale communiste, l’expression politique la plus avancée de la vague révolutionnaire de 1917-23. L’unique façon de franchir ce fossé réside dans la capacité de la classe ouvrière de lutter pour la défense de ses propres intérêts matériels. En ce sens, de tous les cavaliers de la ruine capitaliste, c’est la crise économique et les attaques résultantes sur les conditions de vie et de travail des travailleurs qui contient la possibilité d’obliger le prolétariat de s’unir en défense de ses propres revendications de classe et de développer la perspective d’abattre son ennemi.
Amos, 9 octobre 2021
1 Voir la brochure La Décadence du Capitalisme [341], en particulier le chapitre II : « Crise et Décadence » [342].
Rubrique:
Migrants bloqués à la frontière bélarusse: De chaque côté des frontières, le cynisme de la bourgeoisie n’a aucune limite!
- 60 lectures
Des milliers de migrants coincés depuis plusieurs semaines à la frontière polonaise, abandonnés à leur sort dans des forêts humides et gelées, sans eau ni nourriture. Des familles errant au milieu de nulle part, contraintes de boire l’eau des marécages alentours, de dormir à même le sol par des températures négatives. Des exilés épuisés, souvent malades, tabassés par les troufions de l’armée bélarusse qui les ont conduits sciemment aux frontières de l’Union européenne (UE). Des autorités polonaises hystériques qui n’hésitent pas à renvoyer femmes, enfants, handicapés et vieillards dans les bois et à cogner ceux qui cherchent à traverser clandestinement les murs de barbelés déployés tout au long de la frontière. Ce triste spectacle en rappelle malheureusement bien d’autres, tout aussi révoltants. Mais l’instrumentalisation des migrants à des fins ouvertement impérialistes ajoute à cet affligeant tableau, la couleur du cynisme le plus ignoble.
Otages de sordides rivalités impérialistes
La présence soudaine de migrants dans cette région hostile, route rarement empruntée par les réfugiés, n’a rien de fortuite : le dictateur bélarusse, Alexandre Loukachenko, en conflit ouvert avec l’UE depuis sa réélection contestée d’août 2020, a favorisé, voire organisé l’acheminement de migrants en leur faisant miroiter une illusoire porte de sortie vers l’Europe, et les a jetés sur la frontière polonaise. Des charters seraient même affrétés par Minsk pour transporter les candidats à l’exil.
Pour Loukachenko et sa clique, les migrants ne sont qu’une monnaie d’échange contre les sanctions et les pressions occidentales. D’ailleurs, les négociations à peine débutées avec l’UE et la Russie, le gouvernement bélarusse renvoyait, en guise de « bonne foi », quelques centaines de migrants à la case départ, sur la base du « volontariat » (quel euphémisme !). Tant pis pour les morts ! Tant pis pour les traumatismes ! Tant pis pour les espoirs déçus !
L’utilisation des réfugiés dans le cadre des rivalités impérialistes se développe de façon spectaculaire ces dernières années, profitant d’un contexte où les États les plus riches se sont transformés en véritables forteresses et se vautrent chaque jour davantage dans les discours les plus xénophobes. On a ainsi pu récemment voir la Turquie menacer d’ouvrir les vannes de l’émigration à la frontière grecque, ou encore le Maroc à la frontière espagnole, jouant à chaque fois le « chantage migratoire » au nom de la défense de leurs sordides intérêts nationaux. Même la France, dans le cadre des tensions post-Brexit, suggère, plus ou moins subtilement, qu’elle pourrait laisser le Royaume-Uni se débrouiller seul avec les migrants calaisiens. Il est aussi probable que derrière les réfugiés bélarusse, la Russie de Poutine avance ses pions.
L’hypocrisie et la cruauté des États « démocratiques »
« Les Polonais rendent un service très important à l’ensemble de l’Europe », affirmait Horst Seehofer, le ministre allemand de l’Intérieur. Et quel service ! La Pologne et son gouvernement populiste n’ont pas hésité à déployer des milliers de soldats à la frontière et à menacer explicitement les réfugiés : « Si vous traversez cette frontière, nous emploierons la force. Nous n’hésiterons pas ».(1) Au moins, le message est clair et les intimidations ont été administrées avec zèle : jets de gaz lacrymogène sur des personnes affamées et exténuées, passages à tabac réguliers, aucun soin apporté aux malades…
L’UE, qui se prétend si intransigeante avec le « respect de la dignité humaine », a également fermé les yeux quand la Pologne s’est arrogée, le 14 octobre, au mépris des « conventions internationales », le « droit » de refouler systématiquement les migrants vers la Biélorussie sans vérifier si les demandes d’asile étaient valables, même selon les règles étroites de la légalité bourgeoise. La bourgeoisie s’est ainsi dotée d’un arsenal réglementaire et juridique totalement défavorable aux migrants et elle n’hésite pas à tricher avec ses propres règles quand le besoin s’en fait sentir !
Il en va de même pour les murs dressés contre les migrants. Quand le Royaume-Uni voulait rétablir une frontière en Irlande du Nord, la bourgeoisie s’est offusquée d’une telle hardiesse « menaçant la paix » et « rappelant les pires heures de la guerre froide ». Quand la Lituanie et la Pologne décident de dresser des murs de barbelés sur des milliers de kilomètres, cela s’appelle « protéger les frontières européennes » et « rendre un service très important »…
Le gouvernement populiste de Pologne, après avoir été copieusement conspué pour ses mesures anti-avortement et ses déclarations eurosceptiques, se trouve tout à coup porté aux nues. Cette crise est une véritable aubaine pour redorer le blason polonais auprès de ses « partenaires européens ». En clair, si l’État polonais rend un si grand « service », c’est parce qu’il fait, sans rechigner, le sale boulot des autres États de l’UE.
Rappelons que les « grandes démocraties » européennes, quand elles ne parquent pas elles-mêmes les demandeurs d’asile dans des camps de concentration abjects, comme celui de Moria en Grèce, sous-traitent la « gestion des flux migratoires » à des régimes bien connus pour leur « respect de la dignité humaine » : la Turquie, le Liban, le Maroc ou la Libye, où sévissent encore les négriers de la pire espèce sous l’œil bienveillant (et le porte-monnaie) de l’Union européenne ! Outre-Atlantique, le Président Biden, qui devait prétendument rompre avec l’immonde politique migratoire de son prédécesseur, se révèle tout aussi brutal : son administration « évacue » depuis le mois de septembre des milliers de migrants vers l’enfer haïtien, près de 14 000 selon les médias américains.
Les États « démocratiques » pourront toujours se présenter comme les garants de la « dignité humaine », la réalité montre bien qu’ils n’attachent pas plus d’importance à cette dernière que les régimes plus « autoritaires ». Pour les uns comme pour les autres, seuls comptent leurs froids intérêts dans l’arène impérialiste.
Le « droit d’asile » : une arme pour dresser des murs contre les migrants
Il revient aux partis de la gauche du capital, des écologistes aux trotskistes, de brandir tout aussi hypocritement un semblant d’indignation. On a ainsi pu voir en Pologne et dans d’autres pays européens de petites manifestations, encadrées par les gauchistes, réclamer l’application du « droit international » et l’accueil des réfugiés au nom du « droit d’asile ».
Pourtant, le droit bourgeois, avec ses conventions internationales et ses « droits de l’homme », s’accommode très bien des barrières physiques et réglementaires inhumaines dressées contre les migrants : le « droit d’asile » est appliqué au compte-goutte selon des critères ultra-sélectifs et face aux exactions de la Pologne, en effet incompatibles avec la convention de Genève, il suffit aux États européens de détourner pudiquement le regard.
En « luttant pour l’application des droits des réfugiés », les ONG et les associations gauchistes abandonnent, de fait, les migrants aux fourches caudines de l’administration, les exposent au flicage permanent et au mur tout aussi infranchissable de la bureaucratie. Il n’y a rien à espérer du droit bourgeois qui n’exprime que les sinistres intérêts de la classe dominante et sa barbarie. Les « centres de tri », les gardes-côtes repoussants les fragiles embarcations des migrants (comme le fait Frontex), les innombrables murs, les subventions à des pays tortionnaires, tout cela existe dans le strict respect du « droit ».
La seule réponse à apporter aux crimes de la bourgeoisie envers les migrants, c’est la solidarité internationale des prolétaires. C’est la méthode qu’a toujours défendue le mouvement ouvrier : quand l’Association internationale des travailleurs fut fondée en 1864, elle devait déjà s’opposer aux discours accusant les immigrés de faire baisser les salaires. Face à ce réflexe nationaliste, elle affirmait au contraire « que l’émancipation du travail, n’étant un problème ni local ni national, mais social, embrasse tous les pays dans lesquels existe la société moderne ». Hier comme aujourd’hui, ce ne sont pas les migrants qui portent les attaques contre nos conditions de vie, mais bien le capital.
EG, 21 novembre 2021
1« Faute de politique d’accueil commune, l’Europe déstabilisée par la Biélorussie », Mediapart (11 novembre 2021).
Récent et en cours:
- Migrants [343]
- Immigration [344]
Rubrique:
Naufrage des réfugiés dans la Manche: L’assassin, c’est le capitalisme!
- 37 lectures
Mercredi 24 novembre, 27 réfugiés perdaient la vie dans un naufrage au large de Calais. Cette tragédie qui révulse une fois encore le monde n’est malheureusement pas une nouveauté puisque depuis le début des années 2000, plus de 700 personnes ont trouvé la mort rien que dans la Manche !
Partout dans le monde, des populations fuient la pauvreté, la misère, le chaos guerrier, la violence des gangs, le désastre climatique. Des zones entières du globe tendent à devenir totalement exsangues, réduisant l’existence à un véritable calvaire. Si ce phénomène avait connu un pic sans précédent en 2015, il retrouve aujourd’hui une nouvelle ampleur avec la pandémie et ses conséquences économiques et sociale désastreuses. Et ce malgré le blindage renforcé des frontières et la répression farouche à laquelle les migrants doivent faire face, à l’image des réfugiés massés comme des misérables et persécutés à la frontière polonaise depuis plusieurs semaines. Mais ces hécatombes ont lieu partout, sur terre comme sur mer. Après les accords du Touquet, entrés en vigueur le premier février 2004 entre la Grande-Bretagne et la France, les mesures coercitives, avec leur lot de maltraitance, sont devenues de plus en plus brutales et systématiques. Tout le monde à encore en mémoire la sauvagerie dont avait fait preuve la police française lors du démantèlement de la « jungle » à Calais dans la nuit du 24 au 25 octobre 2016. Partout, les seuls « moyens » des États bourgeois pour « régler la question migratoire » se résument aux violences policières, à une répression terrible, et une surveillance orwellienne menant les réfugiés à prendre de plus en plus de risques, voyageant à tombeaux ouverts. À l’indécence de la joute politicienne entre Boris Johnson et Emmanuel Macron suite à l’annonce du tragique naufrage, est venu s’ajouter le cynisme avec des déclarations comme celle du ministre Darmanin qui d’emblée dédouane à bon compte les États de l’UE et sa propre politique répressive visant à militariser les côtes et les frontières. Tout cela, en faisant porter la responsabilité sur le seul dos des passeurs : « les premiers responsables de cette ignoble situation sont les passeurs » nous dit Darmanin. Nous avons eu des mots similaires de la part de Johnson qui a parlé des gangs « qui s'en sortent littéralement avec un meurtre ».
Quel cynisme ! Si les passeurs sont effectivement des crapules sans foi ni loi qui exploitent la misère humaine, les politiciens des grandes démocraties n’en sont pas moins les principaux criminels. Ce sont eux et leurs politiques ignobles qui justement font émerger et prospérer les passeurs du fait des difficultés accrues pour tous les migrants criminalisés. En réalité, la bourgeoisie cherche à trouver des boucs-émissaires pour tenter de dédouaner sa politique inhumaine et barbare. Elle se sert ainsi des passeurs comme « cache-sexe » pour dédouaner le vrai responsable : le système capitaliste ! Alors qu’il y a peu, les feux des médias étaient braqués sur l’ineffable président Biélorusse Lukatchenko (comme s’il était le seul à instrumentaliser et à martyriser les réfugiés !), cette fois ce sont les passeurs qui servent d’alibis bien commodes !
Ce que ne peuvent dire tous les politiciens et leur système capitaliste nécrophage, c’est que leur pratique est dictée par la défense de la propriété privée et les seuls intérêts des exploiteurs, de la nation qu’ils gouvernent pour le compte du capital national. Parmi tous les crèves-la-faim, seule une main d’œuvre rentable, qualifiée et corvéable est acceptable pour le capital. Tous les autres doivent être refoulés par la dissuasion, les barrières administratives ou physiques, et, de plus en plus, par la brutale force des armes. Une implacable loi du capital qui ne peut exercer ses « ouvertures aux frontières » qu’en fonction d’un seul critère : l’exploitation et le profit ! Les cadavres sur les plages sont, à leurs yeux, le simple prix à payer…
WH, 29 novembre 2021
Géographique:
- France [336]
- Grande-Bretagne [47]
Récent et en cours:
- Immigration [344]
- Migrants [343]
- Crise migratoire [345]
Rubrique:
ICCOnline - décembre 2021
- 41 lectures
Destruction d’un satellite russe: l’espace-poubelle est un enjeu impérialiste croissant
- 57 lectures
Comme l’a écrit le quotidien Libération, c’est à un véritable scénario digne d’un film de science-fiction auquel nous avons assisté : sans aucun avertissement, la Russie a envoyé un missile détruire l’un de ses propres satellites hors d’usage à 400 km d’altitude. En générant un nuage de milliers de débris (dont quatorze très gros), elle a provoqué un début de panique dans la station spatiale internationale, qui a failli se transformer en « dommage collatéral » : située sur la même orbite basse, elle aurait pu être touchée par un débris, et il aurait alors fallu l’évacuer d’urgence, ce à quoi l’équipage s’est immédiatement préparé.
Il a fallu deux jours pour que l’État russe reconnaisse être l’auteur du tir ; comme lors de la guerre froide, on s’est alors retrouvé dans l’ambiance mortifère des « expériences » secrètes, reconnues du bout des lèvres par leurs auteurs pour cause de « secret d’État ». (1) Il faut dire que la destruction d’un satellite en vol, fût-il hors d’usage, fait entrer la Russie dans le club fermé des États capables d’atteindre directement les satellites de leurs ennemis : Chine, Inde, États-Unis. L’Europe et notamment la France n’ont pas encore démontré leur « capacité » à faire de même. Cela fait donc plusieurs fois que des satellites sont transformés en confettis mortels sur des orbites où ils sont dangereux, ce qui constitue une démonstration de plus de l’irresponsabilité totale de la bourgeoisie dès lors qu’il s’agit de défendre bec et ongles ses intérêts impérialistes nationaux. La reconnaissance de cette « expérience » par la Russie a aussitôt été suivie d’une hypocrite dénonciation par les autres « puissances spatiales », conspuant son mépris total des conséquences, notamment vis-à-vis de la station spatiale internationale où, pourtant, se trouvaient deux Russes… La bourgeoisie a, d’ailleurs, transformé l’espace en véritable poubelle dans lequel les débris orbitent par millions autour de la Terre, mettant également en péril les astronautes.
Comme nous l’avons déjà écrit, cela fait longtemps que l’espace fait partie intégrante du champs de bataille impérialiste entre grandes puissances ou aspirant à le devenir, depuis longtemps. Il est même indispensable pour tout pays voulant protéger ses intérêts d’être capable de défendre ses intérêts spatiaux. Comme l’écrit le journal Le Monde, « le tir antisatellite russe démontre que l’espace est en train de devenir un champ de conflictualité comme un autre ». (2) Car ce n’est pas une première : la Chine, l’Inde, les États-Unis ont déjà affirmé leur capacité à défendre leurs intérêts militaires jusque dans l’espace en détruisant un satellite (à chaque fois un des leurs hors d’usage), et soyons confiants dans la volonté des autres bourgeoisies nationales de faire de même dès qu’elles en auront les moyens techniques et financiers. Derrière la présentation des « héros » spatiaux, comme Thomas Pesquet en France, et l’objectif affiché par les Etats-Unis d’envoyer des hommes sur la Lune, voire sur Mars, se cachent, comme pendant la guerre froide, les féroces appétits de tous ces gangsters impérialistes. La militarisation de l’espace a déjà une longue histoire, et on ne peut que sourire devant les cris d’orfraie des officiels américains, du général James Dickinson, chef de l’US Space Command, qui nous dit que « la Russie a fait preuve d’un mépris délibéré pour la sécurité, la sûreté, la stabilité et la durabilité à long terme du domaine spatial pour toutes les nations », (3) au porte-parole du Département d’État américain, qui a qualifié cet essai de « dangereux et irresponsable », alors même que les États-Unis ont par deux fois déjà procédé à la même expérience ! Quant à la ministre française de la Défense, Florence Parly, qui a publié un message sur Twitter nous affirmant que « l’Espace est un bien commun […]. Les saccageurs de l’Espace ont une responsabilité accablante en générant des débris qui polluent et mettent nos astronautes et satellites en danger » (4) elle n’a évidemment pas mentionné que, le même jour, par coïncidence, la France lançait depuis Kourou trois satellites-espion baptisés Ceres, capables de faire du « renseignement d’origine électromagnétique » et d’affranchir l’armée française d’une pesante tutelle américaine en matière d’espionnage électronique.
Le fait d’envisager d’ores et déjà de s’emparer de portions de la Lune ou de Mars, ou d’astéroïdes géologiquement riches, au-delà de la possibilité (et de la rentabilité !) de le faire réellement, montre le rêve de tous ces capitalistes endurcis : mettre la main sur de plus en plus de ressources, de territoires, de moyens de peser sur leurs rivaux, voire de les menacer ouvertement !
Il ne suffit pas à ces bourgeois rapaces d’avoir transformé le monde en champs clos de la concurrence, du chacun contre tous : pour paraphraser un célèbre film d’espionnage, le monde ne suffit plus ! La barbarie rejoint et rejoindra le moindre espace sur Terre, mais aussi dans l’espace, partout où le système capitaliste décadent impose les lois barbares de la concurrence et du profit !
HD, 29 novembre 2021
1 En complément, nous invitons nos lecteurs à lire ou relire : « Nouvelle course à l’espace: un champ de bataille impérialiste pour le capitalisme [346] », disponible sur notre site internet.
2 « Le tir antisatellite russe démontre que l’espace est en train de devenir un champ de conflictualité comme un autre », Le Monde (17 novembre 2021).
3 « En détruisant l’un de ses satellites, la Russie ajoute de la tension dans l’espace », Le Monde (16 novembre 2021).
4 « L’ISS prise dans un nuage de débris : Moscou reconnaît sa responsabilité », Libération (16 novembre 2021).
Récent et en cours:
- Course à l'espace [44]
Rubrique:
Permanence en ligne du CCI sur le féminisme
- 183 lectures
Le CCI anime avec les sympathisants et les lecteurs intéressés, des réunions publiques des permanences et des réunions d’approfondissement de caractère international en anglais, français et espagnol. Il s’agit de lieux de débat qui ont pour objectif de clarifier des questions d’intérêt pour la lutte immédiate et historique du prolétariat.
Les réunions publiques partent d’une prise de position du CCI sur la situation historique et sur des problèmes généraux du mouvement ouvrier.
En revanche, les permanences abordent des thèmes proposés par nos sympathisants et nos contacts.
Plusieurs lecteurs avaient demandé à discuter des luttes parcellaires. Notre plateforme considère comme « luttes parcellaires », celles centrées « sur des problèmes parcellaires tels le racisme, la condition féminine, la pollution, la sexualité et autres aspects de la vie quotidienne ».
Ce type de luttes tant en vogue aujourd’hui ne sert pas la lutte révolutionnaire du prolétariat, bien au contraire, comme le dénonce notre plateforme : « loin de renforcer la nécessaire autonomie de la classe ouvrière, [elles] tendent au contraire à la diluer dans la confusion de catégories particulières ou invertébrées (races, sexes, jeunes, etc.) totalement impuissantes devant l’histoire. En cela, elles constituent un instrument de la contre-révolution que les gouvernements bourgeois ont appris à utiliser efficacement pour préserver l’ordre social ».
Afin de ne pas se disperser dans des thématiques multiples, la permanence propose d’aborder une de ces luttes parcellaires, le féminisme qui, dans de nombreux pays, s’est converti en une idéologie d’État. Partant d’une présentation (voir la pièce jointe) il y eut un débat vivant durant lequel les participants ont fait un effort pour se répondre mutuellement en donnant des éléments d’approfondissement de la thématique et en partant du point de vue de la solidarité prolétarienne.
Cependant, il y eut peu de références aux expériences de lutte du mouvement ouvrier pour la condition de la femme ouvrière et sa dénonciation historique du féminisme qui fut dès le début une idéologie bourgeoise.
Le combat du mouvement ouvrier contre l’oppression de la femme
Bien avant que les féministes ne fassent « leur critique » du machisme, le mouvement ouvrier avait dénoncé dès ses débuts ce dernier et les conditions de l’oppression de la femme ouvrière.
Engels dans son livre L’Origine de la Propriété Privée de la Famille et l’État explique comment la fin du communisme primitif, le développement de la propriété privée et des modes de production basés sur l’exploitation entraîne inévitablement l’oppression de la femme, sa soumission à l’homme pour garantir la continuité de la propriété privée et de la lignée familiale. Engels parle de la « première défaite historique de la femme ».
Les premiers pas du capitalisme, l’accumulation primitive, qui s’étend depuis le XVe siècle, s’est vu accompagnée d’une brutale campagne idéologique contre la femme, accusée de sorcellerie et d’être, par la tentation de la chair qu’elle génère « porteuse du démon ». Une enveloppe religieuse qui s’applique tant au catholicisme qu’au protestantisme, pour faire des femmes de simples machines reproductrices qui fourniront les réserves de force de travail pour le développement capitaliste.
La perspective du mouvement ouvrier fût de voir le problème de la femme, non comme une oppression partielle et spécifique, mais plutôt comme un composant inséparable de la lutte contre l’exploitation avec comme fin ultime l’abolition de l’exploitation et de toutes les oppressions qui émanent de la société de classe et que le capitalisme a poussées à l’extrême. Dans le mouvement ouvrier, l’approche et la lutte commune des ouvriers, femmes et des hommes.
En revanche, la perspective féministe a été depuis le début orientée vers la lutte de revendiquer une position spécifique de la femme au sein de la société capitaliste, pour l’obtention de privilèges dont l’homme jouit dans les entreprises ou dans les institutions étatiques.
Le féminisme ne demande aucune libération, même pas de la femme sinon qu’il plaide en faveur d’une démocratisation de l’ascension pour les pouvoirs économiques et politiques, son orientation étant la concurrence entre hommes et femmes, une « lutte des sexes ».
Ainsi, alors que la perspective du mouvement ouvrier est révolutionnaire, émancipatrice et unitaire, la conception du féminisme est réactionnaire, reproductrice de l’oppression et créatrice de divisions et de concurrence.
Le féminisme remplace la lutte des classes par la « lutte des sexes » ; à l’unité et à la perspective de libération universelle, elle oppose la division homme/femme et l’enfermement dans la catégorie « femme ».
Durant la réunion s’est exprimée une nécessité d’approfondir le thème de la condition historique et actuelle des femmes ouvrières (c’est-à-dire de discuter sur les apports du marxisme et au-delà de Friedrich Engels, les œuvres et les luttes d’August Bebel, Eleonora Marx, Clara Zetkin, Alexandra Kollontaï et Sylvia Pankhurst ainsi que des expériences des luttes de l’après-guerre en Europe et aux États-Unis, que les luttes féministes nient ou déforment. La “lutte” féministe n’a rien à voir avec la lutte revendicative.
Ne pouvant assister à la réunion, un camarade a envoyé la contribution suivante qui s’est inscrite dans le débat : « la vie sociale comporte des luttes sur divers aspects : le travail, l’habitat, la sexualité, l’écologie, l’identité, etc. Ces luttes doivent s’intégrer dans le projet global socialiste sous peine d’être récupérées par la bourgeoisie dans un contexte interclassiste.
Fréquemment, on envisage la difficile situation de participer à un mouvement revendicatif mais sans s’y intégrer totalement puisque le faire suppose une approche interclassiste qui est négative pour la marche vers le socialisme.
Pour cela, nous devons être particulièrement critiques envers tous les appels à des « fronts unis » et nous devons assumer la tâche de démontrer que la lutte partielle mène à la lutte globale de formation d’une société, d’une nouvelle société dans une démocratie prolétarienne, Salutations ».
Bien que le camarade ait raison de dénoncer l’interclassisme des luttes parcellaires et de condamner l’idéologie de « Front Uni »(1), il y a deux points de son intervention qu’il faut éclaircir :
– Il parle de récupération par la bourgeoisie. le problème est que ces luttes sont bourgeoises de bout en bout, car elles nient fondamentalement la division en classes de la société, parce qu’elles atomisent les exploités en catégories sociales qui reproduisent depuis la racine la société capitaliste et son idéologie castratrice, parce qu’elles ont comme objectif de diviser le prolétariat et de semer la zizanie de la concurrence et de l’affrontement.
– Les luttes parcellaires n’ont rien à voir avec la lutte revendicative du prolétariat. Cette dernière fait partie de sa lutte historique globale. Bien que les syndicats et les gauchistes s’efforcent de la rendre stérile en la réduisant à une vision économiste, la lutte revendicative contre l’exploitation est inséparable de la lutte historique pour abolir l’exploitation.
La réponse historique du prolétariat aux multiples oppressions et barbaries du capitalisme
Un autre camarade a beaucoup animé la discussion, disant qu’il avait rompu avec l’idéologie et le milieu politique des luttes parcellaires de genre. A différents niveaux, il a été d’accord avec la position générale du CCI quant au fait que l’unique solution au machisme et autres héritages de la société de classe est la révolution prolétarienne. Sa question était la suivante : « comment répondre à des situations concrètes d’oppression de la femme dans certains pays » ? Par exemple, il se demandait : « comment convaincre une femme ouvrière d’un pays musulman que seule la lutte ouvrière pourra la libérer si, dans d’autres pays capitalistes, il y a bien des avancées sur ce sujet (aujourd’hui en Europe le sexe avant le mariage est largement accepté) ? »
Le prolétariat est une classe révolutionnaire et exploitée à la fois. Il ne peut développer aucune forme de libération parcellaire au sein de la société capitaliste. Sa révolution est tout d’abord politique et consiste en la destruction de l’État capitaliste dans tous les pays et le développement du pouvoir mondial des conseils ouvriers, ouvrant ainsi la période de transition du capitalisme vers le communisme. Durant cette période, il extirpera pas à pas les racines de l’exploitation capitaliste et, de cette manière, éliminera l’interminable montagne d’oppressions que le capitalisme traîne avec lui et depuis plusieurs millénaires les sociétés de classes.
Est-ce que cela veut dire que jusqu’à cette période historique, on devrait rester indifférents aux souffrances brutales que le capitalisme en décomposition cause à toute la population mondiale et dans toutes les sphères de la vie sociale ? Que pourrait faire le prolétariat contre la sauvagerie et la cruauté avec laquelle les régimes islamiques traitent les femmes ?
Nous ne nous faisons pas d’illusions, nous savons que, dans le rapport de forces actuel entre les classes qui existe à l’échelle mondiale, le prolétariat ne possède pas la force suffisante pour contrer directement cette barbarie. Mais cela ne signifie pas pour autant que, comme classe historique, il reste les bras croisés.
En premier lieu, « La lutte contre les fondements économiques du système contient la lutte contre les aspects superstructurels (forme de vie, coutumes, idéologie…) » (Point 12 de notre Plateforme) et « les attaques économiques (baisse du salaire réel, licenciements, augmentation des cadences, etc.) résultant directement de la crise affectent de façon spécifique le prolétariat (c’est-à-dire la classe produisant la plus-value et s’affrontant au capital sur ce terrain) ; la crise économique, contrairement à la décomposition sociale qui concerne essentiellement les superstructures, est un phénomène qui affecte directement l’infrastructure de la société sur laquelle reposent ces superstructures ; en ce sens, elle met à nu les causes ultimes de l’ensemble de la barbarie qui s’abat sur la société, permettant ainsi au prolétariat de prendre conscience de la nécessité de changer radicalement de système, et non de tenter d’en améliorer certains aspects. »(2)
En second lieu, lorsque le prolétariat réussit à affirmer son propre terrain de classe indépendant, son autonomie de classe et à développer la confiance en sa lutte comme classe, il détient la capacité, en rompant avec toute vision interclassiste et de front uni, d’exprimer sa solidarité avec les luttes des secteurs exploités et opprimés et de donner du sens et de la force à la lutte contre les barbaries comme la guerre impérialiste qui affecte toutes les couches de la société. Sur ce terrain et dans ce genre de conditions, il peut donner les moyens pour impulser la rébellion active contre toutes les barbaries de cette société de classe : contre l’oppression des femmes, contre la discrimination des minorités, etc.
Enfin, et ce n’est pas le point le moins important, la lutte idéologique du prolétariat exprimée fondamentalement par ses organisations communistes dénonce de manière implacable toutes les formes d’oppression et de barbarie capitaliste en leur opposant la réponse historique du prolétariat contre la réponse partielle et trompeuse des féminismes, écologismes, « anti-racismes » et autres « -ismes » réactionnaires.
D’autre part, la discussion de la permanence a mis en évidence que, même dans les pays dits démocratiques (Espagne, Brésil, États-Unis, etc), il n’existe pas réellement d’égalité entre hommes et femmes. Elle existe juste dans les champs légaux formels car, dans la pratique, ce qui se produit est la violence, l’inégalité avec des taux élevés de féminicides et d’inégalités salariales. Par conséquent, même dans ces pays capitalistes, cette « égalité » proclamée n’existe pas et pire encore, l’égalité que propose le féminisme est « l’égalité » pour la concurrence, la guerre de tous contre tous, l’affrontement et la destruction mutuelle. C’est donc une égalité dans la reproduction de la barbarie croissante du capitalisme.
Comme l’a expliqué un participant, « la libération de la femme » sous le capitalisme n’est rien de plus qu’une liberté formelle pour monter les échelons dans l’entreprise (quelle libération pour l’humanité si l’oppression qu’exerce un président de la République ou au sein d’une entreprise est prise en charge par une femme ?), pour tuer des gens en occupant des postes dans les hautes hiérarchies des armées, pour être des contremaîtres ou des petites cheffes dans les entreprises, etc. L’exploitation ne disparaît pas mais s’aggrave si elle est multicolore ou multisexuelle.
Même s’il est vrai que le prolétariat féminin supporte une double charge d’exploitation dans le travail et l’oppression machiste, comme l’a expliqué une camarade, cela ne se résout pas dans la lutte des sexes ou en culpabilisant le mari ou le compagnon.
Le mouvement ouvrier inscrit sur son drapeau le combat contre le machisme. Par exemple, la Gauche communiste a comme principe le rejet et le combat contre toute forme d’oppression et de violence contre les femmes et les autres camarades qui ont une orientation sexuelle différente. Tout cela n’a rien à voir avec l’hypocrite idéologie démocratique et s’inscrit dans la nature révolutionnaire émancipatrice des principes prolétariens.
CCI, 24 novembre 2021
Textes publiés par le CCI sur l’oppression des femmes :
La transformación de las relaciones sociales según los revolucionarios de finales del siglo XIX [347]
Huelga feminista : contra las mujeres y contra la clase obrera [94]
El feminismo al servicio del capitalismo [350]
La condition de la femme au XXIe siècle. [351]
Vie du CCI:
- Permanences [291]
Récent et en cours:
- feminisme [353]
Rubrique:
La crise de Covid démontre l’impasse du capitalisme
- 88 lectures
L’été dernier, la bourgeoisie a propagé une énorme campagne de propagande autour du thème : « nous n’avons plus besoin de nous inquiéter, nous avons les vaccins ». Le président américain, Joe Biden, a ainsi déclaré qu’il ne craignait pas que le variant Delta provoque une nouvelle épidémie majeure de Covid-19 à l’échelle nationale (2 juillet 2021). Le directeur exécutif de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), Mike Ryan, a déclaré que le pire de la crise du Covid était passé (12 juillet 2021). Ils ont été soutenus par Boris Johnson, Premier ministre du Royaume-Uni, qui a déclaré : « presque tous les scientifiques sont d’accord sur ce point : le pire de la pandémie est derrière nous » (15 juillet 2021). (1)
Toutes les données sur le nombre de décès et de nouveaux cas quotidiens au cours des derniers mois ont contredit ces déclarations et confirmé que la pandémie n’est pas du tout derrière nous. Les mesures et les recommandations quotidiennes de la bourgeoisie montrent que la pandémie a toujours un impact énorme sur la société et l’économie : secteurs de santé inondés de nouveaux patients, mesures coercitives contre ceux qui refusent de se faire vacciner, nouveaux confinement avec la fermeture d’activités commerciales, d’écoles et de lieux de divertissement.
Pour la majorité de la population mondiale, la crise sanitaire est loin d’être terminée. Elle est encore gravement menacée par les effets du virus à tous les niveaux, en particulier pour ceux qui n’ont reçu qu’une seule dose du vaccin, voire aucune, comme on peut le voir au Japon ou en Australie. Dans certains des principaux pays asiatiques, en particulier, les politiques relativement efficaces d’endiguement du coronavirus en 2020 ont créé l’illusion que le virus était plus ou moins sous contrôle, si bien que le taux de vaccination y est resté plutôt faible.
La lutte frénétique et chaotique pour les vaccins
Les scientifiques s’accordent à dire que la vaccination est le principal rempart contre la propagation du virus. Mais la bourgeoisie est incapable de développer une politique unifiée pour vacciner la population mondiale et contrôler globalement la pandémie. Il n’y a pas de concertation au niveau international qui permettrait l’augmentation nécessaire de la production du vaccin. Au lieu de cela, tous les pays se sont lancés dans une course aux vaccins, les pays les plus riches accumulant des stocks dans le but d’être les premiers à obtenir une immunité de groupe.
Les données de l’OMS de novembre ont révélé que les pays du G20 ont reçu plus de 80 % des vaccins contre le Covid-19, tandis que les pays à faible revenu n’en ont reçu que 0,6 %.(2) Face à cette tendance, le Secrétaire général de l’ONU, António Guterres, a déjà lancé un avertissement contre « le nationalisme et l’accumulation des vaccins [qui] nous mettent tous en danger. Cela signifie plus de décès. Plus de systèmes de santé anéantis. Plus de misère économique ».(3) Chaque État adopte sa propre stratégie et seuls les États les plus puissants ont les moyens de faire face à la pandémie. En cherchant à garantir la vaccination de leurs populations respectives, certains d’entre eux ont privilégié la signature d’accords avec des entreprises pharmaceutiques, voire ont déboursé de l’argent pour précommander des candidats vaccins prometteurs. Cette politique a entraîné d’énormes disparités dans la distribution des vaccins, même au sein de l’Union européenne (UE). Certains pays de l’UE ont même dû s’orienter vers le vaccin russe Sputnik V (Hongrie, Slovaquie), moins efficace, ou le vaccin chinois Sinopharm (Hongrie).
La plupart des nations riches sont coupables d’une accumulation sans scrupules de vaccins. Airfinity, une société d’analyse basée à Londres, prévoit que d’ici la fin de l’année, l’excédent de vaccins aura atteint 1,2 milliard de doses. Si 600 millions de ces doses excédentaires doivent être données à d’autres pays, il reste 600 millions de doses inutilisées dans les stocks, dont près de la moitié aux États-Unis et le reste dans les autres pays riches. (4) Cette politique d’accumulation a déjà entraîné le gaspillage de millions de vaccins.
L’accumulation de vaccins est l’une des raisons des disparités dans la distribution, mais un autre problème important est le coût énorme des vaccins pour les pays pauvres. Les producteurs pharmaceutiques ne pratiquent pas de prix standard mais varient leurs prix en fonction de la quantité achetée. Ils pratiquent des prix plus élevés lorsque la quantité est plus faible. Par exemple, alors que les États-Unis ont payé 15 millions de dollars pour 1 million de doses du vaccin Moderna, le Botswana a dû payer près de deux fois plus, presque 29 millions de dollars.
La distribution inégale des vaccins et le retard qui en résulte dans la vaccination au niveau mondial, compromet chaque stratégie nationale de vaccination. Une politique qui favorise les vaccinations dans les pays riches, et n’empêche pas la propagation de la pandémie dans les pays pauvres, court le risque d’un retour du virus dans les pays les plus puissants, avec également la possibilité de voir émerger des variants résistantes au vaccin. Le « chacun pour soi » au niveau mondial est un puissant accélérateur de la propagation des variants Delta et Omicron et de tous les nouveaux variants à venir.
Un patchwork de mesures incohérentes et contradictoires
Dans sa lutte contre le Covid-19, chaque bourgeoisie est constamment contrainte de donner la priorité à l’économie tout en maintenant un minimum de cohésion sociale, prenant délibérément le risque que les travailleurs tombent malades plus longtemps ou même meurent à cause du virus. Cette situation conduit à un patchwork de recommandations et de mesures incohérentes et contradictoires à travers le monde, et même entre les régions d’un même pays. Quelques exemples :
– Pas de consensus entre les organismes de santé. Le Centre de contrôle et de prévention des maladies (CDC) des États-Unis a annoncé le 13 mai 2021 que les personnes entièrement vaccinées, qui se trouvent à deux semaines de leur dernière injection, peuvent désormais se déplacer sans masque à l’extérieur et dans la plupart des environnements intérieurs. Mais l’OMS a publié des directives différentes, exhortant tous les Américains, même ceux qui sont vaccinés, à continuer de porter des masques en raison de la menace que représente le variant Delta, hautement transmissible, qui a été détecté dans les cinquante États américains.
– Aucune coordination entre régions voisines. Vendredi 17 septembre, le comité de concertation en Belgique a suggéré que le port du masque ne soit plus obligatoire dans les commerces et la restauration à partir du 1er octobre 2021. Mais la Flandre a dit oui, Bruxelles a dit non et la Wallonie décidera plus tard… Chaque région voulait décider en fonction de la situation. Les différents gouvernements régionaux ont pris le pouvoir de décision, chacun dans son pré carré, comme si le virus s’arrêtait aux frontières régionales ou linguistiques.
– Les directives émises un mois sont abrogées le mois suivant. En juillet, le gouvernement britannique a annoncé que toutes les règles de distanciation sociale seraient supprimées et que l’obligation du port du masque serait abrogée à partir du 19 juillet. Mais les supermarchés ont immédiatement annoncé le maintien des masques, tandis que les maires des grandes métropoles ont rendu obligatoire le port du masque dans les services de transport public. Finalement, le gouvernement britannique a cédé et annoncé le port obligatoire des masques dans les magasins et les transports publics à partir du lundi 29 novembre.
– Une « réouverture » suivie d’encore plus de quarantaines. Avec la hausse des vaccinations et la baisse des cas fin juin 2021, le gouvernement néerlandais a fait pression pour une “réouverture”. Les masques faciaux ont été abandonnés presque partout et les jeunes ont été encouragés à sortir à nouveau. Mais lorsque les enfants ont terminé leur première semaine d’école après les vacances d’été, à Utrecht, 10 à 15 classes ont été renvoyées chez elles chaque jour en raison de tests positifs, tandis qu’à La Haye et dans les environs, 34 classes d’école primaire ont été mises en quarantaine et renvoyées chez elles au cours de cette première semaine.
– Un méli-mélo de restrictions sur les déplacements. En Europe, les voyageurs sont confrontés aux mesures particulières de chaque État. Chaque pays a ses propres mesures de sécurité et de quarantaine pour les voyageurs. Dans certains pays, le certificat de vaccination européen suffit pour entrer dans le pays, tandis que d’autres appliquent des restrictions supplémentaires, comme des quarantaines ou des tests PCR. En outre, seules les personnes entrant dans le pays par avion ou par train sont strictement contrôlées.
Méfiance à l’égard du gouvernement, des vaccins et de la science.
Depuis le déclenchement de la pandémie de Covid, nous avons assisté à une augmentation de la méfiance à l’égard des gouvernements, des vaccins, accompagnée d’une recrudescence de la désinformation et des théories du complot :
– une méfiance à l’égard des gouvernements en Russie, en Bulgarie, mais aussi dans différents pays de l’UE comme la Pologne, les Pays-Bas, la Grèce qui, à son tour, a été renforcée par des affirmations irrationnelles et des mensonges flagrants des gouvernements pour couvrir leur négligence et leur impuissance.
– La méfiance et la peur généralisées des vaccins sont alimentées par des campagnes populistes et conspirationnistes, (5) avec un impact particulièrement fort aux États-Unis, conduisant à une polarisation extrême entre les « pro » et les anti-vax.
La Bulgarie est l’un des pays où l’ampleur de la désinformation et de la méfiance à l’égard des vaccins a un réel impact sur le taux de vaccination, qui n’atteint que 20 %. Fin octobre 2021, le pays approchait d’un nouveau pic d’infections, avec plus de 5 000 cas de Covid-19 et 100 décès par jour ; 95 % des personnes décédées n’avaient pas été vaccinées. Alors que le nombre de décès s’accumulait, le système de soins de santé était surchargé et les unités de soins intensifs saturées. Mais la plupart des Bulgares refusent toujours les vaccins contre le Covid-19.
On peut en dire autant de la Russie. Depuis plus d’un an, les agences de propagande russes et les trolls sur internet se sont engagés dans une campagne de désinformation systématique et agressive, visant à entretenir les doutes et les réticences à l’égard des vaccins. Cette campagne de désinformation a fortement alimenté le scepticisme à l’égard des vaccins qui, avec la méfiance envers le gouvernement, est responsable du niveau élevé d’hésitation à l’égard des vaccins chez les Russes. Avec moins de 45 % de la population entièrement vaccinée, le virus s’est propagé à son rythme le plus rapide au cours des derniers mois.
Cette polarisation, notamment aux États-Unis, a provoqué une réaction en chaîne d’une irrationalité totale, qui s’est étendue aux pays européens, à l’Australie et à l’Afrique du Sud. En s’informant sur des sites web douteux qui diffusent des rapports plus ou moins mensongers, les véritables préoccupations concernant le virus ou le vaccin sont très facilement confondues avec des théories farfelues et une méfiance totalement irrationnelle envers la science. L’une des principales théories du complot concerne l’origine-même de la pandémie comme celle selon laquelle l’émergence du virus est due à la technologie 5G qui aurait été conçue pour contrôler à distance les esprits et qui affirme que l’OMS fait partie du complot.
Le Covid-19 a créé un environnement sanitaire propice aux agressions et à la violence. (6) Au cours des six premiers mois de la pandémie, 611 agressions physiques ou verbales, menaces ou discrimination liés au Covid-19 ont été dirigés contre des travailleurs de la santé, des patients et des installations médicales dans plus de quarante pays, selon la Croix-Rouge (CICR). Les partisans des théories du complot se sont rendus coupables d’agressions verbales et même physiques à l’encontre de travailleurs de la santé dans des pays tels que la Slovaquie et les États-Unis. En outre, nous avons également assisté à plusieurs attaques contre les travailleurs des médias grand public.
Impérialisme vaccinal
Les politiciens ne cessent de répéter : « plus jamais ça », « nous devons tirer les leçons de l’histoire », mais loin de faire entendre raison aux États capitalistes et de les faire travailler ensemble, la classe dirigeante, de par sa nature même, est incapable de changer les règles du capitalisme en déclin, dans lequel la concurrence féroce pour les marchés est la règle et toute forme de coopération plus que jamais l’exception. Au cours des cent dernières années, dans le capitalisme décadent, le monde est devenu non seulement une arène de compétition entre les entreprises capitalistes, mais surtout un champ de bataille entre les États capitalistes.
La concurrence est le moteur qui fait tourner le capitalisme, mais elle est aussi la source de la plupart de ses problèmes. La pandémie l’a clairement mis en évidence : pendant des années, les gouvernements ont réduit les budgets de santé afin d’accroître leur compétitivité, avec pour résultat que de nombreux systèmes de santé ont été submergés par les hospitalisations liées au Covid. Bien sûr, tout le monde s’accorde à dire que prévenir les zoonoses (transmission de maladies de l’animal à l’homme) en freinant la destruction massive et chaotique de l’environnement coûtera beaucoup moins cher que d’en payer les conséquences… mais de préférence de manière à ce qu’un autre État agisse le premier ou en supporte lui-même les conséquences. En raison de la concurrence internationale, aucun des États concernés n’est prêt à limiter la destruction des forêts et autres zones sauvages au détriment de sa propre économie nationale. Aucune pensée rationnelle n’est assez forte pour modifier la situation.
Le cadre national est la plus haute expression de l’unité que peut atteindre la société bourgeoise. Face à la pandémie, qui exige une approche globale unifiée, elle n’est pas en mesure de dépasser ce cadre. Lors des crises sanitaires précédentes, comme l’épidémie d’Ebola, par exemple, la bourgeoisie a réussi au moins à sauver les apparences en mettant en place une certaine (et souvent cynique) coordination internationale (avec l’OMS notamment, sur le plan médical) pour défendre les intérêts généraux du capitalisme même dans le contexte de la décadence du système. Mais dans cette phase de décomposition, la tendance au chacun pour soi a pris une telle ampleur que la classe dirigeante n’est même plus capable de réaliser la coopération minimale pour défendre les intérêts généraux de son propre système. Au contraire, chaque État cherche à se sauver lui-même face à la catastrophe en cours.
La pandémie de Covid n’a fait qu’intensifier la course impérialiste à l’influence et aux marchés. La distribution des vaccins est elle-même instrumentalisée à des fins impérialistes. Les États-Unis et l’Europe, mais aussi la Russie, la Chine ou l’Inde, utilisent la distribution de vaccins dans le cadre de stratégie d’impérialisme « doux » (dit « soft power ») pour renforcer leurs positions impérialistes dans le monde :
– Le soutien apporté par la Chine au programme Covax de l’OMS et à la « Route de la soie de la santé » fait partie de son « offensive diplomatique » visant à promouvoir un leadership mondial en matière de santé. Entre-temps, la Chine a livré des vaccins à près de cent pays dans le monde.
– Le Kremlin a lancé son « offensive diplomatique » autour du Sputnik V qui est actuellement enregistré et certifié dans 71 pays. Son offensive met également l’unité de l’UE à l’épreuve. Certains États membres ont commencé à utiliser le vaccin, tandis que l’Italie a accepté de fabriquer le Sputnik V russe non homologué.
– L’Inde est le plus grand exportateur de vaccins du monde. Sous le slogan « les voisins d’abord » (« neighbourhood first »), elle a conclu des accords avec 94 pays pour l’exportation de 66 millions de doses. Le vaccin indien, le Covaxin de Bharat Biotech, fera partie du programme d’exportation en 2022.
Incapables de protéger leur propre population, ces États utilisent donc les vaccins à des fins impérialistes. L’Inde, où seulement 35 % de la population est entièrement vaccinée, a exporté trois fois plus de doses qu’elle n’en a administrées à sa propre population.
La crise mondiale et meurtrière du Covid entraîne également des divisions croissantes, une intensification des tensions entre les factions des bourgeoisies nationales, ce qui accroît encore la perte de contrôle de la bourgeoisie sur l’évolution de la pandémie. D’importantes factions politiques de la bourgeoisie en Europe, comme le Freiheits Partei Österreich, Alternative Für Deutschland, le Rassemblement National en France, mais aussi le Parti Républicain aux États-Unis, etc. attisent avec véhémence le mécontentement de la société à propos des vaccinations obligatoires, du passeport santé et des confinements. Ils participent de plus en plus à des manifestations pour la « liberté » qui se soldent souvent par des affrontements violents avec les forces de répression.
Seule l’abolition du capitalisme offre une perspective
La pandémie s’est étendue au monde entier et l’a radicalement transformé en quelques mois. Cela en fait le phénomène le plus important depuis l’entrée du capitalisme dans la phase de décomposition et confirme notre thèse selon laquelle « L’ampleur de l’impact de la crise du Covid-19 s’explique non seulement par cette accumulation mais aussi par l’interaction des expressions écologiques, sanitaires, sociales, politiques, économiques et idéologiques de la décomposition dans une sorte de spirale jamais observé jusqu’alors, qui a débouché sur une tendance à la perte de contrôle de plus en plus d’aspects de la société ». (7) Il montre clairement la décomposition de la superstructure de la société capitaliste et ses effets sur les fondements économiques qui lui ont donné naissance.
En même temps, ce n’est pas seulement la pandémie qui illustre l’aggravation significative des effets de la décomposition. C’est aussi la multiplication des catastrophes « naturelles » comme les incendies de forêt, les inondations et les tornades, toutes sortes de violences structurelles, des conflits militaires de plus en plus irrationnels et la migration qui en résulte de millions de personnes à la recherche d’un endroit où survivre. L’interaction de tous ces aspects est l’expression de la putréfaction accélérée des fondements mêmes du mode de production capitaliste. C’est une manifestation terrible du contraste entre l’énorme potentiel des forces productives et l’atroce misère qui se répand dans le monde.
Le capitalisme a fait son temps : c’est un homme mort qui marche encore et qui ne peut plus offrir de perspective à l’humanité. Mais dans son agonie, il est encore capable d’amener le monde entier au bord de l’abîme. La classe ouvrière a la capacité et la responsabilité d’empêcher l’anéantissement de l’humanité. Par conséquent, elle doit développer sa lutte sur son propre terrain contre les effets de la crise économique, tels que l’inflation, le chômage, la précarité. Les luttes ouvrières actuelles, (8) aussi timides soient-elles, portent les germes du dépassement de cette barbarie quotidienne, et de la création d’une société débarrassée des nombreux fléaux qui sévissent dans le capitalisme du XXIe siècle.
Dennis, 18 décembre 2021
1 « “Highly probable” that worst of Covid pandemic is behind us, says Johnson », Evening Standard (15 juillet 2021).
2 « EU mulls mandatory vaccination, while urging booster for all », EU-Observer (2 décember 2021).
3 Message vidéo au Sommet mondial de la santé de Berlin, les 24 au 26 octobre 2021.
4 « Why low income countries are so short on Covid vaccines. Hint : It's not boosters », National Public Radio (10 novembre 2021).
5 « Théories du complot : un poison contre la conscience de la classe ouvrière [354] », Révolution internationale n° 484 (septembre octobre 2020).
6 « Navigating Attacks Against Health Care Workers in the Covid-19 Era [355] », JAMA Network (21 April 2021).
7 « Rapport sur la pandémie et le développement de la décomposition [356] », Revue internationale n° 167 (2e semestre 2021).
8 « Luttes aux États-Unis, en Iran, en Italie, en Corée… Ni la pandémie ni la crise économique n’ont brisé la combativité du prolétariat ! [357] », Révolution internationale n° 491 (novembre décembre 2021).
Récent et en cours:
- Coronavirus [55]
- COVID-19 [56]
Rubrique:
ICConline - 2022
- 323 lectures
ICCOnline - janvier 2022
- 62 lectures
Crise du Covid-19 : opportunité ou entrave pour l’essor de la Chine ?
- 61 lectures
La responsabilité écrasante qui incombe à la Chine en ce qui concerne l’éclosion du covid-19 et surtout son expansion vertigineuse, qui a provoqué la pandémie planétaire actuelle, a largement été mise en évidence par l’ensemble des médias. Cependant, le nombre restreint de morts et l’absence de larges vagues de contagions dans le pays - du moins selon les données officielles -, ainsi que le fait que la Chine soit la seule grande puissance à ne pas avoir annoncé de récession économique en 2020 (+2% du PIB) ont mené de nombreux observateurs à présenter la Chine comme la grande gagnante de la crise du Covid-19 sur l’échiquier du rapport de force entre les principales puissances impérialistes.
Il est vrai que depuis le début des années 1980, en ouvrant son économie au bloc US, la Chine a largement profité de la mondialisation de l’économie et de l’implosion du bloc soviétique pour effectuer en trente ans une ascension fulgurante sur le plan économique et impérialiste, qui en a fait le challenger le plus important pour les États-Unis. Aujourd’hui pourtant, la prise en charge de la pandémie, la gestion de l’économie et l’expansion de sa zone d’influence engendrent d’importantes difficultés pour la bourgeoisie chinoise. La crise du Covid-19 accentue fortement les confrontations entre factions au sein de son appareil politique et exacerbe les tensions entre requins impérialistes en Extrême-Orient.
Lourdeurs dans la prise en charge de la crise du Covid
En misant depuis le début sur l’immunité collective avant d’ouvrir le pays, la Chine applique en attendant une politique de lock-down drastique dans des villes et des régions entières, chaque fois que des infections sont identifiées, ce qui entrave lourdement les activités économiques et commerciales : ainsi, la fermeture du port de Yantian, le troisième port de conteneurs du Monde en mai 2021, a conduit au blocage de centaines de milliers de conteneurs (comme les grands peuvent porter jusqu’à 20/30.000 milles conteneurs) et de centaines de navires pendant des mois, désorganisant totalement le trafic maritime mondial. En réalité, le moindre surgissement d’infections, même limité à quelques cas, est appréhendé comme un danger majeur : récemment encore des lock-down drastiques ont été décrétés dans 27 villes et 18 provinces (août ’21), à Xiamen, une ville de 5 millions (septembre ’21) et depuis septembre, des infections sont signalées dans la moitié des provinces et dans la ville de Shanghai.
Par ailleurs, la campagne de vaccination massive pour atteindre l’immunité collective a poussé certaines provinces et villes chinoises à imposer des sanctions financières à ceux qui se méfient et évitent la vaccination. Cependant, face aux nombreuses protestations sur les réseaux sociaux chinois, le gouvernement central a bloqué ce genre de mesures, qui tendaient à "mettre en péril la cohésion nationale". Mais le revers le plus sérieux est sans nul doute les données convergentes sur l’efficacité limitée des vaccins chinois, observée dans divers pays qui les utilisent, comme par exemple au Chili : "Au total, la campagne de vaccination chilienne –importante avec 62 % de la population vaccinée actuellement– ne semble avoir aucun impact notable sur la proportion de décès" (H. Testard, "Covid-19 : la vaccination décolle en Asie mais les doutes augmentent sur les vaccins chinois", Asialyst, 21.07.21). Les autorités sanitaires chinoises préconisaient même d’importer des doses de Pfizer ou Moderna afin de pallier l’inefficacité de leurs propres vaccins.
La gestion extrêmement lourde et peu efficiente de la pandémie par le capitalisme d’État chinois a été illustrée en novembre dernier par l’appel du Ministère du Commerce conviant la population chinoise à stocker chez soi des rations d’urgence.
Accumulation de nuages sombres sur l’économie chinoise
La forte croissance que la Chine connaît depuis quarante ans -même si la progression ralentissait déjà la dernière décennie- semble arriver à son terme. Les experts s’attendent à une croissance du PIB chinois inférieure à 5% en 2021, contre 7% en moyenne sur la dernière décennie et plus de 10% lors de la décennie précédente. Divers facteurs mettent en évidence les difficultés actuelles de l’économie chinoise.
Il y a d’abord le danger d’éclatement de la bulle immobilière chinoise : Evergrande, le numéro deux de l’immobilier en Chine, se retrouve aujourd’hui écrasé par quelque 300 milliards d’euros de dettes, à elles seules 2% du PIB du pays. D’autres promoteurs sont quasiment en défaut de paiement, tels Fantasia Holdings ou Sinic Holdings, et le secteur de l’immobilier, qui représente 25% de l’économie chinoise, a généré une dette publique et privée colossale qui se chiffre en milliers de milliards de dollars. Le crash d’Evergrande n‘est que la première séquence d’un effondrement global à venir de ce secteur. Aujourd’hui les logements vides sont tellement nombreux qu’on pourrait héberger 90 millions de personnes. Certes, l’effondrement immédiat du secteur sera évité dans la mesure où les autorités chinoises n’ont d’autre choix que de limiter les dégâts du naufrage au risque sinon d’un impact très sévère sur le secteur financier : "(…) il n’y aura pas d’effet boule de neige comme en 2008 [aux USA], parce que le gouvernement chinois peut arrêter la machine, estime Andy Xie, économiste indépendant, ancien de Morgan Stanley en Chine, cité par Le Monde. Je pense qu’avec Anbang [groupe d’assurance, NDLR] et HNA [Hainan Airlines], on a de bons exemples de ce qui peut se produire : il y aura un comité rassemblant autour d’une table l’entreprise, les créditeurs et les autorités, qui va décider quels actifs vendre, lesquels restructurer et, à la fin, combien d’argent il reste et qui peut perdre des fonds". (P.-A. Donnet, "Chute d’Evergrande en Chine : la fin de l’argent facile", Asialyst, 25.09.21). De nombreux autres secteurs sont aussi dans le rouge : fin 2020, la dette globale des entreprises chinoises représentait 160 % du PIB du pays, contre 80 % environ pour celle des sociétés américaines et les investissements "toxiques" des gouvernements locaux représenteraient aujourd’hui, selon des analystes de Goldman Sachs, à eux seuls 53 000 milliards de yuans, soit une somme qui représente 52 % du PIB chinois. L’éclatement de la bulle immobilière risque non seulement de contaminer d’autres secteurs de l’économie mais aussi d’engendrer une instabilité sociale (près de 3 millions d’emplois directs et indirects liés à Evergrande), la grande crainte du Parti Communiste Chinois (PCC).
Ensuite, les coupures énergétiques se sont multipliées depuis l’été 2021 : elles sont la conséquence d’un approvisionnement en charbon défaillant, causé entre autres par les inondations records dans la province du Shaanxi (produisant à elle seule 30% du combustible dans tout le pays), et aussi par le durcissement de la réglementation anti-pollution décidée par Xi. Les secteurs de la sidérurgie, de l’aluminium et du ciment souffrent déjà dans plusieurs régions de la limitation de l’offre d’électricité. Cette pénurie a réduit d’environ 7 % les capacités de production d’aluminium et de 29 % celles de ciment (chiffres de Morgan Stanley) et le papier et le verre pourraient être les prochains secteurs touchés. Ces coupures freinent désormais la croissance économique de l’ensemble du pays. Mais la situation est encore plus grave qu’il n’y paraît à première vue. « En effet, cette pénurie d’électricité se répercute désormais sur le marché résidentiel dans certaines régions du Nord-Est. La province du Liaoning a ainsi étendu les coupures de courant du secteur industriel à des réseaux résidentiels » (P.-A. Donnet, « Chine : comment la grave pénurie d’électricité menace l’économie », Asialyst, 30.09.21).
Enfin, la pénurie énergétique mais aussi les lock-down découlant des infections Covid affectent la production dans les industries de diverses régions de Chine, ce qui, à son tour, accroît l’ampleur des ruptures des chaînes d’approvisionnement, déjà hypertendues, au niveau national et mondial, d’autant plus que les chaines de fabrication dans de nombreux secteurs sont confrontées à une pénurie aigüe de semi-conducteurs.
Les données récentes confirment l’essoufflement de la croissance économique, qui va de pair avec une baisse de la consommation intérieure, une chute des revenus des ménages et une baisse des salaires.
Essoufflement du projet de la "nouvelle route de la soie"
Le déploiement de la "nouvelle route de la soie" rencontre des difficultés croissantes à cause du poids financier de la crise du Covid en Chine, mais aussi à cause des difficultés économiques des "partenaires", asphyxiés par la pression de la dette, ou encore de leur réticences de plus en plus manifestes face aux "ingérences" chinoises.
À cause en particulier de la crise du Covid, l’endettement de divers pays « partenaires » atteint des niveaux pharamineux et ceux-ci se retrouvent dans l’incapacité de payer les intérêts des prêts chinois. Des pays comme le Sri Lanka, le Bangladesh (dette extérieure +125% dernière décennie, le Kirghizstan, le Pakistan (20 milliards de $ de prêts bilatéraux octroyés par la Chine), le Monténégro, et divers pays africains, ont demandé à la Chine de restructurer, de retarder ou d'annuler carrément le paiement des remboursements qui sont dus cette année.
D’autre part, une méfiance croissante se manifeste dans divers pays envers les agissements de la Chine (non-ratification du traité commercial entre la Chine et l’Union Européenne, distanciation du Cambodge, des Philippines ou de l’Indonésie), à laquelle il faut ajouter une pression antichinoise exercée par les États-Unis (en Amérique latine envers des pays comme le Panama, l’Équateur et le Chili). Enfin, le chaos produit par la décomposition a pour conséquence de déstabiliser certains pays clés de la "nouvelle route" ; c’est le cas par exemple de l’Éthiopie, qui s’enfonce dans une terrible guerre civile entre le gouvernement central éthiopien et la région du Tigray, alors que le pays, présenté comme un pôle de stabilité et le "nouvel atelier du monde", constituait un point d’appui pour le "Belt and Road Project" en Afrique du Nord-Est, avec une base militaire chinoise à Djibouti.
Bref, il ne faut pas s’étonner qu’en 2020, il y a eu un effondrement de la valeur financière des investissements injectés dans le projet "Nouvelle route de la soie" (-64%), alors que la Chine a prêté plus de 461 milliards de dollars depuis 2013.
Accentuation des antagonismes au sein de la bourgeoisie chinoise.
L’ensemble de ces difficultés attisent les tensions au sein de la bourgeoisie chinoise, même si, du fait de la structure politique capitaliste d’État de type stalinien, elles ne se manifestent pas de la même manière qu’aux USA ou en France par exemple.
Sous Deng Xiao Ping le capitalisme d’État de type stalinien chinois, sous le couvert d’une politique de "créer des riches pour partager leur richesse", a établi des zones "libres" (autour de Hong Kong, Macao, etc.) afin de développer un capitalisme de type "libre marché" permettant l’entrée de capitaux internationaux et favorisant aussi un secteur capitaliste privé. Avec l’effondrement du bloc de l’Est et la "globalisation" de l’économie dans les années 90, ce dernier s’y est développé de manière exponentielle, même si le secteur public sous le contrôle direct de l’État représente toujours 30% de l’économie. Comment la structure rigide et répressive de l’État stalinien et du parti unique a-t-elle prise en charge cette "ouverture" au capitalisme privé ? Dès les années 1990, le parti a intégré massivement des entrepreneurs et des chefs d’entreprises privées. "Au début des années 2000, le président d’alors, M. Jiang Zemin avait levé l’interdiction de recruter des entrepreneurs du secteur privé, vus jusque-là comme des ennemis de classe, (…). Les hommes et les femmes d’affaires ainsi sélectionnés deviennent membre de l’élite politique, ce qui leur garantit que leurs entreprises soient, au moins partiellement, protégées de cadres aux tendances prédatrices" ("Que reste-t-il du communisme en Chine ?", Le monde diplomatique 68, juillet 2021). Aujourd’hui, professionnels et managers diplômés du supérieur constituent 50% des adhérents du PCC.
Les oppositions entre les différentes fractions s’exprimeront donc non seulement au sein des structures étatiques mais au sein même du PCC. Depuis plusieurs années (cf. déjà le "Rapport sur les tensions impérialistes pour le 20e Congrès du CCI", Revue Internationale 152, 2013), les tensions croissent entre différentes factions au sein de la bourgeoisie chinoise[1], en particulier entre celles plus liées aux secteurs capitalistes privés, dépendant des échanges et des investissements internationaux, et celles liées aux structures et au contrôle financier étatiques au niveau régional ou national, celles qui prônent une ouverture au commerce mondial et celles qui avancent une politique plus dogmatique ou nationaliste. La "campagne contre la corruption", engagée par le président Xi, a impliqué des saisies spectaculaires de fortunes gigantesques amassées par des membres de divers clans, tandis que le "tournant à gauche", impliquait moins de pragmatisme économique et plus de dogmatisme et de nationalisme ; leur résultat a surtout été d’intensifier les tensions et l’instabilité politiques ces dernières années : en témoignent "les tensions persistantes entre le premier ministre Li Keqiang et le président Xi Jinping sur la relance économique, tout comme la " nouvelle position" de la Chine sur la scène internationale". (A. Payette, "Chine : à Beidaihe, l'"université d'été" du Parti, les tensions internes à fleur de peau", Asialyst, 06.09.20), les critiques explicites envers Xi qui apparaissent régulièrement (dernièrement l’essai "alerte virale" publié par un professeur réputé de droit constitutionnel à l'Université Qinghua à Pékin et prédisant la fin de Xi), les tensions entre Xi et les généraux dirigeant l’armée populaire, visés en particulier par la campagne anti-corruption ou encore les interventions de l’appareil d’État envers des entrepreneurs trop "flamboyants" et critiques envers le contrôle étatique (Jack Ma et Ant Financial, Alibaba). Certaines faillites (HNA, Evergrande) pourraient d’ailleurs avoir un rapport avec les luttes entre cliques au sein du parti, dans le cadre par exemple de la campagne cynique pour "protéger les citoyens des excès de la "classe capitaliste" (sic)".
Bref, la bourgeoisie chinoise, comme les autres bourgeoisies, est confrontée à des difficultés économiques croissantes liées à la crise historique du mode de production capitaliste, au chaos issu de la décomposition du système et à l’exacerbation des tensions internes entre factions au sein du PCC, qu’elle tente par tous les moyens de contenir au sein de ses structures capitalistes d’État désuètes.
Tensions accrues avec les autres impérialismes en Extrême-Orient
Par ailleurs, la situation est tout aussi délicate pour la bourgeoisie chinoise sur le plan international, d’abord à cause de la politique agressive des USA, mais aussi par les tensions croissantes avec d’autres puissances asiatiques majeures, telles l’Inde et le Japon, intensifiées par le chaos et le chacun pour soi de cette période de décomposition.
La politique "America First", mise en œuvre par Trump à partir de 2017, a essentiellement mené sur le plan impérialiste à une polarisation croissante et une agressivité accentuée envers la Chine, de plus en plus identifiée par la bourgeoisie US comme le danger principal. Les USA ont fait le choix stratégique de concentrer leurs forces sur la confrontation militaire et technologique avec la Chine, en vue de maintenir et même d’accentuer leur suprématie, de défendre leur position de gang dominant face aux rivaux (la Chine et accessoirement la Russie) qui menacent le plus directement son hégémonie. La politique de l’administration Biden s’inscrit pleinement dans cette orientation ; elle a non seulement maintenu les mesures agressives économiques contre la Chine, mises en œuvre par Trump, mais elle a surtout accentué la pression par une politique agressive :
- sur le plan politique : défense des "droits de l’homme" par rapport à la répression des Ouïghours ou des manifestations "pro-démocratie" à Hong Kong, exclusion de la Chine de la Conférence sur la démocratie, organisée par Biden, au profit de Taïwan, dont les USA se rapprochent nettement sur le plan diplomatique et commercial, accusations de piratage informatique envers la Chine, etc. ;
- au niveau militaire, en mer de Chine, par des démonstrations de force explicites et spectaculaires ces derniers mois : multiplication d’exercices militaires impliquant la flotte US et celles d’alliés en mer de Chine du Sud, rapports alarmistes sur les menaces imminentes d’intervention chinoise à Taïwan, présence à Taïwan de forces spéciales américaines pour encadrer les unités d’élite taïwanaises, conclusion d’un nouvel accord de défense, l’AUKUS, entre les USA, l’Australie et la Grande-Bretagne, qui instaure une coordination militaire orientée explicitement contre la Chine, engagement par Biden d’un soutien à Taïwan en cas d’agression chinoise.
La Chine a réagi furieusement à ces pressions politiques et militaires, particulièrement à celles en mer de Chine autour de Taïwan : organisation de manœuvres navales et aériennes massives et menaçantes autour de l’île, publication d’études alarmistes, qui rapportent un risque de guerre "qui n’a jamais été aussi élevé" avec Taïwan, ou de plans d’attaque surprise contre Taïwan, qui conduirait à une défaite totale des forces armées de l’île.
Les tensions sont tout aussi fortes avec d’autres puissances asiatiques : elles sont à leur comble avec l’Inde, sa grande rivale en Asie, à laquelle des incidents militaires sérieux l’ont opposé dans le Ladakh pendant l’été 2020 ; elles s’exacerbent également avec le Japon, dont le nouveau premier ministre Fumio Kishida, pour la première fois depuis 1945, veut "envisager toutes les options, y compris celle [pour le Japon] de posséder des capacités d’attaques de bases ennemies, de continuer le renforcement de la puissance militaire japonaise autant qu’il sera nécessaire" (P.-A. Donnet, "Les relations entre la Chine et le Japon se détériorent à grande vitesse", Asialyst, 01.12.21). Ces pays gardent cependant une certaine distance envers les USA (et n’ont pas adhéré au pacte militaire de l’AUKUS), la frilosité de l’Inde s’expliquant par ses propres ambitions impérialistes, celle du Japon, par le fait d’être écartelé entre d’une part la crainte du renforcement militaire de la Chine et d’autre part leurs liens industriels et commerciaux considérables avec ce pays (la Chine est le plus grand partenaire commercial du Japon qui a exporté pour plus de 141 milliards de dollars vers ce pays en 2020, comparé à 118 milliards de dollars exportés vers les Etats-Unis (cf. Id.)).
Le chaos et le chacun pour soi produits par la décomposition accentuent pour la Chine aussi le caractère imprédictible de la situation, comme l’illustre l’exemple de l’Afghanistan. L’absence de centralisation du pouvoir Taliban, la myriade de courants et de groupes aux aspirations les plus diverses qui composent le mouvement et les accords conclus avec les chefs de guerre locaux pour investir rapidement l’ensemble du pays font que le chaos et l’imprédictibilité caractérisent la situation, comme les attentats récents visant la minorité Hazara le démontrent. Cela ne peut qu’intensifier l’intervention des différents impérialismes (la Russie, l’Inde, l’Iran, …) mais aussi l’imprévisibilité de la situation, donc aussi le chaos ambiant. Pour la Chine, ce chaos rend toute politique cohérente et à long terme dans le pays aléatoire. Par ailleurs, la présence des Talibans aux frontières de la Chine constitue un danger potentiel sérieux pour les infiltrations islamistes en Chine (cf. la situation dans le Sin-Kiang), surtout que les "frères" pakistanais des Talibans (les TTP, cousins des ISK) sont engagés dans une campagne d’attentats contre les chantiers de la "nouvelle route de la soie", ayant déjà entraîné la mort d’une dizaine de "coopérants" chinois. Afin de contrer le danger en Afghanistan, la Chine tend à s'implanter dans les anciennes républiques soviétiques d’Asie centrale (Turkménistan, Tadjikistan et Ouzbékistan). Mais ces républiques font traditionnellement partie de la zone d’influence russe, ce qui augmente le danger de confrontation avec cet "allié stratégique", auquel de toute façon ses intérêts à long terme (la "nouvelle route de la soie") l’opposent fondamentalement.
Une perspective d’intensification du chaos, de perte de contrôle et de confrontations guerrières
La Chine est donc non seulement directement impactée par l’approfondissement du pourrissement du capitalisme, elle est un puissant facteur actif de celui-ci, comme son implication dans la crise du Covid, l’essoufflement de son économie ou les affrontements internes au sein de sa bourgeoisie le démontrent amplement.
Son effort spectaculaire pour tenter de compenser son retard sur le plan militaire par rapport aux Etats-Unis est en particulier un facteur important dans l’accélération de la course aux armements, en particulier sur le continent asiatique qui connaît une hausse significative des dépenses militaires : l'inversion du poids respectif de l'Asie et de l'Europe entre 2000 et 2018 sur ce plan est spectaculaire : en 2000, l'Europe et l'Asie représentent respectivement 27 % et 18 % des dépenses de défense mondiales. En 2018, ces rapports sont inversés, l'Asie en représente 28 % et l'Europe 20 % (données du Sipri). Ainsi par exemple, le budget militaire japonais atteindra un niveau jamais vu depuis 1945 avec plus de 53,2 milliards de dollars pour 2021, une hausse de 15% comparée à la même période de 2020 (cf. P.-A. Donnet, "Les relations entre la Chine et le Japon se détériorent à grande vitesse", Asialyst 01.12.21). L’armement massif des États accroît sensiblement le danger de confrontation entre puissances asiatiques majeures ou les tensions avec les USA, qui sont prééminentes, même si elles n’induisent pas une tendance à la formation de blocs impérialistes dans la mesure où ni les USA aujourd’hui et encore moins la Chine n’arrivent à mobiliser les autres puissances derrière leurs ambitions impérialistes et à imposer de manière durable son leadership à d’autres pays. Cela n’a toutefois rien de rassurant : "Dans le même temps, les "massacres d'innombrables petites guerres" prolifèrent également, alors que le capitalisme, dans sa phase finale, plonge dans un chacun-pour-soi impérialiste de plus en plus irrationnel" (Résolution situation internationale du 24ième Congrès du CCI [358], point 11, Revue Internationale 167).
La Chine ne ressort donc nullement de la crise du Covid-19 comme le "rempart de la stabilité mondiale" ni comme le phare qui indiquerait le chemin de la sortie de crise au capitalisme mondial. "La croissance extraordinaire de la Chine est elle-même un produit de la décomposition. (…) [et] a été mise en œuvre par un appareil politique inflexible qui n'a pu éviter le sort du stalinisme dans le bloc russe que par une combinaison de terreur d'État, une exploitation impitoyable de la force de travail qui soumet des centaines de millions de travailleurs à un état permanent de travailleur migrant et de croissance économique frénétique dont les fondations semblent maintenant de plus en plus fragiles. Le contrôle totalitaire sur l’ensemble du corps social, le durcissement répressif auxquels se livre la fraction stalinienne de Xi Jinping ne représentent pas une expression de force mais au contraire une manifestation de faiblesse de l’État, dont la cohésion est mise en péril par l’existence de forces centrifuges au sein de la société et d’importantes luttes de cliques au sein de la classe dominante" (Résolution situation internationale du 24ième Congrès du CCI, point 9, Revue Internationale 167). Elle apparaît au contraire comme une gigantesque "bombe à retardement" annonçant une effroyable spirale de barbarie pour la planète si la classe ouvrière ne met pas fin au pourrissement sur pied de ce système décadent[2].
R. Havannais / 20.12.21
[1] La littérature sur le PCC énumère par exemple la faction Qinghua (ex étudiants de l’université polytechnique Qinghua à Pékin, tels l’ex-président Hu Jintao et le premier ministre Li Keqiang), aux origines plus modestes et d’orientation plutôt réformatrice, la faction des "princes rouges", issue de familles de la Nomenklatura du PCC (Xi Jinping) et dirigeant la majorité des grands groupes publics ou semi-publics, ou encore la « clique » de Shanghai (Jiang Zemin), orientée vers l’ouverture et les réformes économiques.
[2] Un facteur supplémentaire et récent de cette menace a été révélé avec le risque de propagation du variant Omicron en Chine. En effet, beaucoup plus transmissible que les variants précédents, il est susceptible de mettre en défaut la stratégie chinoise de "zéro Covid-19" reposant sur des mesures drastiques de confinement. Et ceci alors même que des études récentes convergent vers le diagnostic d'une efficacité médiocre des deux principaux vaccins utilisés en Chine. En fonction de l'ampleur que pourraient prendre des suspensions de l'activité (localisés à une ou plusieurs villes, une région, …) qui en découleraient, il est facile d'entrevoir les conséquences possibles de celles-ci en Chine même, et aussi mondialement. (Actualisation du 31/12/2021)
Géographique:
- Chine [281]
Rubrique:
Les caractéristiques historiques de la lutte des classes en France
- 69 lectures
– Les caractéristiques historiques de la lutte des classes en France (partie 1) [359]
– Les caractéristiques historiques de la lutte des classes en France (partie 2) [360]
– Les caractéristiques historiques de la lutte des classes en France (Partie 3 [361])
– Les caractéristiques historiques de la lutte des classes en France (partie 4) [362]
Histoire du mouvement ouvrier:
- 1848 [363]
- Commune de Paris - 1871 [239]
- Révolution Russe [217]
- Mai 1968 [364]
Rubrique:
Permanence en ligne du 15 janvier 2022
- 58 lectures
Révolution Internationale, section en France du Courant Communiste International, organise une permanence en ligne le samedi 15 janvier 2022 à partir de 14h.
Ces permanences sont des lieux de débat ouverts à tous ceux qui souhaitent rencontrer et discuter avec le CCI. Nous invitons vivement tous nos lecteurs, contacts et sympathisants à venir y débattre afin de poursuivre la réflexion sur les enjeux de la situation et confronter les points de vue. N'hésitez pas à nous faire part des questions que vous souhaiteriez aborder.
Les lecteurs qui souhaitent participer aux permanences en ligne peuvent adresser un message sur notre adresse électronique ([email protected] [213]) ou dans la rubrique “nous contacter” de notre site internet, en signalant quelles questions ils voudraient aborder, afin de nous permettre d’organiser au mieux les débats.
Les modalités techniques pour se connecter à la permanence seront communiquées ultérieurement.
Vie du CCI:
- Permanences [291]
Rubrique:
Contre les attaques de la bourgeoisie, nous avons besoin d’une lutte unie et massive! (Tract international)
| Fichier attaché | Taille |
|---|---|
| 246.59 Ko |
- 321 lectures
Dans tous les pays, dans tous les secteurs, la classe ouvrière subit une dégradation insoutenable de ses conditions de vie et de travail. Tous les gouvernements qu’ils soient de droite ou de gauche, traditionnels ou populistes, attaquent sans relâche. Les attaques pleuvent sous le poids de l’aggravation de la crise économique mondiale.
Malgré la crainte d’une crise sanitaire oppressante, la classe ouvrière commence à réagir. Ces derniers mois, aux États-Unis, en Iran, en Italie, en Corée, en Espagne ou en France, des luttes se sont engagées. Certes, il ne s’agit pas de mouvements massifs : les grèves et les manifestations sont encore trop maigres, trop éparses. Pourtant la bourgeoisie les surveille comme le lait sur le feu, consciente de l’ampleur de la colère qui gronde.
Comment faire face aux attaques portées par la bourgeoisie ? Rester isolé et divisé, chacun dans « son » entreprise, dans « son » secteur d’activité ? C’est à coup sûr être impuissant ! Alors comment développer une lutte unie et massive ?
Vers une dégradation brutale des conditions de vie et de travail
Les prix flambent, particulièrement ceux des denrées de première nécessité : l’alimentaire, l’énergie, les transports... L’inflation de 2021 dépasse déjà celle enregistrée après la crise financière de 2008. Aux États-Unis, elle s’élève à 6,8 %, le niveau le plus élevé depuis 40 ans. En Europe, ces derniers mois, le coût de l’énergie a bondi de 26 % ! Derrière ces chiffres, ce sont concrètement de plus en plus de personnes en difficulté pour se nourrir, se loger, se chauffer, se déplacer. Les prix mondiaux des denrées alimentaires ont augmenté de 28 %, menaçant directement de malnutrition près d’un milliard de personnes dans les pays les plus pauvres, surtout en Afrique et en Asie.
L’aggravation de la crise économique mondiale signifie une concurrence de plus en plus acharnée entre les États. Pour maintenir les profits, la réponse est toujours la même, partout, dans tous les secteurs, dans le privé comme dans le public : réduction des effectifs, augmentation des cadences de travail, restriction des budgets, y compris sur le matériel lié à la sécurité des salariés. En janvier, en France, les enseignants sont descendus massivement dans la rue pour protester contre leurs conditions de travail indignes. Eux aussi vivent l’enfer capitaliste au quotidien à cause du manque de moyens et de personnel. Dans les manifestations, une idée profondément juste s’est affichée sur les pancartes : « Ce qui nous arrive remonte bien avant le Covid ! »
Le sort infligé aux travailleurs du secteur de la santé le montre parfaitement. La pandémie n’a fait que mettre en lumière la pénurie de médecins, d’aides-soignants, d’infirmiers, de lits, de masques, de blouses, d’oxygène… de tout ! Le chaos et l’épuisement qui règnent dans les hôpitaux depuis le début de la pandémie n’est rien d’autre que la conséquence des coupes claires menées par tous les gouvernements, dans tous les pays, depuis des décennies. À tel point que l’OMS est obligée, dans son dernier rapport, de tirer la sonnette d’alarme : « Plus de la moitié des besoins sont non satisfaits. Il manque dans le monde 900 000 sages-femmes et 6 millions d’infirmiers et infirmières. […] Cette pénurie préexistante s’est exacerbée avec la pandémie et la pression qui repose sur ces effectifs surmenés ». Dans de nombreux pays pauvres, une large partie de la population n’a même pas pu avoir accès aux vaccins pour l’unique raison que le capitalisme est basé sur la recherche du profit.
Alors, oui, « ce qui nous arrive remonte bien avant le Covid » ! La pandémie est le produit du capitalisme moribond dont elle aggrave la crise insurmontable. Non seulement ce système a fait la preuve de son impuissance et de sa désorganisation face à une pandémie qui a déjà fait plus de dix millions de morts, particulièrement parmi les exploités et les plus pauvres, mais il va continuer à dégrader nos conditions d’existence et de travail, il va continuer à licencier, à pressurer, à précariser, à appauvrir. Sous le poids de ses contradictions, il ne peut que continuer à être happé dans des guerres impérialistes interminables, à provoquer de nouvelles catastrophes écologiques, sources de chaos, de conflits, de misère et de nouvelles pandémies plus graves encore. Ce système d’exploitation n’a plus d’avenir à offrir à l’humanité, autre que la souffrance et la misère.
Seule la lutte de la classe ouvrière est porteuse d’une autre perspective, celle du communisme : une société sans classe, sans nations, sans guerres, où toutes les formes d’oppression seront abolies. La seule perspective, c’est la révolution communiste mondiale !
Une montée de la colère et de la combativité
En 2020, partout dans le monde, une chape de plomb s’est abattue avec les confinements à répétition, les hospitalisations d’urgence et les millions de morts. Après le regain de combativité qui s’était exprimé dans plusieurs pays au cours de l’année 2019, particulièrement lors du mouvement contre la réforme des retraites en France, les luttes ouvrières ont subi un coup d’arrêt brutal. Mais, aujourd’hui, de nouveau, la colère gronde et la combativité frémit :
– Aux États-Unis, une série de grèves a touché des groupes industriels comme Kellog’s, John Deere, PepsiCo, mais aussi le secteur de la santé et des cliniques privées, comme à New York.
– En Iran, cet été, des ouvriers de plus de 70 sites du secteur pétrolier se sont mis en grève contre les bas salaires et la cherté de la vie. Du jamais vu depuis 42 ans !
– En Corée, les syndicats ont dû organiser une grève générale pour la protection sociale, contre la précarité et les inégalités.
– En Italie, il y a eu de nombreuses journées d’action contre les licenciements et la suppression du salaire minimum.
– En Allemagne, le syndicat des services publics s’est senti obligé, face à la montée de la mobilisation, de brandir la menace de grèves pour tenter d’obtenir l’augmentation des salaires.
– En Espagne, à Cadix, les ouvriers de la métallurgie se sont mobilisés contre une diminution de salaire de 200 euros par mois en moyenne. Les employés de la fonction publique en Catalogne ont manifesté contre le recours intolérable aux emplois d’intérim (plus de 300 000 travailleurs de l’État ont des emplois précaires). Des luttes ont eu lieu dans les chemins de fer de Majorque, chez Vestas, à Unicaja, chez les métallurgistes d’Alicante, dans différents hôpitaux, chaque fois contre des licenciements.
– En France, un même mécontentement s’est exprimé par des grèves ou des manifestations dans le secteur des transports, chez les éboueurs, les cheminots et les enseignants.
Préparer les luttes à venir
Toutes ces luttes sont importantes car elles révèlent que la classe ouvrière n’est pas prête à accepter tous les sacrifices que la bourgeoisie tente de lui imposer. Mais il faut aussi reconnaître les faiblesses de notre classe. Toutes ces actions sont contrôlées par les syndicats qui, partout, divisent et isolent les prolétaires autour de revendications corporatistes, encadrent et sabotent les luttes. À Cadix, les syndicats ont cherché à enfermer les travailleurs en lutte dans le piège localiste d’un « mouvement citoyen » pour « sauver Cadix », comme si les intérêts de la classe ouvrière résidaient dans la défense d’intérêts régionaux ou nationaux et pas dans le lien avec leurs sœurs et frères de classe par-delà les secteurs et les frontières ! Les travailleurs rencontrent encore des difficultés pour s’organiser eux-mêmes, pour prendre en main l’organisation des luttes, pour se regrouper en assemblées générales souveraines, pour lutter contre les divisions que nous imposent les syndicats.
Un danger supplémentaire guette aussi la classe ouvrière, celui de renoncer à défendre ses revendications de classe en adhérant à des mouvements qui n’ont rien à voir avec ses intérêts et ses méthodes de lutte. On a pu observer de tels mouvements avec les « gilets jaunes » en France, ou, plus récemment, en Chine, lors de l’effondrement du géant de l’immobilier Evergrande (symbole spectaculaire de la réalité d’une Chine surendettée) qui a surtout provoqué la protestation des petits propriétaires spoliés. Au Kazakhstan, les grèves massives dans le secteur de l’énergie ont finalement été détournées vers une révolte « populaire » sans perspective, piégée dans des conflits entre cliques bourgeoises qui aspirent au pouvoir. Chaque fois que les ouvriers se diluent dans le « peuple » en tant que « citoyens », réclamant à l’État bourgeois de bien vouloir « changer les choses », ils se condamnent à l’impuissance.
Afin de nous préparer à lutter, nous devons, partout où nous le pouvons, nous rassembler pour débattre et tirer les leçons des luttes passées. Il est vital de mettre en avant les méthodes de lutte qui ont fait la force de la classe ouvrière et lui ont permis, à certains moments de son histoire, de faire vaciller la bourgeoisie et son système :
– la recherche du soutien et de la solidarité au-delà de « son » entreprise, de « son » secteur d’activité, de « sa » ville, de « sa » région, de « son » pays ;
– la discussion la plus large possible sur les besoins de la lutte, quels que soient l’entreprise, le secteur d’activité ou le pays ;
– l’organisation autonome de la lutte, à travers des assemblées générales notamment, sans en laisser le contrôle aux syndicats, ni à aucun autre organe d’encadrement de la bourgeoisie.
L’autonomie de la lutte, l’unité et la solidarité sont les jalons indispensables à la préparation des luttes de demain !
Courant communiste international, janvier 2022
Le mouvement contre le CPE doit inspirer nos luttes futures
Récent et en cours:
- Coronavirus; Covid-19; lutte de classe [366]
- Inflation [367]
- Crise économique [368]
Rubrique:
Émeutes au Kazakhstan: Les luttes des travailleurs noyées dans les combats de factions bourgeoises
- 52 lectures
Début janvier, le Kazakhstan a été le théâtre de manifestations et d’émeutes violentes suite à la libéralisation du prix du gaz, ressource majeure pour la vie économique du pays et le quotidien de la population. L’augmentation du prix du gaz s’est ajoutée à celle des denrées alimentaires et de nombreux produits de base, générant une immense colère.
Une classe ouvrière attaquée mais très fragile
Face à cette dégradation considérable des conditions de vie, la classe ouvrière a, dans un premier temps, été aux avant-postes. Dans de nombreux centres ouvriers industriels, miniers ou gaziers, des grèves se sont déclenchées pour exiger des augmentations de salaires. La riposte sociale s’est répandue comme une traînée de poudre dans l’ensemble du pays, avec des manifestations massives qui se sont confrontées immédiatement aux forces de répression, voyant d’ailleurs un certain nombre de policiers changer de camp et rejoindre les manifestants.
La réalité d’un mécontentement ouvrier au Kazakhstan n’est pas nouvelle : déjà en 2011, à Janaozen, région riche en ressources pétrolières, quatorze ouvriers d’un site grévistes avaient été tués lors de la répression d’une manifestation contre les conditions de travail et les bas salaires. Le mouvement s’était ensuite étendu à la grande ville d’Aktau, sur les bords de la mer Caspienne, avant de se propager dans le reste du pays.
Ces dernières semaines, la répression s’est révélée encore plus féroce. Des dizaines, sinon des centaines de manifestants, sont tombés sous les balles des forces de l’ordre. Le pouvoir en place, avec à sa tête le président Tokaïev, n’a pas fait dans la dentelle, appelant même à la rescousse l’armée russe pour mater la rébellion « terroriste », annonçant ouvertement avoir « donné l’ordre de tirer pour tuer sans avertissement ».
Les ouvriers sont donc présents dans cette situation sociale dégradée. Mais ont-ils su, dans cette confrontation avec le pouvoir, développer leur lutte sur un véritable terrain de classe, comme force autonome ? Les violences dans la rue sont-elles l’expression de la lutte de la classe ouvrière ou celle d’une violence populaire, d’un mécontentement général de la population dans laquelle la classe ouvrière est diluée ?
Très rapidement, les revendications initiales contre l’inflation ont été détournées vers des revendications démocratiques, contre la corruption, contre le régime en place, avec des émeutes anti-Tokaïev dans la plupart des grandes villes du pays. Cette révolte populaire, dans laquelle les ouvriers se mêlaient à la petite-bourgeoisie (les commerçants étranglés par les prix, les professions libérales anti-Tokaïev, etc.), s’est ainsi très aisément faite instrumentaliser pour servir de masse de manœuvre dans un conflit entre cliques bourgeoises kazakhes, utilisées par le clan de l’ancien président Nazarbaïev.
Malgré les grèves ouvrières bien réelles, le prolétariat de ce pays n’a pas d’expérience majeure de lutte autonome, soumis en permanence à une chape de plomb dictatoriale et de fortes illusions démocratiques, nationalistes, et parfois religieuses. Il s’est ainsi facilement laissé entraîner sur un terrain bourgeois où il ne peut pas défendre ses propres intérêts de classe, ses propres revendications et, au contraire, ne peut qu’être noyé, utilisé, soumis à des intérêts bourgeois qui lui sont totalement étrangers.
Les rivalités bourgeoises au cœur du chaos
Au Kazakhstan, la dénonciation par le pouvoir des « terroristes » internationaux ou de « bandits » prêts à toutes les exactions lors des manifestations, cachait mal les rivalités internes qui font rage au sein de la bourgeoisie et dont le prolétariat fait les frais dans sa chair, aujourd’hui encore. L’ex-président Nazarbaïev qui avait démissionné en 2019 mais gardait la main mise sur l’ensemble du pays, particulièrement sur ses forces de répression comme le Comité national de sécurité (KNB), a clairement utilisé et manipulé les manifestations pour réagir aux ambitions du nouveau président Tokaïev qui veut accroître son influence dans le pays et s’émanciper du clan Nazarbaïev qui l’avait installé au pouvoir. Nazarbaïev a mobilisé ses partisans au sein même de la police et de l’armée, son « armée privée »(1) pour fragiliser le pouvoir de Tokaïev. C’est ainsi que des policiers ont reçu l’ordre de laisser se développer le chaos, au point que même certains ont rejoint les rangs des manifestants pour tenter d’affaiblir le camp adverse, ce qui explique également les assauts contre les bâtiments gouvernementaux ou l’aéroport d’Almaty. La clique du président Tokaïev a bien évidemment réagi : le directeur du KNB limogé, arrêté et emprisonné, arrestation de Karim Massimov, très proche de Nazarbaïev, ancien premier ministre, ancien chef des services de renseignements, pour suspicion de haute trahison. C’est la claire confirmation d’un panier de crabes entre bourgeois où tous les coups sont permis, où les ouvriers servent de chair à canon pour la clique adverse.
Concrètement, nous sommes loin d’une situation où les forces de répression bourgeoises s’effondreraient, faisant vaciller le pouvoir bourgeois pour rejoindre le prolétariat en passe de renverser l’État capitaliste ! Au contraire, il ne s’agit ni plus ni moins que des ambitions d’un clan bourgeois contre un autre ! Aujourd’hui, même si le clan Tokaïev a pu reprendre le contrôle de la situation sur un monceau de cadavres, d’exécutions sommaires, de milliers de blessés et de multiples arrestations, rien n’est réglé dans le fond, ni au Kazakhstan ni dans toute la région où les tensions impérialistes sont multiples et grandissantes.
Le Kazakhstan reste un enjeu impérialiste
Dans cette situation de décomposition politique, Tokaïev n’avait pas d’autre choix que de demander de l’aide à l’extérieur, particulièrement à l’OTSC,(2) cache-sexe de l’impérialisme russe enclin à renouer avec sa domination d’antan et qui a d’ailleurs réagi immédiatement par l’envoi de matériel et d’un contingent de 3 000 hommes pour soutenir la répression. L’OTSC envoyant quant à elle une centaine d’hommes seulement, expression de la défiance des autres États de ce « partenariat » à l’égard de Moscou. En intervenant directement, qui plus est à la demande de Tokaïev, l’impérialisme russe ne cache pas ses prétentions de vouloir défendre son influence sur des zones constituant l’ex-territoire de l’URSS alors que celles-ci sont désormais, comme au Kazakhstan, l’objet d’un « partenariat stratégique » avec les États-Unis dès la chute de l’URSS et convoitées avec insistance par la Turquie (membre de l’OTAN), et surtout, plus récemment, la Chine.
La Chine s’est ainsi félicité de cette répression et du rétablissement de l’ordre kazakh ! Pékin a, en effet, besoin du régime kazakh, maillon important de son programme d’investissement international des « routes de la soie », et donc besoin du calme social et de la paix des tombes, quitte à être pour l’instant sur la même longueur d’onde que Moscou. Pékin a également besoin du soutien, au moins implicite, du régime kazakh à sa politique répressive à l’égard des musulmans (Ouïgours) du Xinjiang.
Quant à l’Union européenne (UE) et aux États-Unis, soi-disant « très meurtris du fait qu’il y ait eu autant de victimes », ils appellent chacun à une « résolution pacifique » de cette crise, condamnant les violences de manière platonique et hypocrite. Si les grandes puissances « démocratiques » réagissent si platoniquement, c’est que le Kazakhstan ne semble pas être une cible prioritaire des prétentions impérialistes américaines. Par ailleurs, au sein de l’UE des clivages importants existent à propos de l’attitude à adopter envers la Russie.
Au bout du compte, les intérêts impérialistes rivaux restent l’ADN de ce capitalisme pourrissant, la priorité pour tous ces requins barbares, fourbissant tous leurs armes pour les épisodes de confrontations à venir : ils ont tous leur part de responsabilité dans les massacres et sont directement les sources majeures du chaos en cours.
La classe ouvrière n'a rien à gagner des conflits entre gangs bourgeois.
Si la classe ouvrière au Kazakhstan a tenté d’exprimer sa colère, à cause de la faiblesse de sa conscience, de son manque d’expérience, elle n’a pas su résister et encore moins représenter un obstacle aux luttes d’influence et aux affrontements entre cliques rivales au sein de la bourgeoisie kazakhe, comme face aux rivalités entre tous les requins impérialistes qu’ils soient russes, turcs, chinois, européens ou américains. Malgré la répression sauvage et le bain de sang, la colère ouvrière n’a évidemment pas disparu et de nouveaux épisodes de contestation face à la crise et à la répression sont à prévoir.
Mais en l’état actuel, en dépit des mouvements de grèves importants, ces moments de confrontation directe avec les forces de répression ne sont pas un tremplin pour le développement de sa propre lutte autonome et la défense de ses propres intérêts. Elle a, au contraire, tout à perdre dans un tel bourbier où ses revendications économiques sont stérilisées par les revendications démocratiques, nationalistes, utilisées par les factions bourgeoises prêtes à toutes les infamies. Ces illusions démocratiques sont, d’ailleurs, un piège qui reste à venir dans la mesure où les forces d’opposition nationales à visage « démocratique » ne sont en rien structurées et cherchent une visibilité et une crédibilité pour la suite, comme c’est le cas en Biélorussie.
La classe ouvrière kazakhe, seule, est hélas très exposée et vulnérable à ce type de pression idéologique. Même s’il n’en a pas actuellement la force, seul le prolétariat des pays centraux, ayant une expérience éprouvée de telles confrontations comme des mystifications nationalistes et démocratiques, peut montrer le chemin permettant aux ouvriers de se battre sur un terrain propice à la remise en cause de l’exploitation capitaliste et non pas se laisser happer par des mots d’ordre n’ayant pas d’autres logiques que la conservation de l’ordre social. Le devenir des luttes ouvrières qui commencent à se manifester partout dans le monde, passe par l’impulsion nécessaire de la lutte ouvrière dans les pays centraux.
Stopio, 20 janvier 2022
1 Selon tous les commentateurs bourgeois de la presse internationale.
2 Conglomérat politico-militaire de puissances impérialistes régionales (Biélorussie, Arménie, Kazakhstan Tadjikistan, Kirghizistan et Russie).
Géographique:
Personnages:
- Tokaïev [370]
- Nazarbaïev [371]
Récent et en cours:
- Kazakhstan [372]
Rubrique:
Permanence en ligne du 12 février 2022
- 37 lectures
Révolution Internationale, section en France du Courant Communiste International, organise une permanence en ligne le samedi 12 février 2022 à partir de 14h.
Ces permanences sont des lieux de débat ouverts à tous ceux qui souhaitent rencontrer et discuter avec le CCI. Nous invitons vivement tous nos lecteurs et tous nos sympathisants à venir y débattre afin de poursuivre la réflexion sur les enjeux de la situation et confronter les points de vue. N'hésitez pas à nous faire part des questions que vous souhaiteriez aborder.
Les lecteurs qui souhaitent participer aux permanences en ligne peuvent adresser un message sur notre adresse électronique ([email protected] [213]) ou dans la rubrique “nous contacter [214]” de notre site internet, en signalant quelles questions ils voudraient aborder afin de nous permettre d’organiser au mieux les débats.
Les modalités techniques pour se connecter à la permanence seront communiquées ultérieurement.
Vie du CCI:
- Permanences [291]
Rubrique:
ICCOnline - février 2022
- 48 lectures
Les maltraitances dans les maisons de retraite sont un produit de la barbarie du capitalisme
- 101 lectures
La publication de l’enquête de Victor Castanet, Les Fossoyeurs, a remis sur le devant de la scène médiatique le traitement barbare auquel sont soumises d’innombrables personnes âgées dans les maisons de retraite. Bien sûr, la bourgeoisie, gouvernement en tête, a feint la stupéfaction : Comment ? On maltraite les vieux dans les EHPAD ? C’est une « révélation » fracassante ! Alors, branle-bas de combat ! Convocation du directeur chez la ministre de l’Autonomie ! Indignation gouvernementale ! Enquêtes administratives !…
Un secret de Polichinelle enfin révélé ?
Quel cynisme ! Quelle ignominie de la part de tous ces faux indignés ! Ce n’est pourtant pas la première fois que de tels scandales éclatent. Si ces récentes publications ont le mérite de remettre sur le tapis des pratiques choquantes à grande échelle, elles n’ont de « révélations » que le nom. Il suffisait d’écouter, parmi tant d’autres, le cri de détresse du personnel de la maison de retraite des Opalines à Foucherans dans le Jura, en grève pendant cent jours, en 2017 ! Ou la colère des aides-soignants lors de la grève nationale de 2018 ! Ou les alertes répétées des familles restées lettres mortes pendant des années ! Il suffit de prêter l’oreille à l’angoisse des anciens redoutant l’heure fatidique où, faute de solutions, il faudra bien quitter la maison et rejoindre un EHPAD. La stupéfaction indignée de la bourgeoisie n’est qu’une triste farce car tout le monde sait pertinemment comment sont traitées les personnes âgées dans la plupart des établissements !
Partout, dans le privé comme dans le public, la politique des directions est, dans le fond, similaire : réduction drastique des coûts, y compris pour la bureaucratie d’État dans les établissements publics, obsédée par les chiffres de ses tableurs Excel, rentabilité et profits coût que coût dans les établissements privés. Partout, des contrats précaires pour ajuster le personnel en fonction du taux d’occupation des chambres, le manque chronique de matériel basique (gants, papier toilette…), bas salaires et formations insuffisantes. Tout cela ne peut que générer de la souffrance au travail pour les employés et de la maltraitance pour les « résidents ». Les salariés subissent non seulement une exploitation féroce et une course à la rentabilité les contraignant à traiter les personnes agées comme de la marchandise (sous peine de perdre leur boulot), mais ils sont aussi régulièrement culpabilisés par des directions qui, pour se dédouaner à l’annonce du moindre scandale, n’hésitent pas à pointer les « besoins en formation » (en langage clair : l’incompétence du personnel !). Devoir traiter de façon si indigne des personnes vulnérables qu’on côtoie au quotidien et avec qui on noue, forcément, des liens affectifs, c’est aussi une immense souffrance psychique : « On sait bien qu’on n’habille pas bien, qu’on ne lave pas bien. Faire face aux familles sachant ça, c’est dur », disait déjà une aide-soignante lors de la grève de 2018. (1)
Quant à la « clientèle » (parce qu’il ne s’agit, finalement, que de cela !), les conditions d’existence sont tout bonnement révoltantes. Les sous-effectifs se traduisent par des toilettes bâclées et irrégulières parce que le temps dont dispose le personnel pour des personnes dépendantes est souvent de moins de dix minutes, par des petits vieux dormant parfois dans leurs urines parce que les deux aides-soignantes de nuit sont débordées et que les « résidents » n’osent pas déranger, ou par des assistances au moment des repas de cinq à six personnes en même temps, voire plus… La maltraitance est parfois cauchemardesque : les cas de malnutrition ou de déshydratation, voire de brutalisation physique, sont nombreux. Des témoignages ont même rapporté que des personnes âgées tombées au sol n’étaient pas relevées pendant des heures et que d’autres, en pleine crise de démence, étaient enfermées dans leur chambre, comme en prison. Les 390 pages du livre de Victor Castanet sont pleines de scènes plus ignobles les unes que les autres.
Public ou privé : le responsable, c’est le capitalisme
Pour le capitalisme, les vieux, comme les handicapés, les marginaux ou les clochards, ne sont que des bouches inutiles à nourrir, des improductifs aux yeux de l’État et des patrons, des « assistés », tout juste bons à se faire « plumer » par des rapaces comme ceux du groupe Orpea. Dans les sociétés du passé, les anciens étaient respectés parce que leur expérience était un trésor à transmettre aux générations futures. Dans le monde sans lendemain de la bourgeoisie, la « personne dépendante », si elle veut survivre, doit être solvable, parce que les maisons de retraite, au même titre que n’importe quelle entreprise, doivent faire l’objet d’un « retour sur investissement ». Pour ce faire, tous les moyens sont bons pour rogner sur les coûts et employer un minimum de personnel.
Mais toute la campagne médiatique et la fausse indignation du gouvernement contre le « cynisme pur » de ce « groupe privé » n’est qu’une tartuferie ! D’abord parce que l’État finance grassement ce juteux business et qu’il est censé assurer un contrôle, via les Agences régionales de santé notamment, d’une inefficacité criante : il faut dire que les effectifs d’inspecteurs n’ont cessé de fondre d’année en année.
Mais, surtout, dans les maisons de retraite publiques, la situation n’est pas meilleure ! Partout, les mêmes coupes budgétaires et les mêmes suppressions de poste ont engendré la même maltraitance et la même souffrance au travail. Contrairement aux balivernes des gauchistes, défenseurs zélés de l’État « social », ce dernier n’échappe pas à la logique capitaliste de la rentabilité. Face à la concurrence sans limite entre nations, il doit aussi assurer la rentabilité maximum dans ses services, minimiser les coûts et maximiser l’exploitation. Pour l’État, le bien être des vieux, surtout ceux de la classe ouvrière, ne sont pas un investissement profitable mais une charge insoutenable. Dans un contexte de décomposition des rapports sociaux qui fondent toute vie en société, même le plus simple vernis « morale » n’a plus prise : si l’État accepte de « prendre en charge la dépendance », c’est parce que s’occuper à plein temps de personnes âgées est un frein à l’exploitation de leurs enfants qui doivent, par contre, assurer l’énorme charge financière. Le soi-disant « État providence », « garant » de la « solidarité », n’est qu’un mythe ! Dans la réalité, c’est le plus féroce et le plus cynique de tous les patrons !
En polarisant à nouveau la responsabilité des violences dont sont victimes les personnes âgées sur tel ou tel « groupe privé », sur tel ou tel directeur crapuleux, sur tel ou tel « manquement dans les contrôles », la bourgeoisie et ses médias cherchent, encore une fois, à détourner l’indignation du prolétariat du terrain de la réflexion sur les racines de cette barbarie. La violence dans les rapports sociaux et la maltraitance dans les maisons de retraite sont non seulement à l’image de la barbarie du capitalisme, mais elles en sont également le produit direct.
EG, 5 février 2022
1« Chez Orpea, la fin de vie se paye au prix fort », Mediapart (29 janvier 2018). Signalons que l’article date de 2018 et concernait déjà le groupe Orpea aujourd’hui mis sur le banc des accusés.
Situations territoriales:
Récent et en cours:
- EHPAD [373]
- maison de retraite [374]
- Orpéa [375]
Rubrique:
Qu’est-ce que le combat historique de la classe ouvrière? (Partie 2)
- 90 lectures
Dans la première partie de l’article [376], nous avons mis en évidence que ce sont les fondements économiques qui déterminent la composition de la classe ouvrière, fondements économiques sur lesquelles la bourgeoisie tente de mettre un voile en opérant un tour de passe-passe idéologique visant à faire croire que la classe ouvrière n’existe plus. Cette base économique détermine les oppositions de classe et, donc, la lutte de classe. Cette deuxième partie vise à répondre aux courriers de la camarade Pomme au sujet du rapport de force entre les classes. Rappelons d’abord la façon dont la camarade expose le problème dans son courrier (1) : « le matérialisme dialectique permet de comprendre que l’histoire des hommes repose sur une dynamique, un processus fruit des antagonismes de classes et que ces classes se définissent, donc, dans et uniquement dans ce rapport de force ».
Plus loin, la camarade rajoute : « La frontière de classe se réalise et se pense dans la lutte : quels sont les mouvements, les discours et les prises de position qui correspondent aux nécessités révolutionnaires du prolétariat et de ce fait apparaît qui appartient au prolétariat ou non. […] Le prolétariat en tant que classe n’existe qu’au sein de la lutte, non dans le sens où il n’existerait que dans les périodes de mouvements ouvriers, mais que son existence ne peut se penser que dans le rapport de force qui l’oppose à la bourgeoisie ».
La vision développée par la camarade l’amène à défendre une vision schématique du processus de développement de la conscience de classe et du combat pour la perspective révolutionnaire. Si les luttes en tant que telles en sont un des creusets, elles n’en forment pas le seul terrain. Pour la camarade, ce combat semble se réduire essentiellement à une réaction à son exploitation. Mais c’est perdre de vue que ce combat, portant en lui la perspective révolutionnaire, repose avant toute chose sur une vision historique.
Le projet communiste comme produit historique de la conscience prolétarienne
C’est sur la base de la défense de ses intérêts économiques que le prolétariat pourra retrouver son identité de classe, condition indispensable pour développer son combat révolutionnaire et intégrer toutes les oppressions générées par le capitalisme. Contrairement aux classes révolutionnaires du passé, la classe ouvrière ne peut pas construire son projet de société au sein de l’ancienne société, le communisme étant la négation de l’exploitation et de la propriété privée des moyens de production qui permet cette exploitation. C’est un immense défi pour la classe révolutionnaire, car il s’agit de libérer l’humanité des chaînes de l’exploitation, ce dont aucune des classes révolutionnaires précédentes (comme la bourgeoisie contre le système féodal) n’a jamais été porteuse. Or, le chemin qui mène à son émancipation est semée d’obstacles dressées par la bourgeoisie qui tente d’entraver le combat révolutionnaire de la classe ouvrière en exploitant ses illusions, son manque de confiance en elle. Une telle dynamique n’est pas linéaire, mais plutôt en dents de scie, avec des phases d’avancée et des phases de reflux, déterminant ainsi le rapport de force entre les classes. Comme le prolétariat est une classe exploitée au sein de la société bourgeoise, il subit tout le poids des idées dominantes qui sont celles de la classe dominante et en même temps, étant au cœur des contradictions du capitalisme, il est amené à s’opposer à lui et à se projeter dans l’avenir. C’est cette caractéristique du prolétariat qui donne à sa lutte un caractère heurté, où chaque période de reflux permet cependant de tirer les leçons de ses expériences afin d’enrichir la conscience de la classe ouvrière.
Rappelons que Marx et Engels ne sont pas les « inventeurs » de la lutte de classes, ce phénomène avait déjà été mis en évidence par des penseurs bourgeois avant eux. En revanche, leur apport théorique réside dans le fait que cette lutte de classe porte en elle un projet de société radicalement opposé au capitalisme : le communisme. Tant que les conditions matérielles n’étaient pas réunies, le développement des forces productives restant insuffisant et la classe porteuse de ce projet pas encore totalement constituée, le communisme ne pouvait être qu’une « belle idée ». Le développement de l’exploitation capitaliste et les premiers conflits entre bourgeois et prolétaires sécrétèrent au sein de la classe ouvrière les premières esquisses d’un programme communiste, présentées de façon rudimentaire certes, mais qui font partie du patrimoine du prolétariat, comme la conjuration des Égaux et les écrits de Babeuf sous la Révolution Française de 1789. Chaque grande étape des luttes ouvrières apporta des améliorations et une clarification de ce projet : les insurrections de 1848, la Commune de Paris en 1871, la grève de masse en Russie de 1905, la vague révolutionnaire de 1917-1923. Toutes ces expériences sont le fruit d’un combat dans lequel évolue la conscience, les leçons restant inscrites dans la mémoire historique du prolétariat. C’est la traduction pratique de ce que disaient Marx et Engels dans le Manifeste du Parti communiste : le capitalisme a créé son propre fossoyeur. Ses seules armes sont sa conscience et son organisation, son unité grandissante au-delà de toute division de sexe, de race, de religion et de nation. La révolution communiste sera donc le produit historique du combat titanesque entre la bourgeoisie et le prolétariat et non le produit d’un simple rapport de force saisi à un moment donné de manière abstraite, en dehors de tout contexte et sans avoir au préalable analysé où en est la lutte de classe, dans quel contexte historique elle évolue, où en est le prolétariat, quelle est la stratégie de la bourgeoisie… Pour le dire plus simplement, nous ne pouvons pas analyser le rapport de force entre les classes si nous ne le remettons pas dans un cadre historique. La condition nécessaire pour que ce projet aboutisse étant que la classe qui en est porteuse en soit consciente.
La classe ouvrière est la classe de la conscience
Dans sa contribution, la camarade nous dit : « Je souscris à cette description qui pose clairement la place occupée par le prolétariat dans les rapports de production (elle est une classe exploitée) et qui détermine le caractère révolutionnaire de la classe ouvrière ». Or, le fait d’être une classe exploitée ne suffit pas pour être une classe révolutionnaire. Dans le capitalisme, au niveau mondial, il existe des paysans pauvres exploités par des États, des banques ou des usuriers qui prélèvent, sur le fruit de leur travail, des impôts, ou des intérêts sur des dettes contractées pour pouvoir subsister. Comme nous le disons dans la Revue Internationale n° 73 : « En réalité, dans la mesure où l’abolition de l’exploitation se confond, pour l’essentiel, avec l’abolition du salariat, seule la classe qui subit cette forme spécifique d’exploitation, c’est-à-dire le prolétariat, est en mesure de porter un projet révolutionnaire. Seule la classe exploitée au sein des rapports de production capitalistes, produit du développement de ces rapports de production, est capable de se doter d’une perspective de dépassement de ces derniers. » Dans ce même article, il est indiqué : « le capital a concentré la classe ouvrière dans des unités de production géantes, qui n’ont rien à voir avec ce qui pouvait exister du temps de Marx. En outre, ces unités de production sont elles-mêmes, en général, concentrées au cœur ou à proximité de villes de plus en plus peuplées. Ce regroupement de la classe ouvrière, tant dans ses lieux d’habitation que de travail, constitue une force sans pareil dès lors qu’elle sait le mettre à profit, en particulier par le développement de sa lutte collective et de sa solidarité. Une des forces essentielles du prolétariat est sa capacité de prise de conscience. Toutes les classes, et particulièrement les classes révolutionnaires, se sont données une forme de conscience. Mais celle-ci ne pouvait être que mystifiée, soit que le projet mis en avant ne puisse aboutir (cas de la guerre des paysans en Allemagne, par exemple), soit que la classe révolutionnaire se trouve obligée de mentir, de masquer la réalité à ceux qu’elle voulait entraîner dans son action mais qu’elle allait continuer à exploiter (cas de la révolution bourgeoise avec ses slogans “Liberté, Égalité, Fraternité”). N’ayant, comme classe exploitée et porteuse d’un projet révolutionnaire qui abolira toute exploitation, à masquer ni aux autres classes, ni à lui-même, les objectifs et les buts ultimes de son action, le prolétariat peut développer, au cours de son combat historique, une conscience libre de toute mystification. De ce fait, celle-ci peut s’élever à un niveau de très loin supérieur à celui qu’a jamais pu atteindre la classe ennemie, la bourgeoisie. Et c’est bien cette capacité de prise de conscience qui constitue, avec son organisation en classe, la force déterminante du prolétariat ».
Quelle est la fonction des organisations révolutionnaires ?
La camarade nous dit « la frontière de classe se réalise et se pense dans la lutte » et précise par la suite : « quels sont les mouvements, les discours et les prises de position qui correspondent aux nécessités révolutionnaires du prolétariat et de ce fait apparaît qui appartient au prolétariat ou non ». Contrairement à ce que dit la camarade, les frontières de classe ne se définissent pas au cours de la lutte, elles sont le produit historique du combat de classe. Si la classe, à chaque fois qu’elle lutte, devait ré-expérimenter les leçons que nous a léguées son combat historique, son combat révolutionnaire s’en trouverait affaibli et son but historique risquerait de ne pas se réaliser. Prenons l’exemple des syndicats, auxquels la classe doit se confronter pour développer son combat. Les leçons tirées de l’histoire de la lutte de classes nous permettent d’affirmer que cela fait plus d’un siècle qu’ils sont passés avec armes et bagages dans le camp de la bourgeoisie, devenant ainsi un organe de l’État bourgeois visant à saboter, voire réprimer toute action autonome de la classe ouvrière. Or, comme on peut le voir dans les dernières luttes, et même si nous remontons encore plus loin, lors du mouvement contre la réforme des retraites en France, durant l’hiver 2019/2020, la classe a laissé les syndicats organiser sa lutte, en raison de son manque de confiance en elle et de la faiblesse de sa conscience de classe, la rendant vulnérable à l’égard des mystifications et des illusions véhiculés par ces ennemis de classe que constituent les syndicats. Il revient aux organisations révolutionnaires, qui sont la mémoire de toutes ces expériences du passé, qui, dans une continuité historique, et en fonction de l’évolution du combat de classe, ont la responsabilité d’intervenir afin de pousser le prolétariat à développer sa lutte et montrer quels sont les obstacles qui l’entravent. En se focalisant uniquement sur les ressorts des luttes ouvrières, la camarade semble largement sous-estimer l’importance fondamentale du rôle des révolutionnaires, une telle vision l’amenant à occulter le fait que la conscience est une force matérielle agissante, intégrant dans les moments présents les leçons du passé dans la perspective du futur. Les organisations révolutionnaires sont le produit de tout l’effort que fait la classe pour son émancipation. C’est la classe qui leur confie la tâche d’être un élément agissant en son sein afin qu’elle développe sa conscience et ainsi réaliser sa tâche historique, abattre le capitalisme et libérer l’humanité de toute exploitation.
Comme nous l’avons toujours défendu : « l’intervention des révolutionnaires ne représente rien d’autre que la tentative pour le prolétariat d’arriver à la conscience de ses intérêts véritables en vue de dépasser la simple constatation empirique des phénomènes particuliers, en cherchant la relation avec ses principes généraux tirés de son expérience historique. Parce que la mise en avant incessante des frontières de classe, la clarification théorique de plus en plus profonde des buts historiques du prolétariat ne concrétisent en fin de compte que la nécessité pour celui-ci d’avoir pleinement conscience de sa pratique, l’existence des organisations révolutionnaires est bien le produit de cette nécessité. Parce que cette prise de conscience précède et complète à la fois la prise du pouvoir du prolétariat par les conseils ouvriers, elle annonce un mode de production où les hommes, enfin maîtres des forces productives, développeront celles-ci en pleine conscience pour que s’achève le règne de la nécessité et que commence celui de la liberté ». (2)
André, 20 janvier 2022
1 De très larges extraits du courrier ont été publiés dans Révolution internationale n°491 ainsi que sur notre site web.
Vie du CCI:
- Courrier des lecteurs [252]
Rubrique:
"Barbarie" ou communisme?
- 226 lectures
Un blog qui se nomme Barbaria dénonce le capitalisme et sa variante stalinienne, les syndicats et la gauche du capital, le féminisme et les luttes partielles, il s’élève contre la démocratie et le patriarcat, parle de lutte prolétarienne, prétend défendre le communisme comme alternative au capitalisme. Cependant, il nie la lutte de classe du prolétariat, il présente comme une « révolution » ce qui est plutôt la plongée dans la barbarie et, tout en se gargarisant de phrases remplies « de revendications de la Gauche communiste », cache soigneusement l’existence des groupes de la Gauche communiste.
Une négation du prolétariat dilué au milieu des « exploités de l’histoire »
La « lutte des classes » que Barbaria nous présente et le « prolétariat » dont il nous parle n’ont rien à voir avec la véritable lutte des classes et le véritable prolétariat. Barbaria nous explique : « Lorsque les tisserands lyonnais prennent les armes en 1831, la bourgeoisie a une mémoire de classe. Elle s’est souvenue des invasions de ces peuples primitifs qui ont assailli l’Empire romain et qu’ils appelaient barbares, parce que leur langue ressemblait à du bruit. Les tisserands de Lyon ne parlaient pas non plus une langue que la bourgeoisie pouvait comprendre. Dans la lutte séculaire entre la civilisation et la barbarie, la révolution s’exprime dans une langue qui n’est pas celle des maîtres, une langue que l’Empire de la civilisation ne peut atteindre. Chaque fois que les classes exploitées se sont soulevées dans l’histoire, elles ont apporté avec elles la même barbarie, la même communauté humaine contre l’exploitation. Barbaria est un lieu de mémoire. C’est là qu’est conservée l’histoire millénaire de notre classe, des communautés primitives à la communauté humaine mondiale ». (1)
Cette vision fait disparaître le prolétariat, dilué dans toutes les classes exploitées de l’histoire. Si le prolétariat est solidaire avec elles et intègre le meilleur de leur lutte, le prolétariat est différent en ce qu’il n’est pas seulement la classe exploitée sous le capitalisme, mais il est aussi la classe révolutionnaire. Les esclaves et les serfs n’ont pas pu mettre fin à l’exploitation, mais le prolétariat est la première classe exploitée de l’histoire qui a la capacité et la conscience pour mettre fin au capitalisme et créer une nouvelle société, le communisme.
Dans le cadre des débats au sein de la Ligue des communistes, Engels a écrit Les principes du communisme, (2) où il a montré pourquoi le prolétariat est différent des esclaves et des serfs et où, dans cette différence, réside sa nature révolutionnaire. Barbaria laisse tout cela de côté et soutient que les révoltes interclassistes, les « mouvements sociaux » tels que les « gilets jaunes » ou les manifestations au Chili ou en Équateur en 2019, seraient l’expression de la lutte des classes : « Une réalité faussement comprise tente de nous faire croire que nous vivons dans un monde sans révolutions ni révoltes. Il suffit de regarder de la Roumanie à l’Albanie, de l’Algérie à l’Irak, de la Bolivie à l’Équateur, de l’Argentine à Oaxaca, pour voir l’intensité des révoltes et des révolutions qui ont balayé la surface de la terre au cours des 25 dernières années, sans parler de l’intense processus de lutte de classe qui s’est déroulé en 2011 dans le monde arabe, au moment même où de nombreux sociaux-démocrates avaient annoncé la fin des révolutions […] L’avenir immédiat sera donc celui d’une intense lutte de classe. C’est un phénomène que l’on observe déjà depuis quelques mois dans des régions comme la Chine, l’Iran, l’Irak, le Kurdistan, Haïti… Et plus récemment, il a touché aussi la France avec le mouvement des ‘gilets jaunes’, la Hongrie ou la Tunisie ».
Aujourd’hui, le prolétariat souffre cruellement de la perte de son identité de classe, du manque de confiance en ses propres forces, Barbaria panse cette plaie en vendant comme « lutte des classes » la mobilisation interclassiste et nationaliste des « gilets jaunes » qui chantaient La Marseillaise et arboraient le drapeau tricolore avec lequel la Commune de Paris a été écrasée. (3)
La barbarie présentée comme « révolution »
Barbaria parle de « révolution ». Le changement de régime à Cuba en 1959 aux mains du castrisme nous a été vendu comme une « révolution ». L’éviction de Trump de la présidence américaine aurait été une « révolution citoyenne ». Les trotskystes transforment toute agitation dans un pays exotique en « révolution ». Barbaria apporte sa contribution à cette entreprise semant la confusion en nous parlant, comme nous l’avons déjà vu, de « révoltes et révolutions » en Irak (?), en Haïti (??), au Kurdistan (???), en Chine (????), chez les « gilets jaunes » (?????)…
Les émeutes et les convulsions que Barbaria amalgame sous le nom de « révoltes et révolutions » sont très différentes les unes des autres. Cependant, elles ont un point commun : elles n’ont rien à voir avec la lutte du prolétariat. Certaines sont des révoltes désespérées et nihilistes, d’autres sont des mouvements clairement bourgeois, d’autres des affrontements impérialistes. En Chine, par exemple, nous connaissons la rébellion nationaliste des Ouïghours ou le mouvement démocratique à Hong Kong. Quant au Kurdistan, Barbaria fait-il référence au mouvement guerrier et nationaliste du Rojava tant vanté par les anarchistes ? (4)
Mais en quoi consiste la révolution prolétarienne pour Barbaria ? Dans un texte intitulé « 11 points sur Marx », on peut trouver des choses très générales, formellement correctes, sur l’abolition des relations de production capitalistes, la dictature du prolétariat, la destruction de l’État, etc. Cependant, lorsqu’il s’agit d’être concret, nous trouvons des déclarations comme celle-ci : « La réponse de ces communes, comme celle de Puerto Resistancia, est une démonstration de la capacité de notre classe à construire des relations sociales en dehors de celles imposées par le capital et ses États, où, en même temps que les conditions matérielles de vie sont réorganisées, une révolution des valeurs et des relations humaines a lieu. Le monde n’est plus inversé, comme c’est le cas sous le capitalisme, et les besoins sociaux ont la priorité sur tout autre critère (comme l’accumulation illimitée de capital) dans les décisions que prennent les communes sur l’utilisation des ressources disponibles et les efforts qui sont consacrés à leur réalisation. Tout est chamboulé. Ainsi, par exemple, une militante des luttes environnementales, qui avait jusqu’alors besoin d’une escorte face aux multiples menaces et assassinats des paramilitaires, se promène désormais librement, sans crainte, parmi ses voisins. La mobilisation prolétarienne lui a rendu sa sécurité, elle a stoppé la violence du capital dans les espaces où notre classe a imposé sa logique de vie (contre la logique de mort du capital). » (5)
De ce passage, on peut tirer une série de conclusions :
– les relations sociales pourraient être construites en dehors de celles imposées par le capital, au sein même du capitalisme ;
– il y aurait une « révolution dans les valeurs et les relations humaines » (sic !) ;
– au sein du capitalisme, « on pourrait faire en sorte que les besoins humains aient la priorité sur l’accumulation capitaliste" !
En bref, les « révoltes et révolutions » présentées par Barbaria prouveraient des idées telles que :
– le communisme peut déjà être créé au sein du capitalisme ;
– des « espaces libérés » pourraient être créés à partir de la répression de l’État capitaliste ;
– l’économie pourrait être changée sans avoir besoin de détruire le capitalisme…
En d’autres termes, la négation de tout ce qui est « théoriquement » affirmé dans les « 11 points sur Marx ».
Le passage sur la « commune de Puerto Resitancia » à Cali en Colombie présente comme des actes « révolutionnaires » des événements qui expriment l’éclatement de la société en fragments où de petites communautés se protègent désespérément, sans avenir, de la dislocation des relations sociales. Les couches sociales marginalisées, les prolétaires individuels, sont emportés dans le tourbillon de la décomposition et cela est glorifié par Barbaria comme « les lueurs annonciatrices d’une société nouvelle, les étincelles du communisme, les balbutiements, les débuts, de la constitution révolutionnaire d’une classe qui refuse de succomber aux côtés d’un capitalisme moribond ». Pour couronner le tout, Barbaria propose comme alternative de généraliser ce naufrage dans la barbarie à l’échelle mondiale : « Ce que nous voyons à travers l’expérience des communes de Cali ou de Medellin, ou dans les quartiers de Santiago du Chili, est encore insuffisant, ces nouvelles relations sociales ne peuvent s’imposer à la logique du capital qu’au niveau mondial ».
Barbaria revendique la « barbarie » ! Le prolétariat appartiendrait à « la lutte millénaire entre la civilisation et la barbarie », et sa lutte rappellerait les « barbares antiques qui ont pris Rome d’assaut ». Nous nous demandons si cette « revendication » relève de la plus effroyable confusion ou d’une volonté délibérée de présenter le glissement croissant du capitalisme vers la barbarie comme la « perspective révolutionnaire ». Les promoteurs propagandistes de Barbaria doivent l’expliquer.
Cependant, ce qui est très clair pour nous, c’est, tout d’abord, que la civilisation qui naît avec les modes de production esclavagiste, féodal, asiatique despotique et capitaliste, est la pire et la plus sophistiquée forme de barbarie parce qu’elle est institutionnalisée et sanctifiée dans l’État avec ses armées, sa police, ses prisons, ses tribunaux……
Deuxièmement, comme Engels l’avait annoncé en 1890, l’alternative qui se présente à l’humanité est la barbarie ou le communisme. Le visage de la barbarie se dessine de plus en plus rapidement aujourd’hui avec le Covid-19, le désastre écologique, les guerres impérialistes, le chaos croissant… Le tour de passe-passe de Barbaria consistant à inclure le prolétariat dans la « tradition des barbares » et nous montrer comme des « étapes vers la révolution », ce qui n’est rien d’autre que des manifestations de l’enfoncement dans la barbarie.
La Gauche communiste existe-t-elle aujourd’hui ?
Barbaria parle beaucoup de la Gauche communiste, sur son blog, on trouve plusieurs articles : « Amadeo Bordiga, un dinosaure du communisme » (sic !) ; « Sur la fondation du PC d’Italie et de la Gauche communiste italienne » ; « Le passé de notre être » (6), etc.
Les camarades de Programa Comunista font une critique assez judicieuse de l’article sur Bordiga. (7) Ils dénoncent la manipulation de Barbaria qui détache Bordiga de la lutte des groupes de la Gauche communiste pour tenter de « définir un apport personnel de Bordiga qu’il s’approprie pour y construire sa propre théorie, sa vision particulière des problèmes qui ne peuvent être abordés, en termes marxistes, qu’à partir du travail anonyme et collectif de l’organe du parti ».
Les camarades du PCI soulignent que la biographie de Bordiga par Barbaria « est soigneusement découpée en 1929 et laisse de côté tout le travail que, depuis l’après-guerre, Bordiga et tant d’autres camarades ont fait pour restaurer le marxisme ».
Cette amputation est également évidente dans les autres textes de Barbaria qui parle de la Gauche communiste en Allemagne, en Russie, etc., mais seulement jusqu’à la fin des années 1920. Il parle de Bilan sans dire un mot de ses continuateurs, Internationalisme et le CCI. Nous ne trouvons pas la moindre trace des groupes actuels de la Gauche communiste, du CCI, de la TCI, de Programme communiste……
Nous n’allons pas spéculer sur les raisons de cet oubli, c’est à Barbaria de l’expliquer. Cependant, il y a une conclusion que tout lecteur peut tirer de cette absence : la Gauche communiste appartiendrait à un passé lointain, que l’on pourrait étudier comme un « fonds documentaire » dans lequel on pourrait puiser les interprétations qui conviennent à ses propres intérêts. La conséquence est évidente : le prolétariat est privé de sa principale force, la continuité historique critique de ses organisations communistes, le fil historique qui va de la Ligue des communistes aux petits groupes actuels de la Gauche communiste. La méthode de Barbaria consiste à faire disparaître ces derniers de l’horizon, en donnant à comprendre au prolétariat et à ses minorités révolutionnaires qu’il ne dispose pas de cet héritage historique fondamental. Cette amputation de la mémoire contre notre classe n’est pas nouvelle. On assiste ces derniers temps à des entreprises comme celle de Nuevo Curso qui ignore totalement les groupes de la Gauche communiste pour chercher à se faire passer comme « Gauche communiste », en se basant sur une resucée de positions du révolutionnaire Munis qui n’a pas réussi à rompre réellement avec le trotskysme. (8)
Il est possible que les promoteurs de Barbaria ne soient pas d’accord avec les positions que nous défendons au sein du CCI ou avec celles d’autres groupes actuels de la Gauche communiste. L’analyse que nous avons faite ci-dessus le démontre clairement. Comme pour n’importe quelle organisation qui a l’intention de prendre la Gauche communiste comme base de son activité organisée (alors que Barbaria laisse entendre que la Gauche communiste serait « le passé de son propre être »), ce que ce groupe devrait faire est de s’engager dans un débat large et profond avec les organisations qui aujourd’hui se réclament de la Gauche communiste. Si finalement, après un débat approfondi, il arrivait à la conclusion qu’elles défendent des positions erronées, la formation d’un nouveau groupe serait alors une contribution possible. Mais ce qui est malhonnête, c’est de parler de la Gauche communiste en laissant entendre qu’elle appartiendrait « au passé de l’être » de Barbaria, et, en même temps, d’ignorer totalement les groupes actuels de la Gauche communiste.
Nous pensons que la contribution que nous apportons doit être soumise à un débat critique et non ignorée. Nous nous en tenons à ce que la fraction Bilan signalait dans le premier numéro de sa revue (novembre 1933) : « Notre fraction revendique un long passé politique, une profonde tradition dans le mouvement italien et international ; un ensemble de positions politiques fondamentales. Mais il ne prétend pas s’appuyer sur ses précédents politiques pour exiger l’adhésion aux solutions qu’il préconise pour la situation actuelle. Au contraire, elle invite les révolutionnaires à soumettre à la vérification des événements les positions qu’elle défend aujourd’hui, ainsi que les positions politiques contenues dans ses documents de base ».
Acción Proletaria, organe du CCI en Espagne, 26 octobre 2021
1 « Qui sommes-nous ? », Barbaria.net
2 F. Engels, Principes du communisme [378] (1847).
3 Voir notamment parmi autres articles que nous lui avons consacré :
– « Le tract d’intervention de la CCI sur le piège du mouvement des Gilets jaunes [379] »
4 Voir notre article : « Les anarchistes et l’impérialisme kurde [381] » en espagnol.
5 « Por qué lucha el proletariado en Colombia » [382], Barbaria.net.
6 Voir sur le site Barbaria.net :
– « Amadéo Bordiga, un dinosaurio del comunismo » [383]
– « Sobre la fundacion del PCDI y la izquierda comunista italiana » [384]
– « El pasado de nuestro ser » [385]
7 Voir l’article du Parti communiste international (PCI-Programme) en espagnol : « Grupo Barbaria, el bordiguismo a la carta » [386], El proletario n° 22 (janvier – avril 2021).
Rubrique:
Élection présidentielle en France: Pourquoi la bourgeoisie tient-elle tant à nous faire voter?
- 209 lectures
Comme à chaque élection présidentielle, toute l’artillerie électorale de l’État bourgeois est à l’œuvre pour rameuter la classe ouvrière vers les urnes. La bourgeoisie a besoin de cette mystification pour maintenir l’illusion que les choses peuvent changer en mieux dans le cadre de la société capitaliste, et assurer sa légitimité aux yeux des exploités.
Mais avec le discrédit croissant des partis traditionnels de gouvernement (PS et LR, en particulier), les élections ne font plus recette comme avant, renforçant l’hypothèse d’une forte abstention. C’est même un vrai casse-tête pour la bourgeoisie de rendre tout ce cirque crédible alors que sa faillite morale, politique, économique s’étale au grand jour.
L’indiscipline croissante des cliques bourgeoises
Au-delà du spectacle mystificateur des élections, ce qui apparaît de plus en plus nettement, c’est l’indiscipline croissante des cliques bourgeoises dans le paysage politique, en France comme à l’échelle internationale. En effet, le poids de la décomposition sur l’ensemble de la société pousse les différentes cliques concurrentes à s’entre-déchirer de façon encore plus ostentatoire, à coups de trahisons, de volte-faces ou de ralliements opportunistes.
Le système des primaires, qui devait avoir un rôle régulateur et permettre que sorte du chapeau un candidat incontesté pour chacun des différents groupes politiques, n’a fait que contribuer à la débandade et montrer leur difficulté à résister aux pressions centrifuges de la décomposition. Il suffit de regarder ce qui s’est passé à droite, avec les LR, où la tentative de hold-up de Xavier Bertrand et l’intensité des luttes internes ont bien failli hypothéquer la capacité du « parti de l’ordre » à présenter une candidature unique.
Cette tendance au chacun pour soi, au carriérisme, à la lutte d’ego s’exprime aussi de manière éclatante à gauche. Les écologistes se sont livrés une bataille acharnée entre la tendance « social-démocrate » incarnée par Jadot et la « radicalité » sociétale affichée par Rousseau. Quant au Parti socialiste, le naufrage de la candidate Hidalgo suite à ses innombrables volte-faces, n’a fait que renforcer les luttes internes pour sauver les strapontins qui peuvent encore l’être aux élections législatives.
Face à cette situation d’éclatement de la gauche, la bourgeoisie qui s’est voulue innovante, moderne, au fait de l’évolution des « aspirations » de la société, s’est dotée d’un nouvel outil de propagande, présenté comme encore « plus démocratique » : la « primaire populaire » qui a réuni près de 400 000 participants (c’est-à-dire plus que les primaires LR, EELV et FI réunies). Les candidats étaient évalués à la « sauce démocratique » revisitée : du « très bien » au « passable ». Le résultat fût une pagaille sans nom entre les écuries en lice, accouchant d’une candidature qui a aussi pris la forme d’une tentative de hold-up, celle de la prétendue « égérie » de la gauche, Taubira, ex-ministre de Valls et de Hollande.
S’il semble que la gauche de gouvernement n’ait pas eu de véritable intention de jouer la « victoire » à la présidentielle, la bourgeoisie s’inquiète, malgré tout, de la disparition de structures fiables sur lesquelles elle a pu compter auparavant en tant que force d’encadrement et de mystification du prolétariat. Et ce n’est pas l’appui surprise opportuniste de Ségolène Royal à Mélanchon qui fera la différence !
Le piège du populisme et de l’anti-populisme
À l’extrême droite, la nouvelle carte Zemmour vient encore entacher le sérieux de l’élection. Les scores annoncés des partis populistes posent problème au reste de la bourgeoisie, même si la « mise en orbite » médiatique de la candidature de Zemmour avait initialement comme fonction de diviser et affaiblir électoralement le camp de l’extrême droite.
La persistance de l’extrême droite et du populisme n’est pas un phénomène spécifique à la France. C’est même une expression de la perte de contrôle toujours plus grande de la classe dominante sur la conduite de sa politique, contrainte de laisser se développer au sein de son appareil politique, des fractions totalement irrationnelles qui pourraient affaiblir la capacité à gérer au mieux les intérêts du capital national et accélérer la crise historique du capitalisme, comme on a pu le voir avec Trump aux États-Unis ou avec le Brexit au Royaume-Uni. Le populisme s’est ainsi implanté dans de nombreux pays : Autriche, Pologne, Danemark, Canada, Inde, Turquie, Tchéquie, Portugal, etc. Ces groupes prétendent et parviennent, petit à petit, à prendre leur place aux côtés des partis traditionnels, de même que l’ancrage et l’influence persistante du « trumpisme » aux États-Unis, malgré la défaite de Trump. Une partie de la classe ouvrière précarisée et atomisée se trouve ainsi happée par cette propagande qui se présente comme étant « anti-système » et ne s’est pas encore trop mouillée avec l’exercice du pouvoir.
La bourgeoisie essaie d’utiliser Zemmour au mieux de ses intérêts. Face au prétendu « péril fasciste », les prolétaires sont priés de se rendre aux urnes pour défendre l’État démocratique bourgeois. Il est vrai que la ficelle de l’anti-fascisme (ou de l’anti-populisme) n’est plus aussi efficace qu’auparavant, comme lorsque la bourgeoisie avait fait sortir la population dans les rues en 2002 pour protester contre l’accession de Le Pen-père au second tour de la présidentielle. Aujourd’hui, de nombreux « électeurs » ont bien compris que le RN était avant tout utilisé comme épouvantail au profit de partis « de gouvernement » dont la politique anti-migratoire et les représsions brutales n’ont rien à envier aux propositions des Le Pen.
Mais les outrances et les discours immondes de Zemmour facilitent grandement l’idéologie anti-fasciste. On a ainsi pu voir les partis et les médias de gauche affirmer que nous étions dans une période « pré-fasciste ». Les manifestations « contre le populisme » se sont également multipliées à chaque déplacement du candidat « Z ».
À ce petit jeu sordide, la bourgeoisie prend cependant des risques : Le Pen va finir par apparaître moins comme une candidate populiste que « démocratiquement acceptable », respectueuse des Institutions, ne faisant plus peur à personne.
Les élections contre la classe ouvrière
Les élections sont une vraie arme de guerre contre la classe ouvrière consistant à entraver la capacité de celle-ci à prendre conscience qu’elle demeure la seule force sociale capable de combattre la barbarie capitaliste. Il s’agit de lui faire croire qu’elle fait partie d’une même « nation » constituée d’individus et de « catégories » diverses : les jeunes, les femmes, les retraités, les handicapés, les LGBT, les classes moyennes, etc., pour mieux lui faire oublier qu’elle est une classe exploitée par une autre et que son intérêt réside, non pas dans la perpétuation d’un capitalisme prétendument « mieux géré » et « plus humain », mais dans la destruction de ce système et de ses États !
Tous les appels à participer au cirque électoral ne font que renforcer le mensonge présentant les élections comme un véritable choix pour les exploités. Ils livrent individuellement les prolétaires à la propagande de la bourgeoisie : une classe sociale qui gagne toujours les élections. N’oublions pas que la « démocratie » est la forme la plus hypocrite de la domination de la bourgeoisie pour assurer l’exploitation capitaliste.
Toutes les fractions de la bourgeoisie sont également réactionnaires. Tous les soi-disant partis ouvriers, socialistes, communistes, les organisations gauchistes participent à cette mascarade électorale afin de contenir et détourner le prolétariat de son combat révolutionnaire.
Après les « marches pour le climat », EELV comme l’ensemble des partis de gauche, vont profiter d’un temps d’audience non négligeable pour distiller leurs fausses solutions (comme la « décroissance » ou la « taxation des pollueurs », par exemple). Le « vote de survie » pour le climat proposé par EELV tente de rameuter la jeunesse en direction des urnes, même si, pour le moment, il semblerait que leurs gesticulations soient infructueuses et ne paient pas vraiment électoralement parlant. Cela, sans jamais remettre en cause le système capitaliste.
Du côté de La France insoumise, et son chef Mélenchon, dont les colères théâtralisées animent les débats sur les plateaux de télévision, le discours pseudo-radical n’est qu’un poncif éculé de l’idéologie républicaine. Derrière les fables de la « redistribution des richesses », du « renouveau du service public » et de l’ « économie verte », Mélenchon et sa clique n’ont qu’un seul objectif : faire croire au « peuple » que son intérêt réside dans la défense de la République et de la nation !
Les organisations gauchistes (principalement le NPA et LO) ont également leur place réservée dans ce cirque électoral. Eux aussi participent pleinement à entretenir un double discours : d’un côté, il n’y a rien à attendre des élections, mais d’un autre, ils présentent systématiquement des candidats quand ils ne soutiennent pas ouvertement le PS comme ils ont pu le faire en appelant à voter Miterrand en 1981… C’est leur fonction mystificatrice, d’ailleurs, et pour ce qui est de leur participation aux élections bourgeoises en France, depuis de nombreuses décennies, les trotskistes jouent pleinement leur rôle de soutien à la bourgeoisie nationale comme rabatteurs visant à redonner crédit aux institutions. Renvoyer la lutte ouvrière à la participation à un scrutin revient à demander aux exploités de se livrer pieds et poings liés à leurs exploiteurs comme somme d’individus et non comme une classe combative.
Sans préjuger du résultat de la prochaine élection, tant la situation semble instable, il apparaît que la bourgeoisie a pleinement conscience que le cirque électoral s’organisant autour de l’alternance des partis traditionnels, la « social-démocratie » et des conservateurs, est usé et rejeté. La situation politique risque à l’avenir de devenir plus confuse, plus chaotique et imprévisible.
Pour l’heure, la grande préoccupation de la bourgeoisie est l’abstention : alors que l’incurie dont elle fait preuve dans la gestion du Covid et son incapacité à endiguer la crise sautent aux yeux, la bourgeoisie cherche à limiter l’abstention massive qui est annoncée face au sentiment de dégôut des exploités. La classe ouvrière sait faire les comptes des promesses non tenues, elle a accumulé une méfiance envers les élections bourgeoises, elle a partiellement assimilé, au fil de son expérience historique, le fait que ces élections ne peuvent absolument rien changer à ses conditions de vie, d’exploitation et qu’elles ne sont, en définitive, qu’un piège pour l’entretenir dans des illusions et de faux espoirs sur le futur. Mais cela ne signifie pas qu’elle soit en mesure de rejeter clairement la mystification démocratique et avancer sur la voie de la remise en cause du système capitaliste. Pour cela, il lui faudra mener un combat, prendre en main ses luttes pour affirmer sa perspective révolutionnaire de manière consciente à l’échelle internationale.
Mathilde, février 2022
Situations territoriales:
Personnages:
Récent et en cours:
- Présidentielle 2022 [391]
Questions théoriques:
- Populisme [29]
- Démocratie [166]
Rubrique:
Tensions en Ukraine: exacerbation des tensions guerrières en Europe de l’Est
- 277 lectures
Démonstration de force de l’armée russe au moyen de « manœuvres » de grande ampleur le long des frontières ukrainiennes depuis janvier, annonces quasi journalières par les États-Unis d’une invasion russe imminente, envoi de troupes de l’OTAN dans les pays baltes et en Roumanie, ballet diplomatique intense « pour sauver la paix », campagne médiatique russe dénonçant l’hystérie occidentale et annonce du retour de troupes dans leurs cantonnements, ce qui est aussitôt démenti par les États-Unis et de l’OTAN, accrochages entre armée ukrainienne et séparatistes dans le Donbass : dans ce sabbat guerrier macabre entre bourgeoisies impérialistes, les intentions sont diverses et complexes, liées aux ambitions des divers protagonistes et à l’irrationalité caractérisant la période de décomposition. Cela n’en rend la situation que plus dangereuse et imprédictible : mais, quelle que soit l’issue concrète de la « crise ukrainienne », elle implique dès à présent une intensification appréciable de la militarisation, des tensions guerrières et des contradictions impérialistes en Europe.
Les États-Unis à l’offensive avec un président sous pression
Le battage hystérique des États-Unis dénonçant l’invasion russe imminente de l’Ukraine fait suite à un battage similaire orchestré par les États-Unis en automne 2021 concernant « l’invasion imminente » de Taiwan par la Chine. Confrontée à un déclin systématique du leadership américain, l’administration Biden mène une politique impérialiste qui consiste, dans le prolongement de l’orientation initiée par Trump, d’abord à concentrer ses moyens économiques, politiques mais aussi militaires contre l’ennemi principal, la Chine ; de ce point de vue, le positionnement intransigeant face aux visées russes accentue le signal donné à Pékin en automne 2021. Ensuite, en créant des « points chauds » dans le monde, Biden développe une politique de tension visant à convaincre les différentes puissances impérialistes jouant leurs propres cartes qu’elles ont tout intérêt à se positionner sous la protection du parrain dominant. Cette politique s’était cependant heurtée aux limites imposées par la décomposition et avait abouti à un succès mitigé dans le Pacifique face à la Chine avec la création de l’AUKUS, regroupant uniquement les pays anglophones « blancs » (États-Unis, Grande-Bretagne, Australie), tandis que le Japon, la Corée du Sud et l’Inde gardaient leur distance. Ce même type de politique est mené aujourd’hui envers la Russie pour ramener les pays européens sous l’obédience américaine au sein de l’OTAN : la propagande américaine dénonce continuellement l’invasion russe, tout en précisant cyniquement que les États-Unis n’interviendront pas militairement en Ukraine puisqu’ils n’ont pas d’engagement de défense envers ce pays, contrairement à ceux existant au sein de l’OTAN. Il s’agit là d’un message perfide destiné aux pays européens. Or, à côté de Boris Johnson qui se positionne, comme en Asie, comme le fidèle lieutenant des Américains, le ballet diplomatique récent vers Moscou, orchestré par Macron et Scholz, souligne combien les bourgeoisies allemande et française tentent par tous les moyens de préserver leurs intérêts impérialistes particuliers.
En même temps, Joe Biden espère redorer par cette politique de confrontation son blason fortement terni par la fuite des forces américaines d’Afghanistan et par ses échecs répétés au niveau de ses plans socio-économiques : « Après un an de mandat, le président Joe Biden a la plus mauvaise cote de popularité de presque tous les présidents élus, à l’exception de l’ancien président Donald Trump » (CNN politics, 06.02.22) et, en conséquence, « son parti s’achemine, en novembre prochain, vers une défaite aux élections de mi-mandat » (La Presse, Montréal, 23 janvier 2022). Bref, si les États-Unis sont à l’offensive, la marge de manœuvre de leur président est néanmoins réduite à cause de son impopularité intérieure mais aussi par le fait qu’il ne peut être question, après les expériences irakiennes et afghanes, d’engager aujourd’hui massivement une force militaire sur le terrain du conflit. La présence de troupes américaines aux frontières de l’Ukraine reste donc plutôt symbolique.
La Russie piégée et sur la défensive
Depuis une dizaine d’années, nous avons mis en évidence que la Russie joue un rôle de « fauteur de troubles » dans le monde – alors qu’elle est un nain économique – grâce à la puissance de ses forces armées et de ses armes, héritage de la période où elle était à la tête de tout un bloc impérialiste. Cela ne signifie toutefois pas qu’elle soit aujourd’hui globalement à l’offensive. Au contraire, elle se retrouve dans une situation générale où elle subit de plus en plus de pressions tout le long de ses frontières.
– En Asie centrale, avec les Talibans au pouvoir à Kaboul, la menace musulmane pèse sur ses alliés asiatiques des « stans » (Ouzbékistan, Turkménistan, Tadjikistan) ; ensuite, entre la mer Noire et la Caspienne, elle est en guerre larvée avec la Géorgie après l’occupation de l’Ossétie du Sud et de l’Abkhazie en 2008, et tente de maintenir le statu quo entre l’Arménie-Azerbaïdjan après la guerre dans le Haut-Karabakh de 2020, ce dernier pays étant largement courtisé par la Turquie. Enfin, la déstabilisation récente du Kazakhstan constitue un cauchemar pour la Russie car ce pays occupe une place centrale dans la défense de son glacis oriental.
– Sur le versant européen, l’Ukraine et la Biélorussie, qui sont des territoires essentiels de son glacis occidental (la frontière ukrainienne n’est qu’à 450 km de Moscou), sont soumis à de fortes pressions ces dernières années. La Russie y comptait bien conserver des régimes qui lui seraient favorables, mais la « révolution orange » à Kiev en 2014 a vu basculer le pays vers l’Europe, et la même chose a failli se passer au Belarus en 2020.
À travers l’occupation de la Crimée en 2014 et le soutien aux sécessionnistes russophones dans l’est de l’Ukraine (Donetsk et Lougansk), Poutine espérait garder le contrôle sur l’ensemble de l’Ukraine : « En effet, il comptait sur les accords de Minsk, signés en septembre 2014, pour obtenir un droit de regard sur la politique ukrainienne par l’intermédiaire des républiques du Donbass [structure fédérale du pays avec une grande autonomie des régions]. C’est tout l’inverse qui s’est produit : non seulement leur application est au point mort, mais le président Volodymyr Zelensky, dont l’élection en avril 2019 avait donné l’espoir au Kremlin de renouer avec Kiev, a amplifié la politique de rupture avec le « monde russe » engagée par son prédécesseur. Pis, la coopération militaro-technique entre l’Ukraine et l’OTAN ne cesse de s’intensifier, tandis que la Turquie, elle-même membre de l’Alliance, a livré des drones de combat qui font craindre au Kremlin que Kiev ne soit tenté par une reconquête militaire du Donbass. Il s’agirait donc, pour Moscou, de reprendre l’initiative, quand il en est encore temps » (Le Monde diplomatique, février 2022).
Voyant la tendance des États-Unis à se polariser de plus en plus sur la Chine, Poutine a estimé le moment favorable pour accroître la pression sur l’Ukraine et par là aussi « négocier sa place sur la scène impérialiste » ; il a engagé une politique de « guerre hybride » impliquant des pressions multiples, basées sur des tensions militaires, des cyberattaques des menaces économiques (gaz russe) et politiques (reconnaissance des républiques en sécession). Cependant, l’offensive politique et médiatique américaine le prend au piège : à force d’annoncer à grands renforts de tambours une opération militaire d’occupation de l’Ukraine par la Russie, les États-Unis font que toute action plus réduite de la part de la Russie sera appréhendée comme un recul et tentent donc en quelque sorte de la pousser à s’engager dans une opération militaire hasardeuse et probablement d’assez longue haleine, alors que la population russe, elle non plus, n’est pas prête à aller à la guerre et à voir revenir des « body bags » en nombre. La bourgeoisie russe le sait parfaitement ; ainsi le politologue russe, expert en politique internationale de la Russie, Fyodor Lukyanov souligne que « Franchir la ligne entre la démonstration de force et l’utilisation (de celle-ci) est une transition vers un autre niveau de risques et de conséquences. Les sociétés modernes n’y sont pas prêtes et leurs dirigeants le savent » (cité dans De Morgen, 11.02.22).
Montée des tensions et de la militarisation en Europe
Dès à présent, les événements en Ukraine ont un impact très important sur la situation en Europe, et ceci sur un double plan :
Tout d’abord, l’exacerbation des confrontations impérialistes, la pression américaine et l’accentuation du « chacun pour soi » exercent une pression extrêmement forte sur le positionnement des divers États européens. Les déclarations intransigeantes de Biden les obligent à prendre position et les fissures s’accentuent entre eux, ce qui entraînera des conséquences profondes, tant pour l’OTAN que pour l’Union Européenne. D’un côté, la Grande-Bretagne, débarrassée des contraintes du consensus au sein de l’UE, se positionne comme le lieutenant fidèle parmi les fidèles des États-Unis : son ministre des affaires étrangères qualifie même de « second Munich » les tentatives franco-allemandes de trouver un compromis. Différents pays est-européens comme la Roumanie, la Pologne ou les États baltes appellent à la fermeté de la part de l’OTAN et se placent résolument sous la protection des États-Unis. Face à cela, la France ou l’Allemagne sont nettement plus hésitantes et tentent de développer leurs propres orientations par rapport au conflit, comme le soulignent les négociations intenses de Macron et Scholz avec Poutine. Le conflit met en évidence que des intérêts particuliers de type économique mais aussi impérialiste poussent ces pays à avoir leur propre politique envers la Russie, et c’est précisément ce qui est la cible des pressions des États-Unis.
À un niveau plus général, avec la confrontation en Ukraine, les bruits de guerre et la tendance à la militarisation de l’économie vont marquer à nouveau le continent européen, et ceci à un niveau beaucoup plus profond que que nous avions pu voir lors de la guerre en ex-Yougoslavie dans les années 1990 ou même lors de l’occupation de la Crimée par la Russie en 2014, vu l’approfondissement des contradictions dans un contexte de chaos et de chacun pour soi. Le positionnement des divers pays (en particulier de l’Allemagne et de la France) en défense de leurs intérêts impérialistes ne peut qu’accentuer les tensions au sein de l’Europe, aggraver encore le chaos lié au développement du chacun pour soi et accroître l’imprédictibilité de la situation à court et à moyen terme.
Quelle perspective ?
Sans doute, aucun des protagonistes ne cherche à déclencher une guerre générale car, d’une part, à cause de l’intensification du chacun pour soi, les alliances ne sont pas fiables et d’autre part et surtout, dans aucun des pays concernés, la bourgeoisie n’a les mains libres : les États-Unis restent centrés sur leur ennemi principal, la Chine et le président Biden, comme Trump d’ailleurs avant lui, évite à tout prix l’intervention de troupes sur place (cf. le désengagement des troupes en Irak et en Afghanistan et la délégation de plus en plus fréquente de tâches à des prestataires de services privés) ; la Russie craint une guerre longue et massive qui saperait son économie et sa force militaire (le syndrome d’Afghanistan) et évite également d’engager trop fortement ses unités régulières, faisant faire le « sale boulot » par des firmes privées (comme le groupe Wagner). De plus, comme le montre la difficulté persistante à accroître le taux de vaccination, la population russe se méfie profondément de l’État. Pour l’Europe enfin, cela constituerait un suicide économique et la population y est fondamentalement hostile.
Le non-déclenchement d’une guerre totale et massive ne signifie toutefois en aucun cas que des actions guerrières n’éclateront pas ; elles se déroulent d’ailleurs déjà pour le moment en Ukraine à travers la guerre « de basse intensité » (sic) avec les milices sécessionnistes de Kharkov et Lougansk. Les ambitions impérialistes des divers impérialismes, conjuguées à l’accroissement du chacun pour soi et de l’irrationalité liés à la décomposition impliquent irrémédiablement une perspective de multiplication de conflits en Europe même, qui risquent de prendre une forme de plus en plus chaotique et sanglante : multiplication de conflits « hybrides » (combinant des pressions militaires, économiques, politiques), de nouvelles vagues de réfugiés déferlant vers l’Europe de l’Ouest, tout comme des tensions au sein des bourgeoisies, aux États-Unis (cf. la « bienveillance » de Trump envers Poutine) comme en Europe (en Allemagne par exemple), et une perte de contrôle croissante de celles-ci sur leur appareil politique (vagues populistes).
Contre le battage haineux du nationalisme, la Gauche communiste dénonce les mensonges impérialistes de quelque camp que ce soit qui ne peuvent que servir les intérêts des différentes bourgeoisies, russe, américaine, allemande, française… ou ukrainienne et entraîner les ouvriers dans des conflits barbares. La classe ouvrière n’a pas de patrie, la lutte ouvrière contre l’exploitation capitaliste est internationale et rejette toute division sur la base du sexe, de la race ou sur une base nationale. Les ouvriers doivent prendre conscience que s’ils ne contrent pas par leurs luttes l’exacerbation des confrontations entre requins impérialistes, ces confrontations se multiplieront à tous les niveaux dans un contexte d’accentuation du chacun pour soi, de la militarisation et de l’irrationnel. Dans cette optique, le développement des luttes ouvrières en particulier au cœur même des pays centraux du capitalisme constitue aussi une arme essentielle pour s’opposer à l’extension de la barbarie guerrière.
R. Havanais, 18 février 2022
Géographique:
Personnages:
Rubrique:
Militarisme et décomposition (1991)
- 354 lectures
Le conflit en Ukraine, qui implique l’une des plus importantes puissances impérialistes de la planète, est un rappel dramatique de la véritable nature du capitalisme, un système dont les contradictions conduisent inévitablement à des affrontements militaires et à des massacres de populations.
Afin de comprendre pleinement la signification historique de cette guerre, il est essentiel de la placer dans un cadre d'analyse cohérent. C’est pourquoi nous invitons les camarades à lire ou relire :
– « Militarisme et décomposition [396] », texte que nous avions publié en 1991, après la dislocation de l’URSS.
Ce texte, publié pour la première fois dans la Revue internationale n° 64, a été écrit en 1990 comme une contribution à la compréhension de la signification d’une autre guerre : la guerre du Golfe menée par les Américains suite à l’invasion du Koweït par Saddam Hussein. Il est donc paru après la désintégration du bloc de l’Est mais avant l’éclatement définitif de l’URSS. Nous sommes convaincus qu’il reste un guide indispensable pour comprendre la nature de plus en plus irrationnelle et chaotique des guerres impérialistes aujourd’hui. Face à la propagande de la bourgeoisie selon laquelle le monde était à l’aube d’un « Nouvel Ordre Mondial » de paix et de prospérité, le texte insistait sur le fait que « dans la nouvelle période historique dans laquelle nous sommes entrés, et que les événements du Golfe ont confirmée, le monde apparaît comme une vaste foire d’empoigne, où la tendance au “chacun pour soi” fonctionnera à plein régime, et où les alliances entre États seront loin d’avoir la stabilité qui caractérisait les blocs impérialistes, mais seront dominées par les besoins immédiats du pouvoir. Un monde de chaos sanglant, où le gendarme américain tentera de maintenir un minimum d’ordre par l’usage de plus en plus massif et brutal de la force militaire ».
Ce scénario a été amplement confirmé par les événements des trois dernières décennies. Cela ne signifie pas que le texte soit une clé aux données invariables pour prédire l’avenir. Le texte lui-même commence par souligner que si un cadre solide est essentiel pour comprendre l’évolution des événements, il doit être constamment testé et adapté à la lumière de cette évolution, afin de voir quels aspects restent valables et lesquels doivent être révisés. Ainsi, par exemple, si le texte est parfaitement correct lorsqu’il montre l’incapacité de l’Allemagne à constituer la tête d’un nouveau bloc contre les États-Unis, il ne prévoit pas la renaissance de l’impérialisme russe ou la montée fulgurante de la Chine en tant que puissance mondiale. Mais comme nous l’affirmons ailleurs, ces développements sont devenus possibles précisément en raison de la tendance dominante au “chacun pour soi” qui marque les relations impérialistes dans la phase de décomposition.
Sur le contexte mondial permettant de comprendre la montée de la Chine, voir notamment les points 10 à 12 de la « Résolution sur la situation internationale (2019) : Conflits impérialistes ; vie de la bourgeoisie, crise économique [358]», Revue internationale n° 164.
Géographique:
- Ukraine [392]
- Russie, Caucase, Asie Centrale [369]
Personnages:
- Poutine [394]
Récent et en cours:
- Guerre en Ukraine [397]
Rubrique:
ICCOnline - mars 2022
- 34 lectures
Conflit impérialiste en Ukraine: La classe dominante exige des sacrifices sur l’autel de la guerre!
- 264 lectures
Si vous tentez de fuir avec votre famille des zones de guerre en Ukraine, comme des centaines de milliers d’autres personnes, vous serez séparés de force de votre femme, de vos enfants et de vos parents si vous êtes un homme entre 18 et 60 ans : vous êtes maintenant conscrits pour combattre l’avancée de l’armée russe. Si vous restez dans les villes, vous serez soumis aux bombardements et aux missiles, censés viser des cibles militaires, mais causant toujours les mêmes « dommages collatéraux » dont l’Occident a entendu parler pour la première fois lors de la glorieuse guerre du Golfe de 1991 : des immeubles d’habitation, des écoles et des hôpitaux sont détruits et des centaines de civils sont tués. Si vous êtes un soldat russe, on vous a peut-être dit que le peuple ukrainien vous accueillerait comme un libérateur, mais vous paierez de votre sang pour avoir cru à ce mensonge. Telle est la réalité de la guerre impérialiste d’aujourd’hui, et plus elle se poursuit, plus le nombre de morts et les destructions s’accroissent. Les forces armées russes ont montré qu’elles étaient capables de raser des villes entières, comme elles l’ont fait en Tchétchénie et en Syrie. Les armes occidentales qui arrivent en Ukraine vont amplifier davantage la dévastation.
L’âge des ténèbres
Dans l’un de ses récents articles sur la guerre en Ukraine, le journal britannique conservateur The Daily Telegraph titrait : « Le monde glisse vers un nouvel âge des ténèbres fait de pauvreté, d’irrationalité et de guerre [398] ». En d’autres termes, il est de plus en plus difficile de dissimuler le fait que nous vivons dans un système mondial qui s’enfonce dans sa propre décomposition. Qu’il s’agisse de l’impact de la pandémie mondiale de Covid, des dernières prévisions alarmantes sur le désastre écologique auquel la planète est confrontée, de la pauvreté croissante résultant de la crise économique, de la menace tout à fait évidente que représente l’aiguisement des conflits impérialistes, ou la montée de forces politiques et religieuses alimentées par des légendes apocalyptiques et des théories du complot autrefois marginales, le titre du Telegraph n’est ni plus ni moins qu’une description de la réalité, même si ses éditorialistes ne cherchent guère les racines de tout cela dans les contradictions du capitalisme.
Depuis l’effondrement du bloc de l’Est et de l’URSS en 1989-91, nous avons défendu que ce système social mondial déjà obsolète depuis le début du XXe siècle entrait dans une nouvelle et dernière phase de son déclin. Face à la promesse que la fin de la guerre froide entraînerait un « nouvel ordre mondial de paix et de prospérité », nous avons insisté sur le fait que cette nouvelle phase serait marquée par un désordre croissant et une escalade du militarisme. Les guerres dans les Balkans au début des années 1990, la guerre du Golfe de 1991, l’invasion de l’Afghanistan, de l’Irak et de la Libye, la pulvérisation de la Syrie, les innombrables guerres sur le continent africain, l’essor de la Chine en tant que puissance mondiale et le renouveau de l’impérialisme russe ont tous confirmé ce pronostic. L’invasion russe de l’Ukraine marque une nouvelle étape dans ce processus, dans lequel la fin de l’ancien système de blocs a donné lieu à une lutte frénétique de chacun contre tous, où des puissances autrefois subordonnées ou affaiblies revendiquent désormais une nouvelle position dans la hiérarchie impérialiste.
La gravité de cette nouvelle guerre en Europe
L’importance de ce nouveau cycle de guerre ouverte sur le continent européen ne peut être minimisée. La guerre des Balkans a déjà marqué la tendance de chaos impérialiste à revenir des régions les plus périphériques vers les cœurs du système, mais il s’agissait d’une guerre « à l’intérieur » d’un État en désintégration, dans laquelle le niveau de confrontation entre les grandes puissances impérialistes était beaucoup moins direct. Aujourd’hui, nous assistons à une guerre européenne entre États, et à une confrontation beaucoup plus ouverte entre la Russie et ses rivaux occidentaux. Si la pandémie de Covid a marqué une accélération de la décomposition capitaliste à plusieurs niveaux (social, sanitaire, écologique, etc.), le conflit en Ukraine rappelle brutalement que la guerre est devenue le mode de vie du capitalisme dans sa période de décadence, et que les tensions et conflits militaires s’étendent et s’intensifient à l’échelle mondiale.
La rapidité de l’offensive russe en Ukraine a pris par surprise de nombreux experts bien informés, et nous-mêmes n’étions pas certains qu’elle se produirait si rapidement et si massivement. (1) Nous ne pensons pas que cela soit dû à une quelconque faille dans notre cadre d’analyse de base. Au contraire, cela découlait d’une hésitation à appliquer pleinement ce cadre, qui avait déjà été élaboré au début des années 1990 dans certains textes de référence (2) où nous soutenions que cette nouvelle phase de décadence serait marquée par des conflits militaires de plus en plus chaotiques, brutaux et irrationnels. Irrationnels, c’est-à-dire même du point de vue du capitalisme lui-même (3) : alors que dans sa phase ascendante, les guerres, surtout celles qui ouvraient la voie à l’expansion coloniale, apportaient des bénéfices économiques évidents aux vainqueurs, dans la période de décadence, la guerre a pris une dynamique de plus en plus destructrice et le développement d’une économie de guerre plus ou moins permanente a constitué une énorme ponction sur la productivité et les profits du capital. Cependant, même jusqu’à la Seconde Guerre mondiale, il y avait toujours des « vainqueurs » à la fin du conflit, en particulier les États-Unis et l’URSS. Mais dans la phase actuelle, les guerres lancées même par les nations les plus puissantes du monde se sont révélées être des fiascos tant sur le plan militaire qu’économique. Le retrait humiliant des États-Unis d’Irak et d’Afghanistan en est une preuve évidente.
Dans notre article précédent, nous avons souligné qu’une invasion ou une occupation de l’Ukraine était susceptible de plonger la Russie dans une nouvelle version du bourbier qu’elle a rencontré en Afghanistan dans les années 1980, et qui a été un puissant facteur dans la chute de l’URSS elle-même. Certains signes indiquent déjà que c’est la perspective à laquelle est confrontée l’invasion de l’Ukraine, qui s’est heurtée à une résistance armée considérable, et se trouve être impopulaire dans de larges couches de la société russe, y compris dans certaines parties de la classe dirigeante elle-même. Ce conflit a, par ailleurs, provoqué toute une série de sanctions et de représailles de la part des principaux rivaux de la Russie, qui ne manqueront pas d’aggraver la misère de la majorité de la population russe. Dans le même temps, les puissances occidentales attisent le soutien aux forces armées ukrainiennes, tant sur le plan idéologique que par la fourniture d’armes et de conseils militaires.
Malgré les conséquences prévisibles, les pressions exercées sur l’impérialisme russe avant l’invasion réduisaient chaque jour un peu plus la possibilité que la mobilisation de troupes autour de l’Ukraine se limite à une simple démonstration de force. En particulier, le refus d’exclure l’Ukraine d’une éventuelle adhésion à l’OTAN ne pouvait être toléré par le régime de Poutine, et son invasion a aujourd’hui pour objectif clair de détruire une grande partie de l’infrastructure militaire ukrainienne et d’installer un gouvernement pro-russe. L’irrationalité de l’ensemble du projet, lié à une vision quasi messianique de la restauration de l’ancien empire russe, la forte possibilité qu’il débouche tôt ou tard sur un nouveau fiasco, ne pouvaient nullement dissuader Poutine et son entourage de tenter le pari.
Vers la formation de nouveaux blocs impérialistes ?
À première vue, la Russie est maintenant confrontée à un « front uni » des démocraties occidentales et à une OTAN de nouveau vigoureuse, dans laquelle les États-Unis jouent clairement un rôle de premier plan. Les États-Unis seront les principaux bénéficiaires de la situation si la Russie s’enlise dans une guerre ingagnable en Ukraine, et de la cohésion accrue de l’OTAN face à la menace commune de l’expansionnisme russe. Cette cohésion est toutefois fragile : jusqu’à l’invasion, la France et l’Allemagne ont tenté de jouer leur propre carte, en insistant sur la nécessité d’une solution diplomatique et en menant des entretiens séparés avec Poutine. L’ouverture des hostilités les a obligés à reculer, en s’accordant sur la mise en œuvre de sanctions, même si celles-ci nuisent beaucoup plus directement à leurs économies qu’à celle des États-Unis (Par exemple, l’Allemagne doit renoncer aux approvisionnements énergétiques russes dont elle a cruellement besoin). Mais l’Union européenne tend également à développer ses propres forces armées, et la décision de l’Allemagne d’augmenter considérablement son budget d’armement doit également être considérée de ce point de vue. Il est également nécessaire de rappeler que la bourgeoisie américaine est elle-même confrontée à d’importantes divisions quant à son attitude à l’égard de la puissance russe : Biden et les démocrates ont tendance à maintenir l’approche traditionnellement hostile à l’égard de la Russie, mais une grande partie du Parti républicain a une attitude très différente. Trump, en particulier, n’a pas pu cacher son admiration pour le « génie » de Poutine lorsque l’invasion a commencé…
Si nous sommes loin de la formation d’un nouveau bloc américain, l’aventure russe n’a pas non plus marqué un pas vers la constitution d’un bloc sino-russe. Bien qu’elles se soient récemment engagée dans des exercices militaires conjoints, et malgré les précédentes manifestations de soutien de la Chine à la Russie sur des questions comme la Syrie, la Chine a, à cette occasion, pris ses distances avec la Russie, s’abstenant sur le vote condamnant la Russie au Conseil de sécurité de l’ONU et se présentant comme un « honnête intermédiaire » appelant à la cessation des hostilités. Et l’on sait que malgré des intérêts communs face aux États-Unis, la Russie et la Chine ont leurs propres divergences, notamment sur la question du projet chinois de « nouvelle route de la soie ». Derrière ces différences se cache la crainte de la Russie d’être subordonnée aux ambitions expansionnistes de la Chine.
D’autres facteurs d’instabilité jouent également dans cette situation, notamment le rôle joué par la Turquie, qui a, dans une certaine mesure, courtisé la Russie dans ses efforts pour améliorer son statut mondial, mais qui, dans le même temps, est entrée en conflit avec la Russie dans la guerre entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan, et la guerre civile en Libye. La Turquie a maintenant menacé de bloquer l’accès des navires de guerre russes à la mer Noire via le détroit des Dardanelles. Mais là encore, cette action sera entièrement calculée sur la base des intérêts nationaux turcs.
Comme nous l’avons écrit dans notre Résolution sur la situation internationale du 24e Congrès du CCI [358], le fait que les relations impérialistes internationales soient encore marquées par des tendances centrifuges « ne signifie pas que nous vivons dans une ère de plus grande sécurité qu’à l’époque de la guerre froide, hantée par la menace d’un Armageddon nucléaire. Au contraire, si la phase de décomposition est marquée par une perte de contrôle croissante de la part de la bourgeoisie, cela s’applique également aux vastes moyens de destruction (nucléaires, conventionnels, biologiques et chimiques) qui ont été accumulés par la classe dirigeante, et qui sont maintenant plus largement distribués à travers un nombre bien plus important d’États-nations que dans la période précédente. Bien que nous n’assistions pas à une marche contrôlée vers la guerre menée par des blocs militaires disciplinés, nous ne pouvons pas exclure le danger de flambées militaires unilatérales ou même d’accidents épouvantables qui marqueraient une nouvelle accélération du glissement vers la barbarie ».
Face à l’assourdissante campagne internationale d’isolement de la Russie et aux mesures concrètes visant à bloquer sa stratégie en Ukraine, Poutine a mis ses défenses nucléaires en état d’alerte. Il ne s’agit peut-être pour l’instant que d’une menace à peine voilée, mais les exploités du monde entier ne peuvent se permettre de faire confiance à la seule raison d’une partie de la classe dirigeante.
L’attaque idéologique contre la classe ouvrière
Pour mobiliser la population, et surtout la classe ouvrière, en faveur de la guerre, la classe dirigeante doit lancer une attaque idéologique parallèlement à ses bombes et ses obus d’artillerie. En Russie, il semble que Poutine se soit principalement appuyé sur des mensonges grossiers concernant « les nazis et les drogués » qui dirigent l’Ukraine, et qu’il n’ait pas beaucoup investi dans l’élaboration d’un consensus national autour de la guerre. Cela pourrait s’avérer être un mauvais calcul, car il y a des grondements de dissidence au sein de ses propres cercles dirigeants, parmi les intellectuels et dans des couches plus larges de la société. Il y a eu un certain nombre de manifestations de rue et environ 6 000 personnes ont été arrêtées pour avoir protesté contre la guerre. Des rapports font également état de la démoralisation d’une partie des troupes envoyées en Ukraine. Mais jusqu’à présent, il y a peu de signes de mouvement contre la guerre sur le terrain de la classe ouvrière en Russie, qui a été coupée de ses traditions révolutionnaires par des décennies de stalinisme. En Ukraine même, la situation à laquelle est confrontée la classe ouvrière est encore plus sombre : face à l’horreur de l’invasion russe, la classe dirigeante a réussi dans une large mesure à mobiliser la population pour la « défense de la patrie », avec des centaines de milliers de volontaires pour résister aux envahisseurs avec n’importe quelle arme à leur portée. Il ne faut pas oublier que des centaines de milliers de personnes ont également choisi de fuir les zones de combat, mais l’appel à se battre pour les idéaux bourgeois de la démocratie et de la nation a certainement été entendu par des parties entières du prolétariat qui se sont ainsi dissoutes dans le « peuple » ukrainien où la réalité de la division de classe est oubliée. La majorité des anarchistes ukrainiens semblent fournir l’aile d’extrême gauche de ce front populaire.
La capacité des classes dirigeantes russe et ukrainienne à entraîner « leurs » travailleurs dans la guerre montre que la classe ouvrière internationale n’est pas homogène. La situation est différente dans les principaux pays occidentaux, où, depuis plusieurs décennies, la bourgeoisie est confrontée à la réticence de la classe ouvrière (malgré toutes ses difficultés et ses revers) à se sacrifier sur l’autel de la guerre impérialiste. Face à l’attitude de plus en plus belliqueuse de la Russie, la classe dirigeante occidentale a soigneusement évité d’envoyer des « hommes sur le terrain » et de répondre à l’aventure du Kremlin directement par la force militaire. Mais cela ne signifie pas que nos gouvernants acceptent passivement la situation. Au contraire, nous assistons à la campagne idéologique pro-guerre la plus coordonnée depuis des décennies : la campagne de « solidarité avec l’Ukraine contre l’agression russe ». La presse, de droite comme de gauche, fait connaître et soutient les manifestations pro-Ukraine, en faisant de la « résistance ukrainienne » le porte-drapeau des idéaux démocratiques de l’Occident, aujourd’hui menacés par le « fou du Kremlin ». Et ils ne cachent pas qu’il faudra faire des sacrifices, non seulement parce que les sanctions contre les approvisionnements en énergie de la Russie aggraveront les pressions inflationnistes qui rendent déjà difficile de chauffer les habitations, mais aussi parce que, nous dit-on, si nous voulons défendre la « démocratie », il faut augmenter les dépenses de « défense ».
Comme l’a dit cette semaine le commentateur politique en chef du libéral Observer, Andrew Rawnsley : « Depuis la chute du mur de Berlin et le désarmement qui a suivi, le Royaume-Uni et ses voisins ont principalement dépensé les “dividendes de la paix” pour offrir aux populations vieillissantes de meilleurs soins de santé et de meilleures pensions qu’elles n’auraient pu en bénéficier autrement. La réticence à dépenser davantage pour la Défense s’est maintenue, même si la Chine et la Russie sont devenues de plus en plus belliqueuses. Seul un tiers des trente membres de l’OTAN respecte actuellement l’engagement de consacrer 2 % du PIB à leurs forces armées. L’Allemagne, l’Italie et l’Espagne sont très loin de cet objectif.
Les démocraties libérales doivent retrouver de toute urgence la détermination à défendre leurs valeurs contre la tyrannie dont elles ont fait preuve pendant la guerre froide. Les autocrates de Moscou et de Pékin pensent que l’Occident est divisé, décadent et en déclin. Il faut leur prouver qu’ils ont tort. Sinon, toute la rhétorique sur la liberté n’est que du bruit avant la défaite ». (4) On ne saurait être plus explicite : comme l’a dit Hitler, on peut avoir des armes ou du beurre, mais on ne peut pas avoir les deux.
Au moment où, dans un certain nombre de pays, la classe ouvrière montrait les signes d’une nouvelle volonté de défendre ses conditions de vie et de travail, (5) cette offensive idéologique massive de la classe dirigeante, cet appel au sacrifice pour la défense de la démocratie, sera un coup dur contre le potentiel développement de la conscience de classe. Mais les preuves croissantes que le capitalisme vit de la guerre peuvent aussi, à long terme, représenter un facteur favorable à la conscience que tout ce système, à l’Est comme à l’Ouest, est effectivement « décadent et en déclin », que les relations sociales capitalistes doivent être détruites.
Face à l’assaut idéologique actuel, qui transforme l’indignation réelle que suscite l’horreur dont nous sommes témoins en Ukraine en un soutien à la guerre impérialiste, la tâche des minorités internationalistes de la classe ouvrière ne sera pas facile. Elle commence par répondre à tous les mensonges de la classe dirigeante et insister sur le fait que, loin de se sacrifier pour la défense du capitalisme et de ses valeurs, la classe ouvrière doit se battre bec et ongles pour défendre ses propres conditions de travail et de vie. C’est à travers le développement de ces luttes défensives, comme à travers la réflexion la plus large possible sur l’expérience des combats du prolétariat, que la classe ouvrière pourra renouer avec les luttes révolutionnaires du passé, surtout les luttes de 1917-18 qui ont forcé la bourgeoisie à mettre fin à la Première Guerre mondiale. C’est la seule façon de lutter contre les guerres impérialistes et de préparer la voie pour débarrasser l’humanité de leur source : l’ordre capitaliste mondial !
Amos, 1er mars 2022.
1 Cf. « Tensions en Ukraine : exacerbation des tensions guerrières en Europe de l’Est [399] » et « Crise à la frontière russo-ukrainienne : La guerre est le mode de vie du capitalisme ».
2 En particulier : « Militarisme et décomposition [396] », Revue internationale n° 64 (1er trimestre 1991).
3 Cette irrationalité fondamentale d’un système social sans avenir s’accompagne bien sûr d’une irrationalité croissante au niveau idéologique et psychologique. L’hystérie actuelle sur l’état mental de Poutine est basée sur une demi-vérité, car Poutine n’est qu’un exemple du type de leader que la décomposition du capitalisme et la croissance du populisme ont sécrété. Les médias ont-ils déjà oublié le cas de Donald Trump ?
4 « Liberal democracies must defend their values and show Putin that the west isn’t weak [400] », The Guardian (27 février 2022).
5 « Luttes aux États-Unis, en Iran, en Italie, en Corée… Ni la pandémie ni la crise économique n’ont brisé la combativité du prolétariat ! [357] », Révolution internationale n° 491 (novembre décembre 2021).
Géographique:
Personnages:
- Poutine [394]
Récent et en cours:
- Guerre en Ukraine [397]
Rubrique:
Conflit impérialiste en Ukraine: Le capitalisme, c'est la guerre! Guerre au capitalisme!
- 275 lectures
L’Europe est entrée dans la guerre. Ce n’est pas la première fois depuis la Deuxième boucherie mondiale de 1939-45. Au début des années 1990, la guerre avait ravagé l’ex-Yougoslavie, provoquant 140 000 morts avec des massacres de masse de civils, au nom du « nettoyage ethnique » comme à Srebrenica, en juillet 1995, où 8 000 hommes et adolescents furent assassinés de sang froid. La guerre qui vient d’éclater avec l’offensive des armées de Russie contre l’Ukraine n’est, pour le moment, pas aussi meurtrière. Mais nul ne sait encore combien de victimes elle fera au final. Dès à présent, elle a une envergure bien plus vaste que celle de l’ex-Yougoslavie. Aujourd’hui, ce ne sont pas des milices ni des petits États qui s’affrontent. La guerre actuelle met aux prises les deux États les plus étendus d’Europe, peuplés respectivement de 150 et 45 millions d’habitants, et dotés d’armées imposantes : 700 000 militaires pour la Russie et plus de 250 000 pour l’Ukraine.
Quelle est la signification de cette guerre ?
Qui en est responsable ?
Quel impact peut-elle avoir sur la classe ouvrière à l’échelle internationale ?
Comment mettre fin au chaos guerrier ?
Nous vous invitons à venir débattre de ces différentes questions en participant à nos réunions publiques qui se tiendront en ligne le vendredi 25 mars à 20h00.
Ces réunions publiques sont des lieux de débat ouverts à tous ceux qui souhaitent rencontrer et discuter avec le CCI. Nous invitons vivement tous nos lecteurs, contacts et sympathisants à venir y débattre afin de poursuivre la réflexion sur les enjeux de la situation et confronter les points de vue.
Les lecteurs qui souhaitent participer peuvent adresser un message sur notre adresse électronique ([email protected] [213]) ou dans la rubrique “nous contacter” de notre site interne.
Les modalités techniques pour se connecter à la réunion publique seront communiquées ultérieurement.
Vie du CCI:
- Réunions publiques [219]
Rubrique:
Le prolétariat des grandes concentrations ouvrières est au cœur du combat pour l’émancipation de l’humanité
- 115 lectures
Nous publions ci-dessous un large extrait du courrier d’une camarade qui, suite à notre permanence du 15 janvier, revient sur une question qui a été posée aussi par d’autres participants. Dans la mesure où son courrier aborde, dans une première partie non publiée ici, une analyse sur la lutte de classe que nous partageons globalement, nous avons fait le choix de ne répondre qu’à une des questions de son courrier qui traite de la « pénurie de main-d’œuvre ». Cette question a non seulement fait l’objet d’une polarisation dans le débat, mais nécessite, de notre point de vue, une clarification afin de mieux armer la classe ouvrière.
Extrait du Courrier de la camarade Rosalie
[…] Quelques idées plus en marge de la discussion générale ont été abordées comme comment comprendre toute cette partie de la classe ouvrière qui refuse le salariat et trouve des voies plus ou moins confortables pour subvenir à ses besoins immédiats, au risque d’un déclassement social. Peut-on affirmer qu’il s’agit uniquement de démarches de débrouilles individuelles qui les éloignent du réel combat politique ? Nous vivons une période inédite du fait de l’aggravation de la décomposition et de la pandémie qui depuis deux ans semble avoir chamboulé les schémas traditionnels de l’organisation de la société capitaliste. Certes, les travailleurs précaires, voire très précaires, sont une constituante permanente du capitalisme, mais il me semble qu’on assiste à un vrai bouleversement sociétal, à savoir que la classe ouvrière ne va pas se retrouver systématiquement dans le « salariat pur et dur tel que décrit par les premiers marxistes ». Sur cette question, je reprends le courrier des lecteurs de RI de janvier sur le débat : ce n’est pas la question « qui est le prolétariat ? » qui est importante mais « qu’est-ce que le prolétariat ? » Ce n’est pas une classification socio-professionnelle qui peut nous permettre de comprendre les changements actuels de la composition de la classe ouvrière. Revenons à ceux qui refusent l’usine, les cadences insoutenables et la détresse sociale qui va avec. Est-ce pour autant qu’ils adhèrent à l’idéologie bourgeoise ? Ce n’est pas si simple. Beaucoup de jeunes (jusqu’à 40 ans) se détournent des boulots de bêtes de somme et préfèrent vivoter chichement que de s’épuiser au boulot comme l’ont fait leurs aînés. Ce ne sont pas spécialement des anti-système nigauds ni des illuminés, mais ils ont compris que le capitalisme ne pouvait rien leur apporter et sont sans illusion quant à leur avenir professionnel. En quoi, est-ce que cette compréhension en ferait des gens « perdus » pour la cause ouvrière ? Je précise ces éléments car il me semble avoir relevé à plusieurs reprises l’insistance du CCI sur cette question d’identité et de conscience de la classe ouvrière. Pour conclure, j’observe que nous vivons une période inédite avec la pandémie qui a exacerbé les effets de la décomposition notamment au niveau économique. Des millions de travailleurs américains ne sont pas revenus à leurs postes dans les services marchands notamment. Cela pose question : 1. De quoi vivent-ils ? On sait que les aides sociales ne sont pas folichonnes aux États-Unis et les aides de Biden ont pris fin. Il y a un manque de main d’œuvre flagrant dans beaucoup de secteurs dans la plupart des pays : en Roumanie, ils embauchent des travailleurs asiatiques. En France, le CHU de Rouen propose des offres d’emplois aux infirmières de Beyrouth… Ces exemples ne viennent pas contrecarrer le schéma global de l’organisation sociale du capitalisme, mais ils illustrent la période actuelle. Est-ce une tendance qui va se développer ? Dernier point : tous ces travailleurs qui ont fui le système de production « traditionnel » ont compris un certain nombre de choses sur l’exploitation mais le problème est : cette compréhension leur permettra-t-elle de rejoindre les mouvements de lutte qui seuls sont susceptibles d’inverser la perspective de « Socialisme ou Barbarie » ? La prise de conscience ne peut-elle se trouver que dans les grandes concentrations ouvrières ? Je pense notamment aux camps de concentration des usines en Chine et dans les exploitations minières d’Afrique ou d’Amérique du Sud qui ont réduit à l’esclavage des millions de travailleurs. Sont-ils en état et dans les meilleures conditions objectives et subjectives pour cette indispensable prise de conscience ?
Ce ne sont que des réflexions à chaud après cette permanence qui comme toutes les autres organisées par le CCI depuis la pandémie nous permettent de débattre et d’approfondir notre compréhension de la situation internationale. Ce sont des moments d’échange très importants et j’en remercie le CCI.
Amitiés communistes.
Rosalie
Notre réponse
Nous devons d’abord mettre en évidence la réalité du phénomène évoqué par la camarade Rosalie et le problème posé dans l’extrait de son courrier : comment analyser, du point de vue de la lutte, la « partie de la classe ouvrière qui veut fuir le travail salarié » ? Comment interpréter le fait que de nombreux salariés préfèrent désormais abandonner leur emploi pour ne plus subir une exploitation féroce et des salaires de misère ? En d’autres termes, ce phénomène que nous pouvons observer dans bon nombre de secteurs dans les pays développés, où les salariés désertent des postes de travail précaires et/ou difficiles, est-il un atout ou un handicap du point de vue de la conscience ouvrière ?
Ces phénomènes de désertions, se concentrent en France dans les emplois saisonniers surtout : comme la viticulture et la restauration ou l’hôtellerie, par exemple. D’autres secteurs sont touchés comme dans les hôpitaux saturés avec un manque criant d’aides-soignants, dans le secteur des agents d’entretien, des travailleurs dans le bâtiment, ceux de l’aide à la personne, etc. Selon le ministère du travail, entre février 2020 et février 2021, l’hôtellerie-restauration aurait perdu 237 000 salariés. Entre 2018 et 2021, plus d’un millier d’étudiants infirmiers ont démissionné avant la fin de leurs études. Selon le ministre Olivier Véran, une hausse d’ 1/3 des postes vacants dans le paramédical a été enregistrée.
En Grande-Bretagne, la fédération des transports (RHA) souligne un besoin de 100 000 routiers supplémentaires pour faire face à la pénurie. Aux États-Unis, « il manque toujours 4,2 millions d’emplois pour retrouver le niveau d’avant crise » (1) et 10 millions de postes seraient à pourvoir. En six mois, 20 millions de personnes auraient quitté leur emploi ! En Allemagne, « 43 % des entreprises estiment que le manque de main-d’œuvre menace leur activité, contre 28,6 % avant la pandémie de Covid ». (2) Bon nombre de salariés qui ont quitté leur emploi cherchent ainsi une reconversion, vivotent ou se déclarent auto-entrepreneurs. C’est ce qui explique, par exemple, le nombre important de création d’auto-entreprises en France, dont se vante le gouvernement, mais qui recouvre en réalité une explosion de situations très précaires et autant de faillites programmées. Le courrier de la camarade donne des éléments de réponse valables sur les causes de ce phénomène, notamment le fait de la crise économique et la décomposition du capitalisme. Si la bourgeoisie souligne que cette « grande démission » est liée aux conséquences de la pandémie, elle n’est pas une nouveauté. En réalité, elle a surtout commencé à se développer après 2008 et n’a cessé de s’accentuer pour atteindre des chiffres record depuis le début de la pandémie. Une des raisons majeure de l’accélération de ce phénomène est effectivement lié à la gravité de la crise économique. La bourgeoisie a généralisé le travail précaire, multipliant les petits boulots, les bullshit jobs, afin notamment de masquer la catastrophe du chômage de masse. Elle a ensuite été amenée, du fait de la concurrence exacerbée, à attaquer les chômeurs en les affamant pour les forcer à accepter un travail pour un salaire de misère et des conditions indignes, intensifiant les cadences, multipliant les burn-out, recrutant à bas prix ; bref, contraignant les prolétaires à des conditions d’exploitation drastiques. Une situation, donc, devenue de moins en moins supportable. Et l’accélération de la décomposition a été un puissant facteur additionnel. La pandémie et le chacun pour soi n’ont fait qu’accentuer ce sentiment de rejet, de ras le bol et d’épuisement au travail. Lors de notre permanence du 15 janvier, une de nos interventions mettait en évidence que si la crise avait accentué ce phénomène de pénurie, la fuite des emplois précaires était marquée par « un sauve qui peut », un « chacun pour soi » avec la volonté très souvent illusoire de trouver un sort meilleur ailleurs, pensant que, dans d’autres lieux, « l’herbe est plus verte » ; ou qu’il est possible de « s’en sortir » individuellement en créant sa propre entreprise. Or, pour une bonne part, les illusions de vivre un meilleur sort que d’autres, relèvent d’une mystification et souvent d’un refus petit-bourgeois de l’exploitation salariale, amenant à occulter la nécessité de combattre collectivement le système. Alors que la propagande bourgeoise valorise en permanence « l’initiative privée ».
Cela, dans un contexte de difficultés pour la classe ouvrière à affirmer ses luttes, et où domine le souci de sa propre « survie individuelle », phénomène qu’accentue justement la décomposition de la société poussant à se replier sur soi. en essayant de trouver une réponse individuelle à un problème touchant l’ensemble de la société.
Ces salariés qui quittent leur travail, plus atomisés et mystifiés, sont donc dans l’impossibilité de pouvoir réagir par la lutte, excepté dans de très rares cas isolés comme aux États-Unis autour du secteur de la restauration rapide.
Selon le courrier de la camarade, ces désertions de salariés (souvent jeunes et inexpérimentés) sembleraient correspondre à une certaine prise de conscience de l’exploitation capitaliste. La camarade, dans son courrier, se demande : « En quoi, est-ce que cette compréhension en ferait des gens “perdus” pour la cause ouvrière ? ». Et elle ajoute : « tous ces travailleurs qui ont fui le système de production “traditionnel” ont compris un certain nombre de choses sur l’exploitation mais le problème est : cette compréhension leur permettra-t-elle de rejoindre les mouvements de lutte qui seuls sont susceptibles d’inverser la perspective de “Socialisme ou Barbarie” ? ».
La démarche même du questionnement semble pencher implicitement dans le sens de penser que ceux qui ont déserté les emplois précaires auraient une certaine conscience, seraient capables de « comprendre un certain nombre de choses sur l’exploitation », au moins au même titre que ceux des « grandes concentrations ouvrières ». Ce qui est vu par la camarade comme une prise de conscience par ceux qui refusent le travail salarié, en vient du coup à l’amener à relativiser par la même la force du prolétariat traditionnel, celui qui constitue le cœur des grands bastions de la production capitaliste. La camarade dit même ceci, exprimant clairement ses doutes : « la classe ouvrière ne va pas se retrouver systématiquement dans le salariat pur et dur tel que décrit par les premiers marxistes ».
Ces doutes formulés de manière interrogative par la camarade nous semblent préjudiciables dans le contexte actuel où la classe ouvrière est justement fragilisée et n’a pas encore conscience de son être, alors qu’il est nécessaire au contraire de mettre en exergue son potentiel, sa propre existence comme force historique. Même si le prolétariat semble redresser la tête par ses luttes au niveau international, il reste fragilisé. Il n’a pas encore retrouvé son identité de classe et se trouve menacé justement par le poids des influences petites bourgeoises qui risquent de le diluer dans des mouvements interclassistes. Une menace qui risque de lui faire quitter son terrain de classe dans un contexte où le poids croissant de la décomposition favorise la pénétration en son sein des idéologies étrangères à son combat.
Pour autant, contrairement à ce que pense la camarade, nous ne disons pas que les salariés qui fuient le travail précaire sont « définitivement perdus » pour la cause ouvrière. Nous voulons seulement souligner que ceux qui ont quitté leur job sont particulièrement mystifiés et touchés par l’accélération de la décomposition, qu’ils sont souvent très marqués par l’individualisme ou le désespoir et donc se situent très en marge, voire plutôt en dehors des luttes ouvrières aujourd’hui. De ce fait, nous pensons que la camarade, focalisée sur ces phénomènes immédiats, semble surévaluer la signification du « rejet du travail salarié » par les individus quittant leur job. Elle en vient à inverser la réalité de la situation sur le plan de la conscience de classe.
Alors que, malgré ses faiblesses, la classe ouvrière traditionnelle, celle « pure et dure des premiers marxistes », toujours sur son lieu de travail, présente dans les grandes concentrations industrielles, renoue avec son combat, exprime par ses grèves et manifestations au niveau international un frémissement prometteur, la camarade semble au contraire douter en tentant de valoriser plutôt les apparences trompeuses où des éléments pour le moins atomisés et mystifiés, en proie aux miasmes de la décomposition, seraient animés d’une sorte de prise de conscience alors qu’en réalité ils se coupent davantage du lien par le travail qui unit les exploités. Nous ne pouvons pas mettre sur le même plan les jeunes précarisés, non intégrés à la production, les éléments usés qui fuient leur travail avec leurs illusions et ceux qui sont amenés, du fait des attaques présentes et à venir, à développer leur combat de résistance au cœur des grandes métropoles et concentrations ouvrières. L’expérience vivante montre que ce sont bien de ces bastions industriels les plus concentrés et expérimentés au monde, là ou les ouvriers travaillent de manière réellement associée, collective et solidaire, que les luttes se développent déjà et que les luttes futures les plus conscientes se développeront encore. Face aux attaques inévitables liées à la crise du système capitaliste, ces bastions seront en mesure de montrer le chemin à suivre pour les prolétaires isolés et toutes les autres couches non exploiteuses de la société, de développer le combat pour renverser le capitalisme.
WH, 29 janvier 2022
1 « Aux États-Unis : 531.000 emplois créés en octobre mais la pénurie de main d’œuvre persiste », La Tribune (5 novembre 2021).
2 Selon le baromètre de l’emploi de la banque publique KfW et de l’Ifo, cité dans Les Échos (25 novembre 2021).
Vie du CCI:
- Courrier des lecteurs [252]
Heritage de la Gauche Communiste:
- La lutte Proletarienne [401]
- Conscience de classe [402]
Rubrique:
En dépit des patrons, du Covid et des syndicats, la lutte de classes n’a pas disparu!
- 55 lectures
Le CCI a publié un article sur les signes récents d’un renouveau de la combativité ouvrière dans plusieurs pays : « Luttes aux États-Unis, en Iran, en Italie, en Corée… Ni la pandémie ni la crise économique n’ont brisé la combativité du prolétariat ! [357] »Les luttes aux États-Unis sont particulièrement importantes, et cette contribution d’un proche sympathisant de ce pays vise à les examiner plus en détail.
Stimulée par les conditions imposées par la pandémie, la détérioration permanente des conditions de vie de la classe ouvrière aux États-Unis s’est transformée au cours des deux dernières années en une attaque en règle de la bourgeoisie. Qu’ils aient été jetés en pâture au système d’assurance-chômage dysfonctionnel de l’Amérique ou qu’ils aient été contraints de poursuivre le travail au péril de leur santé et de celle de leur famille, parce qu’il était jugé nécessaire ou « essentiel » de le faire, les ouvriers ont été confrontés à un assaut constant depuis le début de la pandémie de coronavirus. Tout cela pendant que les capitalistes tentent de forcer les ouvriers à marcher au rythme de leurs tambours : certaines factions se rallient aux théories du complot vantées par la droite populiste et se transforment en milices marginales et en pseudo-communautés virtuelles basées sur des mensonges illusoires qui se répandent si rapidement via les réseaux sociaux ; d’autres profitent du besoin de sécurité et de prudence afin de renforcer l’État sécuritaire déjà hypertrophié. La seule perspective que la bourgeoisie puisse mettre en avant, en cette période de crise, est une perspective teintée d’une impuissance qui ne peut être que le reflet de l’impuissance du système capitaliste secoué de convulsions, alors qu’il se tord dans l’agonie de sa crise de sénilité, la crise de la décomposition : « Vous, les ouvriers essentiels, allez maintenir notre société à flot ! » Dans sa tentative de revigorer une classe ouvrière déjà surchargée et sous-payée avec une « éthique du travail », c’est-à-dire en mobilisant ces secteurs essentiels de l’économie pour produire sans arrêt afin de maintenir la tête des capitalistes hors de l’eau, la bourgeoisie ne peut pas cacher une vérité fondamentale sur la société qu’elle a construite : la force collective de la classe ouvrière reste la puissance qui fait tourner la roue, le carburant qui alimente le feu. Cependant, à la grande surprise de la bourgeoisie, la classe ouvrière a pris cela à cœur et montre précisément ce que signifie être au centre de l’économie.
Les charpentiers sont en train d’affronter à la fois les patrons et les syndicats
« Striketober », ainsi nommé pour les explosions massives de grèves qui ont eu lieu en octobre, a fait place à un mois de novembre tout aussi combatif, alors que les ouvriers de tout le pays passent à l’action et refusent des travailler dans des conditions dégradantes pour un salaire déshumanisant. Avant même le mois d’octobre, la seconde moitié de l’année a vu se développer des grèves dans tout le pays, notamment dans les usines de Frito Lay et Nabisco, tandis qu’en septembre, une grève des charpentiers à Washington a ouvert la voie aux luttes en cours, que nous suivons de près, car elles continuent à se développer dans tous les secteurs de l’économie. Les charpentiers de Washington ont été attaqués sur deux fronts, comme c’est souvent le cas pour de nombreux ouvriers – ils ont été attaqués à la fois par les patrons et par les syndicats. Alors que l’United Brotherhood of Carpenters (UBC) présentait aux ouvriers des contrats contenant concession sur concession, remplissant chaque page des désirs de la General Contractor Association (GCA). Mais il y avait un mécontentement généralisé au sein de la main-d’œuvre et lorsque les charpentiers se sont vus présenter un accord de principe dans lequel les demandes des membres du syndicat n’étaient pas satisfaites, une majorité écrasante des travailleurs de l’UBC a voté contre l’accord et s’est mise en grève jusqu’à ce qu’un accord qui serait approuvé puisse être proposé. À la grande consternation des employeurs et de la direction du syndicat, les travailleurs ont tenu bon et ont rejeté cinq accords de principe avant que la direction internationale de l’UBC ne s’en mêle : invoquant la fraude et l’ingérence, la direction nationale du syndicat a pris le contrôle total de la section locale qui était la source de tant de problèmes, et la grève a finalement pris fin lorsque l’accord final présenté aux travailleurs a été approuvé de justesse.
Cela ne signifie pas que les travailleurs se sont échappés de la prison syndicale. Une grande partie de leur militantisme était canalisée par une formation syndicale de base, le Peter J. McGuire Group, du nom du fondateur socialiste de l’UBC. Le groupe s’est entièrement engagé à travailler à l’intérieur du cadre syndical : selon son président, le Peter J. McGuire Group a « promu le bon type de direction pour le Carpenters Union ». Il convient également de noter que le groupe a banni de sa page Facebook les auteurs du World Socialist Website – un groupe de gauche qui, de manière quelque peu inhabituelle, se spécialise dans les critiques radicales des syndicats.
A bien des égards, le décor était planté pour l’expérience de « Striketober » et sa continuation jusqu’à maintenant. Bien que les charpentiers de Washington aient repris le travail, les leçons tirées de leur lutte offrent une perspective importante pour les luttes qui se déroulent actuellement. Les charpentiers de l’UBC ont fait face à l’opposition non seulement des représentants des capitalistes, mais aussi de leurs propres « représentants » supposés dans le syndicat ! Bien que la Gauche Communiste connaisse depuis longtemps le danger que représentent les syndicats, les leçons qui ont formé et continuent de confirmer l’analyse selon laquelle les syndicats sont des organes d’État qui servent à restreindre les ouvriers doivent être généralisées et soulignées afin de comprendre les difficultés auxquelles sont confrontées les luttes des « Striketober » aujourd’hui. C’est l’un des aspects les plus importants de la lutte en cours. A titre d’exemple, et pour examiner le deuxième aspect qui fait écho à de nombreuses luttes actuelles, nous devons nous pencher sur les luttes des ouvriers de l’équipement agricole de John Deere dans le Midwest.
John Deere : les ouvriers s’opposent au système de salaires à deux vitesses
Les ouvriers de John Deere sont « représentés » par le syndicat United Auto Workers (UAW), que certains connaissent peut-être depuis le début de la pandémie, puisqu’il a manœuvré avec les patrons des usines automobiles du Michigan pour maintenir les ouvriers dans les usines avec, au mieux, une protection minimale. Aujourd’hui, l’UAW et John Deere travaillent de concert pour étendre le système de salaires et d’avantages sociaux à plusieurs vitesses qui a été établi en 1997. C’est cette année-là que les ouvriers de John Deere ont été divisés en fonction de leur année d’embauche : les ouvriers embauchés après 1997 constituaient une deuxième classe, ce qui impliquait un salaire réduit par rapport aux plus anciens et la suppression de nombreux avantages dont bénéficiaient les ouvriers embauchés avant 1997, dont les soins de santé après le départ en retraite. Cette année, l’UAW a présenté à ses membres un contrat de travail qui créerait un troisième statut d’ouvriers, avec des salaires encore plus bas pour ces derniers et une nouvelle diminution des avantages, notamment des pensions. Cette proposition a été rapidement rejetée par les membres du syndicat, et les ouvriers de John Deere, qui travaillent dans environ onze usines et trois centres de distribution, de l’Iowa à la Géorgie, de l’Illinois au Colorado, sont en grève depuis lors ; refusant que les conditions de vie de leurs futurs collègues soient dégradées, ils ont voté contre plusieurs accords de principe proposés par Deere et l’UAW au cours de leur grève. Ici encore, nous voyons les ouvriers de John Deere lutter contre une offensive conjointe de leur patron et de leur propre syndicat ! Les ouvriers de la base sont obligés de se débrouiller tout seuls – mais le fait d’être seuls n’indique pas un isolement ou un affaiblissement de la lutte. Le fait que les ouvriers soient prêts à rejeter les conseils du syndicat et à insister pour maintenir leurs propres revendications est au contraire une évolution positive. Il s’agit d’une tendance dans de nombreuses batailles menées par la classe ouvrière, dans lesquelles les syndicats sont à la traîne derrière une classe de plus en plus combative qui réveille le militantisme ouvrier à travers le pays (et le monde, d’ailleurs). En fait, les ouvriers de l’usine de Détroit, Michigan, qui sont également membres de l’UAW, ont exprimé leur solidarité avec les ouvriers de John Deere en grève(1). Il est clair que les ouvriers de John Deere ne sont seuls ni dans la lutte contre les manœuvres du syndicat, ni dans la lutte contre le système de salaires à plusieurs vitesses qui leur est imposé par les patrons et les syndicats.
Kellogg’s : des signes de solidarité entre les générations
La lutte contre le système de salaires et d’avantages sociaux à plusieurs vitesses est également présente dans la grève des ouvriers de Kellogg’s, car leur syndicat, le Bakery, Confectionary, Tobacco Workers and Grain Millers International Union (BCTGM), permet l’expansion d’un système à deux vitesses qui a été approuvé lors de la dernière convention collective des céréaliers – il faut noter que c’est le même syndicat BCTGM qui « représente » les ouvriers de Nabisco et de Frito Lay qui ont fait grève au début de l’année, invoquant des semaines de travail interminables (parfois jusqu’à 70 heures), sans paiement d’heures supplémentaires. L’échelon inférieur des salaires, négocié dans le dernier contrat, devait être concerner 30 % de la main d’œuvre, un frein dérisoire à cette politique de division, mais un frein tout de même. Kellogg’s cherche à relever ce plafond et à embaucher un plus grand nombre d’ouvriers dans cette tranche inférieure. Les ouvriers y voient une attaque claire, non seulement contre leurs futurs collègues, mais aussi contre leurs collègues actuels. Permettre à Kellogg’s de relever ce plafond pourrait très bien ouvrir la voie à une disqualification accrue de la main d’œuvre actuelle et à une baisse du niveau de vie des ouvriers. A cela s’ajoute un autre problème : les ouvriers ne cessent de vieillir. A mesure que les ouvriers de l’échelon supérieur partiront à la retraite, ou chercheront un autre emploi, lentement mais sûrement, c’est l’échelon inférieur qui dominera et finira par constituer l’ensemble de la main d’œuvre. Il ne fait aucun doute qu’il s’agit d’un système qui, non seulement divise les ouvriers, mais qui les maintient dans un état de précarité toujours plus grand. Cela se voit dans les luttes de Striketober, dans lesquelles les ouvriers identifient activement cette situation comme une attaque contre leur existence et y opposent une lutte sérieuse, mais aussi dans les réglementations du travail qui ont façonné la division du travail aux États-Unis dans la phase du capital décadent pendant des décennies – le système du travail à plusieurs vitesses créé par l’automatisation et le New Deal.
Les ouvriers sont confrontés à des divisions anciennes et nouvelles
Il ne faut pas oublier que l’absence de protections juridiques et de réglementations dans le secteur des services signifiait que, dans l’ensemble, les ouvriers de ce secteur étaient moins bien payés et recevaient bien moins d’avantages sociaux en moyenne, que leurs homologues du secteur manufacturier. D’où la création d’un système à deux vitesses dans l’économie générale du travail dans son ensemble, et pas seulement dans les contrats syndicaux contre lesquels les ouvriers luttent aujourd’hui. Cette division de la classe a opportunément séparé les ouvriers en fonction de la race et du sexe : héritage idéologique de la période de l’esclavage, l’image raciste de l’ouvrier noir « soumis » a été confirmée par son entrée dans le secteur des services, tandis que l’image patriarcale de la femme « soumise » a été également été confirmée par son emploi. En tant que tel, le capital avait divisé la classe ouvrière de telle sorte que les préjugés antérieurs semblaient confirmés par la réalité tant qu’aucun ouvrier n’osait regarder au-delà des apparences. Les ouvriers du secteur manufacturier, majoritairement blancs et masculins, pouvaient être facilement séparés de leurs homologues noirs et féminins, tandis que les mouvements en faveur de l’égalité raciale et de l’égalité des sexes séparaient les ouvriers de la lutte des classes et les entraînaient dans des luttes identitaires sans issue qui ne peuvent trouver de réponse émancipatrice aux questions de race et de sexe dans la société capitaliste. Pendant ce temps, les ouvriers du secteur manufacturier, dont le nombre d’emplois diminue depuis des décennies, se retrouvent en situation de mobilité descendante, ce qui s’exprime également par une autre version de l’impasse des luttes identitaires : plutôt que de chercher la solidarité avec les ouvriers des secteurs des services, qui deviennent de plus en plus la seule possibilité d’emploi dans de nombreux endroits du pays, ils se replient sur leur identité blanche et pensent devoir défendre leur statut social contre les minorités, les migrants, les Noirs, les féministes, l’« élite » (qui, dans la plupart des cas, ne désigne que les riches démocrates). Cela alimente la flamme du populisme, qui a balayé les États-Unis depuis le cycle électoral de 2016, et continue aujourd’hui de façonner les positions du Parti Républicain.
Cette scission n’est cependant pas un fossé infranchissable – en fait, c’est dans les luttes d’aujourd’hui que l’on peut trouver une réponse à ces divisions : les ouvriers ne se battent pas seulement dans le secteur manufacturier mais aussi dans le secteur des services. A l’instar des grèves décrites ci-dessus, les ouvriers de la santé des établissements de Kaiser Permanente, le long de la côte Ouest, étaient prêts à faire grève contre un accord à deux vitesses ; les syndicats sont intervenus à la dernière minute avec un accord qui ne répondait toujours pas aux nombreuses demandes des ouvriers pour éviter la grève. Les infirmières ont été déboutées(4), mais aussi les pharmaciens de Kaiser(5), qui devaient faire grève à partir du 15 novembre. Une autre grève a été empêchée par les représentants syndicaux : celle des membres des équipes de production de cinéma et de télévision de l’International Alliance of Theatrical Stage Employees (IATSE), qui devaient faire grève jusqu’à ce qu’un accord de principe soit proposé et ratifié malgré le rejet majoritaire du contrat(6). Cela montre qu’en dehors du paysage industriel traditionnel, il existe une indignation et une demande croissantes de meilleures conditions de vie et de travail, de la part des ouvriers eux-mêmes, tandis que les syndicats courent pour rattraper leur retard et les tirer vers le bas Les ouvriers qui n’étaient pas syndiqués jusqu’à présent ont également été contraints d’agir – à l’instar des chauffeurs de bus scolaires du comté de Cumberland, en Caroline du Nord, qui se sont mis en « arrêt maladie » pour protester contre leurs salaires dérisoires(7) ; les ouvriers des cafeterias du comté voisin de Wake ont utilisé la même tactique(8) pour à peu près les mêmes motifs.
Les syndicats essaient de récupérer le militantisme des ouvriers
Tout cela montre que la combativité des ouvriers à travers le pays fait boule de neige : les grèves stimulent les ouvriers qui sont confrontés à des conditions similaires et engendrent d’autres grèves. Cependant, la classe ouvrière est encore confrontée à de nombreux obstacles qui accompagnent la pandémie, et plus généralement la période de décadence du capitalisme et sa phase de décomposition. L’un d’entre eux, comme mentionné brièvement ci-dessus, est la question des syndicats, qui servent l’État capitaliste dans la période de décadence. Alors qu’ils s’efforcent de contenir de nombreuses luttes en cours, il sont aussi intervenus pour empêcher des actions de grève dans beaucoup d’autres cas. Il convient de noter que les syndicats ne constituent pas seulement une menace directe, mais aussi indirecte : l’UAW est actuellement prête à voter des mesures qui « démocratiseraient » le syndicat, en passant aux élections directes, en opposition au système actuel de délégués. Si la mise en œuvre de cette mesure peut sembler être une victoire pour la base, elle met également en avant une illusion qui peut servir à faire dérailler les luttes futures : l’identification de la base avec le syndicat lui-même, l’illusion que le syndicat appartient aux ouvriers. Le CCI a déjà écrit sur le rôle des syndicats dans le capitalisme décadent(9), je ne m’étendrai donc pas sur ce sujet.
La « Politique Identitaire » : une division fatale pour la classe ouvrière
Une autre menace pèse sur la classe ouvrière : les luttes interclassistes et les luttes identitaires partielles qui ont fait leur apparition ces dernières années. En particulier aux États-Unis, l’été dernier, les manifestations autour de Black Lives Matter (BLM), qui avaient leur base dans l’indignation bien réelle et les problèmes spécifiques des personnes noires en Amérique, se sont ancrées sur un terrain bourgeois avec le slogan « défendons la police ». Les démocrates ont voulu donner l’impression d’agir vaguement en faveur de la création d’une police « humaine », pour faire marche arrière tout de suite après ; même réduite à de tels slogans et à la promotion de la politique démocrate, cette simple demande libérale qui a résonné dans les défilés de BLM voit son écho amoindri. Si les luttes de classe actuelles se développent davantage, alors que les ouvriers en lutte s’unissent au-delà des frontières de l’usine, de l’entreprise et de l’industrie, l’inégalité matérielle très réelle des ouvriers noirs sera une question à laquelle la classe ouvrière devra répondre sur son propre terrain, sans concession à un quelconque mouvement bourgeois. Un dernier obstacle est constitué par les actions isolées qui ont lieu, sous forme de démissions massives. Le marché du travail reste tendu, alors que de plus en plus d’ouvriers quittent leur emploi, partageant souvent leurs derniers textes écrits à leurs supérieurs sur les réseaux sociaux, en signe de solidarité avec tous ceux qui envisagent de faire de même. Bien que cela puisse mettre les capitalistes dans une situation délicate, cette solution individualiste isole les ouvriers les uns des autres, nuit à l’auto-organisation, et les expériences partagées des ouvriers ne peuvent pas être exprimées aussi clairement à travers les médias sociaux, quelle que soit la portée des textes partagés en solidarité.
En dépit de ces obstacles, la classe ouvrière d’aujourd’hui semble néanmoins avancer timidement. Les défaites mineures qu’elle a connues ne semblent pas freiner son élan, et de plus en plus d’ouvriers n’ont d’autre choix que de faire grève pour une vie meilleure. Nous ne pouvons qu’exprimer notre grande satisfaction devant ce refus des ouvriers de se laisser abattre par la dégradation de leur vie, et nous devons clairement insister sur le fait que ce n’est qu’en s’unissant que ces luttes peuvent être menées de plus en plus loin, pour en arriver peut-être à un point où elles poseront des questions politiques très importantes. L’action unie dans de nombreuses usines, comme chez John Deere, démontre clairement que c’est par une extension de la lutte que l’on peut maintenir l’élan. Une telle extension requiert l’intervention de militants communistes afin de fournir une perspective politique, d’autant plus que la lutte peut se développer pour traverser les frontières, à l’intérieur et à l’extérieur des États-Unis – la classe ouvrière mondiale, malgré les énormes difficultés auxquelles elle est confrontée a montré qu’elle n’est pas vaincue, qu’elle a toujours un potentiel pour riposter et faire avancer ses luttes. Si nous pouvons observer ce phénomène avec beaucoup d’enthousiasme, il est également impératif pour nous de participer à ces luttes, afin d’aider la classe ouvrière à prendre conscience de sa force et de sa tâche historique : l’abolition de la société de classe.
Noah L, 16 novembre 2021
1 World Socialist Website, November 11, 2021
2 Jason E. Smith, Smart Machines and Service Work, pp. 8, 2020, Reaktion Books.
3 Ibid. pp. 30.
4 World Socialist Website November 14, 2021.
5 Yahoo News, November 14, 2021.
6 World Socialist Website, November 16, 2021
7 CBS Local Cumberland Country News : School Bus Drivers out for living wage – indisponible en Europe/GB).
8 ABC Channel 11 Eyewitness News, November 16, 2021.
9 ICC Pamphlet : Unions Against The Working Class – Les syndicats dans le capitalisme décadent
Géographique:
- Etats-Unis [184]
Rubrique:
Convoi de la liberté: Un mouvement étranger à la lutte de la classe ouvrière
- 79 lectures
Depuis la fin du mois de janvier, le Canada connaît un mouvement de protestation, appelé « convoi de la liberté ». Les protestataires étant contre l’obligation du pass vaccinal imposé par le gouvernement à toutes les personnes franchissant les frontières terrestres du pays. Les camionneurs canadiens, premiers impactés par cette décision, ont été à l’initiative de ce mouvement qui s’est propagé rapidement sur l’ensemble du territoire pour essaimer par la suite en Europe (France, Belgique) et en Océanie (Australie, Nouvelle-Zélande).
La défense des libertés individuelles, c’est la défense du capitalisme
Quelles étaient donc les motivations de ces chauffeurs routiers venus des quatre coins du pays pour converger, le 29 janvier, devant la colline du parlement à Ottawa ? Tout simplement le rejet de l’obligation vaccinale et plus généralement la demande de la levée de toutes les mesures obligatoires de précautions sanitaires. Tout cela au nom de la liberté propre à chacun de choisir sa propre destinée. Mais ce qui a surtout mis le feu aux poudres, c’est que l’obligation vaccinale à l’encontre des entrepreneurs du transport routier porte un sérieux coup à l’activité des 15 % d’entre eux, non encore vaccinés, lésés par l’interdiction de pouvoir effectuer les liaisons entre le Canada et les États-Unis. Ce fameux convoi s’est donc mis en branle au nom de la liberté individuelle et de la liberté d’entreprendre. Autrement dit, deux crédos de l’idéologie bourgeoise que reprennent en permanence à l’unisson les petits commerçants, les petits entrepreneurs, les artisans… En bref, la petite bourgeoisie, incapable de voir plus loin que le bout de son nez et de sa bourse !
La protestation a trouvé un écho de l’autre côté de l’Atlantique, puisqu’un nouveau convoi s’est constitué en France, le 9 février, afin de converger sur Paris pour le 11 du même mois. Ce convoi informe et hétéroclite composé d’individus de tous bords (gilets jaunes, restaurateurs, opposants farouches au pass vaccinal, camionneurs, etc.) a repris à son compte les revendications des transporteurs canadiens en y ajoutant pêle-mêle : la suppression des directives européennes, la suppression de toutes les mesures sanitaires, la démission des députés, sénateurs, du président de la République, l’augmentation des salaires nets, la détaxation du carburant et l’instauration d’un référendum d’initiative populaire, revendication mise en avant auparavant par les gilets jaunes. Dans les médias, nous avons pu voir les participants brandir des drapeaux français aux fenêtres de leur véhicule, affirmant agir au nom du peuple français pour la défense de la liberté et de la démocratie prétendument en danger. La Belgique, l’Australie, la Nouvelle-Zélande (et désormais les États-Unis) ont vu également se mettre en route les mêmes convois de mécontents.
Mais en fait, d’Ottawa à Paris en passant par Bruxelles et Camberra, cette protestation contre l’obligation du pass vaccinal procède de la même logique individualiste, avec une absence de souci collectif face à la poursuite de la pandémie, à ses ravages encore actuels et ceux à venir. Surtout, le cocktail des préoccupations (liberté individuelle, patrie-nation, démocratie) ne remet absolument pas en cause l’ordre social capitaliste. Pire ! Il ne fait qu’en prendre la défense. Car, en réalité, ce slogan pour la défense des libertés individuelles ou de la démocratie est le cache-sexe le plus grossier de la défense de l’État bourgeois et de la dictature du capital. (1)
Une protestation qui sert au renforcement de l’État policier
Au Canada et ailleurs, la protestation s’est exprimée par des rassemblements et des blocages routiers mais également par des manifestations de rue et l’occupation de lieux emblématiques tels que la colline du Parlement à Ottawa ou les Champs-Elysées à Paris. Ceci a donné lieu à des affrontements avec la police, à travers lesquels cette dernière a su utiliser toutes ses méthodes répressives : contrôles routiers et verbalisations, gaz lacrymogènes, matraquage, arrestations. En France, près de 7 000 gendarmes et policiers ont été déployés pour faire respecter l’interdiction de manifester avec des menaces de lourdes amendes et de peines de prison pour les récalcitrants. Au Canada, l’état d’urgence à Ottawa fut déclaré le 6 février face à la « menace de sûreté et de sécurité ». Après trois semaines de coups de matraques et d’aspersions de sprays au poivre, la « police à repris le contrôle d’Ottawa », pouvions-nous lire dans les médias avec un bilan de 200 arrestations et l’application d’une loi d’exception donnant à l’État canadien toute « légitimité » pour exercer la terreur de façon totalement débridée. S’il est clair que les gouvernements souhaitent éviter tout blocage et désordre, la bourgeoisie n’oublie jamais de tirer profit de telles situations.
En accolant l’étiquette de « mouvement social » à ce type de protestation stérile, la classe dominante fourbit ses armes, renforce son État policier et crée des précédents visant à légitimer la répression violente des luttes de la classe ouvrière au nom de la « défense de l’ordre public ». Car elle seule est en mesure d’engendrer un mouvement pouvant réellement mettre en péril ce que la bourgeoisie appelle « l’ordre public », en réalité l’ordre social capitaliste.
Le « règne de la liberté » dépendra de la victoire de la révolution prolétarienne
« Le désir de liberté », la capacité de forger sa propre destinée et d’être honnête avec soi-même est un des plus vieux besoins humains. L’interaction entre les désirs les plus profonds de l’individu et les besoins des autres a toujours été un aspect fondamental de l’existence humaine.
Pendant une grande partie de l’histoire humaine pré-capitaliste, dominée par les sociétés de classes et l’exploitation de l’homme par l’homme, le besoin spirituel de l’individu, de liberté personnelle et de contrôle sur son destin a été largement retourné contre lui par le spectre d’un pouvoir divin au-dessus des hommes et par les représentants auto-désignés de ce dernier sur terre qui, nullement par hasard, se trouvaient appartenir à la classe des propriétaires d’esclaves. La masse de la population qui produisait était enchaînée sur terre par la classe dominante et dans les cieux imaginaires par un tyran céleste.
La laïcisation et donc la politisation de la liberté personnelle et de la destinée, dans les révolutions bourgeoises (en particulier dans la révolution bourgeoise française de 1789-1793) a été une étape fondamentale dans le progrès vers des solutions dans le monde réel de la liberté humaine. Mais c’est aussi parce qu’elle a ouvert la voie à la classe ouvrière pour s’imposer sur l’arène politique et se définir politiquement comme classe révolutionnaire.
Cependant, dans la Déclaration des Droits de l’Homme de 1789, la bourgeoisie présentait frauduleusement sa liberté nouvellement gagnée pour son commerce comme une réalisation universelle qui profitait à tous. Cette tromperie résultait en partie de ses propres illusions et en partie des besoins de la bourgeoisie d’enrôler toute la population derrière ses drapeaux et son idéologie nationaliste. Le concept de liberté reste une forme abstraite, mystifiée, qui cache le fait que, dans la société capitaliste, les producteurs, tout en étant légalement libres et égaux à leurs maîtres, seraient enchaînés par une nouvelle forme d’exploitation, le salariat, et une nouvelle dictature, celle des « lois » du capital. La bourgeoisie victorieuse a apporté avec elle la généralisation de la production de marchandises qui a accentué la division du travail, arrachant l’individu à la communauté. Paradoxalement, de cette atomisation et de cet isolement, a surgi la mystique de la liberté individuelle dans la société capitaliste. En réalité, seul le capitalisme est libre.
Le développement vivant, historiquement concret de la liberté individuelle dépend donc de la solidarité de la lutte prolétarienne pour l’abolition des classes et de l’exploitation. La liberté réelle n’est possible que dans une société où le travail est libre, ce qui sera le mode de production communiste, où l’abolition de la division du travail permettra le développement et l’épanouissement complet de l’individu.
Tous les « convois de la liberté », outre qu’ils sont l’expression de l’impuissance et des frustrations de la petite bourgeoisie, contribuent à un enfoncement dans l’impasse du capitalisme et ne sont qu’une manifestation des miasmes de la décomposition et de l’atomisation sociale. Ils ne sont qu’un piège totalement étranger et fondamentalement opposé au développement de la lutte prolétarienne, seule force capable d’émanciper l’ensemble de la société du joug du capitalisme.
Vincent, 24 février 2022.
1 « La démocratie bourgeoise, c’est la dictature du capital » [403], Revue internationale n° 100, (1er trimestre 2000).
Géographique:
Récent et en cours:
- Convoi de la liberté [405]
Rubrique:
Bilan critique du mouvement des Indignés de 2011
- 191 lectures
Dix ans après, quelles leçons pouvons-nous tirer du mouvement des Indignés ? Comprendre à travers une analyse critique les luttes passées, tout en ayant le regard tourné vers l’avenir est source de force et d’encouragement pour le prolétariat dans une situation historique qui se détériore par moments sur tous les plans : pandémie, crise économique, barbarie guerrière, destruction de l’environnement, effondrement moral…
La force du prolétariat réside en sa capacité de tirer des leçons d’une lutte qui a plus de trois siècles d’expérience historique. Grâce à elle, il peut développer sa conscience de classe afin de lutter pour la libération de l’humanité du joug du capitalisme.
Le prolétariat a besoin de revenir constamment sur ses luttes passées, non pas pour tomber dans la nostalgie, bien au contraire, mais pour examiner de façon implacable ses faiblesses, ses limites, ses erreurs, ses points faibles, etc. afin d’en extirper un trésor de leçons qui lui servent à aborder sa lutte révolutionnaire.
Revenir sur le mouvement des Indignés de 2011 est nécessaire pour réaffirmer sa nature prolétarienne mais également pour comprendre ses énormes limites et faiblesses. C’est seulement de cette façon que nous pourrons tirer parti de ses leçons pour la période à venir.
L’entrée en lutte des nouvelles générations de la classe ouvrière
Tout mouvement prolétarien doit être analysé dans son contexte historique et mondial. Le mouvement du 15 Mai s’est produit en 2011 au sein d’un cycle de luttes qui s’est développé sur la période 2003-2011.
En 1989-91, l’effondrement de l’URSS et de ses régimes satellites a permis à la bourgeoisie mondiale de lancer une accablante campagne anticommuniste qui martelait sans répit ces trois slogans : « Fin du communisme », « Faillite du marxisme » et « Disparition politique de la classe ouvrière ». Cela a provoqué un fort repli dans la combativité et la conscience des ouvriers[1].
Depuis lors, la majorité des ouvriers ne se reconnaissent plus comme tels mais ils se voient pour certains comme une minorité plus chanceuse, la « classe moyenne » et pour les autres comme « ceux d’en bas », « les précaires », « les perdants dans la vie », etc. Face à la notion de classe, scientifique, unificatrice, universelle et avec une perspective de futur, la bourgeoisie propage à sa grande joie la vision réactionnaire, divisionniste de « catégories sociales » à travers son armée de serviteurs (partis, syndicats, idéologues, “influenceurs”) qui ne cessent de crier sur tous les toits – depuis Internet jusqu’aux universités en passant par le parlement et les moyens de “communication” – que la classe ouvrière n’existe pas, que c’est un concept « dépassé » qu’il n’y a que des « citoyens » de la « communauté nationale ».
Le repli s’est également exprimé à travers le retour en force des idéologies démocratiques, syndicalistes, humanistes, réformistes qui proclament la « fin de l’histoire ». Il n’y aurait pas d’autre monde possible que le capitalisme et le mieux qu’on puisse faire serait de « l’améliorer » pour que chacun puisse trouver sa « place » en son sein.
Toute tentative de changer le capitalisme conduirait à des situations bien pires, ce qui serait accrédité par ce qu’il s’est passé en URSS ou ce que l’on voit en Corée du Nord, à Cuba, au Venezuela, au Nicaragua, etc. et qui démontrerait que le dilemme historique formulé par Engels à la fin du XIXe siècle, Communisme ou Barbarie, serait faux parce que « le communisme, c’est aussi la barbarie ».
Malgré cet énorme fardeau, depuis 2003, il y a un renouveau des luttes ouvrières. Il y a eu des grèves significatives comme celle du métro de New York (2005), la grève de Vigo (2006), les grèves dans le nord de l' Égypte (2007), les protestations de jeunes ouvriers en Grèce (2008) mais les deux mouvements les plus importants furent la lutte contre le CPE[2] en France (2006) et le mouvement des Indignés en Espagne (2011)[3].
« Ces deux mouvements massifs de la jeunesse prolétarienne ont retrouvé spontanément les méthodes de luttes de la classe ouvrière, notamment la culture du débat dans les assemblées générales massives ouvertes à tous. Ces mouvements ont également été caractérisés par la solidarité entre les générations (alors que le mouvement des étudiants de la fin des années 1960, très fortement marqué par le poids de la petite bourgeoisie, s’était développé contre la génération qui avait été embrigadée dans la guerre).
Si, dans le mouvement contre le CPE, la grande majorité des étudiants en lutte contre la perspective du chômage et de la précarité, s’est reconnue comme faisant partie de la classe ouvrière, les Indignés en Espagne (bien que leur mouvement se soit étendu à l’échelle internationale grâce aux réseaux sociaux) n’avaient pas une claire conscience d’appartenir à la classe exploitée.
Alors que le mouvement massif contre le CPE était une riposte prolétarienne à une attaque économique (qui a obligé la bourgeoisie à reculer en retirant le CPE), celui des Indignés était marqué essentiellement par une réflexion globale sur la faillite du capitalisme et la nécessite d’une autre société » (Résolution sur le rapport de force entre les classes du 23e Congrès du CCI (2019))[4].
Malgré ces contributions, ces mouvements n’ont pas réussi à dépasser le repli de la conscience et de la combativité de 1989 et furent très marqués par ses effets mais aussi par les dérivés du processus de décomposition sociale et idéologique qui touche le capitalisme depuis les années 1980[5].
Leurs limites les plus importantes furent qu’ils ne réussirent pas à mobiliser l’ensemble de la classe ouvrière et se produisirent dans un nombre limité de pays. Ils se réduisirent aux nouvelles générations ouvrières. « Les travailleurs des grands centres industriels restaient passifs et leurs luttes demeuraient sporadiques (la peur du chômage étant un élément central d’une telle inhibition). Il n’y eut pas de mobilisation unifiée et massive de la classe ouvrière, mais seulement d’une partie d’entre elle, la plus jeune »[6].
Les jeunes ouvriers entrèrent en grève (beaucoup d’entre eux étaient encore étudiants), la majeure partie affectée par la précarité, le chômage, le travail totalement individualisé et isolé, reliés à de petites entreprises, la plupart d’entre elles n’ayant pas de siège social. Dans de telles conditions, au poids asphyxiant du recul historique expliqué précédemment, s’est ajouté l’inexpérience, l’absence totale de vie collective préalable, la terrible dispersion sociale.
La perte de l’identité de classe
La lutte des Indignés s’est retrouvée face à un mur qu’elle n’a pas pu franchir : la perte de l’identité de classe qui perdure depuis 1989.
Cette perte d’identité a fait que la grande majorité des participants au mouvement ne se reconnaissait pas comme faisant partie de la classe ouvrière.
Beaucoup étaient encore étudiants ou avaient fait des études supérieures[7]. Ceux qui étudiaient encore travaillaient sporadiquement pour payer leurs études et beaucoup de ceux qui occupaient des emplois précaires et mal payés pensaient que cette situation était transitoire, espérant obtenir un poste en accord avec leur niveau d’études. Pour résumer, beaucoup de participants croyaient que leur appartenance à la classe ouvrière était circonstancielle, une sorte de purgatoire avant d’arriver finalement au « paradis » de la « classe moyenne ».
Un autre facteur qui empêchait qu’ils se reconnaissent comme membres de la classe ouvrière est qu’ils changeaient constamment d’entreprise ou de poste de travail, la majorité travaillant dans de petites entreprises ou des entreprises de sous-traitance qui opèrent dans des usines ou des centres de distribution, de commerce ou de service[8].
Nombre d’entre eux travaillent seuls, fréquentant à peine leurs collègues, enfermés chez eux avec le télétravail ou participant à ce qu’on appelle « l’ubérisation du travail », « en passant par l’intermédiaire d’une plateforme internet pour trouver un emploi, l’ubérisation déguise la vente de la force de travail à un patron en une forme d'"auto-entreprise » tout en renforçant la paupérisation et la précarité des « auto-entrepreneurs ». L’ubérisation du travail individuel renforce l’atomisation, la difficulté de faire grève, du fait que l’auto-exploitation de ces travailleurs entrave considérablement leur capacité à lutter de façon collective et à développer la solidarité face à l’exploitation capitaliste » (op.cit. note 4).
Bien qu’elle exprimât de la sympathie pour la classe ouvrière, la majorité n’avait pas le sentiment d’appartenir à cette dernière. Elle se voyait comme une somme d’individus atomisés, frustrés et indignés par une situation toujours plus angoissante de misère, d’instabilité et d’absence de futur.
Le contexte du chômage accompagne tel une ombre angoissante les jeunes générations ouvrières. Ils vivent piégés dans un engrenage d’emplois précaires qui alternent avec des phases de chômage plus ou moins prolongées, beaucoup d’entre eux tombant dans une situation de chômage de longue durée. Ceci a pour effet ce que nous annoncions il y a 30 ans dans nos Thèses sur la décomposition : « Une proportion importante des jeunes générations ouvrières subit de plein fouet le fléau du chômage avant même qu’elle n’ait eu l’occasion, sur les lieux de production, en compagnie des camarades de travail et de lutte, de faire l’expérience d’une vie collective de classe. En fait le chômage, qui résulte directement de la crise économique, s’il n’est pas en soi une manifestation de la décomposition, débouche, dans cette phase particulière de la décadence, sur des conséquences qui font de lui un élément singulier de cette décomposition. S’il peut en général contribuer à démasquer l’incapacité du capitalisme à assurer un futur aux prolétaires, il constitue également, aujourd’hui, un puissant facteur de “lumpénisation” de certains secteurs de la classe, notamment parmi les jeunes ouvriers, ce qui affaiblit d’autant les capacités politiques présentes et futures de celle-ci. » (voir note 4)
ILS FONT PARTIE DE LA CLASSE OUVRIERE mais subjectivement ils ne se reconnaissent pas en elle. Cela a eu pour effet que le mouvement de 2011 n’a pas coupé le cordon ombilical de la sournoise « communauté nationale »[9]. Par exemple le slogan « nous sommes les 99%, ils sont le 1%", si populaire dans le mouvement Occupy aux États-Unis, n’exprime pas une vision de la société divisée en classes mais plutôt la vision typiquement démocratique que répète si souvent le gauchisme, du “peuple”, des « citoyens de base » face au 1% de “ploutocrates” et d'“oligarques” qui “trahiraient” la nation. Dans cette optique, les classes n’existent pas mais il existerait plutôt une somme d’individus répartie entre une majorité de “perdants” face à une élite de “gagnants”. Ainsi les participants au mouvement avaient d’énormes difficultés pour comprendre que « la société est divisée en classes, une classe capitaliste qui possède tout et ne produit rien et une classe exploitée, le prolétariat, qui produit tout et possède de moins en moins. Le moteur de l’évolution sociale n’est pas le jeu démocratique de « la décision d’une majorité de “citoyens” (ce jeu est plutôt le masque qui couvre et légitime la dictature de la classe dominante) mais la lutte de classe. » (se reporter à la note 2).
L’illusion d’une réforme de la démocratie.
Dépossédés de la force et la perspective que procure le fait de se reconnaître comme membres d’une classe historique qui représente l’unique futur pour l’humanité, les jeunes Indignés étaient terriblement vulnérables à l’illusion d’un « renouveau du jeu démocratique ».
Partout dans le monde, l’État démocratique est un leurre qui recouvre la dictature du Capital. Cependant, vu que domine l’idéologie selon laquelle « le communisme a échoué » ou « le communisme est le cauchemar que nous voyons à Cuba, au Venezuela ou en Corée du Nord », les participants au mouvement du 15 mai se sont accrochés à la chimère de « rénover la démocratie » suivant cette vieille mystification que répètent tant les politiciens : « la démocratie est le moindre mal de tous les régimes ».
Avec ce slogan, ils veulent nous embrigader dans la « lutte pour une véritable démocratie ». Ainsi le groupe bourgeois qui a accompagné et contrôlé le mouvement en Espagne s’appelait Democracia Real Ya (DRY)[10]. Ils nous disent « D’accord, la démocratie n’est pas parfaite, elle traîne le lourd fardeau des politiciens, de la corruption, de la complaisance envers les pouvoirs financiers et les entreprises », par conséquent la question n’est pas de lutter pour des utopies qui débouchent sur la barbarie sinistre de la Corée du Nord, de Cuba ou du Venezuela mais plutôt d'« épurer la démocratie » pour créer une « démocratie au service de tous ».
C’est cela la véritable utopie réactionnaire car la démocratie est ce qu’elle est et elle ne peut ni « se réformer » ni « s’améliorer ». Nouvelles constitutions, référendums, fin du bipartisme, démocratie participative, etc. sont les rapiéçages qui ne changent absolument rien à rien et dont l’unique finalité est de nous livrer pieds et poings liés à la dictature du capital sous son costume démocratique.
Le slogan le plus étendu dans les Assemblées du 15 Mai était « Ils appellent cela démocratie, mais ce n’est pas le cas ». C’était un piège, une mystification très dangereuse qui a sapé de l’intérieur le mouvement et l’a empêché de s’étendre. Les États bourgeois sont cela : de la démocratie. Ils l’appellent démocratie et C’EN EST UNE, c’est cela la démocratie, autrement dit, le déguisement démocratique de l’État totalitaire de la décadence capitaliste.
Comme l’ont dénoncé les « Thèses sur la démocratie bourgeoise et la dictature prolétarienne », adoptées par le 1er Congrès de l’Internationale Communiste en 1919, il n’existe et n’existera jamais une démocratie qui soit bonne, pure, participative, humaine, au « service de tous », « la plus démocratique des républiques bourgeoises ne saurait être autre chose qu’une machine à opprimer la classe ouvrière mettre la masse des travailleurs à la merci de la bourgeoisie et d’une poignée de capitalistes »[11].
Nous ne vivons pas dans une société de « citoyens libres et égaux », nous vivons dans une société DIVISÉE EN CLASSES… Et par conséquent, l’État n’est pas un organe neutre au service des citoyens mais il représente la DICTATURE de la classe dominante, du capital, qui oriente la société non vers la satisfaction des besoins des “citoyens” mais vers l’ACCUMULATION DU CAPITAL, le profit des entreprises et l’intérêt national.
Le Capital domine la société au nom de l’intérêt de la Nation qui serait une supposée « communauté de citoyens libres et égaux » et se barricade dans l’État qui, pour garder l’apparence de « représentant de la majorité », organise un rituel d’élections, de droits, de consultations, d’oppositions, d'« équilibres des pouvoirs », d'« alternance », etc.
Une critique encore timide du piège démocratique surgit dans de petites minorités au sein des assemblées. Il y en eut qui « complétèrent » la consigne « ils l’appellent démocratie, mais ce n’est pas le cas » avec une autre consigne « C’est une dictature mais ça ne se voit pas ». Il existait ici un début de prise de conscience. Ils l’appellent démocratie MAIS c’est une dictature, la dictature du Capital.
La dictature qui, au lieu d’un parti unique ou d’une autocratie militaire, présente une constellation de partis et de syndicats qui s’expriment différemment mais tendent tous vers le même but : la défense du capital national. La dictature qui ne compte pas de grand dictateur inamovible mais qui change de dictateur tous les 4 ans par le jeu des élections, jeu que l’État organise et contrôle pour faire en sorte que le résultat soit l’option majoritaire de la défense du capital national[12].
La dictature qui, au lieu des menaces et du despotisme flagrant des régimes autoritaires, se cache vertueusement et hypocritement derrière les belles paroles sur la solidarité, l’intérêt de tous, la volonté de la majorité, etc.
La dictature qui, au lieu de voler ouvertement pour le bénéfice de la minorité prend le déguisement de la « justice sociale », du « prendre soin des plus démunis », « personne ne reste à la traîne », et autres balivernes.
La dictature qui au lieu de réprimer sans vergogne ou de nier tout type de droit ou d’organisation, nous enferme dans les « droits » qui nous privent de tout et dans des « organisations » qui nous divisent et nous désorganisent comme classe.
Ce début de compréhension (« c’est une dictature mais ça ne se voit pas ») fut très minoritaire, ce qui domina dans les assemblées fut l’illusion d’un « renouveau démocratique »[13].
Dix ans après, en quoi consiste le « renouveau démocratique » qu’espéraient beaucoup de jeunes dans les assemblées ? Eh bien, nous le voyons bien. Les deux grands partis (PP et PSOE) sont désormais accompagnés par de nouveaux requins : Vox, Ciudadanos et Podemos. Ces « rénovateurs » ont amplement démontré qu’ils sont IDENTIQUES aux autres. Les mêmes tromperies, le même service inconditionnel au capital espagnol, la même soif insatiable de pouvoir, le même clientélisme[14]… La démocratie ne s’est pas renouvelée, elle a renforcé la machine d’État contre les travailleurs et contre toute la population.
Le virus démocratique entraina une inefficacité de la lutte face aux opérations de répression policière, car « malgré quelques réponses solidaires basées sur l’action massive contre la violence policière, c’est la “lutte” conçue comme pression pacifique et citoyenne sur les institutions capitalistes qui amena le mouvement très facilement vers l’impasse » (se reporter à la note 2).
Avec le mensonge démocratique, la bourgeoisie espagnole a réussi à faire en sorte que le mouvement du 15 Mai ne s’articule pas « autour de la lutte de la principale classe exploitée qui produit collectivement l’essentiel des richesses et assure le fonctionnement de la vie sociale : les usines, les hôpitaux, les écoles, les universités, les ports, les travaux, la poste… » (op.cit. note 2) mais qu’elle soit diluée dans une indignation interclassiste totalement impuissante. Malgré quelques timides tentatives d’extension aux centres de travail, cela échoua et le mouvement est demeuré toujours plus cantonné aux places publiques. Le regroupement et l’action commune des minorités qui exprimaient une « frange prolétarienne » face à la confusion dominante dans les assemblées n’a pas abouti. Pour cela, le mouvement, malgré les sympathies qu’il a suscitées, perdit en force jusqu’à se réduire à une minorité toujours plus désespérément activiste.
L’impasse de l'« indignation ».
Le slogan du mouvement fut « l’indignation ». L’indignation se distingue de la vengeance, de la haine, de la revanche, du dédommagement et autres manifestations morales propres à la bourgeoisie et à la petite bourgeoisie. En cela, l’indignation concorde plus avec la morale prolétarienne qu’avec ces sentiments profondément réactionnaires et destructeurs. Cependant l’indignation, aussi légitime qu’elle soit, exprimait plus une impuissance qu’une force, plus une perplexité qu’une certitude. L’indignation est un sentiment très primaire dans la lutte de classe du prolétariat et comme tel, il ne possède pas la capacité pour affirmer, même à un niveau élémentaire, la force, l’identité et la conscience de notre classe.
Les ouvriers s’indignent à cause du renvoi d’un camarade de travail, à cause des manœuvres des syndicats, à cause de l’arrogance et du sentiment de supériorité des patrons et des contremaîtres, à cause des accidents du travail qui fauchent subitement une vie humaine ou condamnent un camarade à l’invalidité… Cependant, l’indignation en elle-même ne définit nullement le terrain de classe du prolétariat si elle ne se place pas du point de vue de son autonomie politique de classe, du point de vue de ses revendications et de sa recherche d’une perspective propre, l’indignation apparaît comme un sentiment « humain » indifférencié que n’importe quel individu de n’importe quelle classe peut sentir et qui peut faire partie de n’importe quelle lutte bourgeoise ou petite-bourgeoise. Lorsque l’indignation s’élève comme catégorie indépendante et absolue, le terrain de classe prolétarien disparaît.[15]
Le fait que les prolétaires mobilisés en Espagne aient adopté le nom même « d’Indignés » comme signe de reconnaissance soulignait la difficulté manifeste qu’ils avaient pour trouver le chemin de classe prolétarien auquel ils appartenaient. C’était l’expression de leur impuissance et elle contenait le danger de se laisser dévier sur un terrain bourgeois, démocratique, de « protestation populaire », totalement interclassiste. L’indignation est par nature passive et purement morale. Elle peut correspondre à une étape embryonnaire de la prise de conscience qui doit être nécessairement dépassée par l’affirmation d’un terrain de classe, posant l’alternative pour le communisme. Si elle demeure le slogan du mouvement, la porte reste ouverte à son extinction ou si elle tente l’affrontement, le résultat est nécessairement son encadrement et sa récupération sur un terrain bourgeois, une défaite prolétarienne sans palliatifs.
Ce danger, nous l’avons clairement observé pendant les mobilisations aux États-Unis contre l’assassinat de Georges Floyd par la police. L’indignation fut canalisée vers une revendication pour une police « plus humaine » qui agisse « démocratiquement », c’est-à-dire un terrain radicalement bourgeois de défense de l’État démocratique et de ses appareils répressifs.
Les jeunes ouvriers qui occupaient les places et célébraient les assemblées massives quotidiennes avaient besoin de mettre de côté cette conception initiale de « l’indignation ». Le fait de ne pas y arriver et de ne pas réussir à allumer la mèche de la lutte dans les centres de travail, a perdu le mouvement.
Une vision erronée de la crise capitaliste
Si le mouvement des Indignés fut une réponse à la grave crise capitaliste de 2008, les participants se sont obstinés à voir les effondrements financiers qui se succédaient, les violentes coupes budgétaires que les gouvernements mettaient en œuvre, l’austérité brutale qu’ils promouvaient non comme une crise mais plutôt comme une “arnaque”. Les coupes budgétaires, la misère, la précarité étaient perçues comme résultat de la corruption (« il n’y a pas assez d’argent pour tous ces voleurs » fut l’une des phrases les plus répétées dans les assemblées) et non comme un résultat des convulsions et de l’impasse historique du capitalisme.
« Avec la faillite de la banque Lehman Brothers et la crise financière de 2008, la bourgeoisie a pu enfoncer encore un coin dans la conscience du prolétariat en développant une nouvelle campagne idéologique à l’échelle mondiale destinée à instiller l’idée (mise en avant par les partis de gauche) que ce sont " les banquiers véreux » qui sont responsables de cette crise, tout en faisant croire que le capitalisme est personnifié par les traders et le pouvoir de l’argent. La classe dominante a pu ainsi masquer les racines de la faillite de son système. Elle a cherché d’une part, à amener la classe ouvrière sur le terrain de la défense de l’État “protecteur”, les mesures de sauvetage des banques étant censées protéger les petits épargnants. Mais au-delà de ces mystifications, l’impact de cette campagne sur la classe ouvrière a consisté à renforcer son impuissance face à un système économique impersonnel dont les lois générales s’apparentent à des lois naturelles qui ne peuvent être contrôlées ou modifiées ». (se reporter à la note 4).
La majorité des participants voyaient comme responsables de leurs souffrances « une poignée de “méchants” (des financiers sans scrupules, des dictateurs sans pitié) alors que [Le capital] est un réseau complexe de rapports sociaux qui doit être attaqué dans sa totalité et non pas se disperser en poursuivant ses expressions multiples et variées (la finance, la spéculation, la corruption des pouvoirs politico-économiques). (se reporter à la note 2).
Cette terrible faiblesse donnait à la bourgeoisie une énorme marge de manœuvre pour embrouiller le mouvement dans toutes sortes de mystifications, toutes plus démobilisatrices et démoralisantes les unes que les autres.
En premier lieu, il n’y a pas de reconnaissance de l’obsolescence historique du capitalisme et de la nécessité impérieuse de le détruire mais il est considéré plutôt comme un système qui pourrait être « réformé et amélioré ».
En second lieu, le capitalisme n’est pas considéré comme un rapport social mais plutôt comme une somme d’individus, d’entreprises ou de secteurs (financiers, industriels, etc.). Ce raisonnement laisse la porte ouverte à l’idée qu’il y aurait des fractions du capital « meilleures et progressistes » alors que d’autres seraient « pires et réactionnaires ». Les maux du capitalisme ne sont pas identifiés à la nature même d’un système composé d’un ensemble de nations qui luttent à mort pour le profit et la domination impérialiste mais plutôt à des individus « mauvais », à la « finance », aux « spéculateurs », etc. C’est-à-dire que la voie est libre pour le Frontisme : se regrouper derrière telle ou telle fraction de la bourgeoisie considérée « moins mauvaise » contre une autre fraction estampillée comme étant « la pire ». La voie est libre pour tous les pièges avec lesquels la bourgeoisie a embrigadé le prolétariat dans la barbarie guerrière et au sacrifice de ses conditions de vie : choisir entre démocratie et fascisme, entre dictature et démocratie, entre le moindre mal et le plus grand mal[16].
Enfin la « lutte contre la corruption » cache la réalité qui est que le VOL est dans la plus-value que le capital extrait aux ouvriers de façon légale et consentie à travers un « contrat de travail » qui serait d'« égal à égal ». La corruption est à la base de la production de la plus-value qui est extorquée légalement et structurellement aux ouvriers et, dès lors, le problème n’est pas la corruption mais la plus-value. Le slogan « il n’y a pas assez d’argent pour tous ces voleurs » a caché l’exploitation capitaliste, l’exploitation du prolétariat par l’ensemble du capital.
Ainsi donc, cette fausse vision de la crise, cette campagne contre « les méchantes finances » et la « corruption », attaquait l’autonomie politique du prolétariat, niait l’exploitation capitaliste et l’existence de classes et liait les prolétaires à l’idée du frontisme ainsi qu’au fait de choisir son plat dans le menu empoisonné des options capitalistes.
La présence de la petite bourgeoisie radicalisée
Les assemblées se remplirent de petits-bourgeois radicalisés par les effets de la crise et, face à ceux-ci, le manque de confiance des jeunes ouvriers en leurs propres forces fit qu’ils se laissèrent embobiner par les belles paroles de ces secteurs dominés par le verbiage, les incohérences, le crétinisme, les oscillations constantes, l’empirisme et l’immédiatisme.
Tous les mouvements authentiques du prolétariat se sont vus accompagnés des couches de la petite bourgeoisie, de couches sociales non exploiteuses. La Révolution russe de 1917 sut gagner à sa cause des paysans et des soldats. Il est nécessaire de comprendre la nature du prolétariat et la nature de la petite bourgeoisie et des autres couches non exploiteuses
« De toutes les classes qui, à l’heure présente, s’opposent à la bourgeoisie, le prolétariat seul est une classe vraiment révolutionnaire. Les autres classes périclitent et périssent avec la grande industrie ; le prolétariat, au contraire, en est le produit le plus authentique » dit le Manifeste Communiste.
« Les classes moyennes, petits fabriquants, détaillants, artisans, paysans, tous combattent la bourgeoisie parce qu’elle est une menace pour leur existence en tant que classes moyennes. Elles ne sont donc pas révolutionnaires, mais conservatrices ; bien plus, elles sont réactionnaires : Elles cherchent à faire tourner à l’envers la roue de l’histoire. »
Cela veut-il dire que le prolétariat doit considérer la petite bourgeoisie comme son ennemie ? Non. Ce qu’il doit faire est de lutter de toutes ses forces contre l’influence néfaste et destructrice de la petite bourgeoisie, spécialement de l’idéologie petite-bourgeoise. Cependant, il doit imposer son propre terrain de classe, son autonomie politique comme classe, ses revendications et partant de cette position de force, gagner à sa cause au moins une partie de la petite bourgeoisie, vu que :
1/ « Tous les mouvements historiques ont été, jusqu’ici, accomplis par des minorités. Le mouvement prolétarien est le mouvement spontané de l’immense majorité au profit de l’immense majorité ».
2/ La petite bourgeoisie et les couches non exploiteuses « si elles sont révolutionnaires, c’est en considération de leur passage imminent au prolétariat : elles défendent alors leurs intérêts futurs et non leurs intérêts actuels ; elles abandonnent leur point de vue pour se rallier à celui du prolétariat ».
La grave faiblesse du mouvement du 15 Mai ne fut pas la présence des couches de la petite bourgeoisie radicalisée. Le problème fut que les jeunes ouvriers, les minorités résolument prolétariennes, ne furent pas capables de défendre et de faire assumer aux Assemblées les positions, leurs revendications et perspectives de classe. A la place, ce qui domina furent les approches individualistes, citoyennes, les « solutions » comme les coopératives, les jardins urbains, etc. c’est-à-dire qu’après les premiers efforts de réflexion et d’intuitions sur un terrain de classe, c’est le glissement vers les illusions petites-bourgeoises qui finit par prédominer de sorte que la partie était gagnée pour la bourgeoisie.
Les apports du mouvement
Cette critique impitoyable des faiblesses et déviations dont a souffert le mouvement des Indignés n’invalide en rien son caractère de classe prolétarien et ses apports pour les luttes futures. Le prolétariat est une classe exploitée et révolutionnaire à la fois. Sa principale force n’est pas une succession de victoires mais la capacité de tirer des leçons de ses défaites.
Dans son dernier écrit, Rosa Luxemburg, la veille de son assassinat par les sbires de la social-démocratie, « L’Ordre règne à Berlin » précise : « Que nous enseigne toute l’histoire des révolutions modernes et du socialisme ? La première flambée de la lutte de classe en France s’est achevée par une défaite. Le soulèvement des canuts de Lyon, en 1831, s’est soldé par un lourd échec. Défaite aussi pour le mouvement chartiste en Angleterre. Défaite écrasante pour la levée du prolétariat parisien au cours des journées de juin 1848. La Commune de Paris enfin s’est terminée par une terrible défaite. La route du socialisme – à considérer les luttes révolutionnaires – est pavée de défaites. Où en serions-nous aujourd’hui sans toutes ces “défaites”, où nous avons puisé notre expérience, nos connaissances, la force et l’idéalisme qui nous animent ? De chacune, nous tirons une portion de notre force, une partie de notre lucidité »[17].
Les terribles leçons que nous venons d’exposer font partie des orientations que les luttes futures devront suivre. Cependant, la lutte de 2011 nous apporte une série d’éléments positifs très importants.
L’article que nous avons cité précédemment, Le mouvement du 15 Mai cinq ans après, résume ces acquis (voir note 5). Nous soulignerons quelques-unes d’entre-elles.
Les assemblées générales
L’émancipation des travailleurs sera l’œuvre des travailleurs eux-mêmes ou ne sera pas, affirmait la Première Internationale. Les assemblées générales massives, ouvertes à l’ensemble des ouvriers, sont la réponse concrète à cette nécessité. Dans les assemblées générales, les ouvriers discutent, pensent, décident et mettent en œuvre les accords ENSEMBLE. Une participante au mouvement du 15 Mai s’exclamait : « Cest merveilleux que 10.000 inconnus aient pu se réunir !".
Les assemblées sont le cœur et le cerveau des luttes ouvrières.
Le cœur : elles sont un mélange de solidarité, de camaraderie, d’unité, de fraternité. Le cerveau : parce qu’elles doivent être l’organe collectif et unitaire de direction du mouvement, analysant les obstacles et les dangers qui le menacent et proposant la marche à suivre.
Mais les assemblées générales furent également une réponse concrète au problème que nous analysions au début : la majeure partie des jeunes ouvriers se retrouvent atomisés et dispersés par le télétravail, les emplois « uberisés », les petites entreprises, les situations de chômage, etc. En s’unissant dans les assemblées, en occupant les places, (le slogan du mouvement était « Occupe les places publiques »), ils réussirent à créer un lieu de regroupement, de construction d’unité, d’organisation de la lutte.
Il ne s’agit pas de glorifier les assemblées, nous avons vu comment en leur sein, les confusions qui tenaillaient les participants, l’affluence de la petite bourgeoisie et SURTOUT le travail de sape de la bourgeoisie et concrètement de DRY, finirent par leur ôter toute force. En filant la métaphore d’une légende tirée de la Bible, on pourrait dire que ces Salomé ont réussi à raser le crane du Sanson prolétaire. Face à cela, les futures assemblées « devront se renforcer avec un bilan critique des faiblesses apparues :
- Elles ne se sont étendues que très minoritairement vers les lieux de travail, les quartiers, les chômeurs… Si le noyau central des assemblées doit être l’assemblée générale de ville, en occupant les places et les bâtiments publics, il doit se nourrir de l’activité d’un large réseau d’assemblées dans les usines et lieux de travail principalement.
- Les commissions (de coordination, de culture, d’activités, etc.) doivent être sous le contrôle strict de l’assemblée générale devant laquelle elles doivent rendre des comptes scrupuleusement. Il faut éviter ce qui est arrivé au mouvement du 15 Mai où les commissions sont devenues des instruments de contrôle et de sabotage des assemblées manipulées par des groupes en coulisse tels que DRY (Democracia Real Ya)
La solidarité
La société capitaliste sécrète par tous ses pores « la marginalisation, l’atomisation des individus, la destruction des rapports familiaux, l’exclusion des personnes âgées, l’anéantissement de l’affectivité », c’est-à-dire « l’anéantissement de tout principe de vie collective au sein d’une société qui se trouve privée du moindre projet, de la moindre perspective ».
Face à tout cela, le mouvement du 15 Mai a semé une première graine : « il y a eu des manifestations à Madrid pour exiger la libération des détenus ou empêcher que la police arrête des migrants ; des actions massives contre les expulsions de domicile en Espagne, en Grèce ou aux États-Unis ; à Oakland, « l’assemblée des grévistes a décidé l’envoi de piquets de grève ou l’occupation de n’importe quelle entreprise ou école qui sanctionne des employés ou des élèves d’une quelconque manière parce qu’ils auraient participé à la grève générale du 2 novembre. »
Le mouvement a également fait preuve d’une recherche de la solidarité entre les différentes générations de la classe ouvrière, par exemple, les jeunes ouvriers accueillirent avec enthousiasme la présence des retraités qui apportaient leurs propres revendications.
Cependant, ce fut un premier pas, encore timide, miné par la perte de l’identité de classe, et situé encore plus sur un terrain de « la solidarité en général » que sur le terrain universel et libérateur de la SOLIDARITE DE CLASSE PROLETARIENNE. Pour cela, la vague populiste qui a secoué les pays centraux (le Brexit, Trump…) a éclipsé ces tentatives, imposant la xénophobie et la haine des migrants. Le prolétariat doit retrouver le terrain de sa solidarité de classe. Les Assemblées Générales doivent se concevoir comme un instrument de l’ensemble de la classe, ouverte aux ouvriers de toutes les entreprises, précaires, travailleurs “uberisés”, chômeurs, retraités… ».
La lutte doit s’étendre en brisant les barrières de l’entreprise, de la région, de la nationalité, de la catégorie, de la race, le prolétariat s’affirmant comme la classe formant un creuset dans lequel se révèle la véritable humanité unifiée dans le communisme. Toute lutte doit se concevoir comme partie de la lutte de TOUTE LA CLASSE OUVRIÈRE, se donnant comme première priorité L’EXTENSION ET L’UNIFICATION DES LUTTES.
Avec l’arme de la solidarité de classe, il faut combattre à mort la FAUSSE SOLIDARITE que propage la bourgeoisie, ses syndicats, ses partis : la « solidarité citoyenne », la « solidarité nationale », les collectes caritatives qui humilient les ouvriers en les convertissant en mendiants.
La culture du débat
La société actuelle nous condamne à l’inertie du travail, à la consommation, à la reproduction de modèles à succès qui provoquent des millions d’échecs, à la répétition de stéréotypes aliénants qui ne font rien sinon amplifier ce que répète l’idéologie dominante. Face à tout cela, et comme fausses réponses qui entraînent toujours plus dans la putréfaction sociale et morale, apparaît « la profusion des sectes, le regain de l’esprit religieux, y compris dans certains pays avancés, le rejet d’une pensée rationnelle, cohérente, construite, y inclus de la part de certains milieux “scientifiques” et qui prend dans les médias une place prépondérante, notamment dans des publicités abrutissantes, des émissions décervelantes ; l’envahissement de ces mêmes médias par le spectacle de la violence, de l’horreur, du sang, des massacres, y compris dans les émissions et magazines destinés aux enfants ; la nullité et la vénalité de toutes les productions “artistiques”, de la littérature, de la musique, de la peinture de l’architecture qui ne savent exprimer que l’angoisse, le désespoir, l’éclatement de la pensée, le néant. » (se reporter à la note 5).
Face à cela, durant les premières semaines du mouvement en Espagne, un débat vivant, massif s’est développé, abordant une multitude de sujets qui reflétaient la préoccupation, non seulement pour la situation actuelle mais aussi pour le futur ; pas seulement les problèmes économiques, sociaux ou politiques mais également des questions morales et culturelles. L’importance de cet effort, même timide et accablé par des faiblesses démocratiques et des approximations petites-bourgeoises est évidente. Tout mouvement révolutionnaire du prolétariat surgit toujours à partir d’un gigantesque débat de masse. Par exemple la colonne vertébrale de la Révolution en Russie de 1917 résidait dans le débat et la culture de masse. John Reed rappelle que « la soif d’instruction, si longtemps réprimée, avec la révolution prit la forme d’un véritable délire. Du seul Institut Smolny pendant les six premiers mois, sortaient chaque jour des trains et des voitures chargés de littérature pour saturer le pays. La Russie, insatiable, absorbait toute matière imprimée comme le sable chaud absorbe de l’eau. Et ce n’était point des fables, de l’histoire falsifiée, de la religion diluée et des romans corrupteurs à bon marché-mais les théories sociales et économiques, de la philosophie, les œuvres de Tolstoï, de Gogol et Gorki[18]. ».
Ce développement de la culture du débat est une arme porteuse d’avenir, car cela permet à l’ensemble des prolétaires de forger sa conviction, son enthousiasme, sa capacité de lutte, comme le dit l’Idéologie allemande, l’ouvrage de Marx et Engels : « la révolution est nécessaire non seulement parce qu’il n’est pas d’autre moyen pour renverser la classe dominante, mais encore parce que c’est seulement dans une révolution que la classe du renversement réussira à se débarrasser de toute l’ancienne fange et à devenir ainsi capable de donner à la société de nouveaux fondements[19] ». De façon concrète, la culture du débat permet au prolétariat de faire face à trois nécessités fondamentales :
- S’affirmer comme classe, donnant un cadre dans lequel il peut gagner à sa cause les couches sociales non exploiteuses ;
- Acquérir une conscience claire des objectifs et des moyens concrets de sa lutte ;
- Combattre jusqu’à se libérer pleinement de tout le poids de l’idéologie bourgeoise et petite-bourgeoise.
C. Mir 27-12-21
[1] Ce que nous avons mis en évidence en janvier 1990 voir Effondrement du bloc de l’Est : des difficultés accrues pour le prolétariat
[2] CPE : Contrat Première Embauche, une mesure du gouvernement français qui légalisait la précarité sous prétexte de donner « des opportunités d’emploi » aux jeunes.
[3] Pour une analyse de ces luttes voir :
Grève de la métallurgie à Vigo en Espagne : une avancée dans la lutte prolétarienne [406]
Les révoltes de la jeunesse en Grèce confirment le développement de la lutte de classe [407]
Luttes en Egypte : une expression de la solidarité et de la combativité ouvrières [408]
Thèses sur le mouvement des étudiants du printemps 2006 en France [409]
2011 : De l’indignation à l’espoir [410]
[4] Résolution sur le rapport de forces entre les classes (2019)
[5] Voir nos Thèses sur la décomposition [10]
[7] Le capitalisme, depuis les années 1960, s’est vu obligé, pour les besoins de sa reproduction, de généraliser l’éducation universitaire à une majorité de la population. Cela non pas par charité, mais avec l’objectif d’augmenter la productivité du travail…
[8] Aux différents étages des grandes entreprises, par exemple, dans les usines d’automobiles, travaillent non seulement les employés directs de l’entreprise mais aussi une myriade de sous-traitants ou d’entreprises auxiliaires qui appartiennent à un autre groupe ou dépendent d’une autre convention collective, ont d’autres conditions de travail, d’autres salaires, d’autres horaires, mangent à part, etc.
[9] Le nationalisme a pesé comme une chape de plomb sur le mouvement des Indignés en Grèce où sont apparus des drapeaux nationaux durant les concentrations et les marches. En Espagne s’il n’y eut pas de drapeaux espagnols dans les manifestations, beaucoup de jeunes qui ont participé aux assemblées de Barcelone se sont laissés entraîner dans la répugnante mobilisation pour l' « indépendance de la Catalogne » depuis 2012.
Voir L’Espagne et la Catalogne : deux patries pour imposer la même misère [412]
[10] Pour une dénonciation de cette racaille voir Le mouvement citoyen « Democracia Real Ya !": une dictature sur les assemblées massives [413].
Il importe de signaler que beaucoup des cadres qui ont milité dans DRY se sont unis a posteriori à cette entreprise de duperie et d’hypocrisie capitaliste qu’est Podemos.
[11] La démocratie bourgeoise, c’est la dictature du capital [403](Thèses sur la démocratie bourgeoise et la dictature prolétarienne (mars 1919)
[12] Avec le développement de la décomposition politique et idéologique du capitalisme, la bourgeoisie des pays centraux tend à perdre le contrôle du jeu électoral. De cela découle l’émergence de fractions populistes qui sont des défenseurs acharnés du capital national mais qui agissent de façon indisciplinée, chaotique, défendant des options impérialistes, économiques, etc. qui ne sont pas en adéquation avec l’intérêt global de l’État capitaliste.
[13] Malgré la résistance à la volonté de DRY d’imposer un « décalogue démocratique »
[14] Voir Vox (Espagne) : Une “voix” clairement capitaliste [63] et, en espagnol : Podemos : un poder del Estado capitalista [414]
[15] Pour une analyse du sens et des limites de l’indignation voir le chapitre sur ce thème de notre Rapport sur la lutte de classe internationale au 24e Congrès du CCI [415].
Voir également la dénonciation de l’essai de Stéphane Hessel sur l’indignation : S’indigner, oui ! contre l’exploitation capitaliste ! (à propos des livres de Stéphane Hessel « Indignez-vous ! » et « Engagez vous !") [416]
[16] Voir le point IX de notre Plateforme : « Le frontisme, stratégie de dévoiement du prolétariat » [417]
[17] « L’ordre règne à Berlin »
[18] Dix Jours qui Ébranlèrent le Monde
[19] L’Idéologie allemande, Chapitre : Feuerbach, Conception matérialiste contre conception idéaliste, Résultats, Ed. La Pléiade, p. 1123.
Evènements historiques:
- Indignés [418]
Rubrique:
Une déclaration internationaliste en Russie
- 138 lectures
Nous publions une déclaration sur la guerre en Ukraine du KRAS, un groupe anarcho-syndicaliste lié à l’Association internationale des travailleurs (AIT). Nous savons qu’en Russie, toute protestation contre la guerre fait l’objet d’une répression féroce de la part de l’État. Nous saluons donc le courage et la conviction des camarades du KRAS qui ont publié cette déclaration clairement internationaliste, dénonçant les deux camps impérialistes et appelant à la lutte de la classe ouvrière contre la guerre.
Notre solidarité avec les camarades du KRAS n’implique pas que nous soyons d’accord avec tout le contenu de leur déclaration, comme la demande d’une « cessation immédiate des hostilités » qui nous semble être une concession à l’idée que les deux camps bourgeois peuvent faire la paix. Même si la Russie se retirait d’Ukraine et cessait les bombardements, nous ne doutons pas que les hostilités se poursuivront sous d’autres formes, comme c’est le cas depuis 8 ans. À cet égard, la déclaration de la fédération serbe de l’AIT, d’obédience elle-aussi anarcho-syndicaliste, est plus claire dans sa dénonciation des illusions pacifistes répandues par une partie de la bourgeoisie : « Face aux horreurs de la guerre, il est très facile de se tromper et de lancer un appel impuissant à la paix. Mais la paix capitaliste n’est pas la paix. Une telle “paix” est en fait une guerre avec une étiquette différente contre la classe ouvrière. Dans cette situation, une position antimilitariste cohérente implique de faire des efforts directs pour arrêter la guerre capitaliste, mais en même temps de prendre le contrôle de la situation dans le pays, et de changer radicalement le système socio-économique – c’est-à-dire qu’une guerre de classe organisée est nécessaire ». (1)
Nous devons également souligner que ces deux groupes font partie d’un réseau anarchiste international qui n’est pas du tout homogène dans sa réaction contre la guerre. En allant, par exemple, sur la page web de la section britannique, la Solidarity Federation, on ne trouve, au moment où nous écrivons ces lignes, rien du tout sur la guerre, seulement des comptes rendus de conflits locaux et d’activités de la fédération. La déclaration sur la guerre de la section française de la CNT s’oppose à l’inhumanité de la guerre mais ne mentionne pas du tout la nécessité d’une réponse sur le terrain de la classe ouvrière. (2 )
Le KRAS, en revanche, a toujours défendu une position prolétarienne et internationaliste contre les actes immondes de sa « propre » classe dirigeante, et nous avons publié un certain nombre de leurs déclarations dans le passé. (3)
CCI, 18 mars 2022
NON A LA GUERRE ! (Déclaration de la section de l’AIT en Russie)
La guerre a commencé.
Ce dont les gens avaient peur, ce contre quoi ils avaient mis en garde, ce à quoi ils ne voulaient pas croire, mais qui était inévitable, est arrivé. Les élites dirigeantes de Russie et d’Ukraine, incitées et provoquées par le capital mondial, avides de pouvoir et gonflées de milliards volés au peuple travailleur, se sont réunies dans une bataille mortelle. Leur soif de profit et de domination est maintenant payée par le sang de gens ordinaires – comme nous.
Le premier coup de feu a été tiré par le plus fort, le plus prédateur et le plus arrogant des bandits : le Kremlin. Mais, comme toujours dans les conflits impérialistes, derrière la cause immédiate se cache tout un enchevêtrement de raisons puantes et dégoûtantes : il s’agit de la lutte internationale pour les marchés du gaz, et du désir des autorités de tous les pays de détourner l’attention de la population de la tyrannie des dictatures « sanitaires », et de la lutte des classes dirigeantes des pays de l’ex-Union soviétique pour le partage et la redistribution de l'« espace post-soviétique », et des contradictions à plus grande échelle et à l’échelle mondiale, et de la lutte pour la domination mondiale entre l’OTAN, dirigée par les États-Unis d’une part et la Chine d’autre part, qui défie l’ancienne hégémonie américaine et attache son « petit frère » du Kremlin à son char. Aujourd’hui, ces contradictions donnent lieu à des guerres locales. Demain, elles menacent de se transformer en une troisième guerre impérialiste mondiale.
Quelle que soit la rhétorique « humaniste », nationaliste, militariste, historique ou autre qui justifie le conflit actuel, il n’y a derrière que les intérêts de ceux qui ont le pouvoir politique, économique et militaire. Pour nous, travailleurs, retraités, étudiants, il n’apporte que souffrance, sang et mort. Le pilonnage, le bombardement de villes pacifiques, le meurtre de personnes n’ont absolument aucune justification.
Nous exigeons la cessation immédiate des hostilités et le retrait de toutes les troupes aux frontières et aux lignes qui existaient avant le début de la guerre.
Nous demandons aux soldats envoyés au combat de ne pas se tirer dessus, et encore plus de ne pas ouvrir le feu sur la population civile.
Nous les exhortons à refuser en masse d’exécuter les ordres criminels de leurs commandants.
ARRÊTEZ CETTE GUERRE !
ARMES AU PIED !
Nous appelons la population à l’arrière des deux côtés du front, tous les travailleurs de Russie et d’Ukraine, à ne pas soutenir cette guerre, à ne pas l’aider – mais au contraire, à y résister de toutes leurs forces !
N’allez pas à la guerre !
Pas un seul rouble, pas une seule hryvnia(4) ne doit sortir de nos poches pour la guerre !
Frappez contre cette guerre si vous le pouvez !
Un jour – quand ils auront assez de force – les travailleurs de Russie et d’Ukraine exigeront des comptes sur la responsabilité de tous les politiciens présomptueux et des oligarques qui nous montent les uns contre les autres.
Souvenons-nous en : PAS DE GUERRE ENTRE LES TRAVAILLEURS DE RUSSIE ET D’UKRAINE !
PAS DE PAIX ENTRE LES CLASSES !
PAIX dans les chaumières – GUERRE dans les palais !
Section de l’Association internationale des travailleurs de la région russe, (26 février 2022)
1 En anglais : Let's turn capitalist wars into a workers' revolution !, International Workers Association. [419]
2 « Paix aux chaumières, guerre aux Palais ! » [420], déclaration sur le site de la CNT-AIT.
4 Monnaie ukrainienne.
Géographique:
Récent et en cours:
- Guerre en Ukraine [397]
Rubrique:
ICCOnline - avril 2022
- 39 lectures
Conflit impérialiste en Ukraine et les responsabilités des révolutionnaires
| Fichier attaché | Taille |
|---|---|
| 164.33 Ko |
- 245 lectures
Venez aux réunions publiques organisées le 7 mai 2022 par le CCI pour discuter des questions soulevées par la guerre en Ukraine et des tâches des révolutionnaires. Vous trouverez ci-dessous les horaires et les lieux de ces réunions publiques :
- Bruxelles : 14H00, Pianofabriek, rue du Fort 35, 1060 Bruxelles.
- Marseille : 15H00, local de Mille Babords, 61 Rue Consolât, Métro « Réformés », 13001 Marseille.
- Paris : 15H00 au CICP (21ter Rue Voltaire, 75011 Paris), Métro « Rue des Boulets ».
- Toulouse : 14H00, La Chapelle, 36 rue Danielle Casanova – 31000 TOULOUSE, Métro (ligne B) station « Canal du Midi / Compans-Caffarelli».
- Lille : 15H00, Café "Les Sarrazins", 52-54 rue des Sarrazins, Lille (Wazemmes).
Face à la guerre en Ukraine, le CCI s'appuie sur les contributions historiques de la Gauche communiste pour défendre une position internationaliste. En pratique, cela signifie :
- Aucun soutien à un quelconque camp dans les conflits impérialistes.
- Opposition au pacifisme
- Seule la classe ouvrière est une force de transformation sociale, qui aboutit au renversement révolutionnaire du capitalisme.
- Dans les luttes et les réflexions de la classe ouvrière, les organisations révolutionnaires ont un rôle essentiel à jouer dans le développement de la conscience de classe.
- La lutte contre la guerre impérialiste exige la coopération et la solidarité des authentiques internationalistes.
Vie du CCI:
- Réunions publiques [219]
Rubrique:
Le capitalisme, c'est la guerre! Guerre au capitalisme!
- 613 lectures
-
Campagnes idéologiques: Une propagande impérialiste, barbare et criminelle! [427] (new)
-
Déclaration du KRAS-AIT: Contre les attaques nationalistes, solidarité internationaliste! [428] (new)
-
Les anarchistes et la guerre: Entre internationalisme et “défense de la nation” [429] (new)
-
La guerre en Ukraine, un pas de géant dans la barbarie et le chaos généralisés [430]
-
Sommet de l'OTAN à Madrid: un sommet de guerre pour la guerre [431]
-
Un bilan des réunions publiques sur la Déclaration commune de groupes de la Gauche communiste [432]
-
Le trotskisme, grand rabatteur de l’impérialisme, recruteur de chair à canon [433]
-
Campagne idéologique: La propagande “humanitaire” au service de la guerre [435]
-
Réunions publiques du CCI: Qui peut arrêter les guerres et la barbarie capitaliste? [436]
-
Conférence de Zimmerwald: Une référence indispensable pour la défense de l’internationalisme [437]
-
Déclaration commune de groupes de la Gauche communiste internationale sur la guerre en Ukraine [438]
-
Éditorial: Face à la guerre impérialiste, opposons la lutte de classe! [439]
-
Face à la guerre comme face à la crise, la classe ouvrière ne doit accepter aucun sacrifice [440]
-
États-Unis, Russie, Union européenne, Ukraine… Tous les États sont responsables de la guerre! [441]
-
Conflit impérialiste en Ukraine: La classe dominante exige des sacrifices sur l’autel de la guerre! [443]
Géographique:
Personnages:
Récent et en cours:
- Guerre en Ukraine [397]
- OTAN [447]
Rubrique:
Non au bulletin de vote, oui à la lutte de classe!
- 142 lectures
Alors que les deux candidats désignés au premier tour de la présidentielle, Marine Le Pen et Emmanuel Macron, entrent à nouveau en lice pour le second tour, la bourgeoisie et ses médias continuent de propager un mensonge mille fois répété : l’avenir se jouerait dans les urnes. Enjeux pour la bourgeoisie, certes, mais pas pour les ouvriers ! L’expérience d’innombrables mandats, de droite, de gauche et du centre, comme celles des « fronts républicains » depuis 20 ans, ont clairement démontré que cette mascarade ne peut en rien empêcher la plongée constante de la société capitaliste dans la crise, le chaos et la dégradation inexorable des conditions de vie. Au-delà des apparences, de la variété de discours, pour la plupart sans couleur ni panache, tous les candidats ont défendu un même programme de fond : celui du capital national, qu’il s’agit, pour la classe dominante, de défendre dans l’arène mondiale face à une concurrence exacerbée, sur fond de crise économique, de guerre et de chaos croissant. La bourgeoisie n’a qu’une seule méthode pour mettre en œuvre son programme : accroître encore et encore l’exploitation de la force de travail pour en extraire un profit maximal et écarter les concurrents !
Que valent donc les discours lénifiant des candidats face à l’aggravation spectaculaire du réchauffement climatique, des catastrophes en série, de la misère croissante, de la famine et du chaos guerrier sur tous les continents et jusqu’aux portes d’un des principaux centre du capitalisme mondial ? Que peuvent sérieusement proposer ces tristes candidats face à la crise économique mondiale, aux dettes abyssales, à l’inflation incontrôlable ? Dans ce contexte, que valent les promesses démagogiques et le slogan « Nous tous » de Macron, lui qui n’a cessé de mentir et de jouer sur les divisions en accentuant la précarité, la pauvreté ou le démantèlement des services de santé ? Celles de Marine Le Pen valent-elles mieux, elle qui prétend ouvertement rejeter les problèmes économiques et sociaux sur le dos des immigrés et sauver le « pouvoir d’achat des Français » et propose presque de « raser gratis », comme le faisait autrefois la gauche ? (1)
Les élections, une mystification au service de l’exploitation
Voter, ce n’est pas seulement choisir entre Macron et Le Pen, entre « la peste et le choléra » ou entre « régime démocratique et régime autoritaire », c’est, en réalité, bien pire que cela ! C’est à nouveau plébisciter le capitalisme et son mode de domination destructeur.
Bien entendu, le bon sens commun du petit bourgeois répondra : « Malgré tout, il faut voter pour préserver ce droit acquis de haute lutte » ! Et les voix des gauchistes du même acabit ajouteront : « le mouvement ouvrier, les révolutionnaires ne participaient-ils pas traditionnellement aux élections et au travail au sein du parlement ? Le prolétariat ne s’est-il pas battu pour ce droit ? ». Toutes ces niaiseries n’expliquent nullement un curieux paradoxe historique : au moment de la conquête du suffrage universel par la classe ouvrière, au XIXe siècle, la bourgeoisie s’y opposait avec la dernière des brutalités, réprimant tous ceux qui se battaient pour ce qui était perçu alors comme un droit et un progrès. Or, aujourd’hui, tout au contraire, la bourgeoisie défend mordicus les urnes, vante ses institutions « démocratiques » à grands coups de slogans publicitaires, stigmatise les abstentionnistes « égoïstes » et envisage même, comme c’est déjà le cas en Belgique, d’infliger des sanctions à ceux qui refusent d’accomplir leur « devoir civique » !
En réalité, dès ses origines, le mouvement ouvrier et le courant marxiste (en dehors de ses courants opportunistes) ont toujours considéré que la démocratie bourgeoise et le prétendu « pouvoir du peuple » n’étaient que mystifications au service de la bourgeoisie et de l’exploitation capitaliste. Dans une société divisée en classes antagoniques, nulle « égalité » civique n’est possible, même dans la République bourgeoise la plus démocratique. Cependant, au XIXe siècle, dans cette période de phase ascendante du capitalisme, le prolétariat devait se constituer et s’affirmer comme classe, il lui était encore possible de s’appuyer sur des fractions bourgeoises progressistes face aux vieilles couches sociales réactionnaires. Il était aussi encore possible de lutter pour des réformes réelles et durables. En permettant de pousser la législation en leur faveur, en limitant, par exemple, le temps de travail quotidien, en améliorant les salaires, en défendant et arrachant, non sans luttes, de meilleures conditions de vie et de travail, les élections participaient à l’éveil des consciences et au renforcement de l’unité et de l’influence des ouvriers dans la société. Bien entendu, la fraction parlementaire socialiste était entièrement subordonnée au principe de la lutte de classe et conçue comme un moyen relié au but qui était de renverser, à terme, le capitalisme. (2)
En revanche, lorsque le capitalisme est entré dans sa phase de déclin historique, au moment de la Première Guerre mondiale, l’impossibilité d’octroyer des réformes durables et le développement du capitalisme d’État rendaient impossible toute participation fructueuse aux élections sans en payer les conséquences néfastes. Avec l’exacerbation des confrontations entre nations, induites par la décadence, s’est développé un des phénomènes caractéristiques de cette période : le capitalisme d’État, qui répond à la nécessité pour chaque pays, d’obtenir le maximum de discipline en son sein de la part des différents secteurs de la société, de réduire au maximum les affrontements entre classes mais aussi entre fractions rivales de la classe dominante afin, notamment, de rendre son économie la plus compétitive possible. L’octroi de réformes réelles en faveur de la classe ouvrière devient tout bonnement impossible, sous peine de reculer dans la compétition mondiale. Toutes les fractions bourgeoises sont ainsi devenues réactionnaires. Aujourd’hui, elles le sont toujours, de l’extrême-gauche à l’extrême-droite. Comme le proclamait l’Internationale communiste, « le centre de gravité de la vie politique actuelle est complètement et définitivement sorti du parlement ».
Notre rejet catégorique du parlementarisme et des élections ne repose donc nullement sur un dogme moral ou des idées abstraites, mais sur l’analyse des conditions historiques de la lutte de classe et la tradition du combat révolutionnaire.
L’avenir appartient au prolétariat et à la lutte de classe
Prétendre, comme Mélenchon, qu’« un autre monde est possible » grâce au bulletin de vote est une imposture ! Aujourd’hui, rabattre les ouvriers vers les urnes, comme le font depuis des décennies les gauchistes, comme Poutou ou Nathalie Arthaud, en prétendant transformer les élections en « tribune révolutionnaire » en faveur de « l’urgence anticapitaliste » ou au nom du « camp des travailleurs », n’a fait qu’entretenir les pires illusions (3) sur des institutions bourgeoises de plus en plus boudées et désertées, exposées à la légitime méfiance des exploités. Alors que les ouvriers doivent défendre leur unité, les élections les atomisent au contraire dans les isoloirs, les divisent et les exposent aux pressions idéologiques nauséabondes du capital en attaquant leur conscience et les désarment en les berçant d’espérances illusoires.
Mais si le prolétariat doit effectivement rejeter les urnes, ce n’est pas en se repliant sur lui-même ou en boudant simplement l’élection, comme on le voit pour une partie de la population marquée par le désenchantement, la colère et le désespoir, mais en luttant fermement sur son terrain de classe contre les effets de la crise et les attaques du capital. Face au coût de la vie exorbitant, face à la dégradation de la situation et à la barbarie croissante, il n’y a pas d’autre choix que de se battre contre le système capitaliste lui-même, sa crise, sa logique de guerre et de concurrence généralisée. Pour cela, la classe ouvrière devra miser sur sa solidarité, sur ses propres méthodes de luttes pour affirmer son autonomie de classe en résistant aux attaques à venir. Elle en a la force et tout le potentiel, elle doit prendre confiance en elle-même, reconnaître qu’elle peut se mobiliser et résister collectivement, comme elle a commencé à le faire au moment de la lutte contre la réforme des retraites durant l’hiver 2019/2020. Elle devra baser sa réflexion, déjà présente dans de petites minorités, sur l’expérience des luttes du passé et l’histoire du mouvement ouvrier, s’engager dans un combat collectif et conscient pour en tirer les leçons, discuter et comprendre la situation dans des assemblées générales souveraines, s’organiser elle-même pour poser les conditions de la lutte afin de l’étendre le plus largement possible à tous les ouvriers.
Dans ce combat, les révolutionnaires auront un rôle primordial à jouer pour stimuler l’action du prolétariat qui permettra, à terme, de développer les conditions d’un combat ouvrier international, combat qui exprimera une politisation capable d’offrir une réelle perspective, celle de la destruction du capitalisme pour un projet authentiquement communiste.
WH, 15 avril 2022
1 Il faut se souvenir de tous les slogans bidons déversés jusqu’à plus soif d’élection en élection : « Changer la vie » (Mitterrand), « Sortir du tunnel », « Contre la fracture sociale » (Chirac), « Ensemble tout devient possible » (Sarkozy), « Le changement, c’est maintenant » (Hollande)… Comme l’ont dit cyniquement certains politicards : « les promesses n’engagent que ceux qui les écoutent ».
2 Cette lutte pour des réformes ne doit pas être confondue avec le réformisme, une dérive opportunisme qui conduisait à séparer justement le but et les moyens, à s’accommoder au capitalisme pour in fine mieux capituler. Le cas le plus connu est celui de Bernstein pour qui le « mouvement est tout le but n’est rien ». Marx dénonçait d’ailleurs déjà à son époque le « crétinisme parlementaire ».
3 En 1981, Lutte ouvrière se servait de sa « tribune révolutionnaire » pour appeler à voter Mitterrand. Ce parti devait récidiver en 2007 en faveur de la candidate du Parti socialiste Ségolène Royal.
Situations territoriales:
Personnages:
Récent et en cours:
- Election présidentielle [448]
Rubrique:
Montée de l’extrême-droite en Europe: Existe-t-il un danger fasciste aujourd’hui? (2005)
- 133 lectures
La qualification de Marine Le Pen, candidate du Rassemblement national, au deuxième tour de l’élection présidentielle donne l’occasion à la classe dominante d’asséner une nouvelle campagne de « diabolisation » de l’extrême droite en poussant les exploités à « défendre la démocratie » en votant pour Emmanuel Macron, sensé représenter le camp du « bien ». « Démocratie ou dictature » tel est le faux dilemme que tente d’imposer la classe dominante dans la droite ligne des campagnes antifascistes au cours des années 1930. La très faible affluence lors des marches contre l’extrême droite organisées le 16 avril, ainsi que le fort taux d’abstention pronostiqué par les sondages pour le deuxième tour, semblent montrer que le « front républicain » fait de moins en moins recette.
Si le poids grandissant des partis populistes est une marque des difficultés des fractions les plus rationnelles de la classe dominante à garder la maîtrise de l’appareil politique, cela ne concerne en rien les intérêts des exploités. Populistes ou pas, tous les partis présents aux élections sont les défenseurs du système et de l’exploitation du travail salarié. En jouant sur la peur du « danger fasciste », la bourgeoisie tente d’atténuer le discrédit de plus en plus fort pesant sur les élections et les « partis démocratiques ».
Les lecteurs pourront trouver ci-dessous un article paru dans la presse du CCI en 2005 montrant la différence entre les pouvoirs fascistes des années 1930 et la percée des partis populistes actuellement. Si plusieurs aspects factuels sont aujourd’hui dépassés, l’analyse générale reste pleinement valable selon nous.
– Montée de l’extrême-droite en Europe : Existe-t-il un danger fasciste aujourd’hui ? [449]
Situations territoriales:
Personnages:
Récent et en cours:
- Election présidentielle [448]
Rubrique:
Seul le renversement des lois du capitalisme pourra mettre fin à l’exclusion sociale
- 76 lectures
À peine quelques semaines et, déjà, le scandale des maltraitances dans les EHPAD du groupe ORPEA est relégué au fin fond de l’actualité soumise à une autre expression dramatique de la décomposition capitaliste, la guerre.
Dans un précédent article, nous avions clairement affirmé combien toute cette campagne médiatique et la fausse indignation du gouvernement sur la situation dans les EHPAD étaient d’une hypocrisie sans nom. (1) La main sur le cœur, des trémolos dans la voix, la ministre à l’autonomie, Brigitte Bourguignon, comme d’autres, osait affirmer de manière éhontée « qu’on ne fait pas n’importe quoi dans ce pays, dans une activité qui est lucrative mais qui ne doit pas l’être au détriment de la bientraitance ». Lucrative donc, c’est-à-dire source de profits, mais activité au plus haut point désintéressée et solidaire… De qui se moque-t-on ? Dernier exemple en date où la logique capitaliste et sa pourriture morale se sont confirmées, l’ancien directeur général d’ORPEA, censé garantir cette « bientraitance institutionnelle », a été limogé fin janvier suite au scandale mais aussi parce qu’il est soupçonné de délit d’initiés ; averti de la sortie du livre « Les Fossoyeurs », il aurait revendu « à l’insu de son plein gré » quelque 7 500 titres ORPEA lui ayant rapporté plus de 800 000 euros. Chassez le naturel… Au-delà du sentiment de dégoût, on ne peut que constater, une fois de plus, que la « bientraitance » sous le capitalisme n’est jamais que celle du profit extorqué à l’humanité comme marchandise qu’il faut rentabiliser jusqu’au bout dans des établissements mouroirs.
Le Moloch capitaliste contre la vieillesse
La question « des vieux » dans le capitalisme est devenue une véritable caricature de la barbarie ordinaire. La population mondiale vieillit. D’après les projections de l’ONU, 16 % des êtres humains auront 65 ans ou plus en 2050, contre seulement 9 % aujourd’hui. Même si avec l’épidémie de Covid, l’espérance de vie mondiale a connu en 2020 sa plus forte baisse depuis la Seconde Guerre mondiale (France Inter, septembre 2021), il n’en reste pas moins que ce vieillissement historique de la population mondiale inquiète économistes, gouvernements et États qui parlent d’un « tsunami gris » où la population active ne parviendra plus à subvenir aux besoins des plus âgés.
En 1973, sortait le film de science-fiction Soleil vert, librement inspiré du roman de Harry Harrison, Soylent green (1966), où dans une société totalitaire du futur (situé… en 2022 !), la pollution, le chômage massif, la surpopulation et le manque de nourriture amènent le pouvoir à créer des aliments artificiels et industriels, soi-disant issus de plancton mais, en réalité, fabriqué à partir des cadavres de vieux, de chômeurs suicidés ou euthanasiés. Cette vision de l’industrialisation et du « cannibalisme » social dans ce film avait fait grand bruit à l’époque. C’étaient les premières expressions écologistes petite-bourgeoises réagissant au retour de la crise et appelant à réduire la consommation dans un monde aux ressources gaspillées, vantant la perspective prétendument radicale et « révolutionnaire » de la « décroissance » avant l’heure.
Aujourd’hui, la réalité vient concrétiser sur bien des aspects cette œuvre d’imagination apocalyptique. L’ « anthropophagie » du Moloch capitaliste transforme tous les jours l’être humain en une pure marchandise à rentabiliser jusqu’au dernier souffle de vie. Alors que dans les sociétés du passé, les anciens étaient respectés parce que leur expérience était un trésor à transmettre aux générations futures, le vieillissement est considéré par le capitalisme comme une calamité, une charge insupportable et inutile pour le mode de vie de la société bourgeoise. Les retraités sont donc vus comme des « improductifs » et des « inutiles » à l’égard desquels l’État bourgeois exprime la plus profonde indifférence. C’est pourquoi la retraite, dans tous les pays et sous tous les gouvernements, est peu à peu repoussée à des âges canoniques et donne lieu à des pensions de plus en plus maigres. Tant pis si ces ouvriers sexagénaires ne peuvent plus assumer leur tâche. Et surtout, tant pis s’ils sont malades et épuisés, ou plutôt, tant mieux. Car c’est bien là le calcul de la classe dominante : que les ouvriers qui n’ont pas été licenciés en cours de route soient contraints de laisser tomber leur emploi, résignés et au bout du rouleau, sans avoir obtenu leur nombre de trimestres nécessaire pour une pension déjà à minima. Qu’ils crèvent à la tâche ou qu’ils partent avec leur pension de misère ! Et lorsqu’ils ne pourront plus vivre tout seuls, c’est le racket institutionnalisé dans les maisons de retraite. L’État en profitera pour récupérer les pensions des anciens et attaquer les salaires des autres membres de la famille obligés de prendre en charge ou de compléter le prix du « séjour ».
La paupérisation des vieux, particulièrement ceux de la classe ouvrière, est déjà spectaculaire dans les pays sous-développés, déjà choquante depuis longtemps, comme en Inde, par exemple, où il n’existe quasiment pas de prise en charge des personnes âgées. C’est aussi le cas dans les pays développés :
– En Corée du Sud, actuellement, près de la moitié des plus de 66 ans vit sous le seuil de pauvreté, conduisant les « Bacchus Ladies », ces dames âgées aux pensions ridicules, (la plupart ont entre 60 et 80 ans) qui se prostituent en plein Séoul pour pouvoir se nourrir !
– Au Japon, des retraités ne pouvant plus payer leur loyer choisissent même de commettre des délits pour s’offrir le luxe d’avoir un toit… en prison !
L’exclusion fait partie de l’ADN du capitalisme décadent
« Pour le capitalisme, les vieux, comme les handicapés, les marginaux ou les clochards, ne sont que des bouches inutiles à nourrir, des improductifs, aux yeux de l’État et des patrons, des “assistés”, tout juste bons à se faire “plumer” par des rapaces comme ceux du groupe ORPEA ». (2) Effectivement, l’exclusion ne concerne pas seulement les personnes âgées même s’ils en sont significativement les premières victimes, mais tous ceux qui, d’une façon ou d’une autre, ne correspondent pas aux exigences de productivité de la société capitaliste marchande, tous les laissés pour compte : les chômeurs, les retraités, les SDF ou sans-abris, tous les « accidentés de la vie », tous les malades, psychiatriques ou physiques, tous ceux qui, au-delà même de ne plus être rentables, représentent un « poids social », un « coût économique » affaiblissant d’autant le profit global de la nation capitaliste. Cela ne date pas d’hier, mais de toutes les sociétés d’exploitation, la société capitaliste reste le nec plus ultra de l’exclusion généralisée pour garantir l’exploitation et le profit maximal.
Bien sûr, la classe dominante cherche par tous les moyens à masquer ou détourner cet instinct naturel du capitalisme à grands coups de « campagnes de communication ». Les discours et la propagande sur le handicap en sont un parfait exemple. Ainsi, la vitrine des jeux paralympiques ou du handisport vient « valoriser », de manière hypocrite, le handicap, source d’exclusion, dans une prétendue perspective « d’intégration et d’égalité ». Il s’agit, en réalité, d’un bourrage de crâne basé sur le culte de la réussite individuelle et la propagande du « si on veut, on peut ! », qui cache mal les réalités de l’exclusion sociale de l’immense majorité des handicapés. La fonction du sport, comme pour les « valides », n’est fondamentalement ici qu’un conditionnement pour adhérer à la culture et à l’exaltation de la compétition, du nationalisme et de la concurrence entre nations qui sont les « valeurs » mêmes sur lesquelles s’appuie le capitalisme !(3) L’exclusion du handicap reste toujours la règle dans un monde capitaliste qui se doit d’être efficace, rapide, rentable pour suivre les lois économiques et la logique de l’exploitation.
Le chômage, exclusion majeure pour la classe ouvrière
Hannah Arendt écrivait en 1961 : « Ce que nous avons devant nous, c’est la perspective d’une société de travailleurs sans travail, c’est-à-dire privés de la seule activité qui leur reste. On ne peut rien imaginer de pire ». Le « chômage de masse » auquel fait référence Arendt forme la plus grande marmite à exclusion et à atomisation que le capitalisme à l’agonie peut fournir.
Si l’État, dans certains pays occidentaux comme la France, a permis après la Seconde Guerre mondiale un relatif « soutien » et le maintien d’un salaire social nécessaire pour entretenir une « armée de réserve » efficace pour l’intensification de la production et une exploitation forcenée, c’était à des fins de « reconstruction » et de compétitivité de l’économie nationale. Cet « État-Providence », devenu désormais trop coûteux, a été largement démantelé et tend à disparaître partout, avec les coups de boutoir croissants de l’aggravation de la crise économique, précarisant, jetant à la rue et marginalisant totalement ceux qui sont devenus « inutiles » ou « inaptes à la production ». C’est cette sordide réalité que tente de masquer l’hypocrisie bourgeoise et sa fausse solidarité, développée sous toutes ses formes, en vantant les « efforts » d’aide sociale des États aux plus faibles ou démunis, en faisant appel au portefeuille de la « solidarité citoyenne », en multipliant la mise en sous-traitance du marché des « aides sociales » par des entreprises elles aussi uniquement motivées par le profit maximum à retirer de ce créneau, qui va des mouroirs déshumanisés que sont les EHPAD à la gestion hospitalière, des « foyers » ou « centres spécialisés » pour « encadrer » les jeunes en difficulté aux « aides aux handicapés » et autres « association d’aides à domicile », etc.
La solidarité que prône et dont se gargarise la bourgeoisie ne peut être qu’une fausse solidarité reposant sur le mensonge et la poursuite de conflits d’intérêts mercantiles, totalement sous l’emprise du « chacun pour soi » et de la concurrence capitaliste : « L’idée que l’État serait l’incarnation de la solidarité, telle que l’ont cultivée en particulier la social-démocratie et le stalinisme, est l’un des plus grands mensonges de l’histoire. La solidarité ne peut jamais être imposée contre la volonté. Elle n’est possible que si ceux qui expriment la solidarité et ceux qui la reçoivent partagent la conviction de sa nécessité. La solidarité est le ciment qui tient ensemble un groupe social, qui transforme un groupe d’individus en une seule force unie ». (4)
L’exclusion devient la marque de fabrique du capitalisme agonisant
L’accélération de la crise économique partout dans le monde pousse des millions d’exploités non seulement au chômage, mais également à ses conséquences les plus sordides que sont la vie « dans la rue », la drogue, la délinquance… Cette logique infernale de désocialisation touche aujourd’hui des masses toujours plus nombreuses de l’humanité. Là encore, la bourgeoisie n’hésite pas à instrumentaliser la situation de ces populations en les présentant comme des « incapables », des « poids morts », des « assistés » ne pouvant s’en prendre qu’à eux-mêmes. En d’autres termes, il s’agit de culpabiliser ces « individus hors norme » pour mieux cacher l’abjecte indifférence de la société capitaliste.
Les sans-abris, toxicomanes et drogués que l’on trouve dans toutes les concentrations urbaines sont ainsi présentés comme marginaux par « accident » ou « incompétence », « manque de volonté », incapables de « s’intégrer », de travailler, des « déchets » sociaux sources de toutes les vilenies. Souvent, ils ne sont pourtant et de plus en plus que des jeunes en souffrance, éjectés du rouleau compresseur de l’école, éjectés de pays en guerre, traumatisés, délaissés par des familles impuissantes, rejetés par le système productif ou tout simplement délaissés par les services de santé des États ! Seule l’économie parallèle du trafic de stupéfiants, les mafias de la came, trouvent avantage à l’exploitation jusqu’à la mort d’une partie de ces exclus.
La solidarité prolétarienne est l’arme du futur
La solidarité est une expression concrète de la nature sociale de l’humanité, une tendance vers une activité pratique de soutien mutuel entre les êtres humains dans la lutte pour l’existence, aujourd’hui pervertie par la société capitaliste. Elle n’est pas un idéal utopique à atteindre, mais au contraire une force matérielle active caractérisée par la conscience, la volonté et par l’initiative. La solidarité est donc le dépassement de l’individualisme et du particularisme dans l’intérêt de l’ensemble de la communauté aussi vieille que l’humanité elle-même. Bien que dans l’histoire de l’humanité, la solidarité entre les membres de la société ait été avant tout un réflexe instinctif de préservation, plus la société humaine devient complexe et conflictuelle, depuis l’apparition des sociétés de classes, plus haut est le niveau de conscience nécessaire à son développement. En ce sens, la solidarité de classe du prolétariat constitue la forme la plus haute de la solidarité humaine jusqu’ici.
Or, là où règnent en permanence les rapports marchands, la réduction des hommes eux-mêmes à des marchandises et le principe bourgeois du calcul d’intérêt, des avantages et des inconvénients de ce que l’on offre à l’autre, la tendance consécutive inexorable à la désagrégation des rapports sociaux qui culminent dans le capitalisme décadent, il n’y a pas de solidarité possible autre que dans le combat de classe. La bourgeoisie ne peut ainsi que prolonger et accentuer toujours plus les souffrances de l’humanité en défendant bec et ongles son système de domination.
La classe ouvrière est la seule force sociale, à travers le développement de ses luttes sur son terrain de résistance et de lutte contre l’exploitation capitaliste et de sa perspective révolutionnaire, capable d’exprimer sa solidarité à tous les exclus du système, à tous les exploités parce qu’à l’opposé de la bourgeoisie, le prolétariat est amené à développer dans sa lutte contre le capitalisme une solidarité de classe, expression de son unité et qui correspond en même temps à sa tache historique de libérer l’ensemble de l’humanité du fléau et des chaînes de l’exploitation.
Sa solidarité est celle d’une classe internationale qui, en luttant au-delà de toutes les particularités nationales, raciales, physiques, pourra bannir l’exploitation en mettant fin au travail salarié par la révolution communiste en instaurant une société dont les rapports sociaux seront non plus établis sur la base d’un rapport entre exploités et exploiteurs mais selon le principe suivant : « De chacun selon ses capacités à chacun selon ses besoins », lequel reposera l’ossature de la société communiste.
Stopio, 19 mars 2022
1 « Les maltraitances dans les maisons de retraite sont un produit de la barbarie du capitalisme [450] », disponible sur notre site internet (5 février 2022).
3 Voir notre série sur le sport, et notamment : « Le sport, le nationalisme et l’impérialisme [451] (Histoire du sport dans le capitalisme, partie III) ». Sans compter que le handisport et les JO paralympiques sont aussi un vecteur important de la concurrence féroce entre entreprises ou entre nations et que « la guerre des prothèses » n’a rien à envier à la « guerre des masques » ou celle des vaccins que nous avons largement dénoncées dans nos articles sur la pandémie.
4 « La confiance et la solidarité) dans la lutte du prolétariat [452] ». (2001)
Récent et en cours:
- maison de retraite [374]
- EHPAD [373]
Rubrique:
32 heures: La face cachée de la réduction du temps de travail
- 119 lectures
Depuis plusieurs années, la question de la réduction du temps de travail est un serpent de mer que les partis de gauche comme les syndicats tentent de vendre aux exploités comme la « solution miracle » : après « l’expérimentation » des 32 heures en Espagne et en Islande, sa mise au sein d’un nombre croissant d’entreprises de part le monde, ce fût au tour de Mélenchon et son programme « L’avenir en commun » de défendre les vertus de la réduction du temps de travail lors de la campagne présidentielle. (1)
À en croire ses promoteurs, qu’ils soient patrons, économistes, syndicalistes ou politiciens de gauche, une telle réduction du temps de travail aurait de multiples vertus : baisse du chômage, de la consommation d’énergie, de la pollution, de l’absentéisme, des maladies et soins liés au stress et à l’épuisement, amélioration du bien-être et de la santé mentale des salariés… et, surtout, hausse de la productivité ! Au Japon, lors d’une expérimentation des 32 heures de travail hebdomadaires sur 4 jours ouvrés sans baisse de salaire nominal durant le mois d’août 2019, la société Microsoft a tiré des résultats plus que concluants : augmentation de 40 % de la productivité tout en réalisant d’importantes économies d’énergie et de papier). En France, inspirée par ces résultats, l’entreprise LDLC a adopté depuis 2021 le même dispositif de réduction de temps de travail : « Le PDG Laurent de la Clergerie était sûr de lui, malgré quelques réticences : “Les manageurs ont mis deux mois pour se faire à l’idée, ils avaient peur que leurs équipes ne fassent rien en leur jour d’absence. Mais justement ces heures je ne leur ai pas données, je leur ai simplement évité de faire du présentéisme” non-productif ». (2) D’ailleurs, « sans avoir “besoin de recruter ni de faire des changements majeurs”, l’entreprise a en réalité… quadruplé son bénéfice net. “Aujourd’hui, finalement, les gens sont heureux, le bien-être est là, et l’entreprise gagne plus d’argent qu’avant, se réjouit-il. En fait, j’ai fait jackpot, je l’avais pas prévu… C’est presque une formule magique”. » (3)
La hausse de la productivité est en effet le principal aspect de la réduction du temps de travail qui intéresse les capitalistes. Lorsqu’en 1926, Henry Ford instaura dans ses usines la semaine de 40 heures de travail sur 5 jours ouvrés sans baisse de salaire nominal, c’était en premier lieu pour la raison que cette formule était la plus à même de favoriser l’exploitation maximale de ses ouvriers, qui devaient se reposer plus longtemps afin de pouvoir reconstituer leur force de travail en raison du travail à la chaîne et des cadences infernales imposées par l’organisation fordiste de l’exploitation capitaliste. C’est aussi l’augmentation de la productivité, notamment dans le secteur de l’armement, et l’embrigader idéologique les prolétaires pour la guerre, que la gauche française avait en vue lorsqu’elle mit en place, en 1936, sous le gouvernement de Front populaire, les lois sur la semaine de 40 heures de travail et les 2 semaines de congés payés, comme le reconnaîtra plus tard Léon Blum en personne : « Le rendement horaire, de quoi est-il fonction ? […] Il dépend de la bonne coordination et de la bonne adaptation des mouvements de l’ouvrier à sa machine ; il dépend aussi de la condition morale et physique de l’ouvrier.
Il y a toute une école en Amérique, l’école Taylor, l’école des ingénieurs Bedeau, que vous voyez se promener dans des inspections, qui ont poussé très loin l’étude des méthodes d’organisation matérielle conduisant au maximum de rendement horaire de la machine, ce qui est précisément leur objectif. Mais il y a aussi l’école Gilbreth qui a étudié et recherché les données les plus favorables dans les conditions physiques de l’ouvrier pour que ce rendement soit obtenu. La donnée essentielle c’est que la fatigue de l’ouvrier soit limitée…
Ne croyez-vous pas que cette condition morale et physique de l’ouvrier, toute notre législation sociale était de nature à l’améliorer : la journée plus courte, les loisirs, les congés payés, le sentiment d’une dignité, d’une égalité conquise, tout cela était, devait être, un des éléments qui peuvent porter au maximum le rendement horaire tiré de la machine par l’ouvrier ». (4)
C’est encore et toujours l’augmentation de la productivité, le prolétaire restant une bête de somme à exploiter, qui était l’objectif du gouvernement de la « gauche plurielle » de Lionel Jospin lorsque ont été mises en place à partir de 2000 les lois sur les 35 heures de travail. (5)
D’ailleurs, tout comme ce fut le cas pour les 40 heures en 1936, les 35 heures actuelles ne constituent qu’une moyenne théorique du temps de travail hebdomadaire et la flexibilité accrue des horaires de travail introduite avec ces lois aboutit à une durée réelle supérieure à celle affichée (39,1 heures hebdomadaires en moyenne pour les travailleurs salariés en 2018… soit plus que les 39 heures hebdomadaires en vigueur avant la mise en place des « 35 heures » !
En outre, le maintien annoncé du niveau des salaires ne relève que d’un effet d’annonce particulièrement mensonger. Ainsi, les lois Aubry ont permis de sortir du décompte du temps de travail des moments comme les pauses ou les temps de déplacement ou d’habillage jusque-là comptabilisés. De plus, elles ont permis non seulement la baisse du salaire indirect en réduisant les cotisations sociales versées par les entreprises passant aux 35 heures, mais aussi un blocage du salaire direct durant un an et demi en moyenne, ce qui signifie, en tenant compte de l’inflation, une baisse du salaire réel. Au final, quand la gauche annonce une réduction du temps de travail, c’est bien une hausse de la productivité du travail qu’elle fournit aux capitalistes et une forte intensification de son exploitation.
Sans surprise, les entreprises qui sont déjà allées au-delà en passant aux 32 heures de travail hebdomadaires l’ont fait pour des raisons similaires. Ce fut par exemple le cas de Bosch Rexroth à Vénissieux, comme le reconnaît, en cherchant à nous enfumer avec le mythe du « gagnant/gagnant », un responsable local de la CGT : « On a profité de la loi Aubry I et de cette possibilité de négociation pour passer à trente-deux heures payées trente-neuf. En contrepartie, il n’y a pas eu d’augmentation de salaire pendant trois ans. Cela a permis une quarantaine d’embauches, principalement dans la production, sur six cents salariés environ. Sur les services supports (logistique, qualité, etc.), où il n’y a pas eu de création de postes, ça a un peu intensifié la charge de travail. En échange, les cadres et les techniciens en forfait jours ont pu obtenir jusqu’à vingt-trois jours de RTT. Grâce aux trente-deux heures, nous sommes parvenus à un certain confort pour les salariés. Le patron y a retrouvé ses petits ; il a dit que c’était rentable pour lui ». (6)
Une telle mesure peut également servir à réduire le nombre de chômeurs en répartissant le temps chômé dans toute la classe ouvrière, ce qui permet de baisser les coûts liés à l’assurance-chômage et donc d’optimiser encore l’exploitation de la force de travail. Ainsi, selon un rapport parlementaire de 2014, « les lois Aubry ont coûté, par an, 2 milliards d’euros aux entreprises et 2,5 milliards d’euros aux administrations publiques, soit un peu plus de 12 800 euros par emploi créé, à comparer avec l’indemnisation nette moyenne d’un chômeur, qui s’élèverait à 12 744 euros par an en 2011. C’est la politique en faveur de l’emploi la plus efficace et la moins coûteuse qui ait été conduite depuis les années 1970 ». (7)
Et qu’en est-il de ce motif de plus en plus évoqué, à savoir qu’une telle mesure contribuerait à la protection de l’environnement ? « Il faut d’une part réduire le temps de travail pour en améliorer le partage et d’autre part modérer la croissance, voire annuler l’augmentation de la production en transférant les gains de productivité, non pas sous forme de revenus, mais sous forme de temps libre. Et tout cela est acceptable si on met bien l’accent sur ce qu’on gagne (du temps) par rapport à ce qu’on perd : une consommation qui n’est pas tant que cela synonyme de plaisir et de bonheur ». (8) Ce ne serait donc pas le capitalisme qui détruit la planète dans sa soif inextinguible de profit, mais les travailleurs salariés qui, mus non par la nécessité mais par une quête hédoniste de davantage de « loisirs », produiraient et consommeraient trop sans vraiment se soucier des conséquences de leurs actes pour la planète !
La pilule pouvant se révéler difficile à avaler pour ces mêmes travailleurs dont les conditions de vie ne cessent de se dégrader, il s’agirait donc de savoir bien leur présenter les choses : « Réduire le temps de travail représente un premier pas qui permet de rendre acceptable la limitation de la consommation et de la production. Cela pourrait servir de levier pour un changement de mentalité et de société, en accompagnant la transition énergétique tout en aidant à partager le travail. […] L’impératif de réduction des émissions de gaz à effet de serre repose de manière plus urgente encore une vraie question de société : sommes-nous prêts à travailler, à produire et à consommer moins pour vivre plus équitablement ensemble ? » (9) En voilà un vibrant appel à se serrer la ceinture… « pour le bien de la planète » ! Et c’est ainsi que la paupérisation est repeinte en vert. Il faut donc nous attendre à ce qu’on nous serve ce genre de propagande écologiste pour justifier les baisses de salaire ou l’augmentation des prix, comme c’est déjà le cas pour le prix des carburants, du gaz ou de l’alimentation afin d’« inciter les consommateurs à renoncer au pétrole » et au « gaspillage d’énergies ». Un vrai bourrage de crâne basé sur la culpabilisation des exploités !
On le voit, les mesures de « réduction du temps de travail », qu’elles soient effectives ou non, ne constituent en rien un cadeau du patron bienveillant ou un acte généreux de la part d’un gouvernement de gauche. Aujourd’hui comme hier, derrière les justifications sociales ou environnementales, elles accentuent la précarité et ont en réalité pour seul objectif d’optimiser l’exploitation capitaliste en l’adaptant aux conditions de la crise économique. Le prolétariat ne devra pas s’illusionner si la bourgeoisie tente de lui faire accepter ce type de « lendemains qui chantent ». Il s’agit au contraire de résister à ces nouvelles attaques en préparation, à ce surcroît d’exploitation que tente de déguiser en « cadeau » (empoisonné) la bourgeoisie.
DM, 26 avril 2022
1 Voir : « La France Insoumise encore et toujours au service du capitalisme [453] » sur le site internet du CCI.
2 « La semaine de quatre jours, positive pour les salariés… et pour l’employeur [454] », Le Monde (26 janvier 2022).
3 « Salariés “contents de venir au travail”, bénéfices quadruplés pour cette entreprise… la semaine de quatre jours serait-elle la formule magique ? [455] », France Info (20 janvier 2022).
4 Cité dans notre article « 1936 : Fronts populaires en France et en Espagne : comment la bourgeoisie a mobilisé la classe ouvrière pour la guerre [456] », Revue internationale n° 126 (3e trimestre 2006).
5 Voir à ce sujet notre article « 35 heures : une loi qui sert les intérêts de la bourgeoisie [457] », Révolution internationale n° 327 (octobre 2002).
6 « Ressentiment tenace contre les lois Aubry [458] », Le Monde diplomatique (juin 2021).
7 Ibid.
8 « Travailler moins pour polluer moins [459] », Le Monde diplomatique (juin 2021).
9 ibid.
Personnages:
- Mélenchon [388]
Récent et en cours:
- 32 heures [460]
Courants politiques:
- Gauchisme [461]
Rubrique:
La France Insoumise, encore et toujours au service du capitalisme
- 266 lectures
Suite au premier tour de l’élection présidentielle, Mélenchon est arrivé en troisième position, à quelques centaines de milliers de voix de la qualification au second tour. Il doit son relatif succès à la mobilisation de l’électorat populaire et ouvrier des anciens « bastions rouges » de la banlieue parisienne et des concentrations ouvrières de la plupart des grandes villes françaises. Sa candidature a pris également chez beaucoup de jeunes pourtant plus méfiants envers tous les discours convenus des bonimenteurs patentés du cirque électoral. Alors que les partis historiques de la gauche, PS et PCF en tête, ont fait naufrage, décrédibilisés, incapables de représenter le moindre espoir aux yeux d’électeurs désabusés, La France insoumise (LFI), avec son leader charismatique Mélenchon, se présente désormais comme la « force de gauche » par qui peut venir l’espérance d’un avenir meilleur. Elle se donne à la fois l’image du recours face au « libéralisme » bourgeois, au « pouvoir de l’argent » et des « riches », face aux attaques du pouvoir macronien comme au danger « fasciste » du Rassemblement national de Marine Le Pen…
À travers son slogan « un autre monde est possible », LFI se présente même comme une force alternative en opposition à la société capitaliste. Et ce alors que de larges parties de la classe ouvrière et de la nouvelle génération constatent la putréfaction du monde capitaliste sous les coups de butoir de la crise et de la guerre et la nécessité de « changer la société ». Il n’est dont pas surprenant qu’après son échec pour accéder au deuxième tour de l’élection présidentielle, Mélenchon s’est empressé d’appeler à la mobilisation massivement dans les urnes lors des élections législatives afin, selon lui, de « contraindre » Macron à le nommer premier ministre et assurer une prétendue « opposition ».
Depuis l’élection de Mitterrand et du PS au début des années 1980 et la participation du PC aux gouvernements de la gauche, la classe ouvrière sait à quoi s’en tenir avec la gauche et ce genre de palabres. Derrière les grands discours « émancipateurs » se cache la poursuite de l’exploitation la plus effrénée, les attaques à n’en plus finir des conditions de vie, et la répression des luttes sociales et des grèves. Le discrédit de ces partis est justement le fonds de commerce d’un Mélenchon qui pousse à penser qu’une « vraie » gauche pourrait réellement « changer la vie ». Il n’en est clairement rien !
Car ce projet porté par Mélenchon n’est en rien novateur. C’est une copie modernisée des fausses alternatives véhiculées par toutes les fractions social-démocrates radicales, écologistes et citoyennes. (1) Avec ces habits neufs, la bourgeoisie tente donc de redynamiser l’idéologie portée par la gauche du capital et de remplacer un stalinisme clairement moribond en réactivant le programme, tout autant anti-ouvrier, de la vieille social-démocratie. En appelant à « l’union populaire » pour « un autre monde possible », Mélenchon et sa clique, veulent nous faire croire qu’ils constituent, par un recyclage d’idéologies pourtant périmées, une alternative au capitalisme. Dans la réalité, ils en sont toujours de fervents défenseurs !
Un programme mystificateur et va-t-en-guerre
Pour faire face à la crise, le « Programme de l’Union populaire » propose « de grands chantiers pour relever le défi écologique… Engager un plan global de rénovation de nos infrastructures pour les adapter au changement climatique ». Est-ce une nouveauté susceptible de « créer plusieurs centaines de milliers d’emplois et réduire massivement le chômage » ? Depuis quelques années, la campagne idéologique en faveur d’un « New Deal vert » prétend résoudre tout à la fois le problème du changement climatique, du chômage et des inégalités. Le « New Deal vert » propose, nation par nation, des plans mirifiques pour une nouvelle croissance basée sur des énergies, une production et des infrastructures écologiques, promettant un soutien à l’économie en s’appuyant sur l’augmentation des dépenses. En fait, le « New Deal vert » trouve sa très pâle inspiration dans la politique capitaliste d’État menée dans les années 1930 aux États-Unis afin de relancer la croissance, suite à la grande dépression de 1929. Le New deal de Roosevelt n’a finalement été qu’une politique de grands travaux basée sur le recours massif et inédit à l’endettement étatique, permettant de construire navires et avions de guerre, bases militaires et terrains d’aviation. Ce n’était d’ailleurs pas différent des politiques en vigueur à cette époque en Allemagne, quand de nombreuses autoroutes étaient construites en préparation de la guerre à venir. Voilà la logique concrète contenue dans une telle proposition radicale !
Des propositions du même acabit ont également éclos sur la « garantie d’emploi, réduire le temps de travail, en finir avec la flexibilité ». (2) Là encore, des propositions mirifiques qui font « rêver » ! La réalité, c’est que chaque soi-disant avancée sociale, notamment portée par la gauche au pouvoir (semaine de congés payés supplémentaire en 1982 ou 35 heures. en 2000) s’est systématiquement traduite par l’aggravation de l’exploitation avec l’augmentation des cadences, le gel des salaires et la précarisation accrue de l’emploi, tout cela amenant pression, souffrance au travail, suicides parfois, précarité et « mobilité » pour tous les exploités.
Penser qu’il pourrait en être autrement, par enchantement, dans un contexte de crise et concurrence capitaliste accrue et acharnée (que revendique d’ailleurs totalement le candidat Mélenchon) est une pure illusion. En effet, la « relocalisation des productions essentielles, engager un plan de reconstruction industrielle pour mettre fin à la dépendance de la France dans les domaines stratégiques (semi-conducteurs, médicaments, etc.) et pour soutenir la bifurcation écologique », outre l’endettement massif, ne pourrait se faire qu’au prix d’une réduction drastique des coûts de production et d’une attaque cinglante de nos conditions de vie. Ce sont là les lois inexorables du système capitaliste !
Quant à la promesse de gauche éculée du « partage plus juste des richesses » et de « faire payer les riches », c’est encore de la poudre aux yeux : Mélenchon et sa clique n’ont rien de plus à proposer qu’un énième saupoudrage de « nouvelles » recettes fiscales, notamment un rétablissement de l’impôt sur les grosses fortunes supprimé par Macron et une taxation plus forte de l’État sur les propriétés immobilières.
Autre proposition altermondialiste prétendant en finir avec le chaos et la barbarie guerrière dans le monde, d’autant plus importante dans ce contexte d’accélération guerrière comme aujourd’hui en Ukraine : « Pour promouvoir la paix et la coopération », « retrouver une voix indépendante, assumer l’indépendance de la France dans le monde, est une nécessité ». Derrière un tel discours récurrent se cache le chauvinisme le plus crasse promettant les horreurs guerrières de demain : « Si tu veux la paix, prépare la guerre ». Au nom de ce principe de va-t-en-guerre guerre, concrétisé à l’extrême dans toute l’histoire du capitalisme, des millions d’exploités y ont laissé leur vie, dans la défense d’intérêts nationaux bourgeois qui n’ont jamais été les leurs, en toute « indépendance ».
Mélenchon en remet une couche qui ne se pare même pas d’oripeaux pacifistes : « La France peut et doit se défendre elle-même, en dehors de toute alliance militaire permanente quelle qu’elle soit. Pour cela, la défense doit être l’affaire de la Nation tout entière ». Pour ce faire, les propositions sont multiples et très expressives d’un avenir soi-disant « radieux » de coopération et d’entente mutuelle : « Stopper les privatisations des industries d’armement et des missions de défense nationale, puis les réintroduire dans le secteur public. Prioriser l’acquisition de matériel militaire français dans l’armée. Ouvrir la possibilité d’un service militaire comme composante optionnelle du service citoyen obligatoire. Mobiliser l’espace numérique et la réalité spatiale pour installer des systèmes défensifs et non létaux contre les agressions et pour la paix. Adapter le matériel militaire et l’équipement de nos soldats à la nouvelle donne climatique. Lancer un plan d’adaptation des infrastructures militaires vulnérables ». N’en jetez plus, la cour est pleine ! Si d’aucuns pouvaient s’illusionner sur la vision du futur un tantinet « révolutionnaire », « solidaire » et « radical » de Mélenchon, ils ont la démonstration sans fard d’une perspective chauvine et va-t-en-guerre décomplexée.
Nous pourrions multiplier à l’envi toutes les propositions supplémentaires pour une « défense nationale » du renseignement, de l’anti-terrorisme, d’une police de proximité plus efficace, de techniques de répression plus « républicaines » au service de l’État !
La France Insoumise, fer de lance de la division au sein de la classe ouvrière
Il existe donc aujourd’hui dans les rangs ouvriers et dans la jeune génération beaucoup d’illusions sur la nature de LFI du fait notamment de la perte de repère que subit la classe ouvrière sur sa conscience d’elle-même et sa capacité à entrevoir la société communiste dont elle est porteuse. Mais si ces difficultés existent bel et bien, elles ne signifient pas une incapacité irréversible de recouvrer son identité de classe et la conscience du but à atteindre. Et cela, la bourgeoisie le sait et veille à éviter qu’une telle « catastrophe » se produise au travers des mystifications véhiculées par les partis de gauche.
LFI est désormais la principale force de la gauche capable d’assumer ce rôle d’encadrement idéologique du prolétariat. À la fois :
– En stérilisant le rôle révolutionnaire de la classe ouvrière par sa dilution dans l’amas informe du « peuple français », des « couches populaires » et « citoyennes ».
– En dévoyant le but d’une société sans classe sociale, sans exploitation et sans État par un prétendu égalitarisme garanti par l’État républicain.
– Enfin, en torpillant les luttes passées et à venir, en sapant la recherche de l’unité et de la solidarité au sein de la classe ouvrière. Pour s’en faire une idée, il est nécessaire de revenir sur la tentative idéologique ignoble de LFI de division générationnelle que l’on a vu déjà à l’œuvre pendant la pandémie et qui s’est réactivée avant ce premier tour et juste après : en clair, les vieux seraient la génération par qui le mal arrive, celle qui, pour beaucoup, ne s’est pas protégée et a entraîné le confinement de tous et le sacrifice des jeunes. Aujourd’hui, LFI et ses relais médiatiques stigmatisent le vote des ex-babyboomers pour Macron et Le Pen. Le conservatisme réactionnaire des vieux empêcherait les « forces vives » de la jeunesse (votant davantage pour Mélenchon) de se donner une perspective. Insinuer ouvertement ou par la bande que les retraités ont leur « carrière derrière eux », ont égoïstement profité du plein emploi, du consumérisme et de la retraite à 60 ans est une ignominie à vomir dont Mélenchon se sert pour caresser dans le sens du poil de jeunes électeurs, en majorité diplômés, face à un avenir plus qu’incertain, et pour diviser les ouvriers.
Outre l’aspect grossier de cette campagne, l’idéologie dominante tente en fait d’entraver toute potentialité d’une véritable unité et solidarité pour les luttes à venir, décrédibilisant toute l’expérience accumulée par les générations ouvrières précédentes, si nécessaires pour renforcer les luttes à venir. Voilà encore l’expression concrète de la « coopération » et de la « morale » prônées par le sieur Mélenchon. Au bout du compte, derrière les affirmations qu’« un autre monde est possible », il faut clairement lire « un même État national est possible ».
Il est donc nécessaire de rappeler une vérité toute simple : pour les prolétaires, l’État est le fer de lance de l’exploitation capitaliste ! Qui mène sans cesse des attaques générales contre les conditions de vie de la classe ouvrière ? Qui réprime la moindre expression de révolte contre l’ordre établi ? C’est l’État bourgeois ! Hier, aujourd’hui et demain, tous ses défenseurs, ses « réformateurs » affichés, par les urnes, par les discours ou les programmes, aussi radicaux soient-ils, n’en sont que des rouages directs et indirects. Mélenchon et LFI sont des ennemis de la classe ouvrière, de ses luttes et de ses efforts pour renforcer la conscience prolétarienne d’une alternative révolutionnaire nécessaire et possible.
Stopio, 23 avril 2022
1 Comme celles du Parti Socialiste Unifié en son temps. Celui-ci avait été présenté comme la tentative de construire une démarche de « réformisme révolutionnaire », très marqué par la logique du « grand soir ». Ses contributions aux pièges et aux impasses autogestionnaires, comme lors des luttes de Lip, avaient contribué, comme tant d’autres, à dévoyer toute la réflexion prolétarienne suite à Mai 68.
2 Voir : « 32 heures : La face cachée de la réduction du temps de travail [462] » sur le site internet du CCI.
Situations territoriales:
Personnages:
- Mélenchon [388]
- La France Insoumise [463]
Récent et en cours:
- Election présidentielle [448]
Courants politiques:
- Gauchisme [461]
Rubrique:
Alain Krivine: Au-delà des apparences, un défenseur du capital!
- 208 lectures
Alain Krivine est décédé le 12 mars 2022. La plupart des médias bourgeois ont salué la mémoire de « Krivine la cravate », ancien candidat aux élections présidentielles françaises de 1969 et 1974 : du Figaro à Libération, en passant par Le Monde et Marianne, toute la presse bourgeoise s’est fendue de son petit hommage à cette « figure de l’extrême-gauche » et surtout à celui qui « s’était présenté au suffrage des électeurs tout en dénonçant la “duperie” des élections » et a donc bien rendu service à la bourgeoisie française en cautionnant, de façon « critique » bien sûr, le cirque électoral. En cette période de campagne électorale, un tel rappel vaut bien un hommage à une personnalité qui n’a jamais menacé de quelque façon que ce soit l’ordre capitaliste dominant.
La liste des hommages rendus par les partis politiques démocratiques est d’ailleurs fort longue : de Nathalie Artaud à Jean-Luc Mélenchon, de Fabien Roussel à Pierre Moscovici, toute la Gauche y est allée de sa larme pour le « militant révolutionnaire » qui « n’a jamais renié ses convictions anticapitalistes et révolutionnaires » (N. Artaud). Et c’est bien là le problème.
Ces convictions qu’Alain Krivine n’aurait jamais reniées, quelles sont-elles ? La Jeunesse Communiste Révolutionnaire qui est devenue en 1969 la Ligue Communiste, puis en 1974 la Ligue Communiste Révolutionnaire, dont il a été le fondateur, le candidat à la présidence (deux fois !) et le porte-parole, est à l’origine une scission des Jeunesses Communistes et de l’Union des Étudiants Communistes, deux organisations du PCF ; cette scission du PCF ne s’est pas faite sur des critères programmatiques, mais sur le refus de soutenir la candidature de Mitterrand à la présidentielle de 1965 ainsi que l’indépendance de l’Algérie. Et Krivine n’est pas parti de ces organisations du fait de ses désaccords : réclamant « le droit de tendance » dans la JC, il en a été exclu.
Liée à la IVe Internationale et au courant trotskyste de Pierre Frank (Parti communiste internationaliste), la JCR débute son activité par un soutien aux manifestations contre la guerre du Vietnam et, dans les faits, par un soutien pur et simple à « l’Oncle Hô » Chi-Minh et à la guerre sous drapeau stalinien ; Krivine et son organisation n’ont dans les faits jamais dévié d’une ligne : soutenir le Bloc de l’Est et le stalinisme contre le bloc occidental ; en pratique, la LCR a soutenu le castrisme et le guévarisme, les sandinistes nicaraguayens, l’invasion russe de l’Afghanistan en 1979 (même si la « base » de l’organisation a sur ce sujet désavoué son « Bureau politique » !), le nationalisme palestinien, l’Irak de Saddam Hussein contre les « troupes impérialistes occidentales ». La logique de cette politique est claire : « dans la logique bourgeoise des trotskystes (pour lesquels il n’y a jamais eu depuis la Seconde Guerre mondiale qu’un seul bloc impérialiste, celui dominé par les États-Unis), « l’adversaire principal, le seul véritable, de tous les peuples et des travailleurs occidentaux, c’est l’impérialisme, qu’il soit américain, britannique ou français ». (1) Toujours, partout, Krivine et son organisation ont défendu le nationalisme, les États, les luttes entre cliques bourgeoises, la guerre, du moment qu’il s’agit de combattre les États-Unis et leurs alliés, et exclusivement eux. Ils ont constamment défendu, comme leur ancêtre stalinien le PCF, la nature soi-disant « socialiste » de l’URSS et de ses satellites. Partout, toujours, la LCR a poussé les prolétaires à choisir un camp dans les combats impérialistes, le camp soi-disant « socialiste » défendant les prétendues « conquêtes de 1917 ». On peut ajouter que dans l’actuelle guerre en Ukraine, l’héritier de la LCR, le NPA, appelle à la « solidarité avec le peuple ukrainien », ce qui marque en creux le soutien de cette organisation à l’État capitaliste ukrainien, comme tout va-t-en-guerre, contre l’internationalisme prolétarien défendu par Trotsky pendant la Première boucherie mondiale !
Dans les luttes ouvrières, la LCR a toujours mis son action bourgeoise au service du sabotage par les syndicats, de l’isolement des prolétaires en lutte et des ouvriers combatifs : il n’est que de se souvenir de son engagement dans la grève de Mai 68, où elle a purement et simplement suppléé l’incapacité du PCF à encadrer le mouvement en soutenant l’action des syndicats, UNEF en tête, de son action dans l’enfermement de la lutte des ouvriers de Lip dans le piège de l’autogestion en 1973, dans la grève des cheminots de décembre 1986, lorsque la LCR a monté les « coordinations » pour faire le même travail contre-révolutionnaire que les syndicats décrédibilisés, isoler les roulants dans le corporatisme et empêcher les « éléments extérieurs » de participer aux AG cheminotes, (2) ou dans la lutte des infirmières en 1988 où la LCR a combattu la méfiance des grévistes envers les syndicats officiels en la détournant vers de nouvelles « coordinations » (c’est-à-dire vers le piège d’une pratique radicale du syndicalisme « de base »). (3) On se rappellera aussi des magouilles et du sabotage permanent des décisions des AG dans les comités chargés de les mettre en œuvre au cours de la lutte anti-CPE de 2006, alors même que les militants du CCI étaient calomniés en sous-main ou empêchés d’entrer dans les AG étudiantes pourtant ouvertes à tous, comme à Toulouse-Rangueil, (4) ou du soutien systématique à l’isolement et au dévoiement de la colère ouvrière dans toutes les actions stériles menée par les syndicats, que ce soit SUD ou la CGT, par exemple dans la lutte des enseignants parisiens en 2003, dans celle contre la réforme des retraites en 2010 ou dans la lutte menée contre la « pwofitasyon » en Guadeloupe la même année.
Aujourd’hui, l’héritier de la LCR, le NPA, toujours sous la houlette de Krivine, continue de présenter des candidats à toutes les élections, toujours avec le même argumentaire mensonger. Quand l’actuel candidat, Philippe Poutou, nous répète, comme avant lui Olivier Besancenot : « Une victoire électorale ne suffira pas, car les capitalistes, qui détiennent le pouvoir économique et les rênes de l’État, ne se laisseront pas faire. Il nous faudra imposer le changement par une mobilisation d’ensemble sur les lieux de vie et de travail pour constituer une force capable de révolutionner la société », cela ne peut que faire écho à ce que disait le candidat Krivine à la présidentielle de 1969 : « Les élections sont une telle duperie que même des travailleurs s’apprêtent aujourd’hui à apporter leurs suffrages au candidat Poher ! Ce faisant, ils croient transformer le non au référendum en une victoire ouvrière. Ils croient pouvoir troquer la trique gaulliste pour un régime joufflu, bonasse et apaisant. Mais quel est le véritable visage du pouvoir ? Se trouve-t-il au Parlement ? Se trouve-t-il au Sénat ? » (5) Autrement dit : ça ne sert à rien de voter mais il faut continuer à se servir de la « tribune électorale » qu’ « offrirait » la bourgeoisie, donc… allez vous défouler dans l’isoloir ! Et que vive la démocratie bourgeoise avec l’aide pleine et entière des trotskystes, ajouterons-nous !
Alors, oui, la bourgeoisie française peut remercier Krivine pour ses bons et loyaux services ! En tout cas, ça valait bien un petit hommage ! Mais la classe ouvrière retiendra surtout que la LCR/NPA et son porte-parole n’ont jamais été autre chose qu’une forme de stalinisme, plus « jeune », « sympathique » et « moins dogmatique » que leurs cousins de Lutte Ouvrière, et surtout moins déconsidérée que leurs mentors, le PCF et la CGT !
HG, 1er avril 2022
1 « PCF, CGT, Trotskystes, des va-t-en-guerre comme les autres [464] », Révolution Internationale n° 94 (octobre 1990).
2 Décembre 1986 : les ouvriers peuvent se battre sans les syndicats [465] », Révolution Internationale 264 (janvier 1997).
3 « Le rôle actif des Trotskystes dans la stratégie de la bourgeoisie », Révolution Internationale 174 (décembre 1988).
4 « L’intervention du CCI dans le mouvement contre le CPE [466] », Révolution Internationale 369 (juin 2006).
5 « Alain Krivine contribua à écrire les plus grandes heures du trotskisme français », Marianne (17 mars 2022).
Personnages:
- Krivine [467]
Courants politiques:
- Trotskysme [468]
Rubrique:
Élections en France: Seule la lutte de classe peut "changer le monde"
- 115 lectures
Après le deuxième tour de l’élection présidentielle, marquant la victoire sans grande surprise d’Emmanuel Macron face à sa concurrente Marine Le Pen, les bourgeoisies française et européenne ont pu pousser un véritable « ouf » de soulagement. Le nouveau président et la nation française resteront bel et bien ancrés dans la vie politique de l’UE. Une fois encore, le courant populiste du Rassemblement national (RN) aura été écarté du pouvoir malgré son inexorable progression. (1)
Les effets de la décomposition sur le cirque électoral
Dans un contexte de turbulences de plus en plus fortes avec la guerre en Ukraine couplée aux effets de la pandémie et d’une crise économique marquée par l’inflation, il était impératif pour la bourgeoisie française, comme en 2017, d’écarter la fraction du RN de Marine Le Pen dont les ambiguïtés, l’inconsistance et les flous politiques vis-à-vis de l’UE risquaient d’affaiblir considérablement la France face à ses rivaux, notamment les États-Unis. Le danger était également de distendre fortement, voir de remettre en cause le difficile équilibre entretenu depuis des décennies pour maintenir à flots les liens fragiles du « couple franco-allemand ». Cela, sans compter le séisme, les incertitudes et le désordre politique intérieur qu’une telle victoire aurait pu générer au sein de l’Hexagone.
La victoire de Macron par 58,5 % des voix, alors qu’il n’est pas parvenu à construire un véritable parti depuis 2017, est donc, en ce sens, une réussite de la bourgeoisie française. Cette dernière a ainsi mis à la tête de l’État une fraction lucide pour la gestion du capital national et elle a réussi, une fois encore, à faire « barrage » au populisme, évitant en même temps l’inconvénient d’une « cohabitation », c’est-à-dire le risque d’une confrontation et d’une dilution du pouvoir exécutif dans son expression politique bicéphale.
Il n’empêche que la réussite électorale laisse à la bourgeoisie un arrière-goût amer, tant les difficultés, les problèmes de fond et les fragilités politiques persistent. En effet, si on comptabilise le nombre de voix du président Macron par rapport aux 47 millions d’inscrits, ce dernier n’obtient que 38 % de ce total et Marine Le Pen 27 %, c’est-à-dire moins, pour cette dernière, que le total des abstentions, des votes blancs ou nuls ! L’abstention à 28 % est la plus importante de toutes les élections présidentielles, depuis 1969, alors boycottée par un PCF qui réunissait plus de 21 % des suffrages. En comptant les non-inscrits sur les listes électorales, l’abstention représente en réalité 35 % de la population en âge de voter. Malgré son « succès » et sa « légitimité », Emmanuel Macron est cette fois le Président « le plus mal élu » de la Ve République. La grande colère qui persiste dans la population fait de lui une personnalité largement détestée, particulièrement dans les milieux ouvriers.
De plus, il hérite d’une situation difficile et très instable qu’il a lui-même favorisé dès son premier mandat, siphonnant et pulvérisant les grands partis de gouvernement traditionnels, à droite comme à gauche (Les Républicains et le Parti socialiste), laminés bien avant le premier tour, désormais menacés de disparition. Ces derniers sont incapables de se relever au moins pour les cinq années à venir. De plus, le parti écologiste, Europe-Écologie-Les-Verts (EELV), qui avait vocation, par ses thématiques, d’attirer une partie de la jeunesse et de tenter de prendre le relais de la social-démocratie moribonde, a été sanctionné lui-même par un fiasco. Le parti de Macron, LREM, reste quant à lui sans assise solide, notamment du fait de son incapacité à s’implanter réellement dans au niveau local et de la consistance en son sein de fractions rivales issues des partis traditionnels. Si bon nombre de personnalités politiques s’y sont ralliées progressivement en « allant à la soupe », les courants, groupes ou partis très divers qui le composent sont truffés d’opportunistes dont l’ex « socialiste » Manuel Valls est un des représentants les plus caricaturaux. Dans cette structure minée par des ambitions contraires, chacun cherche à gagner en influence et à placer un nombre conséquent de députés pour les prochaines législatives. Macron a d’ailleurs échoué pour l’instant à fusionner l’ensemble de ces formations qui le soutiennent et se heurte déjà en plus de cela à la formation Horizons de son ancien premier ministre, Édouard Philippe, devenu un rival. Ainsi, même si ces groupes tireront probablement leur épingle du jeu lors des prochaines élections législatives de juin du fait de la dynamique présidentielle, rien ne sera facile tant les divisions sont présentes, au risque d’imposer la nécessité d’une coalition forcée et fragilisée. Cela, d’autant plus que les difficultés liées au contexte international, à la crise économique, à la situation sociale et aux attaques que devra prendre le nouveau gouvernement ne feront qu’exacerber les forces centrifuges tout au long du mandat qui débute.
Aujourd’hui, la victoire de Macron se fait malgré une montée en puissance de l’instabilité sociale et du chaos. Le président n’a pas hésité à exploiter les thèmes idéologiques de l’extrême-droite, par pur opportunisme et utilitarisme, comme ce fut le cas, par exemple, lors des discours sécuritaires de certains de ses ministres, de Castaner à Darmanin, jouant ensuite avec le feu en se réjouissant un peu trop hâtivement de la montée en puissance d’un Zemmour propulsé par les médias. (2) Tous les discours les plus réactionnaires et nauséabonds de la « macronie » se sont accompagnés d’une politique qui n’a cessée de diviser, accentuant fortement la fameuse « fracture sociale » et la pauvreté.
Dans ce cadre, l’autre victoire de la bourgeoisie au premier tour reste le score de l’Union Populaire de Mélenchon, une formation de gauche présentée comme une nouvelle alternative au pouvoir de centre-droit de Macron, en mesure d’encadrer idéologiquement la classe ouvrière. Même si ce parti politique n’a, pour l’instant, pas vocation à assurer une « alternance gouvernementale » comme ses prédécesseurs du passé, il n’en reste pas moins une force de mystification efficace au service de la bourgeoisie, comme le montre son appel à la remobilisation massive de l’électorat de gauche aux législatives en mettant en avant l’expression d’un sentiment de « frustration ».Cela, même si la logique annoncée de son « troisième tour social » et sa volonté de « revanche » compliqueront probablement la donne de la future majorité élue au parlement. (3)
Une offensive idéologique anti-ouvrière pour les législatives
Face au désintérêt croissant vis-à-vis des élections, notamment du fait de la méfiance et de la colère accumulées depuis des décennies, celle d’avoir eu de nouveau à choisir « entre la peste et le choléra », une nouvelle offensive idéologique tente de mobiliser encore le plus massivement possible les électeurs pour les prochaines législatives, en particulier ceux de la classe ouvrière qu’on cherche à rabattre à tout prix vers les urnes. Cela, pour les isoler et attaquer davantage leur conscience afin de les désarmer. (4) Tous les camps politiques de la bourgeoisie s’animent donc avec frénésie, d’autant que pour bon nombre la question de leur survie politique se pose très nettement. Les premiers bains de foules et les voyages de Macron, qui « mouille la chemise » dans les quartiers populaires pour « convaincre », montrent que le nouveau président ne lâchera rien de son offensive jusqu’au mois de juin. Les Républicains, en miette, toujours sous l’effet d’une panique liée à la défaite et aux menaces de nouvelles désertions, tentent désespérément de mobiliser à la faveur de leur « ancrage local », jouant d’un pâle marketing politique de « proximité », relançant les thèmes en vogue, ceux du « pouvoir d’achat », de la « sécurité », etc., tout en restant tétanisés par leur manque d’inspiration et la fuite des cadres. Le RN, quant à lui, fort de ses 41 %, laisse entendre mensongèrement qu’il peut « limiter la casse sociale » de Macron en cherchant à devenir la « première opposition » au futur gouvernement tout en s’attachant à vouloir « dégonfler » le phénomène Zemmour.
Naturellement, les plus dangereux bonimenteurs restent sans conteste les forces de gauche, cette fois autour de La France Insoumise et son Union Populaire, même si en marge les gauchistes ne sont pas en reste. Quelles que soient les tractations politiciennes en coulisses, entre EELV, le PS, le Parti communiste, le Nouveau parti anticapitaliste (NPA) et LFI en position de force, il faut bien distinguer l’illusoire « contrepoids » qu’une telle formation politique offrirait face à Macron. Il s’agit en réalité de faire croire qu’ « un autre monde est possible » sous le règne du capitalisme et de désarmer le prolétariat vers le piège mystificateur des urnes et de la démocratie bourgeoise. LFI après avoir conspué un PS « traître à la gauche », vient d’ailleurs subitement de constater que ce parti, à l’origine des pires attaques contre la classe ouvrière, avait « changé ».
Bien entendu, pour ceux qui ne se contentent pas d’emblée de cette supercherie, il est nécessaire d’adopter, en complémentarité, un ton plus radical. C’est, par exemple, le cas de Lutte ouvrière (LO) qui n’a pas donné de consigne de vote entre les deux tours, mais qui, par la voix de sa candidate Nathalie Arthaud, appelle les ouvriers à « ne pas se démobiliser en vue des élections législatives ». Dans une lettre adressée au NPA datée du 28 avril, voici ce que cette organisation répond au sujet des discussions menées avec l’Union Populaire : « En ce qui nous concerne, nous restons sur notre ligne politique et plutôt que de cautionner une opération de rafistolage du réformisme, nous annoncerons, dans les prochains jours, notre présence aux législatives dans toutes les circonscriptions de la métropole, pour défendre le “camp des travailleurs” ». Un comble ! Une défense, comme toujours, qui consiste à rabattre sans relâche vers les urnes et à canaliser la colère vers les institutions bourgeoises. Toute cette triste tambouille bourgeoise, au-delà des pseudo-débats mystificateurs, ne sert en réalité qu’à berner les ouvriers et à leur cacher qu’en réalité les tractations en cours ne recouvrent que de sordides intérêts de cliques, masquent les véritables rapports de forces faits d’une concurrence propre à la classe bourgeoise, dont seuls les intérêts comptent sur l’échiquier politique. Tous ces politicards n’ont de conviction que celle qui sert la défense de leur propre place et de leurs intérêts, de leur propre influence quand ce n’est pas purement et simplement leur sinistre trajectoire carriériste. Les transfuges de dernières minutes, les ralliements ou les oppositions n’obéissent qu’à des logiques totalement étrangères à la classe ouvrière.
L’élection présidentielle a été une nouvelle fois l’occasion pour la bourgeoisie d’attaquer la conscience du prolétariat en utilisant les résultats pour accentuer encore plus les divisions. Ainsi, toute une campagne idéologique jette la méfiance sur la classe ouvrière dont certaines parties (comme notamment dans les anciens centres industriels aujourd’hui en proie au chômage) sont accusées d’être gagnées par l’idéologie d’extrême droite. Le saucissonnage des résultats des votes par catégories sociologiques : celle des employés, des ouvriers, des professions intermédiaires, les vieux, les jeunes, ou ceux dont les revenus par mois sont corrélés à telle ou telle manière de voter, permet est également une tentative volontaire de semer l’opposition et la division au sein de la classe ouvrière, diffusant par là le poison de la méfiance en son propre sein. Bien entendu, si ces « analyses » comportent factuellement une part de vérité, l’optique reste toujours de discréditer à l’avance toute possibilité d’unité et de riposte ouvrière.
Ce faisant, cette offensive prolongée par la bataille des législatives a pour objet d’entraver au maximum toute forme de réflexion, de diluer, d’isoler les prolétaires afin de les rendre impuissants face aux réformes envisagées dont l’objet est de poursuivre les attaques après l’intermède en trompe l’œil du « quoi qu’il en coûte ».
Il n’y a pas d’illusions à se faire, les élections ne sont pas un terrain pour l’expression des revendications ou de la lutte de la classe ouvrière. Face aux mystifications électoralistes, aux attaques qui se profilent de nouveau contre nos retraites, contre l’école, contre la santé… face à la paupérisation présente et à venir, le prolétariat se doit de rester sourd aux appels à voter de la bourgeoisie pour les législatives, en particulier de la part de ses faux amis que sont les partis de gauche et gauchistes, ceux qui cherchent à l’arrimer aux institutions d’un système barbare, d’un capitalisme aux abois qui sème toujours plus la destruction et la mort. Mais la classe ouvrière ne pourra se contenter de simplement bouder les urnes. Elle devra prendre confiance en ses propres forces et devra reprendre le chemin difficile de la lutte. La lutte de classe représente un avenir ; elle seule doit pouvoir guider à nouveau notre futur.
WH, 29 avril 2022
1 Le Pen avait obtenu 17,9 % des voix en 2012 sans accéder au second tour ; 34,3 % en 2017 ; 41,5 % en 2022.
2 Lire notre article : « Phénomène Zemmour, Une sinistre marionnette au service du jeu électoral [469] », Révolution internationale n° 491 (novembre décembre 2021).
3 Lire notre article : « La France Insoumise, encore et toujours au service du capitalisme [453] », disponible sur le site internet du CCI.
4 Lire notre article : « Non au bulletin de vote, oui à la lutte de classe [470] », disponible sur le site internet du CCI.
Personnages:
Récent et en cours:
- Election présidentielle [448]
- LREM [471]
- RN [472]
- LFI [473]
Rubrique:
Kinder, Buitoni, Lactalis… Derrière les scandales, c’est le capitalisme qui tue!
- 68 lectures
Il ne se passe plus une semaine sans qu’un scandale alimentaire éclate dans le monde ! Le phénomène n’est malheureusement pas nouveau : la crise de la « vache folle » dans les années 1990, le scandale du lait frelaté en 2008 (en Chine), la crise du concombre en 2011 (en Europe), la fraude à la viande de cheval de 2013 (en Europe), les œufs contaminés en 2017 (en Europe et en Asie), la contamination du lait infantile dans une usine Lactalis en 2017 (en France)… Cette liste est loin d’être exhaustive et ne rend compte que de quelques affaires médiatisées. Il suffit de se promener dans les rayons d’un supermarché pour constater que les « rappels de produits » sont presque quotidiens. Mais c’est désormais au tour des pizzas Buitoni et des œufs Kinder de faire la Une de l’actualité. Comme après chaque scandale, la bourgeoisie pointe du doigt les patrons véreux de l’industrie agroalimentaire, dénonce l’hygiène déplorable sur les lignes de production et promet davantage de contrôles. Et comme après chaque scandale, il ne faudra pas plus de quelques semaines avant qu’une nouvelle affaire éclate ! Car la vérité, c’est que les États censés « protéger les consommateurs » n’ont cessés, dans leur course frénétique aux coupes budgétaires, de réduire à peau de chagrin les effectifs d’inspection ; les industriels, quant à eux, n’ont cessé de rogner sur les procédures de contrôle pour préserver leurs marges face la concurrence. C’est donc toute la logique du capitalisme qui se trouve à l’origine de ces scandales et des victimes qu’ils occasionnent, bien souvent des ouvriers et leurs enfants. Parce que le capitalisme n’a plus aucune perspective à offrir qu’un enfoncement sans fin dans la crise et dans la concurrence chaque jour plus acharnée et meurtrière, les scandales alimentaires ne vont cesser de s’accroître, à l’image des catastrophes industrielles ou environnementales.
C’est la raison pour laquelle nous invitons nos lecteurs à lire deux « classiques » du mouvement ouvrier qui identifiaient très clairement les froids rouages du capitalisme derrière des scandales liés, en apparence, à la « fatalité » :
– Un extrait de La situation de la classe laborieuse en Angleterre [474], de Friedrich Engels (1845).
– Un article de Rosa Luxemburg du 1er janvier 1912 : Dans l’asile de nuit [475].
Récent et en cours:
- Scandales alimentaires [476]
Rubrique:
Réunion publique en ligne: Conflit impérialiste en Ukraine et les responsabilités des révolutionnaires
- 118 lectures
Face à la guerre en Ukraine, le CCI s'appuie sur les contributions historiques de la gauche communiste pour défendre une position internationaliste. En pratique, cela signifie :
- Aucun soutien à un quelconque camp dans les conflits impérialistes.
- Opposition au pacifisme
- Seule la classe ouvrière est une force de transformation sociale, qui aboutit au renversement révolutionnaire du capitalisme.
- dans les luttes et les réflexions de la classe ouvrière, les organisations révolutionnaires ont un rôle essentiel à jouer dans le développement de la conscience de classe
- la lutte contre la guerre impérialiste exige la coopération et la solidarité des authentiques internationalistes.
Venez à la réunion publique en ligne organisée le vendredi 20 mai 2022 à 21h00 par la section du CCI en France pour discuter des questions soulevées par la guerre en Ukraine et des tâches des révolutionnaires.
Tout ceux qui souhaitent participer à cette réunion publique en ligne peuvent adresser un message sur notre adresse électronique ([email protected] [213]) ou dans la rubrique “contact” de notre site internet.
Vie du CCI:
- Réunions publiques [219]
Rubrique:
ICCOnline - mai 2022
- 38 lectures
Fusillade d’Uvalde: Une nouvelle illustration de l’agonie barbare de la société capitaliste!
- 76 lectures
Six jours après l’attentat raciste de Buffalo, l’horreur s’est à nouveau abattue aux États-Unis, cette fois sur une école primaire, celle d’Uvalde au Texas, lors d’une tuerie qui a emporté la vie de 19 enfants et deux de leurs enseignants. Ce massacre sans mobile visant des petits gamins sans défense ne peut que glacer le sang. On n’ose imaginer la dévastation des familles et les traumatismes que devront porter, toute leur vie durant, les survivants.
Salvador Ramos, l’auteur de la tuerie, était un jeune de 18 ans, timide et issu d’une famille pauvre, souvent moqué parce qu’il était « différent » et un peu « étrange ». Comme beaucoup d’adolescents mal dans leur peau, il a commencé à s’entailler les bras et le visage, puis s’est peu à peu isolé en multipliant les longues périodes d’absence à l’école. Salvador Ramos avait certainement une fragilité particulière qui l’a conduit à développer un goût morbide pour les armes à feu avant de commettre cet acte effroyable, mais il a le parcours typique d’une masse croissante de jeunes sans perspective qui se sent tellement écrasée, rejetée et incomprise qu’elle se jette de plus en plus nombreuse dans un processus mortifère d’auto-destruction. Face à la souffrance que représente pour eux l’existence, face à l’absence totale d’espoir d’une vie meilleure, nombreux sont les jeunes à se donner la mort. Salvador Ramos, lui, a sombré, comme d’autres jeunes gens ivres d’une vengeance nihiliste, dans ce que la société capitaliste a de plus barbare : il a voulu quitter ce monde en emportant avec lui des gosses de 10 ans, l’incarnation du futur de l’humanité qui ne pouvait plus exister à ses yeux.
Ce nouveau massacre n’est pas seulement le fait d’un « monstre » qu’il suffirait d’éradiquer pour combattre le « mal dans notre société » (dixit Trump). En réalité, le « mal dans notre société », c’est le système capitaliste tout entier, un système sans avenir qui se décompose en entraînant l’humanité dans son sillage meurtrier. Les tueries de masse et les attaques terroristes s’enchaînent depuis des années aux États-Unis et ailleurs dans le monde à un rythme toujours plus effrayant. Le mois dernier, une fusillade éclatait dans une école maternelle de la région d’Oulianovsk, en Russie (trois morts). Quelques jours plus tard, un attentat visant une école de filles à Kaboul emportait une cinquantaine d’étudiantes. En janvier, un tireur abattait une personne et causait trois blessés à l’université d’Heidelberg, en Allemagne, avant de se donner lui-même la mort…
Ces trente dernières années, les tueries dans les établissements scolaires se sont multipliées. Mais plus qu’ailleurs, les États-Unis, où plus de 4 000 enfants ont succombé sous les coups d’une arme à feu pendant la seule année 2020 (!), sont particulièrement touchés par ce phénomène. Il y a, bien sûr, au cœur de ce cauchemar, la prolifération délirante des armes à feu. Comment ne pas être consterné de voir un jeune de 18 ans, souffrant de graves troubles psychiques, être tranquillement en mesure de s’acheter deux fusils d’assaut ? Il existe dans ce pays une gigantesque industrie de l’armement qui fait aussi son beurre en écoulant des millions de flingues dans la population sans se préoccuper de la vie des centaines de milliers de victimes !
Ce lucratif business surfe allègrement sur des idéologies parfaitement irrationnelles qui s’épanouissent sur le terreau fertile de la décomposition généralisée du capitalisme [10]. (1) L’accélération récente de ce processus (2) s’est en partie caractérisée par l’explosion des « théories du complot » et une forte paranoïa sociale. Pendant la pandémie de Covid-19 les ventes d’armes ont ainsi explosé, tantôt au nom de « la protection des citoyens face à l’ingérence de l’État », tantôt pour « protéger l’Amérique du grand remplacement ». C’est dans ce contexte que Salvador Ramos est passé à l’acte et qu’un suprémaciste blanc a pu tirer sur la foule d’un magasin de Buffalo.
Bien sûr, face à l’horreur, les huiles du Parti républicain ont encore fait l’étalage d’un cynisme sans limite et d’une bêtise crasse qui ne semble même plus s’embarrasser de la logique la plus élémentaire. Il est donc revenu aux politiciens démocrates la lourde tâche de dissimuler la responsabilité du capitalisme pourrissant dans ce massacre : « Quand pour l’amour de Dieu allons-nous affronter le lobby des armes ? » s’est écrié le président Biden. Messieurs Clinton, Obama et Biden, cette bande d’hypocrites sans scrupule qui n’a jamais hésité à débloquer des milliards de dollars pour exporter des armes ou armer jusqu’aux dents ses forces de répression, avaient pourtant tout loisir « d’affronter le lobby des armes » pendant leurs nombreux mandats. Qu’ont-ils fait à part verser une larme faussement compatissante à chaque nouvelle fusillade ? Rien ! Ils ont gesticulé parce que la fabrication d’armes est un secteur stratégique extraordinairement prospère en Amérique ! Mais surtout, derrière la prétendue solution miracle du contrôle des armes à feu, (3) la bourgeoisie cherche à dissimuler les origines du « mal dans notre société ».
Salvador Ramos est mort, le corps criblé de balles, mais les causes de sa trajectoire de meurtrier ne sont pas prêtes de disparaître. Avec l’aggravation de la crise du capitalisme, avec la croissance inéluctable de la misère, de la précarité, de la violence sociale et de l’exclusion, le désespoir et la haine ont encore de beaux jours devant eux. Le seul contrepoison à cette dérive barbare réside dans le développement massif et conscient des luttes du prolétariat qui offrira aux jeunes une véritable identité, l’identité de classe, et une véritable solidarité, celle qui se forge dans la lutte contre l’exploitation. C’est dans ces luttes que les exploités de tous les pays pourront peu à peu comprendre et défendre la seule perspective qui puisse sauver l’humanité de la barbarie : le renversement du capitalisme par la révolution mondiale !
EG, 29 mai 2022
1 Cf. « La décomposition, phase ultime de la décadence capitaliste [10] », Revue internationale n° 107 (4e trimestre 2001). Alors que le prolétariat n’a pas encore trouvé la force de renverser le capitalisme en affirmant ouvertement sa perspective révolutionnaire, la bourgeoisie est aujourd’hui incapable de mobiliser les différentes composantes de la société autour de la seule « réponse » qu’elle puisse apporter à la crise historique de son système : la guerre mondiale. La société est ainsi plongée dans une impasse momentanée, une sorte de « blocage » depuis la fin des années 1980, marqué par l’absence de toute perspective immédiate.
Cette phase de décomposition se caractérise par un pourrissement de l’ensemble des rapports sociaux à tous les niveaux, encore plus évident sur le plan idéologique avec le développement sans précédent du terrorisme, de la criminalité, le raz-de-marée de la drogue, de la violence décomplexée, la profusion de sectes, le regain de l’esprit religieux et d’idéologies totalement irrationnelles, de la violence et du désespoir… Il n’est, à ce titre, pas du tout hasardeux que le nombre de fusillades dans les établissements scolaires ait explosé ces trente dernières années.
2 Accélération que le CCI a identifié dès le surgissement de la pandémie mondiale de Covid-19 et qui s’est largement confirmée et aggravée avec la guerre en Ukraine.
3 En Asie, où les armes sont plus strictement contrôlées, les attaques se font le plus souvent au couteau. En Chine, par exemple, le jour même du massacre de Newtown, en 2013, un homme a blessé avec un couteau 22 enfants dans une école.
Géographique:
- Etats-Unis [184]
Personnages:
- Biden [395]
Récent et en cours:
Rubrique:
ICCOnline - juin 2022
- 42 lectures
La guerre et la capacité de réaction du prolétariat dans la situation actuelle
- 199 lectures
La guerre en Ukraine, qui manifeste et aiguise la propagation du chaos aux portes de l'Europe, est une étape importante dans l'accélération de la barbarie à laquelle nous conduit le système capitaliste. En effet, nous assistons à la convergence explosive des contradictions du capitalisme sous forme de désastre écologique, de résurgence des pandémies, d'inflation imparable, de guerres de plus en plus irrationnelles, d'exodes migratoires, de chacun pour soi, de déstabilisation et d'alliances de plus en plus circonstancielles, de dislocation et de fragmentation sociales, etc. où chaque tentative capitaliste de maintenir l'ordre est un pas vers le désordre. Ainsi, l'autodestruction du capitalisme est le contraire de sa destruction révolutionnaire par le prolétariat.
Pour orienter la manière dont nous devons préparer dès à présent la réponse que la classe sera en mesure de développer, et lui donner une perspective, nous devons faire l'effort de comprendre la situation. Il y a deux questions que nous devons résoudre :
- Le prolétariat peut-il apporter une réponse immédiate à la guerre ? La guerre impérialiste est-elle le terrain favorable à la maturation du combat du prolétariat ? Le slogan de la transformation de la guerre impérialiste en guerre de classe est-il valable aujourd'hui ?
- Le prolétariat de tous les pays est-il dans la même position pour initier, soutenir ou supporter le poids fondamental de cette réponse ?
Pour connaître les lieux et horaires de ces réunions publiques voir la rubrique "Agenda [479]".
Géographique:
- Europe [24]
Rubrique:
Incidents au stade de France: L’État bourgeois est le véritable hooligan
- 93 lectures
Quand, en ce 28 mai, les familles de supporteurs madrilènes et liverpuldiens se préparaient à passer 90 minutes de « parenthèses enchantées », elles pouvaient peut-être s’attendre à rencontrer quelques hooligans. Elles étaient pourtant loin d’imaginer que les véritables brutes auxquelles elles feraient face allaient être ces « hommes en bleu » supposément chargés de la protection de l’événement. Ce fut, en effet, une journée de terreur pour les victimes de l’État bourgeois. Les mensonges impudiques du premier flic de France, Gérald Darmanin, et de son sous-fifre Didier Lallement, tristement célèbre pour la politique ultra-répressive instituée lors du mouvement des « gilets jaunes », et régulièrement utilisée contre le prolétariat à chaque manifestation, ne peuvent dissimuler la vérité des faits. Les témoignages abondent de cette violence aveugle des forces de répression bourgeoises, avec matraquages et gazages de personnes innocentes, parfois de jeunes enfants, accompagnés pour les moins chanceux, de croche-pattes et de tabassage à terre. Et, comme par hasard, toutes les vidéos à proximité du stade ont été prématurément effacées ! Oui, il est probable que ces supporteurs se souviendront de cette journée mémorable où, pour parfois 690 euros, ils purent bénéficier d’un passage à tabac en règle de la part de l’État français.
Manque de moyen et terreur d’État : le cocktail de la décomposition capitaliste
Tout le monde, en France et à l’étranger a pu constater l’incapacité de l’État français, septième puissance mondiale, à organiser un simple événement sportif. Cette incurie ne s’explique pas seulement par une simple sous-estimation des organisateurs, elle découle avant tout d’une véritable déstructuration des services. Très vite, les enquêtes ont révélé qu’une des principales raisons du chaos était le trop faible nombre de stadiers par rapport au nombre de supporteurs attendus. (1) Le mensonge, vite levé, des « trente à quarante milles faux billets » utilisé par Darmanin visait justement à masquer cette réalité. A savoir que face au manque de moyens et au désordre que cela peut provoquer, l’État n’a plus qu’une seule solution à sa disposition : la violence brutale et aveugle.
Cet exemple, loin d’être exceptionnel, illustre bien l’impasse dans laquelle le capitalisme s’enfonce. Cela fait plus d’un siècle qu’il a perdu tout caractère progressiste, comme l’affirmait le Manifeste de l’Internationale communiste à son congrès fondateur de 1919. Pire encore, il est entré depuis ces dernières décennies dans sa phase ultime de décomposition. (2) Le fait qu’une des principales puissances du capitalisme comme la France, avec tous les moyens potentiels à sa disposition, soit incapable d’organiser un événement sportif, devenant ainsi la risée de la presse mondiale, illustre à la perfection une certaine perte de contrôle de la bourgeoisie sur son appareil étatique.
La répression policière : une répétition générale en prévision de la lutte de classe
Les arguments de Darmanin sur la fraude ou la gestion des hooligans servent en réalité à la bourgeoisie française, un peu dépassée par l’événement, de justification de la violence de l’État face aux « menaces à l’ordre public ». Derrière cette appellation volontairement floue se dissimule la préparation du terrain pour la répression de la classe ouvrière. Ce que souhaitent le gouvernement et la préfecture de police, de manière moins fébrile, c’est à la fois envoyer un message clair à tous les opposants potentiels à la politique de la bourgeoisie et en même temps préparer la police et ses méthodes de répression en prévision de la reprise de la lutte de classe face à la crise économique.
Dans le théâtre de la politique française, le rôle du « bon flic » est déjà joué par la gauche du capital, au premier rang desquels la gauche radicale de Mélenchon et du PCF, et sur son flanc gauche, par les trotskistes, les anarchistes officiels et les syndicats. Pour les premiers, c’est l’argument de la « police de proximité », supposée, par la magie même du changement de nom, être au « service des citoyens », censée ne réprimer seulement que la « délinquance ». Ce qu’ils omettent volontairement de préciser, c’est que les ouvriers qui refuseront l’ordre établi en luttant contre le capitalisme, parce qu’ils sont déjà criminalisés pour cela, seront traités comme des « délinquants », voire des « terroristes » ! L’histoire des luttes ouvrières abonde d’exemples en ce sens.
Quant aux seconds, alors que les trotskystes « purs » de LO plagient le programme mélenchonniste, ceux du NPA proposent par exemple de « désarmer la police ». Les prolétaires peuvent désormais être rassurés par la niaiserie de cet angélisme trompeur, ils pourront continuer d’être déférés devant les tribunaux, tabassés par la police et parqués dans les prisons surpeuplées, mais ils pourront, soi-disant, échapper à l’éborgnement et aux mains arrachées ! C’est sur une question comme la nature de la police que l’appartenance de la gauche et l’extrême gauche du capital à la bourgeoisie est des plus évidente.
La démocratie bourgeoise et l’État totalitaire : deux faces d’une même pièce
Dans un État de droit, comme l’est la France, les « violences policières » sont présentées comme une « exception », un « dérapage » commis par quelques moutons noirs. En réalité, la violence d’État est au cœur de toutes sociétés de classes. Elle contribue à empêcher ce système décadent de s’écrouler en maintenant par la force les conditions d’une exploitation forcenée. Pour le prolétariat, l’opposition démocratie/dictature perd toute raison d’être : la démocratie aussi est totalitaire dans la mesure où elle réagit avec les moyens les plus perfectionnés de la violence d’État pour empêcher toute remise en question de ce système et toute alternative. Cet incident apparaît bien dans les médias bourgeois comme un simple dérapage, une anomalie. La répression violente est en réalité la réponse normale de l’État démocratique.
Pache, 15 juin 2022
1« Incidents au Stade de France : le déni des pouvoirs publics malgré une organisation défaillante », Le Monde (30 mai 2022).
2Sur la décomposition, voir, « Thèses sur la décomposition », Revue internationale n°107 (4e trimestre 2001).
Situations territoriales:
Personnages:
Récent et en cours:
- Police [482]
- Stade de France [483]
Rubrique:
ICCOnline - juillet 2022
- 42 lectures
Sommet de l'OTAN à Madrid : un sommet de guerre pour la guerre
- 121 lectures
"L'Europe se militarise et annonce le plus grand déploiement de troupes depuis la guerre froide", "La guerre de la Russie contre l'Ukraine a brisé la paix et sérieusement altéré notre environnement de sécurité", tels sont les titres menaçants du sommet de Madrid. La Russie, mais aussi la Chine, sont ouvertement désignées comme des "ennemis de la démocratie". Le sommet de Madrid a été un exercice clairement belliciste. Et les mots sont assortis de décisions. Ils parlent de dépenser 200 milliards d'euros en armement, de déployer jusqu'à 300 000 soldats dans les pays d'Europe de l'Est, dans l'arc allant de la Baltique à la mer Noire. Ils menacent la Chine. Ils défient Poutine. C'est un sommet par et pour la guerre.
L'OTAN, un instrument de l'impérialisme américain
En 1949, dans le cadre de la confrontation impérialiste entre les États-Unis et le bloc russe, les États-Unis ont fondé l'OTAN (Organisation du traité de l'Atlantique Nord) comme un outil clé contre le bloc ennemi. Il s'agissait d'une alliance militaire et politique qui permettait aux États-Unis de contrôler leurs alliés dont les armées, les services secrets, les cellules de renseignement et les armements dépendaient de plus en plus des dispositifs, brevets, fournitures et protocoles américains. Toutes les bases militaires d'un pays allié peuvent être utilisées par l'OTAN, c'est-à-dire par les États-Unis.
Avec l'effondrement du bloc russe en 1989, les pays anciennement sous tutelle américaine ont tenté de se libérer de leur contrôle. Le bloc américain s'est désintégré et aujourd'hui il n'y a plus de blocs impérialistes. Toutefois, cela n'a pas débouché sur un "nouvel ordre mondial" de paix, de démocratie et de prospérité, comme l'avait promis le président américain de l'époque, Bush père. Au contraire, ce que nous avons vu ces 30 dernières années, c'est une multiplication de guerres de plus en plus chaotiques et sanglantes (Irak, Afghanistan, ex-Yougoslavie, Syrie, Libye, Yémen, etc.) qui, parmi de nombreux autres ravages, ont conduit au plus grand exode de réfugiés de l'histoire : 26 millions en 2017, 86 millions en 2020 et en mai 2022, la barre des 100 millions a été dépassée.[1]
Actuellement, la guerre en Ukraine et 52 autres conflits inondent la planète de sang. Comme nous le disions dans Militarisme et décomposition, écrit en 1990, "Dans la nouvelle période historique dans laquelle nous sommes entrés, et que les événements du Golfe ont confirmée, le monde apparaît comme un immense jeu de dupes dans lequel les alliances entre Etats n'auront pas la stabilité des blocs, mais seront dictées par les besoins du moment. Un monde de désordre meurtrier, dans lequel le "gendarme" américain va tenter de ramener un minimum d'ordre par l'utilisation de plus en plus massive de son potentiel militaire".[2]
Les États-Unis n'ont pas dissous l'OTAN, mais ont continué à l'utiliser comme un moyen de contrôler leurs anciens alliés. L'Allemagne, par exemple, compte 20 bases militaires américaines sur son territoire et son armée est étroitement dépendante des dispositifs et des équipements informatiques de l'OTAN.
En février 1990, James Baker, alors secrétaire d'État américain, a promis au président russe Gorbatchev que "si les États-Unis maintiennent leur présence en Allemagne dans le cadre de l'OTAN, pas un pouce de la juridiction militaire actuelle de l'OTAN ne sera étendu vers l'est".[3]
Entre capitalistes, et plus encore entre États, les accords les plus sacrés restent lettre morte au bout de quelques minutes. Les États-Unis ont fait le contraire de ce qu'ils avaient promis. À partir du milieu des années 1990, elle a étendu l'OTAN aux pays de l'ancienne orbite russe : Pologne, États baltes, République tchèque, Roumanie, Hongrie, etc.
Cet élargissement présentait un intérêt mutuel pour les deux parties. En intégrant les anciens "satellites" russes, les États-Unis creusent un fossé entre l'Allemagne et la Russie, les maintenant toutes deux sous pression politique et militaire. De leur côté, les anciens pays soviétiques ont gagné un puissant sponsor pour se défendre contre les ambitions impérialistes de leurs deux grands voisins et, protégés par le parapluie de l'OTAN, pour assouvir leurs propres appétits impérialistes.
L'OTAN et la guerre en Ukraine
Cette stratégie d'"élargissement vers l'Est" s'est heurtée aux intérêts de la Russie qui, après s'être remise fragilement de l'énorme débâcle de 1989, tente, grâce à la main de fer de Poutine, de jouer un rôle mondial sur l'échiquier impérialiste, en s'impliquant dans la guerre en Syrie et dans diverses guerres en Afrique, et en établissant des alliances avec le Venezuela, l'Iran, le Nicaragua, etc.
Dans cette politique de recherche de la gloire impérialiste perdue, elle s'est heurtée au rideau de fer imposé par les Etats-Unis sur son flanc ouest. En particulier, les tentatives d'intégrer l'Ukraine et la Géorgie à l'OTAN ont constitué une ligne rouge que la Russie ne pouvait tolérer et a répondu par des opérations militaires "spéciales" brutales.
En 2008, la Russie a tendu un piège à la Géorgie en l'entraînant dans une guerre et en imposant deux républiques "indépendantes" qui constituent un coin russe dans le territoire géorgien : l'Ossétie du Sud et l'Abkhazie.
En 2014, elle a réitéré l'opération vis-à-vis de l'Ukraine en occupant la Crimée et en proclamant deux républiques "populaires" dans le Donbass qui agissent comme un sous-traitant militaire du parrain russe.
L'explosion actuelle de la guerre barbare en Ukraine trouve ses racines dans cette lutte impérialiste entre la Russie et les États-Unis, même si, comme nous l'avons expliqué, ces derniers ont tendu un piège au Kremlin : pendant des mois, ils ont annoncé l'invasion de l'Ukraine tout en affirmant que les États-Unis n'interviendraient pas. Il s'agit d'une répétition du même piège que les États-Unis ont tendu à l'Irak en 1990 lorsqu'ils ont laissé entendre qu'ils avaient le feu vert pour envahir le Koweït. Poutine a mordu à l'hameçon et s'est jeté sur l'Ukraine.
Les États-Unis ont utilisé la guerre en Ukraine pour resserrer l'étau de l'OTAN sur ses anciens alliés. Ceux-ci, en particulier l'Allemagne et la France, veulent se débarrasser de cette alliance gênante qui les empêche de déployer leurs propres ambitions impérialistes. Macron a parlé d'une OTAN "en état de mort cérébrale". Il a dû ravaler ses paroles, du moins pour un temps, les États-Unis ont rétabli la force de l'OTAN et Biden a proclamé à Madrid que "Vladimir Poutine cherchait à finlandiser l'Europe". Ce qu'il va obtenir, c'est une "OTANisation de l'Europe".
Au sommet de Madrid, les États-Unis utiliseront pleinement le "soutien à l'Ukraine", la "défense du David ukrainien écrasé par le Goliath russe", pour ligoter les "alliés européens". Dans une nouvelle intervention sur Internet, Zelensky reproche une nouvelle fois à l'Allemagne et à la France leur prétexte de "ne pas humilier la Russie" pour échanger "la paix contre des territoires". Le sommet de l'OTAN réaffirme la politique américaine consistant à entraîner la Russie dans le bourbier sanglant d'une longue guerre qui s'enlise actuellement dans le Donbass avec un coût humain et productif énorme : selon Zelensky, entre 60 et 100 soldats ukrainiens meurent chaque jour, il ne dit rien des morts civils, tandis que la Russie perd 150 soldats chaque jour. L'une des conséquences les plus graves de cette guerre est qu'elle a paralysé le transport des céréales vers les pays d'Afrique et d'Asie, provoquant des famines qui, selon l'ONU, touchent 197 millions de personnes.
L'un des objectifs du sommet est que le contingent de troupes atlantistes déployé dans l'arc frontalier avec l'ours russe, de la mer Noire à la Baltique, passe de 40 000 soldats à 300 000 hommes ! Les États-Unis vont stationner 100 000 soldats, l'Allemagne a promis d'en déployer 20 000, la France en a installé 1 000 en Roumanie. Dans la même veine, l'OTAN ouvre une gigantesque base militaire en Pologne, les États-Unis envoient deux destroyers en Espagne et établissent un bouclier antimissile sur la base de Rota.
Si nous comparons le sommet de Madrid aux précédents sommets de l'OTAN, nous constatons une nette escalade du bellicisme : "La réponse des alliés à ce nouveau contexte sera de mobiliser plus de troupes, plus d'armes, plus de munitions sur leur flanc oriental, pour montrer leurs muscles contre Moscou". Le langage hypocrite de la paix a été laissé dans le tiroir pour les seuls chants de guerre. Renforçant l'atmosphère générale, l'adhésion de la Finlande et de la Suède à l'OTAN, pays historiquement déguisés en "neutres", jette encore plus d'huile sur le feu guerrier. Il ne fait aucun doute que toutes ces décisions, tant publiques que secrètes, s'inscrivent dans une dynamique de confrontation belliciste et contribueront à de nouvelles tensions impérialistes qui sont les germes de nouvelles guerres.
Profitant de la forte dynamique de la militarisation de l'Europe de l'Est, la Pologne et les pays baltes demandent constamment plus d'armes, plus de troupes, affichant sans vergogne leurs propres ambitions. "Le Premier ministre polonais Mateusz Morawiecki a annoncé lundi la construction de centaines de stands de tir publics à travers le pays et une nouvelle loi sur l'accès aux armes à feu pour "former la société" à la défense nationale. Il a déclaré que "si la Russie pense un jour à attaquer la Pologne, qu'elle sache que 40 millions de Polonais sont prêts à la défendre les armes à la main".[4]
Un autre point abordé par le sommet est la "modernisation technologique" des armes, des systèmes de défense, des moyens de cyber-guerre, etc. Cela implique des investissements énormes qui seront payés par les Etats membres et, surtout, augmentera la dépendance technologique vis-à-vis des Etats-Unis.
Dans ce contexte, le renouvellement du "concept stratégique" de l'OTAN renforce encore l'atmosphère belliciste qui a été imposée à Madrid et qui s'est traduite symboliquement par l'occupation policière de la ville par plus de 10 000 agents en uniforme. Pour la première fois dans l'histoire de l'OTAN, la Chine est directement pointée du doigt : le concept stratégique " annonce une nouvelle ère dans la sécurité transatlantique, marquée par les actions d'" acteurs autoritaires qui défient les intérêts, les valeurs et le mode de vie démocratiques ", ce qui conduit à la conclusion que la Chine " cherche à subvertir l'ordre international fondé sur des règles, y compris dans les domaines spatial, cybernétique et maritime ". Passant des paroles aux actes, l'Australie, la Nouvelle-Zélande, le Japon et la Corée du Sud, les rivaux de la Chine dans le Pacifique, ont été invités à Madrid. Le message ne pourrait être plus clair.
La principale menace pour le leadership impérialiste américain dans le monde vient de la Chine. Le géant asiatique a déployé une stratégie économico-impérialiste, la Route de la soie[5], pour défier la domination américaine. Le piège que les États-Unis ont tendu à la Russie vise en fin de compte la Chine. Pris dans une longue et pénible guerre en Ukraine, la Russie est devenue plus un fardeau qu'un atout pour la Chine. La Chine a été très réticente à soutenir son allié russe. D'autre part, la guerre ukrainienne déstabilise la route de la soie de la Chine, tant sur le plan économique que militaire.
La mise à l'index de la Chine dans le concept stratégique de l'OTAN constitue une nouvelle étape dans l'escalade des tensions guerrières dans le monde. Avec ce mouvement stratégique, les États-Unis développent une politique d'"encerclement de la Chine" : d'une part, dans le Pacifique, les États-Unis ont formé une alliance avec les rivaux de la Chine (Australie, Japon, Corée du Sud, Philippines, Vietnam) ; d'autre part, ils affaiblissent fortement l'allié russe de la Chine ; enfin, les projets d'expansion de la route de la soie sont déstabilisés par la guerre en Ukraine.
Mais tout aussi significative dans l'escalade impérialiste est l'inclusion du "flanc sud", c'est-à-dire l'Afrique, dans le "concept stratégique" de l'OTAN. Ici, l'Espagne mise gros car cela touche ses propres intérêts (Sahara, Maroc, défense des enclaves de Ceuta et Melilla, protection contre les vagues migratoires, etc.) Cependant, l'objectif ultime est avant tout de bloquer l'expansion russe et chinoise en Afrique. La Russie emploie ses mercenaires Wagner dans les différents conflits africains, tandis que la Chine tisse un réseau d'accords militaires et commerciaux. Elle a par exemple établi une base militaire à Djibouti.
La racine de la guerre est le capitalisme
Nous constatons que le sommet donne un coup de fouet à la confrontation guerrière qui saisit aujourd'hui le monde. Et dans cette confrontation, le rôle prépondérant des États-Unis et la force de leur bras politico-militaire, l'OTAN, sont renforcés.
Toutefois, ce succès est temporaire. Depuis l'effondrement du bloc russe, nous avons constaté que la capacité des États-Unis à imposer leur "ordre mondial" se détériore. Dans un monde où chaque État-nation "fait son chemin" sans respecter aucune discipline, où prolifèrent des conflits locaux de plus en plus destructeurs, où les ambitions impérialistes de tous les États se déchaînent en force, le gendarme américain n'a pour seul moyen d'arrêter le chaos que le militarisme, la guerre, la prolifération des armements. Cependant, ces démonstrations de force n'arrêtent pas le chaos, mais ne font que l'exacerber. "Dès que les États-Unis se vantent de leur supériorité militaire, tous leurs rivaux reculent, mais le recul est tactique et momentané. Plus les États-Unis s'efforcent d'affirmer leur domination impérialiste, en rappelant brutalement qui est le plus fort, plus les contestataires de l'ordre américain sont déterminés à le contester, car pour eux, leur capacité à conserver leur rang dans l'arène impérialiste est une question de vie ou de mort". [6]
Cette analyse est cruciale pour démonter le piège tendu par les groupes d'extrême gauche du capital et même les ministres du gouvernement liés à Podemos ou aux restes d'Izquierda Unida, qui imputent la tension guerrière à l'OTAN et se permettent même une position "neutre" : ni Poutine ni l'OTAN.
L'OTAN est un instrument de la confrontation impérialiste, mais elle n'est ni la cause des guerres ni de cette confrontation. Son renforcement et ses fanfaronnades militaristes n'apporteront pas la paix et la démocratie, comme le promettent les dirigeants atlantistes avec de moins en moins de conviction, mais ils ne sont pas non plus la seule cause de la guerre barbare qui ensanglante le monde. Tous les États, qu'ils soient pro-OTAN ou anti-OTAN, sont des agents de guerre, tous participent au glissement de la planète dans une spirale de conflits chaotiques.
Quand ils parlent de "pas d'OTAN, bases dehors", ces groupes de gauche servent la guerre et l'impérialisme. Ils veulent que nous fassions la guerre au nom de la défense nationale, en rejetant le "multinationalisme" de l'OTAN. En France, Mélenchon s'oppose à l'OTAN en proposant que la France "s'arme jusqu'aux dents comme une force de maintien de la paix". Dans cette conception ultra-militariste, il va jusqu'à proposer le rétablissement du service militaire !
Le prolétariat doit rejeter la guerre et le militarisme, qu'ils soient menés "à l'intérieur de l'OTAN" ou déployés "à l'extérieur de l'OTAN". Ces bellicistes d'extrême gauche qui "s'opposent à l'OTAN" injectent le poison de la défense de la patrie, poison avec lequel ils veulent que nous tuions et assassinions pour défendre l'Espagne et que nous acceptions l'inflation, les licenciements, les coups portés à nos conditions de vie pour "pouvoir envoyer des armes en Ukraine". Un groupe trotskyste appelant au "désarmement de l'OTAN" propose que "les travailleurs européens fassent preuve de la plus large solidarité internationaliste, en envoyant des fournitures et des milices ouvrières internationales, comme dans les années 30 lors de la guerre civile espagnole"[7]. Avec des arguments "anti-OTAN", ces serviteurs du capital proposent ce que les États-Unis et l'OTAN veulent : que les travailleurs s'impliquent dans le massacre impérialiste en Ukraine, que nous nous sacrifions sur le front économique et devenions de la chair à canon sur le front militaire.
Opero et Smolny 30-06-22
[7] ¡Fuera el pacto entre la OTAN y su gendarme Putin para repartirse Ucrania! (Democracia Obrera)
Evènements historiques:
- Guerre en Ukraine [489]
Récent et en cours:
- Guerre en Ukraine [397]
Questions théoriques:
- Impérialisme [45]
Rubrique:
Multiplications des incendies dans le monde: Le capitalisme brûle la planète!
- 98 lectures
De la Slovénie en passant par la République tchèque, la Turquie, le Portugal, la Grèce, l’Italie, la France, l’Espagne, l'Allemagne, les Canaries, des centaines de milliers d’hectares de forêts et d’habitations sont aujourd’hui réduits en cendres avec toutes les conséquences écologiques et humaines que l’on peut imaginer. Même le Royaume-Uni a vu le feu ravager des milliers d’hectares dans la région de Londres. Dernièrement, la Californie s’est embrasée. Le parc du Yosemite et ses séquoias légendaires sont menacés par un incendie géant ayant cramé plus de 7 000 hectares. Au Maghreb, au Tchad, les incendies se multiplient aussi… Bref, le monde est en feu ! Si 350 millions d’hectares partent chaque année en fumée dans le monde, si déjà la forêt amazonienne, une grande part de l’Australie et de la Sibérie ont connu le ravage des flammes, nous atteignons de nouveaux records aujourd’hui !
Très clairement, ces incendies sont la conséquence directe du dérèglement climatique sur la totalité de la planète : les épisodes caniculaires de plus en plus fréquents et intensifs à l’image des pics de chaleurs historiques que connaît l’Europe cet été. En Inde et au Pakistan, les températures ont avoisiné ces dernières semaines les 50° C ! Un niveau de chaleur insoutenable pour la survie même de millions d’êtres humains qui tend d’ailleurs à devenir la norme, de l’avis d’une grande partie du monde scientifique. Dans le même temps, des inondations meurtrières frappent en Iran. La spirale infernale longtemps annoncée devient donc une réalité.
Si la bourgeoisie cherche à dissimuler la responsabilité du mode de production capitaliste face au dérèglement climatique en braquant l’attention sur les pyromanes, sur le comportement déplorable de tel ou tel milliardaire avec ses jets privés, des touristes, ou de telle ou telle entreprise, cette instrumentalisation est aussi le moyen de cacher son incurie et son incapacité totale à endiguer le phénomène tant elle est happée par la fuite en avant destructrice. À ce titre, les pseudos « accords historiques » des multiples conférences pour le climat ne sont ni plus ni moins que de la pure hypocrisie, de belles paroles n’accouchant que de « mesurettes » absolument pas à la hauteur des enjeux globaux pour la planète.
L’incapacité et les carences croissantes de tous les gouvernements et structures internationales pour faire face aux catastrophes et les prévenir, sont patentes : les services de secours, les stratégies d’anticipation sous le poids de décennies de coupes budgétaires, sont de plus en plus défaillantes et impuissantes. Les capacités technologiques, satellitaires de détection des foyers potentiels, de prévisions météorologiques, restent sans relais, faute de budgets et de moyens financiers. Les flottes d’avions bombardiers d’eau (quelques dizaines d’avions et hélicoptères seulement en France, par exemple), susceptibles de réagir au plus vite et contrer efficacement ces feux dévastateurs sont renforcées au compte-gouttes, faute de moyens. Elles sont bien évidemment loin d’égaler les flottes aériennes militaires de toutes les armées qui, elles, se dotent tous les jours davantage de chasseurs et autres bombardiers capables de faire pleuvoir le feu sur l’ « ennemi » potentiel, le concurrent impérialiste.
Face aux incendies, les pompiers sont présentés aujourd’hui comme les héros de cette « guerre du feu », les combattants prêts à « sacrifier leur vie », tout comme les soignants étaient applaudis précédemment comme des « héros de la nation » en luttant contre la pandémie. Pourtant, tous font les frais, partout dans le monde, d’attaques et de la détérioration de leurs conditions de travail et de vie : « de plus en plus de missions, avec de moins en moins de moyens ». Beaucoup y ont déjà perdu la vie.
Mais la défense de la nature, de l’espèce humaine, de la vie, ne pèsent pas lourd (et la nature comme l’homme en subissent les meurtrissures) face aux exigences de la loi du profit et de la concurrence capitaliste entre les États. Car voilà la véritable préoccupation de la bourgeoisie : la défense de ses intérêts et non ceux de l’humanité et de sa relation avec le « monde naturel ».
Ces incendies d’aujourd’hui ne sont donc pas des épiphénomènes exceptionnels. Ils sont devenus le quotidien du monde capitaliste où la dévastation atteint des sommets. Avec la propagation des monocultures intensives, une déforestation volontaire à outrance, un aménagement du territoire de plus en plus anarchique guidé par la rentabilité immédiate, les écosystèmes, les espèces animales et la biodiversité sont détruites jour après jour. L’accélération du dérèglement climatique et les catastrophes environnementales qui l’accompagnent sont les produits de la logique de fonctionnement d’un système capitaliste criminel et mortifère qui en est réduit à mettre en œuvre au sens propre une politique de « la terre brûlée » qui ne réserve à l’humanité que toujours plus de destruction et de misère, menaçant ouvertement sa survie. Pour obéir aux lois du profit et aux nécessités de la guerre, les gouvernements de nombreux pays jettent encore de l’huile sur le feu en prolongeant les centrales à charbon connus pour leurs effets destructeurs. Cela, au nom de l’indépendance nationale vis-à-vis du gaz russe. En Afrique ou au Moyen-Orient, les États consomment désormais du gaz encore plus massivement alors que cette énergie fossile est également désastreuse pour l’environnement. Le capitalisme sacrifie la planète pour la guerre !
Le monde est aujourd’hui à feu et à sang et ce n’est pas une simple image. En juillet 1914, juste avant le déclenchement de la Première Guerre mondiale Jean Jaurès déclarait : « Le capitalisme porte en lui la guerre comme la nuée porte l’orage ! ». C’est encore le cas à l’heure actuelle : les ravages de la guerre en Ukraine en témoignent, mais s’y cumulent ceux liés au réchauffement planétaire et au dérèglement climatique, démontrant que le capitalisme porte en lui la dévastation, la destruction généralisée et la sécrète par tous les pores de sa peau.
Cette putréfaction devient de plus en plus violente, barbare, incontrôlable et donne au quotidien la preuve flagrante que le capitalisme n’est plus signe de progrès pour l’humanité, mais au contraire est synonyme de mort et de destruction. Le monde capitaliste devient concrètement de plus en plus invivable. Il n’y a que le prolétariat qui puisse y mettre un terme par le développement de son combat révolutionnaire, de sa conscience de classe en défense de ses conditions de vie et l’instauration d’une société sans exploitation. Le sort de l’humanité est entre ses mains.
Stopio, 24 juillet 2022
Récent et en cours:
- environnement [289]
- incendies [490]
Rubrique:
ICCOnline - août 2022
- 31 lectures
La bourgeoisie impose de nouveaux sacrifices, la classe ouvrière répond par la lutte (Tract international)
| Fichier attaché | Taille |
|---|---|
| 225.28 Ko |
- 475 lectures
"Enough is enough", "trop c'est trop". Voilà le cri qui s’est propagé d’écho en écho, de grève en grève, ces dernières semaines au Royaume-Uni. Ce mouvement massif baptisé "L’été de la colère", en référence à "L’hiver de la colère" de 1979, implique chaque jour des travailleurs dans plus en plus de secteurs : les trains, puis le métro de Londres, British Telecom, La Poste, les dockers de Felixstowe (un port vital en Grande-Bretagne), les éboueurs et les chauffeurs de bus dans différentes parties du pays, Amazon, etc. Aujourd’hui les travailleurs des transports, demain ceux de la santé et les enseignants.
Tous les journalistes et commentateurs constatent qu’il s’agit du mouvement le plus important de la classe ouvrière dans ce pays depuis des décennies ; il faut remonter aux immenses grèves de 1979 pour trouver un mouvement plus important et massif. Un mouvement d'une telle ampleur dans un pays aussi important que le Royaume-Uni n'est pas un événement "local". C'est un événement de portée internationale, un message aux exploités de tous les pays.
Face aux attaques contre le niveau de vie de tous les exploités, une seule réponse :
le combat de classe
Décennie après décennie, comme et encore plus que dans les autres pays développés, les gouvernements britanniques successifs ont attaqué sans relâche les conditions de vie et de travail avec un seul leitmotiv : précariser et flexibiliser au nom de la compétitivité nationale et du profit. Les attaques ont atteint un tel niveau ces dernières années que la mortalité infantile connait dans ce pays "une augmentation sans précédent" depuis 2014 (selon la revue médicale BJM Open).
C’est pourquoi l’explosion actuelle de l’inflation représente un tel tsunami. Avec 10,1% d’augmentation des prix en juillet sur un an, 13% prévu en octobre, 18% en janvier, les ravages sont dévastateurs. "Beaucoup de gens pourraient être contraints de choisir entre sauter des repas pour chauffer leur logement, ou vivre dans le froid et l’humidité", a ainsi prévenu le NHS, le Service National de la Santé. Avec une augmentation du prix du gaz et de l’électricité de 54 % au 1er avril et de 78 % au 1er octobre, la situation est effectivement intenable.
Le niveau de mobilisation des travailleurs britanniques est donc enfin à la hauteur des attaques qu'ils subissent, alors que ces dernières décennies ils n'avaient pas trouvé la force pour y répondre, encore KO debout depuis les années Thatcher.
Dans le passé, les ouvriers anglais étaient parmi les plus combatifs du monde. Si on se base sur le nombre de jours de grève, "l'hiver de la colère" de 1979 constitue le mouvement le plus massif de tous les pays après celui de Mai 1968 en France, avant même "l'automne chaud" de 1969 en Italie. C'est cette énorme combativité que le gouvernement de Margareth Thatcher avait réussi à étouffer de façon durable en infligeant toute une série de défaites cuisantes aux ouvriers et particulièrement lors de la grève des mineurs en 1985. Cette défaite a marqué un tournant, celui du reflux prolongé de la combativité ouvrière au Royaume-Uni ; elle annonçait même le reflux général de la combativité ouvrière dans le monde. Cinq ans après, en 1990, l’effondrement de l’URSS, présentée frauduleusement comme un régime "socialiste", l’annonce non moins mensongère de la "mort du communisme" et du "triomphe définitif du capitalisme" ont fini d’assommer les travailleurs du monde entier. Depuis, privés de perspective, atteints dans leur confiance et leur identité de classe, ils ont subi de plus en plus, au Royaume-Uni encore plus qu'ailleurs, les attaques de tous les gouvernements sans être capables de réellement riposter. Les manifestations massives en France faisant souvent figures d’exception ces dernières années.
Mais la colère s'est accumulée et aujourd’hui, face aux attaques de la bourgeoisie, la classe ouvrière au Royaume-Uni montre qu’elle est de nouveau prête à lutter pour sa dignité, à refuser les sacrifices imposés sans cesse par le capital. Et une nouvelle fois, elle est le reflet le plus significatif de la dynamique internationale : l’hiver dernier, des grèves avaient commencé à éclater en Espagne et aux Etats-Unis ; cet été, l’Allemagne et la Belgique ont elles-aussi connu des débrayages ; pour les mois à venir, tous les commentateurs annoncent "une situation sociale explosive" en France et en Italie. Il est impossible de prévoir où et quand la combativité ouvrière va de nouveau se manifester massivement dans l’avenir proche, mais une chose est certaine, l'ampleur de la mobilisation ouvrière actuelle au Royaume-Uni constitue un fait historique majeur : c'en est fini de la passivité, de la soumission. Les nouvelles générations ouvrières relèvent la tête.
Le combat de classe face à la guerre impérialiste
L'importance de ce mouvement ne se limite pas au fait qu'il met fin à une longue période de passivité. Ces luttes se développent à un moment où le monde est confronté à une guerre impérialiste de grande ampleur, une guerre qui oppose, sur le terrain, la Russie à l'Ukraine mais qui a une portée mondiale avec, en particulier, une mobilisation des pays membres de l'OTAN. Une mobilisation en armes mais aussi économique, diplomatique et idéologique. Dans les pays occidentaux, le discours des gouvernements appelle aux sacrifices pour "défendre la liberté et la démocratie". Concrètement, cela veut dire qu'il faut que les prolétaires de ces pays doivent se serrer encore plus la ceinture pour "témoigner leur solidarité avec l'Ukraine", en fait avec la bourgeoisie ukrainienne et celle des pays occidentaux.
Les gouvernements justifient sans aucune honte leurs attaques en instrumentalisant à la fois la catastrophe du réchauffement climatique et les risques de pénuries énergétiques et alimentaires ("la pire crise alimentaire jamais connue" selon le Secrétaire général de l'ONU). Ils en appellent à la "sobriété" et annoncent la fin de "l’abondance" (pour reprendre les mots iniques du Président français Macron). Mais, en même temps, ils renforcent leur économie de guerre : les dépenses militaires mondiales ont atteint 2.113 milliards de dollars en 2021 ! Si le Royaume-Uni fait partie des cinq plus grands États en matière de dépenses militaires, depuis l’éclatement de la guerre en Ukraine, tous les pays du monde ont accéléré leur course aux armements, y compris l’Allemagne, une première depuis 1945 !
Les gouvernements en appellent aux "sacrifices pour lutter contre l'inflation". C'est une farce sinistre alors qu'ils ne font que l'aggraver en faisant exploser les dépenses de guerre. Voilà l’avenir que promettent le capitalisme et ses bourgeoisies nationales en compétition : plus de guerres, plus d’exploitation, plus de destructions, plus de misère.
Voilà aussi ce que les grèves du prolétariat au Royaume-Uni portent en germe, même si les travailleurs n’en ont pas toujours pleinement conscience : le refus de se sacrifier encore et toujours plus pour les intérêts de la classe dominante, le refus des sacrifices pour l’économie nationale et pour l’effort de guerre, le refus d’accepter la logique de ce système qui mène l’humanité vers la catastrophe et, finalement, à sa destruction.
Voilà la seule alternative : socialisme ou destruction de l’humanité.
La nécessité de déjouer les pièges de la bourgeoise
Cette capacité à redresser la tête est d’autant plus marquante que la classe ouvrière au Royaume-Uni a subi ces dernières années le matraquage de l’idéologie populiste, qui dresse les exploités les uns contre les autres, les divise en "locaux" et "étrangers", en blancs et noirs, en hommes et femmes, jusqu’à faire croire que le repli insulaire du Brexit pouvait être la solution.
Mais il y a d’autres pièges bien plus pernicieux et dangereux tendus par la bourgeoisie sur le chemin des luttes du prolétariat.
La grande majorité des grèves actuelles ont été appelées par les syndicats qui se présentent ainsi comme l'organisation indispensable pour organiser la lutte et défendre les exploités. Les syndicats sont indispensables, oui, mais pour défendre la bourgeoisie et organiser la défaite de la classe ouvrière.
Il suffit de se rappeler à quel point la victoire de Thatcher a été permise grâce au travail de sape des syndicats. En mars 1984, quand 20.000 suppressions d’emplois sont brutalement annoncées dans le secteur des charbonnages, la réaction des mineurs est fulgurante : dès le premier jour de grève, 100 puits sur 184 sont fermés. Un corset de fer syndical entoure alors immédiatement les grévistes. Les syndicats de cheminots et de marins soutiennent platoniquement le mouvement. Le puissant syndicat des dockers se contente de deux appels à la grève tardifs. Le TUC (la centrale syndicale nationale) refuse de soutenir la grève. Les syndicats des électriciens et des sidérurgistes s’y opposent. Bref, les syndicats sabotent activement toute possibilité de lutte commune. Mais surtout, le syndicat des mineurs, le NUM (National Union of Mineworkers), parachève ce sale boulot en cantonnant les mineurs dans de vaines batailles rangées avec la police pour tenter d'empêcher la sortie du charbon des cokeries (plus d’un an !). Grâce à ce sabotage syndical, à ces occupations stériles et interminables, la répression policière peut s’abattre avec d’autant plus de violence. Cette défaite sera la défaite de toute la classe ouvrière.
Si aujourd’hui, au Royaume-Uni, ces mêmes syndicats ont un langage radical et font mine de prôner la solidarité entre les secteurs, brandissant même la menace de la grève générale, c’est parce qu’ils collent aux préoccupations de la classe ouvrière, ils tentent de capter ce qui anime les travailleurs, leur colère, leur combativité et leur sentiment qu’il faut se battre ensemble, pour mieux stériliser, détourner cette dynamique. En réalité, sur le terrain, ils orchestrent des grèves séparées ; derrière le mot d’ordre unitaire de hausse des salaires pour tous, ils enferment et divisent dans les négociations corporatistes ; surtout ils prennent grand soin d’éviter toutes réelles discussions entre les travailleurs des différents secteurs. Nulle part de réelles assemblées générales interprofessionnelles. C’est pourquoi il ne faut pas se laisser duper quand Lizz Truss, la favorite pour remplacer Boris Johnson, déclare qu'elle "ne laissera pas" le Royaume-Uni "être rançonné par des syndicalistes militants" si elle devient Première ministre. Elle ne fait là que s’inscrire dans les pas de son modèle, Margareth Thatcher ; elle crédibilise les syndicats comme les représentants les plus combatifs des travailleurs pour mieux, ensemble, mener la classe ouvrière à la défaite.
En France, en 2019, face à la montée de la combativité et l’élan de solidarité entre les générations, les syndicats avaient déjà usé du même stratagème en prônant la "convergence des luttes", un ersatz de mouvement unitaire, où les manifestants qui défilaient dans la rue étaient parqués par secteur et par entreprise.
Au Royaume-Uni comme partout ailleurs, pour construire un rapport de forces nous permettant de résister aux attaques incessantes contre nos conditions de vie et de travail, et qui demain vont s’aggraver encore avec violence, nous devons, partout où nous le pouvons, nous rassembler pour débattre et mettre en avant les méthodes de lutte qui ont fait la force de la classe ouvrière et lui ont permis, à certains moments de son histoire, de faire vaciller la bourgeoisie et son système :
- la recherche du soutien et de la solidarité au-delà de "sa" corporation, "son" entreprise, "son" secteur d’activité, de "sa" ville, "sa" région, "son" pays ;
- l’organisation autonome du combat ouvrier, à travers des assemblées générales notamment, sans en laisser le contrôle aux syndicats, ces soi-disant "spécialistes" des luttes et de leur organisation
- la discussion la plus large possible sur les besoins généraux de la lutte, sur les leçons à tirer des combats et aussi des défaites, car il y aura des défaites mais la plus grande défaite est de subir les attaques sans réagir, l'entrée en lutte est la première victoire des exploités.
Si le retour des grèves massives au Royaume-Uni marque le retour de la combativité du prolétariat mondial, il est aussi vital que les faiblesses qui avaient signé sa défaite en 1985 soient dépassées : le corporatisme et l’illusion syndicale. L’autonomie de la lutte, l’unité et la solidarité sont les jalons indispensables à la préparation des luttes de demain !
Et pour cela, il faut se reconnaître comme membre d’une même classe, une classe unie par la solidarité dans la lutte : le prolétariat. Les luttes d'aujourd'hui sont indispensables pas seulement pour se défendre pied à pied contre les attaques mais aussi pour reconquérir cette identité de classe à l'échelle mondiale, pour préparer le renversement de ce système synonyme de misère et de catastrophes de toutes sortes.
Dans le capitalisme, il n'y a pas de solution : ni à la destruction de la planète, ni aux guerres, ni au chômage, ni à la précarité, ni à la misère. Seule la lutte du prolétariat mondial soutenue par tous les opprimés et exploités du monde peut ouvrir la voie à une alternative.
Les grèves massives au Royaume-Uni sont un appel au combat pour les prolétaires de tous les pays
Courant Communiste International, 27 août 2022
Vie du CCI:
- Interventions [492]
Géographique:
- Grande-Bretagne [47]
Rubrique:
Les ouvriers sont prêts à se battre, et la classe dominante se prépare à saboter les luttes
- 103 lectures
Malgré la pandémie de Covid, malgré la guerre en Ukraine, malgré les divisions toxiques attisées par le Brexit, la classe ouvrière, en Grande-Bretagne et dans d’autres régions du monde, se prépare à lutter pour défendre ses conditions de vie. Et, à long terme, c’est la seule issue qui permette de s’écarter de la voie qui mène le capitalisme à l’auto-destruction.
La « crise du coût de la vie » est devenue un facteur actif de la résistance de la classe ouvrière. La crise économique mondiale n’est pas apparue avec la Covid ou avec la guerre en Ukraine ; elle s’est développée pendant des décennies auparavant (rappelons-nous la « crise du pétrole » pendant les années 70 ou le « crash financier » de 2008). Mais les récentes expressions du glissement du capitalisme vers la barbarie ont certainement aggravé le déclin économique mondial et au sein de celui-ci le déclin économique spécifique de la Grande-Bretagne. Et elles n’ont que partiellement caché l’impact grandissant et désastreux du Brexit à ce niveau. La flambée de l’inflation qui s’élève maintenant à 9,1% - et devrait atteindre 11 % à la fin de l’année - a un impact direct sur les familles de travailleurs ordinaires (c’est-à-dire la classe ouvrière) pour chauffer leurs maisons, se rendre au travail et apporter la nourriture au foyer.
Pour de nombreux travailleurs, la spirale des prix et les offres salariales bien inférieures au taux de l’inflation ont été la goutte d’eau qui a fait déborder le vase, après des années d’attaques contre les salaires, l’emploi et les prestations sociales. 40 000 travailleurs du rail : aiguilleurs, personnel de maintenance des voies et des trains - appartenant au RMT (Rail, Maritime and Transport Union) - ont fait grève en juin et prévoient d’autre grèves, le 27 juillet, le 18 et le 20 août, première grève nationale en Grande-Bretagne depuis environ 25 ans. 5500 conducteurs de trains, appartenant à un autre syndicat, l’ASLEF (Associated society of locomotive engineers and firemen) feront également grève le 30 juillet, dans huit compagnies ferroviaires. Avant cela, il y aura des grèves de moindre ampleur, dans d’autres compagnies. Dans le nord-ouest de l’Angleterre, les conducteurs de bus ont été en grève pour un conflit salarial avec Arriva. Des grèves sont également prévues dans le secteur des communications. 40 000 travailleurs de British Telecom feront grève le 29 juillet et le 1er août. Les travailleurs de Royal Mail feront grève entre le 20 et le 22 juillet. Ces grèves pourraient concerner 115 000 travailleurs. Suite au rejet par les syndicats des propositions d’augmentation de salaires par les employeurs, dans les compagnies aériennes, cet été pourrait voir des arrêts de travail généralisés dans les aéroports, tant en Grande-Bretagne que dans d’autres pays d’Europe.
Dans le secteur de l’éducation, il y a eu un certain nombre de grèves dans les universités et les collèges d’enseignement professionnel. Le syndicat national de l’éducation et le syndicat national des professeurs appellent à des « actions massives » à l’automne, si les négociations échouent. Dans le secteur de la santé, suite à l’offre du gouvernement d’une augmentation de 5 % (ou moins) pour les travailleurs de la santé et de l’éducation et d’autres secteurs publics, les syndicats ont dénoncé avec colère les seules augmentations dans le secteur de la santé comme une « trahison », un « coup de pied dans la mâchoire » et ont averti que des arrêts de travail pourraient se profiler à l’horizon ([1]).
Ces conflits s’inscrivent dans le cadre d’une montée générale de la combativité des travailleurs. Le syndicat GMB, qui est très présent dans les unions locales parmi les travailleurs manuels, a indiqué que le nombre de conflits pour la période de octobre 2019 à mars 2020 était sept fois supérieur à celui de la même période pour 2019-2020 ; le syndicat Unite, très implanté dans le secteur public, a revendiqué une multiplication par quatre des conflits.
La signification de ces grèves
Ces luttes ne sont pas une réponse directe de la classe ouvrière à la guerre capitaliste en Ukraine. Mais, après s’être entendus dire que « nous sommes tous ensemble » dans la lutte contre la Covid et que nous devons tous être prêts à faire des sacrifices pour défendre l’Ukraine et l’Occident contre l’agression russe, il n’est pas anodin de constater que la classe ouvrière n’est pas prête à abandonner la lutte pour la défense de ses intérêts de classe au nom de l’unité nationale. Et, si nous regardons les autres pays d’Europe, nous constatons que la classe ouvrière « tire sur la laisse » dans de nombreux pays. En 2019, juste avant le début de la crise du Covid, il y a eu de nombreux mouvements de grève en France et même pendant les confinements - surtout au début - les ouvriers de nombreux secteurs, y compris les « héros » du secteur de la santé, ont mené des actions collectives contre le fait d’être obligés de travailler sans réel moyen de protection contre le virus. A la fin des confinements, de nombreux mouvements se sont multipliés aux États-Unis, en Iran, en Italie, en Turquie, ce qui nous a amenés à publier un article intitulé « Luttes aux États-Unis, en Iran, en Italie, en Corée : ni la pandémie ni la crise économique n’ont brisé la combativité de la classe ouvrière » ([2]). Si nous comparons ces mouvements contre l’intensification de l’exploitation de la classe ouvrière à la situation de la classe ouvrière en Ukraine, qui a été presque entièrement soumise à l’effort national, nous pouvons y voir la preuve que, si les travailleurs connaissent une véritable défaite en Ukraine, cela ne s’applique pas à la classe ouvrière dans son ensemble et en particulier pour ses fractions les plus expérimentées, qui ne sont pas prêtes à sacrifier la défense de leurs intérêts matériels de classe au nom de l’intérêt national et encore moins à être enrôlées dans la guerre au bénéfice de la classe capitaliste.
On peut objecter que les luttes du prolétariat se cantonnent au domaine économique et ne peuvent pas déboucher, à court terme du moins, sur une alternative politique à l’impasse historique dans laquelle se trouve la société capitaliste. Or, pour des raisons que nous avons déjà analysées par ailleurs ([3]), la classe ouvrière a perdu la conscience de son identité, a perdu tout sens d’elle-même en tant que force sociale distincte ; mais les luttes en réponse à la crise économique et aux attaques qui l’accompagnent lui fournissent un point de départ indispensable à la reconstruction de son identité de classe, surtout quand un grand nombre de travailleurs de différents secteurs sont en lutte pour des revendications économiques sensiblement identiques. Et la récupération de l’identité de classe contient nécessairement une dimension politique vitale ([4]), car elle tend à mettre en avant le scénario avancé par le Manifeste de 1848 : « La société dans son ensemble se divise de plus en plus en deux deux grands camps hostiles, deux classes qui se font directement face : la bourgeoisie et le prolétariat ».
La réponse de la classe dirigeante et de ses syndicats
La formation de la classe ouvrière en une force unifiée face à la bourgeoisie est, bien sûr, un long chemin à parcourir, et nous n’avons pas l’intention de minimiser les immenses obstacles qui vont se dresser devant elle - avant tout parce que la décomposition accélérée de la société bourgeoise elle-même menace d’entraîner la classe ouvrière dans son sillage, d’infliger au corps du prolétariat les sentiments de haine et les divisions (nationales, sexuelles, raciales, religieuses, etc…) propres à ce système moribond. Dans le même temps, même si la bourgeoisie elle-même est de plus en plus divisée, perdant de plus en plus le contrôle de son propre système et de son appareil politique en particulier, elle est toujours capable de développer des stratégies et des manœuvres pour empêcher l’unification de son ennemi mortel : le prolétariat. En réponse aux grèves en Grande-Bretagne, le gouvernement de B. Johnson cultivant son populisme, qui a prétendu être « le vrai parti des travailleurs » (sic !), ne lance pas pour l’instant une attaque frontale contre les grèves mais adopte principalement une position plus conciliante, même si le ministre des transports, Grant Schapps a déclaré que les demandes des travailleurs du rail étaient déraisonnables. Il admet qu’il y a « une crise du coût de la vie », qu’il présente comme « temporaire » et déclare qu’il est nécessaire de faire des choix difficiles afin de surmonter les difficultés. Il offre également, aux travailleurs les plus pauvres, une aide symbolique en juillet et à l’automne. Plus récemment, il a proposé de porter de 2 à 5 % l’augmentation des salaires dans le secteur public, c’est-à-dire qu’il propose une réduction des salaires d’environ 5 % au lieu de 8 %. Les médias bourgeois les plus sérieux, notamment du Guardian et de l’Observer, mais aussi de la BBC, ont beaucoup parlé de « la vague de grèves », l’exagérant même et prédisant un « été chaud », un retour à la lutte de classes des années 70. De nombreux articles ont été publiés pour démontrer la légitimité des revendications des travailleurs du rail, et notamment pour féliciter Mick Lynch, dirigeant du syndicat RMT, pour sa défense intelligente et structurée des revendications face aux questions des médias plus hostiles([5]) . Un certain nombre d’enquêtes ont aussi été publiées, montrant que les grèves ferroviaires avaient bénéficié d’un soutien considérable du public. Cela contraste fortement avec les grèves précédentes dans les transports, où les médias se sont largement concentrés sur la misère des banlieusards [qui passent beaucoup de temps dans les trains] qui pâtissent des « exigences égoïstes » des syndicats. Il est vrai qu’un tabloïd comme le Sun peut encore proclamer que : « les grèves ferroviaires de cette semaine sont ce qui arrive lorsque des voyous marxistes nourris de fantasmes de ‘guerre des classes’ essaient d’utiliser les malheurs économiques du public pour faire tomber un gouvernement élu qu’ils méprisent. » (20/06/2022), mais une telle rhétorique incendiaire sert aussi à recrédibiliser l’image des syndicats.
Dans le passé, la bourgeoisie a toujours fait en sorte de passer sous silence les nouvelles de la montée des mouvements de grèves sauvages, a contrario cette (soudaine) publicité permanente et souvent favorable aux grèves indique une tentative de la classe dirigeante d’anticiper et donc de dissiper un développement plus dangereux du mouvement de classe. Les syndicats ont bien joué leur partition dans cette division des tâches, ils font leur travail pour garder la lutte de la classe ouvrière sous leur contrôle : ainsi, l’appel lancé par le TUC en direction de la classe ouvrière à participer à une grande manifestation nationale qu’il a organisé le 18 juin contre l’augmentation du coût de la vie afin de prendre les devants et préserver ce contrôle.
De plus :
- les syndicats ont veillé à ce que les grèves respectent les restrictions légales très sévères en vigueur aujourd’hui.
- La liste des grèves ci-dessus montre que, en dépit du fait que des secteurs importants de la classe ouvrière sont en lutte aujourd’hui, seule une partie d’entre eux sont actuellement grévistes.
- Les grèves sont fractionnées et réparties sur plusieurs jours.
- Il apparaît que l’on ait veillé à ce que les grèves de différents secteurs n’aient pas lieu le même jour.
- Les grèves, selon les syndicats, sont dirigées contre le gouvernement conservateur et non contre la classe dirigeante dans son ensemble. L’objectif final est d'orienter vers l’élection d’un gouvernement travailliste.
- Cette mystification « anti-tories » est renforcée par des groupes d’extrême-gauche, comme le Socialist Worker's Party. Alors que les gauchistes critiquent Keir Starmer (le chef du parti travailliste) pour ne pas avoir soutenu les grèves et pour avoir dénoncé les députés s’étant rendus sur les piquets de grève, leur propagande vise constamment la nécessité de « chasser les tories » pour les remplacer par un gouvernement travailliste avec une direction plus radicale (dans le genre de Corbyn par exemple). Et s’ils appellent à l’unification des grèves, celle-ci doit se faire par le biais des syndicats agissant ensemble. En somme, le travail des gauchistes consiste à empêcher la classe ouvrière de sortir de l’emprise des travaillistes et des syndicats.
Ce que nous voyons aujourd’hui n’est qu’un aperçu de ce que la classe ouvrière doit faire si elle veut se forger une puissance unifiée et consciente capable d’affronter et de renverser le pouvoir du capital. Cela nous rappelle également le cynisme et la ruse d’un appareil dirigeant qui ne se limite pas au parti conservateur mais inclut l’ensemble du « mouvement travailliste » - de Starmer aux syndicats et à l’extrême-gauche. Aussi, l’identification des obstacles à la lutte de classe, l’exposition de ses véritables ennemis, participe nécessairement de la libération de l’immense potentiel de la classe exploitée, révélé par ses luttes immédiates.
Amos (1er juillet)
[1] « Menaces de grève, alors que les employés du secteur public reçoivent un salaire inférieur à l’inflation » [493], The Guardian.
[2] « Luttes aux États-Unis, en Iran, en Italie, en Corée… Ni la pandémie ni la crise économique n’ont brisé la combativité du prolétariat! », Révolution internationale n°491, (novembre-décembre 2021). [357]
[3] Voir par exemple le « rapport sur la lutte des classes pour le 23e congrès internationale du CCI : formation, perte et reconquête de l’identité de classes », Revue internationale n°164. [113]
[4] Ce que nous écrivions dans notre brochure Les syndicats contre la classe ouvrière dans les années 70 reste vrai tout au long de la période de décadence du capitalisme : « Ce que le prolétariat doit abandonner, ce n’est pas la nature économique de sa lutte (une impossibilité de toutes façons s’il veut lutter en tant que classe), mais toutes se illusions sur les possibilités futures de défendre ses intérêts, même les plus immédiats, sans sortir du cadre purement économique, et sans adopter consciemment une compréhension politique, globale et révolutionnaire de sa lutte. Face à l’inévitable échec immédiat de ses luttes revendicatives dans le capitalisme décadent, ce que la classe ouvrière doit conclure, ce n’est pas que ces luttes soient inutiles, mais que le seul moyen de les rendre utiles pour la cause prolétarienne, c’est de les concevoir et les transformer consciemment en moments d’apprentissage et de préparation de combats plus généralisés, plus organisés et plus conscients de l’inévitabilité de l’affrontement final avec le système d’exploitation. » (pages 45-46)
[5] Voir par exemple l’article publié dans The Guardian : « Des « ennemis de l’intérieur » ? Peu crédible ...la plupart de gens comprennent pourquoi nous avons besoin de syndicats prêts à faire grève. » [494]
Géographique:
- Grande-Bretagne [47]
Rubrique:
ICCOnline - septembre 2022
- 54 lectures
Après six mois de barbarie guerrière en Ukraine, le prolétariat en Grande-Bretagne donne un début de réponse
- 187 lectures
Le CCI tiendra, le samedi 17 septembre, des réunions publiques pour discuter de l'accélération de la barbarie capitaliste, démontrée par la guerre en Ukraine ainsi que par l'approfondissement de la crise économique mondiale et l'aggravation des effets du changement climatique. En considérant la réponse de la classe ouvrière internationale, nous accorderons une attention particulière aux importantes luttes ouvrières qui se déroulent actuellement en Grande-Bretagne.
Ces réunions se dérouleront dans les villes suivantes :
Lille : Café "Les Sarrazins", 54 rue des Sarrazins 59000, à 15H00.
Marseille : Association Mille Bâbords, 61 Rue Consolât 13001, à 15H00.
Paris : CICP, 21 ter rue Voltaire (métro "rue des boulets") 75011, à 15H00.
Toulouse : Restaurant On’ador, 5 Rue de Université du Mirail, métro "Mirail Université", 31000, à 15H00.
Rubrique:
Ni le camp de Lula, ni le camp de Bolsonaro, ni aucun autre ! Contre tous les camps capitalistes, le seul avenir réside dans le développement de la lutte de classe du prolétariat.
- 79 lectures
Au moment où se préparent les élections générales au Brésil, la bourgeoisie intensifie sa propagande, renforce la mystification démocratique à travers ses "alternatives", en mettant en scène le duel opposant d'un côté Lula, représentant le visage démocratique de la gauche, et de l'autre l'actuel président Bolsonaro, expression caricaturale du populisme et de l'extrême droite (une sorte de Trumpist sud-américain).
Les arguments présentés par les formations politiques ou les candidats dans la course pour convaincre les électeurs de leur accorder leur vote se résument généralement à ceci, au Brésil comme dans tout autre pays : les élections constituent un moment où les "citoyens" sont confrontés à un choix dont dépendrait l'évolution de la société et, par conséquent, leurs futures conditions de vie. Grâce à la démocratie, chaque citoyen aurait la possibilité de participer aux grands choix de société. Selon eux, le vote serait l'instrument de transformation politique et sociale qui définirait l'avenir du pays.
Mais la réalité n'est pas celle-là puisque la société est divisée en classes sociales aux intérêts parfaitement antagonistes ! L'une d'entre elles, la bourgeoisie, exerce sa domination sur l'ensemble de la société par la possession des richesses et, grâce à son État, sur toute l'institution démocratique, les médias, le système électoral, etc. Elle peut ainsi imposer en permanence son ordre, ses idées et sa propagande aux exploités en général, et à la classe ouvrière en particulier. Cette dernière, en revanche, est la seule classe qui, par ses luttes, est capable de contester l'hégémonie de la bourgeoisie et faire table rase de son système d'exploitation.
Le capitalisme, le système de production qui domine la planète et tous ses pays, est en train de sombrer dans un état de décomposition avancée. Après un siècle de déclin, il atteint sa phase finale, menaçant la survie de l'humanité par une spirale de guerres insensées, de dépression économique, de catastrophes écologiques et de pandémies dévastatrices.
Tous les États-nations de la planète s'engagent à maintenir ce système moribond. Tout gouvernement, qu'il soit démocratique ou dictatorial, ouvertement pro-capitaliste ou faussement "socialiste", existe pour défendre les véritables objectifs du capital : l'accroissement du profit aux dépens du seul avenir possible pour notre espèce, une communauté mondiale où la production n'a qu'un seul but - la satisfaction des besoins humains.
Mais, nous dit-on, cette fois au Brésil les enjeux sont différents. Réélire Bolsonaro -ou participer à sa réélection en ne votant pas- reviendrait à approuver toutes les politiques qu'il a menées pendant ses quatre années de mandat.
Il est vrai que Bolsonaro, comme ce fut le cas pour Trump, est un défenseur acharné du système capitaliste: intensification de l'exploitation, dans la mise en œuvre des "réformes" du travail et des retraites, dans la poursuite des mesures d'austérité qui ont élargi les coupes dans les domaines de l'éducation, de la santé, etc. Mais il n'est pas seulement un défenseur classique du capitalisme, il s'est révélé être un défenseur de tout ce qu'il y a de plus pourri dans le capitalisme, une caricature de populisme : son déni de la réalité du Covid-19 et du changement climatique, son encouragement à la brutalité policière au nom de la loi et de l'ordre, ses appels au racisme et à l'extrême droite, son comportement personnel répugnant de nature homophobe et misogyne, ... Mais le fait qu'il soit un escroc et un raciste n'a pas empêché d'importantes factions de la classe capitaliste de le soutenir parce que ses politiques de restriction des contrôles environnementaux et sanitaires servent à augmenter leurs profits.
Si, comme c'est plus probable, Lula est élu, ce ne sera pas pour améliorer la situation de la classe ouvrière, mais pour être plus efficace que ne l'a été Bolsonaro au service de la défense du capital national, laquelle se fait toujours au détriment des intérêts de la classe ouvrière.
Pour la gauche du capital, l'élection de Lula constitue une tâche primordiale, d'abord pour faire sortir Bolsonaro du "Planalto" (palais présidentiel), ensuite pour défendre la démocratie. À cet égard, le PT (Parti du Travail, l'appareil politique au service de Lula) a réussi à articuler un large front de gauche, ainsi qu'à faire des coalitions avec des partis de centre-droit.
La plus grande clarté sur ce que représentent Lula et Bolsonaro est d'autant plus nécessaire que les menaces de Bolsonaro de ne pas respecter le verdict des urnes -comme ce fut le cas avec Trump- pourraient conduire, si elles étaient mises à exécution, à des affrontements violents entre fractions de la bourgeoisie, voire à une tentative de coup d'État. Si cela devait se produire, il est de la plus haute importance pour l'avenir de la lutte des classes au Brésil qu'aucune fraction du prolétariat ne se laisse embarquer dans la défense de l'un ou l'autre des deux camps opposés. Les deux sont des ennemis du prolétariat mais Lula, soutenu par les partis de gauche de la bourgeoisie, est plus capable de tromper la classe ouvrière. C'est là une raison supplémentaire pour s'en méfier particulièrement.
Revolução Internacional (27 09 2022)
Géographique:
- Brésil [495]
Personnages:
- Jair Bolsonaro [496]
Récent et en cours:
Rubrique:
Explication des amendements rejetés du camarade Steinklopfer
- 202 lectures
Présentation du CCI
Dans la continuité de la discussion des documents publiés à la suite du 23e Congrès du CCI(1), nous publions de nouvelles contributions exprimant des divergences avec la Résolution sur la situation internationale du 24e Congrès(2). Comme avec la précédente contribution du camarade Steinklopfer, le désaccord porte sur la compréhension de notre concept de la décomposition, sur les tensions inter-impérialistes et la menace de guerre, et sur le rapport de force entre le prolétariat et la bourgeoisie. Afin d’éviter tout retard supplémentaire lié à la pression des événements récents, nous publions de nouvelles contributions des camarades Ferdinand et Steinklopfer sans la réponse défendant la position majoritaire dans le CCI, mais nous répondrons évidemment à ce texte en temps voulu. Nous devons signaler que ces contributions ont été écrites avant la guerre en Ukraine.
Au cours du 24e Congrès international, j’ai présenté un certain nombre d’amendements à la résolution sur la situation internationale. Leur orientation générale est un approfondissement des divergences que j’ai présentées, sous la forme d’amendements, au Congrès précédent. Certains ont été acceptés par le Congrès, d’autres ont été rejetés parce que le Congrès a estimé nécessaire de prendre le temps de les discuter plus profondément avant de les voter. En reproduisant certains de ces derniers amendements, cet article va se concentrer principalement sur ceux qui ont été rejetés parce que le Congrès était en désaccord avec leur contenu. Ces divergences concernent avant tout deux des dimensions essentielles de notre analyse sur la situation mondiale : les tensions impérialistes et le rapport de force de classes global entre la bourgeoisie et le prolétariat. Mais il y a un fil rouge qui relie entre eux ces désaccords, qui tourne autour de la question de la décomposition. Bien que l’ensemble de l’organisation partage notre analyse de la décomposition comme phase ultime du capitalisme, lorsque nous voulons appliquer ce cadre à la situation actuelle, des différences d’interprétation apparaissent. Ce sur quoi nous sommes tous d’accord est que cette phase terminale, non seulement a été ouverte par l’incapacité de l’une ou l’autre des principales classes de la société d’offrir une perspective à l’humanité toute entière, unir de grandes parties de la société soit derrière la lutte pour la révolution mondiale (le prolétariat), soit derrière la mobilisation pour la guerre généralisée (la bourgeoisie), mais qu’elle y a ses plus profondes racines. Mais, pour l’organisation, il y aurait une seconde force motrice à cette phase terminale, qui serait la tendance au chacun-pour-soi : entre les États, au sein de la classe dominante de chaque État national, dans la société bourgeoise au sens large. Sur cette base, en ce qui concerne les tensions impérialistes, le CCI tend à sous-estimer la tendance à la bipolarisation entre grands États dominants, la tendance vers la formation d’alliances militaires entre États, tout comme il sous-estime le danger grandissant de confrontation militaire directe entre grandes puissances, qui contient une dynamique potentielle vers ce qui ressemble à une Troisième Guerre mondiale, laquelle pourrait potentiellement détruire l’humanité entière. Sur la même base, le CCI aujourd’hui, en ce qui concerne le rapport de force entre les classes, tend à sous-estimer le sérieux de l’actuelle perte de perspective révolutionnaire de parties du prolétariat, ce qui mène l’organisation à assurer que la classe ouvrière peut retrouver son identité de classe et sa perspective communiste essentiellement à travers les luttes ouvrières défensives.
Les tendances vers la guerre
Pour ma part, bien que je sois d’accord avec l’idée que le chacun-pour-soi bourgeois est une très importante caractéristique de la décomposition, qui a joué un très grand rôle dans l’ouverture de la phase de décomposition avec la désintégration de l’ordre impérialiste mondial de l’après-Seconde Guerre mondiale, je ne crois pas que c’en soit une des principales causes. Il est bien plus vrai que le chacun-pour-soi bourgeois est une tendance permanente et fondamentale du capitalisme depuis sa naissance (allant même dans certaines circonstances jusqu’à la fragmentation et la désintégration de l’État bourgeois lui-même), tout comme la contre-tendance au rapprochement de forces nationales bourgeoises - dont l’État de classe est le principal outil -est fondamentale et permanente, allant jusqu'à la tendance au totalitarisme capitaliste d'État à l'époque du capitalisme décadent. Pour moi, l’incapacité à la fois du prolétariat et de la bourgeoisie d’imposer une solution à la crise qui menace l’existence de notre espèce est le facteur essentiel de la phase de décomposition, depuis 1989 jusqu’à aujourd’hui, et pas la tendance vers le chacun-contre-tous.
Au contraire, je dirais que la brutalité grandissante des deux tendances vers la fragmentation et la désunion, et vers l’imposition d’un minimum d’unité nationale à travers le capitalisme d’État, y compris l’affrontement toujours plus dur entre ces deux tendances opposées, sont ce qui caractérise, à ce niveau, cette phase terminale. Pour moi, le CCI s’éloigne de sa position originelle sur la décomposition en assignant au chacun-contre-tous un rôle de cause fondamentale et décisive qu’il n’a jamais eu aussi unilatéralement. Comme je le comprends, l’organisation a migré vers la position que, avec la décomposition, le chacun-contre-tous a acquis une qualité nouvelle par rapport à la précédente phase du capitalisme décadent, représentée par une sorte de domination absolue de la tendance à la fragmentation. Pour moi, par contre, il n'y a pas de tendance majeure dans la phase de décomposition qui n'existait pas déjà auparavant, en particulier dans la période de la décadence capitaliste ouverte par la Première Guerre mondiale. C’est pourquoi j’ai proposé un amendement à la fin du point trois de la résolution sur la situation internationale (qui a été rejeté par le Congrès) qui disait : « en tant que telle, la présente phase de décomposition n’est pas une période qualitativement nouvelle au sein -ou au-delà - de la décadence du capitalisme, mais est caractérisée -en tant que phase terminale du capitalisme - par la pire aggravation de toutes les contradictions du capitalisme en déclin ». La qualité nouvelle de la phase de décomposition consiste, à ce niveau, dans le fait que toutes les contradictions déjà existantes d’un mode de production en déclin sont exacerbées au plus haut point. Il en va de même avec la tendance au chacun-contre-tous qui est, elle aussi, exacerbée par la décomposition. Mais la tendance à la guerre entre puissances dominantes, et ainsi vers la guerre mondiale, est également exacerbée, comme le sont toutes les tensions générées par les mouvements vers la formation de nouveaux blocs impérialistes et par les tendances visant à les contrecarrer. L’incapacité à comprendre ceci nous amène aujourd’hui à gravement sous-estimer le danger de guerre, en particulier les conflits qui vont sortir des tentatives des États-Unis d’utiliser leur actuelle supériorité militaire contre la Chine, afin de stopper le développement de cette dernière, tout comme nous sous-estimons sérieusement le danger de conflits militaires entre l’OTAN et la Russie (ce dernier conflit étant, au moins à court terme, potentiellement encore plus dangereux que le conflit sino-américain du fait qu’il comporte un risque encore plus grand de déboucher sur une guerre thermonucléaire). Considérant que le CCI cherche à se rassurer sur l’improbabilité d’une guerre nucléaire du fait de l’inexistence de blocs impérialistes, le très important danger à l’heure actuelle est celui de guerres majeures entre les grandes puissances, autour des tentatives de rapprochement de ces blocs d’une part et des tentatives de l’empêcher d’autre part. C’est par souci de cette inquiétante trajectoire de l’analyse de l’organisation que j’ai proposé l’ajout suivant à la fin du point 8 : « Tout au long du capitalisme décadent jusqu’à aujourd’hui, des deux principales expressions du chaos généré par le déclin de la société bourgeoise, - conflits impérialistes entre État et perte de contrôle au sein de chaque capital national - au sein des régions centrales du capitalisme lui-même, la précédente tendance a prévalu sur la dernière. En supposant, comme nous le faisons, que cela continuera à être le cas dans le contexte de la décomposition, cela signifie que seul le prolétariat peut constituer un obstacle aux guerres entre grandes puissances, mais pas les divisions au sein de la classe dominante de ces pays. Si dans certaines circonstances ces divisions peuvent retarder le déclenchement de la guerre impérialiste, elle peuvent aussi les catalyser. » Cet amendement a été également rejeté par le Congrès. La Commission d’Amendements du Congrès a écrit que cet amendement « revient en fin de compte à mettre en question le cadre de la décomposition ; il pourrait donc apparaître de nouvelles zones de prospérité ». Pourtant le but de cet amendement n’était pas de mettre en avant la perspective de nouvelles zones de prospérité, mais de mettre en garde contre l’illusion que les divisions au sein des différentes classes dominantes nationales constitueraient nécessairement un obstacle aux guerres entre États nationaux. Loin d’être exclus par notre théorie de la décomposition, les conflits entre puissances dominantes confirment de façon frappante la validité de cette analyse. La décomposition est une accélération, l’exacerbation de toutes les contradictions du capitalisme décadent. Ce que le CCI pensait au départ mais risque maintenant d’oublier, c’est que le chacun-contre-tous impérialiste n’est qu’un pôle de la contradiction, l’autre étant la bipolarisation impérialiste à travers l’émergence d’un concurrent dominant toutes les autres puissances dominantes (une tendance qui contient en soi le germe de la formation de blocs impérialistes opposés, sans lui être identique). A ce niveau, nous souffrons d’un manque d’assimilation (ou d’une perte d’assimilation) de notre propre position. En partant de l’idée que le chacun-pour-soi est fondamental et constitutif de la phase de décomposition, la véritable idée que le pôle opposé à la bipolarisation peut se renforcer lui-même et pourrait même éventuellement finir par prendre le dessus doit apparaître comme mettant notre analyse en question. Il est vrai qu’autour de 1989, avec l’effondrement du bloc de l’Est (rendant le bloc occidental superflu), lors de la phase d’ouverture de la décomposition, c’est peut-être la plus importante explosion de chacun-pour-soi de l’histoire moderne qui s’est ouverte. Mais ce chacun-pour-soi a plus été le résultat que la cause de cette chaîne historique d’événements. La cause première était cependant l’absence de perspective, le « no future » qui prévalait et caractérise cette phase terminale. En ce qui concerne la classe dominante, ce « no future » est lié à sa tendance grandissante, dans le capitalisme décadent, à agir de façon « irrationnelle », en d’autres termes d’une façon préjudiciable à ses propres intérêts de classe. Ainsi, tous les principaux protagonistes de la Première Guerre mondiale en sont sortis affaiblis, et dans le Second conflit mondial, les deux principales puissances impérialistes à l’offensive (l’Allemagne et le Japon) ont toutes les deux été défaites. Mais cette tendance était loin d’être totalement dominante comme l’a montré l’exemple des États-Unis qui ont bénéficié à la fois militairement et économiquement de leur participation aux deux conflits mondiaux, et qui, grâce à leur supériorité économique écrasante sur l’Union soviétique, ont été à même, en un sens, de gagner la Guerre froide sans avoir à se lancer dans une nouvelle guerre mondiale. En revanche, il est difficile de voir comment, sur le long terme, la rivalité actuelle entre les États-Unis et la Chine peut ne pas conduire à une guerre entre eux, ou comment l’un et l’autre pourraient tirer profit d’une telle issue. Contrairement à l’URSS, la Chine est un concurrent sérieux pour la domination des États-Unis, pas seulement militairement mais aussi (et pour le moment, surtout) économiquement, de sorte qu'il est peu probable que son défi puisse être efficacement relevé sans des affrontements militaires directs de quelque nature que ce soit. C’est précisément pourquoi l’actuelle rivalité sino-américaine est l’une des expressions les plus dramatiques du « no future » généralisé de la phase terminale du capitalisme. Le défi chinois aux États-Unis a manifestement le potentiel pour amener notre espèce au bord de l’abîme. Dans l’analyse actuelle de l’organisation, cependant, la Chine n’est pas et ne sera jamais un concurrent sérieux des États-Unis, parce que son développement économique et technologique est considéré comme « un produit de la décomposition ». Si l’on suit cette interprétation, la Chine ne peut être et ne sera jamais plus qu’un pays semi-développé incapable de rivaliser avec les vieux centres du capitalisme d’Amérique du Nord, d’Europe ou du Japon. Cette interprétation n’implique-t-elle pas que l'idée, sinon d'un arrêt du développement des forces productives - que nous avons toujours, à juste titre, exclu comme caractéristique du capitalisme décadent - du moins de quelque chose qui n'en est pas loin, est maintenant postulée par l'organisation dans la phase finale de la décadence ? Comme un lecteur attentif l’aura noté, le 24e Congrès a condamné non seulement l’idée d’un défi global de l’impérialisme chinois comme remettant en cause la question de l’analyse théorique de la décomposition -l’idée même que la Chine a renforcé sa compétitivité au détriment de ses rivaux est rejetée comme une expression de mes prétendues illusions sur la bonne santé du capitalisme chinois. De façon similaire, mon idée que la Chine, au moins jusqu’à maintenant, s’en est beaucoup mieux sortie dans sa gestion de la pandémie de Covid que son rival américain est considérée comme une démonstration de mon rejet du caractère global de la décomposition. En lien avec la pandémie, j’ai proposé l’amendement suivant au point cinq de la résolution (rejeté par le Congrès) : « Dans une analyse marxiste, il est important de prendre ces différences en compte, en particulier dans la mesure où elles révèlent des tendances majeures qui existaient déjà avant la pandémie et ont été renforcées par elle. Ces trois tendances ont une particulière signification. Premièrement, l’établissement d’un troisième centre majeur du capitalisme mondial en Extrême-Orient (aux côtés de l’Europe et de l’Amérique du Nord), qui dans certains domaines surpasse même les autres au niveau de la modernité et de l’efficience capitaliste. Deuxièmement, l’émergence de la Chine aux dépens des États-Unis. Troisièmement, le fiasco de la forme « néo-libérale » du capitalisme d’État face à la pandémie (dont le modèle d’« État sobre », sans stocks -production « juste à temps » et livraison - a été le plus radicalement appliqué dans les vieux pays capitalistes) ». J’ai l’impression que, pour l’organisation aujourd’hui, les lois immuables du capitalisme ne s’appliquent plus dans la phase de décomposition. N’y a-t-il plus de gagnants ni de perdants dans la lutte de la concurrence capitaliste ? De même, jusqu'à présent, nous n'avons jamais nié qu'il puisse y avoir différents degrés de développement de la décomposition selon les différents pays et situations. Pour moi, la question de savoir pourquoi ce ne serait plus le cas est un mystère. Qu’il s’agisse de la pandémie ou de la situation en général, notre application du cadre de la décomposition risque de favoriser une tendance à une superficialité théorique et à la paresse. Notre compréhension de la décomposition donne le cadre de l’analyse de la pandémie, tout comme elle le fait pour cette phase en général, tout comme le fait notre compréhension de la décadence ou du capitalisme dans son ensemble. Ce cadre, absolument essentiel, n’est pas encore notre analyse en tant que telle. Nous risquons cependant de confondre les deux, de penser que nous avons déjà fait l’analyse lorsque nous donnons le cadre. Et que signifie dire que « le développement de la Chine est le produit de la décomposition » ? Est-ce que la prolétarisation de 600 millions de paysans (une part significative de toute éventuelle future révolution prolétarienne mondiale) est le produit de la décomposition ? Ne serait-il pas plus correct de dire que cet aspect du développement en Chine a lieu MALGRÉ la décomposition ?
Quant à la question vitale du danger d’affrontements militaires entre des puissances de premier plan comme les États-Unis et la Chine, elle ne relève pas du pronostic, personne ne sait véritablement de quoi le futur sera fait. Ce que l’organisation sous-estime gravement, c’est ce qui se passe sous ses yeux ici et maintenant. Ainsi que les représentants les plus éminents de la bourgeoisie américaine l’ont eux-mêmes récemment rendu public, le gouvernement chinois s’attendait à une attaque militaire américaine d’un certain type avant la fin du premier mandat de Donald Trump. Ce qui pouvait aboutir à cette conclusion était non seulement la rhétorique belliciste de la Maison Blanche, mais aussi la grande hâte avec laquelle Washington a retiré ses troupes du Proche-Orient (de Syrie) et les a redéployées en Extrême-Orient. C’est de toute façon une hypothèse plausible de dire que l’un des moyens utilisés par la classe dominante chinoise pour répondre à cette menace a été, au début de la pandémie, de permettre à ce nouveau virus de contaminer le reste du monde, dans le but de saboter les plans de son rival américain. Compte tenu des critiques formulées par le Parti démocrate américain à l’encontre de la politique étrangère de Trump au cours de cette période, on peut supposer qu’après que Joe Biden ait remplacé Trump dans le Bureau ovale, Pékin a adopté une politique attentiste, mais en fin de compte le retrait encore plus précipité de Biden d’Afghanistan suivi par la formation de l’alliance militaire AUKUS auront convaincu les Chinois que Biden suit la même logique d’affrontement que Trump. Considérant que, selon le célèbre journaliste d'investigation américain Bob Woodward, Trump envisageait d'utiliser des armes atomiques contre la Chine, ce qui est en ce moment en discussion au sein de la « communauté de sécurité » américaine, c’est avant tout la déstabilisation politique du régime chinois actuel, en particulier à travers la construction d’une politique systématique de provocation au sujet de la question taïwanaise. L’hypothèse sous-jacente est que, si Xi Jinping ne réagit pas militairement face aux mouvement en faveur de l’indépendance de Taïwan, si la Chine réagit militairement mais sans succès, cela peut aboutir à une telle « perte de face » qu’elle pourrait contribuer à marquer le début de la fin du règne du stalinisme en Chine (le chaos qui s’ensuivrait dans le pays le plus peuplé du monde serait accepté comme un moindre mal par Washington comparé à l’actuelle menace constituée par la poursuite de l’émergence de son rival chinois). Au nom de ce qui est censé être une défense du concept de décomposition, l’organisation a en réalité commencé à saper la clarté et la cohérence de l’analyse de la décadence du CCI. Auparavant, nous comprenions la période de déclin du capitalisme non seulement comme une époque de guerres et de révolutions, mais de guerres et de révolutions mondiales. L’actuelle sous-estimation de la tendance propre, innée du capitalisme décadent vers la guerre mondiale est vraiment alarmante.
Sur le rapport de force entre les classes
Si nous nous tournons maintenant vers la seconde divergence fondamentale qui concerne le rapport de force entre les classes, j’ai proposé, à côté d’autres amendements sur la lutte de classe, le passage suivant concernant le point 32, soulignant la gravité de la retraite prolétarienne à travers les trois défaites politiques principales qu’il a subies. Cet ajout, rejeté par le Congrès, est le suivant : « Depuis le retour d’une génération non défaite sur la scène de la lutte de classe en 1968, le prolétariat a subi trois défaites politiques consécutives d’importance, chacune accroissant les difficultés de la classe. La première défaite a été son incapacité initiale à se politiser. Le gauchisme et la politique de la « gauche au gouvernement » (qui a augmenté les aides sociales) ont été, dans les années 70, les fers de lance de ce retour en arrière, suivi dans les années 80 par la gauche dans l’opposition mobilisée sur le terrain contre la très réelle combativité ouvrière, et le revirement vers une politique économique et gouvernementale « néo-libérale ». L’un des buts de cette dernière était de ralentir l’inflation, mais pas uniquement, parce qu’en érodant le pouvoir d’achat de tous les ouvriers, celle-ci tendait à favoriser les luttes pour les salaires et la possibilité de leur unification. Ainsi affaiblie, la classe ouvrière au cours des années 80 s’est révélée incapable d’aller dans le sens imposé par la situation économique (crise internationale, « mondialisation ») et objectivement préparée par les gigantesques luttes de 1968 en France et de 1980 en Pologne : que les mouvements de masse débordent les frontières nationales. La seconde défaite, en 1989 (de loin la plus importante), qui a conduit à la phase de décomposition, a été marquée par le fait que le stalinisme a été mis à terre par sa propre décomposition, et pas par les luttes ouvrières. La troisième défaite, celle de ces cinq dernières années, résulte de l’incapacité de la classe de répondre de façon adéquate à la crise « de la finance » et « de l’Euro », laissant un vide qui a été comblé, parmi d’autres choses, par l’identitarisme et le populisme. Alors que le centre de gravité du recul mondial se trouvait en Europe de l’Est, pour le moment ce centre de gravité se trouve aux États-Unis (par exemple avec le phénomène du Trumpisme) et en Grande-Bretagne (Brexit). La défaite de 1989 et la plus récente portent les caractéristiques d’une défaite politique dans le contexte de la décomposition. Aussi sérieuses qu’elles soient, ce ne sont pas des défaites de même nature que celles subies pendant la contre-révolution. Ce sont des défaites dont le prolétariat peut se remettre (idée que nous avons développée au cours de notre dernier Congrès international). Bien qu’il ne soit pas possible aujourd’hui de mesurer combien de temps elles pourraient peser, nous ne pouvons plus exclure (plus de trois décennies après le début du recul général du combat prolétarien en 1989) que ce recul de l’après 1989 pourrait peser aussi longtemps que la contre-révolution qui a duré pratiquement quatre décennies (depuis le milieu des années 20 jusqu’au milieu des années 60). Cependant, d’un autre côté, le potentiel pour le dépasser plus rapidement est réel, du fait que sa cause profonde se trouve avant tout à un niveau subjectif, dans le dramatique sophisme qu’il n’y a aucune alternative au capitalisme. »
Il est déjà frappant dans la résolution du 23e Congrès que le problème de la faiblesse, bientôt de l’absence de perspective révolutionnaire prolétarienne, n’est pas considéré comme central pour expliquer les problèmes des luttes ouvrières au cours des années 80. Dans l’actuelle résolution, l’accent est mis une nouvelle fois sur l’impact négatif du « chacun pour soi », et sur le machiavélisme de la bourgeoisie qui met en avant cette mentalité. Mais parce que les résolutions des 23e et 24e Congrès continuent d’avancer que la lutte de classe, après la défaite de la grève de masse en Pologne, a continué d’avancer durant les années 80, elles sont incapables d’expliquer en profondeur pourquoi ce chacun-pour-soi et cette stratégie de la bourgeoisie ont obtenu un succès aussi indubitable. Cette incapacité, cet attachement à l’analyse de l’avancée de la lutte prolétarienne au cours des années 80 (une analyse qui était déjà erronée, mais d’une certaine manière compréhensible à l’époque vu le nombre significatif de luttes ouvrières, mais qui l’est bien moins aujourd’hui), est d’autant plus frappante, vu que cette décennie est entrée dans l’histoire comme celle du « no future ». Comme nous l’avons déjà constaté en ce qui concerne l’impérialisme, nous avons eu tendance à analyser les luttes des années 80 d’abord et avant tout du point de vue du chacun-pour-soi, ce qui nous a conduit à être incapables de reconnaître le caractère central de la perte de confiance croissante du prolétariat dans sa perspective révolutionnaire au-delà du capitalisme. Les luttes ouvrières de la fin des années 60 et du début des années 70 ont mis fin à ce que nous avons très justement appelé la plus longue contre-révolution de l’histoire, pas seulement du fait de leur caractère massif, spontané et auto-organisé, mais aussi parce qu’ils commençaient à se dégager de la camisole de la Guerre froide, dans laquelle le seul choix apparent était soit le « communisme » (c’est-à-dire le bloc de l’Est, ou l’alternative chinoise) soit la « démocratie » (c’est-à-dire le bloc occidental). Dans ce renouveau du combat prolétarien, il apparaissait l’idée, vague et confuse, mais très importante, de la lutte à la fois contre l’Est et l’Ouest, un rejet des deux, avec une mise en cause du cadre politique construit par le capitalisme pour une Troisième Guerre mondiale. C’était central pour ce que à l’époque nous décrivions (de façon tout à fait correcte) comme un changement du cours historique, d’un cours vers la guerre généralisée en un cours vers des affrontements de classe de plus en plus importants. Cette politisation initiale, bien que centrée à l’Ouest, a quand même rejoint l’Est, devenant ainsi un obstacle à la conduite vers la guerre du Pacte de Varsovie : l’idée de défier et éventuellement de renverser non seulement le capitalisme occidental (où se trouve le cœur du système mondial), mais également le stalinisme à l’Est, au moyen de l’auto-organisation et éventuellement des conseils ouvriers qui marcheraient vers l’établissement du véritable communisme. Cette première politisation a été combattue avec succès par la classe dominante au cours des années 70, et le résultat a été qu’après la défaite de la grève de masse de 1980 en Pologne, de plus en plus d’ouvriers ont commencé à se tourner vers le modèle économique de type occidental, alors que dans les pays centraux d’Occident, les luttes des années 80 ont été de plus en plus caractérisées par une attitude fataliste de « rejeter la politique », ou de se positionner démonstrativement soi-même sur un strict terrain économique. Face à cette dépolitisation, l’espoir qu’avait le CCI dans les années 80 -celui que ces luttes économiques, en particulier la confrontation avec les syndicats, pourrait devenir le creuset d’une repolitisation, peut-être même à un niveau supérieur - ne s’est pas réalisé. La réalité de cette faillite de la repolitisation a été reconnue (à partir de la fin des années 80) par notre analyse de la décomposition, laquelle définit la nouvelle phase comme étant sans perspective. Si l’on en croit la résolution, le combat prolétarien, malgré tous les problèmes qu’il affronte, s’est au départ développé correctement avant d’être stoppé dans son élan par un événement historique mondial qui apparaît lui être extérieur : l’effondrement du bloc de l’Est. Vu comme ça, le CCI aujourd’hui affirme que les effets les plus accablants de cet événement sont voués à disparaître avec le temps, permettant à la classe en quelque sorte de poursuivre son parcours antérieur, une saine politisation liée à ses luttes défensives. L’organisation affirme qu’en comparaison avec les années 80, le processus de politisation sera poussé en avant par l’approfondissement de la crise économique, qui dans un premier temps contraint les ouvriers à lutter et leur fait perdre leurs illusions, leur ouvrant les yeux sur la réalité du capitalisme.
Au contraire, à mon avis, la principale faiblesse, déjà présente dans les années 80, n’était pas le niveau des luttes économiques, mais les niveaux politique et théorique. Ce que l’organisation semble avoir oublié, c’est qu’un accroissement du militantisme ouvrier n’est pas nécessairement accompagné d’un développement en étendue et en profondeur de la conscience au sein du prolétariat. Le fait que c’est même le contraire qui pourrait être le cas est clairement illustré par l’évolution de la situation sociale avant la Seconde Guerre mondiale. Dans de nombreux pays d’Europe occidentale (comme la France, la Belgique, les Pays-Bas et surtout en Espagne), mais aussi par exemple en Pologne et (encore plus important) aux États-Unis, la combativité ouvrière était bien plus développée au cours des années 30 qu’au cours de la décennie précédente : les dix ans qui ont suivi la première vague de la révolution mondiale étaient centrés sur la Russie et l’Europe centrale. L’une des principales explications de ce développement paradoxal est simple. Elle se trouve dans la brutalité de la crise économique, de la Grande Dépression, laquelle après 1929 a contraint les ouvriers à se défendre. Et malgré cette activité militante, le cours historique tendait vers une Seconde Guerre mondiale, et pas vers une intensification de la lutte de classe. Face à la contre-révolution en URSS et à l’échec de la révolution en Allemagne et ailleurs en Europe centrale, la combativité des ouvriers a reculé à un niveau mondial. Loin de bloquer le cours à la guerre mondiale, il a même été possible pour la classe dominante d’utiliser cette activité militante à ses propres fins, en particulier à travers l’« anti-fascisme » (« arrêter Hitler ») et pour défendre la soi-disant patrie du socialisme en URSS. Même les grèves extrêmement importantes et massives en Italie au cours de la Seconde Guerre mondiale n’ont pas été capables de se sortir de ce piège politico-idéologique. En Irlande du Nord, par exemple, il y a eu de très grandes grèves au cours de la Seconde Guerre mondiale, souvent centrées précisément sur l’industrie d’armements, les ouvriers reconnaissant là le renforcement de ce que les syndicats appelaient leur « pouvoir de négociation » précisément grâce à la guerre, mais malheureusement sans affaiblir de quelque façon que ce soit l’ambiance patriotique belliqueuse qui a également submergé ces travailleurs. En ce sens, même si c’est un facteur indispensable, le militantisme ouvrier seul est insuffisant que ce soit pour développer la politisation ou pour juger si le combat prolétarien avance ou pas. Tout ceci est illustré non seulement par l’expérience des années 30 et 80, mais aussi par l’actuelle situation. Bien entendu, nous avons vu ces dernières années se dérouler d’importantes luttes ouvrières de résistance. Bien entendu, nous en verrons d’autres dans la période à venir. Bien entendu, il y a même de bonnes chances que cette activité militante s’accroisse, vu la dégradation des conditions de vie et de travail du prolétariat qui, dans beaucoup de secteurs, prend une tournure dramatique (les effets de la crise économique), vu également les meilleures conditions de « négociation » dans d’autres secteurs en raison d’un dramatique manque de travailleurs suffisamment qualifiés (les effets de l’anarchie capitaliste). Et, oui, il y a de nombreux exemples, qui plus est qualitativement très convaincants dans l’histoire démontrant que les ouvriers peuvent répondre aux attaques, non seulement par une grande combativité, mais par un développement correspondant de conscience de classe (de 1848 à 1989, et la vague révolutionnaire qui a débuté au cours de la Première Guerre mondiale fut dans une importante mesure une réaction à la misère économique et sociale). Mais qu’en est-il des perspectives à plus court terme de la politisation prolétarienne dans la situation concrète actuelle ? Que les années 60 et le début des années 70 aient vu à la fois une effervescence de combativité et de conscience de classe ne prouve pas que la même chose se produit aujourd’hui, l’exemple des années 30 ou celui des années 80 prouvant le contraire. Aujourd’hui, le CCI se rassure lui-même en disant que le prolétariat mondial n’est pas prêt à marcher vers une Troisième Guerre mondiale - ce qui est vrai. Mais à ce niveau, la situation ne fait que ressembler à celle de l’après-1968, lorsqu’une nouvelle génération de prolétaires est devenue l’obstacle majeur à une telle guerre. À ce moment, deux blocs impérialistes rivaux s’étaient préparés, étaient prêts et capables de déchaîner une Troisième Guerre mondiale. Il n’y a aujourd’hui aucune préparation de ce type de la part de la classe dominante. Non seulement parce que le prolétariat ne veut pas aller vers une telle guerre, mais parce que la bourgeoisie elle-même n’a pas l’intention de faire marcher qui que ce soit vers une nouvelle guerre mondiale. Le but de la bourgeoisie chinoise, par exemple, est comment surpasser les États-Unis en évitant une guerre mondiale, du fait que ces derniers disposent d’une énorme supériorité militaire et qu’ils la conserveront probablement pour quelque temps encore. Le but de la bourgeoisie américaine, par exemple, dans sa tentative d’arrêter l’émergence de la Chine, est de l’empêcher de former un bloc militaire (en particulier avec la Russie), lequel augmenterait la probabilité qu'elle ose finalement déclencher une Troisième Guerre mondiale. Ainsi nous voyons que, à la différence de la situation au cours de la Guerre froide, aujourd’hui personne ne planifie de guerre mondiale. Au contraire, les différents capitaux nationaux, pour la plus grande partie, développent différentes stratégies dont les buts sont tous d’accroître leur propre influence et position, tout en évitant une Troisième Guerre mondiale. Mais l’une des questions que les révolutionnaires doivent se poser est de savoir si tout cela rend une Troisième Guerre mondiale moins probable qu’elle ne l’était durant la Guerre froide. La réponse du CCI est aujourd’hui affirmative : nous sommes mêmes allés jusqu’à parler de l’improbabilité d’une telle catastrophe. Je ne partage pas du tout cette idée. Je considère même qu’elle est très dangereuse - avant tout pour l’organisation elle-même. Comme je le vois, le danger d’une Troisième Guerre mondiale est aujourd’hui aussi grand, si ce n’est plus grand, que pendant les deux dernières décennies de la Guerre froide. Ainsi, le principal danger est précisément que les différentes manœuvres stratégiques et tactiques militaires censées éviter une conflagration mondiale vont y conduire. Sous cet éclairage, la question pour le prolétariat d’être prêt à marcher vers la Guerre mondiale ne peut plus être posée comme lors de la Guerre froide (c’est pourquoi le 23e Congrès du CCI avait raison de conclure que le concept que nous appelons cours historique n’est plus valable dans la situation actuelle). On peut être d’accord, par exemple, pour dire que le prolétariat des États-Unis n’est pas aujourd’hui prêt à envahir la Chine. Mais ne serait-il pas possible pour la bourgeoisie des États-Unis dans la situation présente, de gagner le soutien de la population à des « actions militaires dures » contre la Chine, apparemment et ostensiblement sous le seuil de la guerre mondiale. Il est je pense bien plus difficile de répondre à cette question, et la situation est plus difficile aussi pour un prolétariat politique plus vulnérable. Mais c’est la question que nous pose la situation historique, et pas celle, abstraite, d’être hypothétiquement prêt à aller vers la guerre mondiale. Cette dernière peut avoir lieu même si aucun des principaux acteurs n’en a l’intention : la tendance vers la guerre est enracinée bien plus profondément dans l’essence du capitalisme que le niveau des impulsions conscientes ou inconscientes de la classe dominante, cette dernière n’étant qu’un des facteurs les plus importants, et très loin d’être le seul. Il est de la plus haute importance politique de dépasser toute approche schématique, unilatérale de faire de l’existence de blocs impérialistes une précondition des affrontements militaires entre grandes puissances dans la situation actuelle. Pas seulement parce que le noyau d’une alliance militaire de plus long terme contre la Chine a déjà été créé par les États-Unis et l’Australie, dont la partie intérieure est actuellement leur accord « AUKUS » avec la Grande-Bretagne, et la partie extérieure leur coopération appelée « QUAD » avec le Japon et l’Inde. Mais avant tout parce que cela mène à d’autres facteurs d’importance similaire ou plus grande, dont un est que les principaux rivaux impérialistes sont gonflés à la fois de ressentiment et de soif de revanche. Dans le cas de la Chine, c’est l’orgueil blessé d’une grande puissance qui se sent humiliée par ses anciens maîtres coloniaux, qu’elle considère comme l’Occident barbare ou le Japon. On voit à quel point ces facteurs sont importants grâce à la situation après la Première Guerre mondiale, par exemple, lorsque de nombreux marxistes, après la défaite subie par l’impérialisme allemand, pensaient que la prochaine guerre mondiale aurait lieu entre la Grande-Bretagne et les États-Unis, du fait qu’ils étaient les deux plus importantes des grandes puissances restantes. A l’opposé, au cours de la Première Guerre mondiale, Rosa Luxemburg avait déjà justement prédit que la constellation pour une Seconde Guerre mondiale se trouverait plutôt dans une sorte de continuation de la première, vu le degré de haine et l’envie de vengeance suscités par la première. Dans cette optique, il est hautement significatif que, ces dernières années, un ressentiment sorti des entrailles de la société bourgeoise soit en train d’engloutir les États-Unis, présentant une certaine ressemblance avec la haine instillée en Allemagne en conséquence de sa défaite au cours de la Première Guerre mondiale, et ce qui était ressenti comme « l’humiliation de Versailles » qui l’a suivie. L’exemple le plus frappant de ce phénomène aux États-Unis aujourd’hui est que, alors que l’Amérique, surtout depuis 1989, supporte le fardeau militaire et financier de la surveillance du globe, le reste du monde a saisi l’opportunité de poignarder son bienfaiteur dans le dos, en particulier au niveau économique, afin de supprimer des millions de « jobs américains ». Sur cette base a émergé une très vigoureuse « opinion publique » du rejet de « perdre des vies et des dollars américains » sous n’importe quel prétexte (que ce soit « aide humanitaire », « croisade démocratique » ou « construction d’une nation »). Derrière ce qui semble être une forte réaction anti-guerre, il y a malheureusement d’abord et avant tout bien sûr un virulent nationalisme américain, qui permet d’expliquer, non les retraits militaires d’abord de Syrie (sous Trump) puis d’Afghanistan (sous Biden) en soi, mais le caractère chaotique, de fuite en avant de ces évacuations : qui est capable de ramener au plus vite « nos gars et nos filles » de tels pays est devenu un important facteur de la furieuse lutte de pouvoir qui se développe au sein de la bourgeoisie américaine. Ce nationalisme représente un danger politique important pour le prolétariat des États-Unis du fait qu’il est capable de générer une importante force de gravité autour de belligérants aussi longtemps qu’il sera vu comme étant lui-même dirigé contre le « véritable » ennemi (non les Talibans, mais la Chine : celle qui est présentée comme la responsable de la destruction de l’industrie américaine). Rien de tout ceci ne signifie que le déchaînement des formes les plus destructrices de l’état de guerre capitaliste soit inévitable. Mais la tendance dans cette direction est inévitable, tant que le capitalisme poursuit son règne.
En ce qui concerne le rapport de force entre les classes, l’organisation a avancé que ma position est proche de celle du « modernisme ». Par modernisme, on entend, dans ce contexte, le souhait de remplacer la lutte des ouvriers par celle d’autres catégories (comme on l’a déjà postulé dans le passé, par exemple celle entre riches et pauvres, ou entre les donneurs d’ordre et les preneurs d’ordre) comme élément central dans la société bourgeoise moderne. Le terme « moderniste » a été utilisé par différents courants politiques de l’après-guerre pour se différencier de ce qu’ils considéraient être une conception révolue de la lutte ouvrière. D’un autre côté, il faut aussi noter que le rejet ou la sous-estimation des luttes ouvrières défensives est bien plus ancienne que le courant moderniste. Au XIXe siècle, les soutiens de Lassalle en Allemagne, par exemple, se prononçaient contre les grèves sur la base de la théorie lassallienne de la « loi d’airain des salaires », d’après laquelle aucune amélioration, même temporaire, de la condition ouvrière n’était possible par le biais des luttes salariales. Dans les années 1920, la Tendance d’Essen du groupe communiste de gauche KAPD, également en Allemagne, a commencé à rejeter la nécessité de la lutte ouvrière quotidienne avec l’argument que seule la révolution elle-même permet de défendre les intérêts de classe. On peut trouver beaucoup d’arguments différents, et même de tendances politiques qui remettent en question l’importance de la lutte ouvrière quotidienne, pas seulement le modernisme. Ce qu’elles ont toutes en commun, c’est la sous-estimation erronée et fatale du rôle de la lutte ouvrière quotidienne. Pour ma part, je ne partage ni les conceptions modernistes, ni celle de Lassalle ou de la Tendance d’Essen. Au contraire, je suis d’accord avec le reste du CCI sur l’importance de la dimension défensive de la lutte ouvrière. La divergence dans le CCI n’est pas de savoir si ces luttes sont importantes. Elle est de savoir quel rôle elles peuvent et doivent jouer dans une situation historique donnée. Nécessairement, une telle discussion doit se confronter, non seulement avec le potentiel de ces luttes, mais aussi avec leurs possibles limitations. La situation historique actuelle est caractérisée par le fait que le prolétariat mondial a perdu confiance dans sa boussole révolutionnaire et dans son identité de classe. Trouver une issue à ce dilemme est clairement la tâche centrale du prolétariat révolutionnaire aujourd’hui. Face à cette situation, le CCI se pose la question : quelles forces matérielles peuvent de façon réaliste montrer le chemin ? La réponse de l’organisation donnée aujourd’hui par l’organisation est que, avant tout, la lutte de classe quotidienne garde tout son potentiel. Cette réponse contient une part importante de vérité. Même si le monde entier en venait à partager l’idée que la lutte de classe prolétarienne est une chose du passé, non seulement elle est encore très vivante, mais elle est même indestructible tant que le capitalisme existe. Le CCI, néanmoins, a absolument raison de garder sa confiance dans la dynamique des antagonismes de classe, en contradiction avec le mode de production bourgeois, dans la souffrance du prolétariat causée par la crise capitaliste, dans la résilience de la réponse prolétarienne, tout ceci venant démontrer que nous vivons toujours dans une société de classes, dont les contradictions ne peuvent être résolues que par le dépassement du capitalisme par le prolétariat. Pour ma part, je ne critique pas du tout cette position. Ce que je critique est son caractère unilatéral, la sous-estimation de la dimension théorique de la lutte ouvrière. Sans la lutte de classe quotidienne, il n’y aura ni perspective communiste, ni identité de classe prolétarienne. Ceci étant dit, ni la perspective communiste, ni l’identité de classe ne sont le produit DIRECT de la lutte ouvrière immédiate. Ils en sont le produit indirect, en particulier si l’on prend en compte leur dimension théorique. La lutte de classe prolétarienne n’est pas une révolte plus ou moins aveugle, pas plus qu’elle ne réagit de façon simplement mécanique à la dégradation de sa situation, comme les chiens du professeur Pavlov. L’abstraction des relations capitalistes contraint le prolétariat à suivre le chemin indirect de la théorie afin d’être capable de comprendre et de dépasser la domination de classe. Non seulement la perspective du communisme, mais aussi l’identité de classe prolétarienne ont une dimension théorique essentielle que même les plus importants mouvements économiques et politiques, jusqu’à et y compris la grève de masse, peuvent accroître, mais ne pourront jamais remplacer. Forger à la fois une perspective révolutionnaire et une identité de classe adéquate est impossible sans l’arme du marxisme. C’était moins le cas au tout début du mouvement ouvrier parce que le capitalisme et la classe bourgeoise n’étaient pas encore complètement développés, la révolution prolétarienne n’était pas encore « à l’agenda de l’histoire ». Dans de telles conditions immatures, des versions du socialisme plus ou moins utopiques et/ou sectaires aidaient quand même la classe ouvrière à développer sa conscience révolutionnaire et une identité de classe propre. Dans les conditions du capitalisme d’État totalitaire décadent, ce n’est plus possible : les différentes versions non-marxistes de « l’anti-capitalisme » sont incapables de mettre le capitalisme en question, piégées qu’elles sont par leur propre logique. Mon insistance sur le caractère indispensable de cette dimension théorique a été mal comprise par l’organisation, comme une manifestation de dédain envers la lutte ouvrière quotidienne. La critique portée à mon encontre que je défendrais une conception « substitutionniste » de la lutte de classe est peut-être encore plus significative. Par « substitution », il est signifié que je défendrais soi-disant l’idée que le travail théorique de quelques centaines de Communistes de gauche (dans un monde occupé par plus de sept milliards d’habitants) peut, en lui-même, être une contribution essentielle pour retourner la tendance en faveur du prolétariat. Je pense en effet que le travail théorique est essentiel pour retourner la tendance. Mais ce travail doit être accompli, pas uniquement par quelques centaines de militants communistes seuls, mais par des millions de prolétaires. Le travail théorique est la tâche, non des révolutionnaires seuls, mais de la classe ouvrière comme un tout. Étant donné que le processus de développement du prolétariat est inégal, il est de la responsabilité particulière des couches les plus politisées du prolétariat de l’assumer ; des minorités, donc, oui, mais cela comprend potentiellement des millions d’ouvriers qui, loin de se substituer eux-mêmes à l’ensemble, pousseront pour impulser et stimuler plus avant les autres. Pour leur part, les révolutionnaires ont la tâche spécifique d’orienter et d’enrichir cette réflexion qui doit être accomplie par des millions. Cette responsabilité des révolutionnaires est au pire au moins aussi importante que celle d’intervenir dans des mouvements de grève, par exemple. Cependant, l’organisation a peut-être oublié que les masses prolétariennes sont capables de participer à ce travail de réflexion théorique. Cet oubli, il me semble, exprime une perte de confiance dans la capacité du prolétariat de trouver une voie de sortie de l’impasse où le capitalisme a piégé l’humanité. Cette perte de confiance s’exprime elle-même dans le rejet de toute idée que le prolétariat a subi des défaites politiques importantes au cours des décennies qui ont suivi 1968. Faute de cette confiance, nous finissons par minimiser l’importance de ces très graves revers politiques, en nous consolant avec les luttes défensives quotidiennes, vues comme le principal creuset de la voie à suivre, ce qui est à mes yeux une concession significative à une approche « économiciste » de la lutte de classe déjà critiquée par Lénine et Rosa Luxemburg au début du XXe siècle. La compréhension que le « prolétariat n’est pas vaincu », qui donnait une vision correcte et très importante dans les années 70 et 80, est devenue un article de foi, un dogme creux, qui empêche toute analyse sérieuse, scientifique du rapport de force. Dans un amendement au point 35, concernant le retour à la conscience en relation avec la question de la guerre, j’ai proposé l’ajout suivant (rejeté par le Congrès) : « Récemment, cependant, la situation a commencé à changer. Depuis que la rivalité États-Unis/Chine est devenue le principal antagonisme de l’impérialisme mondial, la possibilité s’ouvre que, à un moment dans le futur, le prolétariat commence à comprendre le caractère inexorable de l’impérialisme dans le capitalisme. Si la crise économique et la guerre ensemble peuvent, dans des circonstances favorables, contribuer à une politisation révolutionnaire, il est raisonnable de supposer que la combinaison des deux facteurs peut être plus efficace même que chacun d’entre eux seul. » La Commission d’Amendement du Congrès a écrit, pour s’expliquer, que « L’idée doit être rejetée, elle ne prend pas en compte que la bourgeoisie ne peut pas déclencher la guerre. »
Steinklopfer
Rubrique:
La révolution internationale n'a rien à voir avec les méthodes de la bourgeoisie et ses organisations d'extrême gauche!
- 182 lectures

Le 1er mai dernier, le journal Le Monde a publié sur son site internet, dans la rubrique « Direct », la photographie reproduite ci-dessus, qui a été prise lors de la manifestation de Nantes, où des manifestants aident à dresser une banderole représentant différents personnages : un manifestant antiraciste de Black Lives Matter, un combattant kurde armé d’une kalachnikov, et des membres de black blocs anarchistes. Ces personnages sont censés personnifier la « Révolution internationale » !
La publication d’un slogan similaire au nom de la section du CCI en France, Révolution Internationale, n’a rien d’anodin. Cet amalgame permet à la presse bourgeoise d’assimiler la lutte révolutionnaire de la classe ouvrière, et donc ses organisations révolutionnaires, à des éléments gauchistes et petits bourgeois, notamment les « casseurs » et les black blocs, dont les méthodes de violence aveugle et nihiliste n’ont absolument rien à voir avec la lutte révolutionnaire de la classe ouvrière. Nous le disons très clairement : ce n’est pas notre bannière !
Ce type d’amalgame ou d’assimilation, par lequel les organisations de la classe ouvrière sont frauduleusement assimilées à des groupes qui pratiquent le banditisme, la lutte armée ou le terrorisme, vise purement et simplement à criminaliser les organisations de la classe ouvrière comme le CCI, afin de mieux préparer et justifier la répression que l’État bourgeois leur infligera au moment qu’il choisira.
CCI
Récent et en cours:
- Black blocs [499]
Courants politiques:
- Gauchisme [461]
Questions théoriques:
- Terrorisme [206]
Rubrique:
La Gauche communiste sur la guerre en Ukraine
- 279 lectures
Introduction du CCI
Nous publions ci-après un échange de courriers principalement entre les groupes de la Gauche communiste, depuis la première proposition d’écrire, de finaliser et de publier une Déclaration commune.
La correspondance au sein du mouvement marxiste a toujours été un aspect important de son développement et de son intervention dans la classe ouvrière. La Gauche communiste a poursuivi cette tradition. La correspondance ci-dessous est particulièrement significative parce qu’elle montre le processus de contact et de discussion entre les groupes constituant la Gauche communiste au sujet des principes et procédures permettant la mise en place d’une action commune comme la Déclaration commune sur la guerre en Ukraine.
Le fait que beaucoup de cette correspondance concerne le CCI et la Tendance Communiste Internationaliste (TCI) au sujet du refus de cette dernière de participer et de signer la Déclaration commune devrait aider les lecteurs à comprendre les arguments contradictoires concernant la motivation de cette Déclaration, les critères d’inclusion de groupes dans la Déclaration, la question de savoir comment aborder les différentes analyses de la situation impérialiste dans la Déclaration, et d’autres questions. Bien que la TCI ait mis fin à cet aspect de la correspondance, les questions vitales contenues dedans restent à clarifier et à débattre. (1)
Nous avons également inclus à la fin la correspondance avec deux groupes n’appartenant pas à la tradition de la Gauche communiste : le KRAS, un groupe anarcho-syndicaliste russe, et Perspective Communiste Internationaliste, un groupe coréen. Nous leurs avons demandé de soutenir la Déclaration commune du fait de leur rejet internationaliste de la guerre en Ukraine.
Par ailleurs, la correspondance est présentée dans l’ordre chronologique.
Le CCI aux groupes du Milieu Politique Prolétarien, 25/02/2022
Le CCI à :
– La TCI,
– Parti Communiste International (Programma Comunista)
– Parti Communiste International (Il Comunista)
– Istituto Onorato Damen
– Internationalist Voice
– Fil Rouge
Camarades,
La guerre impérialiste frappe à nouveau l’Europe à une échelle massive. Une fois de plus la guerre en Ukraine nous rappelle dramatiquement la véritable nature du capitalisme, un système dont les contradictions mènent inévitablement à des confrontations militaires et des massacres de populations, particulièrement des exploités. Depuis le début du XXe siècle, les organisations politiques du prolétariat ont, au-delà de leurs divergences, uni leurs forces pour dénoncer la guerre impérialiste et appeler le prolétariat de tous les pays à s’engager dans la bataille pour dépasser le système qui la génère, le capitalisme. Les Congrès de Stuttgart en 1907, de Bâle en 1912, les conférences de Zimmerwald en 1915 et Kienthal en 1916 ont ouvert la voie menant à la révolution communiste d’octobre 1917 en Russie et à la fin du carnage impérialiste.
Au cours des années 30 et du second carnage impérialiste mondial, c’est tout à l’honneur de la Gauche communiste d’avoir fermement brandi la bannière de l’internationalisme prolétarien face à ceux qui appelaient les prolétaires à se battre entre eux au nom de l’« anti-fascisme », la « défense de la démocratie » ou la « défense de la patrie du socialisme ». Aujourd’hui, il est de la responsabilité de ces groupes qui proclament appartenir à cette Gauche communiste de défendre fermement l’internationalisme prolétarien, et en particulier :
– de dénoncer les mensonges de tous les secteurs nationalistes de la classe dominante afin d’enrôler les prolétaires dans la guerre impérialiste, ou de les associer dans leurs politiques impérialistes en les appelant à prendre parti pour un camp impérialiste ou l’autre ;
– d’appeler les prolétaires du monde entier à refuser tous les sacrifices que la classe dominante et ses États veulent lui imposer, de mener la lutte de classe contre ce système qui les exploite férocement et voudrait en faire de la chair à canon ;
– de rappeler l’importance et l’actualité des vieux slogans du mouvement ouvrier : « les prolétaires n’ont pas de patrie ! » « Prolétaires de tous les pays, unissez-vous ! »
Nous sommes convaincus que votre organisation, comme nous, ne faillira pas à assumer sa responsabilité internationaliste face à l’actuelle guerre. Cependant, le CCI pense que l’affirmation de l’internationalisme aurait un impact plus important si les positions prises par chacun s’adossaient à une prise de position commune à nos organisations, basée sur les positions fondamentales que nous partageons tous. Nous vous appelons donc à accepter notre proposition et, si vous y êtes favorables, à contacter notre organisation aussi rapidement que possible afin de préparer cette prise de position commune.
Recevez, camarades, nos saluts communistes et internationalistes.
Il Programma au CCI, 01/03/2022
Chers amis,
Il n’est pas aujourd’hui temps de discuter, mais de mettre en pratique les directives inchangées et immuables de la préparation révolutionnaire : le travail pour préparer le défaitisme révolutionnaire, pour détacher la classe prolétarienne de l’hégémonie bourgeoise et petite-bourgeoise et, en perspective, de transformer la guerre impérialiste en guerre civile.
Sincèrement vôtres,
Programme Communiste
TCI au CCI, 02/03/2022
Camarades,
Nous avons discuté votre proposition. Personne ne peut être en désaccord avec la volonté des organisations de la Gauche communiste de répondre au nouveau et toujours plus dangereux cours qu’a maintenant pris le monde impérialiste, et nous y avons déjà nous-mêmes répondu de diverses manières.
Nous ne sommes pas non plus en désaccord avec votre vision des positions prolétariennes de base.
« - de dénoncer les mensonges de tous les secteurs nationalistes de la classe dominante afin d’enrôler les prolétaires dans la guerre impérialiste, ou de les associer dans leurs politiques impérialistes en les appelant à prendre parti pour un camp impérialiste ou l’autre ;
– d’appeler les prolétaires du monde entier à refuser tous les sacrifices que la classe dominante et ses États veulent lui imposer, de mener la lutte de classe contre ce système qui les exploite férocement et voudrait en faire de la chair à canon ;
– de rappeler l’importance et l’actualité des vieux slogans du mouvement ouvrier : « les prolétaires n’ont pas de patrie ! » « Prolétaires de tous les pays, unissez-vous ! »
Cependant, nous devons chercher à aller plus loin que ces points importants de propagande. Par le passé, nous avons toujours constaté que nos perspectives entièrement différentes rendaient impossible toute déclaration commune, et ce phénomène s’est accentué au fil du temps. Par conséquent, bien que nous ne soyons pas par principe opposés à une forme quelconque de prise de position commune, nous nous trouverons face au même vieux problème. La question est : où en êtes-vous aujourd’hui sur ces perspectives ? Est-ce qu’elles nous permettront de produire un document significatif pouvant constituer un guide pour l’action ? Notre seconde question est : à qui d’autre avez-vous proposé cette initiative conjointe ? Nous savons que tous les partis bordiguistes non seulement la refuseront, mais prendront plaisir à nous répéter qu’ils sont LE parti. Et cela peut vouloir dire qu’il est ainsi nécessaire de voir au-delà de la « Gauche communiste » (qui malgré notre récent accroissement reste malheureusement petite), mais vers ceux qui partagent notre perspective de classe, sinon notre politique précise. Le slogan de « No War But the Class War », non seulement pose cette question pour d’autres groupes politique, mais les tire en avant vers la perspective de la Gauche communiste. Plus important, c’est un appel au combat pour la classe ouvrière dans son ensemble, liant comme elle le fait la lutte contre les attaques quotidiennes du capitalisme avec l’épouvantable futur que le capitalisme nous prépare. Un futur qui semble maintenant plus proche que jamais.
Nous avons fait circuler l’annonce de réunion parmi tous les camarades.
Saluts internationalistes
Le Bureau International de la TCI
Réponse d’Internationalist Voice, 03/03/2022
Chers camarades !
Nous saluons votre initiative de faire une déclaration commune sur la guerre et sommes d’accord avec vous qu’une déclaration commune aurait un impact plus important. Cependant, un point essentiel pour nous est de savoir qui a reçu cette lettre, et nous pouvons vous croire que seuls des révolutionnaires l’ont reçu.
Une déclaration a déjà été publiée ; voir en annexe, et la version anglaise sera bientôt disponible.
Saluts internationalistes,
Internationalist Voice
Lettre de l’Institut Onorato Damen, 03/03/2022
Camarades,
Nous saluons votre proposition.
Nous pensons, comme vous, que les communistes internationalistes du monde entier ont la responsabilité de clarifier les causes de la guerre impérialiste et de prendre position sur la guerre.
Notre organisation croit que la perspective politique communiste, basée sur l’internationalisme prolétarien, le défaitisme révolutionnaire et le rejet de tous les camps impérialistes, représente de plus en plus la seule réponse possible de la classe ouvrière au carnage impérialiste et à la barbarie capitaliste. C’est la seule possibilité de futur pour l’humanité, dans une société qui sera finalement humaine : la société communiste.
Nous saluons l’idée que les révolutionnaires, au-delà des divergences entre organisations, doivent être unis pour dénoncer la guerre impérialiste et soutenir le prolétariat mondial dans la perspective d’une révolution communiste internationale.
Notre organisation est ainsi d’accord pour préparer une déclaration commune, soutenue par différents groupes communistes révolutionnaires internationalistes, en plus des prises de positions et analyse que chaque organisation publiera indépendamment.
Cela devrait représenter une voix internationaliste plus forte ; nous pensons également que cela pourrait représenter un pas en avant sur la route de la confrontation franche et fraternelle entre communistes, dans la perspective de construire le futur Parti communiste mondial, sur la base de la clarté programmatique.
En ce qui concerne comment préparer cette déclaration commune, nous suggérons que le CCI prépare une proposition sur la façon de travailler ensemble.
Avec nos saluts communistes fraternels,
IOD
Le CCI au Milieu Politique Prolétarien concernant l’appel, 13/03/2022
Le CCI à :
Tendance Communiste Internationaliste
PCI (Programma Comunista)
PCI (Il Comunista)
PCI (Il Partito Comunista)
Institut Onorato Damen
Internationalist Voice
PCI (Le Prolétaire)
Chers camarades,
Nous écrivons suite à notre lettre du 25 février 2022 proposant une prise de position publique commune sur les principes internationalistes fondamentaux contre la guerre en Ukraine partagés par la tradition de la Gauche communiste dans son ensemble. Nous avons reçu un soutien positif à notre proposition de la part de l’Institut Onorato Damen et d’Internationalist Voice. La Tendance Communiste Internationaliste a également répondu positivement aux principes généraux que nous avions proposé pour la déclaration, mais a quelques questions concernant l’analyse de la situation, les groupes invités et la possibilité de mener d’autres initiatives communes. Le PCI (Programma) a fait une courte réponse rejetant notre proposition, en disant que « c’est le temps d’agir, pas de parler ». Les autres groupes invités n’ont pour l’instant pas répondu.
La principale tâche de la Gauche communiste aujourd’hui est de parler d’une voix unitaire des principes internationalistes fondamentaux de notre tradition en ce qui concerne la nature impérialiste de la guerre, la dénonciation des illusions pacifistes et la perspective alternative de la lutte de la classe ouvrière menant au dépassement du capitalisme. Nous devons défendre la seule tradition politique qui a maintenu ces principes à l’épreuve du feu dans le passé.
À notre avis, la fonction de cette prise de position n’est par conséquent pas d’aller en profondeur dans l’analyse de la situation, sur laquelle il y a sans doute des divergences d’appréciations entre les organisations se réclamant de la Gauche communiste ; nous ne pensons pas non plus que la déclaration soit le lieu pour aborder la question d’autres initiatives communes. Une prise de position commune par les groupes de la Gauche communiste ne serait en aucun cas un obstacle pour discuter des divergences et approches alternatives dans d’autres contextes.
Les camarades d’IOD ont suggéré que le CCI rédige la déclaration commune. Afin d’accélérer le processus, nous avons accepté cette suggestion et le projet d’appel est mis en lien avec cette lettre. Nous avons essayé de présenter les principes internationalistes d’une façon que tous les signataires peuvent accepter. Cependant, toute proposition des camarades de formulation alternative à celles du texte est bienvenue afin de réaliser l’objectif commun de la déclaration. Mais nous espérons que les camarades, considérant que le temps est compté, se limiteront d’eux-mêmes aux modifications qu’ils considèreront essentielles pour remplir l’objectif commun, pour qu’une version définitive soit rapidement produite.
Nous sommes confiants que la déclaration commune de la Gauche communiste permettra aujourd’hui de faire connaître plus largement ces principes et cette tradition au sein de la classe ouvrière.
Nous attendons une réponse rapide de votre part.
Saluts communistes,
Le CCI
La TCI au CCI, 21/03/2022
Sur la proposition de déclaration commune sur la guerre en Ukraine
Camarades,
Merci de l’envoi du projet d’appel et de nous avoir informés qui en serait signataire. De façon regrettable, nous devons vous dire que nous ne pouvons être d’accord.
Le projet proposé contient plusieurs lacunes (ainsi que des erreurs factuelles que nous laisserons de côté pour l’instant) et n’est pas adéquat en tant que guide politique pour montrer à la classe ouvrière comment lutter contre la guerre. En premier lieu il ne s’intéresse pas à la signification réelle de cette guerre en ce moment particulier. Il lui manque également une analyse cohérente de ce qui se passe actuellement. En tant que tel, il ne propose aucune perspective. C’est une pure déclaration de papier et nous avons besoin d’offrir plus que cela. Comme Lénine l’a dit il y a longtemps, « sans théorie révolutionnaire, pas de pratique révolutionnaire ».
Un exemple de cette faiblesse est le fait que ce projet de déclaration fait référence au fait que « la classe ouvrière mondiale ne peut que développer sa lutte contre la dégradation des salaires et des conditions de vie », mais ne dit pas comment, alors que depuis des décennies c’est le contraire, la lutte de classe doit maintenant revivre. Ce qui lie l’actuelle guerre et les attaques continues sur les conditions de vie des ouvriers, c’est la crise économique capitaliste qui après 50 ans reste insoluble. Cette guerre est une nouvelle et claire indication que les options strictement économiques s’épuisent pour le capitalisme, et le monde est bien plutôt engagé sur la route inter-impérialiste de l’ultime « solution ». Il n’est pas question dans le projet d’un nouveau et dangereux départ dans l’histoire du capitalisme (confirmé, par exemple, par l’absence de toute référence à la Chine et au fait que la guerre en Ukraine a permis de définir un alignement impérialiste plus clair à un niveau général).
Cette intemporalité abstraite face à une réalité qui émerge est renforcée par de longs passages sur l’histoire de la Gauche communiste. Aussi inattaquables que soient les détails, nous ne vivons pas dans le même monde que nos prédécesseurs, et ce document transpire le sentiment d’avoir été écrit pour « le milieu » comme vous l’appelez. La Gauche communiste peut avoir une histoire fondée sur des principes d’opposition à la guerre dont nous pouvons être fiers, mais comme la déclaration l’admet à la fin, nous n’avons que peu d’influence sur la classe aujourd’hui. Dans notre situation actuelle d’obscurité politique, pensez-vous qu’annoncer que : « aujourd’hui, face à l’accélération du conflit impérialiste en Europe, les organisations de la Gauche communiste ont le devoir de lever la bannière de l’internationalisme prolétarien conséquent, et de fournir un point de référence pour tous ceux qui cherchent les principes de la classe ouvrière » soit à même d’étendre notre influence ? Nous ne vivons plus à l’époque de la Seconde ou de la Troisième Internationale lorsqu’il y avait une masse qui suivait, ce qui s’est terminé par des ouvriers trahis et a mené à la guerre impérialiste. Notre tâche n’est pas de réagir aux trahisons historiques des Internationales supposément ouvrières, mais de continuer à poser les bases d’une nouvelle Internationale. Nous avons la tâche bien plus difficile de reconstruire de zéro.
Ce qui nous amène à votre liste de potentiels signataires. Elle est vraiment courte, et même plus courte encore qu’elle le paraît, du fait que nous savons tous que chaque parti « bordiguiste » se considère lui-même comme le seul parti international possible. Vous ne développez pas pourquoi cette sélection est aussi étroite parmi les groupes de la Gauche communiste, mais sur votre site Internet nous pouvons le trouver.
« Controverses, GIGC, Perspective Internationaliste, Matériaux Critiques et quelques autres appartiennent au milieu parasite et n’ont rien à voir avec l’internationalisme prolétarien, même s’ils écrivent dessus et même s’ils mettent exactement la même position en avant. Leur activité est caractérisée par le sabotage des activités communistes et se trouve sur le chemin de toute possibilité d’action unitaire de l’authentique Gauche communiste. Les groupes qui appartiennent à la Gauche communiste sont Il Partito Comunista, Il Programma Comunista, l’Institut Onorato Damen, Programme Communiste, la Tendance Communiste Internationaliste et Internationalist Voice. » Donc ce que vous nous demandez est de signer votre propre définition de qui est ou n’est pas dans la Gauche communiste, et en plus, votre idée ancienne que toute organisation formée par ceux qui ont quitté le CCI doivent être coupable de « parasitisme ». Nous avons depuis longtemps critiqué cette étiquette destructrice. Nous avons également critiqué ces groupes à l’occasion, mais toujours dans des termes politiques dans un but de clarification, pas avec une étiquette visant à détruire leur droit à l’existence.
Dans tous les cas, votre proposition est trop étroite. Même si nous étions d’accord sur qui fait partie de la Gauche communiste, nous n’avons pas le monopole de la vérité sur le sujet. L’influence des idées internationalistes (souvent comme résultat de tous nos efforts passés pour promouvoir l’internationalisme) a pénétré des organisations politiques venant de différentes traditions. Dans cette situation, nous devrions tenter de les tirer vers un mouvement plus vaste contre la guerre.
D’une certaine façon le débat est une répétition de celui que le CCI a mené en Grande-Bretagne avec la CWO sur la promotion de No War But the Class War en tant que corps organisé de résistance de classe à la guerre. En effet, à l’époque nous étions tout aussi critiques de votre approche étroite que nous le sommes maintenant. La CWO écrivait alors que nous reconnaissions : « l’absolue faiblesse des forces communistes dans le monde et notamment en Grande-Bretagne. À l’inverse du CCI, nous ne nous gonflons pas nous-mêmes par des auto-descriptions d’un mouvement international qui a survécu plus longtemps qu’aucune des trois Internationales dans l’histoire du mouvement ouvrier. Nous reconnaissons notre tâche centrale de sauvegarder et de développer la théorie et la pratique communistes mais c’est une tâche impossible si nous restons isolés et introvertis.
Les communistes ne peuvent se défendre et enrichir leur programme et leur organisation qu’en interagissant avec la réalité sociale. Nous devons reconnaître l’actualité du développement des forces, et développer la théorie et la pratique en fonction de ce développement. Cela s’applique à la fois aux développements sous-jacents dans l’économie mondiale et ces éléments qui sont pris dans toutes sortes de mouvements sociaux et sont réceptifs au programme communiste ». (voir https://www.leftcom.org/en/articles/2002-12-01/communism-against-the-war… [500]
Aujourd’hui, la TCI voit la promotion de cette forme d’organisation à un niveau international comme le meilleur moyen de contribuer à un véritable mouvement de classe contre les guerres que ce système produit inévitablement. Et comme nous l’avons dit auparavant, il n’est pas suffisant de faire des déclarations de papier (même si elles sont un début nécessaire), nous devons trouver des moyens de toucher l’ensemble de la classe ouvrière, et certainement de nous engager avec ses éléments les plus concernés. Il ne reste pas beaucoup de temps et, vu les quatre décennies de recul de la classe, il y a d’énormes défis à affronter. Une nouvelle génération vient vers la Gauche communiste au fur et à mesure que la crise monte et nous devons lui donner quelque chose qu’elle peut utiliser pour construire un véritable mouvement. Cela signifie que nous avons besoin de quelque chose de plus clair et concret que la proposition que vous mettez aujourd’hui en avant.
Saluts internationalistes
Le Bureau International de la Tendance Communiste Internationaliste
Le CCI à la TCI, 22/04/2022
Chers camarades,
Le CCI est d’accord avec les principes internationalistes fondamentaux contenus dans l’appel de No War but the Class War sur la guerre en Ukraine. Puisqu’il est demandé à ceux qui sont globalement d’accord de répondre à l’appel, nous voudrions souligner notre soutien avec les principes de la Gauche communiste qu’il contient :
– la guerre en Ukraine est de nature entièrement impérialiste et aucunement une guerre de défense nationale. La classe ouvrière ne doit pas soutenir quelque camp que ce soit dans ce carnage dont elle est la principale victime ;
– la présente période de guerres impérialistes du capitalisme, matérialisée par la guerre en Ukraine, nous rapproche de l’extinction de l’humanité ;
– seul le dépassement du capitalisme peut mettre fin aux guerres impérialistes. Les illusions pacifistes en un capitalisme paisible masquent que la perspective révolutionnaire de la classe ouvrière est la seule solution face à l’impérialisme ;
– la route vers la révolution prolétarienne ne peut être basée que sur la lutte de la classe ouvrière pour défendre ses conditions de vie (et contre les syndicats comme vous le soulignez), et l’engagement dans le processus qui mène à la formation du parti politique international de la classe ouvrière. Ce processus exclut nécessairement les traditions contre-révolutionnaires sociale-démocrate, stalinienne et trotskyste.
Après avoir affirmé notre accord fondamental sur ces questions, il y a un problème lié à l’appel de la TCI qu’il est important de clarifier : vu l’accord étroit sur la question des principes internationalistes exprimé dans l’appel de la TCI, il était parfaitement possible pour elle de signer la Déclaration commune des groupes de la Gauche communiste (publiée sur les sites des signataires), qui était basée sur ces véritables principes et laisser de côté les désaccords secondaires entre les groupes. La Déclaration commune, du point de vue des principes internationalistes, pourrait être signée par la TCI, même si votre organisation trouve qu’elle est en elle-même insuffisante pour la lutte contre la guerre impérialiste (nous reviendrons en détail sur les raisons que vous mentionnez dans votre lettre de refuser de signer cette Déclaration).
Peut-être pensez-vous qu’il n’est pas approprié de se référer dans un tel appel à l’expérience et à la tradition du mouvement ouvrier depuis la Conférence de Zimmerwald, et en particulier à la tradition de la Gauche communiste. Si tel est le cas, pourriez-vous nous dire pourquoi ? Si, au contraire, vous considérez valide cette préoccupation d’y inscrire la position des internationalistes sur la guerre en Ukraine en continuité avec celle de nos prédécesseurs, nous ne voyons pas, sur la base des positions internationalistes claires que nous partageons, pourquoi vous ne pourriez pas soutenir la Déclaration commune des groupes de la Gauche communiste.
Peut-être la proposition originelle d’une Déclaration conjointe que nous vous avons envoyée était-elle insuffisamment claire sur le point qu’elle ne cherche pas à être une initiative exclusive contre la guerre impérialiste. Comme les comités NWCW que vous proposez dans votre appel par exemple, les signataires peuvent avoir d’autres activités avec lesquelles les autres signataires ne sont pas d’accord, ou dont les modalités et objectifs ne leur sont pas clairs.
Les signataires pouvaient également être en désaccord sur leur analyse de la situation mondiale, mais ils étaient néanmoins d’accord sur le fait que le capitalisme n’a d’autre alternative que de sombrer dans la barbarie.
Mais un important besoin dans la situation est de faire une Déclaration commune et donc d’affirmer plus fortement l’internationalisme de la Gauche communiste. Bien entendu, ces principes communs pourraient être reformulés ou renforcés par rapport au projet proposé (comme ils ont été discutés avec IOD), et les critères pour les groupes signant la Déclaration pourraient être discutés.
Nous vous demandons donc de reconsidérer votre refus de signer la Déclaration Commune.
En ce moment, l’appel rendu public de la TCI apparaît comme une mise en concurrence avec la Déclaration commune, et ceux qui s’approchent des positions internationalistes de classe de la Gauche communiste seront confrontés à deux « unités » d’appels face à la guerre, séparées et rivales.
Pouvons-nous être d’accord au moins sur un point : que cette situation ambiguë est une faiblesse de tout le camp internationaliste ?
Nous allons examiner vos suggestions pour essayer de résoudre ce problème.
Saluts communistes,
Le CCI
La TCI au CCI, 24/04/2022
Camarades,
Si vous êtes réellement sérieux dans votre tentative de nous persuader de signer votre déclaration, vous n’êtes pas sur la bonne voie.
En premier lieu, vous n’abordez pas le point principal de notre décision de refuser de signer le document qui est que nous n’acceptons pas votre définition étroite de qui peut le faire et qui ne le peut pas au sein du « milieu ». Nous n’avons jamais été d’accord avec votre idée de « parasitisme » et nous ne souhaitons pas même implicitement l’approuver.
Nous notons également que vous acceptez les principes de l’appel de NWCW, mais le but de NWCW n’est pas simplement de s’adresser à la Gauche communiste, mais de rassembler de façon pratique tous ceux et toutes les organisations réellement internationalistes et contre la guerre impérialiste. Nous approchons d’un point critique dans l’histoire mondiale où le système capitaliste a pris un tournant décisif vers des conflits nouveaux et plus larges. Prendre position en se basant sur les positions internationalistes est un point de départ nécessaire, mais le but est d’aller plus loin que la simple affirmation des principes. Nous avons besoin de créer un mouvement au sein de la classe ouvrière la plus large qui prépare la voie pour une réponse politique aux horreurs que le système impose déjà à certains ouvriers et qu’il imposera finalement à tous. Nous notons que la version de la déclaration que vous nous avez demandé de signer n’est pas la version actuellement sur votre site Internet. Nous avons mis en ligne cette version avec les signatures des autres organisations le 6 avril. Aujourd’hui la version sur votre site a été modifiée. Sans la phrase que nous avions critiquée dans notre précédente réponse qui stipulait que : « seules les organisations de la Gauche communiste ont le droit de lever la bannière de l’internationalisme prolétarien conséquent. »
La phrase qui stipulait que : « le combat continu, conscient de la classe ouvrière contre l’austérité qui s’accroît du fait de la guerre impérialiste est donc aujourd’hui le seule obstacle sérieux à l’accélération du militarisme » a également été supprimée.
Il n’y a eu aucune confirmation de cela, et nous ne savons pas si les groupes qui ont signé la déclaration le 6 avril ont été consultés sur ces modifications. Il est difficile d’avoir un dialogue sérieux si les conditions du débat ne cessent de changer.
Dans tous les cas, notre position sur la signature de la « déclaration commune » reste la même.
Saluts internationalistes,
La TCI
Le CCI à la TCI, 29/04/2022
Chers camarades,
Merci pour votre réponse du 24 avril. Nous regrettons que vous refusiez toujours de signer la Déclaration commune de la Gauche communiste sur la guerre en Ukraine.
Vous remarquez que la version finale de la Déclaration commune de la Gauche communiste n’est pas tout-à-fait la même que le projet que nous vous avons envoyé le 13 mars à vous et à d’autres groupes pour approbation. Dans cette dernière correspondance, nous avons demandé aux groupes de la Gauche communiste des commentaires et des formulations alternatives au projet, il est donc tout à fait normal et logique que ces discussions aient amené des modifications du projet avec les co-signataires, afin d’être d’accord sur une version finale de la Déclaration. Évidemment, les co-signataires ont été consultés et la version finale modifiée est le résultat d’une discussion commune. Vous auriez pu participer à ce processus d’amendements communs mais vous vous êtes prononcés contre l’idée d’une déclaration conjointe dans la lettre que vous nous avez envoyée le 21 mars (au passage, nous notons que le premier appel de No War but the Class War daté du 6 avril sur le site web de la TCI comportait douze points d’accord, tandis que le second du 23 avril n’en a plus que cinq. Qu’est-il arrivé aux sept autres ?).
Évidemment, nous n’avons pas cherché à publier le projet initial de Déclaration commune de la Gauche communiste ; tout l’enjeu pour une Déclaration commune, c’est que les co-signataires soient d’accord sur une version finale avant sa publication, en tant qu’expression de leur action commune. Il n’existe donc pas de « changement » comme vous le prétendez dans les termes du débat. Les termes sont restés les mêmes depuis la première lettre proposant une Déclaration commune jusqu’à sa réalisation finale. En tous les cas, vous admettez que vous n’auriez de toute façon pas signé la Déclaration commune, aussi ces modifications entre le projet et la version finale ne sont pas la raison de votre refus de la signer.
Mais quelles sont donc les raisons de votre refus de signer la Déclaration Commune ? Votre lettre reste assez obscure sur ce point fondamental.
Votre lettre évoque la motivation de la TCI derrière l’appel de No War but the Class War. Quels que soient les mérites qu’ait cet appel – nous sommes d’accord avec les principes internationalistes sur lesquels il se base – ou ses faiblesses, il était et reste parfaitement possible pour la TCI de signer aussi la Déclaration Commune, qui contient les mêmes principes internationalistes. Le groupe coréen Perspective Communiste Internationaliste a montré en pratique le recours à cette option. Mais votre lettre ne répond pas à cette possibilité que posait votre lettre précédente. Pas plus qu’elle ne répond au problème posé par l’existence de deux appels internationalistes qui peuvent apparaître comme une compétition entre eux. Le besoin fondamental du camp révolutionnaire n’est pas pour les groupes de la Gauche communiste de juste produire des prises de position internationalistes séparément, mais d’unir leurs forces dans l’esprit de Zimmerwald et de l’unité prolétarienne en action. Pourquoi rejetez-vous résolument ces principes fondamentaux ?
La conception du milieu de la Gauche communiste derrière la Déclaration Commune est trop étroite pour vous. Était-ce réellement pour laisser de côté de faux groupes de la Gauche communiste et des bloggeurs qui préfèrent attaquer ce milieu plutôt que d’attaquer la bourgeoisie impérialiste, que vous avez refusé de signer la Déclaration Commune ? Bien que n’étant pas d’accord avec la qualification de « parasite » de cette fausse Gauche communiste, vous avez néanmoins reconnu son rôle négatif dans une récente correspondance avec le CCI. Donc, le rejet du terme « parasite » n’est pas une raison suffisante pour éluder l’importante responsabilité d’aider à unifier la véritable Gauche communiste contre la guerre impérialiste.
Finalement, vous dites que nous prenons la « mauvaise voie » pour vous persuader de signer la Déclaration Commune. Dites-nous s’il vous plaît quelle serait la « bonne voie » pour vous en persuader.
Saluts communistes,
Le CCI
La TCI au CCI, 30/04/2022
Camarades,
Nous avons clairement expliqué dans notre précédente correspondance que, malgré le fait que nous soutenons toute déclaration internationaliste contre la guerre, votre Appel est défini par l’étroitesse de son but. Non seulement vous excluez tous les groupes que vous considérez « parasites », mais le document initial disait que « seules les organisations de la Gauche communiste ont le droit de lever haut la bannière de l’internationalisme prolétarien conséquent », et c’est la version que vous avez publiée le 6 avril. Maintenant vous prétendez que votre Appel vient de la « Gauche communiste », ce qui vous place au même niveau que les bordiguistes.
Nous ne pensons pas que vous partagez notre préoccupation concernant la gravité de la présente situation. Nous notons qu’il y a un article sur votre site qui avance qu’il n’y aura pas de guerre impérialiste généralisée tant « que les blocs n’auront pas été formés » (voir https://en.internationalism.org/content/17151/ruling-class-demands-sacrifices-altar-war [501]). Le monde a pris un tournant décisif vers la guerre impérialiste, ce que la Gauche communiste savait être l’issue de cette longue crise du cycle d’accumulation du capital. Même si elle fait la paix avec l’Ukraine (ce qui semble de moins en moins probable), il ne s’agira que d’une trêve. Les contradictions croissantes du système dictent maintenant le cours que le capitalisme impérialiste nous fait prendre. Ça a pris plus longtemps que nous le pensions tous, mais ce n’est pas la seule question d’importance. Comme nous l’avons dit dans notre Appel à l’action, la classe ouvrière subit un recul depuis des décennies, et, comme nous l’avions prévu, aucun mouvement de masse pour l’instant ne pourrait mener à une convergence théorique de vues pouvant produire une nouvelle internationale viable. Notre idée autour de NWCW est d’essayer de donner aux internationalistes de toutes tendances la capacité de résister d’une façon pratique à la fois à la guerre impérialiste et à toutes les fausses réponses de la gauche capitaliste (y compris le pacifisme), tout autant que d’étendre le plus largement au sein de la classe ouvrière la critique internationaliste du capitalisme comme initiateur des guerres impérialistes. En bref, tandis que votre appel regarde vers l’intérieur, nous cherchons à regarder à l’extérieur.
Nous ne souhaitons pas être associés de quelque façon que ce soit à votre vision de longue date que certains autres groupes seraient des « parasites », et il est malhonnête de votre part de même sous-entendre que nous partagerions votre vision sur ce point. Nous avons émis des critiques envers d’autres groupes du camp prolétarien, mais sur des questions précises (comme l’idée que la classe ouvrière empêcherait la guerre, par exemple), mais nous ne leur dénions pas le droit à l’existence politique ou ne croyons pas, comme vous le dites dans votre lettre, qu’il seraient « faux ». De la même façon, nous ne jugeons pas les autres groupes comme vous le faites. L’ICP coréen peut prendre ses propres décisions sur ce qu’il veut faire et nous avons accepté l’explication qu’il nous a donnée pour signer votre Appel. L’élément important est qu’il a ainsi pu voir la véritable valeur de tenter de développer une opposition à la guerre et au capitalisme de la façon la plus large possible. A cet égard, nous ne nous attendons pas à ce que tout le monde soit d’accord avec l’ensemble des douze points de notre « Appel à l’action », étant donné qu’il s’agit notamment de la raison pour laquelle la TCI a demandé la création du comité NWCW. Cependant, comme en 2002 avec les groupes NWCW de la CWO contre la guerre en Irak, nous avons toujours eu un ensemble opérant de critères internationalistes qui devaient permettre à d’autres de nous rejoindre. Bien sûr, si nous insistions pour que tous soient exactement d’accord avec la façon dont la TCI voit le monde, nous répéterions votre erreur.
C’est notre dernier mot sur le sujet. Tant que vous ne voudrez considérer qu’un petit nombre de personnes dignes d’être reconnues, il n’y aura pour nous rien à ajouter. Par contraste, nous avons mis en place un Appel à l’action qui donne à tout internationaliste la possibilité de répondre. En ce sens, nous pouvons en fait faire un petit pas en avant au mouvement internationaliste de classe réel contre le Capital avant qu’il ne soit trop tard pour l’humanité.
Saluts internationalistes,
La TCI
Le CCI à la TCI, 16/05/2022
Camarades,
Malheureusement, votre toute dernière lettre (du 30 avril) ne permet à nouveau pas d’expliquer correctement pourquoi la TCI refuse toujours de signer la Déclaration Commune des groupes de la Gauche communiste sur la guerre en Ukraine, même si votre organisation, en tant que partie de la Gauche communiste, appuie les principes prolétariens internationalistes de la Déclaration.
Nous comprenons que la TCI veuille un « Appel à l’action » contre la guerre impérialiste, mais nous ne comprenons pas pourquoi, en ce qui concerne une position commune du camp de la Gauche communiste, la TCI reste inactive.
Votre organisation veut un « large » appel opposé à « l’étroitesse » de la Déclaration Commune. Mais en refusant de signer la Déclaration Commune, vous avez réduit l’impact d’une prise de position commune de la Gauche communiste.
Pire, parce que la TCI refuse de signer la Déclaration Commune, l’appel de No War But the Class War de la TCI paraît mettre en œuvre une compétition au sein de la Gauche communiste. Nous vous avons demandé votre réponse à ce problème dans nos précédentes lettres, mais pour l’instant aucune réponse sur ce point ne nous est parvenue.
L’« Appel à l’action » de la TCI, si on en juge par votre dernière lettre, semble gagner en flexibilité : ceux qui sont d’accord avec lui n’ont pas besoin de l’être avec tous les douze points, ce qui offre à la TCI un « ensemble fonctionnel de critères internationalistes ». Mais envers les groupes de la Gauche communiste, la TCI est implacablement rigide dans son refus d’une prise de position commune.
Vous prétendez à nouveau avoir été trompés sur le contenu de la Déclaration Commune. La réalité, c’est que vous avez refusé le processus de révision du projet de prise de position qui vous était proposé quand il vous a été envoyé pour des formulations alternatives. Le véritable problème pour vous n’était pas telle ou telle formulation, mais la volonté d’avoir une Déclaration commune, le véritable principe d’un effort commun, que vous avez décliné.
A nouveau, les différences de la TCI sur l’analyse de la situation mondiale nous sont présentées comme la justification de votre refus. Mais les différences d’interprétation des événements récents ne sont pas un obstacle pour faire une prise de position commune que la Gauche communiste partage concernant la banqueroute du capitalisme mondial et le caractère inévitable de l’extension et de l’intensification de la guerre impérialiste. La Déclaration commune qui défend les axes communs fondamentaux de l’analyse de l’impérialisme mondial par la Gauche communiste n’exclut pas un débat ultérieur sur les différences d’interprétation de ces axes. Au contraire, la Déclaration commune est la base d’un tel débat, une précondition vitale.
Si l’on vous suit, la définition de la Gauche communiste dans le projet de la Déclaration commune était trop restrictive et par conséquent impossible à signer parce qu’elle exclut les blogueurs parasites et les prétendus groupes politiques qui se réclament mensongèrement de cette tradition. Mais la TCI met en question l’inclusion dans la proposition originelle de la Déclaration commune des Partis bordiguistes, qui sont un élément important de la véritable tradition de la Gauche communiste, avec lesquels vous partagez une origine commune. L’exclusion des groupes bordiguistes de l’invitation de l’appel aurait créé une base encore plus étroite, et évidemment encore plus inadéquate pour la participation. Bien sûr, le critère de qui doit être inclus dans la Déclaration Commune de la Gauche communiste est une discussion importante. Cependant, cette question de critère ne saurait être en elle-même utilisée comme justification pour abandonner la tentative de forger une prise de position commune de la Gauche communiste. Être d’accord sur ce critère est une partie d’un processus de discussion qui mène à une position commune. Ce qui est essentiel est la volonté d’y parvenir, laquelle a été totalement absente dans l’attitude de la TCI vis-à-vis de la Déclaration commune.
Dans une situation analogue, le CCI, en répondant positivement à l’appel de Battaglia Comunista en 1976 à rejoindre des conférences de discussions conjointes entre groupes de la Gauche communiste, a montré sa volonté de faire l’effort mais a regretté que l’initiative de Battaglia ne contienne aucun critère pour décider quels groupes pourraient participer à ces conférences. Ce regret n’a pas empêché le CCI de poursuivre le travail conjoint et de participer à la première Conférence. Comme nous l’avions écrit à l’époque à Battaglia :
« À cet égard, nous ne pouvons que regretter que vous ne considériez pas utile de communiquer les noms des groupes invités à cette réunion, ni la base sur laquelle les critères de choix de ces groupes ont été faits. Cependant, ce manque d’information ne nous empêche pas de participer à cette réunion avec notre meilleure volonté révolutionnaire. Par ailleurs, nous aurions aimé, comme nous l’avons déjà dit, qu’un bulletin contenant les lettres de réponses et les autres textes des différents groupes invités soit préparé et distribué aux participants avant la réunion. » (1er mars 1977)
Par bonheur pour la seconde Conférence de la Gauche communiste, une liste de critères proposés par le CCI a été acceptée, et les partis bordiguistes furent invités. Les leçons de cet épisode pour l’effort vers un travail conjoint de cette nature sont que toutes ses conditions ne sont pas nécessairement remplies d’avance, et que les désaccords qui émergent ne doivent pas constituer une excuse pour se retirer du projet. Ce qui est vital, et l’une des principales leçons de la faillite finale des Conférences Internationales au cours des années 70, c’est que la conviction dans le principe d’un effort commun et la volonté de maintenir un forum de discussion des divergences dans la Gauche communiste a manqué. Effectivement, la troisième Conférence a échoué à produire une prise de position internationaliste commune, proposée par le CCI, contre l’invasion de l’Afghanistan par l’URSS à ce moment-là.
Dans votre lettre du 24 avril 2022, vous avez écrit que le CCI vous demandait de reconsidérer votre refus de signer la Déclaration commune qui était « la mauvaise voie ». Nous vous avions donc demandé dans notre réponse quelle devrait être la « bonne voie ». Votre dernier courrier ne répond pas à cette question. Au cours de la dernière réunion publique du CCI à Londres, le samedi 7 avril, la TCI s’est retrouvée face à la même question : que devrait faire le CCI pour vous convaincre de signer la Déclaration commune de la Gauche communiste contre la guerre impérialiste ? Le camarade de la TCI présent à cette réunion a admis qu’il n’avait pas non plus de réponse à cette question.
Est-ce parce que vous ne répondez pas à cette question que vous déclarez aussi péremptoirement que votre dernière lettre était votre « dernier mot » sur le sujet ?
Pour notre part, le CCI reste ouvert à la discussion avec vous sur nos divergences sur le refus de la TCI de signer la Déclaration commune des groupes de la Gauche communiste contre la guerre en Ukraine.
Saluts communistes,
Le CCI
Le CCI au Parti Communiste International (Il Partito),
Chers camarades,
Nous avons lu sur votre site l’annonce d’une conférence publique que vous organisez à Gênes le vendredi 22 avril au sujet de la guerre en Ukraine. Nous avons également lu les cinq thèmes que vous suggérez pour la discussion, avec lesquels nous sommes entièrement d’accord dans leur approche basique. Ainsi que vous le dites justement, la guerre est constante dans le capitalisme, et d’autant plus dans cette phase de déclin historique. Nous considérons également que le choix de votre organisation de tenir une Conférence Publique sur ce sujet est un choix important et responsable pour se confronter à la campagne bourgeoise qui tend à nous demander de soutenir l’un des deux camps dans la guerre, dans ce cas particulier l’Ukraine, comme un pays agressé et donc qu’il faut aider en envoyant… des armes. La propagande bourgeoise, à travers un pacifisme culpabilisant, tente de nous entraîner dans l’horreur de la guerre actuelle. Tout cela doit être dénoncé avec force et nous sommes sûrs que vous le ferez au cours de votre Conférence. Malheureusement, nous n’avons appris que tardivement la tenue de votre réunion, nous regrettons d’être dans l’impossibilité d’y participer physiquement, et nous n’avons pas vu qu’il soit possible d’y participer par Internet. Toutefois, permettez-nous de vous envoyer le texte de la Déclaration commune des groupes de la Gauche communiste sur la guerre en Ukraine, une Déclaration, déclaration que nous avons proposée à d’autres expressions de la Gauche communiste et dont nous pensons important de la présenter au prolétariat aujourd’hui comme expression de ce qui unit les organisations révolutionnaires face aux différentes mystifications bourgeoises. Ainsi que nous vous l’avons écrit dans notre précédent courrier, nous vous demandons de signer cette déclaration, pas pour faire nombre mais pour ouvrir, en partant de la reconnaissance mutuelle que nous appartenons au même camp révolutionnaire, un processus de discussion capable de produire avec le temps une décantation des positions et une clarification politique face à la classe. Nous aimerions saisir cette opportunité d’annoncer la tenue de nos prochaines réunions publiques sur un thème similaire, qui pourront se tenir via Internet, et seront donc facilement accessible, pour l’instant en italien le 4 mai et en anglais le 8 mai. L’annonce de ces réunions paraîtra aussi rapidement que possible sur notre site web – celle en italien dès demain. Nous vous invitons par la présente officiellement à ces réunions, qui peuvent offrir une précieuse opportunité de confrontation entre des organisations réellement révolutionnaires.
Nous attendons impatiemment de recevoir votre réponse et vous adressons nos saluts fraternels.
Courant Communiste International
Le CCI au KRAS
Chers camarades,
Nous vous envoyons des liens vers notre prise de position commune sur la guerre impérialiste en Ukraine (en anglais et russe) signée par trois groupes de la Gauche communiste et un autre groupe proche de cette tradition politique. Nous comprenons que vous venez d’une tradition politique différente, mais nous avons toujours reconnu que vous défendez courageusement et de façon constante – particulièrement dans les conditions actuelles en Russie – les positions internationalistes contre les guerres du capitalisme, et nous avons ainsi récemment publié en plusieurs langues sur notre site web votre prise de position sur la guerre en Ukraine (voir « Une prise de position internationaliste de Russie, https://fr.internationalism.org/content/10731/declaration-internationaliste-russie [442])
Nous vous demandons d’apporter votre soutien à notre prise de position, ou en la signant directement, ou en annonçant que vous êtes globalement d’accord avec elle en dépit de nos divergences, et en la publiant sur votre propre site web ou autre moyens de communications qui vous sont accessibles.
Tous vos commentaires et critiques sont les bienvenus en ce qui concerne la prise de position.
En solidarité,
Le CCI
Réponse du KRAS, 14 avril 2022
Salut camarades.
Merci d’avoir diffusé notre prise de position sur la guerre. Nous ne pouvons nous joindre à celle que vous avez publiée conjointement avec d’autres organisations communistes de gauche, non parce que nous ne serions pas d’accord avec son orientation internationaliste, mais du fait de désaccords théoriques, par exemple la mention de « dictature du prolétariat », un concept que nous ne partageons pas.
Néanmoins, nous avons traduit et publié votre texte sur notre site web (avec une préface et la mention de nos désaccords), « Contre la guerre impérialiste, lutte de classe », dont nous partageons fondamentalement les analyses et l’approche internationaliste : https://aitrus.info/node/5949 [502]
En solidarité,
KRAS-IWA
Le CCI à l’ICP (Corée)
Chers camarades,
Nous vous envoyons l’introduction de notre prise de position commune :
« Les organisations de la Gauche communiste doivent défendre ensemble leur héritage commun d’adhésion aux principes de l’internationalisme prolétarien, en particulier à une époque de grand danger pour la classe ouvrière mondiale. Le retour du carnage impérialiste en Europe dans la guerre en Ukraine est un tel moment. C’est pourquoi nous publions ci-dessous, avec d’autres signataires de la tradition de la Gauche communiste (et un groupe ayant une trajectoire différente mais soutenant pleinement la Déclaration), une Déclaration commune sur les perspectives fondamentales pour la classe ouvrière face à la guerre impérialiste. »
Nous allons publier cela comme nous l’avons écrit hier mercredi à 06 h 04,
2) nous proposons de mettre les groupes signataires suivants :
Courant Communiste International
Institut Onorato Damen
Internationalist Voice
Internationalist Communist Perspective (Corée) soutiennent complètement cette déclaration commune.
Est-ce que cela vous va ?
1 Certains groupes de la tradition du PCI bordiguiste, invités à participer, comme Il Partito et Le Prolétaire/Il Comunista, n’ont pas répondu aux lettres d’invitation, il n’y a donc pas de courrier de leur part. Il Programma a seulement envoyé un court refus qui est inclus dans cette correspondance. Le groupe Fil Rouge n’a pas répondu non plus. Par erreur, le nom de Il Partito a été omis de la liste des destinataires dans la lettre originale de proposition, mais la proposition leur a cependant bien été envoyée. Son nom a été inclus dans les destinataires des lettres postérieures. Une autre lettre a été envoyée à Il Partito, qui est incluse vers la fin, et contient une demande de signer la prise de position, et au cours d’une réunion en ligne d’Il Partito le 22 mai, le CCI a demandé pourquoi il n’avait pas répondu à l’invitation de l’appel sur la guerre en Ukraine. Nous n’avons pas non plus reçu de réponse à ces questions.
Récent et en cours:
- Déclaration commune [503]
Courants politiques:
- Gauche Communiste [163]
Rubrique:
ICCOnline - Octobre 2022
- 49 lectures
Permanence en ligne du 22 octobre 2022
- 85 lectures
Le Courant Communiste International organise une permanence en ligne le samedi 22 octobre 2022 à partir de 14h.
Ces permanences sont des lieux de débat ouverts à tous ceux qui souhaitent rencontrer et discuter avec le CCI. Nous invitons vivement tous nos lecteurs, contacts et sympathisants à venir y débattre afin de poursuivre la réflexion sur les enjeux de la situation et confronter les points de vue. N'hésitez pas à nous faire part des questions que vous souhaiteriez aborder.
Les lecteurs qui souhaitent participer aux permanences en ligne peuvent adresser un message sur notre adresse électronique ([email protected] [213]) ou dans la rubrique “nous contacter” de notre site internet, en signalant quelles questions ils voudraient aborder, afin de nous permettre d’organiser au mieux les débats.
Les modalités techniques pour se connecter à la permanence seront communiquées ultérieurement.
Vie du CCI:
- Permanences [291]
Rubrique:
Anton Pannekoek : La destruction de la nature
- 174 lectures
L’article ([1]) d’Anton Pannekoek (1873-1960) publié en 1909 offre un cinglant démenti aux allégations (qui s’inspirent des mensonges véhiculés par le Stalinisme frauduleusement assimilé au Communisme) que le marxisme n’aurait aucune préoccupation de la question écologique et la nature ; que – comme le capitalisme qu’il prétend combattre – il serait porteur du même "productivisme" destructeur de la nature. C’est tout le contraire qui est vrai !
Dans cet article Pannekoek développe de façon condensée et extrêmement accessible la même approche qu’avant lui, Marx a exposée dans le Capital. Il réaffirme que seul l’instauration du Communisme offre une alternative réaliste à la destruction de la nature.
Aujourd’hui, c’est sciemment que les campagnes idéologiques martèlent la responsabilité de "l’Homme" dans le désastre écologique pour mieux occulter que, comme partie intégrante de la nature, le genre humain interagit avec celle-ci par l’intermédiaire de différentes formes d’organisations sociales qui se sont succédé dans l’histoire. Toutes, depuis la fin de la société communiste primitive de la préhistoire, ont été des systèmes d’exploitation basés sur une division de la société en classes sociales. Ce n’est pas l’Homme, mais le système capitaliste, uniquement animé par l’extraction maximale de profit, qui vampirise et soumet la nature dans son ensemble, tout comme la force de travail du prolétariat – les sources de sa richesse – à une exploitation féroce jusqu’à l’épuisement et l’anéantissement. C’est pourquoi le capitalisme n’a pas de solution à la question écologique et que sa résolution va de pair avec celle de la question sociale.
En 1909 Pannekoek souligne déjà que les ravages de la déforestation représentent une question vitale pour l’humanité. Après plus d’un siècle de décadence du capitalisme, où la dévastation de la nature, au cours de cette période, s’est emballée et se poursuit dans de telles proportions, que ses effets (le réchauffement climatique et ses conséquences, l’effondrement des écosystèmes surexploités, la déforestation causant l’émergence de zoonoses…) combinés à ceux de la crise économique et des guerres impérialistes rend tangible le péril de destruction de l’humanité. Cet enjeu exige que le prolétariat mondial se hisse à la hauteur de sa responsabilité historique de fossoyeur du capitalisme, car seul le projet de société dont il est le porteur, celui de l’abolition de la loi de la marchandise et des rapports sociaux d’exploitation, de la création d’une société sans classes orientée vers la satisfaction des besoins humains, permettra en même temps d’instaurer un réel équilibre entre la nature et le genre humain.
Le CCI
La destruction de la nature
De nombreux écrits scientifiques se plaignent avec émotion de la destruction croissante des forêts. Or ce n’est pas seulement la joie que chaque amoureux de la nature éprouve à l'égard de la forêt qui importe ici. D’importants intérêts matériels, et même des intérêts vitaux pour l’humanité entrent en ligne de compte.
Avec la disparition de leurs riches massifs forestiers, des territoires qui, dans l'Antiquité, étaient réputés pour être des régions fertiles et densément peuplées, des greniers à blé pour les grandes villes, sont devenus des déserts. La pluie n'y tombe que rarement, mais alors en déluges dévastateurs qui emportent les minces couches d'humus au lieu de les fertiliser. Là où la forêt des montagnes a été éradiquée, les torrents alimentés par les pluies d'été font dévaler d'énormes masses de pierres et de sable qui dévastent les riantes vallées alpines, rasent les forêts et détruisent les villages dont les habitants sont innocents du fait que « l'intérêt privé et la déraison ont détruit la forêt dans les régions des hautes vallées et des sources ».
« Intérêt privé et déraison » : les auteurs qui décrivent avec éloquence ce désastre ne vont pas plus loin dans l'analyse de ses causes. Ils croient sans doute qu'il suffit d'en souligner les conséquences pour remplacer la déraison par une meilleure compréhension et en annuler les effets. Ils ne voient pas qu'il ne s'agit là que d'un phénomène partiel, que de l’un des nombreux effets semblables produits par le capitalisme, ce mode de production qui incarne la forme suprême de la chasse au profit.
Comment la France est-elle devenue un pays pauvre en forêts, au point d’importer chaque année des centaines de millions de francs de bois de l’étranger et de dépenser beaucoup plus pour atténuer par le reboisement les conséquences désastreuses de la déforestation des Alpes? Sous l’Ancien Régime, il y avait là de nombreuses forêts domaniales. Mais la bourgeoisie, arrivée au pouvoir lors de la Révolution française, ne voyait dans ces forêts domaniales qu’un instrument d’enrichissement privé. Les spéculateurs ont rasé trois millions d’hectares pour transformer le bois en or. L’avenir était le cadet de leurs soucis, seul comptait le profit immédiat.
Pour le capitalisme, toutes les ressources naturelles ne sont que de l'or. Plus il les exploite rapidement, plus le flux d’or s’accélère. L'économie marchande fait que chacun cherche à faire le plus de profit possible, sans même penser un seul instant à l'intérêt de l'ensemble, celui de l'humanité. C'est pourquoi tout animal sauvage représentant une valeur monétaire, toute plante sauvage générant un profit, est immédiatement l'objet d'une course à l'extermination. Les éléphants d’Afrique ont presque disparu victimes d’une chasse systématique pour leur ivoire. Il en va de même pour les hévéas, victimes d'une économie de prédation où tout le monde ne fait que détruire les arbres sans en replanter de nouveaux. En Sibérie, on rapporte que les animaux à fourrure se raréfient de plus en plus en raison de la chasse intensive et que les espèces les plus précieuses pourraient bientôt disparaître. Au Canada, d'immenses forêts primaires sont réduites en cendres, non seulement par des colons qui veulent cultiver le sol, mais aussi par les "prospecteurs" à la recherche des gisements de minerai qui transforment les versants montagneux en roches dénudées pour avoir une meilleure vue d’ensemble du terrain. En Nouvelle-Guinée, on s’est livré à un massacre des oiseaux de paradis afin de satisfaire la soif de faste d'une milliardaire américaine. Les folies de la mode, comme forme de gaspillage de la plus-value, font partie du capitalisme, ont déjà conduit à l'extermination d’espèces rares ; les oiseaux marins de la côte est-américaine n'ont été préservés de ce destin que grâce à une intervention stricte de l'Etat. De tels exemples pourraient être multipliés à l’infini.
Mais les plantes et les animaux ne sont-ils pas là pour être utilisés par l'homme à ses propres fins ? Ici, nous faisons complètement abstraction de la question de la conservation de la nature telle qu’elle se poserait sans l’intervention humaine. Nous savons que les humains sont les maîtres de la terre et qu’ils transforment complètement la nature à leurs fins. Pour vivre, nous sommes complètement dépendants des forces de la nature et des richesses naturelles; nous devons les utiliser et les consommer. Ce n’est pas de cela dont il est question ici, mais uniquement de la façon dont le capitalisme en fait usage.
Un ordre social rationnel devra utiliser les trésors de la nature à sa disposition de telle sorte que ce qui est consommé soit en même temps remplacé, de sorte que la société ne s’appauvrisse pas mais s’enrichisse. Une économie fermée qui consomme la partie des céréales destinées au réensemencement s'appauvrit toujours plus et doit finalement et inévitablement faire faillite. C'est pourtant ainsi que fonctionne le capitalisme. Il ne pense pas à l'avenir, mais ne vit que dans l'instant présent. Dans l'ordre économique actuel, la nature n'est pas au service de l'humanité mais du capital ; ce n'est pas le besoin de l'humanité en vêtements, en nourriture et en culture qui domine la production, mais le besoin du capital en profit, en or.
Les ressources naturelles sont exploitées comme si les réserves étaient infinies et inépuisables. Avec les conséquences néfastes de la déforestation pour l’agriculture, avec l’extermination des animaux et des plantes utiles, le caractère fini des réserves disponibles manifeste au grand jour la faillite de ce type d’économie. On doit considérer comme une confirmation de cette faillite le fait que Roosevelt veuille convoquer une conférence internationale pour faire l'inventaire des ressources naturelles encore disponibles et prendre des mesures contre leur gaspillage ultérieur.
Bien sûr, ce plan n'est lui-même qu'une fumisterie. L’État peut certes faire beaucoup pour empêcher l’impitoyable extermination d’espèces rares. Mais l'État capitaliste n'est après tout qu'un triste représentant de la collectivité humaine. Il doit s'arrêter devant les intérêts essentiels du Capital.
Le capitalisme est une économie sans tête, qui ne peut pas réguler ses actes par la conscience de leurs conséquences. Mais son caractère dévastateur ne découle pas de ce seul fait. Au cours des siècles passés, les êtres humains ont aussi exploité la nature de manière insensée sans penser à l’avenir de l’humanité tout entière. Mais leur pouvoir était réduit ; la nature était si vaste et si puissante qu’avec leurs faibles moyens techniques, ils ne pouvaient lui faire subir que d’exceptionnels dommages. Le capitalisme, en revanche, a remplacé le besoin local par le besoin mondial, créé de puissants moyens techniques pour exploiter la nature. Il s’agit alors d’énormes masses de matière qui subissent des moyens de destruction colossaux et sont déplacées par de puissants moyens de transport. La société sous le capitalisme peut être comparée à la force gigantesque d’un corps dépourvu de raison. Alors que le capitalisme développe une puissance sans limite, il dévaste simultanément l’environnement dont il vit de façon insensée. Seul le socialisme, qui peut donner à ce corps puissant conscience et action réfléchie, remplacera simultanément la dévastation de la nature par une économie rationnelle.
Anton Pannekoek, Zeitungskorrespondenz Nr. 75, 10 Juli 1909, S. 1-2
[1] Zeitungskorrespondenz, n° 75, (juillet 1909).
Conscience et organisation:
Personnages:
- Anton Pannekoek [505]
Rubrique:
"Solidaires": Un syndicat de "contestation"… anti-prolétarien!
- 352 lectures
En juillet 2021, à grands renforts de publicité dans les différents médias, de l’Humanité à Mediapart en passant par Le Monde diplomatique, sortait un livre de deux universitaires, Sophie Béroud et Martin Thibault : En luttes ! Les possibles d’un syndicalisme de contestation.
L’objectif d’une telle entreprise est d’orienter le syndicat Solidaires sur une ligne visant à l’impliquer dans des luttes posant des questions sociétales, comme le mouvement des gilets jaunes, à partir du constat selon lequel l’enfermement dans un travail d’entreprise décourage les jeunes n’ayant pas de culture politique et abandonnant, après quelques années de militantisme, le travail syndical. Les auteurs de ce texte sont allés enquêter sur le terrain à la rencontre de ces jeunes qui ne veulent plus s’investir dans Solidaires mais qui, pour certains, ont retrouvé sur les ronds-points une ambiance qui n’existait pas dans le syndicat.
Ce travail des deux auteurs universitaires faisait suite à une demande des instances dirigeantes de Solidaires qui avaient du mal à rajeunir son personnel syndical. Sur la base d’une enquête et d’une analyse de l’évolution de SUD/Solidaires, en lien avec les autres organisations syndicales, les auteurs proposent toute une réflexion pour que Solidaires évolue dans une démarche qui se veut être une défense des travailleurs en lien avec la transformation de la société. Pour les auteurs, il s’agit de renouer avec un syndicalisme de contestation (autogestionnaire, démocratique, fédéraliste) à l’image de ce que fût la CFDT après 68 où des militants d’extrême gauche, anarchistes, maoïstes, trotskistes, sont entrés en force, et qui par la suite, en 1988, ont été poussés vers la sortie par une direction qui était plus dans la ligne d’un syndicat de « concertation ». Suite au soutien de Nicole Notat, alors secrétaire générale de la CFDT, au plan Juppé qui, en 1995, avait fait descendre dans la rue des millions de travailleurs, des vagues de militants démissionnent pour rejoindre Solidaires et créer de nouvelles sections syndicales. Se positionnant sur un terrain plus radical, beaucoup de jeunes travailleurs combatifs vont y adhérer pensant trouver là un syndicat qui répondrait à leur attente, à leur envie de lutter. Mais, pour nos deux universitaires, Solidaires prend le tournant d’un syndicat de négociations en 2008, s’institutionnalisant à la faveur de la loi sur la représentativité syndicale. À partir de ce moment-là, le syndicat va connaître une lente érosion, les jeunes ouvriers s’en détournant de plus en plus, d’autres démissionnant ou rejoignant le mouvement des gilets jaunes.
Les syndicats contre la classe ouvrière
Les syndicats sont un rempart contre toute tentative du prolétariat de s’unifier en tant que classe. La bourgeoisie a très bien compris le rôle qu’ils peuvent jouer pour saboter toute capacité de la classe ouvrière à développer son combat contre le capitalisme. C’est en ce sens que l’État bourgeois a besoin d’avoir des syndicats plus ou moins radicaux pour diviser et répondre à toute tentative d’auto-organisation, à prendre ses luttes en main et à prendre conscience qu’elle est une classe en recouvrant son identité. C’est pourquoi les syndicats se partagent le travail : certains se disant « réformistes » alors que d’autres se présentent comme plus « radicaux », voire « contestataires », « révolutionnaires », comme Solidaires. C’est pour répondre à ce besoin que Solidaires a été créé au moment du « tournant réformiste » de la CFDT à la fin des années 1980. Pour l’extrême gauche, maoïstes, trotskistes, libertaires, la CGT stalinienne leur interdisait de mener leurs actions « autogestionnaires », « démocratiques », « fédéralistes ». C’est en ce sens que l’extrême gauche allait trouver dans la CFDT les structures lui permettant d’agir. La grève autogestionnaire de LIP fut d’ailleurs leur haut fait d’arme, cette « expérience » se terminant par une démoralisation et un désarroi chez les ouvriers illusionnés par le fait de reprendre l’usine à leur compte, et ainsi n’aboutir à rien d’autres qu’une auto-exploitation.
Les années qui suivirent la création de Solidaires sont marquées par la caution et sa participation à l’ensemble du travail de sabotage de tous les autres syndicats, chacun jouant sa partition afin d’assurer pleinement leur rôle d’encadrement de la classe ouvrière, couvrant ainsi toutes les expressions de combativité ouvrière, en particulier pour Solidaires en ciblant les jeunes générations.
Leur impact plus grand dans les années 2000, en grande partie dans la fonction publique, et plus particulièrement à la SNCF, secteur très combatif, concurrençant la CGT dans un de ses fiefs, montre que Solidaires a su attirer vers lui ces jeunes ouvriers de plus en plus réticents à suivre un syndicat qui ne leur laissait aucune initiative, où tout était décidé au sein de la direction. Solidaires apparaissait ainsi plus démocratique, moins bureaucratique, plus combatif, laissant plus de champ d’action. Or, c’était un piège qui a démoralisé tous ces jeunes prolétaires qui croyaient qu’en militant au sein de ce syndicat ils pourraient faire avancer les choses. Ils se sont heurtés aux mêmes pratiques syndicales.
Dans une situation de grande difficulté de la classe ouvrière, dont l’expression la plus significative est la perte de son identité, les syndicats ont été l’arme la plus efficace de la bourgeoisie pour éviter que la classe puisse reprendre confiance en elle afin de s’approprier les armes qui lui sont propres : les assemblées générales unissant l’ensemble des prolétaires et prenant les décisions nécessaires au développement de son combat, comme celles des étudiants prolétaires lors du mouvement contre le CPE en 2006. Solidaires avec les autres syndicats, la CGT en tête, organisent sans cesse des simulacres d’assemblées générales où les pontes de ces organisations prennent successivement la parole, empêchant toute prise de parole sérieuse et de décision de la part des ouvriers. C’est ce qu’on a vu lors du grand mouvement contre la réforme des retraites fin 2019/début 2020, où les syndicats ont tout fait pour encadrer et saboter une reprise de la combativité ouvrière après 10 ans d’atonie, à l’image du sabotage de Solidaires lors de la grève dans les technicentres de la SNCF en octobre 2019. Solidaires ayant été surpris par la grève de Châtillon, s’est positionné en « fer de lance » de la lutte dans la suite du mouvement, mais pour mieux l’isoler. Après avoir joué les fiers-à-bras en posant une sorte d’ultimatum à la direction (« On a donné à la direction jusqu’à 18 heures pour répondre à nos revendications »), Solidaires a appelé à la reprise du travail : « On joue le jeu [du dialogue social]. En attendant, le travail reprend, les rames vont sortir » (information AFP du 31 octobre 2019). La direction a repris la balle au bond en programmant une réunion avec les syndicats, et Solidaires a cessé d’évoquer la possibilité d’une grève… pour « jouer le jeu du dialogue social ». Et comme le rapporte le journal Libération du 31 octobre 2019 : « On ne pourra pas dire que l’on ne donne pas de porte de sortie de conflit à la direction ».
Solidaires : courroie de transmission de l’extrême-gauche du capital
Alors que la crise du capitalisme connaît une nouvelle aggravation, alors que l’inflation dégrade les conditions de vie de la classe ouvrière, et ce dans un contexte de guerre impérialiste aux portes des plus grandes concentrations ouvrières d’Europe, la bourgeoisie sait très bien qu’elle doit se préparer à faire face aux tensions sociales de plus en plus fortes, comme nous le montre « l’été de la colère » au Royaume-Uni. Toute la stratégie de la bourgeoisie est de préparer le terrain pour éviter que son ennemi de classe ne retrouve son identité, ouvrant la voie à la perspective d’une transformation révolutionnaire de la société. Les syndicats peuvent s’appuyer, maintenant, sur une force politique, la NUPES, rassemblement de forces de gauche allant du PS à la France insoumise en passant par le PC, pour entraîner le prolétariat dans la défense « d’un État démocratique au service des travailleurs ».
Ayant été rédigé avant l’éclatement de la guerre en Ukraine et l’aggravation de la crise, c’est dans ce cadre que le livre est une réponse de la bourgeoisie à ce futur qui se prépare. Pour ses auteurs, Solidaires doit apporter sa petite contribution en se présentant comme un outil voulant, par rapport aux autres organisations syndicales, donner une touche plus combative, plus contestataire, avec un projet « anti-capitaliste », voire « révolutionnaire » face au projet « réformiste » de la NUPES. Et quel est ce projet ? Celui que l’on connaît : un capitalisme à la sauce stalinienne tel que le proposent ATTAC et le NPA ou le capitalisme autogestionnaire des libertaires. Un projet au sein duquel la défense de la démocratie est élevée comme un étendard contre les « hordes fascistes », avec le sempiternel mot d’ordre du PC en 1936 « faire payer les riches » relooké aujourd’hui par taxer les profits des grandes entreprises qui font des (super) bénéfices. Finalement un projet qui n’a rien de fondamentalement différent de ce que la NUPES et les autres syndicats proposent, si ce n’est que tout cela est ficelé avec un langage plus radical, resservi à chaque élection présidentielle par un « candidat ouvrier » issu du NPA. La cible ce sont, en particulier, les jeunes prolétaires. D’ailleurs nos auteurs s’insurgent lorsqu’un de ceux-ci refuse de participer à la farce électorale.
Leur sale boulot ne s’arrête pas à faire la promotion des mots d’ordre classiques de la gauche et de l’extrême gauche, à diviser la classe ouvrière derrière les différentes sections syndicales (SUD-Rail, SUD-santé et autres), comme le font d’ailleurs les autres syndicats, mais, comme le proposent les auteurs de ce livre, à s’investir dans des mouvements qui sont en fait étrangers aux luttes du prolétariat dirigées contre les effets de l’exploitation. Car il s’agit de dissoudre la classe dans des luttes parcellaires, le féminisme, l’écologisme ou autres luttes antiracistes, jusqu’à promouvoir le mouvement interclassiste des gilets jaunes où la spontanéité, le caractère démocratique, populaire et collectif seraient une source d’inspiration, ce qui colle très bien à la campagne médiatique de la bourgeoisie présentant ce mouvement comme une nouvelle forme de la lutte de classe.
Pour couronner le tout, Solidaires fait la promotion de son internationalisme frauduleux en envoyant un convoi « solidaire » pour soutenir les syndicats ukrainiens qui combattent l’armée de Poutine, une propagande nationaliste de sergents recruteurs comme l’avaient fait leurs ancêtres appelant les ouvriers à s’entre-tuer sur les champs de bataille lors de la Première Guerre mondiale au nom de l’union sacrée, ou lors de la Deuxième Guerre mondiale au nom de la défense de la démocratie face au fascisme.
André, 29 septembre 2022
Récent et en cours:
- SUD Solidaires [506]
Questions théoriques:
- Syndicalisme [183]
Rubrique:
Résolution sur la situation en France (2022)
- 145 lectures
Récemment s’est tenu le 25e congrès de Révolution internationale, section du Courant communiste international en France. Les travaux de ce congrès ont notamment abouti à l’adoption de la résolution sur la situation en France que nous publions ci-dessous.
Guerre, récession, pandémie, destruction de l’environnement… le capitalisme est en train de plonger l’humanité dans l’abîme. Ces différentes crises, qui aujourd’hui s’aggravent de concert et se nourrissent les unes les autres, sont toutes le fruit de ce système décadent. À terme, l’enjeu est la survie de l’espèce humaine. Il n’y a qu’une seule alternative : socialisme ou destruction de l’humanité. La responsabilité de la classe ouvrière et de ses minorités révolutionnaires est donc immense.
1. L’éclatement de la guerre en Ukraine marque le retour de la barbarie impérialiste en Europe. Dans ce conflit s’affrontent directement et indirectement les principales puissances militaires de la planète. Cet événement majeur et inédit depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale a déjà provoqué des milliers de victimes, dévasté des villes entières et poussé des millions de femmes et d’enfants à fuir sur les routes. Les hommes, eux, sont obligés de rester, comme chair à canon.
Loin d’exprimer une quelconque « logique » économique, ce conflit est l’expression de la dynamique toujours plus irrationnelle dans laquelle le capitalisme, ce système obsolète, s’enfonce. À la différence de la pandémie de Covid et des catastrophes liées au dérèglement climatique, la guerre est le produit d’une action voulue et délibérée des différentes bourgeoisies nationales en concurrence. Comme le proclamait déjà le manifeste de la conférence de Zimmerwald en septembre 1915 : « La guerre qui a provoqué tout ce chaos est le produit de l’impérialisme. Elle est issue de la volonté des classes capitalistes de chaque nation ».
2. Depuis des décennies, les États-Unis ont poussé la Russie dans ses retranchements en intégrant dans l’organisation qu’ils dirigent, l’OTAN, toute une série de pays anciennement membres du Pacte de Varsovie. Les dirigeants de cette puissance savaient pertinemment que le processus d’entrée de l’Ukraine dans l’OTAN, et donc l’établissement d’une présence militaire américaine à la frontière russe, serait intolérable pour la Russie, comme l’installation de missiles « soviétiques » à Cuba en 1962, à 144 km de ses côtes, avait été inacceptable à la bourgeoisie américaine au point de menacer la planète d’une apocalypse nucléaire.
Les États-Unis ont donc délibérément provoqué la Russie afin de l’entraîner dans une guerre d’occupation longue et épuisante dans le but d’affaiblir le principal allié militaire potentiel de la Chine et aussi de resserrer les rangs des pays occidentaux autour de leur puissance. Face au piège tendu par les États-Unis, la Russie s’est lancée dans une aventure désespérée, déchaînant un déluge de feu jusqu’aux portes de Kiev. Pour défendre sa position dominante face à une Chine qui se présente en challenger de l’Amérique, la première puissance mondiale n’a ainsi pas hésité à déstabiliser non seulement l’Europe, mais également le monde : ce conflit va étendre la barbarie, désorganiser la production et le commerce mondial, aggraver considérablement la récession, pousser encore plus le processus inflationniste et abattre la famine sur une partie de la planète.
3. Cette guerre rappelle à quel point le capitalisme menace directement l’humanité. Cet événement, marqué du sceau de l’irrationalité, représente un pas supplémentaire dans la dynamique de chaos et du chacun pour soi, donnant à l’évolution de la situation un caractère toujours plus imprévisible. L’impasse dans laquelle s’enfonce la Russie rend dorénavant envisageable l’utilisation de bombes nucléaires « tactiques » en Ukraine (« mini-bombes » dont la puissance peut dépasser tout de même celle lancée sur Hiroshima en 1945 !). Les tensions impérialistes qui continuent de monter en Asie, autour de Taïwan, sont elles aussi lourdes de menaces pour l’avenir.
Ces ravages et l’orientation de toutes les nations renforçant l’économie de guerre révèlent une nouvelle fois que le capitalisme n’a d’autre chemin à offrir que la destruction de la planète. Alors que le GIEC, dans son dernier rapport, alerte sur l’urgence et les immenses dangers du dérèglement climatique, le développement considérable de l’économie de guerre et l’aggravation de la crise économique vont pousser toutes les bourgeoisies, dans tous les pays, à renforcer l’exploitation des hommes et de la nature, « quoi qu’il en coûte »… à l’espèce humaine, quand ce ne sont pas directement les bombes qui détruisent et qui tuent.
Ce faisant, les conditions seront encore plus favorables à l’irruption de nouveaux virus et donc à de nouvelles pandémies, alors même que les dégâts causés par le Covid-19 sont loin d’être terminés.
Tous les discours écologistes prônant la possibilité d’un capitalisme plus vert apparaissent ici pour ce qu’ils sont : des mensonges, de la propagande. Car la réalité c’est que, s’il n’est pas renversé à l’échelle internationale, le capitalisme entraînera toute l’humanité dans la plus effroyable des barbaries et ravagera la planète. Il est d’ailleurs hautement symbolique et révélateur de leur hypocrisie que, dans tous les pays, les partis écologistes soient souvent les plus va-t-en-guerre.
L’impérialisme français fragilisé par la stratégie américaine d’endiguement de la Chine
4. Évidemment, la France participe, comme toutes les nations, petites ou grandes, à cette dynamique mortifère, en jouant sa propre carte au nom de ses intérêts impérialistes particuliers.
Avec la constitution des blocs russe et américain, la France a cherché, dès les années 1950, à défendre son indépendance au sein du bloc occidental afin de conserver une influence mondiale à travers son statut de « puissance d’équilibre ». C’est une des raisons pour laquelle l’État français s’est très tôt donné les moyens de développer son propre arsenal nucléaire pour ne pas dépendre du parapluie américain et a pris ses distances avec l’OTAN dominée par les États-Unis.
Après la fin de la guerre froide et la disparition du bloc « soviétique », la bourgeoisie française avait encore moins de raison de respecter « la discipline de bloc », elle a donc accentué ses velléités de « non-alignement » en allant jusqu’à refuser, en 2003, de participer à l’invasion de l’Irak, aux côtés de l’Allemagne et de la Russie.
Mais l’impérialisme français a surtout rapidement été empêtré dans une situation de perte d’influence continue en se trouvant peu à peu relégué dans la hiérarchie des puissances mondiales. Dans cette nouvelle situation historique, l’impossibilité pour tout impérialisme de préserver ses zones d’influence de l’extension du chaos en raison du développement général du chacun pour soi et de l’instabilité, conjuguée à ses fragilités structurelles, notamment économiques, l’ont ainsi conduit à une relative perte d’influence dans son ancien pré-carré africain où elle fait désormais étalage d’une certaine impuissance, comme on a pu le voir avec l’échec de l’opération Barkhane. Au Moyen-Orient, elle perd aussi de son influence, notamment au Liban où elle a soutenu Hariri, corrompu et haï par la population, mais elle parvient néanmoins à y maintenir une certaine présence, notamment à travers la vente d’armes à l’Arabie Saoudite, aux Émirats Arabes Unis et à l’Égypte (en 10 ans, ses ventes d’armes y ont augmenté de 44 % !). À l’avenir, ces liens vont probablement encore se renforcer avec ces États du Golfe récalcitrants à soutenir la stratégie américaine dans le conflit ukrainien. Même la capacité de la France à intervenir militairement dans le monde est largement dépendante de la logistique et du renseignement des États-Unis. Avant même le déclenchement des hostilités en Ukraine, la stratégie américaine d’endiguement de la Chine avait déjà considérablement affaibli sa position ces derniers mois : en 2021, la mise en place de l’alliance AUKUS entre l’Australie, le Royaume-Uni et les États-Unis, excluant la France d’un énorme marché de sous-marins australiens, l’avait fortement marginalisée dans la région de l’Indo-Pacifique.
C’est dans ce cadre que la France a été particulièrement déstabilisée par l’invasion de l’Ukraine. La bourgeoisie américaine a, momentanément, pu resserrer étroitement ses alliées autour d’une Alliance atlantique renforcée par la crainte d’un affrontement direct avec la Russie. Le parapluie américain demeure aux yeux de la plupart des pays européens, particulièrement à l’Est, la meilleure sinon la seule protection face à Moscou, les armées d’Europe de l’Ouest, au premier rang desquelles se trouve la France, n’ayant pas la capacité d’assurer leur défense. Le gouvernement Biden peut ainsi exercer une énorme pression sur ses alliés européens, les obligeant à s’impliquer bon gré mal gré dans la défense de l’Ukraine et la politique de sanctions, en contradiction avec leurs propres intérêts. La France et l’Allemagne ont ainsi subi une défaite diplomatique de premier ordre qui impactera durablement leur politique étrangère et nécessitera d’autant plus une réaction de leur part pour résister au rouleau compresseur américain.
5. Si la France n’est clairement pas en mesure de s’opposer ouvertement aux États-Unis, elle a une nouvelle fois cherché à s’émanciper de la politique américaine et à défendre ses propres intérêts impérialistes. Avant même le déclenchement de la guerre, les chancelleries allemande et française se sont démenées pour empêcher Poutine de tomber dans le piège tendu par les États-Unis, conscientes des répercussions considérables que cette invasion aurait sur leur économie et leur influence. On a ainsi vu Macron se déplacer jusqu’à Moscou pour tenter de « sauver la paix » et toute une partie de l’intelligentsia européenne se convaincre que l’offensive russe était trop irrationnelle pour que Moscou s’y lance vraiment. Depuis le déclenchement des hostilités, la France comme l’Allemagne, en dépit des déclarations de bonne volonté, traînent des pieds dans la mise en place des sanctions à l’égard de la Russie qui impactent en retour négativement leur économie. Macron s’est même fendu de déclarations polémiques sur la nécessité de ne pas « humilier la Russie », laissant clairement la porte ouverte à des négociations et à une sortie du conflit acceptable pour Moscou.
Dans le même temps, preuve des contradictions qui traversent la situation de la bourgeoisie française, la France livre des armes de très haute technologie à l’Ukraine (par exemple, ses camions-canons Caesar). En fait, la bourgeoisie française est coincée : elle n’a aucun intérêt à entretenir le conflit dans l’Est européen, en même temps elle ne peut pas en être absente, au risque de perdre tout rôle et toute crédibilité militaire dans la région et bien au-delà.
Il est ainsi trop tôt pour déterminer avec certitude l’orientation que prendra la bourgeoisie française pour tenter de défendre son rang dans l’arène mondiale mais, comme en témoigne son retour dans le commandement intégré de l’OTAN en 2008, elle a compris que l’isolement qu’elle avait cultivé jusque-là lui était désormais néfaste, la France ne pouvant plus en assumer seule les conséquences économiques. Il semble, à ce titre, que sa principale perspective réside dans le renforcement du couple franco-allemand.
6. Le retour de la guerre « de haute intensité » en Europe et les menaces qu’elle fait peser sur le continent vont cependant obliger l’État français, comme l’ensemble des États européens, à fournir un effort militaire beaucoup plus considérable. L’éclatement de la guerre en Ukraine signifie que l’affrontement impérialiste majeur entre les États-Unis et la Chine va avoir tendance à se situer de plus en plus sur le terrain militaire ; les puissances d’Europe de l’Ouest, si elles veulent pouvoir défendre leurs propres intérêts, vont donc devoir se donner les moyens d’exister militairement. Nul doute que la bourgeoisie française cherchera à valoriser son « savoir-faire » en matière d’armes de pointe. Elle est cependant consciente de son incapacité à accroître seule son arsenal du fait de ses faiblesses économiques, particulièrement en termes industriels et financiers.
Face au revers diplomatique infligé par les États-Unis, les bourgeoisies française et allemande sont, à ce titre, condamnées à coopérer. En dépit d’intérêts parfois très divergents et d’oppositions fortes, comme pendant les guerres de Yougoslavie dans les années 1990, les relations entre la France et l’Allemagne ont conservé une certaine stabilité depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. La pression américaine pourrait avoir ainsi pour résultat involontaire de pousser ces deux pays à renforcer leur alliance : le couple franco-allemand montre une certaine réticence face à la stratégie américaine vis-à-vis de l’Ukraine, et il n’est absolument pas disposé à se laisser embarquer dans une aventure contre la Chine dont l’Europe dépend fortement sur le plan économique.
Mais les tendances au « chacun pour soi » pourraient aussi entraver ce mariage de raison. En effet, même si la situation pousse actuellement les deux principales puissances européennes à renforcer leur alliance, ça ne les empêchera pas, par ailleurs, de se concurrencer sur d’autres terrains et dans d’autres régions. Depuis le Brexit, la France est la principale puissance militaire de l’Union européenne (UE), dotée d’une industrie de pointe et de capacités de production importantes ; elle espérait ainsi imposer une « défense européenne » sous son autorité, financée par l’ensemble de l’UE, en particulier l’Allemagne, et concurrente d’une OTAN décrétée prématurément en « mort cérébrale » par Macron. Mais les « partenaires européens » de la France ont plus que traîné des pieds comme l’illustre l’échec de la diplomatie française pour impliquer davantage l’UE dans l’opération Barkhane et celui des projets de construction en commun d’avions, d’hélicoptères ou de blindés. Pour l’Allemagne, il est hors de question de financer une armée qui défendrait avant tout les intérêts français et dont les armes seraient de facto technologiquement sous le contrôle de la France (c’est pour cela que l’Allemagne pose comme condition à une plus grande coopération militaire le partage des brevets français). D’ailleurs, l’Allemagne cherche d’ores et déjà à renforcer son arsenal militaire qui pourrait, à terme, rivaliser avec celui de la France et déstabiliser l’équilibre traditionnel entre les deux pays : à la France la puissance militaire, à l’Allemagne la puissance économique. Depuis plusieurs années, le budget que Berlin alloue à l’armement a dépassé celui de la France, et la guerre en Ukraine a été l’occasion d’une accélération considérable de cette politique. Récemment encore, l’Allemagne, sous la pression des États-Unis, a commandé des avions américains au détriment des Rafales français.
Il convient donc de rester vigilant sur l’orientation que prendront les alliances entre les bourgeoisies européennes. L’instabilité des alliances selon les lieux et les moments est encore aujourd’hui l’hypothèse la plus probable.
Face à la guerre, l’affaiblissement inéluctable du capital français
7. Dès 2020, la pandémie de Covid avait déjà fortement accéléré la crise dans laquelle commençait à s’enfoncer l’économie capitaliste. La récession, le chômage et la désorganisation de la production mondiale frappaient de nombreux pays mais la bourgeoisie ne cessait de répéter que la « sortie du tunnel » était proche et que la croissance repartirait de plus belle. La production a ainsi semblé connaître une certaine reprise après les périodes de confinement, mais la croissance de l’économie s’est aussi accompagnée d’une hausse de l’inflation, tandis que les circuits de production continuaient de se désorganiser. Avec la guerre en Ukraine en guise de « sortie de tunnel », c’est aujourd’hui toute l’économie mondiale qui accélère son plongeon.
La guerre est une donnée fondamentale et permanente de la décadence du capitalisme qui structure et oriente l’ensemble de la société (l’immense majorité des avancées technologiques des dernières décennies est directement issue du monde militaire ou développée pour lui : GPS, Internet, micro-ondes, satellites et fusées, énergie solaire, plastique…). Elle aspire surtout comme un trou noir des pans entiers de la production : toutes les dépenses liées à la guerre (production d’armes en vue d’être utilisées ou stockées, emploi d’une armée de militaires, de techniciens et d’administratifs), ne dégagent pas de profit, elles sont une perte sèche pour le capital, financée par l’exploitation accrue de la classe ouvrière. Avec la guerre en Ukraine et tout le développement de l’économie de guerre qui va en découler dans tous les pays, le poids mort du militarisme va donc peser plus lourd encore sur les épaules de la société dans les années à venir.
8. La situation économique est d’ailleurs déjà en train de se dégrader à grande vitesse, particulièrement pour les pays européens : en plus de renforcer la fragmentation de la production mondiale en coupant les voies de transport de marchandises de la mer Baltique jusqu’à la mer Noire, il faut noter qu’une part significative des ressources énergétiques consommées en Europe provient de la Russie qui représente également un marché important pour ses exportations. La France étant le premier employeur privé étranger en Russie, la fracture actuelle est donc extrêmement préjudiciable au capital français. L’Ukraine aussi est un producteur majeur de matières premières alimentaires, ce qui exerce non seulement une forte pression sur les prix, mais fait peser un risque accru de famine dans plusieurs pays du Moyen-Orient et d’Afrique.
La fragmentation plus profonde de la production mondiale induite par l’accélération de la décomposition du capitalisme sous la pandémie et accentuée par la guerre pousse d’ores et déjà la France, comme de nombreux autres États, à relocaliser une partie de ses industries stratégiques pour sécuriser sa production. La bourgeoisie présente ces relocalisations comme une « chance » pour les ouvriers en France. Mais l’OMC a déjà alerté sur les dangers d’un tel processus : la course à l’accumulation de matières premières dans chaque nation, loin de réduire l’insécurité de l’économie, risque au contraire de perturber davantage les chaînes d’approvisionnement et de ralentir significativement la production mondiale du fait du chacun pour soi. Il suffit de se souvenir des actes de piraterie auxquels se sont livrées les États pendant la « guerre des masques » pour s’en convaincre. De la même façon, les États vont devoir sécuriser l’approvisionnement de matières premières, comme l’uranium pour les centrales nucléaires françaises, ce qui va inéluctablement accroître les tensions impérialistes et, donc, le poids de l’économie de guerre.
9. Pour affronter les chocs à venir, la bourgeoisie française part avec de nombreux handicaps, en particulier la dégradation continue pendant plusieurs décennies de son appareil de production vieillissant et de sa recherche, comme en témoigne l’affaiblissement de l’industrie automobile dans laquelle la France ne peut plus rivaliser avec l’Allemagne. Cette rétrogradation s’est même muée en humiliation quand il s’est avéré que la France a été la seule « puissance pharmaceutique » à être incapable de produire un vaccin contre le Covid-19, alors même qu’il s’agissait jusque-là de l’un de ses fleurons.
Mais c’est surtout sur le plan de la décomposition que la bourgeoisie trouve les obstacles les plus importants à la modernisation de son appareil de production. Les coupes budgétaires successives depuis 40 ans ont, en effet, abouti à une forte dégradation des services de l’État au premier rang desquels la recherche, l’éducation et la santé :
– Les « cerveaux », ingénieurs et scientifiques, sont nombreux à partir à l’étranger pour y trouver des conditions de travail plus convenables.
– L’institution scolaire doit faire face à d’énormes difficultés pour la formation de nouvelles forces de travail à exploiter. Une masse croissante d’élèves se trouve de moins en moins qualifiée pour occuper des emplois techniques, voire pour occuper un emploi tout court, même très faiblement qualifié.
– Une partie de plus en plus large de la population, mal ou pas soignée, est dans un état de santé physique et/ou psychique tellement dégradé qu’elle ne peut plus affronter les conditions elles aussi de plus en plus intenables du monde salarié. Selon l’OMS, une personne sur huit au sein de la population mondiale est atteinte de troubles mentaux, et ce chiffre est en très forte augmentation chaque année. En France, le secteur du soin psychiatrique et psychologique a été frappé de coupes claires ces dernières années, au point de transformer les hôpitaux psychiatriques en zone d’errance et de maltraitance.
La main d’œuvre en capacité de travailler vient ainsi à manquer. La bourgeoisie française est consciente de ce problème et, pourtant, si la fraction Macron semble faire un effort pour la recherche et la technologie de pointe, elle continue de rogner encore et encore le système de soins et le secteur de l’éducation au nom des « économies nécessaires », ce qui témoigne de l’irrationalité de plus en plus grande de ce système.
Par ailleurs, du fait notamment de la combativité historique de la classe ouvrière en France, la bourgeoisie de ce pays a eu le plus grand mal à mener aussi loin que ses voisines les attaques contre les conditions de vie des travailleurs.
10. Cela dit, la bourgeoisie française peut aussi s’appuyer sur des points forts qu’elle ne manquera pas de chercher à valoriser. La fraction Macron a prouvé depuis 2014 (Macron est alors nommé Ministre de l’Économie sous la présidence du « socialiste » Hollande) sa capacité à réformer et à orienter les efforts vers les secteurs de haute technologie. Ainsi, toute une série de « réformes » importantes ont pu être menées à bien, en particulier la Loi travail (qui a très fortement précarisé le marché du travail en décuplant la « flexibilité ») et la récente Loi sur l’assurance chômage (qui permet de réduire significativement le montant des allocations versées et de rayer des listes des allocataires de nombreux chômeurs).
Si la désindustrialisation est bien réelle et si son retard technologique est de plus en plus perceptible (dans l’informatique ou l’intelligence artificielle, par exemple), elle conserve néanmoins un savoir-faire dans plusieurs secteurs, comme le luxe, le tourisme, l’aéronautique ou l’armement. Bien que ce dernier secteur soit une perte nette pour le capital global, la nation qui vend des armes peut néanmoins en tirer profit, en termes économiques mais surtout en termes d’influence. Nul doute que la France cherchera à vendre ses engins de mort partout où ses intérêts impérialistes le lui dicteront, en particulier en Europe, au Moyen-Orient (l’Arabie Saoudite est déjà l’un des meilleurs clients de la filière française d’armement) ou en Inde.
L’instabilité de l’appareil politique de la bourgeoisie française
11. À l’instar des autres pays, la France va connaître la récession avec son cortège d’attaques contre la classe ouvrière et devra faire face à des difficultés qui menacent directement son rang dans l’arène internationale. C’est pourquoi, avec les dernières élections présidentielles et législatives, elle a cherché à s’armer le mieux possible pour affronter les crises à venir.
Si le Rassemblement national a encore accru ses scores électoraux, signifiant le renforcement de l’idéologie populiste dans la société, Macron, bien que détesté par une partie de la population, a pu se maintenir au pouvoir en prouvant sa stature d’homme d’État. Face à l’accélération du militarisme et de la crise économique, la bourgeoisie française a su maintenir à la tête de l’Exécutif sa fraction la plus adaptée aux besoins et à la défense des intérêts globaux du capital français, en écartant le principal parti populiste. La bourgeoisie française a toujours été divisée au sujet de ses relations avec Moscou, comptant dans ses rangs des fractions pro-russes historiquement issues du PCF, et qui gravitent aujourd’hui autour de La France Insoumise, ou de la droite « souverainiste ». Macron et sa coalition de partis (Renaissance, Modem et Horizons) représentent, à ce titre, la fraction la plus à même de défendre les intérêts de l’impérialisme et du capital français, dans les traces de la tradition gaullienne au cours de la guerre froide : dans le camp américain mais autonome. Aujourd’hui, dans un contexte où les blocs n’existent plus, il s’agit plutôt d’être l’alliée des États-Unis tout en voulant garder son indépendance.
En 2017, la bourgeoisie avait pu placer Macron au pouvoir en « siphonnant » les électeurs et une partie de l’appareil du PS, ce qui avait abouti à l’amenuisement des forces de gauche à l’Assemblée nationale. L’absence d’une opposition de gauche crédible représentait un handicap dans la capacité de la bourgeoisie à mener ses réformes, pour encadrer idéologiquement la classe ouvrière et entretenir la mystification électorale. Avec le score de Mélenchon à la présidentielle et la constitution, derrière lui, de la coalition des forces de gauche, la NUPES, la bourgeoisie dispose désormais d’une force d’opposition plus à même de leurrer la classe et la conduire vers des impasses. Elle représente même aujourd’hui un parti de gouvernement plausible puisque son programme n’a rien de très radical, moins à « gauche » que ne l’étaient les programmes de Mitterrand en 1981 et de Jospin en 1997, cela dans le but de diriger le mécontentent vers les urnes et l’illusion d’une autre gouvernance possible. Dès les résultats du premier tour de l’élection présidentielle connus, la fraction autour de Mélenchon s’est d’ailleurs employée à mener une campagne de division extrêmement cynique, présentant les vieux comme une génération ayant profité à fond de l’État-providence et votant désormais « pour la retraite à 65 ans » au détriment des jeunes. Ce travail de division répond directement aux embryons de solidarité intergénérationnelle que nous avions pu observer lors du mouvement contre la réforme des retraites, peu avant la pandémie de Covid-19.
Quant à la partie de la classe ouvrière qui ne se laisserait pas berner par ces douces sirènes de la social-démocratie new-look, les partis d’extrême-gauche, trotskistes en têtes, ont su se placer lors de la campagne présidentielle en tenant un discours très orienté sur la nécessité de renverser le capitalisme. Il ne faut ici pas se tromper sur le sens de la faiblesse de leurs scores électoraux : ces partis ne cherchaient pas à briller en termes de pourcentage mais bien à préparer l’encadrement idéologique des minorités les plus radicales et en réflexion du prolétariat qui sont en train d’émerger.
12. Cependant, avec l’aggravation de la décomposition, la bourgeoisie française va devoir faire face à des pressions centrifuges accrues en son sein. En 2017, la majorité de bric et de broc comprenait le risque, sous la pression des tendances au chacun pour soi, de fortes tensions, voire d’un éclatement. Cette réalité n’a fait que s’amplifier depuis avec, notamment, la création du parti de l’ancien premier ministre Édouard Philippe (Horizons), directement concurrent de la tendance Bayrou (le Modem) et visant à terme à contester la place de leader à Macron. Les difficultés de Macron à constituer un gouvernement après l’élection présidentielle témoignent ainsi des subtils équilibres qu’il a fallu mettre en œuvre au sein de la majorité.
Mais c’est le résultat des élections législatives qui exprime le plus clairement cette instabilité. Macron n’a pas réussi à obtenir une majorité suffisante et devra désormais composer avec une Assemblée nationale instable, ce qui pourrait déboucher sur des crises politiques régulières, voire une grave crise institutionnelle, pouvant ralentir la capacité de la bourgeoisie à mettre en œuvre ses attaques. Il est cependant clair que la bourgeoisie ne manquera pas de retourner cette situation contre la classe ouvrière en réanimant l’idéologie démocratiste à travers l’idée que le Parlement, « la maison du Peuple », jouera « enfin » un véritable rôle dans l’appareil étatique. Dès les résultats annoncés, toute la presse et tous les partis n’ont pas manqué de souligner que le Parlement ne serait plus une simple chambre d’enregistrement, mais un « acteur central de la vie démocratique » avec lequel Macron devra désormais « composer ».
Le résultat de ces élections législatives confirme aussi la progression du Rassemblement national, qui s’installe comme un candidat de plus en plus crédible au pouvoir. La bourgeoisie française va devoir faire face au développement de la pensée irrationnelle au sein même de l’État, dans une grande partie de la population et donc à la montée du populisme. Contrairement aux promesses de Macron d’éradiquer le populisme, le Rassemblement national s’est durablement installé comme une force politique incontournable, tandis que les théories du complot ont explosé à l’occasion de la pandémie. Macron et son gouvernement ne sont clairement pas en mesure de faire reculer ces expressions caricaturales de la décomposition sociale et du no future, d’autant plus que le parti présidentiel a régulièrement joué lui-même avec le feu des thématiques populistes pour se maintenir au pouvoir, et n’a pas hésité à propager de grossières fake news, pendant la crise du Covid, pour dissimuler la responsabilité de l’État, suscitant à son tour la recrudescence des théories complotistes anti-vaccins.
La classe ouvrière face à la décomposition et à la guerre
13. Dans les circonstances actuelles, la période à venir va s’avérer extrêmement compliquée pour la bourgeoisie. Avec le développement de l’économie de guerre et l’aggravation de la crise économique, la bourgeoisie va devoir imposer d’énormes sacrifices à la classe ouvrière, en particulier à travers l’inflation et la mise en œuvre de la réforme des retraites que l’État avait été contraint de reporter à cause de la pandémie et du risque de chaos social. La bourgeoisie est consciente qu’elle va donc devoir s’affronter à une colère grandissante.
Le mouvement interclassiste des « gilets jaunes », qui a longuement occupé le terrain social et attiré parmi les franges les plus fragiles et inexpérimentées du prolétariat, était le produit de l’érosion continue de l’identité de classe. Le prolétariat ne parvenait pas à jouer son rôle de classe organisée en lutte et a laissé, par conséquent, le terrain de la contestation aux expressions de colère de la petite bourgeoisie.
Mais le mouvement contre la réforme des retraites de l’hiver 2019-2020 a démontré la capacité du prolétariat en France à se mobiliser sur son propre terrain comme classe antagonique au capital et à développer sa solidarité et son unité, bien que de façon très embryonnaire. Après 9 ans de calme social, le retour de la lutte de classe a mis en évidence un processus de maturation souterraine au sein du prolétariat face à l’aggravation de la crise économique, aux attaques et au discrédit des principaux partis politiques de la bourgeoisie.
La pandémie de Covid-19 a marqué un coup d’arrêt momentané à la dynamique de reprise de la lutte de classe en France. Le sentiment de sidération généralisé et les mesures de télétravail, résultant des confinements, ont fortement renforcé l’atomisation et le sentiment d’impuissance.
Mais la colère a continué de s’accumuler et la combativité n’a pas disparu, comme le prouvent les nombreuses grèves isolées sur tout le territoire depuis des mois. De même, si les théories complotistes ont pu facilement se répandre au sein de la population en général, l’impact de cette pourriture idéologique sur la classe ouvrière en France est resté relativement limité, comme on a pu le voir avec le « convoi de la liberté » et les manifestations anti-pass et anti-vax qui sont demeurées ultra-minoritaires.
Face à ce potentiel intact de lutte du prolétariat de tous les pays centraux, comme on l’a vu récemment en Grande-Bretagne lors de la grève des cheminots, aux États-Unis avec la « striktober » ou encore en Allemagne dans le secteur de la sidérurgie, etc. ces bourgeoisies, à la différence des mensonges grossiers de la propagande russe, ont dû déployer une propagande extrêmement sophistiquée pour présenter le conflit en Ukraine comme une « guerre défensive ». Elles sont loin de pouvoir embrigader la classe ouvrière dans une guerre directe. Le rapport de forces entre les classes dans les pays où le prolétariat est le plus expérimenté, interdit même à ces États d’avoir trop de victimes dans les rangs de l’armée professionnelle.
14. La guerre a, toutefois, déjà un impact négatif sur la classe ouvrière d’Europe de l’Ouest. La barbarie effroyable et les risques, y compris nucléaires, que ce conflit fait peser sur l’humanité a renforcé la peur de l’avenir et le sentiment d’impuissance. Privée de son identité de classe, de sa confiance en elle-même et de toute perspective révolutionnaire, la classe ouvrière est condamnée à subir la guerre comme un événement catastrophique hors de son influence. Sur le plan subjectif, cet événement tragique ne peut, actuellement, que renforcer le no future.
Mais au sein des minorités en recherche de positions de classe, cette guerre peut aussi pousser au développement de la conscience, comme un témoin de la maturation souterraine de la classe dans son ensemble. Pour mieux dévoyer la réflexion, on a ainsi vu des syndicats, notamment quelques sections de la CGT en France, et les partis « radicaux » de la bourgeoisie (anarchistes officiels, trotskistes…) se fendre de communiqués prétendument internationalistes.
Bien que la classe ne puisse pas actuellement se mobiliser sur son terrain directement contre la barbarie de la guerre impérialiste, l’aggravation de la crise qu’elle va induire peut jouer en faveur de sa combativité et de sa conscience. Dans les années à venir, la bourgeoisie devra soutenir un effort de guerre durable et exiger des prolétaires des « sacrifices » pour financer ses impératifs impérialistes, ce qui constitue un terreau fertile pour le développement de luttes. De même, l’inflation, parce qu’elle touche l’ensemble de la classe, peut constituer un terrain favorable au développement de luttes unitaires et solidaires, en même temps qu’elle contient le risque de luttes interclassistes, une partie de la petite-bourgeoisie étant elle-même impactée par ce phénomène. La crise économique reste donc encore la « meilleure alliée » de la classe ouvrière, un puissant stimulant de la lutte et de la prise de conscience.
Malgré toutes ses difficultés, le prolétariat n’est pas vaincu et la situation demeure ouverte. Sa colère et sa combativité ne se sont pas étiolées, au contraire elles vont grandissantes. La bourgeoisie sait qu’elle va devoir affronter une situation explosive et doit donc marcher sur des œufs en multipliant les primes à tel ou tel secteur, les mesures anti-inflation et les concessions sur une réforme des retraites à haut risque. C’est la raison pour laquelle elle prépare le terrain des futures attaques avec beaucoup de soin, non seulement sur le plan politique avec la NUPES, mais aussi au plan syndical, en lançant de grandes manœuvres pour faire monter les cliques les plus radicales dans l’appareil de la CGT. Le positionnement actuel de la CFDT, favorable en 2018 à la réforme des retraites et aujourd’hui vent debout contre, témoigne de l’affichage de radicalité de tous les syndicats qui ont senti l’immense mécontentement dans la classe et la nécessité de se préparer à encadrer les probables mouvements sociaux à venir.
Vie du CCI:
- Résolutions de Congrès [507]
Situations territoriales:
- France [508]
Rubrique:
ICCOnline - novembre 2022
- 45 lectures
Permanence en ligne du 12 novembre 2022
- 38 lectures
Le Courant Communiste International organise une permanence en ligne le samedi 12 novembre 2022 à partir de 14h.
Ces permanences sont des lieux de débat ouverts à tous ceux qui souhaitent rencontrer et discuter avec le CCI. Nous invitons vivement tous nos lecteurs, contacts et sympathisants à venir y débattre afin de poursuivre la réflexion sur les enjeux de la situation et confronter les points de vue. N'hésitez pas à nous faire part des questions que vous souhaiteriez aborder.
Les lecteurs qui souhaitent participer aux permanences en ligne peuvent adresser un message sur notre adresse électronique ([email protected] [213]) ou dans la rubrique “nous contacter” de notre site internet, en signalant quelles questions ils voudraient aborder, afin de nous permettre d’organiser au mieux les débats.
Les modalités techniques pour se connecter à la permanence seront communiquées ultérieurement.
Vie du CCI:
- Permanences [291]
Rubrique:
La crise du parti Tory exprime l’impasse de l’ensemble de la classe dominante
- 54 lectures
La démission de Liz Truss après 44 jours comme Première ministre n’est que le dernier volet d’une séquence d’événements chaotiques sans précédents dans la politique britannique depuis le référendum sur le Brexit en 2016 et rien n’indique que les choses vont se stabiliser miraculeusement dans une sorte de retour à la normalité constitutionnelle. Au moment où nous écrivons, une nouvelle bataille pour la direction est en cours : Rishi Sunik semble être le favori mais le retour de Boris Johnson est également une possibilité, ce qui est la claire expression d’un parti à court d’option et qui pourrait être au bord d’une division historique.
Mais la crise du parti tory est en réalité l’expression d’une crise politique bien plus profonde au sein de l’ensemble de la classe dominante et d’un système en décomposition dans lequel la bourgeoisie, de manière générale, perd de plus en plus le contrôle sur sa propre vie politique.
44 jours de pagaille politique
Truss est devenue Première ministre le 6 septembre et a écarté des postes ministériels toutes les personnes qui s’étaient opposées à elle dans l’élection pour la direction du parti contre Rishi Sunik. Le 23 septembre, Kwasi Kwarteng avait annoncé une série de baisse d’impôts qui n’avait pas été chiffrée ou mandatée par le Bureau pour la Responsabilité budgétaire. Cela a eu immédiatement un impact considérable sur la valeur de la livre, comme sur les taux d’intérêts, les fonds de pension, les obligations d’État et sur la disponibilité des prêts hypothécaires. À la conférence du parti tory début octobre, Truss a étiqueté tous les opposants à sa politique économique comme membres d’une coalition anti-croissance, comme s’il y avait des factions de la classe dominante qui n’avaient pas d’intérêt à l’accumulation du capital et au renforcement de l’économie nationale, alors qu’il n’y a que des désaccords au sein de la bourgeoisie sur les moyens d’y parvenir.
Le 14 octobre, Kwarteng avait dû quitter une réunion du FMI aux États-Unis afin d’être limogé (pour avoir exécuté ce qui avait été décidé avec Truss) et était remplacé par Jeremy Hunt comme Chancelier de l’Échiquier. Le 17 octobre, Hunt a annoncé l’abandon de presque toutes les mesures du mini-budget de Truss. Un plan de 45 milliards de livres de baisse d’impôts non financé a subi une amputation de 32 milliards et, au nom de la stabilité et de l’équilibrage des comptes, il y aura une réduction drastique des dépenses. Le plafonnement des prix de l’énergie prévu initialement sur deux ans durera seulement jusqu’à avril prochain et il n’a été trouvé seulement que la moitié des 70 milliards pour combler le trou noir fiscal.
Il est certain que le gouvernement Truss a démontré une incompétence particulière dans le fait de ne pas comprendre quels seraient les effets de sa politique. Mais les racines historiques et le contexte global qui président à la crise économique et politique qui secoue le capitalisme britannique, vont au-delà de l’inaptitude d’une administration particulière.
Décomposition sociale et perte de contrôle politique
Historiquement, la bourgeoisie britannique a toujours été capable de faire les ajustements appropriés dans son appareil politique pour faire face à toutes les situations, que ce soit au niveau économique, impérialiste ou dans son rapport à la lutte de classe. Les trois dernières décennies de décomposition sociale ont montré à quel point la bourgeoisie a progressivement perdu le contrôle de son appareil politique, notamment en raison de l’influence grandissante du populisme dans l’une de ses principales composantes. Cela est devenu évident en 2016 avec la maladresse de Cameron consistant en la tenue d’un référendum sur l’appartenance à l’Union européenne, dans une tentative avortée de contrecarrer l’influence du populisme, notamment celle du Parti pour l’indépendance du Royaume-Uni (UKIP) au sein du parti conservateur.
Depuis la décision du Brexit, nous avons eu droit à May et les négociations sur le départ de l’Union européenne puis à Johnson et son « Getting Brexit done », lequel signifiait accepter un accord dont il devint rapidement évident qu’il serait contesté. Le départ de Johnson fut précipité car sous-entendant qu’il avait été victime d’un coup de poignard dans le dos ; il y a pourtant de nombreux membres du parti tory qui sont toujours ouvertement en faveur d’un retour de Boris Johnson au pouvoir.
Le choix de Liz Truss, émergeant d’un nombre limité de candidats tous entachés par leur implication dans le gouvernement Johnson, aurait pu signifier une rupture avec la surenchère populiste. Mais il a été marqué par l’adoption de fantasmes hérités des principes libéraux thatcheriens qui ont ensuite terni l’image des tories comme gestionnaires responsables de l’économie britannique. L’un des seuls points sur lequel il y a eu continuité entre Johnson et Truss a été leur capacité à changer complètement de position sans aucun scrupule.
Une crise économique de longue date
Truss et avant elle Johnson, ont rendu l’invasion de l’Ukraine par la Russie en février responsable de la hausse de l’inflation, et plus particulièrement de l’augmentation des coûts énergétiques. Pourtant, les entreprises du secteur de l’énergie faisaient déjà faillite à la fin de l’année 2021, et l’inflation au Royaume-Uni (dont la hausse est actuellement plus rapide que celle de n’importe quel pays du G7) décollait déjà au cours de la même année et avait atteint 5,4 % à la fin du mois de décembre avant de passer ensuite à une inflation à deux chiffres (la hausse de la plupart des produits alimentaires étant nettement plus élevée). Il s’agit du taux le plus élevé depuis 1982, et cette augmentation devrait se poursuivre selon toutes les prévisions. En ce qui concerne plus particulièrement les coûts de l’énergie, les prix de l’électricité ont augmenté de 54 % et ceux du gaz de 95,7 % de janvier à septembre.
Mais la crise économique du capitalisme britannique n’est pas seulement le produit de la guerre, de la pandémie ou du Brexit. En réalité, la suprématie économique de la Grande-Bretagne dans le monde était déjà remise en question par des puissances montantes comme les États-Unis et l’Allemagne à la fin du XIXe siècle, et les décennies qui ont suivi la Première Guerre mondiale ont été l’histoire de la descente continue de la Grande-Bretagne vers le statut de puissance de troisième ordre. Cette longue descente s’est accélérée dans la phase finale de la décadence du capitalisme : la montée du populisme et le fiasco du Brexit sont un produit évident de cette phase, et s’ils sont certainement un facteur accélérateur dans la tourmente économique et politique du Royaume-Uni, ils n’en sont pas la cause sous-jacente, qui ne peut être recherchée que dans les contradictions insolubles du capitalisme en tant que système mondial.
Il est important de comprendre cela, car il s’agit d’un avertissement pour la classe ouvrière : un changement d’équipe au pouvoir n’éliminera pas la menace croissante de paupérisation. Les choix faits par les différentes équipes au pouvoir ne représentent aucune alternative de moindre mal. Comme le dit la résolution sur la situation internationale du 24e Congrès du CCI : « [les] changements de politique ne peuvent empêcher l’économie mondiale d’osciller entre le double danger de l’inflation et de la déflation, de nouvelles crises du crédit et des crises monétaires ouvrant toutes sur des récessions brutales ».
Alors que Truss voulait initialement s’attaquer à « l’orthodoxie de la politique du budget public », ce qui a conduit à des paniques sur les marchés financiers, à des augmentations massives de la dette, à une pression sur l’inflation et à des attaques contre les conditions de vie de la classe ouvrière, l’adhésion de Hunt à cette même orthodoxie, dans la dernière des nombreuses volte-faces du gouvernement, signifie la réaffirmation d’un régime d’austérité, sans la prétention d’un « ruissellement » de la richesse. Cela impliquera des réductions des dépenses publiques et des augmentations d’impôts. En bref, de nouvelles attaques contre les conditions de vie des prolétaires.
En l’état actuel des choses, la politique budgétaire signifie une réduction des dépenses publiques, tandis que la Banque d’Angleterre, après avoir essayé de faire face à l’incurie du gouvernement, tentera encore de limiter l’inflation, ce que les commentateurs désignent comme la voie vers une récession plus profonde et plus prolongée.
Des fissures dans le Royaume « Uni »
Un autre domaine dans lequel il y a eu une continuité est celui qui a consisté à renforcer le SNP (Parti National Écossais) en le présentant ainsi que son projet d’indépendance de l’Écosse comme des possibilités viables. En effet, contrairement aux gouvernements Johnson et Truss, le SNP en Écosse s’est comporté dans les limites normales de la respectabilité bourgeoise, toujours prêt à blâmer Londres pour sa gestion des problèmes économiques ou son incurie face à la pandémie. L’éclatement du Royaume-Uni semblait autrefois un doux rêve de nationalistes excentriques, mais le SNP est désormais en mesure de présenter l’indépendance (et le retour dans l’Union européenne) comme une alternative séduisante à la domination des populistes et des extrémistes anglais.
Dans le même temps, la question du statut de l’Irlande du Nord n’est pas résolue, l’accord final du Brexit laissant la bourgeoisie britannique coincée entre le Protocole sur l’Irlande du Nord et l’accord du Vendredi Saint. (1) Le Parti unioniste démocrate (DUP) s’est retranché obstinément derrière le Protocole sur l’Irlande du Nord, mais le gouvernement britannique n’aura pas d’autre choix que de convoquer de nouvelles élections si le DUP ne revient pas à un partage du pouvoir avant le 28 octobre. Le DUP ayant été devancé par le Sinn Fein lors des dernières élections législatives en mai en tant que premier parti régional, il pourrait être réticent à répéter l’expérience. Entre-temps, l’Union européenne et les États-Unis font pression sur la Grande-Bretagne pour qu’elle ne fasse rien qui puisse perturber la situation fragile actuelle en Irlande du Nord.
Avec la guerre en Ukraine, l’impérialisme britannique demeure le plus grand soutien de Zelensky en Europe, tant sur le plan de la fourniture d’armes que sur celui de la rhétorique. Cela représente une charge pour les finances britanniques, et l’engagement précédent de Truss d’augmenter de manière significative le budget de la défense ne sera pas nécessairement maintenu, bien qu’il faille toujours se rappeler que le militarisme est au cœur de la survie du capital national, et que la guerre n’est plus un facteur rationnel en termes de gains économiques ou même stratégiques.
La bourgeoisie britannique fait face à une classe ouvrière combative
Sur un autre front, la bourgeoisie britannique doit faire face aux luttes de la classe ouvrière. Les luttes de l’été ne se sont pas éteintes avec l’arrivée de l’automne et si, pour l’instant, le contrôle des syndicats en limite l’ampleur, celles-ci représentent déjà une rupture avec des années de passivité et pourraient bien se développer. En réponse, le gouvernement a parlé de renforcer la législation contre les grèves et les manifestations. Toutes les factions bourgeoises utiliseront la répression sous une forme ou une autre, mais la tentative de faire passer des mesures politiques et économiques provocatrices à un moment où la lutte des classes se développe est une autre expression de l’incompétence particulière du gouvernement Truss. D’autre part, malgré cette perte de contrôle croissante de l’appareil politique par la bourgeoisie, il ne faudrait pas sous-estimer la capacité des différentes factions à répondre aux développements de la lutte de classe, notamment par une division du travail entre un gouvernement « dur » et des syndicats aux accents de plus en plus radicaux. Dans le même temps, les partis d’opposition, menés par les travaillistes, redoublent leurs appels à des élections générales, ce qui est un autre moyen éprouvé de saboter la lutte de classe.
Cependant, les conditions objectives de l’aggravation du conflit de classe mûrissent chaque jour. Le capitalisme ne peut éviter de s’attaquer aux conditions de vie et de travail de la classe exploitée, que ce soit sous la forme de l’inflation et de la hausse amplifiée du coût de la vie, ou de la réduction des dépenses publiques, ce qui, dans la pratique, signifie des attaques contre les allocations, les retraites et les services de tout organisme financé par l’État, des services de santé à l’éducation en passant par le logement et les transports publics. La bourgeoisie n’a rien d’autre à offrir que l’austérité et aucun parti d’opposition ne peut représenter une alternative à cela malgré les promesses des travaillistes et du Parti nationaliste écossais.
Dans la défense de ses conditions de vie contre les attaques grandissantes, la classe ouvrière n’a rien à gagner dans les divisions croissantes qui touchent son ennemi de classe : à ce niveau du conflit de classe, il est plus probable que ces dernières soient utilisées pour renforcer les divisions au sein-même de la classe ouvrière (la lutte entre supporters et opposants au Brexit, les soi-disant « guerres de cultures » ont précisément cet impact négatif sur la conscience que les ouvriers ont d’eux-mêmes en tant que classe avec des intérêts communs). Le développement de la lutte de classe dépendra de la capacité des prolétaires de commencer à comprendre qu’il n’y a plus rien dans le capitalisme qui puisse être sauvé et que leur résistance doit se développer dans la perspective de renverser ce système à l’agonie.
Car, 22 octobre 2022
1 Signé en 1998, l’accord du Vendredi Saint a mis fin aux trente années de violences qui firent des milliers de morts en Irlande du Nord (NdT).
Géographique:
- Grande-Bretagne [47]
Rubrique:
Le mythe de la neutralité et du non-alignement percé à jour
- 91 lectures
La vitesse avec laquelle la Suède et la Finlande ont rejoint l’OTAN est un signe clair du développement rapide de la militarisation en Europe du Nord après l’invasion de l’Ukraine en février dernier. Ce processus, initié par la Finlande, a conduit le gouvernement suédois à un changement de cap historique, abandonnant une politique de non-alignement vieille de plus de 200 ans qui datait de la fin des guerres napoléoniennes. Cette politique, de même que la « neutralité » officielle de la Suède, n’a en effet jamais été qu’un écran de fumée destiné à dissimuler son affiliation de longue date au bloc occidental depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale.
Le déroulement rapide des événements après l’invasion de l’Ukraine par la Russie a conduit à une grave intensification de la propagande militariste dans les deux pays, inédite dans leur histoire contemporaine. Le mythe des pays nordiques « pacifiques » est clairement percé à jour, et l’OTAN en profitera pour renforcer son flanc nord, ce qui aura pour effet d’étendre l’encerclement de la Russie et ne pourra que conduire à une nouvelle aggravation des conflits impérialistes en Europe.
La Finlande, une « neutralité » forcée contrôlée par la Russie soviétique
La Finlande, qui partage une large frontière avec la Russie (à peu près la même distance qu’entre Lübeck et Monaco), a une toute autre expérience de la « neutralité » que la Suède. Après que la Suède ait perdu la Finlande au profit de la Russie, la Finlande est devenue un grand-duché et faisait partie de la Russie tsariste en 1809, et ce jusqu’en 1917. Les luttes révolutionnaires en Finlande en 1917-1918, qui ont pris la forme d’une guerre civile entre le camp révolutionnaire et les Blancs, ont été écrasées avec l’aide de l’armée allemande. En raison de l’invasion par la Russie en 1939 et de la « guerre d’Hiver » de 1939-40, mais aussi de la guerre contre la Russie aux côtés de l’Allemagne jusqu’à la défaite en 1944, la Finlande a dû se soumettre à de lourdes réparations de guerre à partir de cette même période Cela signifie que la Finlande a été contrainte, après la Seconde Guerre mondiale, d’entretenir une « relation particulière » avec la Russie soviétique et de pratiquer une politique de « neutralité » forcée qui a duré près de cinquante ans, jusqu’à la chute de l’ancien bloc de l’Est. La Finlande était un pays où l’URSS exerçait un important contrôle sans avoir recours à la puissance militaire, comme c’était le cas dans les pays baltes. La politique de « finlandisation » permettait à l’URSS d’avoir le dernier mot lors de l’élection des gouvernements et des présidents, bien que la Finlande ait officiellement une démocratie à l’occidentale.
La Suède : 200 cents ans de « neutralité » et de non-alignement ?
La perte de la Finlande au profit de la Russie en 1809 (considérée comme « la moitié est du Royaume de Suède » depuis le début du Moyen Âge) a porté le coup final aux ambitions de la Suède qui souhaitait maintenir son ancien statut de grande puissance locale. Durant le XVIIIe siècle, la Suède a peu à peu perdu ses anciennes possessions autour de la mer Baltique, et le nouveau roi en place, le général français Jean-Baptiste Bernadotte, a déclaré en 1818 que la Suède, afin de maintenir la paix avec la Russie, devrait rester « neutre » et éviter de contracter des alliances avec d’autres puissances Européennes.
Cette politique de « neutralité » a été rigoureusement appliquée au cours des deux guerres mondiales, même si la majeure partie de la bourgeoisie avait clairement sa préférence pour le camp allemand. Cela a permis le transport de troupes allemandes au travers du pays jusqu’au nord de la Norvège et jusqu’au nord de la Finlande durant les premières années de la Deuxième Guerre mondiale. Lorsque la guerre éclata en Finlande, la Suède soutint son voisin en lui envoyant de la nourriture, des munitions, des armes et des médicaments. Ce n’est que vers le milieu de la guerre, après Stalingrad, que la bourgeoisie suédoise a effectué un virage « opportuniste » et a commencé à soutenir le camp des Alliés.
Alors que les secteurs traditionnels de la bourgeoisie suédoise entretenaient des rapports étroits avec l’Allemagne, les sociaux démocrates, de plus en plus influents grâce à leur hégémonie au pouvoir entre 1933 et 1976, développèrent de forts liens avec les États-Unis et la Grande-Bretagne après la Seconde Guerre mondiale. La politique de « neutralité » signifiait désormais que la Suède (sans le reconnaître officiellement) aidait l’OTAN et le bloc de l’Ouest dans leurs opérations de renseignement à l’encontre de l’Union Soviétique au cours des années 1950 et 1960. Ce n’est qu’au début des années 2000 que ce « secret d’État » a été révélé, bien après la chute du bloc de l’Est.
Le rôle de la Suède dans les années 1960 et 1970, au plus fort de la guerre froide, peut être illustré par le rôle qu’a joué Olof Palme et son éloquente critique de la politique américaine au Vietnam. Le fait d’être un « allié essentiel » des États-Unis était un atout important pour le bloc de l’Ouest, puisque la prétendue neutralité de la Suède pouvait être utilisée afin d’influencer d’anciennes colonies qui risquaient de basculer dans la sphère du bloc de l’Est.
Après la chute du bloc de l’Est, la Suède a réorganisé ses forces militaires et aboli le service militaire obligatoire pendant plus de deux décennies, seulement pour le réinstaurer en 2017. Avec la menace croissante de la Russie au cours de la dernière décennie, la Suède et la Finlande ont développé une affiliation militaire avec les pays de l’OTAN appelée « Partenariat pour la paix », et des discussions ont eu lieu sur une éventuelle collaboration militaire entre la Finlande et la Suède, mais la question de l’adhésion directe à l’OTAN n’était pas inscrite politiquement à l’ordre du jour des deux pays jusqu’à l’invasion de l’Ukraine.
En moins de deux mois, les sociaux-démocrates suédois ont abandonné la politique de « neutralité » et de non-alignement en dépit des fortes critiques au sein même du parti. Alors que la question de l’alignement avec l’OTAN ne figurait pas à l’ordre du jour politique et n’était défendue ouvertement que par une minorité des partis au Parlement, à savoir le Parti libéral, après l’invasion de l’Ukraine, une forte majorité du Parlement suédois a proclamé son soutien au « processus de l’OTAN ». La question de l’OTAN n’a même pas été abordée lors des campagnes électorales suédoises de cette année. Après les élections, la situation n’a pas changé. Les sociaux-démocrates ont été remplacés par une coalition de droite, dans laquelle les démocrates suédois d’extrême-droite joueront un rôle non négligeable. Mais bien que ce parti ait un passé de prises de position et de connexions pro-russes, il a modifié sa position sur l’OTAN au cours du printemps. Le seul parti ouvertement opposé à l’adhésion à l’OTAN est le parti de gauche, l’ancien parti communiste.
De même, lorsque la Première ministre finlandaise Sanna Marin a déclaré que la Finlande devait adhérer à l’OTAN, cela constituait également une rupture totale avec la politique de « neutralité » et avec l’ancienne soumission à son voisin russe pendant la guerre froide.
Rejoindre l’OTAN ne signifie pas « paix et protection » mais un chaos militaire grandissant
Aujourd’hui, le renforcement de l’OTAN sur son flanc nord contient le risque d’une escalade d’un conflit militaire en Europe du nord. Il s’agit d’un autre exemple de la politique à long terme des États-Unis visant à imposer son ordre mondial en encerclant ses principaux rivaux impérialistes, une stratégie qui crée, en réalité, un chaos plus grand, comme l’ont montré les guerres en Afghanistan, en Irak et en Ukraine. Le principal argument en faveur de l’alignement avec l’OTAN a été de « maintenir la paix et la sécurité » et d’attiser ainsi une peur séculaire de la Russie, l’ennemi juré historique des pays scandinaves.
La déclaration de la ministre suédoise des affaires étrangères, Ann Linde, selon laquelle l’adhésion à l’OTAN serait une manière « d’éviter les conflits » et permettrait d’instaurer une situation plus paisible et plus sereine en Europe, est manifestement fausse. Le renforcement de l’OTAN sur son flanc nord signifiera avant tout un renforcement des États-Unis par la mise en place d’un gigantesque bouclier contre la Russie dans les États nordiques et baltes. L’alignement avec l’OTAN et son augmentation obligatoire des budgets militaires à 2 % du PIB (ce qui signifie un renforcement de l’industrie militaire suédoise, Bofors et SAAB) entraînera une instabilité et une insécurité accrues pour la classe ouvrière ainsi que pour l’ensemble de la population. Avec sa tactique hypocrite consistant à apparaître comme « défenseur de la paix » tout en attisant les flammes de la guerre et du chaos, ce revirement stratégique des classes dirigeantes suédoises et finlandaises est un signe clair de l’escalade de la situation en quelques mois seulement.
La militarisation accrue de la société dans les pays Scandinaves (illustrée ce printemps par l’ancienne Première ministre suédoise Magdalena Andersson posant avec un casque dans un char d’assaut lors d’une opération conjointe dirigée par l’OTAN dans le nord) ne conduira qu’à davantage de déstabilisation et de destruction.
Edvin, 19 octobre 2022
Géographique:
- Suède [509]
Récent et en cours:
- OTAN [447]
- Guerre en Ukraine [397]
Rubrique:
Appel à la “sobriété énergétique”: L’État bourgeois fait payer la crise au prolétariat!
- 91 lectures
« On doit tous se bouger » ! « Il va falloir transformer durablement nos habitudes et nos comportements », « résister », « accepter de payer le prix de notre liberté et de nos valeurs », accepter « la fin de l’abondance ». Voilà ce que clame Macron depuis près de deux mois pour justifier d’éventuelles pénuries causées par « l’absence de gaz russe ». Mais rassurons-nous, pour « résister », le gouvernement a tout prévu : il suffit de baisser le chauffage, de couper la wifi, d’éteindre les lumières quand on est absent (d’après le sage conseil d’Olivier Veran, porte-parole du gouvernement…), de porter des pulls à col roulé (selon Bruno Le Maire, le ministre de l’économie et des finances) ou encore de mettre un couvercle pour faire bouillir plus vite l’eau des pâtes… Et pour mieux nous montrer la voie, le château de Versailles, la pyramide du Louvre et la tour Eiffel s’éteindront plus tôt le soir. Ouf, nous voilà sauvés !
On croirait le début d’un sketch humoristique, mais non : il s’agit bien du discours proféré sur toutes les chaînes de télévision et de radio par les principaux représentants de l’État. La société s’auto-détruit, les catastrophes écologiques s’enchaînent, le chaos guerrier s’amplifie, la pauvreté ne cesse d’augmenter, les prix de s’envoler… mais en participant activement au plan de sobriété énergétique de l’État, en faisant chacun de « petits efforts » tout ira pour le mieux dans le meilleur des mondes.
La mystification de l’État « providentiel »
La réalité de toute cette propagande ridicule, c’est une attaque idéologique bien plus sournoise, menée aussi bien par le gouvernement que par tous les partis bourgeois de gauche et écologistes. L’État profite, en effet, de l’atomisation des prolétaires pour développer tout un catéchisme citoyen afin d’accompagner idéologiquement et faire accepter les effets de la crise économique, préparer les esprits à des attaques à venir encore plus brutales, comme la loi sur l’assurance chômage ou celle sur les retraites qui ne visent ni plus ni moins qu’à diminuer le montant des pensions et augmenter le temps de travail. Dans un contexte où la colère reste toujours forte, où la lutte du prolétariat au Royaume-Uni peut trouver des résonances dans d’autres pays comme en France, la bourgeoisie reste sur ses gardes. Par exemple, à travers le fameux « bouclier énergétique » permettant de plafonner le prix de l’énergie, l’État français se présente comme le bon samaritain soucieux du sort des plus démunis au nom de la « solidarité nationale » face à la guerre et d’une prétendue préservation de l’environnement ! Il faut « être au rendez-vous de la solidarité et de la sobriété », martèle le président. Le discours est d’autant plus efficace qu’il joue sur les craintes légitimes : celle de la pénurie, de l’accélération de la crise écologique, des coupures d’électricité, de la crise économique et de la guerre. Au fond, il s’agit d’inculquer aux ouvriers qu’ils doivent soutenir l’État démocratique dans sa prétendue quête de justice, de paix et de préservation de l’environnement, y compris au travers de sacrifices pour la guerre et l’économie de guerre. Cela a d’ailleurs toujours été la logique de la bourgeoisie. Churchill en 1940 n’avait rien d’autre à offrir à la classe ouvrière britannique que « du sang, du labeur, des larmes et de la sueur ». Macron, lui, n’a à offrir que la « fin de l’abondance » et des sacrifices afin de venir, prétendument, en aide « aux plus fragiles » dont le nombre ne cesse d’augmenter.
Ces flots de mensonges déversés par l’ensemble de la bourgeoisie (partis politiques, médias aux ordres, patronat, syndicats…) ne visent qu’à faire croire que l’État est l’instrument de « l’intérêt commun », un organisme au-dessus des classes et de leurs petits intérêts particuliers. Autrement dit, un « État providentiel » ! En réalité, cet organe apparu en relation avec le développement des sociétés de classes, est toujours au service de la classe dominante ! Comme l’affirmait Engels dans l’Anti-Dühring : « l’État moderne, quelle qu’en soit la forme, est une machine essentiellement capitaliste : l’État des capitalistes, le capitaliste collectif idéal. Plus il fait passer de forces productives dans sa propriété, et plus il devient capitaliste collectif en fait, plus il exploite de citoyens. Les ouvriers restent des salariés, des prolétaires. Le rapport capitaliste n’est pas supprimé, il est au contraire poussé à son comble ». C’est bien l’État capitaliste, qu’il soit patron ou non, qui a contribué à la dégradation de nos salaires et de nos conditions de vie, qui a renforcé l’exploitation des ouvriers depuis des décennies !
Culpabiliser les individus pour mieux dédouaner le capitalisme
De plus, par des slogans tels que « chacun a son rôle à jouer », « la solution est dans notre main », le gouvernement rend chaque ouvrier responsable de la « sur-consommation » énergétique et de la destruction de la planète. Il appelle à se sacrifier et faire de son mieux pour l’effort national en nourrissant un sentiment de culpabilité. La bourgeoisie ne se privera d’ailleurs pas d’expliquer, lorsque les attaques deviendront plus insupportables encore, que tout est de la faute des « égoïstes » qui n’ont pas « joué le jeu ». Alors qu’en réalité la prédation et l’accaparement frénétique des ressources sont essentiellement à mettre sur le compte d’un complexe industriel de l’industrie lourde au service de la machine de guerre, de l’agriculture intensive, du pillage des terres rares et des forêts, de l’anarchie de la production, etc., c’est-à-dire un système qui ne peut exister sans la recherche constante du profit et de l’accumulation.
La fameuse « sobriété » est, en effet, uniquement au service des besoins et des intérêts de la classe dominante, elle n’est rien d’autre que l’une des conséquences du développement de l’économie de guerre et prend la forme d’une véritable insulte pour tous les exploités connaissant les situations de précarité les plus extrêmes et vivant au quotidien, dans leur chair, la « sobriété » des conditions d’existence imposée par l’exploitation de la force de travail par le capitalisme à la surface du monde.
Car tandis que le budget de la Défense explose (en augmentation de 3 milliards d’euros par an entre 2022 et 2025) manifestant par là les velléités toujours plus guerrières de tous les États qui alimentent une concurrence sauvage, les ouvriers doivent se serrer encore plus la ceinture et en subir les conséquences : inflation galopante, pénuries à venir, système de soins à l’agonie, système éducatif à bout de souffle, précarisation des contrats de travail, réforme des retraites à venir, etc. Quelle indécence que d’exiger de « baisser la température dans les foyers » quand une partie toujours plus croissante de la population vie dans des logements mal isolés, quand le prix de l’énergie est tel que des millions de personnes peuvent déjà difficilement se chauffer, alors que des millions d’autres sombrent chaque jour un peu plus dans la « précarité énergétique » à mesure qu’augmentent les prix du gaz et de l’électricité !
Dans le capitalisme, ce système qui ne peut survivre qu’en détruisant la planète, il n’y a pas de solution : ni au réchauffement climatique, ni aux guerres, ni au chômage, ni à la précarité, ni à la misère. Seule la lutte du prolétariat mondial soutenue par tous les opprimés et exploités du monde peut ouvrir la voie à une alternative.
Jeanne, 9 octobre 2022
Rubrique:
Permanence en ligne du 10 décembre 2022
- 70 lectures
Le Courant Communiste International organise une permanence en ligne le samedi 10 décembre 2022 à partir de 14h.
Ces permanences sont des lieux de débat ouverts à tous ceux qui souhaitent rencontrer et discuter avec le CCI. Nous invitons vivement tous nos lecteurs, contacts et sympathisants à venir y débattre afin de poursuivre la réflexion sur les enjeux de la situation et confronter les points de vue. N'hésitez pas à nous faire part des questions que vous souhaiteriez aborder.
Les lecteurs qui souhaitent participer aux permanences en ligne peuvent adresser un message sur notre adresse électronique ([email protected] [213]) ou dans la rubrique “nous contacter [214]” de notre site internet, en signalant quelles questions ils voudraient aborder, afin de nous permettre d’organiser au mieux les débats.
Les modalités techniques pour se connecter à la permanence seront communiquées ultérieurement.
Vie du CCI:
- Permanences [291]
Rubrique:
ICCOnline - décembre 2022
- 38 lectures
L’autonomie de la classe ouvrière est une nécessité
- 113 lectures
Les vastes manifestations en Iran ont été déclenchées par le meurtre en détention d’une jeune femme arrêtée pour « port incorrect du hijab » par la police des mœurs du régime, mais elles témoignent d’un mécontentement beaucoup plus profond au sein de la population iranienne, des centaines de milliers de personnes ayant afflué dans les rues et affronté la police. Au-delà d’un écœurement généralisé face à l’oppression ouverte et légale des femmes par la République islamique, elles sont une réaction à l’inflation galopante et aux pénuries exacerbées par les sanctions imposées par l’Occident à l’encontre de l’Iran et fortement aggravées par le lourd et ancien poids d’une économie de guerre gonflée par la poursuite incessante des ambitions impérialistes de l’Iran. Elles sont également une réaction à la corruption sordide de l’élite dirigeante qui ne peut se maintenir que par une répression brutale de toutes les formes de protestation, y compris la résistance de la classe ouvrière à la stagnation des salaires et aux conditions de travail misérables. Le parlement iranien vient d’adopter de nouvelles lois sanctionnant les exécutions pour des crimes « politiques », et des centaines, voire des milliers de manifestants ont été tués ou blessés par la police de l’État et les grotesquement mal nommés « gardiens de la révolution ».
Ce recours à la répression directe est un signe de la faiblesse du régime des Mollahs, et non de sa force. Il est vrai que le résultat désastreux des interventions américaines au Moyen-Orient depuis 2001 a créé une brèche qui a permis à l’impérialisme iranien d’avancer ses pions en Irak, au Liban, au Yémen et en Syrie, mais les États-Unis et leurs alliés les plus fiables (la Grande-Bretagne en particulier) ont répondu en alimentant l’armée saoudienne dans la guerre du Yémen et en imposant des sanctions paralysantes à l’Iran sous prétexte de s’opposer à sa politique de développement des armes nucléaires. Le régime se retrouve de plus en plus isolé, et le fait qu’il fournisse des drones à la Russie pour attaquer les infrastructures et les civils en Ukraine ne fera que renforcer les voix occidentales qui demandent que l’Iran soit traité, aux côtés de la Russie, comme un État paria. Les relations de l’Iran avec la Chine sont une autre raison pour laquelle les puissances occidentales veulent le voir affaibli encore plus qu’il ne l’est déjà. Parallèlement, nous assistons à un effort concerté des gouvernements des États-Unis et d’Europe occidentale pour instrumentaliser les manifestations, notamment en s’emparant du slogan le plus connu des protestations, « Femmes, Vie, Liberté » :
« Le 25 septembre 2022, le journal français Libération ornait sa première page du slogan “Femmes, Vie, Liberté” en perse et en français accompagné d’une photo de la manifestation. Lors d’un discours sur la répression des manifestants en Iran, une membre du Parlement de l’Union Européenne a coupé ses cheveux en prononçant les mots “Femmes, Vie, Liberté” dans l’enceinte même du Parlement de l’Union Européenne ». (1) De nombreux autres exemples pourraient être énoncés.
Quel genre de révolution est à l’ordre du jour en Iran ?
Compte tenu de la faiblesse du régime, on parle beaucoup d’une nouvelle « révolution » en Iran, notamment de la part des gauchistes et des anarchistes de tous bords, ces derniers parlant d’une « insurrection féministe », tandis que les factions bourgeoises les plus traditionnelles évoquent un renversement « démocratique », avec l’installation d’un nouveau régime qui abandonnerait son hostilité envers les États-Unis et leurs alliés. Mais comme nous l’avions écrit en réponse à la mystification sur la « révolution » de 1978-1979 : « les événements en Iran font apparaître que la seule révolution qui soit à l’ordre du jour, dans les pays arriérés, comme partout ailleurs dans le monde aujourd’hui, est la révolution prolétarienne ». (2)
Contrairement à la révolution de 1917 en Russie, qui se voulait un élément de la révolution mondiale, les protestations actuelles en Iran ne sont pas menées par une classe ouvrière autonome, organisée par ses propres organes unitaires et capable d’offrir une perspective à toutes les couches et catégories opprimées de la société. Il est vrai qu’en 1978-1979, nous avons eu des aperçus du potentiel de la classe ouvrière à offrir une telle perspective : « Venant à la suite des luttes ouvrières dans divers pays d’Amérique Latine, en Tunisie, en Égypte, etc., les grèves des ouvriers iraniens ont constitué l’élément politique majeur qui a conduit au renversement du régime du Shah. Alors que le mouvement “populaire” regroupant la presque totalité des couches de la société iranienne tendait, malgré ses mobilisations de masse, à s’épuiser, l’entrée dans la lutte du prolétariat d’Iran à partir d’octobre 1978, notamment dans le secteur pétrolier, non seulement relançait l’agitation mais allait poser au capital national de ce pays un problème pratiquement insoluble ». (3)
Pourtant, nous savons que même à cette époque, la classe ouvrière n’était pas assez forte politiquement pour empêcher le détournement du mécontentement de masse par les Mollahs, soutenus par une foule de gauchistes « anti-impérialistes ». La lutte de classe internationale, bien qu’entrant dans une deuxième vague de mouvements ouvriers depuis Mai 68 en France, n’était pas à même de poser la perspective d’une révolution prolétarienne à l’échelle mondiale, et les ouvriers en Iran (comme ceux de Pologne un an plus tard) n’étaient pas en mesure de poser l’alternative révolutionnaire par eux-mêmes. Ainsi, la question de savoir comment entrer en relation avec les autres couches opprimées est restée sans réponse. Comme le disait encore notre déclaration : « La place décisive occupée par le prolétariat dans les événements en Iran pose un problème essentiel que celui-ci devra résoudre pour mener à bien la révolution communiste : celui de ses rapports avec l’ensemble des autres couches non-exploiteuses de la société et notamment les sans-travail. Ce que démontrent ces événements, c’est que :
– ces couches, par elles-mêmes, et malgré leur nombre, ne constituent pas une force réelle dans la société ;
– bien plus que le prolétariat, elles sont perméables aux différentes formes de mystification et d’encadrement capitalistes, y compris les plus archaïques comme la religion ;
– en même temps, dans la mesure, où la crise les frappe avec autant ou plus de violence qu’elle frappe la classe ouvrière, elles constituent une force d’appoint dans la lutte contre le capitalisme dont la classe ouvrière peut et doit prendre la tête.
Face à toutes les tentatives de la bourgeoisie de défouler leur mécontentement dans des impasses, l’objectif du prolétariat est de mettre en évidence qu’aucune des “solutions” proposées par le capitalisme ne peut leur apporter une quelconque amélioration, et que c’est uniquement dans le sillage de la classe révolutionnaire qu’elles peuvent obtenir satisfaction pour leurs aspirations, non comme couches particulières, historiquement condamnées, mais comme membres de la société. Une telle politique suppose de la part du prolétariat son autonomie organisationnelle et politique, c’est-à-dire, en particulier, le rejet de toute politique “d’alliance” avec ces couches ».
Aujourd’hui, les mystifications qui mènent le mouvement populaire dans une impasse ne sont pas tant les mystifications religieuses, ce qui est compréhensible lorsque les masses peuvent facilement voir le visage nu et corrompu d’un État théocratique, que les idéologies bourgeoises plus « modernes » comme le féminisme, la liberté et la démocratie.
Mais le danger est encore plus grand de voir la classe ouvrière se dissoudre en tant que masse d’individus dans un mouvement inter-classiste qui n’a pas la capacité de résister aux plans de récupération des factions bourgeoises rivales. Ceci est souligné par le contexte international de la lutte des classes, où la classe ouvrière commence à peine à se réveiller après une longue période de repli au cours de laquelle la décomposition progressive de la société capitaliste a de plus en plus rongé la conscience que le prolétariat avait de lui-même en tant que classe.
Le militantisme des ouvriers et les tromperies des gauchistes
Il ne s’agit pas de nier le fait que le prolétariat a, en Iran, une longue tradition de lutte militante. Les événements de 1978-1979 sont là pour le prouver ; en 2018-2019, il y a eu des luttes très étendues impliquant les ouvriers de la canne à sucre de Haft Tappeh, les camionneurs, les enseignants et d’autres ; en 2020-2021, les travailleurs du pétrole ont entamé une série de grèves militantes à l’échelle nationale. À leur apogée, ces mouvements ont donné des signes clairs de solidarité entre divers secteurs confrontés à la répression de l’État et à de puissantes pressions pour que les travailleurs reprennent le travail. En outre, face à la nature ouvertement pro-régime des syndicats officiels, il y a également eu des signes importants d’auto-organisation des travailleurs dans beaucoup de ces luttes, comme nous l’avons vu avec les comités de grève en 1978-1979, les assemblées et les comités de grève à Haft Tappeh et plus récemment dans les zones pétrolières. Il ne fait également aucun doute que les ouvriers discutent de ce qu’il convient de faire face aux manifestations actuelles et que des appels à la grève ont été lancés pour protester contre la répression de l’État. Et nous avons vu, par exemple en Mai 68, que l’indignation contre la répression de l’État, même si elle n’est pas initialement dirigée contre les travailleurs, peut être une sorte de catalyseur pour que ces derniers entrent sur la scène sociale, à condition qu’ils le fassent sur leur propre terrain de classe et en utilisant leurs propres méthodes de lutte. Mais pour le moment, ces réflexions de classe, cette colère contre la brutalité du régime, semblent être sous le contrôle des organes syndicaux de base et des gauchistes, qui tentent de créer un faux lien entre la classe ouvrière et les protestations populaires, en ajoutant des revendications « révolutionnaires » aux slogans de ces dernières.
Comme l’écrit Internationalist Voice : « La phrase “femme, vie, liberté” est enracinée dans le mouvement national et n’a pas de connotation de classe. C’est pourquoi ce slogan est brandi de l’extrême droite à l’extrême gauche, et ses échos se font entendre dans les parlements bourgeois. Ses composantes ne sont pas des concepts abstraits, mais une caractéristique des relations de production capitalistes. Un tel slogan fait des femmes qui travaillent l’armée noire du mouvement démocratique. Cette question devient un problème pour la gauche du capital, qui emploie le terme radical de “révolution”, et suggère donc que ce slogan soit “conservé” en y ajoutant des extensions. Ils ont fait les suggestions suivantes :
– Femme, vie, liberté, administration municipale (trotskistes) ;
– Femme, vie, liberté, socialisme ;
– Femme, vie, liberté, gouvernement ouvrier ».(4)
Cet appel au conseil ou au pouvoir des soviets circule en Iran au moins depuis 2018. Même s’il trouve son origine dans les efforts réels mais embryonnaires d’auto-organisation à Haft Tappeh et ailleurs, il est toujours dangereux de confondre l’embryon avec sa forme achevée. Comme Bordiga l’a expliqué dans sa polémique avec Gramsci lors des occupations d’usines en Italie en 1920, les conseils ouvriers ou soviets représentent une étape importante, au-delà des organes défensifs comme les comités de grève ou les conseils d’usine, car ils sont l’expression d’un mouvement vers une lutte unifiée, politique et offensive de la classe ouvrière. Les gauchistes qui prétendent que c’est aujourd’hui à l’ordre du jour trompent les travailleurs, avec pour objectif de mobiliser leurs forces dans une lutte pour une forme « de gauche » de gouvernement bourgeois, ornée « d’en bas » par de faux conseils ouvriers.
Les tâches de la gauche communiste
Internationalist Voice poursuit ainsi : « Contrairement à ceux de la gauche du capital, la tâche des communistes et des révolutionnaires n’est pas de sauver les slogans anti-dictature, mais d’assurer la transparence quant à leur origine et leur contenu. Encore une fois, en opposition aux démagogues de la gauche du capital, se distancer de tels slogans et élever les revendications de classe du prolétariat est un pas dans la direction de la clarification de la lutte de classe ».
Cela est vrai même si cela signifie que les révolutionnaires doivent nager à contre-courant pendant les moments d’euphorie « populaire ». Malheureusement, tous les groupes de la gauche communiste ne semblent pas être à l’abri de certaines des tromperies les plus radicales injectées dans les manifestations. Nous pouvons ici identifier deux exemples inquiétants dans la presse de la Tendance communiste internationaliste (TCI). Ainsi, dans l’article « Voix ouvrières et révoltes en Iran », (5) la TCI publie des déclarations sur les protestations par le Syndicat des Travailleurs de la Canne à Sucre Haft Tappeh, du Conseil pour l’organisation des protestations des travailleurs contractuels du pétrole et du Conseil de coordination des organisations syndicales des enseignants iraniens. Sans doute ces déclarations sont-elles une réponse à une authentique discussion sur les lieux de travail quant à la manière de réagir aux mouvements de protestation, mais le premier et le troisième de ces organismes ne se cachent pas d’être des syndicats (même s’ils peuvent tirer leurs origines d’authentiques organes de classe, en devenant des structures permanentes, ils ne peuvent qu’avoir assumé une fonction syndicale) et ne peuvent donc pas jouer un rôle indépendant de la gauche du capital qui, comme nous l’avons dit, ne défend pas l’autonomie réelle de la classe mais cherche à utiliser le potentiel des ouvriers comme outil de « changement de régime ».
Parallèlement à cela, la TCI ne parvient pas non plus à se distinguer de la rhétorique gauchiste sur le pouvoir des soviets en Iran. Ainsi, l’article « Iran : Imperialist Rivalries and the Protest Movement of “Woman, Life, Freedom” », (6) tout en fournissant des éléments importants concernant les tentatives de récupération des manifestations par les puissances impérialistes extérieures à l’Iran, annonce : « Dans notre prochain article, nous plaiderons pour une autre alternative : du pain, des emplois, la liberté, le pouvoir aux Soviets. Nous traiterons de la lutte des travailleurs et des tâches des communistes, et à la lumière de cela, nous exposerons la perspective internationaliste ».
Mais nous ne sommes pas à Petrograd en 1917, et appeler au pouvoir des soviets alors que la classe ouvrière est confrontée à la nécessité de défendre ses intérêts les plus fondamentaux face au danger de se dissoudre dans les manifestations de masse, de défendre toute forme naissante d’auto-organisation contre leur récupération par les gauchistes et les syndicalistes de base, c’est au mieux se tromper gravement sur le niveau actuel de la lutte de classe et au pire attirer les ouvriers dans des mobilisations sur le terrain de la gauche du capital. La gauche communiste ne développera pas sa capacité à élaborer une véritable intervention dans la classe en se laissant prendre au piège de l’immédiatisme au détriment des principes fondamentaux et d’une analyse claire du rapport de force entre les classes.
Un article récent dans Internationalist Voice souligne qu’il y a actuellement un certain nombre de grèves ouvrières qui ont lieu en Iran en même temps que les manifestations dans les rues : « Ces derniers jours, nous avons assisté à des manifestations et à des grèves de travailleurs, dont la caractéristique commune était la protestation contre le faible niveau de leurs salaires et la défense de leur niveau de vie. Le slogan des ouvriers grévistes de l’entreprise sidérurgique d’Ispahan, “assez de promesses, notre table est vide”, reflète les conditions de vie difficiles de l’ensemble de la classe ouvrière. Voici quelques exemples de grèves ouvrières de ces derniers jours qui avaient ou ont la même revendication : Grève des travailleurs de la compagnie sidérurgique d’Ispahan ; grève de la faim des employés officiels des sociétés de raffinage et de distribution de pétrole, de gaz et de produits pétrochimiques ; grève des travailleurs du complexe du centre-ville d’Ispahan ; grève des travailleurs de la cimenterie d’Abadeh dans la province d’Ispahan ; grève des travailleurs de l’eau minérale de Damash dans la province de Gilan ; grève des travailleurs de la compagnie Pars Mino ; grève des travailleurs de la compagnie industrielle Cruise ; protestation des travailleurs du groupe sidérurgique national ». (7)
Il semble que ces mouvements soient encore relativement dispersés et si les démocrates et les gauchistes multiplient les appels à la « grève générale », ce qu’ils entendent par là n’a rien à voir avec une réelle dynamique vers la grève de masse, mais serait une mobilisation contrôlée d’en haut par l’opposition bourgeoise et mélangée aux grèves des petits commerçants et d’autres couches non prolétariennes. Cela ne fait que souligner la nécessité pour les ouvriers de rester sur leur propre terrain et de développer leur unité de classe comme base minimale pour bloquer la répression meurtrière du régime islamique.
Amos, novembre 2022
1 « The continuation of the protests, labour strikes and general strike [510] », Internationalist Voice (20 novembre 2022).
2 « Iran : leçons des événements », Révolution internationale n° 59 [511] (17 février 1979).
3 Ibid.
4 « The continuation of the protests, labour strikes and general strike [510] », Internationalist Voice (20 novembre 2022).
5 « Voix ouvrières et révoltes en Iran [512] » sur le site de la TCI (1er novembre 2022).
6 « Iran : Imperialist Rivalries and the Protest Movement of 'Woman, Life, Freedom [513]'" sur le site de la TCI (2 novembre 022).
7 « The continuation of the protests, labour strikes and general strike [510] », Internationalist Voice (20 novembre 2022).
Rubrique:
Quel contenu doit prendre l’intervention des révolutionnaires contre la guerre en Ukraine?
- 182 lectures
Nous publions ci-dessous un extrait du courrier que nous a adressé un lecteur à propos de notre tract international [445] sur la guerre en Ukraine, suivi de la réponse du CCI.
Réception du tract international sur la guerre en Ukraine
Les réactions ont été glanées ici et là et en aucune sorte elles ne sauraient avoir un caractère général sur la perception de cette guerre par la classe ouvrière ou par la population en général. Pour cela, l’étude doit bien évidemment être plus longue et la méthode plus scientifique. Aussi, seule une « enquête ouvrière » pourrait revêtir un aspect objectif.
La guerre en Europe n’est pas une nouveauté, ainsi certains ont du mal à comprendre le caractère spécial de cette guerre si ce n’est la propagande officielle faisant de l’impérialisme russe le « mauvais ». (…) Le tract souligne l’importance pour la classe ouvrière et donc pour les minorités communistes de ne pas prendre parti entre les différents impérialismes dans les luttes que ceux-ci se mènent. Des décennies de propagande stalinienne et/ou tiers-mondiste rendent complexe les prises de positions pour aucun des deux protagonistes étatiques.
Ainsi, il m’a été donné d’entendre des prises de positions fortement « pro-russes » en réalité pour des raisons « d’anti-américanisme ». Il est parfois également difficile d’admettre pour certains la nature impérialiste de l’État russe. « L’impérialisme » ou « les impérialistes » sont utilisés pour parler des puissances de l’Otan et de l’Europe de l’Ouest.
(Le CCI revient sur l’historique des guerres passées depuis la Deuxième Guerre mondiale ce qui est apprécié en raison de la clarté que cela apporte mais a posé des questions par rapport à l’équivalence des différents conflits évoqués.)
La guerre aux périphéries de la Russie n’est également pas nouvelle. Les dernières guerres en Tchétchénie, en Géorgie, entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan, et surtout la guerre larvée entre les deux factions Ukrainiennes, l’une à Kiev et l’autre à Donetsk.
La nouveauté et la surprise résident dans l’intervention directe de l’État russe et dans l’ampleur de cette intervention. Cependant, tandis que le militarisme russe était présenté comme une puissance titanesque, la lenteur de l’avancée militaire russe me fait craindre une surestimation de la puissance militaire russe. Je ne sais pas si les analogies avec la Guerre d’Hiver sont appropriées, ni si elles ont été déjà trop faites mais dans ce cadre elle me semble adéquate.
L’embrigadement de la classe ouvrière derrière la défense de la « patrie » ou de la « démocratie » n’est en revanche pas encore là. Bien qu’il soit évident que dans le cadre électoral la bourgeoisie tente à travers cela d’embrigader une partie de la population derrière elle mais cela semble avoir du mal à prendre. J’admets n’avoir entendu qu’une seule fois la phrase « le dilemme aujourd’hui, c’est qui mettre face à Poutine ». En revanche les positions internationalistes demeurent faibles. Le désintéressement semble être important surtout chez les jeunes.
La guerre quitte les périphéries pour se rapprocher des centres du capitalisme. En se rapprochant des centres elle se met face au danger que représente le prolétariat des pays avancés. La réaction de la classe ouvrière face à l’embrigadement pour la défense de la démocratie semble confirmer le cadre de la décomposition, à savoir que le prolétariat serait trop faible pour s’affirmer de manière offensive, mais pas encore vaincu au point de marcher directement derrière l’État. En ce sens, j’attends avec impatience les articles de polémiques prévues car ils reviendront certainement sur la décomposition et cela me permettra d’approfondir encore un peu.
La guerre nécessite l’intervention des communistes assumant la direction de la propagande contre la guerre, cependant, quelles perspectives de politisation de la classe ouvrière sont ouvertes sur ce thème ? Promouvoir les positions et les intérêts internationalistes du prolétariat est nécessaire mais le tract ne revient que de manière trop large et trop abstraite sur les conséquences économiques en termes de hausse des prix à venir. Or c’est sur ces points qu’il faut insister. Il faudrait peut-être traiter du salaire réel.
Je ne connais pas le calendrier qui a été adopté par l’organisation et si éventuellement d’autres interventions sont prévues sur des points plus spécifiques comme la pression économique qui va s’exercer sur les travailleurs du fait de l’inflation et contre l’embrigadement derrière le Macron chef de guerre démocrate ou les autres candidats développant un point de vue sur un terrain « pacifiste » ou « multipolaire », etc.
Je ne sais pas si tous les problèmes posés par cette guerre peuvent être traités comme un tout et sur un seul front. Je suis trop peu expérimenté pour répondre à la question.
La question des moyens utilisés pour politiser, et du processus de politisation renvoient au rapport de force entre les classes et la « mesure » de la conscience de classe.
Empiriquement, il peut y avoir quelques méthodes ou techniques pour prendre la température mais c’est l’attention portée par la classe aux révolutionnaires et leur propagande qui est déterminante. Ainsi, sur la forme du tract je ne comprends pas pourquoi il ne fait pas émerger des mots d’ordre clairs qui pourront être utilisés. Il ne s’agit en aucun cas d’activisme mais de clarté. Un mot d’ordre pour chaque question soulevée par le conflit c’est-à-dire :
1. L’impérialisme et la réponse internationaliste.
2. Les conséquences à venir pour les ouvriers de tous les pays en matière de baisse du pouvoir d’achat.
3. Lutter contre l’embrigadement derrière l’idéologie démocratique ou derrière le pacifisme.
En fait le CCI évoque toutes ces questions donc ce n’est vraiment qu’une question de forme sur le tract, sur la clarté des mots d’ordres transmis.
Albert, mars 2022
Réponse du CCI
Nous saluons fortement la démarche du camarade consistant à prendre position sur notre tract international (1) et nous rapporter les discussions qu’il a pu avoir à son sujet. Le CCI a besoin de telles initiatives qui stimulent son intervention en la soutenant, la questionnant ou la critiquant. C’est quelque chose d’indispensable pour rendre plus convaincante notre argumentation. Il ne s’agit pas ici d’une « lubie » du CCI, mais de la méthode du mouvement ouvrier. Ainsi l’Iskra (2) dédiait une page de chacun de ses numéros à la publication de correspondances. La Revue Bilan (3), malgré le contexte très défavorable de la contre-révolution, ne perdait pas une occasion de publier des correspondances. En retour, le CCI doit avoir à cœur de répondre le plus clairement possible aux courriers qu’il reçoit.
Pour le camarade Albert, notre tract serait trop abstrait, pas assez en phase avec les réflexions actuelles dans la classe et ses besoins immédiats face à la situation. Le camarade avance notamment la nécessité d’insister davantage sur les conséquences de la guerre sur le plan économique et sur la pression qui va en résulter sur la classe ouvrière. Selon lui, un tel axe d’intervention serait plus à même d’orienter concrètement la classe ouvrière. Avant d’aller plus loin dans la réponse aux critiques du camarade, nous voulons particulièrement soutenir la préoccupation portée par ce courrier à l’intervention des révolutionnaires tout particulièrement dans des moments « brûlants » nécessitant de défendre des principes fondamentaux tels que l’internationalisme prolétarien.
Si notre tract, publié le 27 février, n’intervient pas d’emblée sur les conséquences économiques de la guerre sur la classe ouvrière, c’est parce que, à ce moment-là, cela n’était pas la priorité. En effet, face à un événement d’une telle importance pour le futur, la priorité ne pouvait que s’articuler, selon nous, autour des axes suivants :
- la réaffirmation des principes prolétariens face à la guerre ;
- la dénonciation des mensonges de la propagande guerrière et de la nature impérialiste de tous les États ;
- la réaffirmation de la véritable solidarité à travers le développement, partout dans le monde, de luttes ouvrières massives et conscientes.
Ne pas s’en tenir à cette priorité dans une intervention par tract, à ce moment-là, aurait constitué de notre part une grave erreur politique.
Tout comme notre lecteur, nous sommes convaincus que la clé du problème se trouve dans la mobilisation de la classe ouvrière pour la défense intransigeante de ses conditions de vie face aux attaques croissantes du capitalisme en crise. En effet, pour survivre, celui-ci est contraint d’attaquer toujours plus les conditions de vie du prolétariat et ce dernier, pour survivre, sera également contraint de se défendre de façon toujours plus massive, consciente et unie… jusqu’au renversement du capitalisme ou sa propre défaite.
C’est la raison pour laquelle, très rapidement, la question du nécessaire développement de la lutte de classe a occupé une place plus importante dans notre intervention et ce sera de plus en plus le cas (4). Mais pas de façon abstraite ou à travers des mots d’ordre ne correspondant pas aux possibilités immédiates de la classe ouvrière qui, lorsque qu’éclata la guerre en Ukraine, n’avait pas encore totalement dépassé une certaine paralysie résultant de la pandémie. De plus, la guerre, le déchaînement de la barbarie et aussi en partie les campagnes démocratiques ont plongé, dans un premier temps, la classe ouvrière dans un état de sidération.
Les grèves en Grande-Bretagne ces derniers mois ont révélé un changement significatif de la situation comme nous l’avons affirmé dans un nouveau tract diffusé à l’échelle internationale et dans lequel nous avons particulièrement mis en évidence la nécessité de lutter tous ensemble, en recherchant la solidarité entre les différents secteurs alors que les syndicats n’ont de cesse d’isoler et de diviser les luttes.
Cependant, l’intervention d’une organisation révolutionnaire ne peut se résumer à des tracts, ou à des articles traitant de la lutte de classe, même s’ils sont indispensables.
En effet, si de par sa forme, une intervention par tract permet une diffusion plus large, elle ne permet cependant pas de développer une analyse politique et historique en profondeur de la situation. Or, une telle analyse est absolument indispensable et prioritaire face à des événements, comme l’éclatement de la guerre en Ukraine, de portée mondiale et impactant fortement le futur.
Si le CCI, armé de ses propres analyses, n’intervient pas à ce niveau-là, personne ne viendra défendre à sa place ses propres positions. Cet aspect de notre intervention a été dominant depuis le début du conflit. C’était indispensable afin de nous porter à la hauteur de notre responsabilité consistant à contribuer activement au développement de la conscience au sein de la classe ouvrière. Nous ne pouvions pas faire l’impasse sur les questions suivantes :
- Comprendre la signification de la guerre dans la période de décadence du capitalisme ;
- Comprendre les caractéristiques de la phase actuelle de décomposition du capitalisme et son impact sur les tensions impérialistes :
- Comprendre les visées impérialistes des différents protagonistes ;
- Evaluer la vulnérabilité des différentes factions mondiales du prolétariat aux sirènes nationalistes ;
En fait, le camarade a conscience que l’intervention d’une organisation révolutionnaire concerne différentes questions : « Je ne sais pas si tous les problèmes posés par cette guerre peuvent être traités comme un tout et sur un seul front. ». À ce propos, nous voulons insister sur ce fait que l’intervention d’une organisation révolutionnaire nécessite un cadre d’analyse qui lui-même doit être vérifié et enrichi par les situations qui se présentent afin de pouvoir faire face aux défis de la période historique. Ce cadre d’analyse doit non seulement sous-tendre notre intervention mais également être présenté au lecteur de façon adaptée.
Enfin, il est une dimension essentielle de note intervention qui doit également être pris en compte : l’appel lancé aux groupes de la Gauche communiste pour défendre conjointement l’internationalisme prolétarien face à l’éclatement du chaos guerrier en Europe. Cette initiative, ayant par la suite donné lieu à une Déclaration commune de plusieurs groupes de la Gauche communiste, se plaçait résolument dans l’héritage du mouvement révolutionnaire et tout particulièrement dans le sillage de la conférence de Zimmerwald. Celle-ci fut un événement majeur pour la défense de l’internationalisme en pleine boucherie mondiale et fièvre nationaliste. Mais elle fut aussi, sous l’impulsion des bolcheviks, un moment charnière permettant de poser les bases politiques pour le regroupement des forces révolutionnaires en vue de la fondation du nouveau parti, après la faillite de la IIe Internationale.
L’intervention par voie de presse est une tâche essentielle et permanente des organisations révolutionnaires. C’est notamment par ce biais que les révolutionnaires peuvent pleinement jouer leur rôle au sein de la classe. Mais pour que celui-ci soit le plus efficient possible il demeure indispensable que leurs prises de position répondent aux besoins concrets de la classe mais toujours avec la boussole pointée dans la même direction : la défense de la perspective révolutionnaire et la nécessité du communisme.
CCI, octobre 2022
2 Organe du Parti ouvrier social-démocrate de Russie (POSDR). Il fut publié à partir de 1900, sous la direction de Lénine, Martov et Plekhanov.
3 Organe théorique de la fraction de Gauche du Parti communiste d’Italie.
4 Nous avons déjà commencé en publiant :
- Face à la guerre comme face à la crise, la classe ouvrière ne doit accepter aucun sacrifice [440] (29 mars 1922).
- Face à la guerre impérialiste, opposons la lutte de classe ! [439] (6 avril 1922).
Vie du CCI:
- Courrier des lecteurs [252]
Récent et en cours:
- Guerre en Ukraine [397]
Rubrique:
L’identité de classe et la perspective révolutionnaire
- 109 lectures
Nous publions ci-dessous une contribution de la camarade Rosalie qui prolonge un aspect abordé lors de la réunion publique tenue à Paris le 17 septembre dernier. Nous partageons globalement les réflexions de la camarade et voulons saluer l’effort théorique produit sur un sujet aussi essentiel pour la perspective révolutionnaire.
Nous voulons cependant faire quelques remarques. Premièrement, la camarade écrit : « À l’origine du capitalisme, les choses étaient simples : on était ouvrier, paysan ou bourgeois et pour ce qui concernait les ouvriers, les revendications étaient sur le terrain des améliorations de salaire ». En fait, les oppressions raciale, féminine ou encore homosexuelle existaient. Seule la dégradation de l’environnement n’en était pas au point de mettre en péril la survie même de la civilisation. Surtout, dans la période de décadence du capitalisme, le prolétariat ne peut plus obtenir d’amélioration significative des conditions d’existence. La bourgeoisie utilise donc tous les moyens pour détourner la classe de son propre terrain de lutte, les luttes parcellaires faisant évidemment partie de ces moyens.
Nous voulons particulièrement insister sur le fait que derrière le développement des multiples « luttes identitaires » évoqués par la camarade, se cache le danger des luttes parcellaires susceptibles de happer des parties de la classe ouvrière sur des terrains de luttes totalement stériles et néfastes à l’affirmation de l’identité de la classe ouvrière, classe exploitée à l’échelle internationale. Aussi, ce n’est qu’en s’efforçant de développer ses luttes de façon autonome que la classe ouvrière sera peu à peu en mesure de recouvrer son identité.
Si dans ce processus long et sinueux, il s’agira d’être attentif aux réactions de la classe ouvrière dans des pays tels que la Chine ou l’Inde comme le souligne la camarade, il faut être clair et lever toute ambiguïté sur le fait que la clé demeure entre les mains du prolétariat des pays centraux du capitalisme, le plus expérimenté et donc le plus capable de déjouer les pièges de la bourgeoisie. C’est à lui qu’incombe la plus grande responsabilité dans la capacité du prolétariat mondial à ouvrir une nouvelle période révolutionnaire. D’autant, que c’est dans ces mêmes pays que figurent les principaux groupes historiques du milieu politique prolétarien.
Malgré son importance sur le plan quantitatif, le prolétariat des pays périphériques reste marqué par des faiblesses beaucoup plus importantes liées à son manque d’expérience. C’est la raison pour laquelle le CCI rejette la théorie du « maillon le plus faible », point de vue de Lénine et développé par l’Internationale communiste. (1)
Enfin, nous voulons fortement souligner la conclusion dressée par la camarade qui pose de façon particulièrement claire l’enjeu contenu dans les luttes présentes et à venir, dans la capacité de la classe ouvrière à recouvrer son identité et développer sa conscience de classe.
Par contre, le prolétariat n’est pas révolutionnaire du simple fait qu’il soit une classe de « dépossédé et d’exploité » comme le souligne la camarade mais aussi par le fait que, pour se libérer de cette exploitation, il doit mettre fin à toute forme de société de classes. La classe ouvrière étant la seule classe sociale permettant de dépasser la société capitaliste.
RI
Samedi 17 septembre, j’ai participé à la réunion publique organisée à Paris avec pour ordre du jour : la suite de l’analyse de la guerre en Ukraine et les grèves en Grande-Bretagne notamment leurs implications au niveau international. Je partage totalement l’exposé reprenant les textes du CCI et voudrais revenir sur la notion d’identité de classe, notion qui nous occupe depuis plusieurs mois dans les réunions publiques et permanences ainsi que dans la presse ; l’ordre du jour de la réunion publique d’aujourd’hui nous rappelle que la compréhension de cette question d’identité est essentielle pour appréhender la période, à savoir : est-ce que la guerre en Ukraine peut être un déclencheur de la lutte de classe autrement dit une forte opposition à la guerre et à l’engagement du prolétariat à la défense du capitalisme ? Ces deux points sont en effet essentiels car ils nous conduisent au cœur de l’alternative : socialisme ou barbarie. J’ai refait un peu d’histoire. À l’origine du capitalisme, les choses étaient simples : on était ouvrier, paysan ou bourgeois et pour ce qui concernait les ouvriers, les revendications étaient sur le terrain des améliorations de salaire, de conditions de travail, etc. Les premières associations ouvrières avaient pour mot d’ordre le fameux « Prolétaires de tous pays, unissez-vous ». Au fil du déroulement du mouvement ouvrier, la société capitaliste a évolué et fait apparaître d’autres classifications sociales. Aujourd’hui qu’observons-nous ? La société capitaliste, dans sa phase de décomposition, a donné naissance à différentes « crises d’identité » correspondant à autant de groupes d’opprimés. Ces groupes souffrant d’oppressions réelles sont encouragés à se mobiliser dans des luttes identitaires en tant que minorités ethniques, féministes, LGBT, minorités de défense de la nature, du local, antispécistes, alimentation BIO, respect de la vie animale, etc. Tous ces mouvements étant plutôt sur le terrain de la gauche, la droite s’occupe d’autres crises identitaires que ce soit la reconquête de l’homme blanc, de l’homme viril, de la religion comme base de l’organisation sociale, etc.
On le voit, les choses sont nettement plus confuses qu’avant et l’identité de classe qui devrait être revendiquée par le prolétariat devient une notion parmi d’autres, voire moins pertinente que d’autres plus modernes du fait que la bourgeoisie nous explique sans cesse que la classe ouvrière n’existe plus. La situation est d’autant plus complexe que les raisons d’oppressions existent bel et bien. Les agressions dans nos vies ne manquent pas et la vie quotidienne devient de plus en plus difficile pour les plus précaires d’entre nous. La dégradation écologique fait envisager le pis pour les années à venir. C’est dans cette fausse thématique que certains prolétaires se laissent embarquer dans ces mouvements identitaires. C’est pourquoi, il nous faut rappeler quelques vérités historiques : toutes ces manifestations sont étrangères à l’identité de classe et sont le produit de la perte de la seule identité de classe qui peut sauver l’humanité à savoir l’identité de classe du prolétariat avec comme perspective le communisme. On a des outils, me semble-t-il, et on peut s’appuyer sur quelques acquis de la théorie marxiste et le premier d’entre eux : l’exploitation de la classe ouvrière est la pierre angulaire de tout l’édifice capitaliste et c’est pour cette raison que le prolétariat de par sa position de dépossédé et d’exploité est révolutionnaire par nature et que sa lutte contient le renversement du capitalisme. Une fois qu’on a dit cela, une question demeure : Où en est le prolétariat et comment va-t-il agir en fonction de ce qu’il va être obligé historiquement de faire pour éviter la destruction de l’humanité ? Le mouvement ouvrier est né de la reconnaissance d’un intérêt commun de classe qui a été à la base de son identité de classe initiale puis son développement vers sa conscience de classe avec la création de ses organisations révolutionnaires. Qu’en est-il aujourd’hui ? Le prolétariat reste la classe de la dépossession et sa fonction dans la société capitaliste n’a pas changé. Ce qui ne signifie pas que « mécaniquement » chaque prolétaire aux différents moments de l’histoire ait été ou soit en mesure de se considérer et de se positionner comme détenteur de cette identité. Ceci étant rappelé, on peut se demander pourquoi depuis les années 1980, la bourgeoisie a été capable de mettre en œuvre toute une série de campagnes idéologiques efficaces jusqu’à proclamer la fin de la lutte de classes présentée comme un épouvantail de temps révolus où la société était divisée en classes sociales… ce qui bien sûr serait totalement dépassé et ne correspondrait plus à la période. Ce qu’il convient de faire d’après la bourgeoisie, c’est se battre pour de grands thèmes sociétaux dans lesquels chaque prolétaire est dilué et devient une femme, un jeune, un vieux, une personne discriminée en raison de son origine, de son handicap, de son orientation sexuelle, de ses préférences alimentaires, de son implantation géographique le désignant comme citoyens ou immigrés avec toutes les sous-classifications possibles : politiques, économiques, climatiques, etc. On le voit très clairement, dans cette panoplie de luttes identitaires, le prolétariat a de quoi y perdre sa boussole et partir dans des luttes sans perspective et très éloignées de sa lutte politique. Un autre point à prendre en compte : il faut bien voir que plus cette situation délétère continue plus la décomposition compromet la perspective d’une autre société humaine.
Comment la situation peut-elle évoluer ? La bourgeoisie, même en phase de déclin final, continue à mettre en place quelques mesures pour tenter d’enrayer la machine (2) que ce soit la mondialisation de la production qui a comme conséquence de nouvelles grandes concentrations ouvrières comme en Chine, en Asie du Sud-Est. Ce qui, entre parenthèses, illustre que le capitalisme sans le prolétariat est une vue de l’esprit. Cette mondialisation n’est pas sans poser de problèmes : on l’a vu au moment de la pandémie COVID et de la guerre en Ukraine avec les difficultés d’approvisionnement et de transport et surtout parce que cette nécessité économique se heurte à l’actuelle tendance au protectionnisme nationaliste.
On le voit bien : tous ces éléments objectifs ne sont pas suffisants pour « réveiller » l’identité de classe au sein du prolétariat et il faut la combinaison de plusieurs facteurs subjectifs comme : quel est le niveau politique des nouvelles générations d’ouvriers en Asie ? en Inde ? Et comment vont réagir toutes ces fractions du prolétariat à l’aggravation de la crise qui comme partout dans le monde, vont les mettre par pans entiers dans la plus grande précarité ? Si l’étincelle de la lutte de classe est attendue dans les pays occidentaux industrialisés de longue date et ayant grâce aux organisations révolutionnaires pu sauvegarder les acquis prolétariens, cette nouvelle répartition de l’exploitation ouvrière doit être prise en compte.
Pour conclure, c’est dans cette perspective que les prochaines luttes vont être déterminantes : en effet, soit elles vont permettre au prolétariat d’affirmer son identité de classe et jouer son rôle historique, soit ces luttes vont rester sur le terrain bourgeois auquel cas le prolétariat restera atomisé à la bourgeoisie faute d’engagement politique sur son terrain.
R., 17 septembre 2022
1 Pour de plus larges développements sur ce sujet voir :
– « Débat : à propos de la critique de la théorie du « maillon le plus faible" », [514]Revue internationale n° 37, (2e trimestre 1984). [514]
– « La théorie du “maillon faible” et la responsabilité du prolétariat des “pays centraux” », [515]Révolution internationale n° 491, (novembre-décembre 2021). [515]t
2 Le texte de la camarade semble, ici, contenir une erreur de formulation. Cette phrase nous paraît contradictoire. La camarade ne voulait-elle pas plutôt dire que les « quelques mesures » prises par la bourgeoisie visent à tenter de contenir la plongée du capitalisme dans le marasme ? Donc à essayer de « huiler » la machine plutôt que de « l’enrayer » ? (NdR)
Vie du CCI:
- Courrier des lecteurs [252]
Rubrique:
Lutte Ouvrière et Révolution Permanente, deux artisans du sabotage des luttes!
- 380 lectures
Depuis cet été, la situation sociale a évolué de manière significative en Europe. L’aggravation considérable de la crise économique avec, en particulier, la flambée spectaculaire des prix et ses conséquences dramatiques sur les conditions de vie et de travail de la classe ouvrière ont poussé le prolétariat à réagir : en Grande-Bretagne d’abord, et dans d’autres pays européens ensuite comme en France, en Allemagne, en Italie ou en Grèce. Des grèves ont été organisées par les syndicats sous la pression du mécontentement qui règne dans la classe ouvrière. Cette situation s’est concrétisée en France par trois journées de grèves et de manifestations (les 29 septembre, 18 octobre et 10 novembre), relativement bien suivie pour la première, un peu moins pour les suivantes. Quoiqu’il en soit, ces événements ont démontré la réalité de la combativité des prolétaires, mais qui, pour le moment, reste parfaitement encadrée par les chiens de garde de l’ordre social que sont les syndicats et les partis d’extrême-gauche.
Les discours des gauchistes dans les dernières luttes: isoler, désorienter et démoraliser !
Certains groupes politiques trotskystes comme Révolution Permanente (RP) et Lutte Ouvrière (LO) se sont fortement mobilisés dans ces grèves avec un discours anti-prolétarien bien rodé. LO s’était déjà exprimée sur les luttes en Grande-Bretagne, avec un discours faussement radical comme à son habitude, en affirmant que « les travailleurs n’ont aucun contrôle sur leurs grèves, entièrement dirigées et décidées par des directions syndicales, qui pourraient y mettre fin sur la base de compromis insatisfaisants », (1) ce qui est exact, même si les « compromis insatisfaisants » montreraient par trop la collusion des syndicats avec l’État-patron, et que « pour que la grève se généralise, pour qu’elle soit commune à l’ensemble du monde du travail, il faudrait que les travailleurs débordent les organisations syndicales des différents secteurs ». Cette officine de l’État bourgeois va même plus loin en proclamant qu’il est impératif de « déborder les organisations syndicales » regrettant que « la plupart des mobilisations sont restées sectorielles » et que « la dynamique des grèves […] est émiettée par cette dispersion et par l’absence de plan d’ensemble ». On retrouve le même discours à propos des récentes grèves et journées de manifestations en France puisque dans le « Bulletin d’entreprise » du 10 octobre dernier, (2) signé par Nathalie Arthaud, LO nous dit que « la lutte est difficile. C’est pourquoi il faut la préparer. Souvent l’initiative des débrayages ou de la grève est prise par les syndicats. […] L’essentiel est que la lutte soit dirigée démocratiquement par les travailleurs qui veulent se battre. » Évidemment, LO ne donne absolument pas la clé permettant à la classe ouvrière de s’approprier sa lutte. Sous des accents de radicalité, LO ne fait ici que propager la mystification classique de l’extrême-gauche selon laquelle c’est à la « base » et non pas « aux directions syndicales » de prendre en charge la lutte, discours dont elle s’est déjà faite le porte-voix zélé pour saboter les luttes de l’intérieur même de syndicats pourtant discrédités. En effet, systématiquement, ses militants appuient de manière directe ou indirecte la sale besogne des syndicalistes.(3) Le seul et unique objectif de cette propagande consiste à épouser verbalement le sentiment de méfiance pouvant régner au sein de la classe à l’égard des « directions » pour mieux enchaîner les ouvriers à l’emprise du syndicalisme à travers l’appel « au syndicalisme de base » ou des « coordinations ». Face à toutes ces mystifications propices à la désorientation des luttes, la seule ligne prolétarienne demeure l’auto-organisation des luttes contre les syndicats (et pas uniquement leurs directions) et le contrôle du mouvement par des assemblées générales unitaires ouvertes à tous les ouvriers.
Le groupe Révolution Permanente, (4) très présent dans les manifestations, est quant à lui sur une approche bien moins subtile : non seulement il laisse entendre que la grève dans les raffineries est « légitime » du fait des profits extravagants des entreprises pétrolières, comme si la lutte pouvait être justifiée, non par les sacrifices que le capital impose à la classe ouvrière, mais par les profits qu’il en tire (et donc que, si le capital perdait de l’argent, la lutte serait bien moins justifiée !), mais ce groupe pousse ouvertement à l’isolement des ouvriers dans leur secteur d’activité, les raffineries, en l’occurrence : « Faire tenir la grève, en alimentant les caisses de grèves des deux entreprises, […] mais aussi par un élan de solidarité, qui peut s’exprimer par des visites de soutien, des communiqués ou motions syndicales de soutien à la grève, et plus globalement par une dénonciation acharnée des profits des groupes pétroliers, de leur politique de destruction de la planète et de leurs profits faramineux : voilà notre tâche actuelle. ». (5) En plus d’appuyer totalement la campagne syndicale de « blocage de l’économie », RP met surtout en scène l’impuissance des ouvriers à soutenir le mouvement dans les raffineries, en transformant les autres secteurs ouvriers en purs spectateurs de cette grève.
La classe ouvrière a déjà depuis longtemps fait l’expérience de ce genre de stratégie qui ne mène qu’à épuiser les ouvriers en grève en les isolant les uns des autres : les secteurs « stratégiques » dans l’économie ne manquant pas, on peut répéter ce genre de stratégie stérile dans autant de secteurs que l’on veut ! La triste expérience des mineurs anglais et de leur année de grève en 1983/84, qui eux aussi cherchaient à « bloquer » une économie alors encore très dépendante du charbon, doit nous rappeler toute l’inanité de ces mots d’ordre. En appuyant le mouvement des raffineries, totalement encadré par les syndicats, isolé malgré la sympathie que lui témoignent la plupart des autres ouvriers, RP ne cherche qu’à étouffer davantage le mouvement et à créer la confusion dans la tête des ouvriers les plus combatifs. RP cherche, en effet, à réduire le combat de la classe ouvrière à des conflits par procuration, une lutte contre un patronat avide et non contre le capitalisme. Du reste, lorsque la situation a commencé à se détériorer, l’État a mis en place la réquisition des quelques ouvriers nécessaires à la remise en marche de la distribution du carburant, et a rouvert les vannes des pompes à essence !
Le gauchisme reste une arme indispensable de la bourgeoisie contre la classe ouvrière
Il existe aujourd’hui non seulement une nécessité de lutter contre les sacrifices que la crise du capitalisme et la décomposition de la société imposent au prolétariat, mais aussi un mécontentement de plus en plus fort menant à une volonté de plus en plus marquée de se battre et d’en découdre. Il existe au sein de la classe ouvrière mondiale une conscience que la situation ne peut qu’empirer, et cette préoccupation devient centrale dans le rapport de force entre la bourgeoisie et classe ouvrière. La bourgeoisie le sait parfaitement, et elle veut absolument éviter que ce mécontentement ne mène à une généralisation des luttes, ce qui permettrait à la classe ouvrière d’éprouver sa force et de retrouver une partie de son identité, de la conscience de son rôle pour la transformation de la société. Pour éviter cela, la classe dominante cherche à encadrer la lutte des exploités au moyen de ses syndicats et à les désorienter en pourrissant leur conscience avec une idéologie faussement prolétarienne.
Depuis Mai 68 et la reprise internationale de la lutte de classe, le gauchisme occupe en France une place importante dans le dispositif bourgeois d’encadrement du prolétariat, notamment du fait de la place très importante qu’y occupait le Parti communiste français stalinien et de la nécessité de lui adjoindre une opposition « critique » de gauche(6). L’effondrement mondial du stalinisme ne peut que renforcer l’importance de la place qu’occupe le trotskysme dans l’organigramme bourgeois et étatique des saboteurs de luttes : leur caution « radicale » (dont on peut voir qu’elle va très loin dans le cas de LO) est fondamentale pour crédibiliser, d’une part, la gauche « de gouvernement », en appelant à « faire pression sur elle » (comme lorsque LO appelait à voter pour le « socialiste » Mitterrand en 1981 ou pour Royal en 2007), et les syndicats, qui sont toujours présentés comme des organes de lutte, mais menés par des « directions syndicales qui jouent le jeu du dialogue social avec le gouvernement et le patronat ». Nulle part, jamais ces officines gauchistes n’expliqueront que les prolétaires, dès lors qu’ils luttent contre la dégradation de leurs conditions de vie et de travail, s’affrontent en fait à l’État capitaliste, et donc que leur lutte est à la fois économique et politique, alors que les syndicats, de par leur nature même, ne peuvent que se cantonner à les encadrer et enfermer sur un terrain strictement économique et limité en désarmant totalement la classe ouvrière face à son principal ennemi, l’État.
Dans les luttes, lorsque les ouvriers parviennent à desserrer le carcan syndical en s’auto-organisant, en menant des assemblées générales avec une réelle prise en main pour discuter des perspectives et des moyens de la lutte, les trotskystes ont toujours joué les chiens de garde empêchant les ouvriers combatifs et les révolutionnaires de participer aux assemblées générales, comme lors de la lutte des cheminots de décembre 1986 ou celle des infirmières en 1988, en sabotant les décisions de ces assemblées générales comme le faisaient les militants du NPA lors de la lutte contre le CPE en 2006, en poussant les ouvriers dans des luttes stériles et isolées dont ils ne peuvent sortir que vaincus, amers et désabusés, comme lors de la lutte des raffineries du mois dernier.
LO et RP cherchent toutes deux à briser la prise de conscience des ouvriers sur la nature et la fonction des syndicats, la première en déviant la réflexion sur une fausse opposition entre base et direction syndicale, la seconde en martelant la validité de la stratégie syndicale sur l’isolement dans la corporation et l’entreprise. Cela signifie, clairement, que la lutte de la classe ouvrière est aussi une lutte contre le gauchisme et contre des organisations comme LO et Révolution Permanente.
Pour la Gauche communiste, il est vital que les ouvriers étendent leur lutte le plus rapidement possible, sortent de l’usine ou de l’administration pour obliger la bourgeoisie à céder le plus rapidement possible sur les revendications. Nous savons combien les grèves longues sont un piège pour le prolétariat. Nous savons aussi que les syndicats seront présents et dangereux jusqu’à la révolution, aussi les communistes doivent-ils dès à présent se battre dans chaque lutte, même la plus petite, pour donner une direction politique très claire sur la nécessité de l’extension géographique de la lutte et la nécessité des assemblées générales. Cette direction politique ne signifie pas que les révolutionnaires puissent organiser la classe ou décider à sa place, mais qu’ils doivent montrer concrètement la validité de cette orientation politique et contrer toutes les tentatives de maintenir la lutte dans l’isolement.
HG, 9 novembre 2022
1 « ne vague de grèves inédite en Grande-Bretagne », Lutte de classe n° 226 (septembre-octobre 2022).
2 « Après le 18 octobre : préparer une lutte d’ensemble », Lutte ouvrière n°2830, (28 octobre 2022).
3 Cf. notre brochure : Bilan de la lutte des infirmières (octobre 1988). Par le biais de « l’entrisme », des militants de LO sont eux-mêmes syndiqués et jouent un rôle non négligeable avec les syndicalistes (au sein de la CGT par exemple).
4 Ce groupe est le produit d’une scission au sein du NPA.
5 « Contre Total et les groupes énergétiques : pourquoi soutenir la grève des raffineurs pour des augmentations de salaire ? », site de Révolution permanente (3 octobre 2022).
6 Le trotskysme cessa d’être un courant du mouvement ouvrier quand il passa définitivement dans le camp de la bourgeoisie au cours de la Deuxième Guerre mondiale en abandonnant l’internationalisme prolétarien au profit de la défense d’un camp impérialiste contre l’autre, en particulier au nom de l’antifascisme ou de la défense de la « patrie socialiste ». Voir la Brochure du CCI : Le trotskysme contre la classe ouvrière [516].
Courants politiques:
- Gauchisme [461]
- Trotskysme [468]
Rubrique:
Face à l’accélération de la décomposition capitaliste, seule la lutte du prolétariat peut représenter une alternative pour l’humanité
- 170 lectures
L’accentuation considérable du chaos guerrier provoquée par la guerre en Ukraine, la pandémie de Covid 19 et ses millions de victimes, les catastrophes climatiques s’abattant avec une violence redoublée aux quatre coins de la planète, la crise économique, sans doute l’une des pires de l’histoire du capitalisme, faisant sombrer des pans entiers du prolétariat dans la précarité et la misère... Toutes ces manifestations de barbarie, de chaos et de misères démontrent l’impasse irrémédiable face à laquelle se trouve le capitalisme.
Dès lors, les années 2020 vont marquer, dans toutes les régions du monde et sur tous les continents, une aggravation sans précédent des convulsions, des catastrophes et des pires souffrances. C’est l’existence-même de la civilisation humaine qui est ouvertement menacée ! Comment expliquer cette accumulation et agrégation de tant de catastrophes ?
Pour autant, les luttes ouvrières qui se développent en Grande Bretagne depuis cet été, montrent que la classe ouvrière, certes avec beaucoup de difficultés, commence à réagir et refuse de subir les attaques portées par la bourgeoisie sur ses conditions de travail et d’existence. C’est en développant les luttes sur ce terrain là que la classe ouvrière se donnera les moyens de retrouver son identité de classe et sera en mesure de dégager une alternative face la spirale mortifère dans laquelle le capitalisme plonge l’humanité.
Nous vous invitons à venir débattre de ces sujets en participant aux réunions publiques du CCI qui se tiendront à :
Marseille : le 28 janvier à partir de 15H00, local de Mille Bâbords, 61 Rue Consolât, 13001.
Paris : le 28 janvier à partir de 15H00, CICP, 21 ter rue Voltaire (Métro « rue des boulets »).
Toulouse : le 14 janvier à partir de 14H00, Mairie annexe de Saint Cyprien (Métro « Saint Cyprien »).
Lille : le 14 janvier à partir de 15H00, bistrot « Les Sarrazins », 52 rue des Sarrazins (Métro « Wazemmes »).
Vie du CCI:
- Réunions publiques [219]
Questions théoriques:
- Décomposition [517]
Rubrique:
Coupe du monde de football 2022 au Qatar: Une illustration de l’irrationalité et de la barbarie criminelle du capitalisme
- 92 lectures
L’édition de la coupe du monde du football 2022, aussi « festive » soit-elle, exprime au plus haut point l’irrationalité et la pourriture du monde capitaliste. La bourgeoisie est bien consciente que, cette fois-ci, la compétition pue ouvertement la corruption, comme le révèle le « scandale » du « Qatargate » impliquant un vaste réseau de corruption au sein de l’honorable institution du Parlement européen, subventionné par le Qatar et le Maroc (dont une des vice-présidentes, « socialiste » de surcroît, a été écrouée après la découverte de 600 000 € en liquide chez elle) ou encore le fort soupçon pesant sur le président de l’Union des associations européennes de foot, Michel Platini, d’avoir perçu de substantiels dessous-de-table pour avoir soutenu la candidature du Qatar comme pays organisateur de cette Coupe, et où flotte encore l’odeur des cadavres de milliers d’ouvriers morts sur les chantiers ! Mais elle préfère vite oublier et s’extasier plutôt sur la « bonne organisation de ce Mondial ». Une expression, probablement, de sa cynique « positive attitude » en plein marasme économique ! La bourgeoisie ne pourra jamais se priver d’une occasion pour attiser le chauvinisme et le nationalisme, même si c’est au prix de se rouler dans la fange !
Des stades construits sur le sang des ouvriers
Les conditions de travail terribles des ouvriers qui ont construit les stades, les métros, les logements et la ville nouvelle de Lusail sont connus depuis longtemps : travail forcé, interdiction de boire ou de manger sur le chantier, confiscation des documents d’identités, salaires versés au compte-goutte (voire, pas du tout), logements pourris et surpeuplés, emprisonnement dans les stades ou autres lieux de travail, interdiction de quitter le pays ou de changer d’emploi…
Il est impossible de savoir le nombre exact d’accidents de travail graves et mortels, car le Qatar fait tout pour dissimuler les chiffres. Mais des enquêtes du Guardian, de la BBC et d’Amnesty International indiquent clairement que des milliers d’ouvriers venant du Bangladesh, de l’Inde, du Kenya, du Népal, des Philippines, du Sri Lanka ou du Soudan sont morts dans ces véritables camps de travail. Le comble, quelques semaines avant le Mondial, les survivants ont été expulsés en masses de leur logement pour faire de la place aux supporters et pour « nettoyer » les quartiers de la réalité barbare du sport et de l’exploitation capitaliste.
Cette compétition est aussi une catastrophe environnementale ahurissante. Alors que la planète se réchauffe dramatiquement, que les ressources en eau se raréfient, menaçant des régions entières de désastre écologique, la bourgeoisie n’a pas trouvé mieux que de construire huit stades climatisés consommant chacun 10 000 litres d’eau par jour pour une déplorable compétition sportive !
L’hypocrisie des grandes « démocraties »
Face à l’indignation suscitée par la barbarie de la bourgeoisie qatarie, une partie de la presse occidentale et des partis de gauche ont été contraints de dénoncer l’horreur de la situation, comme le caractère rétrograde du régime en place. Comme d’habitude, on nous explique que seuls le Qatar et les instances dirigeantes corrompues du football (c’est-à-dire une partie de la bourgeoisie) seraient responsables de ce désastre. Mais le véritable responsable, c’est le capitalisme !
Les pays « démocratiques » ont mis aussi les deux pieds dans la barbarie ! Car les entreprises de construction, les sociétés de logistique ou de transports sont des firmes françaises, allemandes, chinoises, néerlandaises, belges… Le président de la FIFA, Gianni Infantino, a d’ailleurs répondu cyniquement aux critiques et accusations venant des pays européens : « Combien de ces entreprises européennes qui gagnent des millions et des millions au Qatar ou dans d’autres pays de la région (des milliards chaque année), combien d’entre elles se sont penchées sur les droits des travailleurs migrants ? J’ai la réponse : aucune, car si elles changent la législation, cela signifie moins de profits ». Pour une fois, on ne pourra pas lui reprocher de mentir ! Les pays « démocratiques » participent ainsi sans broncher à la coupe du monde, et pas seulement sur le plan sportif. L’homophobie, l’archaïsme du régime, l’esclavage et les morts ne comptent pas. Les juteux bénéfices valent bien quelques milliers de vie ouvrières. Si l’Émir du Qatar et sa clique de mafieux abjects n’inspirent que le dégoût, loin d’être une aberration, ils ne sont qu’une expression de la réalité sordide de l’exploitation capitaliste !
Face aux enjeux impérialistes, le foot n’est pas qu’un « jeu »
L’organisation de la coupe du monde au Qatar a été décidée en 2010 par les pays démocratiques, avec le soutien appuyé de la France et des autres puissances occidentales, le tout dans une ambiance de corruption éhontée. Car ces événements sportifs n’ont rien à voir avec la « fraternité entre les peuples » tant vantée par la bourgeoisie. La France, par exemple, a soutenu le Qatar et sa volonté d’apparaître comme une puissance régionale respectable, car elle y a des intérêts importants.
Mais, immédiatement après le vote, les accusations de corruption se sont multipliées, révélant les enjeux et tensions impérialistes derrière la « fête » du football. Ce sont les médias anglais qui ont accusé la FIFA de corruption. C’est la justice américaine qui a enquêté et condamné des responsables dans les diverses organisations internationales de football. Le président américain, Barack Obama, a même ouvertement critiqué le choix du Qatar, parce que les États-Unis voulaient eux-mêmes devenir le pays hôte pour 2022 et en récolter les revenus et le prestige !
Maintenant que la crise de l’énergie fait rage en Europe suite à la guerre en Ukraine, il est encore plus important de maintenir de bonnes relations avec le Qatar, qui est un producteur majeur de gaz naturels liquéfiés. Ce n’est pas un hasard si l’Allemagne et la Chine viennent de conclure des accords pour l’importation du gaz qatari.
Il y a en revanche une chose que les différentes bourgeoisies ne bouderont pas : c’est la propagande nationaliste forcenée que chacune de ces compétitions suscite ! Avec ses drapeaux, ses hymnes nationaux, ses supporters beuglant leur haine de l’adversaire, le Mondial est une nouvelle occasion de déchaîner une énorme campagne pour faire croire aux ouvriers que l’union derrière le drapeau national, celui des intérêts de la bourgeoisie, est une « fête » !
LC, 20 décembre 2022
Récent et en cours:
- Coupe du Monde [518]
Rubrique:
ICConline - 2023
- 310 lectures
ICConline - janvier 2023
- 86 lectures
Attaquer le CCI : la raison d’être du GIGC
- 389 lectures
Une fois n’est pas coutume, nous remercions le GIGC, de nous donner l’occasion de rappeler ce qu'il est vraiment.
Pour ce faire, nous reproduisons ci-dessous (intégralement, note de bas de page comprise) leur petit article sensé pointer notre impasse et nos contradictions sur la question du parasitisme, à en croire le titre.
Et pour nos lecteurs, nous y répondons juste après.
Le texte du GIGC
Impasse et contradictions du CCI face au « parasitisme », à la TCI et au GIGC
L’attitude politiquement responsable et fraternelle de la délégation du CCI lors de la réunion du comité «Non à la guerre sauf la guerre de classe» [519] à Paris –que nous saluons– a pu surprendre. La réunion n’était-elle pas organisée à l’initiative du GIGC, qu’il dénonce comme «groupe parasite» et «officine de l’État bourgeois» (Révolution internationale 446), et de la TCI qu’il critique pour ses concessions opportunistes vis-à-vis du parasitisme ? La présidence de cette réunion composée de trois camarades ne comportait-elle pas deux anciens de ses membres, Olivier et Juan, exclus et dénoncés publiquement dans sa presse internationale et traités de «nazis, staliniens, voleurs, maître-chanteurs, voyous, lumpen, calomniateurs, provocateurs, flics» en 2002 ? Pourtant, lors de la réunion publique, aucune dénonciation des supposés parasites et flics. Aucun avertissement aux autres participants qu’ils allaient assister à une réunion tenue par une «officine policière». [1] Aucun ultimatum exigeant l’exclusion de la réunion... de ses propres organisateurs.
Soit les membres et sympathisants actifs composant la délégation du CCI ne croient pas un seul mot des résolutions et autre articles publics dénonçant le GIGC et ses membres –par ailleurs interdits de participer aux réunions publiques du CCI ; soit elle a fait preuve d’une concession opportuniste particulièrement grave vis-à-vis non seulement du soi-disant parasitisme, mais même des soi-disant «agents provocateurs de l’État.»
Nous laissons le CCI face à ses contradictions chaque fois plus béantes et criantes.
Le GIGC, décembre 2022
Le CCI à ses lecteurs
Le GIGC a raison, le CCI est intervenu à la première réunion du comité No War But The Class War avec une «attitude politiquement responsable». Et en effet, nous n’avons pas dénoncé les deux individus qui étaient au présidium, Olivier et Juan, alors qu’ils sont des mouchards.
Pourquoi ?
Le GIGC jubile, croyant déceler là la preuve soit de nos prétendus doutes, soit de notre prétendu opportunisme.
La cause de notre «attitude politiquement responsable» ne peut qu’échapper complètement au GIGC : notre raison d’être n’est pas le GIGC mais la classe ouvrière.
Cette réunion était convoquée officiellement par un «comité» et non par des groupes politiques. Nous intervenions donc dans la réunion d'un comité, un comité nommé No War But The Class War, un comité qui annonce faire face à la guerre impérialiste, un comité qui affiche dans son appel d’authentiques positions internationalistes, un comité qui, en soi, doit représenter l’effort aujourd’hui rare, difficile et précieux de notre classe à s’organiser pour débattre et se dresser contre la barbarie de ce système décadent.
Aujourd’hui, les ouvriers en recherche des positions de classe sont peu nombreux, encore plus rares sont ceux faisant l’effort de se rassembler. Voilà ce que devrait être pour nous un comité, un lieu précieux de la clarification de notre classe, à défendre et à faire vivre. En ce sens, nous avions encouragé tous nos contacts à venir participer.
Notre crainte était que ce comité entraîne ses participants dans une impasse. Parce qu’aujourd’hui les luttes de la classe ouvrière se dressent non pas contre la guerre mais contre la crise économique; par conséquent ce comité risquait d’être une coquille vide, vide de la vie réelle de la classe, un comité hors-sol, artificiel, et donc poussant ses rares participants à mener des actions qui ne correspondent pas à la réalité de la dynamique de notre classe, un comité qui finalement affaiblit la défense de l’internationalisme, sème la confusion et finisse par gaspiller les maigres forces qui émergent. [2]
C’est pourquoi le CCI avait consciemment choisi d’y intervenir de manière déterminée pour défendre l’internationalisme, position cardinale de la Gauche communiste, et d’avertir les participants sur ce qui pour nous constitue d’emblée la fragilité des comités NWCW, la dimension artificielle de ces comités «de lutte». Telle a été la position que nous avons défendue par deux interventions, et qui est en effet «attitude politiquement responsable».
En lieu et place de «comité de lutte», ce serait bien plus des cercles de discussion et de réflexion regroupant les minorités politisées qui peuvent être envisageables aujourd’hui au sujet de la guerre. Quant à la formation de comités de lutte, elle pourrait effectivement jouer un rôle si motivée par le besoin de clarification et d'intervention pour faire face aux attaques économiques.
Voilà ce qui nous semblait être la priorité, l’enjeu central de cette réunion et de notre intervention.
Intervenir sur le fait que deux individus présents dans la salle sont en effet prêts à tout pour détruire le CCI, que c’est fondamentalement leur raison d’être, qu’ils ont déjà commis une incroyable liste de méfaits, allant jusqu’au mouchardage (!) tout cela aurait focalisé le débat sur cette question et donc fait dévier la discussion.
Mais puisque le GIGC le réclame, nous ne voudrions pas le décevoir. Voici un petit rappel du pédigrée de ces deux messieurs.
Ces deux individus viennent de la prétendue «Fraction Interne du CCI» (FICCI) qui était un mini groupuscule composé d’anciens membres du CCI exclus pour mouchardage en 2003, lors de notre 15e congrès international. Ce n'est pas la seule infamie dont ces éléments s'étaient rendus responsables puisque, reniant les principes fondamentaux de comportement communiste, ils s'étaient également distingués par des attitudes typiques de voyous, tels que la calomnie, le chantage et le vol. Pour ces autres comportements, bien qu'ils soient très graves, le CCI n'avait pas prononcé d'exclusion à leur encontre, mais une simple suspension. C'est-à-dire qu'il était encore possible pour ces éléments de revenir un jour dans l'organisation à condition évidemment qu'ils restituent le matériel et l'argent qu'ils avaient dérobés à celle-ci et qu'ils s'engagent à renoncer à des comportements qui n'ont pas leur place dans une organisation communiste. Si le CCI a décidé finalement de les exclure, c'est qu'ils ont publié sur leur site Internet (c'est-à-dire au vu de toutes les polices du monde) des informations internes facilitant le travail de la police : [3]
- la date où devait se tenir la conférence de notre section au Mexique en présence de militants venus d'autres pays. Cet acte répugnant de la FICCI, consistant à faciliter le travail de répression de l'État bourgeois, est d'autant plus ignoble que ses membres savaient pertinemment que certains de nos camarades au Mexique avaient déjà, dans le passé, été victimes de la répression et que certains avaient été contraints de fuir leur pays d'origine ;
- les véritables initiales d'un de nos camarades présenté par eux comme "le chef du CCI", avec la précision qu'il était l'auteur de tel ou tel texte compte tenu de "son style" (ce qui est une indication intéressante pour les services de police).
- le compte rendu régulier dans leur bulletin des résultat du travail d'espionnage de notre organisation, dont des informations qui relèvent directement d'un travail d'indicateur de police.
Il faut préciser qu'avant de procéder à leur exclusion, le CCI avait adressé à chacun des membres de la FICCI une lettre individuelle lui demandant s'il se solidarisait individuellement avec ces mouchardages. Lettre à laquelle la FICCI avait finalement répondu en revendiquant collectivement ces comportements infâmes. Il faut préciser également qu'il avait été donné à chacun de ces éléments la possibilité de présenter sa défense devant le congrès du CCI ou encore devant une commission de 5 membres de notre organisation dont 3 pouvaient être désignés par les membres de la FICCI eux-mêmes. Ces courageux individus, conscients que leurs comportements étaient indéfendables, avaient rejeté ces ultimes propositions du CCI.
À la place, cette «FICCI» a alors envoyé un «Bulletin communiste» aux abonnés de notre publication en France (dont les membres de la FICCI avaient volé le fichier des adresses bien avant de quitter notre organisation) pour leur répéter à longueur de bulletin que le CCI était en proie à une dégénérescence opportuniste et stalinienne.
Et ce n’est pas fini !
En 2005, avant l’une de nos réunions publiques, l’un des membres de la FICCI a menacé de mort l’un de nos militants. Portant toujours un couteau à la ceinture, il lui a odieusement glissé à l’oreille qu'il lui trancherait la gorge.
En fait, nous pourrions poursuivre cette liste encore et encore, tant chaque «Bulletin communiste» contenait son lot de calomnies.
En 2013, la FICCI a pris pour nouveau nom «Groupe international de la Gauche communiste» (GIGC). Plus précisément, ce nouveau groupe est le résultat de la fusion entre une partie du groupe Klasbatalo de Montréal et la FICCI.
Mais ce sont bien les mœurs de voyous et la haine des membres de la FICCI pour le CCI qui ont coloré immédiatement la politique et l’activité de ce groupe.
Ainsi, à peine né, ce GIGC s’est mis à sonner le tocsin et crier à tue-tête qu’il était en possession des Bulletins internes du CCI. En exhibant leur trophée de guerre et en faisant un tel tintamarre, le message que ces mouchards patentés cherchaient à faire passer était très clair : il y a une «taupe» dans le CCI qui travaille main dans la main avec l’ex-FICCI ! C’était clairement un travail policier n’ayant pas d’autre objectif que de semer la suspicion généralisée, le trouble et la zizanie au sein de notre organisation. Ce sont les mêmes méthodes qu’avait utilisées le Guépéou, la police politique de Staline, pour détruire de l’intérieur le mouvement trotskiste des années 1930. Ce sont ces mêmes méthodes qu’avaient déjà utilisées les membres de l’ex-FICCI lorsqu’ils avaient fait des voyages «spéciaux» dans plusieurs sections du CCI en 2001 pour organiser des réunions secrètes et faire circuler des rumeurs suivant lesquelles l’une de nos camarades (la «femme du chef du CCI», suivant leur expression) serait un «flic». Le même procédé pour tenter de semer la panique et détruire le CCI de l’intérieur en 2013 était encore plus abject : sous le prétexte hypocrite de vouloir «tendre la main» aux militants du CCI et les sauver de la «démoralisation», ces indicateurs professionnels adressaient en réalité le message suivant à tous les militants du CCI : «Il y a un (ou plusieurs) traîtres parmi vous qui nous donne vos Bulletins internes, mais on ne vous donnera pas son nom car c’est à vous de chercher par vous-même !». Voilà le véritable objectif permanent de ce «groupe international» : essayer d’introduire le poison du soupçon et de la méfiance au sein du CCI pour chercher à le détruire de l’intérieur. Il s’agit bien d’une véritable entreprise de destruction dont le degré de perversion n’a rien à envier aux méthodes de la police politique de Staline ou de la Stasi.
Nous avons, à plusieurs reprises déjà, interpellé publiquement le GIGC sur la manière dont nos bulletins internes étaient arrivés entre leurs mains. Un complice infiltré au sein de notre organisation ? La police elle-même les aurait-elle obtenus en piratant nos ordinateurs pour les transmettre ensuite au GIGC par un moyen quelconque ? Si, au lieu d'être une bande voyous, le GIGC avait été une organisation responsable, il aurait eu à cœur de résoudre cette énigme et d'informer le milieu politique du résultat de ses investigations. Au lieu de cela, il a toujours évité cette question que nous ne cesserons pas de lui poser publiquement.
Leur dernier article, celui que nous avons reproduit intégralement plus haut, ne déroge pas à ces méthodes nauséabondes. Ce que l’on peut reconnaître au moins au GIGC, c’est sa constance.
Seulement, à travers cet article, ce n’est pas au sein du CCI que le GIGC essaie de semer la division, la suspicion et la méfiance, mais au sein de toute la Gauche communiste. En écrivant «La réunion n’était-elle pas organisée à l’initiative du GIGC, qu’il [le CCI] dénonce comme “groupe parasite” et “officine de l’État bourgeois” (Révolution internationale 446), et de la TCI qu’il critique pour ses concessions opportunistes vis-à-vis du parasitisme ?», le GIGC met volontairement dans le même sac notre dénonciation des mœurs de voyous de ce groupe parasite et notre combat contre l’opportunisme de la TCI.
Le GIGC, digne héritier de la FICCI, a pour fonction de détruire les principes de la Gauche communiste, d’y répandre la méfiance et la division. La haine des membres de l’ex-FICCI vis-à-vis du CCI l’emporte et teinte toute la politique de ce groupe, quel que soit le niveau de conscience de ses différents membres intégrés par la suite. Il s’agit donc d’un combat contre un groupe qui, sous couvert de défendre les positions de la Gauche communiste, défend objectivement les intérêts du camp bourgeois [4] en reprenant à son compte ses pires mœurs et attitudes.
La lutte contre l’opportunisme, elle, se déroule au sein même du camp prolétarien. Toute l’histoire du mouvement ouvrier démontre qu’il s’agit d’une faiblesse constante qui gangrène le camp prolétarien. Il s’agit donc de combattre l’opportunisme par la polémique à la fois la plus ferme et la plus fraternelle possible, au sein du milieu politique prolétarien. Ce combat se mène non seulement entre les organisations révolutionnaires mais aussi en leur sein même. L’histoire du CCI montre qu’il lutte en son sein contre des dérives de ce type depuis 50 ans.
Ces méthodes d’assimilation, de confusion volontaire du GIGC afin de semer le trouble et la méfiance sont abjectes.
Pour paraphraser Rosa Luxemburg : Mensonger, mouchard, pataugeant dans la calomnie, couvert de crasse : voilà comment se présente le parasitisme, voilà ce qu’il est. Ce n’est pas lorsque ses protagonistes se donnent à la tribune d’un présidium d’un comité les dehors de la respectabilité et de la philosophie, de la morale et de l’ouverture, du débat et de la fraternité, c’est quand le parasitisme ressemble à une bête fauve, quand il danse le sabbat de la voyoucratie, quand il souffle la méfiance sur la Gauche communiste et ses principes, qu’il se montre tout nu, tel qu’il est vraiment.
CCI, 15 janvier 2023
[1] Conférence-débat à Marseille sur la Gauche communiste: le Docteur Bourrinet, un faussaire qui se prétend historien [520]
[2] Nous ne pouvons développer ici notre position, nous renvoyons nos lecteurs à notre article « No war but the classe war à Paris : Un comité qui entraîne les participants dans l’impasse » [521].
[3] Le GIGC assume même sa démarche policière. En effet on trouve, depuis 2005, sur son site «GIGC / Bulletin communiste International» des documents relatifs à des discussions internes au sein du CCI.
[4] Cette défense ne s'opère pas à travers la défense d'un programme bourgeois. En effet, comme le mettent en évidence nos thèses sur le parasitisme [522] : «Marx et Engels […] caractérisaient déjà de parasites ces éléments politisés qui, tout en prétendant adhérer au programme et aux organisations du prolétariat, concentrent leurs efforts sur le combat, non pas contre la classe dominante, mais contre les organisations de la classe révolutionnaire».
Courants politiques:
Comment développer un mouvement massif, uni et solidaire?
| Fichier attaché | Taille |
|---|---|
| 248.92 Ko |
- 420 lectures
Au Royaume-Uni, un cri se propage d’écho en écho, de grève en grève, depuis le mois de juin :
« Enough is enough ! » « Trop c’est trop ! »
Ce mouvement massif, baptisé « L’été de la colère », est devenu l’automne de la colère, puis l’hiver de la colère.
Cette vague de grèves au Royaume-Uni est le symbole de la combativité ouvrière qui se développe partout dans le monde :
– En Espagne, où les médecins et les pédiatres de la région de Madrid se sont mis en grève fin novembre, tout comme le secteur aérien et celui du ferroviaire en décembre. De nouvelles grèves sont annoncées dans la santé, pour janvier, dans de nombreuses régions.
– En Allemagne, où la flambée des prix fait craindre au patronat d’avoir à affronter les conséquences d’une crise énergétique sans précédent. Le vaste secteur de la métallurgie et de l’électro-industrie a ainsi connu une série de grèves perlées au mois de novembre.
– En Italie, où une grève des contrôleurs aériens, mi-octobre, s’est ajoutée à celle des pilotes de la compagnie EasyJet. Le gouvernement a même dû interdire toute grève les jours de fête.
– En Belgique, où la grève nationale a été déclenchée le 9 novembre et le 16 décembre.
– En Grèce, où une manifestation a rassemblé des dizaines de milliers de salariés du privé à Athènes en novembre, au cri de « La cherté de la vie est insupportable ! ».
– En France, où des grèves se sont succédé ces derniers mois dans les transports en commun, dans les hôpitaux…
– Au Portugal, où les ouvriers réclament un salaire minimum à 800 euros contre 705 actuellement. Le 18 novembre, c’est la fonction publique qui était en grève. Au mois de décembre, le secteur des transports s’est également mobilisé.
– Aux États-Unis, les élus de la Chambre des représentants sont intervenus pour débloquer un conflit social et éviter une grève du fret ferroviaire. En janvier, ce sont les infirmières de New-York qui se sont mobilisées par milliers.
La liste serait interminable car, en réalité, il y a partout une multitude de petites grèves isolées les unes des autres, dans les entreprises, dans les administrations. Parce que partout, dans tous les pays, dans tous les secteurs, les conditions de vie et de travail se dégradent, partout la flambée des prix et les salaires de misère, partout la précarité et la flexibilité, partout les cadences infernales et les effectifs insuffisants, partout une dégradation terrible des conditions de logement, particulièrement pour les jeunes.
Depuis la pandémie de Covid-19, les hôpitaux sont devenus le symbole de cette réalité quotidienne de tous les travailleurs : être en nombre insuffisant et surexploités, jusqu’à l’épuisement, pour un salaire qui ne permet plus de payer les factures.
La longue vague de grèves qui touche depuis le mois de juin le Royaume-Uni, pays où le prolétariat semblait résigné depuis les années Thatcher, exprime une véritable rupture, un changement d’état d’esprit au sein de la classe ouvrière, non seulement au Royaume-Uni, mais aussi au niveau international. Ces luttes montrent que face à l’approfondissement considérable de la crise, les exploités ne sont plus prêts à se laisser faire.
Avec une inflation à plus de 11 % et l’annonce d’un budget de rigueur par le gouvernement de Rishi Sunak, les grèves se sont succédé dans presque tous les secteurs : les transports (trains, bus, métro, aéroports) et celui de la santé, les postiers du Royal Mail, les fonctionnaires du département de l’environnement, de l’alimentation et des affaires rurales, les employés d’Amazon, ceux des écoles en Écosse, les ouvriers du pétrole de la Mer du Nord… L’ampleur de la mobilisation des soignants n’avait pas été vue dans ce pays depuis plus d’un siècle ! Et les enseignants devraient à leur tour faire grève à partir de février.
En France, le gouvernement a, en plus, décidé d’imposer une nouvelle « réforme » repoussant l’âge légal du départ à la retraite. Le but est simple : faire des économies en pressant comme un citron la classe ouvrière, jusqu’au cimetière. Concrètement, il s’agira de travailler vieux, malade, épuisé ou de partir avec une pension de retraire amputée et misérable. Souvent, d’ailleurs, le licenciement viendra trancher, avant l’âge fatidique, le nœud de ce dilemme.
Les attaques contre nos conditions de vie ne vont pas s’arrêter. La crise économique mondiale va continuer de s’aggraver. Pour s’en sortir sur l’arène internationale du marché et de la concurrence, chaque bourgeoisie de chaque pays va imposer à la classe ouvrière des conditions de vie et de travail de plus en plus insoutenables, en invoquant « la solidarité avec l’Ukraine » ou « l’avenir de l’économie nationale ».
C’est encore plus vrai avec le développement de l’économie de guerre. Une partie croissante du travail et des richesses est dirigée vers l’économie de guerre. En Ukraine, mais aussi en Éthiopie, au Yémen, en Syrie, au Mali, au Niger, au Congo, etc., cela signifie : des bombes, des balles et la mort ! Ailleurs, cela entraîne la peur, l’inflation et l’accélération des cadences de travail. Tous les gouvernements réclament des « sacrifices » !
Face à ce système capitaliste qui plonge l’humanité dans la misère et la guerre, dans la concurrence et la division, c’est à la classe ouvrière (les travailleurs salariés de tous les secteurs, de toutes les nations, au chômage ou au travail, avec ou sans diplôme, en activité ou à la retraite...) de proposer une autre perspective. En refusant ces « sacrifices », en développant une lutte unie, massive et solidaire, elle peut montrer qu’un autre monde est possible.
Divisés, nous sommes faibles. Divisés, nous perdons.
Depuis des mois, dans tous les pays et dans tous les secteurs, oui, il y a des grèves. Mais isolées les unes des autres. Chacun sa grève, dans son usine, son dépôt, son entreprise, son administration. Aucun lien réel entre ces luttes, même quand il suffirait de traverser la rue pour que les grévistes de l’hôpital rencontrent ceux de l’école ou du supermarché d’en-face. Parfois, cette division confine au ridicule quand, dans la même entreprise, les grèves se découpent par corporation, ou équipe, ou étage. Il faut imaginer les secrétaires en grève à un moment différent des agents techniques, ou ceux du premier étage en grève dans leur coin sans lien avec ceux du second. C’est parfois réellement ce qui se passe !
L’éparpillement des grèves, l’enfermement chacun dans son coin fait le jeu de la bourgeoisie, il nous affaiblit, nous réduit à l’impuissance, il nous épuise et nous mène à la défaite.
C’est pourquoi la bourgeoisie déploie tant d’énergie à l’entretenir. Dans tous les pays, la même stratégie : les gouvernements divisent. Ils font semblant de soutenir tel ou tel secteur pour mieux s’en prendre aux autres. Ils mettent ponctuellement un secteur, voire une entreprise en lumière, en faisant des promesses qu’ils ne tiendront jamais, pour faire passer inaperçu le cortège d’attaques qui s’abat partout ailleurs. Pour mieux diviser, ils adressent une aide ponctuelle à une catégorie et réduisent les droits de toutes les autres. La négociation branche par branche, entreprise par entreprise, est partout la règle.
En France, l’annonce de la réforme des retraites, qui va impacter toute la classe ouvrière, s’accompagne d’un « débat » médiatique assourdissant sur l’injustice de la réforme pour telle ou telle catégorie de la population. Il faudrait la rendre plus juste en intégrant mieux les profils particuliers des apprentis, de certains travailleurs manuels, des femmes… Toujours le même piège !
Les travailleurs doivent prendre leurs luttes en main
Pourquoi cette division ? Est-ce seulement la propagande et les manœuvres des gouvernements qui parviennent à nous diviser ainsi, à séparer les grèves et les luttes de la classe ouvrière les unes des autres ?
Le sentiment d’être tous dans le même bateau grandit. L’idée que seule une lutte massive, unie et solidaire peut permettre d’établir un rapport de force germe dans toutes les têtes. Alors pourquoi cette division depuis des mois, dans tous les pays, dans tous les secteurs ?
Au Royaume-Uni, les grèves s’accompagnent traditionnellement de piquet devant chaque lieu en grève. Depuis des mois, les piquets se tiennent les uns à côtés des autres, parfois à une seule journée d’écart, parfois en même temps mais séparés de quelques centaines de mètres. Sans lien entre eux. Chacun sa grève, chacun son piquet. Sans lutte contre cet éparpillement, sans le développement d’une véritable unité dans la lutte, la combativité risque de s’épuiser. Ces dernières semaines, l’impasse et le danger de cette situation a commencé à frapper les esprits. Les ouvriers en grève chacun leur tour depuis six mois pourraient être gagnés par un sentiment de lassitude et d’impuissance.
Pourtant, sur plusieurs piquets de grève, des travailleurs nous ont exprimé leur sentiment d’être impliqués dans quelque chose de plus large que leur entreprise, leur administration, leur secteur.Il y a une volonté grandissante de lutter ensemble.
Seulement, depuis des mois, dans tous les pays, dans tous les secteurs, ce sont les syndicats qui organisent toutes ces luttes morcelées, ce sont les syndicats qui dictent leurs méthodes, qui divisent, isolent, prônent la négociation branche par branche, corporation par corporation, ce sont les syndicats qui font de chaque revendication une revendication spécifique, ce sont les syndicats qui avertissent que, surtout, « il ne faut pas mélanger les revendications pour ne pas se diluer ».
Mais les syndicats ont aussi perçu que la colère gronde, qu’elle risque de déborder et de briser les digues qu’ils ont dressées entre les corporations, les entreprises, les secteurs… Ils savent que l’idée de « lutter tous ensemble » murit dans la classe.
C’est pourquoi, par exemple au Royaume-Uni, les syndicats commencent à parler de rassemblements regroupant différents secteurs, ce qu’ils avaient pris grand soin jusqu’ici d’éviter. Les mots « unity », « solidarity » pointent le bout de leur nez dans leurs discours. Ils ne renoncent pas là à diviser, mais pour pouvoir continuer à le faire, ils collent aux préoccupations de la classe. Ils gardent ainsi le contrôle, la direction des luttes.
En France, face à l’annonce de la réforme des retraites, les syndicats ont ainsi affiché leur unité et leur détermination ; ils ont appelé à de grandes manifestations de rue et à engager le bras de fer avec le gouvernement. Ils crient que cette réforme ne passera pas, qu’il faut être des millions à la rejeter.
Voilà pour le discours et les promesses. Mais qu’en est-il en réalité ? Pour s’en faire une idée, il suffit de se souvenir du mouvement de lutte de 2019-2020, déjà contre la réforme des retraites de Macron. Face à la montée de la combativité et l’élan de solidarité entre les générations, les syndicats avaient usé du même stratagème en prônant la « convergence des luttes », un ersatz de mouvement unitaire, où les manifestants qui défilaient dans la rue étaient parqués par secteur et par entreprise. Nous n’étions pas tous ensemble, mais les uns derrière les autres. Les banderoles syndicales et les services d’ordre saucissonnaient les cortèges par corporation, par entreprise, par centrale. Surtout, aucune discussion, aucune assemblée. « Défilez avec vos collègues habituels et rentrez chez vous, jusqu’à la prochaine ». Sono à fond, pour être bien certain que les plus têtus ne s’entendent pas. Parce que ce qui fait réellement trembler la bourgeoisie, c’est quand les ouvriers prennent leurs luttes en main, quand ils s’organisent, quand ils commencent à se rassembler, à débattre… à devenir une classe en lutte !
Au Royaume-Uni et en France, comme partout ailleurs, pour construire un rapport de forces nous permettant de résister aux attaques incessantes contre nos conditions de vie et de travail, et qui demain vont s’aggraver encore avec violence, nous devons, partout où nous le pouvons, nous rassembler pour débattre et mettre en avant les méthodes de lutte qui font la force de la classe ouvrière et lui ont permis, à certains moments de son histoire, de faire vaciller la bourgeoisie et son système :
– la recherche du soutien et de la solidarité au-delà de sa corporation, son entreprise, son secteur d’activité, sa ville, sa région, son pays ;
– l’organisation autonome du combat ouvrier, à travers des assemblées générales notamment, sans en laisser le contrôle aux syndicats, ces soi-disant « spécialistes » des luttes et de leur organisation ;
– la discussion la plus large possible sur les besoins généraux de la lutte, sur les leçons à tirer des combats et aussi des défaites, car il y aura des défaites, mais la plus grande défaite est de subir les attaques sans réagir. L’entrée en lutte est la première victoire des exploités.
En 1985, sous Thatcher, les mineurs britanniques s’étaient battus durant une année entière, avec un immense courage et une détermination exemplaire ; mais isolés, enfermés dans leur corporation, ils avaient été impuissants ; et leur défaite avait été celle de toute la classe ouvrière. Nous devons tirer les leçons de nos erreurs. Il est vital que les faiblesses qui minent la classe ouvrière depuis des décennies et signent notre succession de défaites soient dépassées : le corporatisme et l’illusion syndicale. L’autonomie de la lutte, l’unité et la solidarité sont les jalons indispensables à la préparation des luttes de demain !
Pour cela, il faut nous reconnaître comme les membres d’une même classe, une classe unie par la solidarité dans la lutte : le prolétariat. Les luttes d’aujourd’hui sont indispensables pas seulement pour nous défendre pied à pied contre les attaques mais aussi pour reconquérir cette identité de classe à l’échelle mondiale, pour préparer le renversement de ce système synonyme de misère et de catastrophes de toutes sortes.
Dans le capitalisme, il n’y a pas de solution : ni à la destruction de la planète, ni aux guerres, ni au chômage, ni à la précarité, ni à la misère. Seule la lutte du prolétariat mondial soutenue par tous les opprimés et exploités du monde peut ouvrir la voie à une alternative, celle du communisme.
Les grèves au Royaume-Uni, les manifestations en France, sont un appel au combat pour les prolétaires de tous les pays
Courant communiste international, 12 janvier 2023
Vie du CCI:
- Interventions [492]
Récent et en cours:
- Réforme des retraites [526]
- été de la colère [527]
Rubrique:
Attaque meurtrière contre des kurdes à Paris: La société capitaliste s’abreuve de mort et de haine!
- 54 lectures
Le 23 décembre dernier, à Paris, une nouvelle tuerie raciste et xénophobe faisait trois morts, les victimes étaient toutes issues de la communauté kurde. Au fil des informations, le profil du suspect devient de plus en plus clair : un homme viscéralement raciste qui voulait tuer le plus d’étrangers possible lors de cette fusillade. Ce dernier ayant déjà attaqué un migrant avec un sabre en décembre 2021.
Un crime à l’image de la folie meurtrière du capitalisme
Ce genre d’actes ignobles n’a, hélas, rien d’extraordinaire. Au contraire, ils rythment désormais le quotidien de la société au quatre coins du monde et font régulièrement les Unes des journaux et des émissions de télévision. L’assassinat du 23 décembre ne doit donc rien au hasard, bien au contraire. Pour autant, les représentants politiques comme les médias aux ordres n’ont pas tardé à réduire cette tuerie comme le simple fait d’un « déséquilibré » au « cerveau grillé », imbibé de l’idéologie d’extrême-droite. Autrement dit, un individu psychologiquement malade. Voilà ! L’affaire était réglée ! En réalité, la démarche de ces individus n’est en rien le produit d’un simple acte individuel mais bien celui d’une société sans aucun futur, se noyant tous les jours dans la barbarie, la destruction des liens sociaux, la marginalisation, l’atomisation des individus, le nihilisme ou encore l’anéantissement de l’affectivité. Un tel cocktail ne pouvant que fabriquer en chaîne des êtres broyés dont les pulsions de haine et de mort peuvent trouver leur conclusion dans le massacre de boucs-émissaires, cette fois-ci des individus issus de la communauté kurde.
Un crime instrumentalisé par la gauche de la bourgeoisie
Personnalités politiques, représentants des différentes sphères de l’État, journalistes et commentateurs de tous bords se sont émus de cet acte barbare en jouant sur le terrain de la peur. Mélenchon et la France insoumise, par exemple, ont dénoncé un authentique acte terroriste d’un militant d’extrême – droite manipulé par la Turquie. Si pour le moment, rien ne permet de confirmer cette thèse, ce qui est sûr c’est que la gauche et l’extrême gauche (LO, NPA notamment) mais aussi, bien sûr, le Parti des travailleurs du Kurdistan (PKK), ont tout de suite compris le bénéfice qu’elles pouvaient tirer de ce drame. En déclarant d’emblée qu’il s’agissait d’un attentat terroriste, toutes ces officines de l’État ont été en mesure d’instrumentaliser la colère des Kurdes en les appelant à se mobiliser sur le terrain de l’antifascisme et de la défense du peuple kurde. (1)Ainsi, preque toute la bourgeoisie est à l’unisson pour dénoncer la montée du fascisme qui mettrait en péril la démocratie. Nous assistons à deux campagnes concomitantes mais totalement complémentaires consistant à entraîner les ouvriers sur le terrain de l’antifascisme. D’un côté, l’extrême droite, par ses discours haineux, déverse sur les réseaux sociaux un odieux mélange de haine, d’appel au lynchage et au pogrom envers tout individu extérieur à la prétendue « communauté nationale ». D’ailleurs, les militants d’extrême-droite ont désormais toujours un fauteuil réservé sur les plateaux télévisés et en radio, à l’image de Zemmour lors de la dernière élection présidentielle, leur donnant ainsi toute légitimité pour déverser leurs discours racistes.
Face à ce déferlement de haine, on assiste, de l’autre côté, à un grand battage médiatique de la gauche et de l’extrême-gauche qui déploient tout leur arsenal dans l’appel au « combat contre le fascisme ». Dès le 23 décembre, les ténors de la NUPES, pour ne citer qu’eux, ont largement occupé les chaînes d’information pour dénoncer la violence de l’extrême – droite qui constituerait une grave menace pour la France. Cette campagne a été lancée, il y a déjà quelque temps, sur les réseaux sociaux. Les médias de gauche « alternatifs », prétendument indépendants, ne cessent de développer ce thème de la montée en puissance de la violence d’extrême-droite. Ce discours est perfide car il distille l’idée selon laquelle la solution politique au pourrissement de la société serait contenue dans la défense de « L’État de droit », c’est-à-dire de la nation, de l’État et de la République bourgeoise, qu’il conviendrait d’utiliser avec efficacité pour régler les problèmes de racisme, de xénophobie, de terrorisme. Mais tout ce ramassis de lieux communs et de mensonges n’est qu’un bourrage de crânes qui montre pleinement la véritable fonction de la gauche du capital : dévoyer la lutte de la classe ouvrière contre le système capitaliste pour mieux l’amener à soutenir et défendre son principal oppresseur : l’État « démocratique ».
S’en remettre aux sbires de la gauche pour changer le monde et préserver l’humanité de la barbarie capitaliste est un dangereux leurre que la classe ouvrière ne doit pas gober !
Mathilde, 30 décembre 2022
1 Les Kurdes savent pertinemment que l’État français ne peut ni ne veut les protéger : les enjeux et le désamour diplomatique avec Erdogan est un sujet brûlant de politique internationale qui prévaut sur tout autre risque d’insécurité de ressortissants kurdes en l’occurrence. Rappelons l’attentat de janvier 2013 qui avait tué trois militantes kurdes et qui s’était soldé, après plusieurs années de procédure, par un classement secret-défense entraînant ainsi la fin de toute procédure.
Situations territoriales:
- France [508]
Récent et en cours:
- Attentats [528]
Rubrique:
Mouvement contre la réforme des retraites en France
- 96 lectures
L’ampleur de la mobilisation lors de la première manifestation contre la réforme des retraites le 19 janvier dernier, a montré la capacité du prolétariat en France de résister à une attaque ignoble de la part de la bourgeoisie contre les conditions de vie et de travail. Mais c’est un ras-le-bol plus général qui s’est exprimé dans tous les cortèges du fait de l’aggravation de la crise économique qui se manifeste notamment par l’inflation. Après les grèves incessantes en Grande-Bretagne depuis l’été dernier, la massivité de la mobilisation des ouvriers en France confirme pleinement le réveil de la combativité du prolétariat à l’échelle mondiale.
Venez discuter de cette question lors de la réunion publique en ligne du CCI le 11 février à partir de 21h00 (Au lieu de 15h comme annoncé initialement en raison des manifestations qui se dérouleront au cours de l'après-midi). Le CCI interviendra dans ces manifestations et il sera toujours possible de nous contacter dans l'après-midi pour s'inscrire à la participation à la réunion publique du soir.
Pour participer à cette réunion publique, veuillez adresser un message sur notre adresse électronique [213] ou dans la rubrique “contact [214]”, afin de nous permettre d’organiser au mieux les débats. Les modalités techniques pour se connecter à la réunion seront communiquées par retour de courriel.
Vie du CCI:
- Réunions publiques [219]
Rubrique:
Être nombreux ne suffit pas, il faut aussi prendre nos luttes en mains
| Fichier attaché | Taille |
|---|---|
| 258.82 Ko |
- 420 lectures
Les 19 et 31 janvier, nous étions plus d’un million dans la rue à nous mobiliser contre la nouvelle réforme des retraites. Le gouvernement prétend que cette colère est due à un « défaut d’explication », à un « manque de pédagogie ». Mais nous avons tous très bien compris ! Avec cette énième réforme, le but est clair : nous exploiter toujours plus et amputer les pensions de tous ceux qui, licenciés ou malades, ne parviendront pas à aller au bout de leurs annuités. Travailler jusqu’à épuisement pour une retraite de misère, voilà ce qui nous attend.
Mais « à un moment donné, ça suffit ! ». Cette expression est revenue si souvent dans les cortèges qu’elle a été reprise par les Une de la presse. Il s’agit presque mot pour mot de l’expression que les grévistes mettent en avant depuis des mois au Royaume-Uni : « Enough is enough », « Trop c’est trop ». Ce n’est pas un hasard. Le lien qui nous unit saute aux yeux : la même dégradation des conditions de vie et de travail, les mêmes attaques, la même inflation, et la même combativité croissante. Parce que, oui, « ça suffit ». La réforme des retraites, les prix qui flambent, les cadences infernales, les sous-effectifs, les salaires de misère… et que dire de la nouvelle réforme de l’assurance chômage, une mesure révoltante qui réduit de 25 % la durée d’indemnisation et va permettre de radier les bénéficiaires à tour de bras ! Et cela pour le plus grand bien des statistiques et des mensonges sur la « réduction du chômage ».
Nos luttes massives montrent notre solidarité
En étant plus d’un million dans la rue le 19 janvier, davantage le 31, la classe ouvrière démontre une nouvelle fois ce qui fait sa force : sa capacité à rentrer massivement en lutte. Chômeurs, retraités, futurs travailleurs, salariés, de tous les métiers, de tous les secteurs, du public ou du privé, les exploités forment une seule et même classe animée par un seul et même sentiment de solidarité : Un pour tous, tous pour un !
Depuis des mois, il y a partout en France des petites grèves, dans les usines ou dans les bureaux. Leur multitude reflète le niveau de colère dans les rangs de la classe ouvrière. Mais parce qu’elles sont isolées les unes des autres, ces grèves sont impuissantes ; elles épuisent les plus combatifs dans des luttes sans espoir. Les grèves corporatistes et sectorielles ne mènent qu’à la défaite de tous, chacun perd dans son coin, chacun son tour, l’un après l’autre. L’organisation des luttes corporatistes et sectorielles n’est que l’incarnation moderne du vieil adage des classes dominantes : « Diviser pour mieux régner ».
Face à cet éparpillement, sous le coup des attaques incessantes à nos conditions de vie et de travail, nous ressentons de plus en plus qu’il faut rompre cet isolement, que nous sommes tous dans le même bateau, que c’est tous ensemble qu’il faut lutter. Les 19 et 31 janvier, en étant plus d’un million dans la rue, à se serrer les coudes, il y avait non seulement de la joie mais aussi une certaine fierté à faire vivre la solidarité ouvrière.
Pour être réellement unis, il faut se regrouper, débattre et décider ensemble
En étant plus d’un million dans la rue, l’atmosphère se charge d’une ambiance nouvelle. Il y a l’espoir de pouvoir gagner, de pouvoir faire reculer le gouvernement, de le faire plier sous le poids du nombre. C’est vrai, seule la lutte peut freiner les attaques. Mais être nombreux est-il suffisant ?
En 2019, nous étions aussi massivement mobilisés et la réforme des retraites est passée. En 2010, contre ce qui devait être la dernière réforme des retraites, juré-craché, nous avons enchaîné quatorze journées d’action ! Neuf mois de lutte ! Ces cortèges ont rassemblé plusieurs fois de suite des millions de manifestants. Pour quel résultat ? La réforme des retraites est passée. Par contre, en 2006, après seulement quelques semaines de mobilisation, le gouvernement a retiré son « Contrat Première Embauche » (CPE). Pourquoi ? Quelle différence y a-t-il entre ces mouvements ? Qu’est-ce qui a fait peur à la bourgeoisie en 2006, au point de la faire reculer si rapidement ?
En 2010 et en 2019, nous étions nombreux, nous étions solidaires et déterminés, mais nous n’étions pas unis. Nous étions peut-être des millions, mais nous étions les uns derrière les autres. Les manifestations consistaient à venir avec ses collègues, à marcher avec ses collègues sous le bruit assourdissant des sonos, et à repartir avec ses collègues. Aucune assemblée, aucun débat, aucune réelle rencontre. Ces manifestations étaient réduites à l’expression d’un simple défilé.
En 2006, les étudiants précaires avaient organisé, dans les universités, des assemblées générales massives, ouvertes aux travailleurs, aux chômeurs et aux retraités, ils avaient mis en avant un mot d’ordre unificateur : la lutte contre la précarisation et le chômage. Ces assemblée étaient le poumon du mouvement, là où les débats se menaient, là où les décisions se prenaient. Résultat : chaque week-end, les manifestations regroupaient de plus en plus de secteurs. Les travailleurs salariés et retraités s’étaient joints aux étudiants, sous le slogan : « Jeunes lardons, vieux croûtons, tous la même salade ». La bourgeoisie française et le gouvernement, face à cette tendance à l’unification du mouvement, n’avait pas eu d’autre choix que de retirer son CPE.
La grande différence entre ces mouvements est donc la question de la prise en main des luttes par les travailleurs eux-mêmes !
Dans les cortèges, aujourd’hui, la référence à Mai 68 revient régulièrement : « Tu nous mets 64, on te re-Mai 68 », pouvait-on lire sur de nombreuses affiches. Ce mouvement a laissé une trace extraordinaire dans les mémoires ouvrières. Et justement, en 1968, le prolétariat en France s’était uni en prenant en mains ses luttes. Suite aux immenses manifestations du 13 mai pour protester contre la répression policière subie par les étudiants, les débrayages et les assemblées générales s’étaient propagés comme une traînée de poudre dans les usines et tous les lieux de travail pour aboutir, avec ses neuf millions de grévistes, à la plus grande grève de l’histoire du mouvement ouvrier international. Très souvent, cette dynamique d’extension et d’unité s’était développée en dehors du giron des syndicats et de nombreux ouvriers avaient déchiré leur carte syndicale après les accords de Grenelle du 27 mai entre les syndicats et le patronat, accords qui avaient enterré le mouvement.
Aujourd’hui, travailleurs salariés, chômeurs, retraités, étudiants précaires, nous manquons encore de confiance en nous, en notre force collective, pour oser prendre en main nos luttes. Mais il n’y a pas d’autre chemin. Toutes les « actions » proposées par les syndicats mènent à la défaite. Seul le rassemblement au sein d’assemblées générales ouvertes et massives, autonomes, décidant réellement de la conduite du mouvement, peut constituer la base d’une lutte unie, portée par la solidarité entre tous les secteurs, toutes les générations, des assemblées générales dans lesquelles nous nous sentons unis et confiants en notre force collective.
Il n’y a aucune illusion à avoir, l’histoire l’a démontré mille fois : aujourd’hui les syndicats affichent leur « unité » et appellent à la mobilisation générale, demain ils vont s’opposer pour mieux nous diviser et mieux nous démobiliser. D’ailleurs, ils ont commencé :
– D’un côté, les syndicats classés « radicaux » focalisent l’attention sur la nécessité de bloquer l’économie du pays. Concrètement, cela signifie que les ouvriers des secteurs les plus combatifs actuellement, comme les raffineurs ou les cheminots, vont se retrouver enfermés sur leur lieu de travail, isolés de leur frères de classe des autres secteurs qui en seront, eux, réduits à la grève par procuration. Comme en 2019 !
– De l’autre côté, les syndicats dits « réformistes » préparent déjà la désunion en répétant « Nous ne sommes pas contre une réforme de la retraite. Nous ne sommes pas des inconscients. On sait bien qu’il faut qu’on conserve un système d’équilibre financier sur ce régime de retraite par répartition. […] Pour autant, on n’a pas envie d’une réforme qui soit injuste ». (Geoffrey Caillon, coordinateur CFDT TotalEnergies). Et d’en appeler le gouvernement à « entendre » le mécontentent et à négocier. Autrement dit, gouvernement et syndicats ont déjà prévu depuis longtemps des aménagements à la réforme pour faire passer la pilule. Comme en 2019 !
L’avenir appartient à la lutte de classe !
La réforme des retraites se fait au nom de l’équilibre budgétaire, de la justice et de l’avenir. Le 20 janvier, Macron a annoncé en grandes pompes un budget militaire record de 400 milliards d’euros ! Voilà la réalité de l’avenir promis par la bourgeoisie : plus de guerre et plus de misère. Le capitalisme est un système d’exploitation, mondial et décadent. Il mène l’humanité vers la barbarie et la destruction. La crise économique, la guerre, le réchauffement climatique, la pandémie ne sont pas des phénomènes séparés ; tous sont des fléaux de ce même système moribond.
Ainsi, nos luttes actuelles ne sont pas seulement une réaction face à la réforme des retraites, ni même face à la dégradation de nos conditions de vie. Fondamentalement, elles sont une réaction à la dynamique générale du capitalisme. Notre solidarité dans la lutte est l’antithèse de la compétition jusqu’à la mort de ce système divisé en entreprises et nations concurrentes. Notre solidarité entre les générations est l’antithèse du no future et de la spirale destructrice de ce système. Notre lutte symbolise le refus de se sacrifier sur l’autel de l’économie de guerre. C’est pourquoi chaque grève porte en elle les germes de la révolution. Le combat de la classe ouvrière est immédiatement une remise en cause des bases mêmes du capitalisme et de l’exploitation.
Notre lutte actuelle prépare les luttes à venir. Il n’y aura pas de répit. En s’enfonçant dans la crise économique mondiale, dans sa folle course au profit, chaque bourgeoisie nationale va n’avoir de cesse d’attaquer les conditions de vie et de travail du prolétariat.
Les travailleurs les plus combatifs et déterminés doivent se regrouper, discuter, se réapproprier les leçons du passé, pour préparer la lutte autonome de toute la classe ouvrière. C’est une nécessité. C’est le seul chemin possible.
Courant Communiste International (2 février 2023)
Se regrouper et débattre
Défiler les uns derrière les autres, puis repartir chacun dans son coin est stérile. Pour être véritablement unis dans la lutte, il faut se rencontrer, débattre, tirer ensemble les leçons de la lutte présente et des luttes passées. Il faut prendre en mains nos luttes.
Partout où cela est possible, sur les lieux de travail ou ici, sur les trottoirs, sur les places, en fin de manifestation, il faut se regrouper et discuter.
Si en lisant ce tract, vous partagez cette volonté de réfléchir ensemble, de s’organiser, de prendre en mains les luttes alors n’hésitez pas à venir à notre rencontre à la fin de la manifestation pour poursuivre le débat.
L’émancipation des travailleurs sera l’œuvre des travailleurs eux-mêmes.
Vie du CCI:
- Interventions [492]
Récent et en cours:
- Réforme des retraites [526]
Rubrique:
ICConline - février 2023
- 58 lectures
Le groupe trotskiste “Lutte ouvrière” dans le rôle de sergent recruteur de la guerre impérialiste
- 286 lectures
Emporté dans une dérive opportuniste qui l’avait conduit jusqu’à demander aux militants de son courant d’adhérer aux partis sociaux-démocrates, ceux-là mêmes qui avaient en Allemagne commandité l’assassinat de Rosa Luxemburg et de Karl Liebknecht, Léon Trotsky défendit durant les années 1930 et jusqu’à sa mort la position selon laquelle l’URSS de Staline n’était pas un pays impérialiste. Les épigones de Trotsky n’ont fait qu’exploiter, au bénéfice de la bourgeoisie, ce raisonnement erroné du vieux révolutionnaire pour enfoncer encore plus la classe ouvrière dans la contre-révolution. En reprenant les erreurs de leur maître et en les poussant jusqu’à leur caricature, les organisations trotskistes n’ont pas mis longtemps pour occuper franchement leur place sur l’échiquier politique bourgeois, aux côtés de tous ceux qui d’une façon ou d’une autre œuvrent afin que se perpétue ce système d’exploitation.
Le groupe français Lutte ouvrière se distingue au sein de la famille trotskiste par sa fidélité sans borne à ce dogme. Pour lui ce n’est pas seulement l’URSS de Staline qui n’est pas impérialiste, mais aussi celle de Khrouchtchev et celle de Brejnev. Et, forme suprême de cette fidélité à toute épreuve, la Russie de Poutine tout autant. Dans la guerre entre l’Ukraine et la Russie, cette position conduit en toute logique Lutte ouvrière à ne dénoncer qu’un seul des deux camps impérialistes, celui de l’Ukraine et de ses alliés européens et américains. Cela signifie qu’elle soutient l’autre camp impérialiste, celui de la Russie. C’est donc le chauvinisme et la défense de la patrie que défend LO en bonne organisation appartenant au camp de la bourgeoisie et non pas l’internationalisme prolétarien !
Aucun pays ne peut se soustraire à l’impérialisme
C’est ce que nous avons pu constater encore une fois lors du meeting de Lutte ouvrière (LO) à Nantes, le 17 novembre dernier. L’exposé a répété que la Russie était faible économiquement, qu’elle avait un budget militaire bien plus faible que les États-Unis ou même la France, ce qui était présenté comme un argument solide. C’est vrai que la Russie est très faible économiquement. Cependant, même si elle n’a pas les mêmes moyens que les États-Unis ou la France, elle a malgré tout un budget militaire proportionnellement très important. Elle était en 2021 le deuxième exportateur d’armes (19 % des armes vendues) derrière les États-Unis (39 %) et devant la France (11 %). La Russie est donc un pays impérialiste comme l’était déjà l’URSS. Il suffit de se souvenir des accords de Yalta en 1945 où les trois grands impérialistes vainqueurs, Churchill, Roosevelt et Staline, se sont partagés le monde. Ou encore lorsque l’URSS envahit l’Afghanistan en 1979 pour trouver un débouché vers les mers chaudes. Poutine a emporté avec lui l’héritage impérialiste du Tsar, de Staline et s’est empressé de lancer plusieurs guerres impérialistes pour protéger son territoire ou de bombarder les civils en Syrie, profitant des difficultés de l’impérialisme américain pour s’implanter au Moyen-Orient.
Notre intervention, lors du meeting de LO, avait pour but principal de rappeler la position de principe internationaliste et de dénoncer la position bourgeoise de LO en reprenant les grandes lignes de ce que nous venons d’exposer. La réponse apportée a été bien mince. Au milieu d’un discours insipide ne ressortait qu’un seul argument : « Le CCI met tout sur le même plan. Que faites-vous de la guerre d’Algérie ? » La guerre d’Algérie (1954-1962) est justement un bon exemple. Elle confirme la position de Rosa Luxemburg sur la fin des luttes de libération nationale à l’époque de l’impérialisme. Arrivée trop tard sur un marché mondial déjà partagé, l’Algérie a été obligé de se vendre à l’un ou à l’autre des grands impérialistes, l’URSS ou les États-Unis, pour essayer de survivre sans jamais pouvoir créer une véritable industrie, (1) les prolétaires algériens étant obligés d’aller vendre leur force de travail dans l’ancien pays colonisateur. Broyée par le système impérialiste mondial, l’Algérie devint elle-même un pays impérialiste comme son voisin le Maroc avec lequel elle n’a cessé de s’affronter militairement pour défendre ses intérêts impérialistes pour des questions de frontières comme au Sahara occidental par exemple.
Loin de mettre toutes les guerres dans le « même sac », le CCI reprend la démarche du marxisme, celle de Lénine et de Luxemburg, qui consiste à replacer chaque guerre dans sa période historique, aujourd’hui celle de la décadence du capitalisme, où l’enjeu est devenu : Révolution communiste ou destruction de l’humanité !
Après la défaite de la vague révolutionnaire internationale et son expulsion d’URSS, Trotsky est resté aveugle devant la contre-révolution à l’œuvre en Russie malgré la terreur stalinienne et la surexploitation du prolétariat. Il s’est bercé d’illusion sur un effondrement possible de la clique stalinienne, cherchant toujours à s’allier avec ce qu’il croyait discerner comme une tendance de gauche au sein de celle-ci. Dans ce but, il caractérisa le régime « soviétique » non pas comme un système capitaliste d’État mais comme un « État ouvrier dégénéré » où subsisteraient certains acquis de la révolution d’Octobre, ce qui voulait dire qu’il fallait à tout prix défendre ce qui n’avait pourtant plus rien d’un bastion prolétarien contre toute agression des autres pays. Une position intenable ! Rongé par ces contradictions et par des crises à répétition, le trotskisme a fait faillite au moment du déclenchement de la Deuxième Guerre mondiale. Il passa alors irrémédiablement dans le camp de la bourgeoisie en soutenant le camp des alliés, c’est-à-dire celui qui prônait à la fois l’idéologie antifasciste, qui avait permis d’embrigader le prolétariat dans la nouvelle guerre impérialiste, et la défense de la patrie socialiste qui dissimulait en fait la réalité du retour de la bourgeoisie à la tête de l’État russe. Alors qu’en 1945 l’armée russe, comme toute armée d’une puissance impérialiste, envahissait l’Allemagne vaincue en tuant des civils, en pillant et en violant, la presse de l’ancêtre de LO saluait l’avancée de l’armée rouge qui, pour lui, rapprochait toujours plus le jour de la révolution prolétarienne mondiale. Ce passage dans le camp de la bourgeoisie est définitif et toutes les variantes du trotskisme ont abandonné le combat pour l’émancipation du prolétariat, l’internationalisme et n’ont cessé depuis de soutenir de manière ouverte ou plus sournoise un camp impérialiste contre un autre. (2)
Pour LO, la perspective du communisme est un continent inconnu
Avec un tel début, la suite de la réunion était prévisible. De nombreux jeunes étaient présents et visiblement certains d’entre eux étaient à la recherche de réponses pour toutes les questions engendrées par cette situation de crise et de guerre. Ils étaient déterminés dans la recherche d’un cadre politique cohérent et d’une perspective révolutionnaire. Leurs questions étaient naturellement très générales : « Qu’est-ce que le communisme ? Comment lutter pour sa victoire ? » Évidemment, à ces questions générales, LO s’est contenté de répondre de façon très générale et les participants durent s’en contenter. Rien sur la nécessité d’une révolution internationale et l’impossibilité du socialisme en un seul pays, rien sur l’insurrection et l’attitude à avoir face à l’État bourgeois, rien sur la dictature du prolétariat et le nouvel État post-révolutionnaire, rien sur la guerre civile révolutionnaire, rien sur les tâches du prolétariat durant la période de transition au communisme, rien sur les caractéristiques de la société communiste qui représente le but final du combat prolétarien ! (3)
À la question : « Qu’est-ce que le communisme ? », la réponse de LO était : « L’abolition de la propriété privée des moyens de production. » Les auditeurs repartiront avec l’idée que le prolétariat ayant pris le pouvoir n’aura qu’à nationaliser les entreprises, et c’est d’ailleurs sans nul doute la vision des militants de LO sur les tâches de la révolution. L’expérience russe a pourtant invalidé la position de Trotsky qui voyait la propriété nationalisée en URSS comme une preuve du caractère prolétarien de l’État. C’était là réduire le capital à une simple forme juridique au lieu de l’appréhender comme un rapport social.
À la question : « Est-ce que la nature humaine, bien souvent égoïste, n’empêche pas la réalisation de cet idéal ? », les participants ont eu pour toute réponse : « Les ouvriers étouffent dans le capitalisme et n’ont pas le droit de s’exprimer, de participer à la gestion de la société. Avec les conseils ouvriers et la démocratie ouvrière, tous pourront participer à la révolution et à la construction du communisme. » Rien sur le combat que doivent mener les prolétaires pour que les conseils ouvriers conservent le pouvoir et empêcher la fusion avec l’État de transition qui avait entraîné leur déclin en Russie dès 1918.
À la question : « Que peut-on faire de concret dès aujourd’hui ? », la réponse a été : « Il y a eu une grève à La Poste récemment. Certes nous n’avons pas pu créer un comité de grève mais nous avons pu constater et encourager la combativité des ouvriers. » Bien entendu, LO est incapable d’expliquer quels sont les besoins de la lutte revendicative, comment déjouer les pièges de la bourgeoisie et quelle est la fonction des syndicats.
Les flous et les silences ont été les plus significatifs face à la question : « Et si la bureaucratie confisque une fois de plus la révolution ? » Pour répondre à cette question, il est indispensable de tirer les leçons de la révolution et de la contre-révolution. C’est la première chose à dire aux jeunes qui veulent s’engager politiquement dans le camp du prolétariat. Ces leçons expliquent que la bureaucratie qui a envahi l’appareil d’État et le parti bolchevik, bureaucratie contrôlée par Staline et ses amis, n’était pas une tendance politique erronée, centriste au sein du camp prolétarien comme le pensait Trotsky, mais qu’elle était le fer de lance de la contre-révolution bourgeoise. Cette contre-révolution bourgeoise s’est progressivement imposée à la faveur de l’isolement de la révolution et de l’identification entre le parti et l’État. Trotsky ne voyait pas la contre-révolution, se bornant dramatiquement à dénoncer le risque d’un « Thermidor » engendré par tous ceux qui poussaient au retour de la propriété privée (les hommes de la NEP, les koulaks, la droite de Boukharine).
La fonction du trotskisme est de rabattre les ouvriers qui prennent conscience de leurs intérêts de classe vers l’idéologie de la bourgeoisie. Dans les luttes revendicatives, là où les ouvriers sont au contact des syndicats et commencent à prendre conscience de leur rôle de saboteurs, LO va tout faire pour les rabattre vers le syndicalisme de base. Lorsque les ouvriers commencent à se détourner des partis de gauche (qui appartiennent en fait à l’appareil politique de la bourgeoisie, tout comme « l’extrême-gauche ») et des élections, LO appelle au front unique avec la gauche « de gouvernement », participe aux élections et appelle à voter au second tour pour un candidat du parti socialiste (pour F. Mitterrand puis pour S. Royal).
Comme nous l’avons vu avec le meeting de LO, il faut inclure dans cette fonction du trotskisme l’encadrement des jeunes éléments qui cherchent à rejoindre le combat prolétarien en les décourageant ou en les embrigadant dans l’activisme et la confusion. À aucun moment LO n’a défendu réellement le programme de la révolution prolétarienne et du communisme. Rien de plus naturel puisqu’elle appartient au camp de ceux que Lénine appelait les social-chauvins, socialistes en parole, chauvins en fait.
Avrom & Romain
1 La décolonisation n’a pas empêché les pays centraux de maintenir leur domination sur les pays périphériques et de fermer la porte à un réel développement économique chez ceux-ci. Les seules exceptions sont quelques pays qui vivent de la rente pétrolière dans une situation précaire qui dépend du bon vouloir des pays les plus puissants, et la Chine qui a bénéficié d’abord du soutien américain et ensuite du choc de l’effondrement du bloc impérialiste russe, puis de la dissolution du bloc américain qui en a découlé, pour contrôler une plus grande part du marché mondial.
2 Par exemple lors de la guerre en Irak au début des années 1990. Voir notre article « Les trotskistes, pourvoyeurs de chair à canon », dans Révolution internationale n° 199, mars 1991.
3 On trouvera des réponses détaillées à toutes ces questions dans notre brochure : Le Communisme n’est pas un bel idéal.
Vie du CCI:
- Interventions [492]
Récent et en cours:
- Guerre en Ukraine [397]
Courants politiques:
- Trotskysme [468]
Rubrique:
Nous ne sommes pas seuls à nous mobiliser... Il y a des luttes ouvrières dans de nombreux pays !
- 259 lectures
De Grande-Bretagne à la France en passant par l’Espagne et les Pays-Bas, les luttes ouvrières se multiplient sous les effets de l’inflation, l’intensification de l’économie de guerre et les attaques frontales de la bourgeoisie sur les conditions de vie et de travail.
Quelle est la signification de ces luttes ? Quelles potentialités contiennent-elles ? Comment la bourgeoisie réplique-t-elle ? Comment la classe ouvrière peut-elle aller plus loin dans ces luttes ?
Venez discuter de toutes ces questions lors des réunions publiques organisées par le CCI dans les villes suivantes :
Lille : le 18 mars à partir de 15H00, bistrot « Les Sarrazins », 52 rue des Sarrazins (Métro « Wazemmes »).
Lyon : le 25 mars à partir de 15H00, au CCO Jean Pierre Lachaize (salle 5), 39 rue G.Courteline, 69100 Villeurbanne.
Marseille : le 8 avril à partir de 15H00, Local Mille Babords, 61 rue Consolat, 13001 Marseille.
Nantes : le 8 avril à partir de 15H00, Salle de la Fraternité, 3 rue de l'Amiral Duchaffault, 44100 Nantes, (Station de tramway "Duchaffault", ligne 1).
Paris : le 1er avril à partir de 15H00, au CICP, 21ter rue Voltaire, 75011 Paris, (Métro "Rue des boulets").
Rennes : le 25 mars à partir de 14H30, Maison de quartier de Villejean, Salle Mandoline, 2 rue de Bourgogne, 35000 Rennes.
Toulouse : le 25 mars à partir de 14H00, Espace François Laffont, 1 rue Léon Jouhaux, 31500 Toulouse, (Métro A station "Jolimont").
Vie du CCI:
- Réunions publiques [219]
Rubrique:
Le désastre porte un nom: le capitalisme!
- 50 lectures
Nous publions ici la déclaration de camarades en Turquie sur le tremblement de terre qui a frappé la Turquie et la Syrie. Nous saluons la réponse rapide des camarades à ces terribles événements, dans lesquels le nombre officiel de morts a déjà dépassé les 21 000 et risque d’être beaucoup plus élevé, y compris ceux qui ont survécu au tremblement de terre initial mais qui doivent maintenant faire face à la faim, au froid et à la maladie. Comme le montre la déclaration, cette catastrophe « naturelle » a été rendue beaucoup plus meurtrière par les exigences impitoyables du profit et de la concurrence capitalistes, qui ont obligé les gens à vivre dans des logements totalement inadaptés et fragiles. Les effets particulièrement catastrophiques du récent tremblement de terre illustrent l’accentuation du mépris de la bourgeoisie pour la vie et la souffrance de la classe ouvrière et des opprimés aujourd’hui, dans la période où le mode de production capitaliste se décompose à tous égards. En particulier, le fait que cette catastrophe se déroule au milieu d’un théâtre de guerre impérialiste en aggrave considérablement l’impact. L’épicentre du séisme se trouvait à Maraş, dans la région majoritairement kurde longtemps théâtre du conflit entre l’État turc et les nationalistes kurdes. Dans le nord de la Syrie, un grand nombre de victimes sont des réfugiés qui ont tenté de se mettre à l’abri de la guerre meurtrière en Syrie, et qui vivaient déjà dans des conditions infernales, exacerbées par le bombardement délibéré des hôpitaux par le régime Assad dans des villes comme Alep. La confrontation permanente entre les factions capitalistes belligérantes dans la région constituera également un obstacle politique et matériel aux efforts de sauvetage déjà insuffisants.
Nous voulons toutefois signaler deux problèmes dans ce texte et dont les camarades ont convenu. Le premier est son titre : « Seule la solidarité de classe prolétarienne peut nous sauver ! ». Ce n’est pas en soit la solidarité prolétarienne qui permettra de mettre fin aux maux du capitalisme, mais le renversement de ce système. Il n’y a pas de « solutions » à la crise historique du capitalisme en son sein. Enfin, la phrase suivante n’est pas juste : « Déjà, dans le monde entier, des travailleurs et des équipes de recherche et de sauvetage expriment leur solidarité pour aider les survivants. Cette solidarité, qui est l’une des plus grandes armes du prolétariat, est une nécessité vitale ». En effet, à l’exception des tous premiers jours, les équipes de secours dépêchées sur place étaient constituées de professionnels, bien souvent envoyées par les États, ce qui n’a rien à voir avec la solidarité prolétarienne.
CCI
Le désastre porte un nom : le capitalisme ! Seul son renversement peut épargner de telles souffrances à l’humanité !
Il n’est pas encore possible de saisir exactement la mesure des effets destructeurs du tremblement de terre qui a eu lieu à Maraş (6 février 2023), et qui a également frappé les provinces voisines et la Syrie. Déjà, les médias affirment que plus de dix mille bâtiments ont été détruits, que des milliers de personnes sont mortes sous les décombres et que des dizaines de milliers de personnes ont été blessées. Les communications avec certaines villes sont coupées depuis deux jours. Des routes, des ponts, des aéroports ont été détruits. On rapporte qu’un incendie s’est déclaré dans le port d’Iskenderun. Les connexions d’électricité, d’eau et de gaz naturel sont coupées dans de nombreuses régions. Ceux qui ont survécu au séisme doivent maintenant lutter contre la faim et le froid dans des conditions hivernales difficiles. Des nouvelles très graves nous parviennent également des zones touchées par le séisme en Syrie, qui est sous l’occupation militaire de la Turquie.
Deux importants tremblements de terre consécutifs sont certes inhabituels. Cependant, contrairement à ce que prétendent la classe dirigeante et ses partis, cela ne signifie pas que les destructions causées par les séismes sont normales. Les appels écœurants à l'« unité nationale » lancés tant par l’opposition que par les partis capitalistes au pouvoir ne peuvent cacher un fait que tout le monde connaît : le capitalisme et l’État sont les principaux responsables de ces destructions.
1- Nous savons que le prolétariat, en tant que classe, fera preuve d’une solidarité sous toutes ses formes dans l’action pour ceux qui se sont retrouvés sans abri, blessés et ont perdu leurs proches dans les zones touchées par le séisme. Des centaines de travailleurs des mines se sont déjà portés volontaires pour participer aux efforts de recherche et de sauvetage dans la zone dévastée.. Les prolétaires n’ont personne d’autre qu’eux-mêmes à qui faire confiance. Nous ne pouvons espérer notre émancipation que par notre propre classe, par l’unité, et non par la classe dominante et son État.
2- Les expériences sismiques passées en Turquie sont la preuve des effets destructeurs et mortels de l’urbanisation qui s’est développée dans le but de reproduire la société du Capital. La seule raison pour laquelle on construit des immeubles à étages incapables d’affronter les tremblements de terre, dans lesquels des gens s’entassent et forment des villes densément peuplées dans les zones sismiques, est de répondre aux besoins de main-d’œuvre abondante et bon marché que recherche le Capital. Après les séismes de Gölcük et de Düzce il y a 20 ans (dans la région de la mer de Marmara), ce séisme démontre une fois de plus la superficialité de toutes les « mesures » prises par l’État et les larmes de crocodile versées par la classe dirigeante. Ce tremblement de terre et ses effets prouvent déjà douloureusement que la raison principale de l’existence de l’État n’est pas de protéger la population pauvre et prolétaire, mais de protéger les intérêts du capital national.
3- Alors pourquoi le capitalisme ne construit-il pas une infrastructure permanente et solide, même si les catastrophes détruisent régulièrement et systématiquement sa propre infrastructure de production ? Parce que sous le capitalisme, les bâtiments, les routes, les barrages, les ports, bref, les investissements en infrastructures en général, ne sont pas construits dans une optique de permanence ou de besoins humains. Dans le capitalisme, tous les investissements en infrastructures, qu’ils soient réalisés par l’État ou par des entreprises privées, sont construits dans un but de rentabilité et de maintien du système de travail salarié. Les populations denses sont entassées dans des villes inhabitables. Même s’il n’y a pas de tremblement de terre, les villes et les zones rurales sont constituées de bâtiments insalubres en béton qui peuvent durer tout au plus 100 ans. La terrible urbanisation capitaliste des 40 dernières années a transformé les villes et même les villages de Turquie en de véritables cimetières de béton. Le système capitaliste basé sur la production de plus-value ne peut être maintenu qu’en employant autant de main-d’œuvre vivante que possible, c’est-à-dire des prolétaires, et en maintenant au minimum les investissements en capital fixe, c’est-à-dire les infrastructures. Dans le capitalisme, la construction est une activité permanente, mais la permanence du bâtiment, son harmonie avec l’environnement et sa réponse aux besoins humains sont totalement ignorés. C’est la règle dans le capitalisme occidental avancé ainsi que dans les capitalismes plus faibles d’Afrique et d’Asie. Le seul objectif social du capital et de ses États est de perpétuer l’exploitation d’un nombre toujours plus grand de prolétaires.
4- L’ordre capitaliste n’est même pas en mesure de proposer des solutions permettant de reproduire son propre ordre d’exploitation. Face aux catastrophes « naturelles », le Capital est non seulement insouciant mais aussi impuissant. Nous voyons cette impuissance même dans le manque de coordination des organisations d’aide sous le contrôle des États-nations et l’incurie de l’État dans la distribution de l’aide d’urgence. Nous le voyons non seulement dans des pays comme la Turquie, où le capitalisme en décomposition a été plus profondément touché, mais aussi dans des pays au cœur du capitalisme, comme l’Allemagne, qui était impuissante face aux inondations il y a deux ans, ou les États-Unis, dont les routes et les ponts s’effondrent lors d’inondations en raison de la faiblesse des investissements dans les infrastructures.
5- Le fait que certaines parties de l’opposition bourgeoise trouvent l’État « incapable » d’« aider » les victimes du séisme présente une vision trompeuse sur la nature de l’État. L’État n’est pas une agence d’aide. L’État est l’appareil collectif de violence d’une classe exploiteuse minoritaire. L’État protège les intérêts du Capital. Certes, puisque le règne du chaos dans une zone sinistrée va à la fois montrer la faiblesse de la classe dominante et entraver la reproduction du Capital lui-même, l’État sera contraint d’organiser un niveau minimum d'« aide ». Mais il semble que l’État soit incapable de fournir même cette aide minimale. Quelle que soit l’intervention de l’État dans la catastrophe, sa fonction principale est de contenir le prolétariat et de concurrencer les autres pays capitalistes dans l’intérêt de son propre Capital national. L’État est la machine idéologique et physique qui aide l’accumulation du Capital, le gardien des conditions qui poussent les travailleurs dans des cercueils de béton mortels et les laissent sans défense face aux catastrophes.
6- Il n’y a rien de « naturel » dans les épidémies, les famines et les guerres que nous avons connues ces dernières années et dont les effets se font sentir dans le monde entier. Bien qu’il soit impossible de prévoir le moment d’un tremblement de terre avant qu’il ne se produise, on peut prédire avec certitude les lignes de faille des tremblements de terre et leur éventuelle magnitude. Le principal agent responsable de tous ces désastres est le capitalisme et les États-nations, l’ensemble de la classe dirigeante existante, qui organise la société autour de l’extraction de la plus-value et du travail salarié, qui exacerbe la compétition militaro-nationaliste et qui menace l’existence et l’avenir de l’humanité. Tant que le capitalisme continuera à dominer, tant que l’humanité continuera à rester divisée en États-nations et en classes, ces catastrophes continueront à se produire, devenant plus meurtrières, plus destructrices et plus fréquentes. C’est l’indication la plus claire de l’épuisement du capitalisme. Partout dans le monde, la classe dirigeante pousse l’humanité vers des guerres, des villes horribles et inhabitables, la faim et la famine, une gigantesque crise climatique mondiale.
Le séisme qui a eu lieu à Maraş et dans ses environs est la dernière preuve concrète et douloureuse que la classe dirigeante n’a aucun avenir positif à offrir à l’humanité. Mais cela ne doit pas nous conduire au pessimisme. La solidarité dont notre classe a fait et fera preuve lors de ce tremblement de terre doit nous donner de l’espoir. Les catastrophes sont dévastatrices non pas parce qu’elles n’ont pas de solution, mais parce que notre classe, le prolétariat, n’a pas encore la confiance en lui nécessaire pour changer le monde et sauver l’humanité du fléau du Capital. Les ressources de l’humanité et de la terre sont suffisantes pour construire des habitations et des cités permanentes et sûres qui nous protégeront des catastrophes. La voie vers cela s’ouvrira lorsque le prolétariat, la seule force capable de mobiliser les ressources du monde pour sa libération, développera sa confiance en lui-même et s’engagera dans une lutte mondiale pour prendre le pouvoir à la classe capitaliste corrompue.
Un groupe de communistes internationalistes de Turquie, 7 février 2023
Géographique:
Récent et en cours:
Rubrique:
Peut-on faire reculer la bourgeoisie en bloquant l’économie?
- 209 lectures
Des millions de travailleurs, d’étudiants, de retraités battent le pavé depuis des semaines contre la réforme des retraites. Dans les cortèges, les manifestants expriment beaucoup d’enthousiasme et une grande fierté de se retrouver par millions dans les rues : « ensemble, nous sommes plus forts » ! Les luttes qui se déroulent simultanément dans de nombreux pays, particulièrement au Royaume-Uni et en France, se caractérisent par un fait nouveau : pour la première fois depuis longtemps, les travailleurs du public et du privé, les salariés en blouse (blanche ou bleue) et ceux en cravate, les étudiants précaires, les chômeurs et les intérimaires, tous commencent, de façon encore très confuse et balbutiante, à se reconnaître comme une force sociale unie par les mêmes conditions d’exploitation : la classe ouvrière.
Nous produisons tout. Sans notre travail, il n’y a pas de profit, pas de marchandises, plus rien ne fonctionne, ni les usines, ni les hôpitaux, ni les écoles, ni les centres commerciaux. Sans notre travail, les déchets s’entassent, personne ne peut manger ni boire, se vêtir ou se soigner. Sans notre travail, rien ne sort des usines et des ports, ni les automobiles, ni les avions, ni les boites de conserve… C’est en substance l’idée qui commence à émerger dans la tête des ouvriers. C’est la raison pour laquelle beaucoup ressentent très justement que notre plus grande force dans la lutte réside dans notre unité.
La colère est immense, le sentiment de devoir se battre tous ensemble l’est tout autant. Mais, chacun perçoit également que les « balades » syndicales, aussi nombreux que nous puissions être dans les rues, ne suffisent pas. Cette mobilisation massive ne semble pas faire trembler le gouvernement, bien décidé à imposer sa réforme. Pour beaucoup, sans « durcir la riposte », plus le mouvement va durer, moins il y aura de gens dans la rue et en grève.
Alors que faire ? Comment les exploités peuvent-ils transformer, dans la durée, la force collective qu’ils perçoivent de plus en plus clairement en véritable rapport de force face à la bourgeoisie ?
Les syndicats et les partis de gauche ont immédiatement mis en avant un mot d’ordre qui, en apparence, paraît s’inscrire dans un combat unitaire et massif : si le gouvernement ne recule pas, à partir du 7 mars, il faudra « bloquer l’économie » et « mettre la France à l’arrêt ». Certains appelaient même à la « grève générale ».
Ces mots d’ordre ont souvent été repris par les grévistes et les manifestants. Après tout, cette tactique ne s’appuie-t-elle pas sur la principale force des ouvriers en lutte ? Ne pouvons-nous pas mettre à genoux la bourgeoisie en cessant de travailler massivement si nous produisons tout ?
Les leçons du blocage des raffineries en 2010
Ce n’est pas la première fois que les syndicats mettent en avant une telle tactique de blocage. En 2010, lors de la précédente réforme des retraites, les manifestations se sont succédé, rassemblant chaque fois des millions de personnes. Tandis que les seuls défilés de rues apparaissaient, aux yeux de tous, impuissants et stériles, des minorités ont cherché des méthodes de lutte plus radicales et efficaces. Poussé, à l’époque, par la CGT, l’arrêt du « secteur stratégique » des raffineries est alors apparu comme un moyen de faire concrètement pression sur la bourgeoisie en paralysant les transports et l’ensemble de l’économie.
Les ouvriers des raffineries se sont alors mis en grève, bloquant la production et la distribution d’essence. Pourtant, la bourgeoisie française n’a pas reculé. Et pour cause : elle avait largement la capacité de faire face aux blocages. La France, comme beaucoup d’autres pays, dispose, en effet, de plusieurs millions de tonnes de pétrole en réserve lui assurant de nombreux mois d’approvisionnement. Elle peut également s’appuyer sur un réseau international de pipelines pour simplement importer de l’étranger de l’essence par camion. Le gouvernement Fillon a ainsi joué, pendant quelques semaines, un simulacre de panique, occasionnant une ruée vers les stations-services. Le risque de pénurie d’essence et de paralysie de l’économie nationale, n’a donc été qu’une piqûre de moustique sur le dos d’un éléphant, un conte de fée pour endormir les ouvriers.
En fait, derrière ce blocage corporatiste s’est surtout profilée une cuisante défaite pour la classe ouvrière. La bourgeoisie s’est employée à isoler des grévistes parmi les plus combatifs et à diviser le prolétariat. D’un côté, les syndicats s’appuyant sur le contrôle absolu qu’ils exerçaient sur le mouvement, ont isolé les ouvriers des raffineries du reste de leur classe. Leur colère justifiée n’a nullement été le point de départ d’une extension de la lutte. Plutôt qu’organiser des piquets volants devant des entreprises d’autres secteurs pour les gagner au mouvement, la CGT a enfermé les bloqueurs sur leur lieu de travail, avec une parodie de solidarité à travers des caisses de grève pour « soutenir les travailleurs en lutte ». Tout devant se jouer sur le seul blocage des raffineries, il s’agissait de tenir, coûte que coûte, dans une ambiance de citadelle assiégée.
De l’autre côté, à travers une intense campagne sur les risques de pénurie d’essence, le gouvernement et ses médias ont volontairement créé un climat de panique parmi la population. Si, en général, les prolétaires n’ont pas stigmatisé les ouvriers des raffineries et ont même plutôt manifesté une certaine sympathie, l’hystérique propagande médiatique a largement contribué à briser toute réflexion sur la possibilité d’élargir la lutte. Finalement, la répression policière s’est abattue sur les raffineries isolées, laissant la classe ouvrière en France KO debout pendant toute une décennie.
La grève des mineurs britanniques en 1984, une expérience tragique de blocage
La grève des mineurs de 1984, au Royaume-Uni, est une autre illustration du caractère illusoire du blocage de la production à partir d’un seul secteur. À cette époque, le prolétariat le plus vieux du monde est aussi l’un des plus combatifs. Par deux fois, l’État a même dû retirer ses attaques. En 1969 et 1972, les mineurs sont, en effet, parvenus à créer un rapport de force favorable à la classe ouvrière en imprimant à la grève une dynamique d’extension sortant de la logique sectorielle ou corporatiste. Par dizaines ou par centaines, ils se sont rendus dans les ports, les aciéries, les dépôts de charbon, les centrales, pour les bloquer et convaincre les ouvriers sur place de les rejoindre dans la lutte. Cette méthode deviendra célèbre sous le nom de flying pickets (« piquets volants ») et symbolisera la force de la solidarité et de l’unité ouvrières.
En arrivant au pouvoir en 1979, Thatcher comptait bien briser les reins de la classe ouvrière en isolant un de ses secteurs les plus combatifs, celui des mineurs, dans une grève interminable et épuisante. Durant des mois, la bourgeoisie anglaise s’est préparée au bras de fer en constituant d’énormes stocks de charbon pour faire face au risque de pénurie. En mars 1984, 20 000 suppressions d’emplois sont brutalement annoncées dans les mines. Comme attendu, la réaction des mineurs a été fulgurante : dès le premier jour de grève, cent puits sur 184 sont fermés. Mais un corset de fer syndical a immédiatement entouré les grévistes pour empêcher tout risque de contamination. Les syndicats des autres secteurs ont soutenu très platoniquement le mouvement, autrement dit, ils ont laissé les mineurs se débrouiller tout seuls, en sabotant activement toute possibilité de lutte commune.
Le National Union of Mineworkers (NUM) a parachevé ce sale boulot en enfermant les mineurs dans des occupations de puits stériles et interminables pendant plus d’un an ! Afin d’éviter que des flying pickets soient envoyés aux portes des entreprises voisines, toute l’attention des ouvriers était focalisée sur la nécessité d’occuper les puits, tous les puits, rien que les puits, coûte que coûte. Bloquer la production du charbon était devenu, sous la houlette syndicale, l’objectif central et unique, une question en soi. Au lieu de voler d’usine en usine, les flying pickets sont restés là, au même endroit, devant les mêmes puits, mois après mois.
La répression policière a également fini par s’abattre sur des mineurs totalement épuisés et isolés. Cette défaite a marqué un tournant, celui d’un reflux de plusieurs décennies de la combativité ouvrière au Royaume-Uni. Elle annonçait même le reflux général de la combativité des ouvriers dans le monde et un recul de leur conscience à partir des années 1990.
Faut-il "mettre la France à l’arrêt" ?
Contrairement aux exemples des raffineries en France ou des mines au Royaume-Uni, les syndicats semblent aujourd’hui appeler des millions de personnes à engager des « grèves reconductibles ». Mais la réalité, c’est que, au nom de la force collective du prolétariat, les syndicats cherchent d’ores et déjà à organiser un repli corporatiste. Ils sont aujourd’hui contraints de coller à un mouvement de lutte qui aspire à la solidarité et ils ne peuvent pas appeler caricaturalement un secteur particulier à lutter par procuration pour les autres.
Pourtant, depuis des semaines, les syndicats poussent pour que, tantôt la SNCF, tantôt la RATP, tantôt les raffineries, tantôt les éboueurs ou tel ou tel secteur « durcissent le mouvement », c’est-à-dire engagent des grèves sectorielles. Pour le 7 mars, les syndicats appellent d’ailleurs à des grèves reconductibles « selon les modalités propres à chaque secteur ». Pour le 8 mars, ils appellent à « une journée de grève féministe », cherchant par-là à diviser les ouvriers et les ouvrières, comme ils le font depuis le début du mouvement en répétant ad nauseam que les femmes, les carrières longues, telle ou telle catégorie sont davantage victimes de la réforme.
Pour le moment, les ouvriers ne se sont pas laissés prendre massivement au piège mais c’est bien l’enfermement corporatiste que les syndicats cherchent à imposer sous le vocable de « grève générale ».
Le culte du blocage a toujours été utilisé par les syndicats contre l’unité et la massification de la lutte. Il est très clair que « mettre la France à l’arrêt », outre le relent nationaliste contenu dans la formule, signifie pour eux : enfermer les ouvriers dans leur entreprise, les couper de leurs frères de classe, de toute discussion, de toute solidarité réelle et concrète, et de toute capacité à étendre la lutte. Un mouvement massif de blocage ne peut réussir que par un véritable pouvoir décisionnel au sein d’assemblées générales souveraines, par une véritable prise en main de la lutte par les ouvriers eux-mêmes, qu’à travers la recherche active de l’extension de la lutte à d’autres secteurs, pas en s’enfermant chacun sur son lieu de travail.
La recherche de l’extension et de la solidarité doit animer toutes les méthodes de lutte !
Oui, le blocage de l’économie s’appuie sur une idée profondément juste, celle que commence à percevoir les manifestants : la classe ouvrière tient sa force de la place centrale qu’elle occupe dans la production. Le prolétariat produit presque l’ensemble des richesses que la bourgeoisie s’approprie. Par la grève, les ouvriers sont potentiellement capables de bloquer toute la production et de paralyser l’économie.
Lors des événements de mai 1968 en France et ceux d’août 1980 en Pologne, de gigantesques grèves ont paralysé ces pays. Mais le blocage n’était nullement l’objectif en soi des ouvriers. Si ces deux luttes sont historiques et restent gravées dans les mémoires, c’est parce que le prolétariat a su construire un rapport de force en sa faveur par l’auto-organisation et la massivité de ses luttes. Quand les ouvriers prennent en main leur lutte, ils se regroupent spontanément en assemblées générales pour débattre et décider collectivement des actions à mener, ils cherchent la solidarité de leurs frères de classe en allant à leur rencontre, en essayant de les entraîner dans le mouvement à l’aide de délégations massives.
Lors de ces deux grandes luttes, les grévistes ont surtout cherché à faire tourner l’économie au service de la lutte et de ses besoins. En 1968, par exemple, les cheminots faisaient circuler les trains pour permettre à la population de se déplacer jusqu’aux manifestations. En 1980, dans les moments les plus forts de ce mouvement, la prise en main des moyens de production est allé beaucoup plus loin encore : le comité de grève interentreprises (nommé MKS) a organisé le ravitaillement des grévistes et de toute la population en contrôlant et en faisant tourner les entreprises d’électricité et d’alimentation ou en alimentant en essence les moyens de transports nécessaires pour la lutte.
Il est d’ailleurs très significatif que les cibles du blocage mises en avant par les syndicats soient systématiquement les raffineries, les gares, les aéroports, les autoroutes ou les transports publics. Le secteur des transports est effectivement un élément stratégique pour la lutte ouvrière, mais pour des raisons exactement inverses que celles évoquées par les syndicats : le blocage des trains, des métros ou des bus est souvent un obstacle à l’élargissement de la lutte et peut favoriser le jeu de la bourgeoisie car il entrave la mobilité des travailleurs qui ne sont plus en mesure de se déplacer pour apporter leur solidarité aux grévistes, en se rendant à leurs assemblées générales ou en participant aux manifestations. Les déplacements des délégations de grévistes vers les autres entreprises sont également rendus difficiles. En fait, le blocage total favorise presque toujours l’enfermement dans le corporatisme et l’isolement.
Il n’existe aucune recette magique de lutte prête à l’emploi et valable en toutes circonstances. Toute méthode de lutte (blocage, piquet, occupation…) peut tantôt être au service du mouvement, tantôt un facteur de division et d’isolement. Une seule chose est certaine : la force de la classe ouvrière réside dans son unité, sa conscience de classe, sa capacité à développer sa solidarité et donc à étendre la lutte à tous les secteurs. C’est l’aiguillon qui doit guider nos luttes.
Tr.Bo, 20 février 2023
Situations territoriales:
Histoire du mouvement ouvrier:
- Mai 1968 [364]
Evènements historiques:
Récent et en cours:
- Réforme des retraites [526]
- blocage de l'économie [533]
Rubrique:
ICConline - mars 2023
- 76 lectures
Partout la même question: Comment développer la lutte? Comment faire reculer les gouvernements? (Tract international)
| Fichier attaché | Taille |
|---|---|
| 446.31 Ko |
- 334 lectures
Grèves générales et manifestations géantes le 7 mars en France, le 8 mars en Italie, le 11 mars au Royaume-Uni. Partout, la colère gronde et s’étend.
Au Royaume-Uni, une vague de grève historique dure depuis neuf mois ! Après avoir subi des décennies d’austérité sans broncher, le prolétariat britannique n’accepte plus les sacrifices. « Enough is enough ! / Trop c’est trop ! ». En France, c’est le recul de l’âge de départ à la retraite qui a mis le feu aux poudres. Les manifestations rassemblent des millions de personnes dans la rue. « Pas une année de plus, pas un euro de moins ». En Espagne, des rassemblements monstres se forment contre l’effondrement du système de soins et des grèves éclatent dans de nombreux secteurs (nettoyage, transports, informatique…). « La indignación llega de lejos / L’indignation vient de loin » reconnaissent les journaux. En Allemagne, étranglés par l’inflation, les personnels du secteur public et leurs collègues postiers débrayent pour des hausses de rémunération. « Du jamais vu en Allemagne ! ». Au Danemark, des grèves et manifestations ont éclaté contre la suppression d’un jour férié afin de financer la hausse du budget militaire. Au Portugal, enseignants, cheminots et soignants protestent eux aussi contre les bas salaires et le coût de la vie. Pays-Bas, États-Unis, Canada, Mexique, Chine… les mêmes grèves contre les mêmes conditions de vie insupportables et indignes : « La vraie galère : ne pas pouvoir se chauffer, manger, se soigner, rouler ! »
Le retour de la classe ouvrière
Cette simultanéité des luttes à travers tous ces pays n’est pas un hasard. Elle confirme un véritable changement d’état d’esprit au sein de notre classe. Après plus de trente années de résignation et d’abattement, par nos luttes, nous disons : « Nous ne nous laisserons plus faire. Nous pouvons et nous devons lutter ».
Ce retour de la combativité ouvrière nous permet de nous serrer les coudes dans la lutte, d’être solidaires dans la lutte, de nous sentir fiers, dignes et unis dans la lutte. Une idée toute simple mais extrêmement précieuse est en train de germer dans nos têtes : nous sommes tous dans le même bateau !
Salariés en blouse blanche, en blouse bleue ou en cravate, chômeurs, étudiants précarisés, retraités, de tous les secteurs, du public comme du privé, tous, nous commençons à nous reconnaître comme une force sociale unie par les mêmes conditions d’exploitation. Nous subissons la même exploitation, la même crise du capitalisme, les mêmes attaques contre nos conditions de vie et de travail. Nous menons la même lutte. Nous sommes la classe ouvrière.
« Workers stand together !/ Les ouvriers restent soudés », crient les grévistes au Royaume-Uni. « Soit on lutte ensemble, soit on finira par dormir dans la rue ! », confirment les manifestants en France.
Peut-on gagner ?
Certaines luttes du passé montrent qu’il est possible de faire reculer un gouvernement, de freiner ses attaques.
En 1968, le prolétariat en France s’est uni en prenant en main ses luttes. Suite aux immenses manifestations du 13 mai pour protester contre la répression policière subie par les étudiants, les débrayages et les assemblées générales se sont propagés comme une traînée de poudre dans les usines et tous les lieux de travail pour aboutir, avec ses 9 millions de grévistes, à la plus grande grève de l’histoire du mouvement ouvrier international. Face à cette dynamique d’extension et d’unité de la lutte ouvrière, gouvernement et syndicats se sont empressés de signer un accord de hausse généralisée des salaires afin d’arrêter le mouvement.
En 1980, en Pologne, face à l’augmentation des prix de l’alimentation, les grévistes portaient encore plus loin la prise en main des luttes en se rassemblant en d’immenses assemblées générales, en décidant eux-mêmes des revendications et des actions, et surtout en ayant pour souci constant d’étendre la lutte. Face à cette force, ce n’est pas simplement la bourgeoisie polonaise qui a tremblé mais celle de tous les pays.
En 2006, en France, après seulement quelques semaines de mobilisation, le gouvernement a retiré son « Contrat Première Embauche ». Pourquoi ? Qu’est-ce qui a fait peur à la bourgeoisie au point de la faire reculer si rapidement ? Les étudiants précaires ont organisé, dans les universités, des assemblées générales massives, ouvertes aux travailleurs, aux chômeurs et aux retraités, ils ont mis en avant un mot d’ordre unificateur : la lutte contre la précarisation et le chômage. Ces AG étaient le poumon du mouvement, là où les débats se menaient, là où les décisions se prenaient. Résultat : chaque week-end, les manifestations regroupaient de plus en plus de secteurs. Les travailleurs salariés et retraités s’étaient joints aux étudiants, sous le slogan : « Jeunes lardons, vieux croûtons, tous la même salade ». La bourgeoisie française et le gouvernement, face à cette tendance à l’unification du mouvement, n’avait pas eu d’autre choix que de retirer son CPE.
Tous ces mouvements ont en commun la prise en main des luttes par les travailleurs eux-mêmes !
Aujourd’hui, travailleurs salariés, chômeurs, retraités, étudiants précaires, nous manquons encore de confiance en nous, en notre force collective, pour oser prendre en main nos luttes. Mais il n’y a pas d’autre chemin. Toutes les « actions » proposées par les syndicats mènent à la défaite. Piquets, grèves, manifestations, blocage de l’économie… peu importe tant que ces actions restent sous leur contrôle. Si les syndicats changent la forme de leurs actions selon les circonstances, c’est pour toujours mieux conserver le même fond : diviser et isoler les secteurs les uns des autres pour éviter que nous débattions et décidions nous-mêmes de la conduite de la lutte.
Depuis neuf mois, au Royaume-Uni, que font les syndicats ? Ils éparpillent la riposte ouvrière : chaque jour, un secteur différent en grève. Chacun dans son coin, chacun sur son piquet. Aucun rassemblement, aucun débat collectif, aucune réelle unité dans la lutte. Il ne s’agit pas là d’une erreur de stratégie mais d’une division volontaire.
Comment en 1984-85, le gouvernement Thatcher est-il parvenu à briser les reins de la classe ouvrière au Royaume-Uni ? Grâce au sale travail des syndicats qui ont isolé les mineurs de leurs frères de classe des autres secteurs. Ils les ont enfermés dans une grève longue et stérile. Pendant plus d’un an, les mineurs ont occupé les puits, sous l’étendard du « blocage de l’économie ». Seuls et impuissants, les grévistes sont allés au bout de leurs forces et de leur courage. Et leur défaite a été celle de toute la classe ouvrière ! Les travailleurs du Royaume-Uni ne relèvent la tête qu’aujourd’hui, plus de trente ans après ! Cette défaite est donc une leçon chère payée que le prolétariat mondial ne doit pas oublier.
Seul le rassemblement au sein d’assemblées générales ouvertes et massives, autonomes, décidant réellement de la conduite du mouvement, peut constituer la base d’une lutte unie et qui s’étend, portée par la solidarité entre tous les secteurs, toutes les générations. Des AG dans lesquelles nous nous sentons unis et confiants en notre force collective. Des AG dans lesquelles nous pouvons adopter ensemble des revendications de plus en plus unificatrices. Des AG dans lesquelles nous nous rassemblons et depuis lesquelles nous pouvons partir en délégations massives à la rencontre de nos frères de classe, les travailleurs de l’usine, de l’hôpital, de l’établissement scolaire, de l’administration les plus proches.
La véritable victoire, c’est la lutte elle-même
« Peut-on gagner ? » La réponse est donc oui, parfois, si, et seulement si, nous prenons nos luttes en main. On peut freiner les attaques momentanément, faire reculer un gouvernement.
Mais la vérité, c’est que la crise économique mondiale va faire sombrer des pans entiers du prolétariat dans la précarité. Pour s’en sortir sur l’arène internationale du marché et de la concurrence, chaque bourgeoisie de chaque pays, que son gouvernement soit de gauche, de droite ou du centre, traditionnel ou populiste, va nous imposer des conditions de vie et de travail de plus en plus insoutenables.
La vérité, c’est qu’avec le développement de l’économie de guerre aux quatre coins de la planète, les « sacrifices » exigés par la bourgeoisie vont être de plus en plus insupportables.
La vérité, c’est que l’affrontement impérialiste des nations, de toutes les nations, est une spirale de destruction et de chaos sanglant qui peut mener toute l’humanité vers la mort. Chaque jour se fracasse en Ukraine un torrent d’êtres humains, parfois des gamins de 18 ou 16 ans, fauchés par les abominables instruments de mort russes et occidentaux.
La vérité, c’est que de simples épidémies de grippe ou de bronchiolite mettent désormais à genoux des systèmes sanitaires exsangues.
La vérité, c’est que le capitalisme va continuer de ravager la planète et de détraquer le climat, provoquant inondations, sécheresses et incendies dévastateurs.
La vérité c’est que des millions d’êtres humains vont continuer à fuir la guerre, la famine, les catastrophes climatiques, ou les trois, pour se heurter aux murs de barbelés des autres pays, ou sombrer dans la mer.
Alors, se pose la question : à quoi bon lutter contre les bas salaires, contre le manque de personnel, contre telle ou telle réforme ? Parce que la lutte ouvrière a pour finalité le renversement du capitalisme et de tous ses maux, l’avènement d’un monde sans classes ni exploitation, sans guerre ni frontières : le communisme.
La véritable victoire, c’est la lutte elle-même. Le simple fait de rentrer en lutte, de développer notre solidarité est déjà une victoire. En nous battant tous ensemble, en refusant la résignation, nous préparons les luttes de demain et nous créons petit à petit, malgré les inévitables défaites, les conditions d’un monde nouveau.
Notre solidarité dans la lutte est l’antithèse de la compétition jusqu’à la mort de ce système divisé en entreprises et nations concurrentes.
Notre solidarité entre les générations est l’antithèse du no future et de la spirale destructrice de ce système.
Notre lutte symbolise le refus de se sacrifier sur l’autel du militarisme et de la guerre.
Le combat de la classe ouvrière est immédiatement une remise en cause des bases mêmes du capitalisme et de l’exploitation.
Chaque grève porte en elle les germes de la révolution.
L’avenir appartient à la lutte de classe !
Courant Communiste International, 1er mars 2023
Vie du CCI:
- Interventions [492]
Récent et en cours:
- Grèves aux Royaume-Uni [535]
- Réforme des retraites [526]
Rubrique:
La grève de masse contre le mythe de la grève générale
- 299 lectures
L’appel au blocage de l’économie et à des grèves reconductibles par les syndicats à partir du 7 mars a ravivé le spectre de la « grève générale », un slogan que nous avons régulièrement entendu dans les dernières manifestations et que les organisations de gauche et de l’extrême-gauche du capital ne se lassent pas de propager. Or, le mythe du « grand soir », véhiculé longtemps par le syndicalisme révolutionnaire, contenant l’idée naïve que la société peut-être transformée du jour au lendemain par un arrêt total de la production capitaliste par les exploités ne résiste pas à l’épreuve de l’histoire et surtout véhicule une conception totalement déformée de la dynamique de la lutte révolutionnaire de la classe ouvrière. Le phénomène de grève de masse au contraire, analysé par Rosa Luxembourg dans la brochure Grève de masse, partis et syndicats, après la révolution en Russie en 1905, demeure la forme de lutte caractéristique de la période de décadence du capitalisme. Il s’agit là d’une leçon fondamentale. Elle seule permet d’ouvrir la voie vers la révolution prolétarienne. Nous invitons nos lecteurs à consulter les deux articles ci-dessous qui traitent largement des caractéristiques historiques de la grève de masse en démontrant ce faisant la stérilité et l’impasse de la vision de la « grève générale ».
- « La grève de masse », [143]Révolution internationale [143] n°81, (janvier 1981) [143].
- « Notes sur la grève de masse », [142]Revue internationale [142] n°27, (4 [142]e [142] semestre 1981) [142].
Situations territoriales:
Récent et en cours:
- Grève de masse [536]
- grève générale [537]
Rubrique:
Seule la révolution communiste peut mettre fin à l’oppression des femmes
- 116 lectures
Depuis plusieurs semaines, les médias braquent les projecteurs sur les conséquences de la réforme des retraites sur les conditions de vie et de travail des femmes. Les syndicats ont donc profité de la journée de la femme, le 8 mars, pour dénaturer une nouvelle fois cette journée puisant ses origines dans l’histoire du mouvement ouvrier, en la transformant en une gigantesque mascarade démocratique et réformiste. Il n’est pas nécessaire d’une énième réforme des retraites pour prendre la mesure du sort particulièrement ignoble que le capitalisme réserve aux femmes et ce depuis la période primitive de ce mode de production. Ce faisant, les femmes exploitées, comme leurs frères de classe, n’ont absolument rien à gagner dans cette société. Par conséquent, l’appel des syndicats à lutter le 8 mars pour les droits des femmes n’est qu’un leurre visant qu’à diviser le mouvement en cours que mène conjointement l’ensemble de la classe ouvrière en France : hommes et femmes, jeunes et vieux, salariés du secteur public comme du privé…
Comme le développe l’article ci-dessous déjà paru dans notre presse, l’abolition de l’oppression féminine fait partie intégrante de la lutte historique de la classe ouvrière pour l’avènement du communisme.
- « Journée internationale des femmes : seule la société communiste peut mettre fin à l’oppression des femmes [538] ».
Récent et en cours:
- feminisme [353]
Rubrique:
Lutte de classe dans le monde
- 389 lectures
Depuis plusieurs mois, les luttes se multiplient dans de nombreux pays du monde. En Angleterre, en France, au Mexique, en Espagne, en Chine et ailleurs, la classe ouvrière réagit face à l’aggravation de la crise économique et aux attaques de la bourgeoisie.
Comme nos lecteurs ont pu le constater, le CCI intervient régulièrement par voie de presse pour mettre en évidence le retour de la combativité ouvrière à l’échelle internationale. Ce dossier compile l’ensemble des articles, des tracts ou d’anciens articles faisant écho à la situation actuelle, publiés récemment sur notre site.
– Bilan du mouvement contre la réforme des retraites : la lutte est devant nous ! (TRACT) [539]
– Royaume-Uni, France, Allemagne, Espagne, Mexique, Chine… Aller plus loin qu’en 1968 ! (TRACT) [540]
– Face à la crise et à l’austérité... La classe ouvrière relève la tête partout dans le monde ! [541]
– En France comme ailleurs… Une même lutte ! Un même combat de classe ! [542]
– La bourgeoisie fait feu de tout bois pour pourrir la lutte ! [543]
– “Dialogue social” et “démocratie” contre la conscience de classe [544]
– 11e manifestation contre la réforme des retraites : comment avons-nous gagné en 2006 ? (TRACT) [545]
– Comment cerner la dynamique générale du combat prolétarien ? [546]
– Les violences aveugles et minoritaires des Black-blocs n’ont rien à voir avec la lutte de classe [548]
– NUPES, Révolution Permanente, Lutte Ouvrière… Les grandes manœuvres pour saboter la lutte ouvrière ! [549]
– Grèves, manifestations, 49-3... Et maintenant ? [550](TRACT) [547]
– La grève de masse contre le mythe de la grève générale [551]
– La combativité et la solidarité des prolétaires s’expriment aussi en Grèce [552]
– Seule la révolution communiste peut mettre fin à l’oppression des femmes [553]
– La grève de masse contre le mythe de la grève générale [551]
– Partout la même question: Comment développer la lutte? Comment faire reculer les gouvernements ? [554](TRACT) [547]
– Nous ne sommes pas seuls à nous mobiliser... Il y a des luttes ouvrières dans de nombreux pays ! [555](TRACT) [547]
– The Spectator et les "gaulois réfractaires" [556]
– Être nombreux ne suffit pas, il faut aussi prendre nos luttes en mains [557](TRACT) [547]
– Comment développer un mouvement massif, uni et solidaire ? [558](TRACT) [547]
– Grèves au Royaume-Uni: Le retour de la combativité du prolétariat mondial [559]
– Peut-on faire reculer la bourgeoisie en b [561]loquant l’économie ? [561]
– Lutte Ouvrière et Révolution Permanente, deux artisans du sabotage des luttes ! [562]
Récent et en cours:
Rubrique:
Grèves, manifestations, 49-3... Et maintenant?
| Fichier attaché | Taille |
|---|---|
| 237.99 Ko |
- 295 lectures
« Ce n’est pas un 49.3 qui va nous faire plier ! »
Face à l’annonce de l’adoption immédiate de la réforme des retraites, la réaction a été fulgurante. Partout en France, la colère a explosé. Dans les centres-villes, travailleurs, retraités, chômeurs, jeunes futurs salariés, nous nous sommes rassemblés par milliers pour crier notre refus d’être exploités jusqu’à 64 ans, dans des conditions de travail insupportables, et pour finir avec une pension de misère. « Éruption », « rage », « embrasement », tels sont les mots de la presse étrangère. Les images de la foule grossissant heure après heure sur la place de la Concorde à Paris ont fait le tour du monde.
Le message est clair :
– Nous n’accepterons plus tous les sacrifices !
– Nous ne courberons plus l’échine sous les ordres de la bourgeoisie !
– Nous sommes en train de retrouver le chemin de la lutte !
– Nous sommes la classe ouvrière !
Le développement de nos luttes inquiète la bourgeoisie
Depuis le début, certaines personnalités politiques, de Hollande à Bayrou, ont mis en garde Macron sur le « timing » de la réforme : « ce n’est pas le bon moment », « il y a des risques de fracture sociale ». Et ils avaient raison !
Cette attaque a provoqué un mouvement social d’une ampleur inconnue depuis des décennies. Les grèves se multiplient et, surtout, les manifestations nous rassemblent par millions dans les rues. Grâce à cette lutte, nous commençons à comprendre qui est ce « Nous » ! Une force sociale, internationale, qui produit tout et doit lutter de manière unie et solidaire : la classe ouvrière ! « Soit on lutte ensemble, soit on finira par dormir dans la rue ! » C’est ce qui s’est clairement exprimé, jeudi dernier, dans la manifestation en soutien aux éboueurs d’Ivry que la police venait déloger : ensemble, nous sommes plus forts !
Et ces réflexes de solidarité ne surgissent pas qu’en France. Dans de nombreux pays, les grèves et mouvements sociaux se multiplient. Au Royaume-Uni face à l’inflation, en Espagne face à l’effondrement du système de santé, en Corée du Sud face à l’allongement de la durée de travail… partout, la classe ouvrière se défend par la lutte.
En Grèce, un accident de train a eu lieu il y a trois semaines : 57 morts. La bourgeoisie a évidemment voulu faire porter le chapeau à un travailleur. L’aiguilleur de service a été jeté en prison. Mais la classe ouvrière a immédiatement compris l’arnaque. Par milliers, des manifestants ont pris la rue pour dénoncer la vraie cause de cet accident meurtrier : le manque de personnel et l’absence de moyens. Depuis, la colère ne désenfle pas. Au contraire, la lutte s’amplifie et s’élargit : aux cris de « contre les bas salaires ! », « ras le bol ! ». Ou encore : « nous ne pouvons plus travailler comme des personnes décentes depuis la crise, mais au moins ne nous tuez pas ! ».
Notre mouvement contre la réforme des retraites est en train de participer à ce développement de la combativité et de la réflexion de notre classe au niveau mondial. Notre mouvement montre que nous sommes capables de lutter massivement et de faire trembler la bourgeoisie. Déjà, tous les spécialistes et docteurs en politique annoncent qu’il va être très compliqué pour Macron de faire passer de nouvelles réformes et attaques d’ampleur d’ici la fin de son quinquennat.
La bourgeoisie est consciente de ce problème. Elle est donc en train de nous tendre des pièges, de nous détourner des méthodes de lutte qui nous cimentent et nous rendent forts, d’essayer de nous envoyer dans des impasses.
Plus de démocratie ?
Depuis l’annonce du 49.3, les partis de gauche et les syndicats nous poussent à la défense de la « vie parlementaire » face aux manœuvres et au « déni de démocratie » de Macron.
Mais des décennies de « démocratie représentative » ont définitivement prouvé une chose : de droite comme de gauche, des plus modérés aux plus radicaux, une fois au pouvoir, ils mènent tous les mêmes attaques et renient tous leurs promesses. Pire, les appels à de nouvelles élections sont le plus sournois des pièges. Il n’a pas d’autre fonction que de couper le prolétariat de sa force collective. Les élections nous réduisent à l’état de « citoyens » atomisés face au rouleau compresseur de la propagande bourgeoise. L’isoloir porte bien son nom !
« Défendre le parlement », « espérer des élections »… ils cherchent à nous faire croire qu’un autre capitalisme est possible, un capitalisme plus humain, plus juste et même, pourquoi pas, plus écologique. Il suffirait qu’il soit bien gouverné. Mensonge ! Le capitalisme est un système d’exploitation aujourd’hui décadent qui entraîne peu à peu toute l’humanité vers toujours plus de misère et de guerre, de destruction et de chaos. Le seul programme de la bourgeoisie, quelle que soit sa couleur politique, quel que soit le masque qu’elle porte, c’est toujours plus d’exploitation !
La démocratie bourgeoise est le masque hypocrite de la dictature capitaliste !
Bloquer l’économie ?
Face à la « surdité » du gouvernement, l’idée grandit que le seul moyen de « se faire entendre », c’est de bloquer l’économie. C’est la compréhension croissante du rôle central de la classe ouvrière dans la société : par notre travail associé, nous produisons toutes les richesses. La grève des éboueurs de Paris le démontre de manière éclatante : sans leur activité, la ville devient invivable en quelques jours.
Mais la gauche et les syndicats dévoient cette idée dans une impasse. Ils poussent à des actions de blocage, chacun dans sa corporation, chacun sur son lieu de travail. Les grévistes se retrouvent ainsi isolés dans leur coin, séparés des autres travailleurs, privés de notre principale force : l’unité et la solidarité dans la lutte.
Au Royaume-Uni, cela fait presque dix mois que les grévistes sont ainsi réduits à l’impuissance malgré leur colère et leur détermination ; parce qu’ils sont divisés par « piquets », chacun à bloquer dans sa boîte. La défaite historique des mineurs anglais lors de la lutte de 1984-85 face à Thatcher était déjà le fruit de ce même piège : poussés par les syndicats, ils avaient voulu bloquer l’économie en provoquant une pénurie de charbon. Ils avaient tenu pendant plus d’un an et étaient sortis épuisés, laminés, démoralisés. Leur défaite avait été celle de toute la classe ouvrière britannique !
Tout casser ?
Une partie des manifestants commence même à se dire qu’il faut passer à des modes d’action plus durs : « je ne suis pas violente du tout, mais là, on sent bien qu’il faut faire quelque chose pour que le gouvernement réagisse ». L’exemple des gilets jaunes est de plus en plus mis en avant. Une certaine sympathie pour les saccages des black-blocs se répand.
Penser que l’État bourgeois et son immense appareil répressif (police, armée, services secrets, etc.) puisse être effrayé un tant soit peu par des poubelles en flammes et des vitrines cassées est illusoire. Ce ne sont que des piqûres de moustique sur la peau d’un éléphant. Par contre, toutes ces actions d’apparence « hyper-radicale » sont parfaitement exploitées par la bourgeoisie pour casser… la force collective du mouvement :
– En mettant en avant la moindre vitrine brisée, les médias effraient toute une partie des travailleurs qui voudraient rejoindre les manifestations.
– En provoquant systématiquement des incidents, les forces de l’ordre gazent, dispersent et empêchent ainsi toute possibilité de rassemblement et de discussion en fin de manifestation.
L’action violente minoritaire des casseurs est, en fait, exactement le contraire de ce qui fait vraiment la force de notre classe.
Notre force, c’est la solidarité, la massivité et la réflexion dans la lutte !
Ces derniers jours, les journaux ont indiqué la possibilité d’un « scénario à la CPE ». En 2006, le gouvernement avait été contraint de retirer son Contrat Première Embauche qui allait plonger la jeunesse dans une précarité encore plus grande. À l’époque, la bourgeoisie avait été effrayée par l’ampleur croissante de la contestation, qui commençait à dépasser le seul mouvement de la jeunesse, des étudiants précaires et des jeunes travailleurs, pour s’étendre à d’autres secteurs, avec des mots d’ordre unitaires et solidaires : « jeunes lardons, vieux croûtons, tous la même salade ! » lisait-on sur les pancartes.
Cette capacité à étendre le mouvement était le fruit des débats dans de véritables assemblées générales souveraines et ouvertes à tous. Ces AG étaient le poumon du mouvement et ont constamment cherché, non pas à s’enfermer dans les facs ou sur les lieux de travail dans un esprit de citadelle assiégée, pour les bloquer coûte que coûte, mais à étendre la lutte, avec des délégations massives vers les entreprises voisines. Voilà ce qui a fait reculer la bourgeoisie ! Voilà ce qui a fait la force de notre mouvement ! Voilà les leçons que nous devons nous réapproprier aujourd’hui !
La force de notre classe réside dans notre unité, notre conscience de classe, notre capacité à développer notre solidarité et donc à étendre le mouvement à tous les secteurs. C’est l’aiguillon qui doit guider nos luttes.
Dans la lutte, nous ne pouvons compter que sur nous-mêmes ! Ni sur les politiciens, ni sur les syndicats ! C’est la classe ouvrière et sa lutte qui portent une alternative, celle du renversement du capitalisme, celle de la révolution !
Aujourd’hui, il est encore difficile de nous rassembler en assemblées générales, de nous organiser nous-mêmes. C’est pourtant le seul chemin possible. Ces AG doivent être des lieux où nous décidons réellement de la conduite du mouvement, où nous nous sentons unis et confiants dans notre force collective, où nous pouvons adopter ensemble des revendications de plus en plus unificatrices et partir en délégations massives pour rencontrer nos frères et sœurs de classe dans les usines, les hôpitaux, les écoles, les commerces, les administrations les plus proches.
Aujourd’hui ou demain, les luttes vont se poursuivre, parce que le capitalisme s’enfonce dans la crise et parce que le prolétariat n’a pas d’autre choix. C’est la raison pour laquelle, partout dans le monde, les ouvriers entrent en lutte.
La bourgeoisie va poursuivre ses attaques : inflation, licenciements, précarité, pénurie… Face à cette dégradation des conditions de vie et de travail, la classe ouvrière internationale va reprendre de plus en plus massivement le chemin de la lutte.
Alors, partout où nous le pouvons, dans la rue, après et avant les manifestations, sur les piquets de grève, dans les cafés et sur les lieux de travail, nous devons nous réunir, débattre, tirer les leçons des luttes passées, pour développer nos luttes actuelles et préparer les combats à venir.
L’avenir appartient à la lutte de classe !
Courant Communiste International, 20 mars 2023
Situations territoriales:
Récent et en cours:
Rubrique:
L’autonomie de la classe ouvrière est une nécessité!
- 63 lectures
À travers cette nouvelle introduction à notre article ci-dessous relatif aux manifestations de rue qui ont eu lieu en Iran en réaction à la barbarie du régime et à leur répression par le pouvoir en place, nous voulons insister davantage sur le danger très important que celles-ci font courir à la classe ouvrière si elle venait à quitter le terrain de lutte de classe en se dissolvant dans un tel mouvement marqué par de fortes illusions démocratiques et toutes sortes de déclinaisons féministes. Cette mise en garde est bien sûr présente dans notre article, mais insuffisamment mise en relief car c’était le message premier que nous devions faire passer, vu que le danger est bien réel pour des fractions de la classe ouvrière en Iran – dont certaines sont par ailleurs impliquées dans des mobilisations sur le terrain de classe de lutte contre l’exploitation capitaliste - de céder aux sirènes de la gauche et de l’extrême gauche du capital appelant à se joindre au vaste mouvement de protestation démocratique de rue. Le titre de notre article, très général, n’est pas non plus au service de cette nécessaire mise en garde. Nous devions également, plus tôt que nous l’avons fait, fermer explicitement la porte à toute illusion selon laquelle, dans la période actuelle, la classe ouvrière en Iran serait déjà à même de constituer une force capable d’ébranler la domination capitaliste en Iran, contrairement à ce que laissent entendre des appels démagogiques « au pouvoir des soviets » émanant de l’extrême gauche du capital. (février 2023)
Les vastes manifestations en Iran ont été déclenchées par le meurtre en détention d’une jeune femme arrêtée pour « port incorrect du hijab » par la police des mœurs du régime, mais elles témoignent d’un mécontentement beaucoup plus profond au sein de la population iranienne, des centaines de milliers de personnes ayant afflué dans les rues et affronté la police. Au-delà d’un écœurement généralisé face à l’oppression ouverte et légale des femmes par la République islamique, elles sont une réaction à l’inflation galopante et aux pénuries exacerbées par les sanctions imposées par l’Occident à l’encontre de l’Iran et fortement aggravées par le lourd et ancien poids d’une économie de guerre gonflée par la poursuite incessante des ambitions impérialistes de l’Iran. Elles sont également une réaction à la corruption sordide de l’élite dirigeante qui ne peut se maintenir que par une répression brutale de toutes les formes de protestation, y compris la résistance de la classe ouvrière à la stagnation des salaires et aux conditions de travail misérables. Le parlement iranien vient d’adopter de nouvelles lois sanctionnant les exécutions pour des crimes « politiques », et des centaines, voire des milliers de manifestants ont été tués ou blessés par la police de l’État et les grotesquement mal nommés « gardiens de la révolution ».
Ce recours à la répression directe est un signe de la faiblesse du régime des Mollahs, et non de sa force. Il est vrai que le résultat désastreux des interventions américaines au Moyen-Orient depuis 2001 a créé une brèche qui a permis à l’impérialisme iranien d’avancer ses pions en Irak, au Liban, au Yémen et en Syrie, mais les États-Unis et leurs alliés les plus fiables (la Grande-Bretagne en particulier) ont répondu en alimentant l’armée saoudienne dans la guerre du Yémen et en imposant des sanctions paralysantes à l’Iran sous prétexte de s’opposer à sa politique de développement des armes nucléaires. Le régime se retrouve de plus en plus isolé, et le fait qu’il fournisse des drones à la Russie pour attaquer les infrastructures et les civils en Ukraine ne fera que renforcer les voix occidentales qui demandent que l’Iran soit traité, aux côtés de la Russie, comme un État paria. Les relations de l’Iran avec la Chine sont une autre raison pour laquelle les puissances occidentales veulent le voir affaibli encore plus qu’il ne l’est déjà. Parallèlement, nous assistons à un effort concerté des gouvernements des États-Unis et d’Europe occidentale pour instrumentaliser les manifestations, notamment en s’emparant du slogan le plus connu des protestations, « Femmes, Vie, Liberté » :
« Le 25 septembre 2022, le journal français Libération ornait sa première page du slogan “Femmes, Vie, Liberté” en perse et en français accompagné d’une photo de la manifestation. Lors d’un discours sur la répression des manifestants en Iran, une membre du Parlement de l’Union Européenne a coupé ses cheveux en prononçant les mots “Femmes, Vie, Liberté” dans l’enceinte même du Parlement de l’Union Européenne ». (1) De nombreux autres exemples pourraient être énoncés.
Quel genre de révolution est à l’ordre du jour en Iran ?
Compte tenu de la faiblesse du régime, on parle beaucoup d’une nouvelle « révolution » en Iran, notamment de la part des gauchistes et des anarchistes de tous bords, ces derniers parlant d’une « insurrection féministe », tandis que les factions bourgeoises les plus traditionnelles évoquent un renversement « démocratique », avec l’installation d’un nouveau régime qui abandonnerait son hostilité envers les États-Unis et leurs alliés. Mais comme nous l’avions écrit en réponse à la mystification sur la « révolution » de 1978-1979 : « les événements en Iran font apparaître que la seule révolution qui soit à l’ordre du jour, dans les pays arriérés, comme partout ailleurs dans le monde aujourd’hui, est la révolution prolétarienne ». (2)
Contrairement à la révolution de 1917 en Russie, qui se voulait un élément de la révolution mondiale, les protestations actuelles en Iran ne sont pas menées par une classe ouvrière autonome, organisée par ses propres organes unitaires et capable d’offrir une perspective à toutes les couches et catégories opprimées de la société. Il est vrai qu’en 1978-1979, nous avons eu des aperçus du potentiel de la classe ouvrière à offrir une telle perspective : « Venant à la suite des luttes ouvrières dans divers pays d’Amérique Latine, en Tunisie, en Égypte, etc., les grèves des ouvriers iraniens ont constitué l’élément politique majeur qui a conduit au renversement du régime du Shah. Alors que le mouvement “populaire” regroupant la presque totalité des couches de la société iranienne tendait, malgré ses mobilisations de masse, à s’épuiser, l’entrée dans la lutte du prolétariat d’Iran à partir d’octobre 1978, notamment dans le secteur pétrolier, non seulement relançait l’agitation mais allait poser au capital national de ce pays un problème pratiquement insoluble ». (3)
Pourtant, nous savons que même à cette époque, la classe ouvrière n’était pas assez forte politiquement pour empêcher le détournement du mécontentement de masse par les Mollahs, soutenus par une foule de gauchistes « anti-impérialistes ». La lutte de classe internationale, bien qu’entrant dans une deuxième vague de mouvements ouvriers depuis Mai 68 en France, n’était pas à même de poser la perspective d’une révolution prolétarienne à l’échelle mondiale, et les ouvriers en Iran (comme ceux de Pologne un an plus tard) n’étaient pas en mesure de poser l’alternative révolutionnaire par eux-mêmes. Ainsi, la question de savoir comment entrer en relation avec les autres couches opprimées est restée sans réponse. Comme le disait encore notre déclaration : « La place décisive occupée par le prolétariat dans les événements en Iran pose un problème essentiel que celui-ci devra résoudre pour mener à bien la révolution communiste : celui de ses rapports avec l’ensemble des autres couches non-exploiteuses de la société et notamment les sans-travail. Ce que démontrent ces événements, c’est que :
– ces couches, par elles-mêmes, et malgré leur nombre, ne constituent pas une force réelle dans la société ;
– bien plus que le prolétariat, elles sont perméables aux différentes formes de mystification et d’encadrement capitalistes, y compris les plus archaïques comme la religion ;
– en même temps, dans la mesure, où la crise les frappe avec autant ou plus de violence qu’elle frappe la classe ouvrière, elles constituent une force d’appoint dans la lutte contre le capitalisme dont la classe ouvrière peut et doit prendre la tête.
Face à toutes les tentatives de la bourgeoisie de défouler leur mécontentement dans des impasses, l’objectif du prolétariat est de mettre en évidence qu’aucune des “solutions” proposées par le capitalisme ne peut leur apporter une quelconque amélioration, et que c’est uniquement dans le sillage de la classe révolutionnaire qu’elles peuvent obtenir satisfaction pour leurs aspirations, non comme couches particulières, historiquement condamnées, mais comme membres de la société. Une telle politique suppose de la part du prolétariat son autonomie organisationnelle et politique, c’est-à-dire, en particulier, le rejet de toute politique “d’alliance” avec ces couches ».
Aujourd’hui, les mystifications qui mènent le mouvement populaire dans une impasse ne sont pas tant les mystifications religieuses, ce qui est compréhensible lorsque les masses peuvent facilement voir le visage nu et corrompu d’un État théocratique, que les idéologies bourgeoises plus « modernes » comme le féminisme, la liberté et la démocratie.
Mais le danger est encore plus grand de voir la classe ouvrière se dissoudre en tant que masse d’individus dans un mouvement interclassiste qui n’a pas la capacité de résister aux plans de récupération des factions bourgeoises rivales. Ceci est souligné par le contexte international de la lutte des classes, où la classe ouvrière commence à peine à se réveiller après une longue période de repli au cours de laquelle la décomposition progressive de la société capitaliste a de plus en plus rongé la conscience que le prolétariat avait de lui-même en tant que classe.
Le militantisme des ouvriers et les tromperies des gauchistes
Il ne s’agit pas de nier le fait que le prolétariat a, en Iran, une longue tradition de lutte militante. Les événements de 1978-1979 sont là pour le prouver ; en 2018-2019, il y a eu des luttes très étendues impliquant les ouvriers de la canne à sucre de Haft Tappeh, les camionneurs, les enseignants et d’autres ; en 2020-2021, les travailleurs du pétrole ont entamé une série de grèves militantes à l’échelle nationale. À leur apogée, ces mouvements ont donné des signes clairs de solidarité entre divers secteurs confrontés à la répression de l’État et à de puissantes pressions pour que les travailleurs reprennent le travail. En outre, face à la nature ouvertement pro-régime des syndicats officiels, il y a également eu des signes importants d’auto-organisation des travailleurs dans beaucoup de ces luttes, comme nous l’avons vu avec les comités de grève en 1978-1979, les assemblées et les comités de grève à Haft Tappeh et plus récemment dans les zones pétrolières. Il ne fait également aucun doute que les ouvriers discutent de ce qu’il convient de faire face aux manifestations actuelles et que des appels à la grève ont été lancés pour protester contre la répression de l’État. Et nous avons vu, par exemple en Mai 68, que l’indignation contre la répression de l’État, même si elle n’est pas initialement dirigée contre les travailleurs, peut être une sorte de catalyseur pour que ces derniers entrent sur la scène sociale, à condition qu’ils le fassent sur leur propre terrain de classe et en utilisant leurs propres méthodes de lutte. Mais pour le moment, ces réflexions de classe, cette colère contre la brutalité du régime, semblent être sous le contrôle des organes syndicaux de base et des gauchistes, qui tentent de créer un faux lien entre la classe ouvrière et les protestations populaires, en ajoutant des revendications « révolutionnaires » aux slogans de ces dernières.
Comme l’écrit Internationalist Voice : « La phrase “femme, vie, liberté” est enracinée dans le mouvement national et n’a pas de connotation de classe. C’est pourquoi ce slogan est brandi de l’extrême droite à l’extrême gauche, et ses échos se font entendre dans les parlements bourgeois. Ses composantes ne sont pas des concepts abstraits, mais une caractéristique des relations de production capitalistes. Un tel slogan fait des femmes qui travaillent l’armée noire du mouvement démocratique. Cette question devient un problème pour la gauche du capital, qui emploie le terme radical de “révolution”, et suggère donc que ce slogan soit “conservé” en y ajoutant des extensions. Ils ont fait les suggestions suivantes :
– Femme, vie, liberté, administration municipale (trotskistes) ;
– Femme, vie, liberté, socialisme ;
– Femme, vie, liberté, gouvernement ouvrier ».(4)
Cet appel au conseil ou au pouvoir des soviets circule en Iran au moins depuis 2018. Même s’il trouve son origine dans les efforts réels mais embryonnaires d’auto-organisation à Haft Tappeh et ailleurs, il est toujours dangereux de confondre l’embryon avec sa forme achevée. Comme Bordiga l’a expliqué dans sa polémique avec Gramsci lors des occupations d’usines en Italie en 1920, les conseils ouvriers ou soviets représentent une étape importante, au-delà des organes défensifs comme les comités de grève ou les conseils d’usine, car ils sont l’expression d’un mouvement vers une lutte unifiée, politique et offensive de la classe ouvrière. Les gauchistes qui prétendent que c’est aujourd’hui à l’ordre du jour trompent les travailleurs, avec pour objectif de mobiliser leurs forces dans une lutte pour une forme « de gauche » de gouvernement bourgeois, ornée « d’en bas » par de faux conseils ouvriers.
Les tâches de la gauche communiste
Internationalist Voice poursuit ainsi : « Contrairement à ceux de la gauche du capital, la tâche des communistes et des révolutionnaires n’est pas de sauver les slogans anti-dictature, mais d’assurer la transparence quant à leur origine et leur contenu. Encore une fois, en opposition aux démagogues de la gauche du capital, se distancer de tels slogans et élever les revendications de classe du prolétariat est un pas dans la direction de la clarification de la lutte de classe ».
Cela est vrai même si cela signifie que les révolutionnaires doivent nager à contre-courant pendant les moments d’euphorie « populaire ». Malheureusement, tous les groupes de la gauche communiste ne semblent pas être à l’abri de certaines des tromperies les plus radicales injectées dans les manifestations. Nous pouvons ici identifier deux exemples inquiétants dans la presse de la Tendance communiste internationaliste (TCI). Ainsi, dans l’article « Voix ouvrières et révoltes en Iran », (5) la TCI publie des déclarations sur les protestations par le Syndicat des Travailleurs de la Canne à Sucre Haft Tappeh, du Conseil pour l’organisation des protestations des travailleurs contractuels du pétrole et du Conseil de coordination des organisations syndicales des enseignants iraniens. Sans doute ces déclarations sont-elles une réponse à une authentique discussion sur les lieux de travail quant à la manière de réagir aux mouvements de protestation, mais le premier et le troisième de ces organismes ne se cachent pas d’être des syndicats (même s’ils peuvent tirer leurs origines d’authentiques organes de classe, en devenant des structures permanentes, ils ne peuvent qu’avoir assumé une fonction syndicale) et ne peuvent donc pas jouer un rôle indépendant de la gauche du capital qui, comme nous l’avons dit, ne défend pas l’autonomie réelle de la classe mais cherche à utiliser le potentiel des ouvriers comme outil de « changement de régime ».
Parallèlement à cela, la TCI ne parvient pas non plus à se distinguer de la rhétorique gauchiste sur le pouvoir des soviets en Iran. Ainsi, l’article « Iran : Imperialist Rivalries and the Protest Movement of “Woman, Life, Freedom” », (6) tout en fournissant des éléments importants concernant les tentatives de récupération des manifestations par les puissances impérialistes extérieures à l’Iran, annonce : « Dans notre prochain article, nous plaiderons pour une autre alternative : du pain, des emplois, la liberté, le pouvoir aux Soviets. Nous traiterons de la lutte des travailleurs et des tâches des communistes, et à la lumière de cela, nous exposerons la perspective internationaliste ».
Mais nous ne sommes pas à Petrograd en 1917, et appeler au pouvoir des soviets alors que la classe ouvrière est confrontée à la nécessité de défendre ses intérêts les plus fondamentaux face au danger de se dissoudre dans les manifestations de masse, de défendre toute forme naissante d’auto-organisation contre leur récupération par les gauchistes et les syndicalistes de base, c’est au mieux se tromper gravement sur le niveau actuel de la lutte de classe et au pire attirer les ouvriers dans des mobilisations sur le terrain de la gauche du capital. La gauche communiste ne développera pas sa capacité à élaborer une véritable intervention dans la classe en se laissant prendre au piège de l’immédiatisme au détriment des principes fondamentaux et d’une analyse claire du rapport de force entre les classes.
Un article récent dans Internationalist Voice souligne qu’il y a actuellement un certain nombre de grèves ouvrières qui ont lieu en Iran en même temps que les manifestations dans les rues : « Ces derniers jours, nous avons assisté à des manifestations et à des grèves de travailleurs, dont la caractéristique commune était la protestation contre le faible niveau de leurs salaires et la défense de leur niveau de vie. Le slogan des ouvriers grévistes de l’entreprise sidérurgique d’Ispahan, “assez de promesses, notre table est vide”, reflète les conditions de vie difficiles de l’ensemble de la classe ouvrière. Voici quelques exemples de grèves ouvrières de ces derniers jours qui avaient ou ont la même revendication : Grève des travailleurs de la compagnie sidérurgique d’Ispahan ; grève de la faim des employés officiels des sociétés de raffinage et de distribution de pétrole, de gaz et de produits pétrochimiques ; grève des travailleurs du complexe du centre-ville d’Ispahan ; grève des travailleurs de la cimenterie d’Abadeh dans la province d’Ispahan ; grève des travailleurs de l’eau minérale de Damash dans la province de Gilan ; grève des travailleurs de la compagnie Pars Mino ; grève des travailleurs de la compagnie industrielle Cruise ; protestation des travailleurs du groupe sidérurgique national ». (7)
Il semble que ces mouvements soient encore relativement dispersés et si les démocrates et les gauchistes multiplient les appels à la « grève générale », ce qu’ils entendent par là n’a rien à voir avec une réelle dynamique vers la grève de masse, mais serait une mobilisation contrôlée d’en haut par l’opposition bourgeoise et mélangée aux grèves des petits commerçants et d’autres couches non prolétariennes. Cela ne fait que souligner la nécessité pour les ouvriers de rester sur leur propre terrain et de développer leur unité de classe comme base minimale pour bloquer la répression meurtrière du régime islamique.
Amos, novembre 2022
1« The continuation of the protests, labour strikes and general strike [510] », Internationalist Voice (20 novembre 2022).
2« Iran : leçons des événements », Révolution internationale n° 59 [511] (17 février 1979).
3Ibid.
4« The continuation of the protests, labour strikes and general strike [510] », Internationalist Voice (20 novembre 2022).
5« Voix ouvrières et révoltes en Iran [512] » sur le site de la TCI (1er novembre 2022).
6« Iran : Imperialist Rivalries and the Protest Movement of 'Woman, Life, Freedom [513]'" sur le site de la TCI (2 novembre 022).
7« The continuation of the protests, labour strikes and general strike [510] », Internationalist Voice (20 novembre 2022).
Géographique:
- Iran [565]
Rubrique:
NUPES, Révolution Permanente, Lutte Ouvrière… Les grandes manœuvres pour saboter la lutte ouvrière!
- 240 lectures
Dans le mouvement social contre la réforme des retraites en France, les partis de gauche radicale, comme La France Insoumise et ceux d’extrême-gauche n’ont pas de mots assez forts pour appeler à ne rien lâcher et à poursuivre la mobilisation. Appel à la lutte parlementaire et démocratique pour les uns, à la grève générale pour les autres, en passant par le rejet des directions syndicales et la prise en main du mouvement par « la base », tous ces partis, conspués par de nombreux grands médias, paraissent ainsi défendre avec force la classe ouvrière, combattre becs et ongles pour les intérêts des exploités. Mais la lutte du prolétariat peut-elle réellement s’appuyer sur eux ?
Le mythe de la lutte parlementaire
La France Insoumise (LFI) de Mélenchon, force vive de la NUPES, profite du mouvement contre la réforme des retraites pour recrédibiliser au maximum le terrain de la lutte démocratique et citoyenne, en dénonçant un gouvernement qui a « réduit le temps du débat parlementaire et malmène le travail des représentants du peuple ». LFI se présente au Parlement comme le porte-parole de la colère qui s’exprime dans la rue.
Mais que peut-on sérieusement attendre du « débat parlementaire » ? Rien ! Le Parlement n’est qu’une coquille vide. Parce que le capitalisme est en déclin, la classe ouvrière ne peut plus améliorer ses conditions de travail par la « lutte pour les réformes », ni appuyer une fraction progressiste de la bourgeoisie comme c’était le cas au XIXe siècle. Les cris d’orfraie des députés LFI ne sont que de la poudre aux yeux, une mystification destinée à faire croire que l’État bourgeois pourrait défendre d’autres intérêts que ceux de la bourgeoisie. (1)
La réalité, c’est que LFI et ses alliés (PS, EELV…) ne défendent pas les intérêts de la classe ouvrière, ils en sont même les ennemis acharnés. Alors que la massivité de la mobilisation contre la réforme des retraites est une expression de la reprise historique de la combativité du prolétariat à l’échelle internationale, alors que des millions d’ouvriers luttent de part le monde contre l’inflation, la misère croissante et l’austérité, les appels répétés des « insoumis » à la mobilisation du « peuple de France » pour la défense des « plus pauvres » n’a pas d’autre vocation que d’enfermer la mobilisation dans les frontières de l’Hexagone et de la « démocratie » nationale.
En somme, LFI participe activement à couper toute réflexion sur le caractère international de la lutte ouvrière. Il s’agit ni plus ni moins de couper la classe ouvrière en France de ses frères de classe en Angleterre, en Espagne, en Belgique pour mieux les réduire à l’impuissance, à ne pas se comporter comme classe en lutte, mais en bons citoyens accomplissant leur « devoir électoral ».
Il n’y a qu’à voir la pantomime orchestrée par les députés NUPES entonnant La Marseillaise (2) et criant au « tournant autoritaire » de Macron pour mieux se présenter comme les défenseurs de la démocratie républicaine, ce régime politique à travers lequel la bourgeoisie impose, de la façon la plus sournoise qui soit, sa dictature sur la société. Après l’échec de la motion de censure contre le gouvernement, les députés NUPES se sont donc empressés d’appeler au « retour aux urnes » pour détourner la mobilisation vers le chemin électoral au détriment de la lutte sociale !
L’extrême-gauche entretient aussi la mystification « démocratique »
Le 8 février dernier, le leader du syndicat « modéré » et « réformiste », Laurent Berger, exposait en ces termes ce qui, selon lui, formait l’enjeu de la situation : « Si le gouvernement persiste dans la voie qui est la sienne aujourd’hui, il fait une faute démocratique qu’il paiera très cher. “Qu’il paiera très cher”, ça ne s’appelle pas une menace, ça s’appelle un avertissement collectif que je pose […]. Bien sûr qu’il y a un risque que ça dégénère ». Cette mise en garde adressée au gouvernement traduisait la vigilance et l’attention que tous les syndicats portent à l’intensité de la combativité et à la réflexion qui tend à se développer dans les rangs de la classe ouvrière.
Et ils ne sont pas les seuls. Comme à leur habitude, toutes les organisations de l’extrême-gauche du capital se sont mises au diapason. En témoignent leurs discours très radicaux, aussi bien sur le fond que sur la forme, tentant de dévoyer ou de détourner tout embryon de réflexion sur la manière d’accentuer le rapport de force.
Si les différentes journées de mobilisations ont confirmé l’aptitude des syndicats à bien encadrer les manifestations, nous avons pu constater que les premières parties de cortèges, hors bataillons syndicaux, demeuraient très denses. De même, les appels syndicaux aux grèves reconductibles dans les transports ou les raffineries, c’est-à-dire à des grèves hyper sectorielles, chacun enfermé dans son entreprise, n’ont pas vraiment fonctionné pour le moment. Ce qui démontre une certaine forme d’indifférence, voire peut-être de méfiance vis-à-vis de certaines méthodes de luttes syndicales dans une partie de la classe ouvrière. D’où le déploiement d’un large éventail de mots d’ordre de la part des différentes organisations gauchistes visant à proposer de prétendues alternatives « au programme défensif », « aux erreurs et au conservatisme des dirigeants du mouvement ». (3) Pour le groupe trotskiste Combattre Pour le Socialisme, la pression sur le parlement bourgeois est la clé de la victoire. Les semaines précédentes il appelait à se mobiliser « par centaines de milliers devant le Palais Bourbon, au moment de la discussion de la loi ». Il persiste et signe après l’adoption du 49.3 en exhortant à se mobiliser face à l’Assemblée : « C’est là que se joue l’avenir de nos retraites, c’est là qu’il faut aller pour faire plier le gouvernement ! »
Ici, il s’agit de critiquer hypocritement l’inutilité criante des journées d’action syndicales pour mieux distiller l’illusion de la victoire par la pression démocratique sur l’État ! La mobilisation devrait s’exporter devant un emblème de l’État démocratique bourgeois. En somme, cette mauvaise boutique appâte le chaland avec la lutte de classe pour mieux vendre sa camelote frelatée : la mobilisation citoyenne.
De son côté, le NPA clame haut et fort qu’ « il n’y a rien à attendre du Parlement : c’est les travailleurs qui font grève et qui manifestent par millions dans la rue en donnant des sueurs froides au patronat et aux macronistes ». Mais ne soyons pas naïfs ! Si aujourd’hui, la massivité du mouvement et la réflexion sur une alternative au capitalisme exprimée par des minorités au sein de la classe ouvrière ne lui laisse pas d’autre choix que d’appeler à « être plus que jamais en grève et dans la rue ! », cela ne signifie pas qu’il abandonne pour autant sa sale besogne consistant à rabattre les ouvriers les plus combatifs vers le terrain stérile et mystificateur des élections. (4) L’adoption du 49.3 lui permet notamment de préparer le terrain. C’est un « scandale démocratique » montrant « le caractère particulièrement antidémocratique des institutions de la Ve République » clame le parti de Besancenot. En bon garant de l’ordre capitaliste, contrairement à son appellation, le NPA se contente donc de sous-entendre qu’une alternative (une VIe République ?) au sein de l’État bourgeois est tout à fait possible !
En réalité, dès que l’occasion se présentera, les têtes de gondoles du NPA, de LO et compagnie nous resserviront le plat indigeste des élections (y compris parlementaires) comme « tribune » à la cause révolutionnaire.
L’extrême-gauche rabat les ouvriers vers le piège syndical
« Contre Macron et son monde, à partir des 7 et 8 mars, bloquer le pays, partout et en même temps ! » (NPA). « Le 7 mars, la jeunesse du côté des travailleurs pour bloquer le pays ! » (Jeunesses communistes). « Construisons la grève reconductible ! » (Révolution Permanente)… Depuis le début du mouvement, les manifestations rassemblent des millions de personnes. Mais le sentiment que ces mobilisations massives ne suffiraient pas à faire plier le gouvernement a connu un écho de plus en plus fort au sein de la classe ouvrière. Par crainte d’être débordé, que la lutte n’échappe à leur contrôle, les syndicats ont adopté des méthodes de lutte prétendument plus radicales. D’où l’appel de l’intersyndicale à mettre « la France à l’arrêt ». Comme à leur habitude, les organisations gauchistes ont sauté sur l’occasion pour jouer leur rôle de rabatteurs, avec toujours la même méthode sournoise : feindre de fustiger les directions syndicales en exhortant « la base » à entrer en action.
Au cours de sa longue histoire, Lutte Ouvrière est passée maître dans ce type de basse besogne et ne semble pas avoir perdu la main : « Aussi unitaires soient-ils, les appels des centrales syndicales ne sont rien si les travailleurs n’en font pas leur combat. Alors, dès mardi, profitons-en pour constituer des équipes de travailleurs combatifs capables d’entraîner les autres ! Profitons de cette journée pour discuter entre nous, nous réunir en assemblées générales, formuler nos revendications, qui vont bien au-delà des retraites et préparer la suite ! ». Sous un verbiage radical et surtout très ambigu, LO appelle ainsi les ouvriers à prendre eux-mêmes en main… l’unité syndicale.
Nouveau venu dans le paysage de l’extrême-gauche, Révolution permanente semble apprendre vite. Elle aussi déplore la tiédeur de l’intersyndicale à poursuivre le blocage de l’économie après la journée du 7, et appelle à la prise en main par « la base » : « Pour mettre la “France à l’arrêt”, elle doit généraliser la perspective de la reconductible […]. Il y a urgence à nous doter d’un plan de bataille alliant élargissement des revendications et auto-organisation à la base pour imposer cette orientation ».
Mais les spectres du « syndicalisme de base » ou même des coordinations, agités comme la voie royale vers l’auto-organisation de la classe ouvrière dans la lutte, n’expriment en rien un appel à rejeter les syndicats et le syndicalisme. Au contraire ! Ils visent ni plus ni moins qu’à les y enchaîner en faisant la publicité de leurs variantes plus « radicales » du même piège enserrant les prolétaires dans leur corporation, leur secteur, leur catégorie (jeunes, femmes…).
Les gauchistes torpillent la réflexion politique
D’ailleurs, LO et ses comparses, veillent à bien établir un « cordon sanitaire » étanche autour de jeunes ouvriers susceptibles de se politiser. Lors de la manifestation du 31 janvier, à Lyon, un tract de LO est distribué : « Le capitalisme détruit la société. Il faut le renverser ! REUNION JEUNES (lycéens, étudiants, jeunes travailleurs) ». Alors que des militants du CCI demandent un de ces tracts où est écrit « Viens rencontrer des militants communistes et révolutionnaires », il leur est carrément refusé dans un premier temps parce qu’ils ne sont plus des « jeunes », et qu’une telle réunion doit permettre à des jeunes de pouvoir s’exprimer sans « la pression de plus anciens » qui, eux, n’ont pas peur de parler (sic !). Il s’agit d’un véritable travail de sape magistral, contre la réflexion, la solidarité et l’unité inter-générationnelle.
Cette pratique de division des luttes et de torpillage de la réflexion n’est pas nouvelle. En 1986, lors de la grève à la SNCF, des coordinations avaient surgi dans la lutte, sur la base de critiques ouvertes aux syndicats. Lutte Ouvrière, d’une manière très radicale, avait su prendre le relais, avec son leader cheminot Daniel Vitry, en interdisant, par exemple, l’entrée des Assemblées générales à d’autres ouvriers venant de la Poste ou des impôts, souhaitant apporter leur solidarité et appeler à étendre la lutte à d’autres secteurs.
Les gauchistes toujours et à jamais dans le camp de la bourgeoisie
Tendance marxiste internationale, Révolution Permanente, Nouveau Parti Anti-capitaliste, Lutte Ouvrière… Derrière le masque fabriqué d’un vernis révolutionnaire et communiste, se cache le vrai visage de LO, du NPA et compagnie ! Si aujourd’hui toutes ces organisations adoptent un ton critique vis-à-vis des syndicats (qu’ils noyautent pour certains et contribuent à animer avec zèle), si, comme LO indiquant ces derniers jours que la seule guerre est « celle contre nos intérêts de travailleurs », elles parlent désormais plus volontiers de « lutte de classes », de « révolution » et même de communisme, ce n’est pas parce qu’elles ont changé de camp mais bien parce qu’elles se chargent du sale boulot que les forces classiques d’encadrement (syndicats et partis de gauche) ne sont pas totalement en mesure d’assumer.
Par conséquent, la classe ouvrière ne doit pas se faire d’illusions. Elle rencontrera de plus en plus la « gauche radicale » et les gauchistes sous les masques les plus variés, « combatifs », « radicaux », voire « révolutionnaires », comme obstacles majeurs au développement de ses luttes. Et si elle doit être plus consciente de cela, elle doit aussi savoir qu’elle ne pourra pas éviter l’obstacle mais bel et bien affronter tous ces faux-amis.
Vincent / Stopio (20 mars 2023)
1Cf. « Les élections contre le prolétariat », Révolution internationale n° 10 (Juillet-août 1974). [566]
2Le chant des Versaillais qui ont massacré les Communards en 1871.
3Tendance internationale (TMI) qui publie Révolution !
Récent et en cours:
- LFI [473]
- Révolution Permanente [568]
- NUPES [569]
- Lutte Ouvrière [570]
Courants politiques:
- Trotskysme [468]
Rubrique:
Comment la classe développe son combat historique?
- 72 lectures
Comme je n’ai pas parlé, je tenais à remercier par écrit le CCI pour la tenue de la permanence. Les échanges étaient nourris, très intéressants et ont répondu à certaines de mes questions. Néanmoins, je souhaitais préciser mon interrogation initiale qui reste partiellement sans réponse.
Les grèves et autres mouvements sociaux qui émergent sur la scène internationale et sur un terrain de classe peuvent-ils se faire écho d’un pays à l’autre ? J’étais présente lors de la manifestation du 29 septembre à Paris et j’ai remarqué que beaucoup étaient intéressés par le tract [du CCI] justement parce qu’il était question des luttes au Royaume-Uni.
Si la lutte « au-delà de “sa” corporation, “son” entreprise, “son” secteur d’activité, de “sa” ville, “sa” région » est un discours de plus en plus audible (depuis le mouvement des retraites, les syndicats sont obligés d’appeler de plus en plus rapidement à l’extension factice des luttes), ce n’est pas le cas lorsqu’il s’agit de « soutien et de solidarité » […] au-delà de “son” pays », sauf lorsqu’il est question de mouvement sur un terrain qui n’est pas celui de la classe ouvrière comme les Gilets Jaunes ou Black Lives Matter par exemple.
Dès lors, comment peuvent se manifester ce soutien et cette solidarité de classe lorsqu’il faut traverser des frontières ?
Bien à vous,
C.
Nous saluons la préoccupation de la camarade de revenir sur une question qui n’a pas été suffisamment clarifiée pour elle lors de notre permanence en ligne. C’est une démarche importante d’aller au bout des questions, au bout des confusions ou divergences pour rechercher toujours la position ou la compréhension la plus juste. L’une des forces du prolétariat réside dans sa conscience, cette capacité à comprendre son identité, sa place dans la société et sa responsabilité historique. Cette conscience nécessite une recherche constante de la vérité pour se défaire des pièges idéologiques de la classe ennemie mais plus généralement de toutes les idéologies qui lui sont étrangères. Pour accéder à cette vérité, le prolétariat doit débattre sans cesse, confronter les positions les unes aux autres, les confronter à la réalité. Ce que fait la camarade en nous interrogeant ainsi relève de cette démarche fondamentale.
L’autre force du prolétariat, c’est son unité. Ces deux forces ne sont pas indépendantes l’une de l’autre, bien au contraire et c’est là que le lien peut se faire avec le questionnement de notre lectrice.
L’unité du prolétariat ne peut se faire que par une démarche consciente, c’est-à-dire par la capacité de la classe ouvrière à se concevoir comme une seule classe à travers le monde, par-dessus toutes les divisions que le capitalisme instaure artificiellement : nationale, corporatiste, raciale, religieuse (et les fausses unités qui vont avec : le peuple, la corporation, la communauté etc). Ces divisions sont lourdes à dépasser car elles trouvent un fondement dans le fonctionnement même de la société capitaliste qui repose sur la concurrence de chacun contre tous les autres, et construit des divisions pertinentes pour le capital dans ce cadre concurrentiel mais totalement aliénantes pour le prolétariat.
En particulier, les divisions nationales sont fortement structurantes pour le capital. La bourgeoisie ne peut se passer de l’adhésion de la classe ouvrière à son idéologie nationaliste, tant en termes de mobilisation pour le capital national que pour l’enrôler dans la guerre le moment venu. Cette idéologie nationaliste est d’autant plus un poison qu’elle s’oppose à la nécessaire compréhension par la classe ouvrière que la seule division réelle dans le capitalisme oppose les classes entre elles et rien d’autre.
Cette unité ne peut donc se décréter, elle s’inscrit au contraire dans un processus long et heurté, qui passe par l’affrontement aux idéologies étrangères au prolétariat : le nationalisme, le corporatisme, toutes les idéologies parcellaires s’attachant aux maux du capitalisme plus qu’à ses racines : féminisme, anti-racisme, etc.
Le prolétariat s’affronte à ces idéologies par le débat, la confrontation des idées et l’analyse de la réalité. Mais là aussi le processus de développement de la conscience de la classe ouvrière ne se décrète pas.
En effet, si l’unité du prolétariat passe par sa conscience, inversement la conscience du prolétariat se développera dans son unité. La première expression de cette unité, même embryonnaire et encore marquée par le nationalisme ou le corporatisme, c’est la lutte. Lorsque la classe ouvrière défend ses conditions de vie et de travail face aux attaques de la bourgeoisie, elle mène une première étape vers la reconnaissance de son identité et dans le même mouvement, vers son unité.
Bien sûr, cette dimension politique des luttes prolétariennes n’est pas toujours consciente. En particulier aujourd’hui, la classe ouvrière subit le poids de la décomposition du capitalisme et n’a pas encore les capacités à se défaire du piège syndical, principal véhicule de toutes les idéologies qui divisent. Mais le fait qu’elle entre en lutte est déjà une victoire, déjà un effort remarquable dans une société à ce point embourbée dans sa décomposition.
C’est par la lutte, et seulement par la lutte, que la classe ouvrière pourra vivre concrètement son identité de classe, comprendre que tous ceux qui luttent, luttent pour la même chose. Même si chacun travaille dans un secteur différent, vit dans un pays différent. Même si chacun ne se conçoit pas comme vivant les mêmes conditions que les autres. Par la lutte et la répétition des luttes, la classe ouvrière trouvera les conditions pour dépasser ses divisions et s’ancrer dans son unité. Plus les luttes se développeront, plus elles seront massives, plus elles seront en mesure de concrétiser la nature unitaire et solidaire de la classe ouvrière.
Bien sûr ces luttes ne déboucheront pas toujours sur des victoires. Au contraire, la classe ouvrière a subi et subira encore des défaites. Mais chacune de ces défaites renferme en elle les ferments d’une prochaine lutte plus unitaire et plus consciente, à condition que le prolétariat soit en mesure de comprendre pourquoi il a perdu, qu’est-ce qui lui a barré la route.
Les éléments les plus conscients de la classe ouvrière voudraient bien sûr que ce processus soit plus rapide, que les victoires soient plus nombreuses que les défaites, que les divisions nationales soient dépassées dès les premières lueurs de combativité. Ils voudraient que les leçons des défaites soient tirés le plus largement possible pour que les pièges de la bourgeoisie finissent par ne plus fonctionner. Nous savons que rien n’est gagné d’avance et que l’ennemi sera difficile à abattre. Il se pourrait même que ça n’arrive pas et que la décomposition sociale entraîne l’humanité à sa perte.
Alors nous comprenons parfaitement l’impatience de la camarade et nous partageons l’importance qu’elle donne à tout ce qui pourrait permettre de « traverser les frontières ».
C’est là souligner toute l’importance et le rôle des organisations révolutionnaires et de tous ceux qui partagent leurs positions et souhaitent appuyer leur intervention. Ce sont les révolutionnaires qui seuls peuvent aujourd’hui porter une perspective plus large, démontrer l’inconsistance des divisions portées par la bourgeoisie en général et les syndicats en particulier, démontrer l’unité de la classe ouvrière à travers le monde : l’unité de ses intérêts, l’unité des attaques qu’elle subit. Cette intervention des révolutionnaires est aujourd’hui essentielle : elle n’aura rien de magique, elle ne remplacera pas l’école de la lutte, mais elle lui donnera un éclairage et une perspective indispensables pour permettre le développement d’une conscience large dans la classe que ses conditions de vie et l’avenir que le capitalisme promet à la planète et à ses habitants ne sont pas une fatalité et que son rôle pour ouvrir la voie à une autre société est déterminant.
Aujourd’hui, l’écho des positions révolutionnaires est encore très faible dans la classe mais cela n’enlève rien à son rôle crucial. C’est pour cela que tous les éléments conscients dans la classe doivent se regrouper autour des organisations révolutionnaires et participer à leur activité : l’analyse de la situation, le débat, l’intervention. L’importance de cette activité ne se mesure pas à l’audience qu’elle obtient immédiatement mais à ce que l’histoire a montré : l’intervention des révolutionnaires a toujours été déterminante dans les victoires de la classe ouvrière alors même que leurs erreurs ont aussi pu avoir des conséquences désastreuses.
Pour nous, cette perspective n’est pas immédiate. Mais il est indispensable de se préparer alors que la classe ouvrière aujourd’hui relève la tête et montre qu’elle est toujours une force sociale sur la scène de l’histoire. Pour les révolutionnaires, il ne fait aucun doute qu’il faut dès aujourd’hui être présents et une force active dans ce processus. Pour reprendre l’image de la camarade, nous sommes les « passeurs » des frontières pour la classe ouvrière.
GD, 3 mars 2023
Vie du CCI:
- Courrier des lecteurs [252]
Rubrique:
Sur la dernière réunion du comité NWBCW Paris
- 121 lectures
Nous publions ci-dessous une prise de position d’un de nos sympathisants à propos de la réunion du comité NWBCW à Paris du 2 décembre. Nous saluons cette contribution et soutenons globalement le contenu politique de ce texte. Selon nous, il permet en effet de souligner deux aspects essentiels que nous voulons mettre en exergue :
– le premier, le caractère totalement artificiel du comité NWBCW, sans rapport avec la réalité d’une prétendue réaction à la guerre au sein de la classe ouvrière : « A moins de considérer que les luttes de l’an passé en Angleterre, celle qui se déroule actuellement en France, etc. soient des luttes qui s’opposent frontalement et surtout consciemment à la guerre, la formation de tels comités n’émane pas d’un mouvement de la classe ».
– le second, le fait qu’une telle initiative opportuniste ne fait qu’accentuer la confusion vis-à-vis du gauchisme et de l’anarchisme : « La création ex-nihilo de structures hétérogènes appelés après-coup « comité de lutte », en appelant à toutes les bonnes volontés gauchistes et anarchistes semble être un cadre impropre à la politique prolétarienne ».
Comme le souligne justement le camarade, ce comité NWBCW n’est finalement rien de moins qu’un « faux-nez basé sur des compromis »
CCI
Je ne vais pas faire ici, un résumé point par point de cette réunion, mais je vais uniquement me concentrer sur ce qui m’a paru être le plus important.
Je ne vais pas entrer dans la polémique sur la signification historique de la guerre en Ukraine, qui devait être la première partie de la discussion lors de la réunion, avec d’un côté la TCI qui voit cette guerre comme une étape vers la généralisation de la guerre inter-impérialiste mondiale et le CCI qui affirme que celle-ci n’est pas encore à l’ordre du jour et que les conditions ne sont pas encore réunies.
Je vais me concentrer sur ce qu’est le comité NWBCW et la politique de création de ce type de comité face à la guerre.
Après le déclenchement de la guerre en Ukraine l’an dernier, deux organisations de la GC ont proposé deux initiatives différentes. D’un côté le CCI a été à l’initiative avec l’Institut Damen et IV d’une déclaration commune des groupes de la GC de l’autre la TCI a appelé à la création de comités NWBCW.
Je reviens sur cette opposition car elle est sous-jacente à la seconde partie de la discussion qui a eu lieu lors de la réunion du comité à savoir qu’est-ce que ce comité, son but, etc.
Le présidium alors a tracé une opposition entre d’un côté un internationalisme abstrait (celui du CCI) et de l’autre une initiative concrète.
Bien sûr, il le fallait le recours au concret, le retour du concret, « voyez-vous camarades, le problème avec cette déclaration commune des groupes de la GC c’est qu’elle est valable en tout temps et en tout lieu », les comités de lutte NWBCW eux sont des initiatives qui permettront aux minorités qui y participent de se tordre, de se plier aux différentes situations, aux différents contextes afin de mieux répondre à la situation actuelle.
Pour traiter ce point, il faut voir ce qu’est un comité de lutte, il émane soit d’une lutte massive de la classe soit d’une lutte dans une de ses parties, regroupant des éléments particulièrement combatifs qui ressentent la nécessité de s’unir pour agir et réfléchir et poursuivre la lutte, se formant d’abord (le plus souvent) sur la base de l’entreprise ou du secteur, il peuvent s’élargir au fur et à mesure de la lutte.L’apparition de comités de luttes n’est jamais à négliger et correspond à un pas en avant dans la maturation de la conscience de classe. Les prolétaires se réunissant pouvant évoquer les échecs et les raisons de ceux-ci, se poser la question de comment s’organiser et dans quel cadre. Il est donc essentiel pour les révolutionnaires organisés de soutenir la création de tels comités et d’y intervenir.
De par sa nature, les conditions de sa formation, un comité est hétérogène politiquement et sensible aux manœuvres et aux sabotages des gauchistes ou des syndicalistes. La tâche des révolutionnaires de la GC est de donner aux prolétaires dans ces comités les outils pour s’opposer à leurs ennemis politiques que sont les gauchistes.
Qu’en est-il donc ici. À moins de considérer que les luttes de l’an passé en Angleterre, celle qui se déroule actuellement en France, etc. soient des luttes qui s’opposent frontalement et surtout consciemment à la guerre, la formation de tels comités n’émane pas d’un mouvement de la classe.
Artificiel semble donc être un terme juste pour qualifier ce type d’initiatives.
Dans ce comité artificiel, les groupes de la GC vont lutter côtes à côtes avec des éléments clairement gauchistes (donc des ennemis politiques). Là survient une manœuvre qui veut faire passer le CCI comme sectaire, en effet au nom de quoi le CCI dirait « untel lutte et celui-làcelui-là non », cependant, si dans une lutte il arrive que se créent des comités dans ceux-ci les révolutionnaires de la GC interviennent non pas pour marcher avec les gauchistes mais les combattre. Comment les combattre tandis que l’on va former avec eux un comité qui de plus ne s’appuie sur aucun mouvement clair de la classe contre la guerre. C’est une faute, ici les révolutionnaires se désarment préventivement et ne pourront être en mesure de guider les participants face aux divers gauchistes et anarchistes.
Il est par exemple ressorti de cette réunion un clair immédiatisme et activisme ce qui était à prévoir, mais il sera impossible pour la TCI de s’y opposer quand elle baigne dedans, maintenant et entretenant l’illusion qu’il pourrait y avoir des actions de classe anti-guerre à populariser et à généraliser à court terme.
Le danger également pour les participants de leur faire croire à des initiatives minoritaires en réalité qui ne feront pas avancer d’un « inch » la conscience dans la classe tout en les exposant à la répression de l’Etat Bourgeois.
Cet activisme pousse également des éléments jeunes et inexpérimentés qui recherchent les positions de classe à s’interrompre dans leur prise de conscience, les empêche d’être aspirés par la GC (à moins de considérer que la GC c’est « trois pelés et un tondu » comme un membre du présidium), ce type de comité constituant un leurre de fait, puisqu’il entretient pour des raisons évidemment opportuniste le flou sur des questions et des positons essentielles et n’est pas sans véhiculer le vieux piège de la substitution, privilégiant des actions spectaculaires maintenant et tout de suite.
La création artificielle d’un « comité » qui met sur le même plan les organisations de la GC et les divers anarchistes, gauchistes, trotskistes, éléments syndicalistes tandis que les conditions d’adhésion sont trop larges et trop floues, que voulant la survie du comité pour agir contre la guerre aucune des questions pièges ne sera clarifiée de peur de mettre dans une position délicate tel ou tel groupe participant, c’est ce qu’un italien du siècle dernier appelait une « alliance sans principes ».
Je peux donner quelques exemples rapides, à aucun moment le présidium n’a ressenti le besoin de clarifier pour la bonne compréhension des participants inexpérimentés, le qualitatif politique de gauchiste, la frontière de classe qui les sépare la GC, le présidium n’est pas revenu sur les illusions des participants sur la situation en Iran que certains voyaient comme le début d’une révolution tandis qu’il ne s’agit même pas d’un mouvement de classe, quand a été évoqué le fait de s’organiser dans les syndicats, il n’a pas rappelé la position de la GC sur les syndicats, leur rôle ce qui aurait été au vu des luttes passées et en préparation largement plus instructif pour tout le monde.
Comment nous faire croire après qu’il sera possible justement de mener un combat contre ces mêmes gauchistes au sein du comité. Autant demander à un puma de se couper les griffes et retirer ses crocs avant de les enfoncer dans la nuque du grizzly. Nul besoin d’être un devin, prophète ou Lévite pour dire cela, mais simplement être marxiste et éviter de donner comme bilan critique de deux décennies de politique de NWBCW « parfois ça marche, parfois non ».
Ces deux propositions la déclaration commune et la formation de comités correspondent à deux manières de faire de la politique et elles ne se valent pas.
Par quoi sont guidés les révolutionnaires, ils ont un devoir face à la classe, celui de lui donner les moyens d’aller vers la clarté politique, cela se traduit par exemple par éviter aux prolétaires les plus conscients ou les plus combatifs (ceux par exemple qui répondent aux appels des organisations de la GC) de présenter des voies de garages, des initiatives d’actions sans rapports avec le mouvement réel lent mais existant de prise de conscience dans la classe.L’activisme, l’immédiatisme et les divers maux dont souffre ce comité ne sont pas dut au hasard mais au poison opportuniste. La création ex-nihilo de structures hétérogènes appelés après-coup « comité de lutte », en appelant à toutes les bonnes volontés gauchistes et anarchistes semble être un cadre impropre à la politique prolétarienne.
La morale ici pourrait être résumé comme suit : « la classe hésite, poussons là !… nulle-part. »
Ce qu’est en réalité ce comité, un faux-nez basé sur des compromis tacite par dépit le tout sur des principes flous pour intervenir et surtout le montrer.
Fraternellement,
Un sympathisant actif du CCI et de la GC
Vie du CCI:
- Courrier des lecteurs [252]
Rubrique:
Répression, insultes, agressions sexuelles, gazage, matraquage… Il ne faut pas tomber dans le piège des provocations policières!
| Fichier attaché | Taille |
|---|---|
| 196.05 Ko |
- 319 lectures
« Tu la fermes ou tu veux que je recommence ? Ah ! tu commences à bégayer, t’en reveux peut-être une pour te remettre la mâchoire droite ? »
« Quand je t’ai attrapé, t’as commencé à trembler, c’est moi qui t’ai mis la balayette ! »
« T’inquiète, ta petite tête, on l’a déjà en photo. T’as juste à te repointer dans la rue aux prochaines manifs : je peux te dire que les têtes, nous on est vachement physio, on les retient. T’inquiète pas que la prochaine fois qu’on vient, tu monteras pas dans le car pour aller au commissariat, tu vas monter dans un autre truc qu’on appelle “ambulance” pour aller à l’hôpital ! »
« T’as de la chance, on va se venger sur d’autres personnes.Si t’as l’occase de regarder la télé, regarde bien, tu verras ce qui t’attend quand tu reviendras ! »
Une provocation policière délibérée et calculée
Ces propos ont été proférés par des policiers de la Brav-M lors de la manifestation du 23 mars à Paris. Enregistrés par l’un des interpellés, ils ont fait le tour des médias, provoquant des débats entre experts sur la formation des agents constituant cette brigade spéciale.
Autrement dit, on veut nous faire croire au dérapage de quelques-uns. Ce n’est qu’un mensonge ! Partout en France, à Rennes, Nantes, Lyon… la police cogne et provoque. Cette simultanéité de la répression n’est pas un hasard. C’est une politique totalement délibérée du pouvoir. L’objectif est simple et c’est même un classique :
– entraîner les jeunes les plus en colère dans un affrontement stérile avec les forces de l’ordre ;
– faire peur à la majorité des manifestants, les décourager de venir dans la rue ;
– empêcher toute possibilité de discussion, en pourrissant systématiquement les fins de manifestations, moment habituellement propice aux rassemblements et aux débats ;
– rendre impopulaire le mouvement, en faisant croire que toute lutte sociale dégénère automatiquement en violence aveugle et en chaos, alors que le pouvoir serait le garant de l’ordre et de la paix.
Nous ne devons pas tomber dans le piège !
Oui, notre colère est immense ! Oui, nous ne pouvons qu’être indignés et combatifs !
Mais notre force ne réside pas dans l’affrontement stérile avec les bataillons suréquipés et surentrainés des CRS, gendarmes mobiles et autres porte-flingues de « l’ordre » des exploiteurs.
De même, notre lutte ne consiste pas à casser des vitrines et brûler des poubelles. Les violences minoritaires ne renforcent pas le mouvement. Au contraire elles l’affaiblissent !
Nous sommes la classe ouvrière ! Nous sommes une force collective, capables de rentrer en lutte massivement, de nous organiser, d’être solidaires, unis, de débattre et nous dresser ensemble face au pouvoir pour refuser la dégradation continue de nos conditions de vie et de travail, pour refuser ce système qui plonge l’humanité dans la misère et la guerre.
Voilà ce qui inquiète vraiment la bourgeoisie : quand nous luttons ainsi en tant que classe. Voilà pourquoi elle nous tend aujourd’hui le piège du pourrissement et du chaos par la violence. Elle veut briser la dynamique en cours et le processus qui se développe depuis des mois à l’échelle internationale.
Le développement de nos luttes inquiète la bourgeoisie
Depuis l’annonce de la réforme des retraites, les grèves se multiplient et, surtout, les manifestations nous rassemblent par millions dans les rues. Grâce à cette lutte, nous commençons à comprendre qui est ce « Nous » ! Une force sociale, internationale, qui produit pratiquement tout et doit lutter de manière unie et solidaire : la classe ouvrière ! « Soit on lutte ensemble, soit on finira par dormir dans la rue ! » C’est ce qui s’exprime clairement, par exemple, dans les manifestations en soutien aux éboueurs d’Ivry que la police vient régulièrement déloger : ensemble, nous sommes plus forts !
Et ces réflexes de solidarité ne surgissent pas qu’en France. Dans de nombreux pays, les grèves et mouvements sociaux se multiplient. Au Royaume-Uni face à l’inflation, en Espagne face à l’effondrement du système de santé, en Corée du Sud face à l’allongement de la durée de travail, en Allemagne contre les bas salaires… partout, la classe ouvrière se défend par la lutte.
En Grèce, un accident de train a eu lieu il y a trois semaines : 57 morts. La bourgeoisie a évidemment voulu faire porter le chapeau à un travailleur. L’aiguilleur de service a été jeté en prison. Mais la classe ouvrière a immédiatement compris l’arnaque. Par milliers, des manifestants ont pris la rue pour dénoncer la vraie cause de cet accident meurtrier : le manque de personnel et l’absence de moyens. Depuis, la colère ne désenfle pas. Au contraire, la lutte s’amplifie et s’élargit, aux cris de « contre les bas salaires ! », « ras le bol ! ». Ou encore : « nous ne pouvons plus travailler comme des personnes décentes depuis la crise, mais au moins ne nous tuez pas ! ».
Notre mouvement contre la réforme des retraites est en train de participer à ce développement de la combativité et de la réflexion de notre classe au niveau mondial.
Notre mouvement montre que nous sommes capables de lutter massivement et de faire trembler la bourgeoisie. Déjà, tous les spécialistes et docteurs en politique annoncent qu’il va être très compliqué pour Macron de faire passer de nouvelles réformes et attaques d’ampleur d’ici la fin de son quinquennat.
Pour cacher aux travailleurs des autres pays cette force du mouvement social en France, tous les médias du monde diffusent en boucle les poubelles qui brûlent et les jets de pierre. Ils réduisent volontairement toute la lutte contre la réforme des retraites à une simple émeute destructrice. Mais leurs grossiers mensonges sont de moins en moins crédibles : en Allemagne, les grèves qui se développent affirment ouvertement qu’elles s’inspirent du mouvement en cours en France.
Il y a là l’embryon d’un lien international. D’ailleurs, les personnels du Mobilier national en grève contre la réforme des retraites avaient affirmé, juste avant que la venue du roi d’Angleterre à Versailles ne soit annulée : « Nous sommes solidaires des travailleurs anglais, qui sont en grève depuis des semaines pour l’augmentation des salaires ».
Ce réflexe de solidarité internationale est l’exact opposé du monde capitaliste divisé en nations concurrentes, jusqu’à la guerre ! Ce réflexe de solidarité internationale rappelle le cri de ralliement de notre classe depuis 1848 : « Les prolétaires n’ont pas de patrie ! Prolétaires de tous les pays, unissez-vous ! ».
Notre force, c’est la solidarité, la massivité et la réflexion dans la lutte !
Contre tous les pièges et les mensonges des bourgeoisies et de leurs médias aux ordres, dans tous les pays, c’est à nous de défendre nos méthodes de luttes, c’est à nous de comprendre ce qui fait notre force et notre unité en tant que classe, c’est à nous de tirer les leçons des combats passés pour les luttes actuelles et à venir.
Par exemple, ces derniers jours, les journaux ont indiqué la possibilité d’un « scénario à la CPE » sans dire un seul mot sur ce qui a constitué son cœur et sa force : les assemblées générales. En 2006, le gouvernement avait été contraint de retirer son Contrat Première Embauche qui allait plonger la jeunesse dans une précarité encore plus grande.
À l’époque, la bourgeoisie avait été effrayée par l’ampleur croissante de la contestation, qui commençait à dépasser le seul mouvement de la jeunesse, des étudiants précaires et des jeunes travailleurs, pour s’étendre à d’autres secteurs, avec des mots d’ordre unitaires et solidaires : « jeunes lardons, vieux croûtons, tous la même salade ! » lisait-on sur les pancartes.
Cette capacité à étendre le mouvement était le fruit des débats dans de véritables assemblées générales souveraines et ouvertes. Ces AG étaient le poumon du mouvement et ont constamment cherché, non pas à s’enfermer dans les facs ou sur les lieux de travail dans un esprit de citadelle assiégée, pour les bloquer coûte que coûte, mais à étendre la lutte, avec des délégations massives vers les entreprises voisines et les autres quartiers. Voilà ce qui a fait reculer la bourgeoisie ! Voilà ce qui a fait la force de notre mouvement ! Voilà les leçons que nous devons nous réapproprier aujourd’hui !
La force de notre classe réside dans notre unité, notre conscience de classe, notre capacité à développer notre solidarité et donc à étendre le mouvement à tous les secteurs. C’est l’aiguillon qui doit guider nos luttes.
Dans la lutte, nous ne pouvons compter que sur nous-mêmes ! Ni sur les politiciens, ni sur les syndicats ! C’est la classe ouvrière et sa lutte qui portent une alternative, celle du renversement du capitalisme, celle de la révolution !
Aujourd’hui, il est encore difficile de nous rassembler en assemblées générales, de nous organiser nous-mêmes. C’est pourtant le seul chemin possible. Ces AG doivent être des lieux où nous décidons réellement de la conduite du mouvement. Elles sont le seul endroit pour organiser la réponse à la répression et à la défense de nos moyens de lutte comme ce fut le cas dans les AG du CPE en 2006. Ces AG sont le lieu où nous nous sentons unis et confiants dans notre force collective, où s’expriment la responsabilité et l’engagement de chacun, où nous pouvons adopter ensemble des revendications de plus en plus unificatrices et partir en délégations massives pour rencontrer nos frères et sœurs de classe dans les usines, les hôpitaux, les écoles, les commerces, les administrations les plus proches. C’est l’extension rapide de la lutte à d’autres secteurs qui fera plier le gouvernement.
Aujourd’hui ou demain, les luttes vont se poursuivre, parce que le capitalisme s’enfonce dans la crise et parce que le prolétariat n’a pas d’autre choix. C’est la raison pour laquelle, partout dans le monde, les ouvriers entrent en lutte.
La bourgeoisie va poursuivre ses attaques (économie de guerre, inflation, licenciements, précarité, pénurie), sa répression et ses provocations. Face à cette dégradation des conditions de vie et de travail, la classe ouvrière internationale va reprendre de plus en plus massivement le chemin de la lutte en devant éviter tous les pièges tendus sur son chemin.
Alors, partout où nous le pouvons, dans la rue, après et avant les manifestations, sur les piquets de grève, dans les cafés et sur les lieux de travail, nous devons nous réunir, débattre, tirer les leçons des luttes passées, pour développer nos luttes actuelles et préparer les combats à venir.
L’avenir appartient à la lutte de classe !
Courant Communiste International, 27 mars 2023
Récent et en cours:
Rubrique:
Les violences aveugles et minoritaires des Black-blocs n’ont rien à voir avec la lutte de classe
- 204 lectures
Depuis plusieurs jours dans le mouvement contre la réforme des retraites, la bourgeoisie déchaîne sa police sur les manifestants avec une violence rare. Ces provocations ont été le terrain fertile d’affrontements entre de petits groupes de Black-blocs et les forces de répression de l’État qui se sont fortement accentués. Poubelles brûlées, vitrines brisées, parties de bâtiments incendiés… Telles sont les images que les chaînes d’informations diffusent en boucle pour mieux discréditer la lutte.
La violence aveugle et ultra-minoritaire de ces groupes ne participe en rien au développement de la lutte. Bien au contraire, comme nous avons pu le constater à l’issue de la neuvième journée de mobilisation, le 23 mars, elles servent de caution aux forces de répression pour se déchaîner sur les manifestants. Ce climat de terreur perpétré par l’État vise à dissuader une partie des travailleurs de se joindre aux cortèges et à empêcher toute forme de discussions ou de rassemblement à la fin des manifestations.
La violence est une question fondamentale de la lutte révolutionnaire. C’est pourquoi, nous proposons ci-dessous un ensemble d’articles permettant d’approfondir la réflexion sur le sujet :
– Terreur, terrorisme et violence de classe [572]
– Résolution sur [573] : terrorisme, terreur et violence de classe [573]
– Black blocs [574] : des méthodes et une idéologie étrangères au prolétariat [574]
– Manifestation des lycéens à Lyon : des provocations policières pour tenter de pourrir le mouvement [576]
– La répression montre le vrai visage de l’État démocratique! [577]
Récent et en cours:
Rubrique:
ICConline - avril 2023
- 59 lectures
12e manifestation contre la réforme des retraites : comment avons-nous gagné en 2006 ?
| Fichier attaché | Taille |
|---|---|
| 227.48 Ko |
- 284 lectures
Nous sommes aujourd’hui dans la rue pour la 12e journée de manifestations contre la réforme des retraites. Chaque fois, nous sommes des millions à nous dresser contre cette attaque, à refuser la dégradation continue de nos conditions de vie et de travail, à nous serrer les coudes, à lutter ensemble.
Travailleurs, chômeurs, étudiants et retraités, nous pouvons être fiers de ce combat collectif, de cette lutte pour la dignité, de cette solidarité qui nous cimente.
L’ampleur de notre mouvement est tel qu’il inspire, en ce moment-même, les travailleurs en Allemagne, en Italie, en Tchéquie, au Royaume-Uni… Eux aussi refusent d’être de plus en plus exploités et paupérisés. C’est à l’échelle internationale que les grèves se multiplient.
Pourtant, nous ressentons aussi, tous, la limite actuelle de notre mouvement. Au Royaume-Uni, les travailleurs enchaînent les grèves depuis dix mois sans que le gouvernement ne plie. Aucune augmentation réelle des salaires, au-delà de quelques miettes. En France, le gouvernement reste « droit dans ses bottes » et maintient son attaque. Pire, les prix alimentaires flambent et les salaires stagnent. Et la future réforme sur le travail annonce déjà la couleur : plus de flexibilité, plus de précarité.
Alors, comment développer un rapport de forces en notre faveur ? Comment faire reculer la bourgeoisie ?
Une partie de la réponse se trouve dans notre propre expérience, dans notre propre histoire, particulièrement dans cet épisode de la lutte de classe qui constitue notre dernière victoire : le mouvement contre le Contrat Première Embauche (CPE) en 2006. Face à la dynamique du mouvement, la bourgeoisie française avait, en effet, dû reculer et retirer sa loi, pourtant adoptée au Parlement. Les médias parlent, d’ailleurs, de la possibilité actuelle d’un « scénario à la CPE », mais sans jamais dire ce qui, à l’époque, avait fait trembler la bourgeoisie française et son gouvernement.
Que s’est-il passé en 2006 ?
Le 16 janvier 2006, le gouvernement, sous prétexte de combattre le chômage des jeunes, soumet au Parlement un projet de loi (cyniquement intitulé « pour l’égalité des chances ») qui contient une disposition particulièrement inique : le CPE. Ce contrat permet aux patrons de licencier les salariés de moins de 26 ans pendant deux ans sans la moindre justification.
Dès le 17 janvier, la jeunesse réagit à cette attaque, comprenant immédiatement qu’elle vise à accroître sa précarité au travail. Dans toutes les universités, elle se rassemble en assemblées générales (AG) pour débattre et décider ensemble de la conduite du mouvement. Des collectifs pour obtenir le retrait du CPE se forment.
Le 24 janvier est lancé le premier appel à manifester.
Le 7 février, plusieurs centaines de milliers de personnes manifestent dans toute la France alors que, dans les entreprises, aucun syndicat n’appelle à une quelconque action ou AG.
Les 14 et 16 février, plusieurs milliers d’étudiants et de lycéens manifestent à Paris, Toulouse, Rennes et Lyon.
Le 27 février, le gouvernement utilise le 49.3 pour faire passer la loi (et donc le CPE) à l’Assemblée nationale.
Le 1er mars, treize universités sont en grève. Blocages, filtrages et fermeture totale des universités sont décidés par les AG des étudiants en grève. Ce sont de véritables AG : elles décident des actions à mener et des mots d’ordre, elles sont ouvertes aux travailleurs, aux chômeurs et aux retraités.
Le 4 mars, la Coordination nationale étudiante, constituée par les délégués élus par les AG, se réunit à Jussieu (Paris). Une cinquantaine de travailleurs, de chômeurs et de retraités venus des quatre coins de la France souhaitent participer aux débats. Mais le syndicat étudiant UNEF s’y oppose. Le débat s’engage dans l’assemblée, la position de l’UNEF est mise en minorité, les portes s’ouvrent et la cinquantaine « d’extérieurs » peut entrer. Durant toute la discussion, les représentants de l’UNEF n’auront de cesse de vouloir réduire le mouvement à des revendications purement estudiantines, quand le reste de l’assemblée œuvrera à élargir les mots d’ordre à tous les travailleurs.
Le 7 mars, la protestation s’intensifie. Près d’un million de manifestants défilent dans toute la France. On commence à voir des salariés se joindre à la manif, mais soit dans les cortèges étudiants, soit sur les trottoirs, rarement derrière les banderoles syndicales. À Paris, les syndicats se mettent en tête de la manifestation. Voyant cela, les étudiants se précipitent et s’imposent à l’avant du cortège. Une vingtaine d’universités sont en grève, avec toujours plus d’AG souveraines.
Le 8 mars, des étudiants de la Sorbonne occupent leur fac pour pouvoir tenir leurs assemblées. Le rectorat de Paris exige l’évacuation du bâtiment classé « monument historique ». Les étudiants refusent et sont encerclés par les CRS et les Gendarmes mobiles qui transforment l’université en véritable souricière.
Le 9 mars, le Parlement adopte définitivement le CPE. Le Premier ministre annonce que la mesure sera appliquée « dans les prochaines semaines ».
Le 10 mars, les étudiants des autres facs décident de se rendre massivement et pacifiquement à la Sorbonne, pour apporter leur solidarité et de la nourriture à leurs camarades affamés et pris en otage sur ordre du Recteur de l’Académie de Paris et du ministère de l’Intérieur.
Dans la nuit du 10 au 11, les forces de l’ordre envahissent la Sorbonne, à coups de matraques et de gaz lacrymogènes. Ils expulsent les étudiants en lutte et en arrêtent plusieurs dizaines.
Le 16 mars, 64 des 84 universités sont bloquées.
Le 18 mars, démonstration de force des anti-CPE : près d’un million et demi de personnes dans la rue. Les syndicats ne font toujours rien dans les entreprises, aucune action, aucune AG.
Le 19 mars, les syndicats brandissent « la menace d’une grève générale »... une menace en l’air jamais exécutée. Un texte normalement réservé aux membres de l’UNEF fuite dans les rangs étudiants. Ce texte explique à ses adhérents comment noyauter les AG, contrôler les débats et les décisions. L’indignation est générale. Certaines assemblées scandent « Unef-Medef », pour souligner le travail de sape du syndicat de l’intérieur au profit du patronat.
Le 20 mars, le Premier ministre exclut une nouvelle fois tout retrait du CPE.
Le 21 mars, un quart des lycées sont bloqués.
Les 28 mars et 4 avril, nouvelles mobilisations record : près de trois millions de manifestants défilent dans toute la France.
Le 10 avril, le CPE est retiré !
De quoi la bourgeoisie française a-t-elle eu si peur au point de reculer ?
Ce qui a fait la force de ce mouvement, c’est d’abord et avant tout le renforcement de la solidarité active dans la lutte. C’est en resserrant les rangs, en construisant un tissu très serré, en comprenant que l’union fait la force, que les étudiants (et les lycéens) ont pu mettre en pratique le vieux mot d’ordre du mouvement ouvrier : « Un pour tous, tous pour un ! »
Les assemblées générales massives, poumon du mouvement
Les amphithéâtres où se tenaient les AG étaient pleins à craquer. Les travailleurs, chômeurs, retraités étaient invités à venir participer aux débats, à apporter leur expérience. Tous les travailleurs qui ont assisté à ces AG ont été sidérés par la capacité de cette jeune génération à distribuer la parole, à convaincre, à confronter les arguments… Les étudiants défendaient en permanence le caractère souverain des AG, avec leurs délégués élus et révocables (sur la base de mandats et remises de mandat), à travers le vote à main levée. Tous les jours, des équipes différentes organisaient le débat à la tribune. Pour pouvoir répartir les tâches, centraliser, coordonner et garder la maîtrise du mouvement, les comités de grève décidaient d’élire différentes commissions : presse, animation et réflexion, accueil et information, etc. C’est grâce aux AG, véritables lieux ouverts de débats et de décisions, et à la centralisation de la lutte que les étudiants décidaient des actions à mener, avec comme principale préoccupation l’extension du mouvement aux entreprises.
La dynamique vers l’extension de la lutte à toute la classe ouvrière
Les étudiants avaient parfaitement compris que l’issue de leur combat était entre les mains des travailleurs salariés. Comme l’avait dit un étudiant dans une réunion de la coordination francilienne du 8 mars « si on reste isolés, on va se faire manger tout crus ». Cette dynamique vers l’extension du mouvement, vers la grève de masse, a démarré dès le début de la mobilisation. Les étudiants ont envoyé partout des délégations massives vers les travailleurs des entreprises proches de leurs lieux d’études. Mais ils se sont heurtés au « blocage de l’économie » syndical : les travailleurs sont restés enfermés dans leurs entreprises sans possibilité de discuter avec les délégations d’étudiants. Alors les « petits sioux » des facs ont dû imaginer un autre moyen de contourner le barrage syndical. Ils ont ouvert les amphithéâtres dans lesquels se tenaient leurs AG. Ils ont demandé aux travailleurs et retraités de leur transmettre leur expérience. Ils avaient soif d’apprendre des vieilles générations. Et les « vieux » avaient soif de transmettre aux « jeunes ». Tandis que les « jeunes » gagnaient en maturité, les « vieux » étaient en train de rajeunir ! C’est cette osmose entre toutes les générations de la classe ouvrière qui a donné une impulsion nouvelle au mouvement. La plus grande victoire, c’est la lutte elle-même : « Parfois les ouvriers triomphent ; mais c’est un triomphe éphémère. Le résultat véritable de leur lutte est moins le succès immédiat que l’union grandissante des travailleurs » (Marx et Engels, Manifeste communiste, 1848).
Le mouvement des étudiants de 2006 allait bien au-delà d’une simple protestation contre le CPE. Comme l’avait dit un professeur de l’université de Paris-Tolbiac, à la manifestation du 7 mars : « le CPE n’est pas seulement une attaque économique réelle et ponctuelle. C’est aussi un symbole ». Effectivement, c’était le « symbole » de la faillite de l’économie capitaliste.
C’était aussi une réponse implicite contre les « bavures » policières (celle qui, à l’automne 2005, avait provoqué la mort « accidentelle » de deux jeunes innocents dénoncés comme « cambrioleurs » par un « citoyen » et poursuivis par les flics). La répression des étudiants de la Sorbonne qui voulaient seulement pouvoir tenir des AG n’a fait que renforcer la détermination des étudiants. Toute la bourgeoisie et ses médias aux ordres n’ont cessé, heure après heure, de faire de la publicité mensongère pour faire passer les étudiants pour des « voyous ». Mais la classe ouvrière n’a pas mordu à l’hameçon. Au contraire, la violence des flics de la bourgeoisie a révélé au grand jour la violence du système capitaliste et de son État « démocratique ». Un système qui jette sur le pavé des millions d’ouvriers, qui veut réduire à la misère les jeunes comme les retraités, un système qui fait régner « le droit et l’ordre » par la matraque.
Les nouvelles générations de la classe ouvrière ont refusé de céder à la provocation de l’État policier. Elles ont refusé d’utiliser la violence aveugle et désespérée. Face à la répression et aux provocations, elles ont maintenu leur méthode de lutte : les AG souveraines, la solidarité et l’extension de la mobilisation !
Prendre la lutte en main, se rassembler en AG pour décider ensemble, c’est possible !
Ces méthodes de lutte qui ont fait la force du mouvement en 2006, qui ont fait trembler la bourgeoisie et l’ont contrainte à reculer, nous aussi nous sommes capables de les mettre en œuvre !
Le CPE n’attaquait pas les jeunes précaires en tant qu’étudiants mais en tant que futurs travailleurs. Les méthodes de lutte qu’ont employées instinctivement les étudiants en grève sont celles de toute la classe ouvrière. Prendre ainsi la lutte en main sur les lieux de travail, se rassembler en AG souveraines, décider collectivement des actions et des mots d’ordre, débattre et construire ensemble le mouvement, étendre la lutte aux secteurs géographiques les plus proches, en allant à la rencontre des travailleurs de l’école, de l’hôpital, de l’usine, de l’administration d’à-côté… tout cela est possible. Réfléchir et élaborer ensemble au sein de ces AG est aussi le moyen de ne pas tomber dans le piège des provocations policières et des affrontements stériles. Les étudiants en 2006 l’ont prouvé !
Nous organiser en AG est aujourd’hui l’étape décisive que nous ne sommes pas encore parvenus à franchir pour transformer les millions que nous sommes dans la rue en véritable force collective, unie et solidaire. Parce que nous manquons de confiance en nous-mêmes, parce que nous confions la direction de nos luttes aux organisations syndicales, parce que nous avons oublié que nous avons déjà été capables de lutter ainsi par le passé. En Pologne en 1980, en Italie en 1969, en France en 1968... pour ne prendre que les trois exemples les plus célèbres des soixante dernières années.
Pour passer ce cap, tous les travailleurs, chômeurs, retraités, étudiants qui cherchent à développer la lutte et la force collective de notre classe, doivent se réunir pour débattre, échanger sur leur expérience et essayer ensemble de se réapproprier les leçons du passé.
L’émancipation des travailleurs sera l’œuvre des travailleurs eux-mêmes !
Courant Communiste International, 5 avril 2023
Récent et en cours:
Rubrique:
Critiques des soi-disant "communisateurs"
- 182 lectures
Récent et en cours:
- communisateurs [583]
Courants politiques:
- Anarchisme & Modernisme [584]
Rubrique:
Royaume-Uni, France, Allemagne, Espagne, Mexique, Chine… Aller plus loin qu’en 1968!
| Fichier attaché | Taille |
|---|---|
| 212.13 Ko |
- 242 lectures
« Trop c’est trop ! » – Royaume-Uni. « Pas une année de plus, pas un euro de moins » – France. « L’indignation vient de loin » – Espagne. « Pour nous tous » – Allemagne. Tous ces slogans, scandés lors des grèves de ces derniers mois à travers le monde, révèlent à quel point les luttes ouvrières actuelles expriment le refus de la dégradation générale de nos conditions de vie et de travail. Au Danemark, au Portugal, aux Pays-Bas, aux États-Unis, au Canada, au Mexique, en Chine… les mêmes grèves contre la même exploitation de plus en plus insoutenable. « La vraie galère : ne pas pouvoir se chauffer, manger, se soigner, rouler ! »
Mais nos luttes sont aussi beaucoup plus que cela. Dans les manifestations, on commence à lire sur quelques pancartes le refus de la guerre en Ukraine, le refus de produire toujours plus d’armes et de bombes, de devoir se serrer la ceinture au nom du développement de cette économie de guerre : « Pas de sous pour la guerre, pas de sous pour les armes, des sous pour les salaires, des sous pour les retraites » a-t-on pu entendre lors des manifestations en France. Elles expriment aussi le refus de voir la planète être détruite au nom du profit.
Nos luttes sont le seul rempart contre cette dynamique autodestructrice, le seul rempart face à la mort que promet le capitalisme à toute l’humanité. Car, laissé à sa seule logique, ce système décadent va entraîner des parties de plus en plus larges de l’humanité dans la guerre et la misère, il va détruire la planète à coups de gaz à effet de serre, de forêts rasées et de bombes.
Le capitalisme mène l’humanité au désastre !
La classe qui dirige la société mondiale, la bourgeoisie, a en partie conscience de cette réalité, de cet avenir barbare que nous promet son système moribond. Il suffit de lire les études et travaux de ses propres experts pour le constater. Selon le « Rapport sur les risques mondiaux » présenté au Forum économique mondial de Davos de janvier 2023 : « Les premières années de cette décennie ont annoncé une période particulièrement perturbée de l’histoire humaine. Le retour à une “nouvelle normalité” après la pandémie de Covid-19 a été rapidement affecté par l’éclatement de la guerre en Ukraine, inaugurant une nouvelle série de crises alimentaires et énergétiques […]. En ce début d’année 2023, le monde est confronté à une série de risques […] : inflation, crises du coût de la vie, guerres commerciales […], affrontements géopolitiques et spectre de la guerre nucléaire […], niveaux d’endettement insoutenables […], déclin du développement humain […], pression croissante des impacts et des ambitions liés au changement climatique […]. Tous ces éléments convergent pour façonner une décennie unique, incertaine et troublée ».
En réalité, la décennie à venir n’est pas si « incertaine » que cela, puisque selon ce même Rapport : « La prochaine décennie sera caractérisée par des crises environnementales et sociétales […], la “crise du coût de la vie” […], la perte de biodiversité et l’effondrement des écosystèmes […], la confrontation géoéconomique […], la migration involontaire à grande échelle […], la fragmentation de l’économie mondiale, les tensions géopolitiques […]. La guerre économique devient la norme, avec des affrontements croissants entre les puissances mondiales […]. La récente augmentation des dépenses militaires […] pourrait entraîner une course mondiale aux armements […], avec le déploiement ciblé d’armes de nouvelle technologie à une échelle potentiellement plus destructrice que celle observée au cours des dernières décennies ».
Face à cette perspective accablante, la bourgeoisie ne peut qu’être impuissante. Elle et son système ne sont pas la solution, ils sont la cause du problème. Si dans les grands médias, elle cherche à nous faire croire qu’elle met tout en œuvre pour lutter contre le réchauffement climatique, qu’un capitalisme « vert » et « durable » est possible, elle sait l’ampleur de son mensonge. Car, comme le souligne le « Rapport sur les risques mondiaux » : « les niveaux atmosphériques de dioxyde de carbone, de méthane et d’oxyde nitreux ont tous atteint des sommets. Les trajectoires d’émissions rendent très improbable la réalisation des ambitions mondiales visant à limiter le réchauffement à 1,5 °C. Les événements récents ont mis en évidence une divergence entre ce qui est scientifiquement nécessaire et ce qui est politiquement opportun ».
En réalité, cette « divergence » ne se limite pas à la question climatique. Elle exprime la contradiction fondamentale d’un système économique basé non sur la satisfaction des besoins humains mais sur le profit et la concurrence, sur la prédation des ressources naturelles et l’exploitation féroce de la classe qui produit l’essentiel de la richesse sociale : le prolétariat, les travailleurs salariés de tous les pays.
Un autre avenir est-il possible ?
Ainsi, le capitalisme et la bourgeoisie forment l’un des deux pôles de la société, celui qui mène l’humanité vers la misère et la guerre, vers la barbarie et la destruction. L’autre pôle, c’est le prolétariat et sa lutte. Depuis un an, dans les mouvements sociaux qui se développent en France, au Royaume-Uni, en Espagne… travailleurs, retraités, chômeurs, étudiants se serrent les coudes. Cette solidarité active, cette combativité collective, sont les témoins de ce qu’est la nature profonde de la lutte ouvrière : une lutte pour un monde radicalement différent, un monde sans exploitation ni classes sociales, sans concurrence, sans frontières ni nations. « Les ouvriers restent soudés », crient les grévistes au Royaume-Uni. « Soit on lutte ensemble, soit on finira par dormir dans la rue ! », confirment les manifestants en France. La bannière « Pour nous tous » sous laquelle a eu lieu la grève contre la paupérisation en Allemagne, le 27 mars, est particulièrement significative de ce sentiment général qui grandit dans la classe ouvrière : nous sommes tous dans le même bateau et nous luttons tous les uns pour les autres. Les grèves en Allemagne, au Royaume-Uni et en France s’inspirent les unes des autres. En France, des travailleurs se sont explicitement mis en grève par solidarité avec leurs frères de classe en lutte en Angleterre : « Nous sommes solidaires des travailleurs anglais, qui sont en grève depuis des semaines pour l’augmentation des salaires ». Ce réflexe de solidarité internationale est l’exact opposé du monde capitaliste divisé en nations concurrentes, jusqu’à la guerre. Il rappelle le cri de ralliement de notre classe depuis 1848 : « Les prolétaires n’ont pas de patrie ! Prolétaires de tous les pays, unissez-vous ! ».
1968
Ainsi, de par le monde, l’ambiance sociale est en train de changer. Après des décennies d’atonie et de tête basse, à subir, la classe ouvrière commence à retrouver le chemin de sa lutte et de sa dignité. Voilà ce qu’a montré « L’été de la colère » et le retour des grèves au Royaume-Uni, près de quarante ans après la défaite des mineurs face à Thatcher en 1985.
Mais nous ressentons aussi tous les difficultés et les limites actuelles de nos luttes. Face au rouleau compresseur de la crise économique, de l’inflation et des attaques gouvernementales qu’ils nomment « réformes », nous ne parvenons pas encore à établir un rapport de forces en notre faveur. Souvent isolés dans des grèves séparées les unes des autres, ou frustrés de réduire nos manifestations à des marches-défilés, sans rencontres ni discussions, sans assemblées générales ni organisations collectives, nous aspirons tous à un mouvement plus large, plus fort, plus solidaire et unitaire. Dans les cortèges en France, l’appel à un nouveau Mai 68 revient sans cesse. Face à la « réforme » qui repousse l’âge de départ en retraite à 64 ans, le slogan le plus populaire sur les pancartes brandies est : « Tu nous mets 64, on te re-Mai 68 ».
En 1968, le prolétariat en France s’est uni en prenant en mains ses luttes. Suite aux immenses manifestations du 13 mai pour protester contre la répression policière subie par les étudiants, les débrayages et les assemblées générales se sont propagés comme une traînée de poudre dans les usines et tous les lieux de travail pour aboutir, avec ses 9 millions de grévistes, à la plus grande grève de l’histoire du mouvement ouvrier international. Face à cette dynamique d’extension et d’unité de la lutte ouvrière, gouvernement et syndicats se sont empressés de signer un accord de hausse généralisée des salaires afin d’arrêter le mouvement. En même temps que se produisait ce réveil de la lutte ouvrière, on pouvait assister à un retour en force de l’idée de la révolution, laquelle était discutée par de nombreux travailleurs en lutte.
Un événement d’une telle ampleur était le signe d’un changement fondamental dans la vie de la société : c’était la fin de la terrible contre-révolution qui s’était abattue sur la classe ouvrière à partir de la fin des années 1920 avec l’échec de la révolution mondiale ayant suivi sa première victoire d’octobre 1917 en Russie. Une contre-révolution qui avait pris notamment le visage hideux du stalinisme et du fascisme, qui avait ouvert la porte de la Seconde Guerre mondiale avec ses 60 millions de morts et qui s’était poursuivie pendant deux décennies après celle-ci. Et cela s’est confirmé rapidement dans toutes les parties du monde par une série de luttes d’une importance inconnue depuis des décennies :
– L’automne chaud italien de 1969, baptisé aussi « le Mai rampant », qui voit des luttes massives dans les principaux centres industriels et une remise en cause explicite de l’encadrement syndical.
– Le soulèvement des ouvriers de Córdoba en Argentine, la même année.
– Les grèves massives des ouvriers de la Baltique en Pologne, durant l’hiver 1970-71.
– De multiples autres luttes les années suivantes dans pratiquement tous les pays européens, particulièrement au Royaume-Uni.
– En 1980, en Pologne, face à l’augmentation des prix de l’alimentation, les grévistes portaient encore plus loin cette vague internationale en prenant en main leurs luttes, en se rassemblant en d’immenses assemblées générales, en décidant eux-mêmes des revendications comme des actions à mener et, surtout, en ayant pour souci constant d’étendre la lutte. Face à cette force, ce n’est pas simplement la bourgeoisie polonaise qui avait tremblé mais celle de tous les pays.
En deux décennies, de 1968 à 1989, toute une génération ouvrière a acquis une expérience dans la lutte. Ses nombreuses défaites, ses victoires parfois, ont permis à cette génération de se confronter aux nombreux pièges tendus par la bourgeoise pour saboter, diviser, démoraliser. Ses luttes doivent nous permettre de tirer des leçons vitales pour nos luttes actuelles et à venir : seul le rassemblement au sein d’assemblées générales ouvertes et massives, autonomes, décidant réellement de la conduite du mouvement, hors et même contre le contrôle syndical, peut constituer la base d’une lutte unie et qui s’étend, portée par la solidarité entre tous les secteurs, toutes les générations. Des AG dans lesquelles nous nous sentons unis et confiants en notre force collective. Des AG dans lesquelles nous pouvons adopter ensemble des revendications de plus en plus unificatrices. Des AG dans lesquelles nous nous rassemblons et depuis lesquelles nous pouvons partir en délégations massives à la rencontre de nos frères de classe, les travailleurs de l’usine, de l’hôpital, de l’établissement scolaire, du centre commercial, de l’administration... les plus proches.
La nouvelle génération ouvrière, qui aujourd’hui est en train de reprendre le flambeau, doit se rassembler, débattre, pour se réapproprier ces grandes leçons des luttes passées. Les anciens doivent raconter aux jeunes leurs combats, pour que l’expérience accumulée se transmette et devienne une arme dans les luttes à venir.
Et demain ?
Mais il nous faudra aussi aller plus loin. La vague de lutte internationale commencée en Mai 68 était une réaction au ralentissement de la croissance et à la réapparition du chômage de masse. Aujourd’hui, la situation est autrement plus grave. L’état catastrophique du capitalisme met en jeu la survie même de l’humanité. Si nous ne parvenons pas à le renverser, la barbarie va progressivement se généraliser.
L’élan de Mai 68 a été brisé par un double mensonge de la bourgeoisie : lors de l’effondrement des régimes staliniens en 1989-91, elle a prétendu que la faillite du stalinisme signifiait la mort du communisme et qu’une nouvelle ère de paix et de prospérité s’ouvrait. Trois décennies après, nous savons d’expérience qu’en guise de paix et de prospérité, nous avons eu la guerre et la misère. Il nous reste à comprendre que le stalinisme est l’antithèse du communisme, qu’il s’agit d’une forme particulièrement brutale de capitalisme d’État issue de la contre-révolution des années 1920. En falsifiant l’Histoire, en faisant passer le stalinisme pour du communisme (comme hier l’URSS et aujourd’hui la Chine, Cuba, le Venezuela ou la Corée du Nord !), la bourgeoisie est parvenue à faire croire à la classe ouvrière que son projet révolutionnaire d’émancipation ne pouvait que mener à la ruine. Jusqu’à ce que le mot « révolution » lui-même devienne suspect et honteux.
Mais dans la lutte, nous allons peu à peu développer notre force collective, notre confiance en nous-mêmes, notre solidarité, notre unité, notre auto-organisation. Dans la lutte, nous allons peu à peu nous rendre compte que nous, la classe ouvrière, sommes capables d’offrir une autre perspective que la mort promise par un système capitaliste en décomposition : la révolution communiste. La perspective de la révolution prolétarienne va faire son retour dans nos têtes et nos combats.
L’avenir appartient à la lutte de classe !
Courant Communiste International, 22 avril 2023
Vie du CCI:
- Interventions [492]
Situations territoriales:
Récent et en cours:
Rubrique:
Aller plus loin qu’en 1968!
- 326 lectures
Partout dans le monde nous voyons des ouvriers rentrer en lutte… et de nouveau aujourd’hui apparaissent dans les manifestations des références à Mai 68.
Mais cette fois il faudra ALLER PLUS LOIN QU’EN 1968 !
Des luttes internationales en rupture avec la période précédente
Tous les camarades ont certainement vu dans les manifestations ce slogan qui est apparu dans plusieurs villes : "Tu nous mets 64, on te re-Mai 68 !" Cette référence à Mai 68 est le signe qu’il existe une réflexion souterraine dans la classe sur les leçons des luttes passées, ce qui se traduira tôt ou tard par de nouvelles avancées du mouvement.
Nous voulons contribuer à cette réflexion et cela tombe bien car c’est aujourd’hui un jour d’anniversaire. En effet, nous sommes le 13 mai 2023 et il y a tout juste 55 ans, le 13 mai 1968, des manifestations, d’une ampleur jamais vue, eurent lieu dans toute la France à l’appel des grandes centrales syndicales. Elles faisaient suite aux manifestations spontanées qui, le samedi 11 mai, avaient protesté énergiquement contre la répression extrêmement violente qu’avaient subie les étudiants la veille. Cette mobilisation oblige la bourgeoisie à reculer. Pompidou annonce que les forces de l’ordre seront retirées du Quartier latin, que la Sorbonne sera rouverte et que les étudiants emprisonnés seront libérés. Les discussions se multiplient partout, pas seulement sur la répression mais aussi sur les conditions de travail des ouvriers, l’exploitation, l’avenir de la société. Ces manifestations du 13 mai en solidarité avec les étudiants sont appelées par des syndicats qui sont dans un premier temps débordés et qui cherchent à reprendre le contrôle du mouvement.
Ces manifestations représentent un tournant, non seulement par leur ampleur mais surtout parce qu’elles annoncent l’entrée en scène de la classe ouvrière. Le lendemain, les ouvriers de Sud-Aviation à Nantes déclenchent une grève spontanée. Ils seront suivis par un mouvement de masse qui atteindra les 9 millions de grévistes le 27 mai. C’était la plus grande grève du l’histoire du mouvement ouvrier international. Partout on revendique, on s’indigne, on se politise, on discute, dans les manifestations, les assemblées générales et les comités d’action qui naissent comme des champignons.
Même si c’est en France que le mouvement est allé le plus loin, il s’inscrivait dans une série de luttes internationales qui ont touché de nombreux pays dans le monde. Ces luttes internationales étaient le signe d’un changement fondamental dans la vie de la société, elles marquaient une rupture avec la période précédente : c’était la fin de la terrible contre-révolution qui s’était abattue sur la classe ouvrière suite à l’échec de la vague révolutionnaire mondiale initiée par le succès de la révolution de 1917 en Russie.
Même si ce n’est pas avec la même ampleur, il se produit à nouveau aujourd’hui une telle rupture avec la période précédente. Partout dans le monde, on voit des ouvriers entrer en lutte contre des conditions de vie et de travail insupportables, en particulier contre l’inflation qui réduit les salaires comme une peau de chagrin. On lit sur les pancartes et les banderoles : « Trop c’est trop ! » au Royaume-Uni ; « Pas une année de plus, pas un euro de moins » en France ; « L’indignation vient de loin » en Espagne ; « Pour nous tous » en Allemagne.
Au Danemark, au Portugal, aux Pays-Bas, aux États- Unis, au Canada, au Mexique, en Chine et en ce moment en Suède où se déroule une grève sauvage chez les conducteurs de trains de banlieue à Stockholm ; dans de nombreux pays, ce sont les mêmes grèves contre la même exploitation, comme le résument très bien les ouvriers anglais : « La vraie galère : [c’est] ne pas pouvoir se chauffer, manger, se soigner, se déplacer ! » La rupture à laquelle nous assistons aujourd’hui, c’est la reprise d’une dynamique de luttes internationales après des décennies de recul de la combativité et de la conscience dans la classe ouvrière. En effet, la faillite du stalinisme en 1989-91 avait été l’occasion de vastes campagnes idéologiques sur l’impossibilité d’une alternative au capitalisme, sur l’éternité de la démocratie bourgeoise comme unique régime politique viable. Ces campagnes ont eu un très fort impact sur une classe ouvrière qui n’avait pas réussi à pousser plus loin la politisation de ses luttes.
Révolution communiste ou destruction de l’humanité
Dans les manifestations en France, on a commencé à lire sur quelques pancartes le refus de la guerre en Ukraine, le refus de se serrer la ceinture au nom de cette économie de guerre : « Pas de sous pour la guerre, pas de sous pour les armes, des sous pour les salaires, des sous pour les retraites ».
Même si ce n’est pas toujours clair dans la tête des manifestants, seul le combat du prolétariat sur son terrain de classe peut être un rempart contre la guerre, contre cette dynamique autodestructrice, un rempart face à la mort que promet le capitalisme à toute l’humanité. Car, laissé à sa seule logique, ce système décadent va entraîner des parties de plus en plus larges de l’humanité dans la guerre et la misère, il va détruire la planète à coups de gaz à effet de serre, de forêts rasées et de bombes.
Comme le dit la première partie du titre de notre 3ème manifeste : « Le capitalisme mène à la destruction de l’humanité… » La classe qui dirige la société mondiale, la bourgeoisie, a en partie conscience de cette réalité, de cet avenir barbare que nous promet son système moribond. Il suffit de lire les études et travaux de ses propres experts pour le constater. Notamment le « Rapport sur les risques mondiaux » présenté au Forum économique mondial de Davos de janvier 2023 et que nous avons largement cité dans notre dernier tract [1].
Face à cette perspective accablante, la bourgeoisie ne peut qu’être impuissante. Elle et son système ne sont pas la solution, ils sont la cause du problème. Si dans les grands médias, la bourgeoisie cherche à nous faire croire qu’elle met tout en œuvre pour lutter contre le réchauffement climatique, qu’un capitalisme « vert » et « durable » est possible, elle sait très bien que ce sont des mensonges.
En réalité, le problème ne se limite pas à la question climatique. Il exprime la contradiction fondamentale d’un système économique basé NON sur la satisfaction des besoins humains mais sur le profit et la concurrence, sur la prédation des ressources naturelles et l’exploitation féroce de la classe qui produit l’essentiel de la richesse sociale : le prolétariat, les travailleurs salariés de tous les pays. Ainsi, le capitalisme et la bourgeoisie constituent l’un des deux pôles de la société, celui qui mène l’humanité vers la misère et la guerre, vers la barbarie et la destruction. L’autre pôle, c’est le prolétariat et sa lutte de résistance au capitalisme devant déboucher sur son renversement.
Ces réflexes de solidarité active, cette combativité collective que nous voyons aujourd’hui, sont les témoins de la nature profonde de la lutte ouvrière destinée à assumer une lutte pour un monde radicalement différent, un monde sans exploitation ni classes sociales, sans concurrence, sans frontières ni nations. « Soit on lutte ensemble, soit on finira par dormir dans la rue ! », confirment les manifestants en France. La bannière « Pour nous tous » sous laquelle a eu lieu la grève contre la paupérisation en Allemagne, le 27 mars, est particulièrement significative de ce sentiment général qui grandit dans la classe ouvrière : « nous sommes tous dans le même bateau » et nous luttons tous les uns pour les autres. Les grèves en Allemagne, au Royaume-Uni et en France s’inspirent les unes des autres. Par exemple, en France, les travailleurs du Mobilier national, avant l’annulation de la visite de Charles III, se sont explicitement mis en grève par solidarité avec leurs frères de classe en Angleterre : « Nous sommes solidaires des travailleurs anglais, qui sont en grève depuis des semaines pour l’augmentation des salaires ». Ce réflexe de solidarité internationale, même s’il est encore embryonnaire, est l’exact opposé du monde capitaliste divisé en nations concurrentes, jusqu’à la guerre. Il rappelle le cri de ralliement de notre classe depuis 1848 : « Les prolétaires n’ont pas de patrie ! Prolétaires de tous les pays, unissez-vous ! ».
Pourquoi faut-il aller plus loin qu’en Mai 68 ?
Mais nous ressentons aussi tous les difficultés et les limites actuelles de ces luttes. Face au rouleau compresseur de la crise économique, de l’inflation et des attaques gouvernementales qu’ils nomment « réformes », les ouvriers ne parviennent pas encore à établir un rapport de forces en leur faveur. Souvent isolés par les syndicats dans des grèves séparées les unes des autres, ils sont frustrés de réduire les manifestations à des marches-défilés, sans rencontres ni discussions ni organisation collective, souvent ils aspirent tous à un mouvement plus large, plus fort, plus solidaire et unitaire. Dans les cortèges en France, l’appel à un nouveau Mai 68 revient régulièrement.
Effectivement, il faut reprendre les méthodes de luttes qu’on a vu s’affirmer dans toute la période qui commence en 1968. Un des meilleurs exemples est celui de la Pologne en 1980. Face à l’augmentation des prix de l’alimentation, les grévistes portaient encore plus loin cette vague internationale en prenant en main leurs luttes, en se rassemblant en d’immenses assemblées générales, en centralisant les différents comités de grève grâce au MKS, le comité inter-entreprises. Ainsi dans toutes ces assemblées, les ouvriers décidaient eux-mêmes des revendications comme des actions à mener et, surtout, avaient pour souci constant d’étendre la lutte. Face à cette force, nous savons que ce n’est pas simplement la bourgeoisie polonaise qui avait tremblé mais celle de tous les pays.
En deux décennies, de 1968 à 1989, toute une génération ouvrière a acquis une expérience dans la lutte. Ses nombreuses défaites, ses victoires parfois, ont permis à cette génération de se confronter aux nombreux pièges tendus par la bourgeoise pour saboter, diviser, démoraliser. Ses luttes doivent nous permettre de tirer des leçons vitales pour nos luttes actuelles et à venir : seul le rassemblement au sein d’assemblées générales ouvertes et massives, autonomes, décidant réellement de la conduite du mouvement, en contestant et neutralisant le contrôle syndical dès que possible, peut constituer la base d’une lutte unie et qui s’étend, portée par la solidarité entre tous les secteurs.
Lors de la diffusion du dernier tract, un manifestant nous a exprimé son accord sur les méthodes de lutte qu’il fallait reprendre, mais il était sceptique sur le titre. « Aller plus loin qu’en 68 ? Si nous faisions comme en 68 ce serait déjà pas mal, nous a-t-il dit. » Si ! Il faut aller plus loin qu’en 68 car les enjeux ne sont plus les mêmes. La vague de lutte internationale commencée en Mai 68 était une réaction aux premiers signes de la crise et à la réapparition du chômage de masse. Aujourd’hui, la situation est autrement plus grave. L’état catastrophique du capitalisme met en jeu la survie même de l’humanité. Si la classe ouvrière ne parvient pas à le renverser, la barbarie va progressivement se généraliser.
L’élan de Mai 68 a été brisé par un double mensonge de la bourgeoisie : lors de l’effondrement des régimes staliniens en 1989-91, elle a prétendu que la faillite du stalinisme signifiait la mort du communisme et qu’une nouvelle ère de paix et de prospérité s’ouvrait. Trois décennies après, nous savons d’expérience qu’en guise de paix et de prospérité, nous avons eu la guerre et la misère, que le stalinisme est l’antithèse du communisme (comme hier l’URSS et aujourd’hui la Chine, Cuba, le Venezuela ou la Corée du Nord !). En falsifiant l’histoire, la bourgeoisie est parvenue à faire croire à la classe ouvrière que son projet révolutionnaire d’émancipation ne pouvait que mener à la ruine. Jusqu’à ce que le mot « révolution » lui-même devienne suspect et honteux. Mais dans la lutte, les ouvriers peuvent peu à peu développer leur propre force collective, la confiance en eux-mêmes, la solidarité, leur unité, l’auto-organisation. La lutte permet peu à peu à la classe ouvrière de se rendre compte qu’elle est capable d’offrir une autre perspective que la mort promise par un système capitaliste en décomposition : la révolution communiste. La perspective de la révolution prolétarienne va faire son retour dans la tête et les combats à venir. Cette fois l’idée de révolution de Mai 68 est en train de se transformer en enjeu pour l’humanité. Face au spectacle du capitalisme en décomposition où règne le « no future », nous proclamons : « L’avenir appartient à la lutte de classe ! »
Pour finir, il nous semble que la situation présente fait émerger un certain nombre de questions que nous avons essayé d’illustrer dans cet exposé :
- Les luttes ouvrières actuelles à l’échelle internationale représentent-elles une rupture avec la période précédente, une reprise de la lutte de classe qui va maintenant se développer ?
- Le monde capitaliste d’aujourd’hui est-il marqué par des phénomènes de décomposition sociale qui peuvent conduire à la destruction de l’humanité ?
- Quelles sont les principales faiblesses du mouvement actuel ?
- Pourquoi est-il nécessaire d’aller plus loin qu’en Mai 68 ?
Venez discuter des leçons de Mai 68 pour les luttes d’aujourd’hui !
Lille : le 13 mai à 15h00, au café « Waz », 54 rue des Sarrazins (Métro « Gambetta »).
Lyon : le 13 mai à 15H00, Salle 5, 1er étage, CCO Jean-Pierre Lachaize, 39 rue G.Courteline - Villeurbanne.
Paris : le 27 mai à 15h00, au CICP, 21ter rue Voltaire, 11e arrondissement (Métro « Rue des boulets »).
Marseille : le 27 mai à 15h00, Local « Mille Babords », 61 rue Consolat.
Nantes : le 13 mai à 15H00, Salle de la Fraternité, 3 rue de l'Amiral Duchaffault, 44100 Nantes, (Station de Tramway "Duchaffault", ligne 1).
Toulouse : le 13 mai, à 14H00, Salle Castelbou 22 rue Léonce Castelbou à Toulouse, (Métro "Compas Caffarelli").
[1] . Pour la discussion : Sur BFM TV, Robert Badinter tirait lui aussi la sonnette d’alarme : Si un hélicoptère s’écrasait sur l’un des réacteurs de la centrale nucléaire de Zaporija, la catastrophe serait encore pire que Tchernobyl.
Rubrique:
ICConline - mai 2023
- 57 lectures
Les ouvriers n'ont aucun camp bourgeois à choisir!
- 88 lectures
Depuis plusieurs mois, les principales villes d’Israël sont le théâtre de manifestations mobilisant des centaines de milliers de personnes pour protester contre les propositions du gouvernement Netanyahou de « réformer » la Cour suprême, qu’il considère comme un obstacle à sa politique. Mais ces manifestations, organisées sous la bannière de la défense de la démocratie et du « vrai » patriotisme israélien, n’offrent qu’une fausse alternative à la classe ouvrière. Cet article a été rédigé alors que les manifestations battaient leur plein, mais nous pensons que la pause actuelle dans les mobilisations de rue ne devrait pas durer longtemps.
Dans la phase terminale de la décadence du capitalisme, la classe dirigeante s’enlise de plus en plus dans la corruption et l’irrationalité. Elle est de moins en moins capable de contrôler son propre appareil politique, étant de plus en plus déchirée par des rivalités entre factions. La vie politique dans l’État d’Israël exprime toutes ces tendances sous une forme exacerbée.
Le gouvernement de Netanyahou est accusé de pots-de-vin et de corruption. Une des motivations de son gouvernement pour tenter de réduire l’autorité de la Cour suprême est d’empêcher les poursuites à son encontre. Comme Trump aux États-Unis, il est plus que disposé à utiliser sa fonction pour un gain personnel évident.
En outre, le gouvernement dirigé par le Likoud de Netanyahou ne peut survivre que parce qu’il est soutenu par des groupes ultra-religieux et le parti néo-fasciste du Pouvoir juif, qui sont unis derrière une volonté d’annexer ouvertement les territoires occupés en 1967, en justifiant ce dessein par des appels à la Torah. L’attitude de ces organisations à l’égard de la situation des femmes, des homosexuels et des Arabes palestiniens exprime, à l’instar de leurs ennemis islamistes détestés, une descente accélérée dans l’irrationalité et l’obscurantisme.
Le projet du gouvernement Netanyahou de museler la Cour suprême est donc également motivé par l’abandon explicite de toute solution « à deux États » pour le problème israélo-palestinien et la création d’un État purement juif du Jourdain à la mer. Ce qui implique nécessairement l’assujettissement et peut-être la déportation massive de la population palestinienne.
Toutefois, ces propositions ont provoqué des manifestations massives et soutenues durant plusieurs semaines. Celles-ci ont obligé Netanyahou à suspendre son plan et à faire un compromis avec ses partisans encore plus à droite au sein du gouvernement, en accordant au Pouvoir juif un certain nombre de postes dans le futur gouvernement. Le point le plus controversé est la formation d’une sorte de milice privée sous le contrôle direct du chef du Pouvoir juif, Itamar Ben-Gvir. Cette milice serait chargée du maintien de l’ordre en Cisjordanie. En pratique, elle servirait de couverture aux faits accomplis par les colons armés (un rôle déjà joué par les forces militaires et policières en place, mais qui provoque toutes sortes de dissensions entre les différentes branches de l’État).
Un conflit au sein de la bourgeoisie
Le mouvement de protestation a récemment inclus des grèves de travailleurs dans les aéroports, les d’hôpitaux, des municipalités et autres. Mais il ne s’agit pas d’un mouvement de la classe ouvrière contre l’exploitation capitaliste. Dans la plupart des cas, les grèves étaient plutôt des lock-out, soutenus par les employeurs. Les hauts responsables de l’appareil politique, militaire et de renseignement ont également fortement soutenu les manifestations, toujours ornées de drapeaux israéliens, et qui dénoncent l’assaut du gouvernement contre la Cour suprême comme une attaque contre la démocratie, voire comme un acte « antisioniste ». Les Arabes israéliens et palestiniens, qui ont déjà une connaissance de première main des délices de la démocratie israélienne, sont restés largement à l’écart des manifestations. Si de nombreux manifestants expriment des craintes réelles quant à leur avenir sous le nouveau régime politique, il ne fait aucun doute que ce mouvement est entièrement dominé par l’affrontement entre des forces bourgeoises rivales.
Le fait qu’il s’agisse d’un conflit au sein de la bourgeoisie est encore souligné par la critique des plans du gouvernement par le président américain Biden et d’autres dirigeants occidentaux. Les politiques provocatrices du gouvernement Netanyahou à l’égard des territoires occupés ne sont pas en accord avec la politique étrangère américaine actuelle. Celle-ci visant à se présenter comme une force de paix et de réconciliation dans la région et qui adhère toujours, verbalement en tout cas, à la solution des deux États. Netanyahou a répondu en insistant sur le fait que l’amitié entre les États-Unis et Israël est indéfectible, mais qu’aucune puissance étrangère ne peut dire à Israël ce qu’il doit faire. En somme, il exprime la tendance générale au chacun pour soi en politique internationale. Déjà, le soutien manifeste du gouvernement à l’expansion de facto par l’intermédiaire des colons a provoqué une nouvelle série d’affrontements armés en Cisjordanie et la crainte d’une nouvelle intifada.
Les illusions envers la démocratie israélienne
Les forces politiques de gauche et libérales de la classe dirigeante, qui soutiennent les manifestations et exigent le retour à une véritable démocratie en Israël, n’ont jamais hésité à travailler main dans la main avec les forces de droite lorsqu’il s’agissait de défendre les intérêts de l’État sioniste. Un exemple bien connu : pendant la guerre de 1948, c’est l’Irgoun (1) de droite commandée par Begin et le groupe Lehi ou gang Stern qui ont été le plus directement impliqués dans l’atroce massacre des Arabes palestiniens à Deir Yassin en avril 1948, où des dizaines, voire des centaines de civils ont été tués de sang-froid.
La force armée contrôlée par le « sionisme travailliste », la Haganah, et le nouvel État indépendant qu’elle a établi par la force des armes, ont officiellement condamné le massacre, mais cela n’a pas empêché la coopération avec les forces d’élite de la Haganah (2) à Deir Yassin. Plus important encore, non seulement les forces officielles ont participé à la destruction d’autres villages, mais elles n’ont pas hésité à tirer profit de la terreur exercée sur les Arabes palestiniens, poussés à quitter la Palestine par centaines de milliers, en résolvant ainsi le problème de l’établissement d’une majorité juive « démocratique ». Par la suite, ces réfugiés ont croupi dans des camps pendant des décennies et n’ont jamais été autorisés à rentrer chez eux. Ils n’en ont pas moins été opprimés par les États arabes, qui les ont utilisés comme un casus belli permanent contre Israël. Quant à la gauche sioniste plus radicale, à l’image d’une organisation comme la Jeune garde (Hashomair Hatzair), et plus largement le mouvement des kibboutz, loin d’établir une enclave socialiste en Israël, leurs fermes collectives ont incarné les bases militaires les plus efficaces dans la formation du nouvel État.
Depuis les années 1970, si la droite sioniste (Begin, Sharon, Netanyahou, etc.) domine de plus en plus la politique israélienne, c’est parce qu’elle tend à représenter la solution la plus décomplexée au problème de la relation d’Israël avec la Palestine dans son ensemble : la force nue, un camp militaire permanent, des lois d’apartheid. Mais cela a toujours été la logique interne du sionisme, avec sa fausse promesse originelle d’une « terre sans peuple pour un peuple sans terre ».
L’hypocrisie de la gauche antisioniste
Il n’est donc pas difficile pour les factions bourgeoises « antisionistes », telles que les trotskistes et les partisans de la « lutte nationale palestinienne », de prouver que le projet sioniste ne pouvait réussir que sous une forme de colonialisme, soutenu d’ailleurs par l’une ou l’autre des grandes puissances impérialistes : d’abord les Britanniques avec leur politique fourbe de « diviser pour mieux régner » en Palestine, (3) puis les États-Unis dans leurs efforts pour déloger les Britanniques de la région, et même l’URSS stalinienne à l’époque de la guerre de 1948.
Mais les gauchistes qui ont soutenu d’abord les groupes de libération palestiniens (OLP, FPLP, PDFLP, etc.) puis les islamistes du Hamas et du Hezbollah, ne nous disent pas l’autre côté de l’histoire. Comme tous les nationalismes à l’époque de la décadence capitaliste, le nationalisme palestinien participe pleinement à la logique de l’impérialisme, notamment depuis les liens établis par le Mufti de Jérusalem avec les impérialismes allemand et italien dans les années 1930 jusqu’au soutien de l’OLP par les régimes arabes régionaux ainsi que par la Russie et la Chine, et le soutien des gangs islamistes par l’Iran, le Qatar et d’autres. En soutenant les « nations opprimées », ils se font les apologistes des pogroms anti-juifs et des attentats terroristes perpétrés par l’opposition nationaliste au sionisme. Et ce depuis les premières réactions à la déclaration Balfour au début des années 1920 et la « grève générale » de 1936 contre l’immigration juive en Palestine, jusqu’aux agressions violentes contre des civils juifs (au couteau, à l’arme à feu ou à la roquette) encore perpétrées par des agents ou des partisans du Hamas et d’autres groupes islamistes.
Les porte-parole de la classe dirigeante qui répandent des illusions sur la paix au Moyen-Orient dénoncent souvent la « spirale de la violence » qui oppose sans cesse Juifs et Arabes dans la région. Mais cette spirale de la haine et de la vengeance fait partie intégrante de tous les conflits nationaux, dès lors que l'« ennemi » est défini comme une population entière. Pour sortir de ce piège mortel, il n’y a qu’une seule voie : celle qu’a tracée la Gauche communiste italienne dans les années 1930 : « Pour les vrais révolutionnaires, il n’y a naturellement pas de question “palestinienne”, mais seulement la lutte de tous les exploités du Proche-Orient, Arabes et Juifs compris, qui fait partie d’une lutte plus générale de tous les exploités du monde entier pour la révolution communiste ».
Mais près d’un siècle plus tard, les guerres et les massacres incessants dans la région ont montré les immenses obstacles au développement d’une unité de classe entre prolétaires juifs et arabes, à la lutte pour la défense de leurs conditions de vie, et à l’ouverture d’une perspective de lutte pour une nouvelle société où l’exploitation et l’État n’existeraient plus. Plus que jamais, une telle perspective aura pour impulsion les pays centraux du capitalisme, où la classe ouvrière dispose d’un potentiel bien plus important pour surmonter les divisions que lui impose le capital, et ainsi porter l’étendard de la révolution avec les travailleurs du monde entier.
Amos, 22 avril 2023
1 Organisation armée de la droite sioniste née en 1931 d’une scission au sein de la Haganah.
2 Organisation armée la plus importante du mouvement sioniste entre 1920 et 1948. Elle servit d’ossature à la création de l’armée israélienne (« Tsahal ») à partir de 1948.
3 Cf. l’analyse de ces manœuvres impérialistes dans la revue de la Gauche communiste italienne, Bilan, en 1936 : « Le conflit Juifs / Arabes : La position des internationalistes dans les années trente : Bilan n° 30 et 31 », Revue internationale n°110, (3 [586]e [586] trimestre 2002). [586]
Géographique:
Personnages:
- Netanyahou [587]
Rubrique:
140 ans de la mort de Karl Marx
- 128 lectures
Le 14 mars 1883, il y a 140 ans, disparaissait Karl Marx, un militant et combattant révolutionnaire de premier plan. Présenté par la bourgeoisie tantôt comme un “philosophe” ou un “économiste”, tantôt comme le diable en personne, il a été tout au long de sa vie traqué et calomnié par ses détracteurs et les forces de police. Souvent présenté à tort comme une icône inoffensive ou un penseur “dépassé”, il lègue au contraire une contribution solidement basée sur la méthode du matérialisme historique qui, une fois débarrassée des déformations dont l’ont affublé les staliniens et les gauchistes, constitue une arme fondamentale au service de la lutte du prolétariat pour son émancipation. Ses capacités souvent méconnues d’organisateur de talent, ses polémiques, son tranchant et sa plume aiguisée, en font un des plus grands révolutionnaire de son temps. Nous publions ci-dessous une série d’articles qui lui sont dédiés.
A) https://fr.internationalism.org/icconline/201806/9718/200-ans-karl-marx-militant-revolutionnaire [588]
B) https://fr.internationalism.org/rinte33/marx.htm [589]
D) https://fr.internationalism.org/ri406/qu_est_ce_que_le_marxisme.html [591]
E) https://fr.internationalism.org/content/9729/bicentenaire-karl-marx-combattant-classe-ouvriere [592]
F) https://fr.internationalism.org/rinte69/communisme.htm [593].
Personnages:
- Karl Marx [597]
Rubrique:
Bulletin de discussion de groupes de la Gauche communiste
- 214 lectures
Au début de la guerre en Ukraine, le Courant Communiste International a proposé aux autres groupes de la Gauche communiste une déclaration commune internationaliste [438] sur le conflit. Trois de ces groupes ont affirmé leur volonté de participer et une déclaration a été discutée, approuvée et publiée par ces différents groupes. Le principe de la déclaration commune était que sur la question fondamentale de la guerre impérialiste et de la perspective internationaliste, les différents groupes de la Gauche communiste étaient d’accord et pouvaient s’unir pour fournir, avec plus de force, une alternative politique claire à la barbarie capitaliste pour la classe ouvrière dans les différents pays.
L’autre aspect de la déclaration commune était que sur d’autres questions, en particulier sur l’analyse de la guerre impérialiste actuelle, ses origines et ses perspectives, il existait des différences entre les groupes constitutifs qui devaient être discutées et clarifiées. En conséquence, les groupes ont décidé d’élaborer de brèves déclarations sur ces questions et de les publier dans un bulletin.
Nous invitons nos lecteurs à consulter ce premier Bulletin de discussion [598] en anglais. Ce document sera prochainement traduit en français.
Récent et en cours:
- Guerre en Ukraine [397]
Courants politiques:
- Gauche Communiste [163]
Rubrique:
En Argentine, la crise frappe les travailleurs
- 72 lectures
Face aux attaques incessantes contre leurs conditions de vie, les travailleurs argentins répondent avec une combativité de plus en plus forte. La bourgeoisie en argentine se prépare à une possible vague de grèves dans différents secteurs. C’est pourquoi, avec le soutien des syndicats et du gouvernement, elle prend des mesures pour étouffer immédiatement toute expression de colère face à la précarité et aux effets de l’inflation provoquée par le capitalisme à l’échelle mondiale.
L’Argentine est actuellement le pays de la région sud-américaine où l’inflation est la plus élevée après le Venezuela. Fin 2022 le taux d’inflation a atteint 94 %, le plus élevé depuis 1991 ! La guerre en Ukraine, (1) après la pandémie du Covid-19, a eu des conséquences brutales. L’inflation entraîne une détérioration accrue des conditions matérielles de la population, mais aggrave davantage celles de la classe ouvrière dans tous les pays. L’inflation érode son pouvoir d’achat alors que les salaires n’augmentent pas. Ce n’est pas un hasard si le 26 août dernier, le gouvernement argentin a officialisé une augmentation de 21 % du salaire minimum, en trois tranches, passant de 47 850 pesos par mois (environ 200 euros) à 57 900 pesos (243 euros) à partir de novembre de cette année. (2)
Face à la crise qui frappe l’Argentine, de nombreuses luttes ont eu lieu ces derniers mois, comme celle des ouvriers des entreprises de pneumatiques Bridgestone, Fate et Pirelli. L’industrie automobile argentine a été paralysée pendant plusieurs mois, ce qui a affecté la production de ces usines. Après une longue négociation entre le syndicat Sutna, (3) les entreprises et le gouvernement, un accord a été conclu sur une liste de revendications pour augmenter les salaires des travailleurs affiliés à Sutna. (4) Une augmentation de salaire qui se fera de manière échelonnée, en plus du fait que les entreprises se sont engagées à donner une prime extraordinaire à chaque travailleur de 100 000 pesos (421 euros environ).
La bourgeoisie argentine se prépare à une éventuelle vague de grèves dans différents secteurs. C’est pourquoi elle avance ses mesures avec le soutien des syndicats et du gouvernement pour tenter de contrôler la colère qui pourrait surgir face à la précarité et aux effets de l’inflation provoquée par la crise économique mondiale. Et même si ces mesures d’augmentations salariales par tranches sont très à la mode ces derniers temps, elles ne suffiront pas à contenir la perte de pouvoir d’achat causée par l’inflation dans tous les pays du monde, y compris en Argentine.
Partis, syndicats, Piqueteros et gouvernement : tous contre la classe ouvrière
Comme nous l’avons vu précédemment avec les luttes des ouvriers des pneumatiques, il existe d’autres luttes qui se déroulent depuis avant la pandémie, mais qui sont étouffées, contrôlées par les partis, les syndicats, les piqueteros et le gouvernement, montrant comment ils agissent tous de manière coordonnée contre les travailleurs.
Au début de l’année 2022, l’agence de presse allemande DW a déclaré : « Le président de l’Argentine, Alberto Fernandez, a annoncé ce vendredi qu’un “accord” a été conclu avec le Fonds monétaire international (FMI) pour refinancer le prêt de plus de 44 millions de dollars que le FMI avait accordé au pays en 2018 quand le libéral Mauricio Macri était à la tête du gouvernement ». (5)
Anticipant et devançant cette annonce au début du mois de janvier 2022, Eduardo Belliboni, leader du Polo Obrero et chef de l’Unidad Piquetera, annonçait déjà que l’année 2022 serait beaucoup plus mouvementée que l’année 2021. Et c’est ce qui s’est passé. « La plus grande mobilisation revendicative contre le gouvernement d’Alberto Fernández », appelée « marche fédérale », a été préparée par des organisations et des mouvements sociaux (Coordinadora por el Cambio Social, Polo Obrero (PO), Movimiento Barrios de Pie (MBP), etc. La mobilisation, qui est partie de différents États, a débuté le 10 mai dans les villes de La Quiaca et d’Ushuaia et s’est achevée le jeudi 12 dans la capitale Buenos Aires.
Les slogans de l’appel étaient : « Pour le travail et les salaires ; contre la faim et la pauvreté ». Eduardo Belliboni a déclaré : « La marche fédérale des piqueteros est en train de devenir une marche des travailleurs contre l’accord salarial et pour leurs revendications. Elle rassemble les chômeurs, les salariés et les retraités, les principaux syndicats étant en première ligne… Une perspective d’unité et de lutte s’ouvre pour le mouvement populaire avec le début de cette grande marche fédérale qui soutient les revendications élémentaires d’une classe ouvrière frappée par l’accord du gouvernement avec le FMI… Nous exigeons un véritable travail et un salaire équivalent au panier de la ménagère qui nous permet de vivre. Nous marchons contre la faim et la pauvreté qui atteignent des niveaux scandaleux en Argentine ».
La « protestation » a « trouvé » son prétexte dans la décision du gouvernement de ne pas étendre le programme « Favoriser l’accès à l’emploi » à un plus grand nombre de bénéficiaires, actuellement environ 1.200.000 personnes recevant 19.470 pesos par mois (équivalent à environ 85 euros).
Ces manifestations de protestation apparaissent alors que quelque chose émerge de plus en plus clairement dans la réalité argentine : les différentes factions bourgeoises s’affrontent de plus en plus ouvertement dans la perspective des élections législatives de novembre. Les factions bourgeoises défendant le péronisme au sein de la « Casa Rosada » se divisent entre ceux qui continuent à soutenir le « Kirshnerisme » et les autres fractions autour de Fernández, une lutte qui dure depuis des années. Le couple présidentiel ne se parle plus depuis deux mois et s’insulte ouvertement. Les porte-parole informels de l’ancienne présidente qualifient Fernández d’usurpateur et lui rappellent qu’il occupe temporairement ce poste. « Le gouvernement est à nous », prévient avec arrogance Andrés Larroque, ministre de la province de Buenos Aires et homme fort de La Cámpora, le groupe dirigé par Máximo Kirchner, le fils de Cristina. « Personne ne possède le gouvernement, le gouvernement appartient au peuple », a répondu Fernández, sans passer par des intermédiaires. À la veille de ces élections de novembre, la lutte pour le pouvoir exacerbe les luttes entre les différentes factions bourgeoises : les péronistes, les modérés du centre, les droitiers autour de Macri et l’émergence d’un populiste nationaliste « psychédélique » auto-décrit comme « libertarien », comme Javier Milei, qui se présente comme anti-socialiste, anti-communiste, anti-péroniste, anti-partis politiques traditionnels, et se déclare ouvertement un admirateur inconditionnel de Trump et de Bolsonaro.
Nous le disons depuis longtemps à propos du mouvement piquetero : « entre juin et août [2005], nous avons assisté à la plus grande vague de grèves depuis 15 ans ». Nous disions cela parce que le prolétariat argentin se montrait combatif, se battait sur son terrain de classe et montrait une tendance à se reconnaître comme prolétaire, et était en train de retrouver sa propre identité de classe. Dans le même article, nous analysions et dénoncions comment ces luttes ouvrières, qui se redressaient difficilement, étaient encore très faibles et étaient éclipsées par « un affrontement bruyant et hyper-médiatisé entre les organisations piqueteros et le gouvernement ». (6)
Les piqueteros, mouvement essentiellement composé de chômeurs, après les luttes interclassistes de la fin 2001, ont acquis une grande notoriété grâce aux médias de masse, qui les ont catapultés sur le devant de la scène politique comme les véritables porte-drapeaux des « justes luttes » du peuple en quête d’amélioration de ses conditions de vie. À cette manipulation de l’État bourgeois se sont joints les co-participants à la mystification des luttes ouvrières. Nous faisons référence à tous ces groupes gauchistes : staliniens, trotskistes, maoïstes, etc, contribuant à leur donner un soutien pseudo-théorique révolutionnaire progressiste, trompant et confondant encore plus ces travailleurs sans emploi et les secteurs extrêmement appauvris de la société, les conduisant dans l’impasse du parlementarisme, de la démocratie et des élections, soutenant l’un ou l’autre messie de la bourgeoisie, comme ce fut le cas à l’époque avec Kirshner. (7)
Depuis la fin 2001, année après année, les piqueteros ont mené des mobilisations visant toujours à réclamer plus de ressources économiques pour les programmes d’aide sociale destinés à vaincre la précarité, ou à renforcer les programmes et les politiques sociales qui rendent les emplois précaires supportables, sans réellement rien changer aux conditions de vie des travailleurs. Et pour quel résultat ? Absolument rien. L’Argentine est l’un des pires pays de la région en termes de conditions de vie et de salaires. Elle est même souvent comparée au Venezuela. Les travailleurs souffrent de l’inflation et de la précarité. La bourgeoisie argentine, par le biais de tous ses appareils, y compris les « organisations populaires », soumet l’ensemble de la société et en particulier la classe ouvrière à toujours plus de sacrifices. Et pour faciliter ce travail, il y a les organisations syndicales, les partis politiques de la soi-disant gauche et tout cet assortiment hétéroclite d’organisations populaires qui travaillent idéologiquement et politiquement, introduisant de faux principes et de fausses idées, conduisant doucement les travailleurs là où la bourgeoisie veut les amener : debout ou assis, criant contre le FMI, contre le gouvernement en place, défendant la démocratie et la patrie. Les emmener aux urnes, parier leur vie sur le Messie du jour.
Il est clair que le FMI est un instrument du capitalisme, en particulier des pays les plus forts de la planète contre les plus faibles. Cependant, l’exploitation est celle de tous les capitalistes du monde sur tous les travailleurs du monde. En d’autres termes, non seulement le FMI, le capitalisme américain, etc., mais aussi le capitalisme argentin et l’État argentin sont pleinement impliqués dans l’exploitation de la classe ouvrière.
Présenter une opposition « anti-impérialiste » au FMI pour lier le prolétariat argentin à la nation, au capital argentin, à la défense de l’exploitation avec la couleur bleue et blanche du drapeau argentin, est un sale tour de passe-passe. Les mobilisations des piqueteros, du Polo Obrero, des péronistes, des syndicats, présentent un choix entre capitalistes : soit le bourreau FMI, soit le bourreau capitaliste argentin soi-disant « indépendant ».
Le FMI est un instrument du capitalisme, qui fait son travail, tout comme le gouvernement des Kirshner, des Fernandez, des Macri, comme l’ont été tous les gouvernements précédents. Ses partenaires sont tous les partis politiques, de la droite à la gauche, y compris tous ceux qui rejoignent le courant populiste et « psychédélique » de Milei, ainsi que les syndicats et les piqueteros. Leur seul but : empêcher le prolétariat de se battre sur son propre terrain de classe.
Par conséquent, il est très clair que ce mouvement orchestré par « La Unidad Piquetera » est un mouvement qui joue contre les intérêts de classe du prolétariat argentin. Son activité le plonge dans une plus grande confusion. Ses méthodes de lutte ne sont pas les méthodes de la lutte prolétarienne. Elles conduisent à la dilution du prolétariat dans le peuple et vise à la défense de la nation argentine, la défense de la démocratie et des élections comme mécanisme de légitimation du pouvoir. Cette politique coïncide avec l’ensemble du programme bourgeois des organisations de gauche, qui soutiennent l’État bourgeois par excellence.
Enfin, la bourgeoisie a également utilisé l’attentat manqué contre Cristina Kirchner pour tenter de mobiliser la population autour de la défense de la démocratie et de l’unité nationale, afin qu’elle s’unisse à ses bourreaux. La bourgeoisie exploite en outre tout son appareil idéologique contre les travailleurs. Avec cette campagne, la bourgeoisie continue à semer davantage de confusion dans l’esprit des travailleurs et à les pousser encore plus à prendre position pour l’un ou l’autre des camps bourgeois. Elle pousse les travailleurs sur le terrain de lutte de la bourgeoisie.
Le prolétariat argentin doit lutter de toutes ses forces pour se libérer de tous ces pièges idéologiques qui sont défendus et diffusés par ces organisations à la solde de l’État bourgeois, en défense de l’État bourgeois et de l’ordre capitaliste en fin de compte. La classe ouvrière en Grande-Bretagne montre la voie à suivre sur le terrain des luttes de classe, contre la crise économique, l’inflation, la précarité et l’exploitation, situations exacerbées par la décomposition capitaliste. (8)
Daedalus.
1 « Contra la Guerra Imperialista en Ucrania por la Lucha de Clases Internacional », disponible sur le site du CCI en espagnole (mai 2022). [599]
2 « Argentina subirá un 21 % el salario mínimo ante la elevada inflación » [600], site de l’agence de presse allemande DW.
3 Sindicato Único De Trabajadores Del Neumatico Argentino : Unique Syndicat des travailleurs du secteur pneumatique argention
4 Il est scandaleux, et c’est une démonstration flagrante de la façon dont les syndicats divisent et montent les travailleurs les uns contre les autres, que l’augmentation salariale ne profite qu’aux travailleurs membres du syndicat.
5 « Presidente de Argentina anuncia nuevo acuerdo crediticio con el FMI » [601], site de l’agence de presse allemande DW.
6 « Oleada de luchas en Argentina : el proletariado se manifiesta en su terreno de clase », Accion proletaria n° 184, (septembre – novembre 2005). [602]
7 "Desde Argentina : Contribución sobre la naturaleza de clase del movimiento piquetero (I) [603]", Accion proletaria n° 177, (juillet – septembre 2004).
Géographique:
- Argentine [604]
Personnages:
- Cristina Kirchner [605]
Récent et en cours:
Rubrique:
La classe ouvrière doit éviter le piège de la défense de l’État démocratique
- 58 lectures
Les manifestations qui ont débuté le 7 décembre après le départ de Pedro Castillo se sont poursuivies et suite au déchaînement de la répression, le ministère public péruvien a indiqué au 20 janvier que l’on dénombrait 55 morts et plus de 1 200 blessés. Par ailleurs dans 28 provinces, principalement dans le sud du pays, 78 barrages routiers et des manifestations de protestation sont toujours en cours. Le 15 janvier dernier, l’état d’urgence a été déclaré dans les régions de Puno, Cuzco, Lima et Callao pour une durée de 30 jours. Le gouvernement actuel de Dina Boluarte reste inflexible quant à sa décision de réprimer durement les manifestations tout en ouvrant des enquêtes judiciaires avec l’appui des services de renseignement de la police afin d’éviter un scénario similaire à celui qu’ont connu ces dernières années des pays comme le Chili et la Colombie. D’autre part, les manifestants demandent la libération de l’ancien président Pedro Castillo (qu’ils considèrent comme victime d’un coup d’État), la démission de Dina Boluarte, des élections anticipées ainsi qu’un référendum populaire sur la convocation d’une assemblée constituante. En décembre de l’année dernière, nous avons publié un article sur notre site internet, dans lequel nous disions : « Les révoltes populaires qui s’élèvent en tant qu’actions organisées des factions opposées de la droite et de la gauche sont des tentatives désespérées de ces mêmes factions pour maintenir ou reprendre le contrôle de l’État [donnant lieu à une polarisation qui] imprègne la société avec tout ce qu’elle comporte de confusion et d’empoisonnement idéologique. Les demandes de “fermeture du congrès”, “ils doivent tous partir”, “nouvelles élections”, “nouvelle constitution”, ne sont rien d’autre que des revendications démocratiques ne visant qu’à maintenir le statu quo de l’État bourgeois. Elles n’ont rien à voir avec les intérêts de la classe ouvrière et son projet historique. Bien au contraire, elles la conduisent à l’enfermement dans la société d’exploitation divisée en classes. Elles sont très éloignées des revendications immédiates qui ont pour but la défense de ses conditions de vie et qui remplissent également une fonction d’expérience de lutte nécessaire à sa maturation politique. […] Bien que nous ne doutions pas qu’il y ait des éléments de la classe ouvrière impliqués dans ces révoltes populaires qui tentent d’exprimer leur indignation face à la décadence de la classe politique, ils le font sur un terrain qui n’est pas le leur et où la bourgeoisie comme la petite bourgeoisie, imposent leurs bannières démocratiques afin de maintenir intacte la société d’exploitation et en défendant leurs propres intérêts de gains et de profits grâce à l’exploitation féroce de la force de travail des prolétaires. Ces éléments de la classe ouvrière et des autres couches non exploiteuses sont emportés par la violence irrationnelle et pourrie d’un système n’ayant plus rien à offrir à l’humanité ». (1)
Il est nécessaire d’insister sur le fait que ces protestations ont conduit, dans certaines régions du pays, à des révoltes de type interclassiste et dans lesquelles les travailleurs se sont rangés sous les bannières de la petite bourgeoisie avec comme conséquence directe, leur atomisation et leur implication dans une confrontation qui ne se situe pas sur leur terrain de classe. De plus, des attitudes typiques du lumpen ont pu être observées comme des incendies de bâtiments, d’entreprises ou de mines, des attaques de bus et d’ambulances, le racket des usagers sur les autoroutes occupées et, pire encore, l’attaque de nombreux ouvriers travaillant dans le secteur de la santé, les mines ou l’agro-industrie et qui se sont vus dérober leurs biens voire agressés parce qu’ils ne voulaient pas se joindre au mouvement.
Au-delà de l’indignation et du profond ressentiment qui existent historiquement dans les provinces du sud du Pérou, telles que Huancavelica, considérée par la Chambre de Commerce comme la deuxième plus pauvre du pays (41,2 %), suivie par des régions comme Puno ou Ayacucho et du fait que l’extrême-gauche ait alimenté la fable du droit à la révolte des plus pauvres, des droits bafoués des peuples indigènes ou du droit des paysans à la terre, ce qui semble être au cœur de toute cette situation sont les aspirations jusqu’à présent frustrées des divers secteurs de la petite bourgeoisie qui espéraient, avec l’arrivée au pouvoir de Pedro Castillo, pouvoir les concrétiser face à la grande bourgeoisie péruvienne. Celle-ci contrôle non seulement, entre autres, les secteurs de l’alimentation, les banques, la construction, les mines, le tourisme, les matériaux, les combustibles, l’éducation avec des revenus annuels se chiffrant en milliards de dollars et des investissements dans une grande partie de l’Amérique du Sud, de l’Europe et des États-Unis, (2) mais elle possède également le contrôle politique avec une forte représentation au Congrès et des racines profondes dans l’appareil d’État. C’est pourquoi cette confrontation a été présentée parfois comme une lutte entre le « sud riche en ressources mais souffrant d’une importante pauvreté » et la bourgeoisie de Lima « corrompue, exclusive et centralisatrice ». L’appropriation des ressources naturelles et matérielles par la bourgeoisie liménienne est l’un des thèmes récurrents dans le discours des protagonistes du mouvement.
Les secteurs de la petite bourgeoisie à l’origine de ces blocages de routes, mobilisations et marches dans les provinces dont certaines sont allées jusque Lima, ont été soutenus par des associations de petits commerçants, des fédérations paysannes, des syndicats, des gouverneurs régionaux, des autorités universitaires, des associations d’avocats, des regroupements d’étudiants, tous largement imprégnées d’idéologie gauchiste combinée à des éléments nationalistes et régionalistes qui ne font que refléter la défense des intérêts spécifiques à ces groupes et, en fin de compte, du capital national.
Selon des estimations de l’Institut National de la Statistique et de l’Information (INEI), en 2021, 25,9 % de la population péruvienne (soit 8,5 millions de personnes) vivait sous le seuil de pauvreté et 4,1 % (soit 1,3 million de personnes) dans l’extrême pauvreté sachant que sont considérées en situation de pauvreté, les personnes dont le pouvoir d’achat mensuel est inférieur à 378 oles (97 $ américains) et en situation d’extrême pauvreté ceux pour qui il est inférieur à 201 soles (52 $ américains). Il faut ajouter à cela l’impact économique de la pandémie de Covid-19 et plus récemment de la guerre en Ukraine. Il est évident que la crise économique mondiale frappe l’ensemble de la bourgeoisie nationale mais elle touche plus durement les secteurs les plus vulnérables de l’appareil productif, sans parler du secteur informel.
Ce sont ces faits qui nous amènent à penser que ces mobilisations constituent une action désespérée des couches sociales qui se sont retrouvées embourbées suite à la détérioration progressive de l’économie et qui aspirent à une plus grande représentation dans l’appareil d’État de façon à pouvoir sauvegarder leurs intérêts. Elles ont profité de l’appauvrissement général pour agiter l’épouvantail de l’exclusion sociale sur la base de la race ou de la région d’origine, de la « démocratie seulement pour quelques-uns ». La Direction nationale du renseignement (DINI) et le ministère de l’Intérieur ont déclaré que ces mobilisations « sont financées par l’exploitation minière illégale, le trafic de drogue et d’autres agents qui cherchent à semer la peur ». En outre, il accuse des organisations politiques et syndicales, telles que le Movadef (Mouvement pour l’Amnistie et les Droits Fondamentaux), la Fenate (Fédération Nationale des Travailleurs de l’Éducation) et des factions du Sentier Lumineux, la CUNARC (Central Única Nacional de Rondas Campesinas del Perú), SUTEP (Syndicat Unitaire des Travailleurs de l’Éducation du Pérou), ainsi que la Fédération régionale des producteurs agricoles et de l’environnement.
De leur côté, les secteurs de la bourgeoisie traditionnelle et leurs partis ont également profité de la situation pour brandir la bannière de la lutte contre le communisme, afin d’éviter que « le terrorisme ne resurgisse dans le pays », ce qui leur a donné l’excuse parfaite pour déclencher la répression et la terreur d’État. Ils ont ainsi fait d’une pierre deux coups en criminalisant les protestations et en présentant toute revendication sociale comme une menace pour l’ordre public. Le gouvernement de Dina Boluarte a déployé 11 000 policiers pour contrôler les manifestations dans la ville et, le 21 janvier, a ordonné une intervention à l’Université Nationale Majeure de San Marcos, la principale université publique du pays, à l’aide d’un important contingent de policiers. Les forces de l’ordre ont enfoncé la porte principale avec un véhicule blindé, utilisant également des drones et des hélicoptères et ont arrêté environ 200 personnes qui, pour la plupart, venaient d’autres régions et passaient la nuit dans l’établissement, envoyant ainsi un message clair au secteur étudiant qu’il accuse de préparer des actions terroristes. Au-delà du fait que les organisations politiques et syndicales de la petite bourgeoisie et des factions de gauche soient à l’origine de ces mobilisations et qu’il puisse exister un financement provenant d’activités illicites, cela ne change en rien l’attitude que les ouvriers doivent adopter face à cette situation, laquelle illustre l’impact de la décomposition du capitalisme sur la vie la bourgeoisie péruvienne.
Par ailleurs, les différentes factions de la bourgeoisie attaquent aussi idéologiquement le prolétariat à travers une campagne dans laquelle le nationalisme, la défense de la démocratie et de la nation sont exaltés. Cela reflète une autre dimension de la crise politique, comme les actions dans lesquelles se manifeste la concurrence impérialiste dans la région.
Le 23 janvier, le ministère péruvien des Affaires étrangères a publié un communiqué rejetant les déclarations du président bolivien, Luis Arce, lequel exprimait son « soutien à la lutte du peuple péruvien pour récupérer sa démocratie et aussi pour récupérer le droit d’élire un gouvernement qui le représente ». (3) Il faut rappeler que le président du Conseil des ministres du Pérou a accusé Evo Morales d’ « encourager l’insurrection […] et d’introduire des armes au Pérou depuis la Bolivie ». Les intentions de Pedro Castillo de permettre à la Bolivie l’accès à la mer ont été rejetées par la droite péruvienne et soutenues par d’autres gouvernements de gauche de la région. Cette situation a conduit le gouvernement péruvien à interdire à Evo Morales et huit autres fonctionnaires boliviens, l’entrée sur son territoire.
De même, le ministère péruvien des affaires étrangères a rejeté les déclarations du président colombien Gustavo Petro sur les événements qui se sont déroulés sur le campus de l’Université Nationale Majeure de San Marcos. L’une des questions qui préoccupait le plus les factions de droite péruviennes était celle des relations avec les autres gouvernements de gauche de la région et qui auraient pu affecter les intérêts historiques en commun des bourgeoisies américaine et péruvienne, bien qu’il semble que Castillo n’ait eu le temps de concrétiser quoique ce soit. L’ambassadrice américaine, Lisa Kenna, a d’ailleurs rappelé ces mêmes intérêts en réitérant « le plein soutien de son pays aux institutions démocratiques du Pérou et aux actions du gouvernement constitutionnel pour stabiliser la situation sociale ». Le patriotisme est un poison idéologique dont les différentes bourgeoisies du monde se servent en permanence. Dans le cas du Pérou, il ne faut pas oublier que tant la guerre du Pacifique avec le Chili (1879-1884), au cours de laquelle il a perdu la province côtière de Tarapacá, que la guerre du Cenepa (1995), concernant la délimitation de la frontière dans la haute-vallée de la Cenepa, continuent d’être des éléments récurrents dans l’élaboration d’un récit historique exaltant le sentiment national.
En résumé, la situation actuelle montre que la bourgeoisie péruvienne, comme l’ont fait par le passé les autres bourgeoisies de droite et de gauche de la région, n’a pas hésité à déchaîner la répression et à maintenir ses intérêts par tous les moyens possibles, en envoyant un message clair pour insuffler la peur dans les rangs du prolétariat. Il est difficile de savoir si ces manifestations et ces barrages routiers vont se prolonger ; ce qui est clair, c’est que la bourgeoisie péruvienne semble être convaincue que la seule façon de parvenir à une certaine stabilité politique et à un contrôle de la situation sera d’appliquer la « violence légitime » de l’État envers la population et la purge de son appareil politique, comportement qui n’est pas étranger à celui que bourgeoisie mondiale a adopté pendant la période de la décadence du capitalisme et qui continue à s’approfondir dans sa phase actuelle de décomposition. Comme nous le disions dans notre article de décembre 2022 : « Ce qui se passe actuellement au Pérou n’est pas une expression ou une réaction prolétarienne se situant sur le terrain de la lutte des classes. C’est, au contraire, une lutte pour des intérêts purement bourgeois, où l’une des deux factions opposées de la bourgeoisie finira par prendre le contrôle de l’État afin de poursuivre l’exploitation des travailleurs. […] Le terrorisme exercé par les bourgeoisies des deux camps continue de faucher des vies humaines. Les méthodes d’incendie et de violence aveugle utilisées sont à l’opposé de celles par lesquelles la classe ouvrière renversera le capitalisme et qui seront fondées davantage sur la capacité à construire une organisation capable d’incorporer le reste des couches non-exploitantes dans son programme, en dirigeant les actions politiques de transformation contre les classes dominantes. La terreur déchaînée par la bourgeoisie et de ses deux camps en pleine ébullition constitue une attaque contre la conscience de la classe ouvrière ». (4)
La section du CCI au Pérou, février 2023.
1« Perú : la clase trabajadora se encuentra en el fuego cruzado de las facciones burguesas enfrentadas », disponible sur le site web du CCI en espagnol, (décembre 2022).
2F. Durand, Les douze apôtres de la démocratie péruvienne (2017).
3La Chancellerie a remis une note de protestation à l’ambassadeur de Bolivie pour les déclarations du président Luis Arce.
4« Perú : la clase trabajadora se encuentra en el fuego cruzado de las facciones burguesas enfrentadas », disponible sur le site web du CCI en espagnol, (décembre 2022).
Géographique:
- Pérou [224]
Rubrique:
Soudan: une illustration vivante de la décomposition du capitalisme
- 85 lectures
Le spectacle d’horreur de la guerre impérialiste qui se déroule au Soudan illustre la poursuite et l’extension de la décomposition du capitalisme, qui s’accélère depuis le début des années 2020. Il exprime la profonde tendance centrifuge au chaos irrationnel et militariste qui affecte de plus en plus de régions de la planète. Quelles que soient les spécificités des deux gangs militaires qui s’affrontent au Soudan (et nous y reviendrons un peu plus loin), le grand responsable de cette nouvelle flambée de violence est le système capitaliste et ses représentants dans les grandes puissances : États-Unis, Chine, Russie, Grande-Bretagne, suivis par toutes les puissances secondaires actives au Soudan : Émirats Arabes Unis, Arabie Saoudite, Turquie, Israël, Égypte, Libye, etc. Vers la fin de l’année dernière, le 5 décembre, le ministère britannique des affaires étrangères a publié une déclaration sur l’avenir démocratique du Soudan qui commençait ainsi : « Les membres du Quad et de la Troïka (Norvège, Royaume d’Arabie Saoudite, Émirats Arabes Unis, Royaume-Uni et États-Unis) se félicitent de l’accord sur un cadre politique initial. Il s’agit d’un premier pas essentiel vers la mise en place d’un gouvernement dirigé par des civils et la définition d’arrangements constitutionnels qui guideront le Soudan pendant une période de transition dont le point culminant sera la tenue d’élections. Nous saluons les efforts déployés par les parties pour obtenir le soutien d’un large éventail d’acteurs soudanais en faveur de cet accord-cadre, ainsi que leur appel à la poursuite d’un dialogue inclusif sur toutes les questions qui les préoccupent et à la coopération en vue de construire l’avenir du Soudan ». Quelques semaines avant que de violents combats n’éclatent, le 8 avril, ces « partenaires internationaux » du Soudan parlaient encore d’un « retour imminent » à un régime civil et à un gouvernement démocratique impliquant les deux principales composantes du gouvernement soudanais : les Forces Armées Soudanaises (SAF) dirigées par le général Abdel Fatah al-Burham et la Force de Frappe Rapide (RSF), (1) dirigée par le général Hamdam Dagalo, alias « Hemediti ». Quelques jours seulement après le début des combats entre ces deux factions militaires soudanaises, il est apparu clairement que cette « démocratie », comme partout ailleurs est une illusion et que toutes les options immédiates et les perspectives à plus long terme pour la population du Soudan et de la région environnante vont aller de mal en pis. Cela est confirmé par la situation dans la capitale du Soudan, Khartoum : autrefois relativement paisible et animée, épargnée par les horreurs qui l’entourent et remplie de réfugiés du « conflit du Darfour » de 2003 (en réalité un génocide ethnique), (2) elle a été réduite à l’état de ruines en l’espace de quelques jours. Le manque d’eau, d’électricité et de services de santé s’accompagne de massacres et de viols perpétrés par les forces de l’ex-gouvernement.
La « désintégration de l’intérieur » du capitalisme
En 1919, l’Internationale communiste a tracé les perspectives du capitalisme : « une nouvelle époque est née ! L’époque de la dissolution du capitalisme, de sa désintégration intérieure, l’époque de la révolution communiste du prolétariat ». La réalité de cette époque du capitalisme a été confirmée par plus d’un siècle de guerre impérialiste croissante, seule réponse à une crise économique permanente. Nous vivons depuis plus de trente ans la phase finale de ce processus de décadence du capitalisme, la phase de décomposition. Et, depuis la pandémie de Covid, et plus encore la guerre en Ukraine, nous assistons à une accélération tragique. La putréfaction profonde de ce mode de production se mesure aujourd’hui par une véritable spirale de destruction à l’échelle de la planète, et notamment par la multiplication des guerres et des massacres (Ukraine, Myanmar, Yémen, Tigré…). Au Soudan, on assiste aujourd’hui à l’effondrement du « processus de paix de la communauté internationale », de l’État soudanais et du gouvernement militaire du Soudan, démontrant d’emblée une tendance plus large de ces agents des grandes puissances à avoir un fonctionnement peu fiable, irrationnel et d’abord motivé par la recherche de la première place : en témoigne le groupe russe Wagner, (3) (actif au Soudan, au Tchad et en Libye sous la direction du général Khalifa Haftar), qui semble de plus en plus se désolidariser de Moscou et prendre une dynamique propre. Cette tendance au chacun pour soi est encore soulignée par le fait que chacun des pays cités plus haut est tout à fait capable de prendre ses propres mesures unilatérales qui exacerberont encore davantage les tendances au chaos au Soudan et dans la région immédiate.
« Sauver nos ressortissants »… et c’est le sauve-qui-peut
Le Soudan était une colonie britannique jusqu’en 1956, quand les États-Unis ont sapé le rôle de l’impérialisme anglais suite à la crise du canal de Suez. Comme dans nombre de leurs colonies, les Britanniques avaient introduit la pratique du « diviser pour mieux régner », utilisant les clivages ethniques et géographiques pour faciliter leur contrôle. On a pu observer les conséquences à long terme de cette politique en 2011, lorsque le pays a été coupé en deux entre un Nord dominé par les Arabes et un Sud dominé par les Africains. Le Soudan, riche de ressources naturelles, est bordé par la Mer Rouge et a une frontière avec l’Égypte et la Libye en Afrique du Nord, l’Éthiopie et l’Érythrée dans la Corne de l’Afrique, l’État du sud-Soudan en Afrique de l’Est et les États du Tchad et de la République Centrafricaine en Afrique Centrale. Il est donc au centre de toutes les rivalités impérialistes régionales et mondiales qui se jouent en Afrique et au Moyen-Orient.
Lorsque le conflit actuel a éclaté, la principale préoccupation des hypocrites « partenaires » du Soudan a été d’abord d’évacuer d’abord leurs diplomates, puis leurs ressortissants du pays, tout en brûlant et détruisant les preuves de leur culpabilité meurtrière. Faisant écho à la « guerre des vaccins » du capitalisme lors de la pandémie de Covid-19, nous avons été témoins du « chacun pour soi », les intérêts nationaux compétitifs l’emportant sur toute forme de coopération : les avions affrétés ont décollé à moitié vides, parce que les papiers nécessaires n’avaient pas été présentés ou parce que les personnes concernées ne figuraient pas sur les listes d’embarquement du personnel qui contrôlait les départs. Lorsque d’autres ressortissants se voyaient attribuer une place dans les procédures d’évacuation, c’était dans le cadre d’un exercice cynique de relations publiques ou pour obtenir un avantage diplomatique sordide. Ces puissances en fuite ont laissé derrière elles un désordre total qu’elles ont elles-mêmes créé et un avenir sombre pour la région.
Il est inutile de citer des chiffres de victimes ou de destructions, car les chiffres « officiels » augmentent de façon exponentielle tous les jours : des dizaines de milliers de morts et de blessés graves, des millions de réfugiés et de déplacés, dont environ quinze millions vivent déjà des miettes des agences d’aide (elles-mêmes partie intégrante de l’impérialisme et de la guerre) et une malnutrition aiguë chez les femmes enceintes et les jeunes enfants, selon un communiqué de l’ONU du 11 avril dernier. Les ressortissants qui ont eu la chance de rentrer au pays ont été accueillis par des drapeaux et des titres de presse chauvins, alors que la grande majorité des Soudanais n’ont aucun moyen d’échapper à la guerre et à la famine et sont condamnés à la misère par les mêmes intérêts nationaux brandissant les drapeaux des États capitalistes qui sont venus apporter la « démocratie » au pays.
Pour ajouter au désordre de Khartoum et d’ailleurs, environ vingt mille prisonniers se sont évadés ou ont été libérés de prison (certains d’entre eux étant d’anciens meurtriers de masse et criminels de guerre condamnés par le gouvernement) ces évadés seront accueillis dans leurs camps respectifs, dans la mêlée générale, ce qui coûtera encore plus cher à la population et à ses espoirs déçus d’une quelconque forme de « paix ». Outre l’inflation galopante, le pillage organisé des approvisionnements, les agressions et les vols commis par les milices armées, la population doit faire face à des problèmes de santé publique et de sécurité.
Des postes de contrôle omniprésents ont fait leur apparition dans de nombreuses rues, et, pour ajouter à son désarroi et à la tension, les cessez-le-feu et les trêves se succèdent sans rien changer à la guerre en cours. (4)
La décomposition du capitalisme garantit la foire d’empoigne militaire
Les deux principaux chefs de guerre, les généraux Dagalo et Hemediti, « partenaires démocratiques » de l’Occident et « amis et alliés » de Moscou, se livrent une bataille féroce, les FAS ayant l’avantage de la puissance aérienne. Ce n’est pas un grand avantage dans ce genre de guerre, mais si la bataille doit se poursuivre, les deux camps auront bientôt besoin d’être réapprovisionnés en armes : les Russes fourniront-ils aux FAR des missiles antiaériens ou d’autres armes par l’intermédiaire de Wagner ? Haftar, soutenu par les Russes en Libye, augmentera-t-il le soutien qu’il apporte et a apporté aux FAR ? L’Arabie Saoudite et l’Égypte vont-elles s’impliquer davantage dans la fourniture d’armes aux Forces armées soudanaises, et Abu Dhabi et Riyad sont-ils à couteaux tirés sur cette question ? Les partisans de la FSR dans les Émirats Arabes Unis qui considèrent que la FSR fait partie de leur plan plus large de contrôle de la Mer Rouge et de la Corne d’Afrique consolideront-ils et renforceront-ils leur soutien ? La Grande-Bretagne et les États-Unis pourraient-ils s’impliquer davantage par le biais de certains de ces vecteurs ? Compte-tenu de la grande instabilité de la situation et de tous les acteurs impliqués, il y a trop d’incertitudes pour faire des prédictions, si ce n’est que la guerre se poursuivra et que le cadre général de la décomposition garantit qu’elle prendra de l’ampleur.
La Chine est très impliquée au Soudan et dans des machinations avec les deux factions de l’Armée, afin de maintenir sa stratégie « nouvelle route de la soie », qui a été mise à mal dans l’Éthiopie voisine. Les États-Unis rattrapent leur retard sur la Chine, mais le Président Biden a récemment intensifié l’activité militaire au Soudan, avec des ressources militaires supplémentaires déployées pour « combattre le terrorisme ». Mais il ne fait aucun doute qu’ils ont été pris au dépourvu et embarrassés par la déclaration britannique selon laquelle nous étions à quelques jours d’un « régime civil » au Soudan. La Russie a également traité avec les deux factions militaires et toutes deux ont parlé favorablement de la construction éventuelle d’un port russe sur la Mer Rouge. L’ensemble de la région ressemble désormais à une boîte de Pandore, avec une situation hautement volatile.
Les évacuations de Soudanais sont en grande partie terminées à ce jour et, comme d’habitude, la guerre est cyniquement reléguée loin des gros titres alors que le pays s’enfonce dans une misère toujours plus profonde. Le Soudan est un exemple de la dynamique du capitalisme et il y en a beaucoup d’autres : de dangereuses lignes de faille impérialistes s’ouvrent avec des tensions militaires croissantes au Moyen–Orient, autour de l’ex-Yougoslavie et du Caucase et, de manière générale, dans le monde entier. Le militarisme est le principal débouché laissé à l’État capitaliste. La guerre en Ukraine, avec ses effets locaux et mondiaux, fait rage. Au début du mois d’avril 2023, la Finlande est devenue le trente et unième pays à rejoindre l’OTAN et sa frontière de 1300 km a doublé la ligne de front avec la Russie. Comme elle l’a fait dans d’autres États de la ligne de front avec la Russie, l’OTAN sera d’abord prudente, puis renforcera ses forces et son armement le long de la frontière, forçant ainsi la Russie à faire de même.
La perspective à plus long terme dans les rapports impérialistes est la confrontation croissante avec la Chine préparée par les États-Unis, mais il y a là aussi des incertitudes et des variables. En attendant, le capitalisme s’enfonce dans la guerre irrationnelle et la barbarie. Le Soudan est une exemple de plus de sa « désintégration intérieure ».
Baboon, 5 mai 2023
1Le FSR trouve ses racines dans la redoutable milice Jangaweed, une machine militaire arabe qui tue et viole et qui a été intégrée au gouvernement soudanais après l’éviction du dictateur Omar al-Bashir en 2019. La Jangaweed est un produit de l’impérialisme des années 1980 et a été intégrée au gouvernement soudanais par ses services de renseignement avec le soutien de l’Occident.
2Il est très probable que cet élément de « nettoyage ethnique », un facteur croissant de décomposition du capitalisme, reprenne de plus belle au Darfour, où il n’a pas vraiment cessé depuis des années.
3Le groupe russe Wagner traite directement avec les deux factions militaires soudanaises, apparemment depuis 2018, et est actif autour du port du Soudan, les services de renseignement britanniques déclarant qu’il s’agit d’une « grande plaque tournante » pour eux (cité dans le journal The Eye, 29 avril). Ils affirment également que le groupe vise à « établir une “confédération” d’États anti-occidentaux ». Outre certains entraînements et activités au Soudan et dans la région, et son étroite collaboration avec le maréchal Khalifa Haftar de Libye, le groupe a également participé, par l’intermédiaire de son front « M Invest, Meroe Gold » établi par Moscou et le dictateur soudanais Bashir, à l’envoi de volumes de métal précieux hors du pays
4Pendant la guerre du Liban, de 1975 à 1990, des milliers de cessez-le-feu ont été demandés et ignorés. Le Liban a été en quelque sorte un « modèle » pour la guerre du Golfe, pour le début de la décomposition capitaliste et l’apparition des « États en faillite ». À ce jour, le Liban a été rejoint par le Yémen, la Syrie, l’Afghanistan, la Libye et maintenant le Soudan (le Pakistan n’étant pas loin de la zone de relégation). Ces régions n’ont pratiquement aucune possibilité de reconstruction effective dans le cadre du capitalisme.
Géographique:
- Afrique [30]
Récent et en cours:
- Soudan [607]
Rubrique:
Opération Wuambushu à Mayotte: L’immonde "nettoyage de printemps" de la bourgeoisie française!
- 155 lectures
Après avoir évacué à tour de bras les campements de migrants en métropole avec une brutalité sans nom, c’est au tour de Mayotte, le plus grand bidonville de France, de voir arriver les forces de l’ordre pour l’opération Wuambushu. Mayotte, dont 77 % de la population vit sous le seuil de pauvreté et dont la moitié est sur le territoire de façon illégale (principalement des Comoriens), est sous le joug d’une violence quotidienne. De nombreux migrants viennent s’échouer sur les plages de Mayotte en espérant trouver une vie meilleure. En mars dernier, plus de vingt migrants sont morts noyés dans l’indifférence la plus totale.
Le 24 avril dernier débutait donc en grande pompe l’opération Wuambushu. L’objectif assumé est de déporter vers les Comores plus de 20 000 personnes en deux mois, soit plus que durant toute l’année précédente. Et tout ça pour rien, pour que le gouvernement puisse montrer les muscles, dans une opération de com’ cynique du sinistre Darmanin : car ceux qui se feront expulser du territoire reviendront au péril de leur vie à bord des kwassa-kwassa, ces frêles embarcations qui finissent régulièrement au fond de l’océan. Ceux qui échapperont à la traque policière iront grossir les rangs du bidonville voisin. Mais qu’importe, l’objectif sera rempli !
À Mayotte, l’État « démocratique » révèle toute la barbarie de la bourgeoisie
L’État n’a reculé devant aucune horreur pour mener à bien ses expulsions. Les sans-papiers des bidonvilles ont vu leur abri de fortune être marqué d’un numéro, signe d’une destruction prochaine. En réalité, vu l’enchevêtrement inextricable des habitations, le marquage n’est qu’un cache-sexe dérisoire : l’État compte manifestement rouler sur les habitants, sans-papiers ou non. En bref, déloger les pauvres coûte que coûte ! Cet infâme marquage n’a pour but que d’humilier un peu plus une population déjà très fragile.
Quelques jours avant le début officiel de l’opération, la police s’est mise à gazer sans raison de nombreux quartiers aux abords de Tsoundzou, si ce n’est pour instiller un peu plus une ambiance de terreur. Plus de 600 grenades lacrymogènes et une soixantaine de LBD ont été lancés sur la population en une soirée seulement. Pire encore, pour mieux effrayer et faire fuir les habitants, les forces de l’ordre n’ont pas hésité à tirer à balles réelles sur le sol. Plus tard, un mineur a été touché par une balle perdue.
Une campagne ouvertement xénophobe est également entretenue sans vergogne par les autorités locales et le gouvernement. Les Comoriens et autres migrants illégaux sont déshumanisés au point qu’ils sont qualifiés d’ennemis : « On a très peu de visibilité sur les ennemis. Ça arrive de partout », déplorait un brigadier sur l’île. Le vice-président du conseil régional, Salime Mdere, a quant à lui carrément appelé au meurtre : « Quand je vois ce qu’il se passe à Tsoundzou […], des gamins qu’on voit de loin… enfin c’est même pas des gamins. Moi je refuse d’ailleurs qu’on emploie ces termes-là : “jeunes” ou “gamins”… Ces “délinquants”, ces “voyous”, ces “terroristes”, à un moment donné, il faut peut-être en tuer ». Voilà la réponse ignoble de la bourgeoisie au chaos qu’elle engendre : « ça » ne mérite pas de vivre !
Mais, dans un premier temps, l’opération ne s’est pas passée comme prévue. La Justice a mis en suspens les « décasages » de Talus II, un des plus grands bidonvilles de Mayotte, au motif que des solutions de relogement n’ont pas été proposées aux habitants. Volte-face ce 17 mai : les décasages peuvent reprendre ! Monsieur le Juge est satisfait : 56 hébergements d’urgence de 30 m², éloignés du bidonville d’au moins quarante minutes de route, ont été proposés aux milliers de familles dont le logement a été tagué du numéro fatidique… et pour six mois seulement ! Entre la déscolarisation forcée des enfants, les familles séparées et entassées dans des bicoques, sur des matelas en mousse à même le sol, Darmanin peut se réjouir : « l’action déterminée de destruction de l’habitat indigne à Mayotte va donc pouvoir reprendre » !
Si la bourgeoisie n’arrive pas à mener sa politique inhumaine aussi rapidement que prévu, elle peut tout de même compter sur des décennies de haine largement alimentées par l’État. Les autorités ont ainsi organisé un véritable pogrom contre les sans-papiers. Depuis le 3 mai, le plus grand dispensaire de l’île est bloqué par un collectif pro-Wuambushu qui n’a pas attendu les ordres d’expulsion du gouvernement pour créer ses propres milices (1). Non contents de dénoncer les sans-papiers aux autorités, ils barrent également l’accès à plusieurs centres de soin de l’île, empêchant la distribution de médicaments aux migrants, et ce avec la bénédiction des autorités : « Des “collectifs de citoyens” sont postés à l’entrée et demandent leurs papiers aux gens qui se présentent aux urgences, tout ça au vu et au su de la direction de l’hôpital et de la police… », témoigne un soignant. (2)
De nombreuses manifestations pro-Wuambushu ont eu lieu à Mayotte. On a pu y voir le chant nationaliste de La Marseillaise être entonné et le drapeau tricolore des versaillais fièrement brandit ! Et le relent guerrier nauséabond du patriotard n’est jamais bien loin : « On est sur une guerre d’usure », déclarait un membre d’un collectif soutenant Wuambushu, et « lorsqu’on part en guerre, il y a toujours des dégâts collatéraux ». (3)
Le combat contre le « néocolonialisme », une diversion idéologique
À l’annonce officielle de Wuambushu, l’intersyndicale (CGT-Solidaires-FSU), a hypocritement demandé au « gouvernement d’arrêter toutes les mesures répressives »… avec la même conviction que face à la répression qui s’est abattue sur le mouvement contre la réforme des retraites. La CGT Mayotte ne s’est pas embarrassée de telles simagrées et a ouvertement apporté son soutien total à l’opération, « qui apportera la paix sociale à Mayotte ». Le but étant que « les conditions de travail des travailleurs de Mayotte soient optimales ». Au turbin, et fissa !
Les gauchistes, quant à eux, dénoncent une politique « néocoloniale » de l’État français. Si la dimension raciste du traitement de la population est bien réelle, le statut d’ancienne colonie de Mayotte n’est pas la raison fondamentale pour laquelle l’État agit ainsi. En réalité, la bourgeoisie se comporte de la même façon avec les ouvriers en métropole, même si elle est, pour le moment, contrainte d’y mettre un peu plus de doigté. En métropole, soucieuse de maintenir vivace les illusions démocratiques, la bourgeoisie est pour l’instant moins « brutale » face au prolétariat. Mais à Mayotte, l’État ne s’embarrasse plus de telles précautions : le prolétariat y est plus isolé, avec peu d’expérience de luttes et très fortement dilué dans une population souvent marginalisée. Si le mouvement contre la réforme des retraites fût un avant-goût de ce que nous réserve la bourgeoisie, elle peut se permettre de montrer son vrai visage à Mayotte, comme elle l’a montré avec une sauvagerie sans nom face aux insurgés de la Commune de Paris, aux révolutionnaires de 1917 ou aux grévistes de 1947 en France.
Les migrants et la population mahoraise réduite à la misère n’ont, d’ailleurs, rien de plus à attendre d’une bourgeoisie moins « colonialiste » comme celle des Comores. En 2019, un accord sur la gestion des migrants a été passé avec la France : en échange d’une aide au développement de 150 millions d’euros, les Comores doivent « coopérer » avec Paris sur la question migratoire. Seulement voilà, au lieu du black-out habituel lorsqu’il s’agit d’expulser des migrants, le gouvernement français a décidé de faire de la com' à outrance sur Wuambushu. Les Comores ont dû bloquer les expulsions, pour finalement annoncer qu’ils ne reprendraient que les sans-papiers « volontaires » au retour. Par amour de leur prochain, sans doute ? Non ! Parce que « cela aurait pu être plus discret et efficace. Il y a un vol et un bateau entre Mayotte et Anjouan tous les jours », se lamentait le président Comorien.
Parallèlement, le gouverneur de l’île comorienne d’Anjouan a annoncé la création d’un « comité de vigilance », « habilité à prendre toutes initiatives et entreprendre des actions non violentes pour éviter que la population d’Anjouan soit menacée dans sa sécurité et dans sa quiétude en raison du déplacement massif de la population par la France »… « Non-violente »… Mais bien sûr ! Les Comoriens vivent dans des conditions plus extrêmes encore que leurs voisins mahorais, la police y est encore plus déchaînée et n’hésite pas à tirer à balle réelle sur la population. Les médias n’hésitent pas à relier les pénuries de riz avec l’arrivée des « refoulés » sur l’île… Un autre pogrom n’est pas loin ! Pour les migrants et la population de Mayotte, le salut ne viendra ni de la bourgeoisie française, ni de la bourgeoisie comorienne, ni d’aucune autre !
D.E., 20 mai 2023
1 Ces collectifs ont eux-mêmes organisés plusieurs opérations de « décasage », depuis 2016 et ont indiqué qu’ils iraient détruire les bidonvilles si les autorités n’agissaient pas.
2 « Depuis dix jours, des collectifs pro-Wuambushu bloquent l’accès aux centres de soins à Mayotte [608] », Mediapart (14 mai 2023).
3 « Des Mahorais prêts à tout pour Wuambushu [609] », Les jours (18 mai 2023)
Situations territoriales:
Personnages:
- Darmanin [480]
Récent et en cours:
Rubrique:
ICConline - juin 2023
- 47 lectures
Bilan du mouvement contre la réforme des retraites : la lutte est devant nous !
| Fichier attaché | Taille |
|---|---|
| 227.08 Ko |
- 297 lectures
Cinq mois de lutte, quatorze journées d’action, des millions de manifestants, une multitude de grèves et de blocages, des records de mobilisation… Bref, un mouvement social d’une ampleur inconnue en France depuis 1968. Pourtant la réforme des retraites est passée. Alors, tout ça pour rien ? Absolument pas !
Ce mouvement est une promesse pour l’avenir. Il est le signe que nous, la classe ouvrière, nous avons commencé à redresser la tête. À nouveau, nous nous serrons les coudes dans la lutte. Durant des décennies, nous avons subi les attaques incessantes des gouvernements successifs, de droite comme de gauche. Mais dorénavant, nous refusons cette dégradation continue de nos conditions de vie et de travail. Voilà ce que montre la massivité de notre mouvement.
Un mouvement riche de leçons pour les luttes futures
Dès la première manifestation, celle du 19 janvier, la grande majorité des travailleurs ne se faisait aucune illusion : le gouvernement n’allait pas reculer. Pourtant, semaine après semaine, nous étions des millions dans la rue à ne pas vouloir nous soumettre. En refusant ainsi de nous résigner, en nous battant tous ensemble, en développant la solidarité entre les secteurs comme entre les générations, nous sommes parvenus à une première victoire : celle de la lutte elle-même.
« Parfois, les ouvriers triomphent ; mais c’est un triomphe éphémère. Le résultat véritable de leurs luttes est moins le succès immédiat que l’union grandissante des travailleurs ». (Marx et Engels, Manifeste communiste, 1848).
Cette victoire est précieuse pour l’avenir. Parce que nous savons que les attaques vont encore s’accroître. Les prix de la nourriture, de l’électricité, du logement, du carburant… vont continuer à grimper. Dans le privé comme dans le public, la précarité, les sous-effectifs, les cadences infernales et les salaires de misère vont empirer encore et encore. L’État va continuer à détruire le système de santé, celui de l’éducation, des transports… seuls les budgets de l’armement et de la répression vont augmenter !
Il va donc falloir continuer à nous battre, en nous appuyant sur l’expérience de notre mouvement actuel. C’est pourquoi il est indispensable de nous rassembler, partout où c’est possible (à la fin des manifestations, sur nos lieux de travail, dans des comités de lutte ou des cercles de discussion, dans des réunions d’organisations révolutionnaires), pour discuter et tirer les leçons. Parce que, oui, ce mouvement est riche d’enseignements :
– Ces dernières décennies, nous avons subi de multiples attaques, restant isolés les uns des autres, impuissants. Nous avions perdu confiance en notre capacité à nous unir, à lutter massivement. Pire, nous avions même oublié que notre force collective pouvait exister. Ce temps est révolu.
– En étant tous ensemble dans la lutte, nous avons commencé à prendre conscience que nous formons une seule et même force. Nous sommes la classe ouvrière ! Chômeurs, retraités, étudiants précaires, travailleurs salariés du privé ou du public, en bleu de travail ou en blouse blanche, dans les ateliers ou dans les bureaux, nous sommes tous des exploités qui, atomisés, chacun dans leur coin, ne peuvent rien face au capital mais qui, unis dans la lutte, deviennent la plus grande force sociale de l’histoire.
– C’est justement cette reconquête de notre identité de classe qui a permis que rejaillisse à notre mémoire l’expérience de nos luttes passées. Ce n’est pas un hasard si le slogan le plus populaire brandi sur les pancartes était : « Tu nous mets 64, on te re-Mai 68 ». Plus spectaculaire encore est l’apparition dans les discussions de références au mouvement contre le CPE de 2006, alors que jusqu’à maintenant cet épisode était totalement ignoré dans nos rangs, comme effacé, comme s’il n’avait jamais eu lieu. En recommençant à nous battre en tant que classe ouvrière, nous rendons possible le début de la réappropriation de notre histoire, de nos expériences, de nos victoires et de nos défaites pour, demain, être plus unis, plus organisés, plus forts.
– Contrairement à 2018, où les cheminots avaient fait grève seuls durant des semaines et jusqu’à épuisement, tandis que les autres secteurs étaient appelés à la « grève par procuration » et à la solidarité platonique, cette fois aucun secteur n’est resté isolé, aucun secteur ne sort abattu. Même les raffineurs qui ont pourtant été poussés, mois après mois, à se replier sur leur lieu de travail au nom du blocage de l’économie. Cette fois-ci, c’est bien la dynamique de la solidarité active dans la lutte qui l’a emporté. Le piège classique de la division et de l’isolement n’a pas fonctionné.
– En réprimant férocement et en provoquant honteusement, l’État français espérait faire peur à la majorité des travailleurs et pousser une minorité dans la confrontation stérile et perdue d’avance avec les forces de l’ordre. Là aussi, nous avons su éviter ce piège, malgré l’immense colère légitime face aux coups et aux insultes.
– Cette terreur d’État dans la rue, comme le passage en force de la réforme en toute légalité, grâce aux mécanismes constitutionnels de la République, ont même commencé à soulever le masque de la démocratie bourgeoise et faire apparaître ce qui se cache derrière : la dictature capitaliste.
– Enfin, et peut-être surtout, ce mouvement a permis qu’émerge une question essentielle pour l’avenir : comment établir un rapport de forces favorable ? Nous nous sommes mobilisés par millions, durant des mois, et pourtant la bourgeoisie française n’a pas cédé. Pourquoi ? Qu’est-ce qui a manqué à ce mouvement pour faire reculer le gouvernement ?
Pour le comprendre, pour parvenir à aller plus loin la prochaine fois, il nous faut justement poursuivre le chemin que ce mouvement a commencé à prendre : nous rappeler nos expériences de luttes passées et leurs leçons.
S’appuyer sur les expériences de lutte de notre classe
Certaines luttes du passé montrent qu’il est possible de faire reculer un gouvernement, de freiner ses attaques.
En 1968, le prolétariat en France s’est uni en prenant en main ses luttes. Suite aux immenses manifestations du 13 mai pour protester contre la répression policière subie par les étudiants, les débrayages et les assemblées générales se sont propagés comme une traînée de poudre dans les usines et tous les lieux de travail pour aboutir, avec ses 9 millions de grévistes, à la plus grande grève de l’histoire du mouvement ouvrier international. Face à cette dynamique d’extension et d’unité de la lutte ouvrière, gouvernement et syndicats se sont empressés de signer un accord de hausse généralisée des salaires afin d’arrêter le mouvement.
En août 1980, en Pologne, face à l’augmentation des prix de l’alimentation, les grévistes portaient encore plus loin la prise en main des luttes en se rassemblant en d’immenses assemblées générales, en décidant eux-mêmes des revendications et des actions, et surtout en ayant pour souci constant d’étendre la lutte. Face à cette force, ce n’est pas simplement la bourgeoisie polonaise qui a tremblé mais celle de tous les pays.
En 2006, en France, après seulement quelques semaines de mobilisation, le gouvernement a retiré son « Contrat Première Embauche ». Qu’est-ce qui a fait peur à la bourgeoisie au point de la faire reculer si rapidement ? Les étudiants précaires ont organisé, dans les universités, des assemblées générales massives, ouvertes aux travailleurs, aux chômeurs et aux retraités. Ils ont mis en avant un mot d’ordre unificateur : la lutte contre la précarisation et le chômage. Les assemblées générales étaient le poumon du mouvement, là où les débats se menaient, là où les décisions se prenaient. Chaque week-end, les manifestations regroupaient de plus en plus de secteurs. Les travailleurs salariés et retraités s’étaient joints aux étudiants, sous le slogan : « Jeunes lardons, vieux croûtons, tous la même salade ! »
Tous ces mouvements ont en commun la prise en main des luttes par les travailleurs eux-mêmes !
En effet, la plus grande force d’une lutte, c’est d’être l’affaire de tous les exploités et non celle des « spécialistes ». En réalité, toutes les « actions » proposées par les organisations syndicales visent justement à leur éviter d’être « débordées », à éviter que la dynamique de ces mouvements victorieux ne réapparaisse, à empêcher que nous débattions et décidions nous-mêmes de la conduite de la lutte. Piquets, grèves, manifestations, blocage de l’économie… tant que ces actions restent sous le contrôle syndical, cela ne peut mener qu’à la défaite.
Depuis maintenant presque un an, au Royaume-Uni, que font les syndicats ? Ils éparpillent la riposte ouvrière : chaque jour, un secteur différent en grève. Chacun dans son coin, chacun sur son piquet. Aucun rassemblement, aucun débat collectif, aucune réelle unité dans la lutte. Il ne s’agit pas là d’une erreur de stratégie mais d’une division volontaire. Déjà, en 1984-85, le gouvernement Thatcher était parvenu à briser les reins de la classe ouvrière au Royaume-Uni par le même sale travail des syndicats. Ils ont isolé les mineurs de leurs frères de classe des autres secteurs. Ils les ont enfermés dans une grève longue et stérile. Pendant plus d’un an, les mineurs ont occupé les puits, sous l’étendard du « blocage de l’économie ». Seuls et impuissants, les grévistes sont allés au bout de leurs forces et de leur courage. Et leur défaite a été celle de toute la classe ouvrière ! Les travailleurs du Royaume-Uni ne relèvent la tête qu’aujourd’hui, plus de trente ans après ! Cette défaite est donc une leçon chèrement payée que le prolétariat mondial ne doit pas oublier.
Seul le rassemblement au sein d’assemblées générales ouvertes et massives, autonomes, décidant réellement de la conduite du mouvement, peut constituer la base d’une lutte unie et qui s’étend, portée par la solidarité entre tous les secteurs, toutes les générations. Des assemblées générales dans lesquelles nous pouvons adopter ensemble des revendications de plus en plus unificatrices. Des assemblées générales dans lesquelles nous nous rassemblons et depuis lesquelles nous pouvons partir en délégations massives à la rencontre de nos frères de classe, les travailleurs de l’usine, de l’hôpital, de l’établissement scolaire, de l’administration les plus proches.
Une dynamique internationale : le retour de la lutte de classe
Aujourd’hui, nous manquons encore de confiance en nous, en notre force collective, pour oser prendre nous-mêmes nos luttes en main. Voilà la limite actuelle de notre mouvement, voilà pourquoi la bourgeoisie française n’a pas tremblé, pourquoi son gouvernement n’a pas reculé. Mais notre histoire prouve que nous en sommes capables. Et, de toute façon, il n’y a pas d’autre chemin.
Le capitalisme va continuer de nous plonger dans la misère et la barbarie. Laissé à sa seule logique, ce système décadent va entraîner des parties de plus en plus larges de l’humanité dans la guerre et la misère, il va détruire la planète à coups de gaz à effet de serre, de forêts rasées et de bombes.
Le sentiment de solidarité, d’être tous dans le même bateau, le besoin de se serrer les coudes, entre les différents secteurs, entre les différentes générations, sont les témoins de ce qu’est la nature profonde de la lutte ouvrière, une lutte pour un monde radicalement différent, un monde sans exploitation ni classes sociales, un monde sans frontières ni affrontements entre nations où la « guerre de tous contre tous » cédera la place à la solidarité entre tous les humains : le communisme.
Notre lutte historique contre le capitalisme est d’ailleurs internationale. Ces douze derniers mois, on a assisté à des mouvements sociaux d’ampleur inédite depuis les années 1980 au Royaume-Uni, en Espagne, en Allemagne, au Danemark, au Portugal, aux Pays-Bas, aux États-Unis, au Canada, au Mexique, en Chine… les mêmes grèves contre la même exploitation de plus en plus insoutenable. « Les ouvriers restent soudés », ont crié les grévistes au Royaume-Uni. « Soit on lutte ensemble, soit on finira par dormir dans la rue ! », ont confirmé les manifestants en France. La bannière « Pour nous tous » sous laquelle a eu lieu la grève contre la paupérisation en Allemagne, le 27 mars, est particulièrement significative de ce sentiment général qui grandit dans la classe ouvrière : nous luttons tous les uns pour les autres.
Dans la lutte face à la dégradation de nos conditions de vie et de travail, particulièrement face à l’inflation, nous allons peu à peu développer notre force collective, notre confiance en nous-mêmes, notre solidarité, notre unité. Dans la lutte, nous allons peu à peu nous rendre compte que nous, la classe ouvrière, sommes capables de prendre nos luttes en mains, de nous organiser, de nous rassembler en assemblées générales pour décider de nos mots d’ordre et de nos actions. Nous allons peu à peu nous rendre compte que nous sommes capables d’offrir une autre perspective que la mort promise par un système capitaliste en décomposition : la révolution communiste.
La perspective de la révolution prolétarienne va faire son retour dans nos têtes et nos combats.
L’avenir appartient à la lutte de classe !
Courant Communiste International, 4 juin 2023
Vie du CCI:
- Interventions [492]
Situations territoriales:
Récent et en cours:
Rubrique:
"La santé et la révolution (Russie soviétique, 1917 – 1924)"
- 129 lectures
Le vendredi 5 mai, l’Organisation mondiale de la santé (OMS), déclarait que « le Covid-19 n’est plus une urgence de santé publique de portée internationale » et prônait « le retour à la normale ».
Avec « au moins 20 millions de morts » selon directeur générale de l’OMS, (1) la pandémie de Covid-19 a révélé de manière éclatante la décrépitude du capitalisme mondial mais aussi l’incurie et le cynisme avec lequel États et gouvernements ont « géré » la situation. Face au délabrement des systèmes de santé partout dans le monde, fruit de décennies de crise économique et d’attaques massives, la classe dominante de tous les pays n’a eu que le mensonge, le vol, l’imposition arbitraire de « mesures de protection » tels que des confinements drastiques venant tout droit du Moyen-Âge. Et alors que les grandes puissances s’enorgueillissaient au printemps 2021 d’avoir produit des vaccins dans un temps record, force est de constater aujourd’hui qu’aucune politique vaccinale cohérente et généralisée n’est mise en place à l’échelle mondiale.
« Pourquoi faire ? », répondront les responsables des États ou des organismes internationaux. Puisque le Covid-19 peut désormais être considéré « de la même manière que nous considérons la grippe saisonnière, à savoir une menace pour la santé, un virus qui continuera de tuer, mais un virus qui ne perturbe pas notre société ou nos systèmes hospitaliers », comme le déclarait, il y a plusieurs semaines, le chef des programmes d’urgence de l’OMS, Michael Ryan. Cette déclaration illustre à elle seule l’état d’esprit de la bourgeoisie mondiale face aux effets macabres du capitalisme. Le Covid « saisonnier » pourra bien faire des centaines de milliers de morts par an dans le monde, tant qu’il « ne perturbe pas » le fonctionnement de la société capitaliste, vivons avec ! Voilà ce que prône désormais ouvertement tous les États et les gouvernements : l’indifférence la plus totale vis-à-vis de la santé des populations humaines aux profits des uniques intérêts de la bourgeoisie. Cette classe qui ne peut qu’employer les procédés les plus perfides et sournois pour tenter de cacher à la face du monde que son propre système n’a de cesse de plonger l’humanité dans l’abîme.
Toute autre fut la méthode employée par les soviets au cours de la Révolution en Russie alors que la classe ouvrière devait faire face aux ravages de la grippe espagnole, du typhus ou encore du choléra. Nous avons commencé à aborder cette question dans la Revue internationale en publiant un article relatif à l’évolution de la situation sanitaire dans la Russie des soviets en juillet 1919, un an après la mise sur pied du Commissariat de l’hygiène publique. (2)
Nous prolongeons ici la réflexion par la critique du livre La santé et la révolution écrit par un collectif d’auteurs. Si comme nous allons le voir, les auteurs ne peuvent s’empêcher de clore leurs études par un plaidoyer à peine voilé en faveur du capitalisme d’État, ce petit livre a le mérite de mettre en évidence le rôle central que joua la classe ouvrière organisée pour faire face aux défis sanitaires en plein processus révolutionnaire et face aux assauts de la contre-révolution menés par les armées blanches et les grandes puissances capitalistes européennes, « et néanmoins, dans les conditions matérielles parmi les plus difficiles qu’il soit possible d’imaginer, la méthode alors mise en œuvre par le prolétariat, notre méthode, en tout point opposée à celle de la bourgeoisie aujourd’hui confrontée à la pandémie du coronavirus, parvient à des résultats qui, à l’époque, constituent un pas en avant considérable ». (3)
Qu’elle fut donc cette méthode ? En quoi, celle-ci permis un pas en avant considérable et une expérience inestimable pour le futur ?
Face à l’urgence sanitaire et aux épidémies, la réaction de la classe ouvrière organisée en soviets
Au lendemain de la prise du pouvoir, la Russie se trouve dans une situation désastreuse. Trois années de guerre ont fait des ravages au sein de la société et accentué des fléaux déjà bien connus : la misère, la famine, les pénuries, la dégradation des infrastructures de santé ou de transports. Mais aussi de nombreuses épidémies telles que le typhus, le choléra, la variole, la diphtérie ou encore la tuberculose.
Ainsi, des défis gigantesques se posaient déjà à la révolution en Russie et ce d’autant, que son isolement rapide ne lui avait pas permis de trouver le soutien du prolétariat mondial. Mais comme le livre le met bien en évidence, la classe ouvrière en Russie puisa sa force dans son organisation collective et centralisée puisque les soviets furent au cœur de la prise en charge de la politique sanitaire. Ainsi, dès la prise du Palais d’Hiver, le comité révolutionnaire mis en place des détachements sanitaires à Petrograd et Moscou en vue de venir en aide aux blessés. Ces « secouristes de l’insurrection » étaient d’abord composés d’ambulanciers, d’infirmiers et d’infirmières militaires ralliés aux bolcheviques et aussi des ouvrières épaulant les médecins. Après quoi, les soviets étendirent les prérogatives des détachements à la prise en charge de l’ensemble de la santé civile. Un grand pas en avant fut ensuite franchi lorsque le gouvernement des soviets se dota d’un Commissariat du peuple à la santé. Désormais, la politique menée aussi bien pour faire face aux victimes de la guerre encore en cours comme aux épidémies fut l’œuvre des travailleurs eux-mêmes.
Cette politique globale tranche déjà drastiquement avec celle mise en œuvre par les différents États lors de la pandémie de Covid-19 consistant à imposer aux populations des mesures visant avant toute chose à pénaliser le moins possible la production capitaliste. Comme l’indique les auteurs du livre : « il n’a jamais été question de prendre des mesures pourtant de bon sens, comme la production massive de matériel médical par les États où la levée des brevets sur les vaccins pour que tous y aient accès. En effet, outre écorner ses profits, cela aurait attenté au droit sacro-saint de la bourgeoisie de disposer à sa guise de son capital. On a là une nouvelle démonstration de ce que la propriété privée des capitalistes passe toujours avant l’intérêt de la collectivité, et dans ce cas précis, de l’humanité tout entière ».
Pour contrer les épidémies, mobilisation et sensibilisation pour tous
Alors que les États n’ont pas hésité à recourir abondamment au mensonge « pour dissimuler les pénuries de masques, le manque de soignants, de lits de réanimation et de vaccins, et leur responsabilité dans cette situation », à aucun moment, il n’a été question de mobiliser la population dans la lutte contre la pandémie, les gouvernements préférant imposer les mesures sanitaires (confinement, port du masque…) par la coercition.
La politique menée par la « République des soviets » fut là aussi animée par une toute autre démarche. Dans toutes les batailles sanitaires qu’elle dût mener, la première mesure consistait à dire la vérité à la population : exposer le plus clairement possible l’état de la situation, les mesures de protection à adopter, le mode d’organisation préconisé pour faire face à la situation. Mais il s’agissait aussi d’appeler à la mobilisation des masses ouvrières. Ce fut le cas aussi bien au cours de l’épidémie de choléra qui frappa le Sud de la Russie ainsi que Moscou et Petrograd à partir de l’été 1918 que pour l’épidémie de variole en 1919 ou encore la grippe espagnole qui fit près de trois millions de morts en Russie. Cette méthode reposant à la fois sur l’adhésion et la participation de larges masses de la population et la centralisation de la politique menée par le gouvernement des soviets (Commissariat à la santé) fut pleinement mise en œuvre lors de l’épidémie de typhus entre 1918 et 1919. Comme l’indiquent les auteurs, l’expérience de la lutte contre l’épidémie fournit « les bases d’un nouveau système de santé reposant sur l’action des travailleurs eux-mêmes, la centralisation, la gratuité et la prévention ».
Dès lors, avec la fin de la guerre civile, des avancées notables furent réalisées dans la formation du personnel médical, la lutte contre la tuberculose, la prise en charge des addictions, la lutte contre la prostitution ou encore l’amélioration de la maternité. En un mot, la prise en charge de la société par la classe ouvrière permettait de l’arracher aux conditions « arriérées » dans lesquelles elle végétait.
Face au fléau des pandémies, il n’y a rien à attendre de l’État !
Dans la dernière partie de ce livre, les auteurs montrent à quel point la politique de santé connut une véritable régression sous le stalinisme. La dégénérescence de la révolution en Russie, s’exprimant notamment par la fusion du parti avec l’État et la dévitalisation totale des soviets, engendra une nouvelle classe dominante exploitant la classe ouvrière sous la forme d’un véritable capitalisme d’État. Par conséquent, la politique menée en matière de santé, n’avait plus pour but de participer à l’amélioration et à l’émancipation de la condition humaine mais à pouvoir permettre à l’État d’exploiter toujours plus la force de travail. La mise en place d’une « médecine du travail » menant des études sur les causes de certaines maladies et la mauvaise santé des travailleurs ou encore recensant les pathologies, n’avaient pas d’autre objectif : permettre une plus grande productivité, donc une plus grande exploitation de la classe ouvrière. De même, la création de crèches et de structures d’accueil pour les enfants plus âgés dans les usines ne fit qu’enchaîner toujours plus les ouvriers et les ouvrières à leur lieu de travail et à l’État capitaliste.
Cependant, entichés du catéchisme gauchiste, notre groupe d’auteurs ne peut s’empêcher de trouver dans la barbarie stalinienne des résidus de la période révolutionnaire : « Le système de santé soviétique, tel qu’il perdura pendant plusieurs décennies, était envié par beaucoup […]. Dans des pays comme les Démocraties populaires en Europe de l’Est ou à Cuba, qui sans avoir connu de révolution ouvrière tentaient d’échapper, entre autres, à leur retard dans le domaine médico-social, on prit donc pour modèle le système de santé soviétique. Avec ses avantages, on l’a vu, ainsi qu’avec ses tares : celles d’une société dominée, écrasée par la bureaucratie. Mais malgré tout, et même s’il ne devint jamais un système de santé socialiste, ce système de santé conserva longtemps des traits de son caractère populaire, novateur et progressiste d’une révolution ouvrière victorieuse ».
Les prétendues prouesses médicales des « économies soviétiques » relèvent davantage de la farce plutôt que de la réalité historique. En URSS comme chez tous ces pays satellites, les populations manquaient de tout. Aussi bien de nourriture que de médicaments. Les auteurs reprennent ici à leur compte un vieux mensonge propagé par les canailles de la gauche et de l’extrême gauche du capital consistant à présenter un État tel que Cuba comme le nec plus ultra de la médecine. La pandémie a rappelé l’état de délabrement sanitaire de cet autre résidu du stalinisme. Puisque là-bas aussi les soignants durent faire face à l’afflux de malades sans disposer suffisamment de médicaments, d’oxygène, d’antigènes, de gel ou de seringues, etc.
Derrière ce clin d’œil nostalgique à la prétendue survivance des avancées de la révolution d’Octobre, via le stalinisme, se cache le credo consistant à considérer l’URSS comme un « État ouvrier dégénéré », perverti par la bureaucratie stalinienne. Aujourd’hui, cette erreur de Trotsky, repris à leur compte par les organisations de l’extrême gauche du capital comme Lutte ouvrière en France, sert à entretenir l’illusion qu’un État « bien géré » pourrait être un outil au service de l’intérêt général. Or, s’il est en apparence placé au-dessus des classes sociales, l’État demeure toujours l’expression de la domination d’une classe donnée dans la société. Dans le capitalisme, l’État incarne donc la domination de la bourgeoisie. De plus, depuis l’entrée du capitalisme dans sa période de décadence, la tendance générale vers le capitalisme d’État est une des caractéristiques dominantes de la société. La pandémie a pleinement confirmé que le capitalisme d’État, défendu bec et ongle par tous les partis de gauche et d’extrême gauche, n’est en rien une solution aux contradictions du capitalisme. Bien au contraire, il en est une claire expression, même s’il peut en retarder les effets au prix de leur amplification à terme ! (4)
S’il parvient un jour à renverser le capitalisme, le prolétariat devra poser les fondations de la société communiste dans un monde ravagé par les guerres, le dérèglement climatique et environnemental ou encore des problèmes sanitaires considérables. Cette tâche gigantesque ne s’effectuera pas avec le concours de l’État mais contre celui-ci, en vue de son dépérissement et sa disparition.
Surtout, cette tâche sera l’œuvre de la classe ouvrière elle-même, organisée et consciente de ses buts. Pour cela, s’appuyer sur les expériences du passé, comme la révolution d’Octobre 1917, et savoir en tirer les leçons essentielles demeure une tâche indispensable pour bâtir la société du futur !
Vincent, 7 mai 2023
1 Pour le moment, le décompte officiel fait état de 7 millions de morts.
2 « La prise en charge de la santé dans la Russie des soviets », Revue internationale n°166, (premier semestre 2021).
3 Ibid.
4 – « La pandémie de Covid et la période de décomposition du capitalisme », Revue internationale n°165, (deuxième trimestre 2020).
– « Pandémie et développement de la décomposition », Revue internationale n°167, (deuxième semestre 2021).
Histoire du mouvement ouvrier:
- Révolution Russe [217]
Récent et en cours:
- Coronavirus [55]
- COVID-19 [56]
- Grippe espagnole [613]
Rubrique:
ICConline - juillet 2023
- 33 lectures
Naufrage de migrants en Méditerranée: le capitalisme tue pour défendre ses frontières
- 73 lectures
Une fois de plus, un naufrage ayant occasionné des centaines de disparus a eu lieu en Méditerranée, le 22 juin, au large de l’île italienne Lampedusa. Ce drame est survenu seulement huit jours après le naufrage d’une embarcation aux bords des côtes grecques. Mais ce qui est présenté comme un simple fait divers est en réalité une expression du chaos engendré par la crise dans laquelle s’enfonce le capitalisme.
La mort de dizaines de personnes dans des naufrages devient un événement récurrent. La plupart de ces voyages de fortune débutent en général au Maghreb mais de nombreux migrants proviennent, en fait, d’Afrique subsaharienne. Ainsi, les principaux pays dont sont issus les victimes de ce naufrage proviennent de la Côte d’Ivoire, du Burkina-Faso et du Cameroun. La raison de leur départ est principalement la dégradation des conditions de vie dans leur région d’origine et l’espoir de bénéficier d’un meilleur avenir. En effet, les conflits sanglants qui font régner le chaos dans ces pays rendent le simple fait d’habiter dans ces régions un calvaire.
Les guerres civiles, comme au Soudan actuellement ou au Mali, la multitude de conflits armées depuis des décennies, l’instabilité de nombreux États et gouvernements, le poids croissant des groupes terroristes comme Boko Haram ou l’État Islamique, des seigneurs de la guerre, tout cela a des conséquences dramatiques sur la population et l’oblige à fuir. Et avec le déséquilibre climatique qui cause de nombreux dégâts environnementaux, il y a encore d’autres facteurs qui pousseront les habitants de ces pays à fuir ce chaos, notamment le manque d’eau et les conséquences des sécheresses sur l’agriculture.
Les conflits ayant eu lieu dans ces pays sont, en grande partie, la conséquence des velléités impérialistes des grandes puissances qui cherchent chacune à défendre leurs sordides intérêts, tout en alimentant un chaos généralisé, une situation toujours plus incontrôlable sur le continent.
L’exploitation sauvage des ressources naturelles par les firmes européennes, américaines, russes ou chinoises, les velléités commerciales et stratégiques de ces mêmes puissances prêtes à tout pour tenter de conserver leur influence et faire main basse sur les ports, les chantiers, les marchés en tout genre… tout cela a des conséquences désastreuses sur la population. Des conséquences dont la bourgeoisie locale, corrompue jusqu’à la moelle, n’a que faire tant qu’elle peut continuer à se gaver en se maintenant coût que coût au pouvoir.
Les grandes puissances subissent donc, à travers des vagues migratoires incontrôlables, le retour de bâton de leurs politiques et de leurs interventions. Étant donné que la marge de manœuvre du capitalisme est de plus en plus réduite dans sa recherche de profit, les bourgeoisies de tous les pays ne peuvent s’encombrer de « bons sentiments » et n’ont donc comme seul choix que de se débarrasser de ce qu’elles perçoivent comme un « problème », de manière inhumaine. Les pays centraux se sont ainsi transformés en véritables forteresses, administratives et militaires : murs, barbelés, camps de concentrations, violences policières… Cela est illustré par la récente opération à Mayotte où depuis des années les autorités locales ont encouragé la haine contre les migrants comoriens. Mais les principaux pays centraux ne peuvent pas se charger eux-mêmes de tout le sale boulot, ils sous-traitent aussi la tâche à d’autres pays, comme la Turquie.
La Libye est devenue une illustration tragique de cette réalité. Après l’intervention de la coalition composée de la France, de la Grande-Bretagne et des États-Unis contre le régime de Kadhafi, la Libye est devenue une zone de non-droit, où règne la pègre, les petits chefs de guerres et une barbarie sans nom. Le pays s’est ainsi transformé en passage obligé pour de nombreux candidats à l’immigration vers l’Europe. Elle est ainsi un serviteur exemplaire et sans scrupule dans le rôle de garde-frontières de l’Union européenne. Un pays tortionnaire dont les récentes guerres civiles ont montré la brutalité dont le gouvernement est capable. On évoque notamment des trafics d’êtres humains. Le témoignage d’une des membres de la Mission d’Enquête de l’ONU sur la Libye, malgré le fait que cette initiative émane d’un repaire de brigands, est à ce titre édifiant : « Le soutien apporté par l’UE aux garde-côtes libyens en termes de refoulements, d’interceptions, conduit à des violations de certains droits de l’Homme. On ne peut pas repousser les gens vers des zones qui ne sont pas sûres, et très clairement les eaux libyennes ne sont pas sûres pour l’embarquement des migrants » ? (1) Cette situation dure depuis plusieurs années et montre la vacuité des discours soi-disant progressistes et humanistes de l’UE.
L’Europe est loin d’être le seul continent faisant preuve d’hypocrisie sur leur prétendu humanisme. L’action des États-Unis, défenseurs de la « démocratie » et des « libertés civiques », en est un autre exemple frappant. Malgré toute la campagne médiatique hypocrite autour du « mur » de Donald Trump, il existait, en réalité, déjà un grillage dans certaines parties de la frontière mexicaine construit par George Bush et Bill Clinton afin de réguler le nombre de migrants clandestins. Avant 2019, cette barrière couvrait une grande partie de la Californie et de l’Arizona.
Mais il ne faudrait pas tomber dans le piège de la défense des « droits » des migrants. Les associations d’aide aux réfugiés et la gauche du capital font persister les illusions d’un État pouvant être réformé afin de mieux prendre en compte leur situation. C’est pour cette raison que les médias mettent parfois en avant des organisations telles qu’Amnesty International : ces groupes politiques récupèrent l’indignation légitime d’une partie de la population pour l’entraîner dans des luttes parcellaires stériles. Le quinquennat du « socialiste » François Hollande a montré toute la solidarité dont l’État peut faire preuve envers les roms ou les africains.
Contrairement à ce que ces soi-disant humanistes prétendent, il n’y a pas à réclamer à l’État bourgeois de respecter les réfugiés. Il s’agit d’une mystification pour le prolétariat. Pour tous les États, la force de travail de la classe ouvrière n’est qu’une marchandise. Et le bien-être de la population mondiale n’est dans leurs esprits qu’un mensonge, un simple vernis pour assurer l’exploitation. Les réfugiés sont des victimes de la phase finale du capitalisme et le seul moyen d’arrêter ce désastre est la lutte du prolétariat avec ses frères de classe, quelles que soient leurs origines.
Edgar, 2 juillet 2023
1“En Libye, le calvaire des migrants et réfugiés” [614], Deutsche Welle (4 avril 2023).
Récent et en cours:
- Migrants [343]
Rubrique:
Sur le blog "Le prolétariat universel": Des bavardages irresponsables qui font le jeu de la bourgeoisie
- 448 lectures
« Fin du match », ainsi s’intitule le dernier texte publié sur le blog Le Prolétariat universel tenu par le sieur JLR.
En tête, se trouve un photomontage sur lequel est écrit « Le palmarès des menteurs ». On y voit, autour, en photo, les têtes de Macron, de Le Pen, de Mélenchon, de Martinez… et d’un militant du CCI ! D’ailleurs, pour que la cible ne fasse aucun doute, le sigle « C.C.I » barre l’ensemble en lettres majuscules. L’image introduit un long texte dans lequel JLR passe son temps à traiter le CCI de menteur. Un menteur pire que Macron, Le Pen, Mélenchon, Martinez donc… à en croire le photomontage.
Quand l’irresponsabilité débridée mène à la calomnie…
« Calomniez, calomniez, il en restera toujours quelque chose » (Francis Bacon).
JLR a un désaccord avec le CCI sur l’analyse du mouvement social contre la réforme des retraites. Pour le CCI, ce mouvement s’inscrit dans la dynamique internationale enclenchée en juin 2022 au Royaume-Uni, avec sa série de grèves et son « été de la colère » : face à l’aggravation de la crise économique mondiale, la classe ouvrière des pays centraux commence à relever la tête et à retrouver le chemin de la lutte. Pour JLR, la série de manifestations en France n’a été qu’une mascarade syndicale qui a emmené les ouvriers atones à une nouvelle défaite. Soit. Le CCI n’a jamais eu aucun problème avec ce type de désaccord, cela devrait même être l’occasion de débats et de confrontation des positions. Arguments à l’appui…
Mais non, JLR n’est pas intéressé par le débat et la clarification, il préfère accuser à tort et à travers. À l’appui de sa démonstration, JLR lâche ce qui est censé être la preuve des mensonges du CCI : « Pour se mentir à lui-même sur le soi-disant “réveil international du prolétariat”, on peut même se servir d’un petit mensonge, dérisoire tant il est ridicule : “Ce n’est pas un hasard si le slogan le plus populaire brandi sur les pancartes était : ‘Tu nous mets 64, on te re-Mai 68’.” Or que nenni, ils avaient repiqué une photo que j’avais prise de trois jeunes lycéennes avec leur petite affiche, assises sur un trottoir, et auxquelles personne ne prêtait attention ».
C’est tout ?… Oui, c’est tout. Pour juger du « petit mensonge » du CCI, il suffit de taper dans n’importe quel moteur de recherche sur Internet « Tu nous mets 64, on te re-Mai 68 » : on verra apparaître des centaines de photos de manifestants brandissant ce slogan sur leurs pancartes.
Il n’y a rien de « dérisoire » ni de « ridicule » dans ces accusations infondées proférées par JLR. Avec son photomontage, JLR associe un militant du CCI aux crapules de la bourgeoisie. Il met sur le même plan les militants communistes et les dirigeants bourgeois. De tels propos, qui s’apparentent à de la calomnie, ne peuvent qu’agir comme un épouvantail pour tous ceux qui commencent à s’intéresser aux positions révolutionnaires, aux organisations communistes et à leurs débats.
Aujourd’hui, les forces révolutionnaires sont encore maigres. Les minorités en recherche des positions de classe, peu nombreuses, sont précieuses. Elles représentent l’avenir. Les gagner au camp révolutionnaire, leur permettre de s’organiser, de s’approprier les principes et l’expérience de la Gauche communiste est un enjeu vital pour le futur des organisations révolutionnaires, pour le futur des luttes du prolétariat, pour la possibilité de la révolution. Rien de moins.
Et voilà JLR qui salit sans retenue le CCI et, à travers lui, la tradition de toute la Gauche communiste. Il n’y a ici, finalement, aucune autre préoccupation que sa petite personne, son bon plaisir, au sein de l’imaginaire politique qu’il s’est créé.
Il faut reconnaître que l’hostilité de JLR envers le CCI est très fluctuante. Il lui arrive même d’écrire des mots élogieux envers notre organisation. Puis, un autre jour, il la couvre de boue et d’insultes. Ainsi, on peut lire dans un article de son blog, au sujet de l’une de nos réunions publiques à laquelle il a participé : « Le meilleur hommage à la tenue de cette réunion est venu de personnes que j’avais invitées directement :“une réunion où l’on pouvait s’exprimer librement, contrairement aux autres groupes politiques, et discuter de problèmes qui sont exclus des médias”. Une réflexion touchante aussi d’un vieux sympathisant du CCI :“un lieu où l’on pouvait échapper au sentiment de solitude” ». Et quelques jours plus tard, il peut qualifier ce même CCI de « secte néo-stalinienne » ou de « secte délirante étrangère au prolétariat ».
Que JLR puisse saluer les positions et démarches du CCI qu’il estime correctes tout en critiquant celles avec lesquelles il est en désaccord ne pose strictement aucun problème. Bien au contraire ! Mais ce n’est pas de cela qu’il s’agit. De toute évidence, le jugement global que JLR porte sur notre organisation dépend grandement de son humeur du moment. Il s’agit là d’un comportement totalement irresponsable. (1)
… et au mouchardage
Seulement, l’irresponsabilité peut mener au pire. Le blog de JLR regorge d’informations sur les militants qu’il peut parfois qualifier de « pervers-narcissique », de « fous »… Tout y passe, la description des couples et de leurs rapports, des précisions sur leurs enfants… La vie des militants étalée sans retenue.
Pourtant, on peut lire sur ce même blog ce type de remarques : « les RG vont-ils vraiment à nouveau s’intéresser au mouvement maximaliste ? (2) Pas seulement par leurs incursions masquées sur le web ? ». Mais, comme pour le reste, ce genre de réflexion passe avant que ça ne le reprenne, et JLR déblatère le lendemain sur la vie des uns et des autres.
À force d’irresponsabilité et d’inconséquence, le voilà conduit à publier la photo d’un militant du CCI. Pour le plus grand plaisir des RG et de « leurs incursions masquées sur le web ». En affichant ainsi le visage d’un militant du CCI, JLR fait le jeu des ennemis déclarés du CCI et de la bourgeoisie.
En fait, cette sorte de délation a même été permise et encouragée par tous ceux qui utilisent le mouchardage comme une arme contre le CCI pour le détruire, notamment la FICCI (aujourd’hui appelée GIGC) dont c’est même la spécialité, la marque de fabrique. (3)
L’histoire du mouvement ouvrier démontre que ce type de mouchardage a toujours préparé et accompagné la répression des organisations révolutionnaires et de leurs militants. La divulgation d’informations sensibles à leur sujet participe directement de la répression en vue de les détruire, et en forme le premier stade. En janvier 1919, c’est la social-démocratie elle-même qui se chargea des mensonges, des diffamations et des appels à la haine qui conduisirent à l’assassinat de Rosa Luxemburg et de Karl Liebknecht.
Aujourd’hui, pour réaliser ce travail, de sape, pour entretenir la suspicion envers les organisations révolutionnaires et même exhaler l’effluve nauséabonde des pogroms, la bourgeoisie n’a pas besoin de se mouiller directement, elle peut compter sur cette fange parasitaire, prête à tout, et gratuitement. Sans partager ce but détestable, JLR se retrouve sur son blog, à alimenter ce marigot à force d’irresponsabilité et de ne pas réfléchir plus loin que son nombril.
La responsabilité de toute la Gauche communiste contre les comportements indignes
La question qui se pose maintenant aux organisations révolutionnaires et à tous ceux qui partagent leurs positions et leur combat est : comment lutter contre ces comportements indignes et destructeurs ?
L’irresponsabilité sans entrave de JLR est encouragée par tout le milieu parasitaire qui se vautre dans la calomnie et le mouchardage. Ce milieu parasitaire peut se répandre d’autant plus facilement qu’il ne rencontre aucun obstacle, aucune digue.
À l’image de ce monde pourrissant, les individus et les groupes prêts à tout, aux coups les plus bas et les plus sordides, prolifèrent. L’usage de la calomnie, et, pour certains, la pratique du mouchardage, incarnent de façon répugnante la haine de l’organisation politique du prolétariat et la volonté de la détruire, propre au parasitisme. Mais le laisser-faire d’une grande partie des groupes de la Gauche communiste, l’absence de réaction année après année, calomnie après calomnie, mouchardage après mouchardage, facilite ce sale boulot. En restant silencieuses, une grande partie des organisations révolutionnaires offrent en réalité un blanc-seing, presque un encouragement à tous ces comportements destructeurs.
Ne rien dire, ce n’est pas seulement manquer de la plus élémentaire solidarité qui doit primer entre les groupes historiques de la Gauche communiste, c’est aussi laisser notre tradition et nos principes être traînés dans la boue, c’est hypothéquer l’avenir. Sans réaction ferme face à la calomnie et au mouchardage, sans une défense visible et intransigeante des principes de la Gauche communiste, sans une solidarité en acte entre organisations révolutionnaires, (4) tout le marigot putride du parasitisme ne pourra que continuer à se développer, à écœurer les minorités en recherche et à détruire.
Nous appelons aussi tous nos lecteurs à participer à cette réaction, à prendre position et à lutter contre ces agissements, à œuvrer pour la solidarité prolétarienne et la défense des principes du camp révolutionnaire et de ce qui constitue son arme la plus précieuse : l’organisation politique du prolétariat.
CCI, 19 juin 2023
1 « C’est une tradition : les ennemis de l’action, les lâches, les biens installés, les opportunistes ramassent volontiers leurs armes dans les égouts ! Le soupçon et la calomnie leur servent à discréditer les révolutionnaires » (Victor Serge).
2 C’est ainsi que JLR désigne les organisations de la Gauche communiste, et notamment le CCI.
3 Pour connaître la liste non-exhaustive des méfaits de ce groupe aux méthodes policières, lire par exemple sur notre site : « Attaquer le CCI : la raison d’être du GIGC [615] ». Nous reviendrons sur la FICCI/GIGC prochainement dans notre presse.
4 En 2002, le BIPR (aujourd’hui Tendance communiste internationaliste) et l’un de ses sympathisants vivant aux États-Unis (prénommé AS) ont été attaqués par le groupe Los Angeles Workers Voice (LAWV). Le BIPR avait ainsi dénoncé le LAWV pour « avoir recours à la calomnie » et avait fort justement affirmé qu’un tel comportement « interdit toute discussion ultérieure ». Le CCI avait immédiatement et publiquement apporté sa solidarité au BIPR et dénoncé, lui aussi, le LAWV. Notre article, « Milieu politique prolétarien : Une attaque parasitaire contre le BIPR », avait pour objectif de défendre tant le BIPR et le sympathisant AS que l’honneur de toute la Gauche communiste.
Vie du CCI:
Courants politiques:
- FICCI - GIGC/IGCL [524]
Rubrique:
ICConline - août 2023
- 49 lectures
Le parasitisme politique n'est pas un mythe, le GIGC en est une dangereuse expression
- 614 lectures
Dernièrement, après une intervention de nos militants dans une réunion du comité NWBCW[1] à Paris, présidée côte à côte par un élément du GIGC et un membre de la TCI, le GIGC ironisait sur le fait que celle-ci constituait la reconnaissance du fait que nous ne croyions pas un seul mot de notre analyse du « parasitisme » du GIGC[2]. Dans l’article, Attaquer le CCI : la raison d’être du GIGC [615], nous avons pointé cette manifestation supplémentaire de la nature parasitaire de ce groupuscule dont l’objectif fondamental consiste à attaquer les groupes politiques de la Gauche communiste et de miner le développement du milieu politique prolétarien.
Il y a deux ans déjà, nous avions écrit un article consacré à la dénonciation des agissements du GIGC (ex FICCI) à travers le soutien qu'il avait apporté à une tentative d'usurpation de la Gauche communiste par un aventurier nommé Gaizka[3] dont nous avions exposé la trajectoire. Depuis lors, le GIGC n'a cessé de multiplier les attaques contre le CCI dans le seul but de jeter le discrédit sur notre organisation et susciter la méfiance à son égard.
C'est pourquoi nous avons décidé de publier un ensemble d'article rassemblés dans un "dossier" regroupant les différentes réponses que nous opposons aux calomnies du GIGC visant, pêle-mêle : - le concept de parasitisme politique qui appartient au patrimoine du mouvement ouvrier ; - notre dénonciation de l’aventurisme politique auquel le GIGC apporte son soutien ; - la cohérence révolutionnaire de notre plate-forme ; - notre analyse de la phase actuelle de la décadence du capitalisme, celle de sa décomposition ; notre intervention dans la situation mondiale tant face à la guerre qu'à la lutte de classe ; - ou encore notre position face la mouvance anarchiste à propos de l'internationalisme et de sa trahison. Ces questions sont abordées dans les articles suivants :
- Les fondements marxistes de la notion de parasitisme politique et le combat contre ce fléau [616]
- Le GIGC tente de discréditer la plateforme du CCI [617]
- Défense de la plateforme du CCI : les nouveaux mensonges du GIGC [618]
- Face aux mensonges et embrouilles du GIGC, défense de l'intervention du CCI face à la guerre [619]
- La complaisance du GIGC avec l'aventurisme une fois de plus vérifiée (à paraître)
- Les déformations infâmes du GIGC concernant la caractérisation de l'anarchisme par le CCI (à paraître)
Cette série de dénonciations des agissements du GIGC s’imposait afin de ne pas laisser sans réponse des calomnies ou des falsifications de la réalité dont le CCI est la cible de la part de ce groupe parasitaire. Nous aurions évidemment préféré dédier nos forces à d'autres activités plus en prise avec la situation mondiale, mais nous nous retrouvons confrontés à une situation comparable à celle du Conseil général de l'AIT, face à un ennemi intérieur alors constitué par l'Alliance de Bakounine. Aujourd'hui un tel "ennemi intérieur", le GIGC, sévit au sein de la Gauche communiste.
[1] Pas de guerre sauf la guerre de classe. Lire notre article, "No war but the class war à Paris : Un comité qui entraîne les participants dans l’impasse" [521].
[2] Dans l'article Impasse et contradictions du CCI face au "parasitisme", à la TCI et au GIGC [620].
[3] Lire L'aventurier Gaizka a les défenseurs qu'il mérite : les voyous du GIGC [621]. (février 2021)
Vie du CCI:
Personnages:
- Gaizka [622]
Courants politiques:
Rubrique:
Hommage à notre camarade Antonio
- 247 lectures
Notre camarade Antonio nous a quittés ce printemps, à la veille de la tenue du 25e congrès international du CCI. Il était l'un des vieux militants fondateurs de Révolution internationale (RI – section en France du CCI) encore présents dans l'organisation. Le congrès lui a rendu un premier hommage, soulignant notamment "son courage et sa modestie", tant dans sa vie personnelle que militante.
L'influence de Mai 68 et de la Gauche communiste
En 1965, comme d'autres étudiants de l'université de Madrid interpellés par le développement des luttes ouvrières dans les Asturies, il commence à se préoccuper de politique dans un contexte où le point de vue de classe doit se frayer un chemin au sein de la confusion ambiante des chants de sirène de "l'opposition démocratique" au régime. Antonio se méfiait alors du PCE (Parti Communiste Espagnol) en raison du stalinisme de celui-ci, mais il a dû aussi apprendre à se méfier du discours de la poignée de groupes trotskystes et maoïstes apparus à cette époque et qui, bien que d'apparence plus ouverte et à "gauche" que le PCE, ne constituaient rien d'autre qu'une version plus radicale de la gauche du capital et tout autant contre-révolutionnaire. Cet intérêt du camarade pour les positions révolutionnaires est à l'origine de son émigration en France, où il arrive à Toulouse en 1967.
Il avait alors des préoccupations culturelles - à cette époque il faisait du théâtre en langue espagnole - qu'il n'abandonnera en fait jamais par la suite, même si elles ont dû souvent s'effacer face à des contraintes familiales ou politiques. Dans l'atmosphère d'effervescence politique de réflexion et discussion d’avant 68, et surtout pendant les évènements, il a alors trouvé des réponses aux questions qu'il se posait. Dans ce contexte, il a su s'inscrire d'amblée dans une véritable perspective internationaliste, intéressé par l'expérience historique du prolétariat en évitant le piège de l'enfermement dans une approche "d'immigré" fixée sur la situation et l'histoire du pays d'origine.
Comme il le dit lui-même, la première discussion en France qui l'a aidé à rompre avec l'atmosphère gauchiste de Madrid a été celle qu'il a eue avec certains des membres fondateurs de Révolution internationale sur la nature impérialiste de la guerre du Viêt Nam, sur la nécessaire défense de l'internationalisme prolétarien et de la solidarité ouvrière, et cela en opposition à l'idée de "guerre révolutionnaire" défendue par les trotskistes et les maoïstes.
Il rencontrera par la suite Marc Chirik (MC) lors d'une réunion en 1968 avec les autres membres fondateurs de Révolution internationale et des "militants" situationnistes. Face à ces derniers, MC défend la nature prolétarienne de la révolution russe de 1917, la réalité de la classe ouvrière en tant que sujet révolutionnaire de l'histoire et la nécessité d'une organisation révolutionnaire. Cette même année, il participe également à la réunion qui approuve la première plate-forme de Révolution internationale, basée sur les principes politiques de l'Internationalisme dont MC a hérité de la Gauche Communiste de France et ensuite transmis.
Il revient en France en 1969 au moment où le noyau initial de Révolution internationale voit ses forces se réduire du fait de certaines démissions mais également parce qu'une majorité de militants toulousains avaient rejoint la capitale.
Derrière une attitude de façade pouvant paraître hésitante, une profonde implication et conviction militante animait Antonio ….
Bien qu'il ait déclaré postérieurement, "je n'étais pas un militant", en parlant de l'époque de 1968, il reprend pleinement l'activité dans Révolution internationale en 1970, puis participe en 1972 au regroupement avec les Cahiers du communisme de conseils de Marseille et le groupe de Clermont Ferrand, d'où émergera la 2ème plate-forme de RI en tant que groupe politique avec une implantation territoriale à la recherche de contacts internationaux. En 1975, il participe au premier congrès du CCI et restera militant jusqu'à la fin de sa vie. Au moment où le mouvement de lutte de classe dans ce pays est à son apogée et que l'État accélère sa politique de "transition démocratique", la publication "Acción Proletaria (AP)" en Espagne ne peut plus être assurée. Pour y faire face, le CCI décide à son premier congrès international de maintenir la publication régulière d'AP, en produisant le journal en France et l'introduisant ensuite clandestinement dans l'Espagne de la fin du franquisme. Sa collaboration à cette publication est alors particulièrement appréciée en raison de la capacité du camarade à analyser finement les manœuvres démocratiques de la "transition" en Espagne, et à les dénoncer en profondeur. Du fait de sa maitrise de deux langues – il était professeur d'espagnol en France - il devait également, à partir de 1975, s'impliquer dans la production en espagnol de la Revue internationale. Le camarade a toujours su placer l'accomplissement de ces responsabilités dans une perspective internationale et historique.
Afin d'organiser et systématiser l'intervention en langue espagnole et la recherche de contacts dans l'espace hispanophone, le CCI nouvellement constitué prend l'initiative de nommer une Commission de langue espagnole (CLE) avec Antonio en son sein. De ce fait, Antonio participait régulièrement aux voyages en Espagne et aux discussions avec les contacts, apportant sa conviction et son assimilation des positions du CCI. Les camarades qui ont voyagé avec lui ont pu apprécier sa très grande sympathie, sa vaste connaissance encyclopédique mais aussi et surtout son humour. Nous y reviendrons !
Antonio a participé à pratiquement tous les congrès internationaux du CCI faisant alors partie d'équipes de traduction simultanée remarquablement efficaces – à un point tel que des scientifiques ayant été invités à une séance d'un congrès furent impressionnés par la qualité du travail. Mais Ils n'ont pas non plus manqué d'être surpris par les commentaires d'Antonio durant les pauses, destinés à éclairer des camarades des délégations espagnole, mexicaine ou vénézuélienne sur des parties d'intervention mal comprises, …. mais ils furent aussi surpris par l'utilisation du micro par Antonio pour faire des blagues.
Une loyauté indéfectible à l'organisation et à la cause, dans les circonstances les plus variées
Dans les moments difficiles de la lutte de l'organisation contre l'esprit de cercle et pour l'esprit de parti, Antonio a toujours choisi la défense de l'organisation. Bien que doté d'une disposition naturelle à créer des liens d'affinité avec des camarades, il ne s'est cependant jamais laissé emporter aveuglément par "la défense de ses amis" contre les principes organisationnels du CCI. Et lorsque certains d'entre eux ont quitté l'organisation avec des ressentiments à son égard, Antonio a maintenu sa loyauté envers le CCI même si cela pouvait impliquer un éloignement personnel vis-à-vis de ses anciens amis.
Les "Antonionades" d'Antonio
Tout en reconnaissant certaines de ses erreurs ou négligences, manques ponctuels d'attention ou d'implication, le camarade les rangeait souvent dans la catégorie de ses "Antonionades". En fait il s'agit là d'une catégorie qui était suffisamment large pour inclure également des sketchs où le camarade se plaisait à faire le "pitre" pour notre distraction à tous.
Ainsi, souvent, à l'occasion de rencontres festives comme en particulier les premiers de l'an, notre camarade savait mettre en scène sa bonne humeur, son humour jamais caustique mais souvent taquin, subtil et amical vis-à-vis de ses camarades. En effet, à son répertoire figurent en très bonne place des sketchs improvisés mettant en scène des proches et des camarades de l'organisation. Au service de son "art" il savait exploiter les subtilités et les pièges des langues française et espagnole - parfois même de l'occitan. Il pouvait ainsi passer des heures à animer des réunions conviviales entre camarades et partager sa bonne humeur.
Mais "l'Antonionade" pouvait également se manifester dans des situations tout à fait différentes qui n'avaient rien de festif et traduisaient une audace particulière de notre camarade.
Ainsi dans les années 1980, lors d'une diffusion par tracts sur les docks à Marseille - citadelle des gardiens cégétistes de l'ordre capitaliste - une équipe de diffusion du CCI se trouve rapidement aux prises avec une patrouille de "gros bras" de la CGT qui veulent nous faire déguerpir. Dans ces moments-là, le but est de tenir le plus longtemps possible en vue de diffuser le plus possible de tracts ce qui n'a rien d'évident en particulier lorsque les entrées se font compte-goutte. Et Antonio de s'esclaffer à la stupeur de tous, "ah mais je ne peux pas renoncer, je suis investi d'un mandat que je suis tenu d'assumer. Il faut que je termine cette diffusion !".
L'effet de sidération ainsi produit dans les rangs de l'escouade syndicale nous a permis de gagner de précieuses minutes de diffusion au terme desquelles le flux de dockers entrant pour prendre le travail nous mettait à l'abri des intimidations.
Néanmoins, sa vie militante n'était pas faite que d'Antonionades, comme en ont témoigné son implication régulière dans la vie de l'organisation ou encore le fait que c'est le même Antonio qu'on retrouve encore dans un épisode de défense d'une manifestation contre les tentatives d' incursion en son sein – mises en échec – par des flics pour y embarquer un jeune qui s'était rendu coupable d'un "bombage" sur un mur.[1]
Dans sa vie professionnelle, certaines "antonionades" sont un pur condensé d'humour, comme l'a rapporté et illustré un de ses collègues de fac venu à ses obsèques et qui par ailleurs soulignait à quel point Antonio respectait ses étudiants : Un jour où les étudiants semblaient ne pas écouter son cours, discutant entre eux dans l’amphi, Antonio ne fit pas de remarque particulière mais s’interrompit. Les étudiants surpris arrêtèrent leurs bavardages se demandant ce qui se passait. Alors Antonio reprit la parole et leur dit : "Aujourd’hui, j’ai l’impression d’être dans un bar en Espagne. Dans les bars en Espagne, la télé marche en permanence mais personne ne la regarde ni ne l’écoute. Mais si une personne s’avise de l’éteindre, il y a toujours quelqu’un pour dire : qui a éteint la télé ? Aujourd’hui je suis la télé du bar." Quel tact et quelle pédagogie !
Antonio, un père et un compagnon aimant, engagé face à l'adversité
Il a d'abord eu une fille qui a toujours soutenu son militantisme et entretenu une sympathie politique avec le CCI. Son deuxième enfant souffre depuis sa naissance d'un handicap physique et intellectuel important. En vue de pouvoir communiquer avec lui, Antonio a appris le langage des signes et a toujours été attentif à ce que le handicap de son fils ne l'éloigne pas de tout et de tous. Et, ensemble, les membres de la famille y sont parvenus! Entre autre, au prix d'un investissement jamais démenti d'Antonio. L'implication de notre camarade envers sa famille a dû encore s'accroître alors que sa compagne est tombée gravement malade. Durant des années, ils ont lutté côté à côte contre un cancer auquel elle a finalement succombé, épuisée par ce combat.
La tension entre les responsabilités personnelles d'Antonio et ses responsabilités militantes a été poussée au maximum à de nombreuses reprises. Comme il l'a dit lui-même, il a été plusieurs fois sur le point d'abandonner la lutte politique mais, finalement, il a gardé sa loyauté envers lui-même, sa famille et l'organisation, orientant sa vie et le soin de sa famille à partir de ce qui était sa passion et sa conviction : le militantisme communiste.
Nous voulons ajouter ici que la vie de ce camarade, qui a réussi à maintenir son militantisme pendant plus d'un demi-siècle (de 1968 à 2023) contre toutes sortes de pressions, constitue un exemple de ce que nous devons transmettre à la nouvelle génération de militants.
Bien qu'il ait été contraint, pendant de longues périodes, de réduire son implication militante, il a pu retrouver ces dernières années la flamme de cette passion en participant à des réunions communes avec des camarades de AP (Espagne), RI (France) et de Rivoluzione Internazionale (Italie), et s'impliquant dans des responsabilités organisationnelles.
Un autre paradoxe de notre camarade ou bien expression de sa très grande modestie ou manque de confiance en lui-même : à plusieurs reprises il a déclaré à des camarades qu'il avait du mal à intérioriser la signification de notre conception consistant à "mettre le militantisme au centre de notre vie". C'est pourtant ce qu'il a réussi à faire tout au long de sa vie !
La dernière "Antonionade" d'Antonio.
Peu de temps après le décès de sa compagne, Antonio avait eu une alerte cardiaque qu'il avait pris en charge tout seul en allant aux urgences en pleine nuit. Un jour plus tard, il en ressortait avec des artères débouchées et prêtes à reprendre du service. Il s'est en fait avéré qu'il avait d'autres problèmes cardiaques, traités par la suite et non réputés critiques mais néanmoins possiblement à l'origine de son décès subit, peu de temps après. Alors que nous avions insisté auprès de lui pour qu'il nous informe plus régulièrement de son état de santé il nous avait répondu que, dans son village natal, certaines personnes pour dire "je vous tiendrai au courant" se trompaient et disaient "je vous tiendrai à l'écart". Une nouvelle Antonionade ! La dernière.
Même si le camarade avait la préoccupation de ne pas "déranger" les autres il était néanmoins parfaitement conscient – et en avait déjà fait la preuve - de la nécessité sociale et politique de faire appel, à chaque fois que nécessaire, à l'organisation et ses militants. En fait, dans la réalité il nous tenait régulièrement informés de sa santé.
Nous avons cependant tous été surpris de son "départ précipité". Adieu camarade et ami.
Par contre, nous n'avons pas été surpris de la participation nombreuse aux obsèques de notre camarade, notamment d'anciens collègues à lui qui, à cette occasion, ont fait des témoignages touchants, mais non surprenants, concernant notamment le très grand respect d'Antonio pour ses étudiants.
Le CCI organisera dans les prochains mois un hommage politique à notre camarade Antonio. Les camarades désireux d'y participer doivent écrire au CCI et, en retour, la date et le lieu leur seront communiqués.
CCI (08/08/2023)
[1] Pour davantage de détail lire à propos de cet évènement l'article suivant Solidarité avec les lycéens en lutte contre la répression policière (témoignage d'un lecteur) [623]
Personnages:
- Antonio [624]
Rubrique:
La pseudo-"critique" de la plateforme du CCI par le GIGC - Un simulacre d’analyse pour discréditer le CCI et sa filiation politique (la Gauche communiste)
- 423 lectures
Le but de cet article n'est pas d’engager un débat sur la validité politique de notre plate-forme -ce à quoi nous sommes évidemment toujours disposés à travers une confrontation honnête de positions divergentes- mais de rétablir la réalité de celle-ci à travers la dénonciation de la démarche du Groupe International de la Gauche Communiste (GIGC) visant exclusivement à disqualifier nos positions, notamment en les présentant comme étant influencées par le conseillisme. Une telle influence se traduirait chez le CCI par une vision "économiciste", "mécanique", "fataliste", par la sous-estimation des luttes revendicatives, et affectant notre conception du parti et de la conscience de classe, etc.
Au-delà du nécessaire rétablissement de la vérité à propos de nos positions politiques ainsi travesties par le GIGC, nous mettons en évidence comment les moyens et procédés qu'il emploie au service de son entreprise de dénigrement sont totalement étrangers à la méthode du mouvement ouvrier et de la Gauche communiste en particulier.
I. Les tares conseillistes dont le GIGC affuble la plateforme du CCI sont de pures calomnies
Le GIGC nous dit que, dès sa constitution, il aurait entrepris, "un processus de clarification sur la plateforme du CCI[1], (…) qu'il avait rejetée comme étant ouvertement conseilliste[2]". Un tel diagnostic politique serait basé sur différentes observations déjà exposées dans certains des textes du GIGC et dont voici un échantillon :
- "La cohérence, indéniable de la PF du CCI, est basée sur une vision économiciste et fataliste qui est, elle-aussi, cohérente avec sa vision conseilliste qui se révèle de manière manifeste dans ses points sur le parti et la conscience de classe"[3]
- "Nous avons souligné la cohérence de la plateforme du CCI fournie par la distinction ascendance-décadence, pour l’essentiel réduite ici à ou bien réformes ou bien impossibilité de réformes, conception qui peut mener à la sous-estimation des luttes revendicatives. L’unité et la clarté d’exposition des frontières de classe en résultant est le point de force du document. La démarche et la compréhension mécanique et économiciste en est sa faiblesse. Elle est typique du matérialisme vulgaire propre au conseillisme qui développe une vision fataliste et mécanique de l’histoire au détriment de sa vision dynamique – marxiste – qui place la lutte des classes au centre et comme moteur de l’histoire."[4]
Pour qui connait les positions CCI, ces "critiques" sont grossièrement mensongères, mais tout le monde ne connait pas le CCI ou bien certains seulement à travers la vision qu'en donne la prose du GIGC, ce qui nous contraint de passer en revue l'essentiel de telles déformations basées sur le mensonge à propos des faits, le maquillage et la déformations des positions, la suggestion en lieu et place de la preuve ou de la concrétisation. Une autre d'entre elles consiste également dans l'occultation des développements politiques du CCI venant expliciter les points de notre plateforme[5].
A. Dans aucun de ses textes le CCI ne réduit le changement de période ascendance/décadence à la possibilité ou non d'obtention de réformes.
Pour aussi importante que soit la question de la possibilité ou non de l'obtention de réformes par le prolétariat dans la période de décadence du capitalisme, jamais dans notre plateforme le changement de période ne se réduit à cette question mais il est envisagé sous l'angle du développement des contradictions internes du capitalisme (Point 3 de la plateforme -La décadence du capitalisme) et ensuite sous l'angle des implications quant au mode d'organisation du capitalisme (Point-4 -Le capitalisme d'État) et enfin sous celui de la lutte de classe (Point-6 -La lutte du prolétariat dans le capitalisme décadent). C'est dans ce dernier point qu'est traitée la question de la possibilité ou non d'obtention de réformes, laquelle est déterminante pour fonder et comprendre la période de décadence :
- la possibilité et la nécessité de la révolution ;
- les formes prises par la lutte du prolétariat, la relation du prolétariat à son avant-garde et la forme prise par cette dernière.
B. Nulle part le CCI ne sous-estime les luttes revendicatives, tout au contraire
En effet, et le GIGC le sait très bien, pour le CCI, la lutte revendicative constitue le socle de granit du développement de la lutte de classe. Cela fait partie, en effet, de l'ADN de notre organisation puisque cette conception était déjà au cœur de la compréhension marxiste du groupe précurseur du CCI, Révolution internationale en France. Ainsi RI nouvelle série n° 9 (Mai-Juin 1974), dans l'article "Comment le prolétariat est la classe révolutionnaire [625]", s'exprime en ces termes : "Le processus à travers lequel la classe ouvrière s’élève à la hauteur de sa tâche historique n’est pas un processus distinct, extérieur à sa lutte économique quotidienne contre le capital. C’est au contraire dans ce conflit et à travers lui que la classe salariée forge les armes de son combat révolutionnaire".
Notre plate-forme ne dément pas une telle position de notre part : "Depuis plus d'un demi-siècle, les ouvriers ont éprouvé de moins en moins d'intérêt à participer à l'activité de ces organisations [les syndicats] devenues corps et âme des organes de l'État capitaliste. Leurs luttes de résistance contre la dégradation de leurs conditions de vie ont tendu à prendre la forme de "grèves sauvages" en dehors et contre les syndicats. Dirigées par les assemblées générales de grévistes et, dans les cas où elles se sont généralisées, coordonnées par des comités de délégués élus et révocables par les assemblées, ces luttes se sont immédiatement situées sur un terrain politique, dans la mesure où elles ont dû se confronter à l'État sous la forme de ses représentants dans l'entreprise : les syndicats". (Point 7 - Les syndicats : organes du prolétariat hier, instruments du capital aujourd'hui)
Et aujourd'hui encore, "L’aggravation inexorable de la crise du capitalisme est un stimulant essentiel à la lutte et à la conscience de classe. La lutte contre les effets de la crise est la base du développement de la force et de l’unité de la classe ouvrière. La crise économique affecte directement l’infrastructure de la société ; elle met donc à nu les causes profondes de toute la barbarie qui pèse sur la société, permettant au prolétariat de prendre conscience de la nécessité de détruire radicalement le système et de ne plus s’illusionner sur les possibilités d’en améliorer certains aspects.
Dans la lutte contre les attaques brutales du capitalisme, et surtout contre l’inflation qui frappe l’ensemble des travailleurs de manière générale et indiscriminée, les travailleurs développeront leur combativité, ils pourront commencer à se reconnaître comme une classe ayant une force, une autonomie et un rôle historique à jouer dans la société. Ce développement politique de la lutte de classe lui donnera la capacité de mettre fin à la guerre en mettant fin au capitalisme." (Le capitalisme mène à la destruction de l'humanité… Seule la révolution mondiale du prolétariat peut y mettre fin [626])
Si nous avons pris autant de place pour réfuter ce mensonge éhonté du GIGC, c'est justement parce qu'il est très préjudiciable à la compréhension – telle que la défend le CCI - du processus de développement de la lutte de classe jusqu'à la révolution.
C. Nulle part le CCI n'esquive la question de la fonction du parti
"Le dernier point, le plus long de toute la plateforme, sur l’organisation des révolutionnaires révèle clairement la contradiction qui a habité le CCI depuis ses débuts entre son approche et ses faiblesses congénitales d’ordre conseilliste et sa volonté de se réapproprier les leçons du mouvement ouvrier et particulièrement de la Gauche communiste. Certes, le parti est mentionné comme tel, formellement, abstraitement, en fait à reculons : 'l’organisation des révolutionnaires dont la forme la plus avancée est le parti (…) ; on peut alors parler de parti pour désigner l’organisation de cette avant-garde (…) ; la nature mondiale et centralisée de la révolution prolétarienne confère au parti...' Mais nulle part le rôle et la fonction du parti en tant qu’avant-garde et direction politiques du prolétariat ne sont évoqués."
Ce qui fonde la nécessité et le rôle de l'organisation révolutionnaire est présent sous forme condensée dans notre plateforme, si bien que toute citation partielle de celle-ci, comme le fait le GIGC, en altère nécessairement le sens. C'est pourquoi nous reproduisons en entier le paragraphe concerné : "L'organisation des révolutionnaires (dont la forme la plus avancée est le parti) est un organe nécessaire que la classe se donne pour le développement de la prise de conscience de son devenir historique et pour l'orientation politique de son combat vers ce devenir. De ce fait l'existence du parti et son activité constituent une condition indispensable pour la victoire finale du prolétariat."
Qu'est-ce que le GIGC a à redire à cette formulation si ce n'est des impressions ? Rien, du vent, … du bluff.
De plus, la plupart des positions défendues dans notre plateforme sont reprises, développées, précisées dans différents articles de notre presse, notamment dans la Revue internationale. C'est le cas en particulier concernant la question de "l'organisation des révolutionnaires" amplement développée dans des textes fondamentaux du CCI et dont le GIGC ne dit pas un mot bien qu'il en connaisse parfaitement l'existence. Quiconque les lit pourra se convaincre de toute l'importance que nous accordons à la question du parti, son rôle, son lien avec la classe ouvrière et le processus menant à sa formation. Nous engageons donc le lecteur à vérifier la validité de notre démenti en consultant les textes suivants :
- Rapport sur la fonction de l'organisation révolutionnaire [627]
- Rapport sur la structure et le fonctionnement des organisations révolutionnaires [628]
- Sur le parti et ses rapports avec la classe [629]
- Rapport sur le rôle du CCI en tant que "Fraction" [630]
D. Le GIGC peut bien dire qu'il a "dépassé le conseillisme de la plateforme du CCI", ce n'est pas cela qui prouve la validité de ses critiques à notre plateforme
Loin s'en faut !
Depuis le début, lorsqu'elle sévissait au sein du CCI jusqu'à sa transformation en GIGC, la FICCI proclamait à qui voulait bien l'entendre qu'elle était le meilleur défenseur des positions du CCI, bien meilleur que le "CCI opportuniste" ! Et ne voici pas que le propre GIGC se rend compte qu'en fait la plateforme du CCI était conseilliste ! La fin de la farce et de l'usurpation ? Rien de cela, la mauvaise farce continue avec les farceurs qui se sont adaptés. C'est ainsi qu'ils découvrent que notre plateforme est "basée sur une vision économiciste et fataliste qui est, elle-aussi, cohérente avec sa vision conseilliste qui se révèle de manière manifeste dans ses points sur le parti et la conscience de classe". Ils font valoir des clarifications politiques apportées par leur propre plateforme qui "essaie de fonder la cohérence et l’explication des frontières de classe à partir et autour de la question du parti et de la conscience de classe, et donc de l’histoire de la lutte des classes elle-même". Même si les faussaires du GIGC en étaient réellement convaincus, ce n'est pas cela, pas plus que toutes leurs critiques vides que nous avons réfutées, qui prouvent le conseillisme de notre conception du parti et de la conscience de classe. D'autant moins que la prétendue nouvelle source d'inspiration du GIGC n'est pas, de notre point de vue, la plus adaptée pour en juger : "Nous n’avons rien inventé. Nous avons juste été convaincus de la justesse politique de la démarche de principe des plateformes successives que la Gauche dite d’Italie avait adoptées, en particulier en 1945 et en 1952." [6] [7]
Pour sa part, comme il l'explique dans sa plateforme, le CCI se base sur "le marxisme qui est la seule conception du monde qui se place réellement du point de vue de la classe ouvrière :
- En expliquant la marche de l'histoire par le développement de la lutte de classe, c'est-à-dire de la lutte basée sur la défense des intérêts économiques dans un cadre donné du développement des forces productives ;
- En reconnaissant dans le prolétariat la classe sujet de la révolution qui abolira le capitalisme (point 1 - La théorie de la révolution communiste.)"
E. Le GIGC invente le "fatalisme" du CCI pour masquer son propre opportunisme vis-à-vis des principes
Plus précisément, il reproche au CCI une "vision fataliste et mécanique de l’histoire au détriment de la vision dynamique –marxiste– qui place la lutte des classes au centre et comme moteur de l’histoire".
Le GIGC ne disposant de rien de consistant pour fonder ses critiques, il procède par insinuation, à travers des "peut mener à …", quand ce n'est pas carrément la diffamation ouverte, le dénigrement, la calomnies, autant de domaines dans lesquels il excelle depuis qu'il est entré en guerre contre le CCI alors que ses "fondateurs" étaient encore membres de notre organisation.
Par contre, ce que l'histoire nous a appris c'est que lorsque l’opportunisme brandit la critique de "fatalisme" contre les positions de la Gauche c’est pour s'octroyer "souplesse" et "flexibilité" vis-à-vis des principes. C'était la signification des critiques formulées par Trotski à Bilan dans les années 1930 et par le PCInt à Internationalisme dans les années 1940. Ceci étant dit, loin de nous l'idée qu'on pourrait identifier le GIGC à Trotski ou au PCInt. Malgré toutes les critiques que le CCI a formulées à l'encontre de l'opportunisme de Trotski et de celui du PCInt, notre démarche est à l'opposé de celle qui, de quelque manière que ce soit, identifierait, le GIGC à ceux-ci. Ces derniers, malgré leurs faiblesses, faisaient partie du camp prolétarien. En revanche, le GIGC, depuis qu'il a vu le jour sous le nom de FICCI, se comporte objectivement comme un défenseur des intérêts de la bourgeoisie par les dégâts qu'il cause dans le milieu de la Gauche communiste. On retrouve ainsi une telle complaisance du GIGC vis-à-vis des principes à propos de la question syndicale, comme nous le verrons ci-après.
II. Le GIGC n'épargne aucun point de la plateforme du CCI de sa critique "radicale" et parfois ouvertement gauchiste
S'il s'agissait seulement de mettre en évidence la "méthode" du GIGC, les illustrations précédentes seraient largement suffisantes. Mais il s'agit également de défendre notre plateforme contre les attaques visant ses différents points, si bien que nous ne pouvons pas nous dispenser de traiter d'autres attaques du GIGC. Ce faisant, nous mettons en évidence comment certaines d'entre elles dissimulent mal une orientation clairement gauchiste.
A. Une critique insuffisante du Parlement ?
Cette attaque est destinée à induire l'idée selon laquelle c'est sans conviction que le CCI soutient les Thèses sur la démocratie écrites par Lénine pour le premier congrès de l'Internationale Communiste.
Selon le point 8 de notre plateforme relatif à "La mystification parlementaire et électorale", "dans sa phase de décadence, le Parlement cesse d’être un organe de réformes, comme le dit l’Internationale communiste au 2e congrès".
À ce propos, le GIGC émet le commentaire critique suivant : "les thèses [sur la démocratie bourgeoise écrites par Lénine] ne limitent pas la question à la seule impossibilité de réforme dans la décadence, loin s’en faut : "L’attitude de la 3e Internationale envers le parlementarisme n’est pas déterminée par une nouvelle doctrine, mais par la modification du rôle du parlementarisme même. Dans les conditions actuelles, caractérisées par le déchaînement de l’impérialisme, le Parlement est devenu un instrument de mensonge, de fraude, de violences, de destruction, des actes de brigandage, œuvres de l’impérialisme, les réformes parlementaires (…) ont perdu toute importance pratique pour les masses laborieuses." Comme on le voit, l’IC l’englobe dans une vision et une compréhension beaucoup plus large et au premier plan politique, c’est-à-dire au plan de la lutte des classes entre bourgeoisie et prolétariat dans les conditions définies par la phase impérialiste du capital."[8]
Ce que le GIGC s'empresse de ne pas dire ici c'est que les thèses de Lénine sont reproduites intégralement dans l'article suivant du CCI "La démocratie bourgeoise, c’est la dictature du capital [403]"[9], ce qui réduit à néant la critique d'une prétendue faiblesse de notre position sur cette question et illustre à nouveau la méthode retorse du GIGC. Quant à l'idée que ce point de notre plateforme ne prend pas en compte la fonction du Parlement dans la nouvelle période elle relève de cette démarche, "calomniez, calomniez, il en restera toujours quelque chose" (F. Bacon), quelle que soit l'inconsistance de la calomnie. En effet, à propos du Parlement, il est dit dans ce point de notre plateforme : "La seule fonction qu'il puisse assumer, et qui explique son maintien en vie, est une fonction de mystification. Dès lors, prend fin toute possibilité, pour le prolétariat, de l'utiliser de quelque façon que ce soit. En effet, il ne peut conquérir des réformes devenues impossibles à travers un organe qui a perdu toute fonction politique effective. À l'heure où sa tâche fondamentale réside dans la destruction de l'ensemble des institutions étatiques bourgeoises et donc du Parlement, où il se doit d'établir sa propre dictature sur les ruines du suffrage universel et autres vestiges de la société bourgeoise, sa participation aux institutions parlementaires et électorales aboutit, quelles que soient les intentions affirmées par ceux qui la préconisent, à insuffler un semblant de vie à ces institutions moribondes" (point 8 de la plateforme du CCI. La mystification parlementaire et électorale).
B. Le rôle du capitalisme d'État réduit aux seules nécessités économiques immédiates du capitalisme ?
Le GIGC écrit : "On peut regretter que ce passage ne rende pas plus explicite le lien entre capitalisme d’État et les besoins de la guerre impérialiste généralisée ce qui tend à réduire le phénomène du capitalisme d’État aux seules nécessités économiques immédiates, alors qu’il est surtout et avant tout une réponse politique contre le prolétariat et pour les besoins de la guerre impérialiste" [10]
Contrairement à ce que prétend le GIGC, ce point de la plateforme du CCI ne réduit en rien le rôle du capitalisme d'État aux "nécessités économiques immédiates", mais prend en compte l'ensemble des contradictions auxquelles le capitalisme est confronté : "Dans la décadence capitaliste, la tendance générale vers le capitalisme d'État est une des caractéristiques dominantes de la vie sociale. Dans cette période, chaque capital national, privé de toute base pour un développement puissant, condamné à une concurrence impérialiste aiguë est contraint de s'organiser de la façon la plus efficace pour, à l'extérieur, affronter économiquement et militairement ses rivaux et, à l'intérieur, faire face à une exacerbation croissante des contradictions sociales. La seule force de la société qui soit capable de prendre en charge l'accomplissement des tâches que cela impose est l'État" (deuxième paragraphe du point 4 de la plateforme intitulé "Le capitalisme d'État"). Le GIGC comptait certainement sur la crédulité des lecteurs de sa prose et sur leur méconnaissance des positions du CCI pour faire passer un mensonge supplémentaire.
C. Une défense trop timide de la constitution de l’Internationale communiste comme parti mondial du prolétariat ?
Le point 15 de notre plateforme sur "La dictature du prolétariat" réaffirme la nécessité de "la destruction de fond en comble de l’État capitaliste [et de l’usage par le prolétariat de] sa propre violence révolutionnaire de classe" mais, selon le GIGC, ce point "ignore complètement le rôle du parti – le mot parti n’est même pas utilisé une seule fois dans ce point ! – tant dans l’insurrection ouvrière – elle-même ignorée – que dans l’exercice de la dictature elle-même. (…) Certes, le parti est mentionné comme tel, formellement, abstraitement, en fait à reculons : "l’organisation des révolutionnaires dont la forme la plus avancée est le parti (…) ; on peut alors parler de parti pour désigner l’organisation de cette avant-garde (…) ; la nature mondiale et centralisée de la révolution prolétarienne confère au parti..." Mais nulle part le rôle et la fonction du parti en tant qu’avant-garde et direction politiques du prolétariat ne sont évoqués."[11]
En réalité, et contrairement à ces assertions mensongères, CCI ne minimise nullement le rôle fondamental joué par le parti dans le succès de la révolution russe (la seule révolution victorieuse), pas plus qu'il ne minimise le rôle que le futur parti sera amené à jouer dans la prochaine révolution. En attestent les nombreux articles de différentes brochures que nous avons dédiés à cette question et que le GIGC prend soin de passer sous silence alors qu'il en connait parfaitement l'existence. Parmi ces documents rappelons :
- Octobre 1917 début de la révolution mondiale : Les masses ouvrières prennent leur destin en main. Chapitre Le rôle indispensable du parti [631].
- Russie 1917 : La plus grande expérience révolutionnaire de la classe ouvrière. Chapitre : Les conceptions fausses du courant conseilliste sur la nature et le rôle du Parti Bolchevique [632].
D. Les syndicats passés mécaniquement et fatalement dans le camp de la bourgeoisie uniquement pour des raisons économiques ?
Citant notre plateforme : "Les syndicats sont devenus inopérants car "le capitalisme cesse d’être en mesure d’accorder des réformes et des améliorations en faveur de la classe ouvrière", le GIGC commente : "De nouveau, l’explication mécanique et économiciste 'ou bien réformes ou bien impossibilité de réformes' revient pour fonder le fait, juste et que nous partageons, que les syndicats sont devenus "d’authentiques défenseurs du capitalisme, des agences de l’État bourgeois en milieu ouvrier (…) par la tendance inexorable de l’État de la période de décadence à absorber toutes les structures de la société." Du coup, et dans la mesure où le passage des syndicats dans le camp bourgeois aurait été mécaniquement fatal du seul point de vue économique, et non le résultat d’un affrontement de classe conditionné par le passage à la nouvelle période historique, le combat que les minorités communistes ont mené de 1918 jusqu’à, grossièrement, la 2e Guerre mondiale dans les syndicats est négligé et rejeté "[12]
Le GIGC attribue au CCI l'idée que les syndicats sont passés mécaniquement dans le camp de la bourgeoisie. Le CCI utilise le terme "inéluctablement" et non pas le terme "mécaniquement". De plus, le GIGC introduit l'idée que "le passage des syndicats dans le camp de la bourgeoisie a été le produit d'un rapport de forces, entre bourgeoisie et prolétariat, se jouant au sein de ces organes". La seule interprétation possible de ce passage est qu'il aurait existé la possibilité pour la classe ouvrière de maintenir les syndicats en tant qu'arme de sa lutte au moyen d'un combat engagé en leur sein !
Il s'agit ici typiquement de la position opportuniste défendue par l'Internationale communiste dégénérescente et qui a inspiré, et inspire encore aujourd'hui, toutes les variétés de gauchisme. En fait, les seuls combats réellement "inspirants" pour le prolétariat relativement à la question syndicale sont ceux qui ont remis en question cette institution en tant que moyen de la lutte de classe, comme ce fut le cas en particulier durant la révolution en Allemagne. Ce qui est tout à fait cohérent avec l'analyse défendue par le CCI dans le point 7 de sa plate-forme : "En entrant dans sa phase de décadence, le capitalisme cesse d'être en mesure d'accorder des réformes et des améliorations en faveur de la classe ouvrière. Ayant perdu toute possibilité d'exercer leur fonction initiale de défenseurs efficaces des intérêts prolétariens et confrontés à une situation historique où seule l'abolition du salariat, et donc leur propre disparition, est à l'ordre du jour, les syndicats sont devenus, comme condition de leur propre survie, d'authentiques défenseurs du capitalisme, des agences de l'État bourgeois en milieu ouvrier (évolution qui a été fortement favorisée par leur bureaucratisation antérieure et par la tendance inexorable de l'État de la période de décadence à absorber toutes les structures de la société)".
Quels combats auraient-ils permis – selon le GIGC - de conserver, même de façon momentanée, le syndicat en tant qu'instrument de défense de ses intérêts par le prolétariat, durant la période allant de 1918 à la deuxième Guerre mondiale ? Le GIGC n'en évoque qu'un et cela vaut la peine de s'y attarder d'autant plus qu'il s'agit là d'une tentative supplémentaire de brouiller les cartes quant à la position de la Gauche communiste de France sur la question syndicale.
III. Le GIGC refait l'histoire en brouillant les cartes
En particulier sur la filiation de la Gauche Communiste, la propre histoire du CCI et notre camarade Marc Chirik.
A. Un mensonge énorme sur la position de la GCF sur la question syndicale
Le GIGC cite Internationalisme, la revue de la GCF (Gauche Communiste de France) : "Nous devons aussi combattre les tendances qui, partant du fait de l’existence d’une bureaucratie syndicale extrêmement forte, formant une couche réactionnaire avec des intérêts homogènes opposés aux intérêts de classe du prolétariat et à la révolution prolétarienne, affirment que les organisations syndicales sont dépassées en tant qu’instruments de lutte anticapitalistes. La fraction syndicale communiste est formée par tous les militants de l’organisation communiste appartenant au même syndicat" (Résolution sur la question syndicale). Que prouve ce passage par rapport au problème qui nous préoccupe ici, à savoir la nature de classe des syndicats en décadence ? Absolument rien si ce n'est qu'il existait au sein d'Internationalisme des confusions sur la question syndicale. Par contre, on reconnait bien ici la malhonnêteté décomplexée du GIGC quand il occulte aux yeux de ses lecteurs une réalité dérangeante, en l'occurrence le fait qu'il existait une réflexion alors en cours au sein de la GCF à propos de la nature des syndicats et qui se traduira par l'analyse suivante : "Les syndicats sont aujourd'hui complètement intégrés à l'État, ils sont un appendice de l'État avec la fonction de faire accepter, par la classe ouvrière, les mesures d'exploitation et d'aggravation de leurs conditions de misère. Les récents mouvements de grève ont mis en évidence que ce moyen classique de lutte des ouvriers a cessé d'être l'arme exclusive du prolétariat, a perdu sa nature absolue de classe et peut aussi servir de moyen de manœuvre d'une fraction politique capitaliste contre une autre, d'un bloc impérialiste contre un autre et finalement dans l'intérêt général du capitalisme." ("Problèmes actuels du mouvement révolutionnaire international" – Internationalisme n° 18 – Février 1947).
B. Mensonges sur l'attitude du CCI dans les luttes face aux syndicats
Ainsi, le GIGC salue hypocritement ce qu'il appelle le "CCI historique" pour avoir été enfin capable de comprendre la vraie nature des syndicats : "il faut saluer la capacité du CCI historique pour clairement comprendre que les syndicats sont devenus des organes à part entière de l’État bourgeois et, dans les années 1980 pour le moins, en tirer toutes les implications quant à son intervention dans les luttes réelles de la classe". Hypocritement et mensongèrement car, comme on l'a vu précédemment, c'est à Internationalisme qu'il est revenu d'apporter des clarifications importantes par rapport à Bilan sur la question syndicale ?
Pourquoi ce besoin d'encenser l'intervention du CCI des années 1980 qui était "Loin d’attendre une lutte pure libérée des syndicats par la grâce du Saint Esprit". Pour deux raisons :
1) Cracher sur l'intervention du CCI des années ultérieures implicitement caractérisée par l'attente de "une lutte pure libérée des syndicats par la grâce du Saint Esprit", qui depuis deux décennies "préfère s’adonner au fétiche de l’auto-organisation et de l’assembléisme, au nom des véritables assemblées débarrassées des syndicats, pour masquer son défaitisme".[13] Le mythomane en a rêvé, et c'est devenu réalité sous sa plume haineuse. Le CCI n'a jamais délaissé ni méprisé aucune lutte de la classe ouvrière, et le fait de dénoncer, comme nous l'avons fait, certaines caricatures "d’assemblées générales" convoquées habituellement par les syndicats dans les entreprises n'est en rien synonyme de désertion mais constitue au contraire un moment de dénonciation de l'aboutissement du sabotage et de l'omniprésence syndicales. Contrairement à l'idée que le GIGC tente d'instiller, depuis les luttes des années 1980 le CCI n'a jamais renié la nécessité fondamentale de la lutte de classe, partout où celle-ci s'exprime, quelles que soient ses forces et ses faiblesses. Ce qui, une nouvelle fois, est cohérent avec l'importance que le CCI attribue aux luttes de défense immédiate de la classe ouvrière pour le développement du combat de classe, ce que le GIGC essayait aussi de masquer à travers des critiques frauduleuses que nous avons mises en évidence précédemment.
2) Refaire l'histoire du CCI des années 1980 en lui attribuant des positions qui n'ont jamais été les siennes mais celles du BIPR à l'époque : "il [le CCI] comprit alors pleinement que les groupes communistes d’avant-garde et le parti se devaient d’être au premier rang du combat politique contre les dévoiements et les sabotages syndicaux et gauchistes et pour la direction politique des luttes ouvrières." Seul un mythomane ayant l'aplomb du GIGC est capable de débiter de telles balivernes. Le CCI ne s'est jamais considéré comme étant un parti (ou un parti en miniature) mais comme un groupe politique ayant une "fonction similaire à celle d'une fraction", chargé d'œuvrer à la fondation du futur parti, tout en constituant un pont avec celui-ci. De même il a toujours critiqué la conception des "groupes internationalistes d'usine" du BIPR, considérés comme des courroies de transmission du parti dans la classe ouvrière. Hier comme aujourd'hui, le CCI a toujours lutté pour que la classe ouvrière s'organise en assemblées générales afin de prendre sa lutte en mains et l'étendre, il a toujours combattu l'action des syndicats visant à saboter de telles initiatives de la classe.
C. Mensonges dans l'explication de cet autre mensonge relatif à notre prétendu renoncement au combat contre les syndicats
Le GIGC revendique sa contribution à "la revendication et la défense du combat contre le conseillisme dans les années 1980 que le CCI avait mené alors"[14]. Il n'est pas impossible qu'à l'époque certains des militants qui allaient devenir des voyous de la FICCI y aient participé. Par contre il est aussi affirmé que le CCI aurait "rejeté ce [combat] depuis lors."[15]. Pourquoi un tel mensonge du GIGC ? Possiblement pour se faire mousser auprès de la TCI dont le prédécesseur, le BIPR, avait justifié son sabotage des conférences de la Gauche communiste des années 1970 par le prétendu "conseillisme" du CCI.
Le GIGC est incapable de prouver dans les faits ce prétendu renoncement du CCI au combat contre le conseillisme mais il nous donne une explication au "renoncement" en question. La cause se trouve donc, selon lui, dans "la rupture organique entre la Gauche communiste de France et le CCI" : "la rupture organique avec les fractions de la Gauche communiste issues de l’Internationale Communiste (IC), dans son cas d’avec la Gauche communiste de France (GCF) et plus largement avec la Gauche dite italienne, ne put être comblée par la seule présence de Marc Chirik, membre de la fraction italienne à partir de 1938, puis de la GCF"[16]. Cette rupture organique a effectivement constitué un lourd handicap que la présence de notre camarade Marc Chirik a heureusement permis de réduire, notamment à travers le combat contre le conseillisme, plus précisément le centrisme vis-à-vis du conseillisme en notre sein. La clarification et l'homogénéisation qui se sont opérées dans notre organisation à cette occasion ont permis au CCI de s'armer face au danger du conseillisme dont l'influence dans une partie de la jeunesse a participé à la difficile politisation de celle-ci. Il est par contre un domaine où la seule présence de notre camarade MC ne pouvait suffire à surmonter des faiblesses liées à la rupture de la continuité organique, c'est celui du militantisme révolutionnaire qui ne peut faire l'économie de la pratique, même si, également sur ce plan, notre camarade MC a fait le maximum pour transmettre les enseignements de sa propre expérience. Une telle faiblesse au sein du CCI s'est notamment traduite par des attitudes, des démarches relevant de l'esprit de cercle justement critiqué par Lénine au 2e congrès du POSDR et auquel il oppose l'esprit de parti. Mais pire que l'esprit de cercle se trouve le pourrissement de celui-ci dans le clanisme nihiliste, et à la dégénérescence de celui-ci dans la pire variété de parasitisme, prompt à tenter d'infliger le maximum de dommages à l'organisation lorsque celle-ci se défend contre les agissements et comportements de voyous. La FICCI, mère du GIGC, fut la pire incarnation de cette démarche au sein du CCI.
D. Le GIGC invente de toute pièce "une contribution positive" du BIPR à la clarification politique au sein du CCI
Nous ne dénions pas la capacité d'une discussion avec d'autres groupes prolétariens d'être à même de participer à la clarification en notre sein. Mais ici il s'agit d'une nouvelle invention du GIGC totalement impossible d'un point de vue chronologique.
Dans un article récent adressé à la TCI[17], le GIGC évoque un "débat contradictoire que le PCInt-Battaglia Comunista et le CCI avaient développé à la fin des années 1970 autour de la question du cours historique" (…) Le CCI y aurait alors reconnu, selon le GIGC, "la justesse de la critique de BC à sa position de cours à la révolution", laquelle "faisait de la révolution une voie tout ouverte et inéluctable". Mémoire d'éléphant ou affabulation de la part des membres du GIGC ? Il n'est pas dit où et à quelle occasion cela est arrivé. Pour donner plus de consistance à cette "histoire", le GIGC ajoute cependant : "ce fut grâce à cette critique dont le CCI aurait alors reconnu la justesse, qu’il avait précisé – changé – sa position et défini le "cours" comme "vers des affrontements massifs de classe décisifs".
Il nous faut, encore une fois, rétablir la vérité face aux mensonges du GIGC. C'est vrai que dans notre texte sur Le cours historique [633] adopté par le 2e Congrès du CCI en 1977 nous parlions de "cours à la révolution" mais, déjà dans ce document de base, le CCI, en aucune façon, ne "faisait de la révolution une voie tout ouverte et inéluctable" puisqu'il y est écrit : "Notre perspective ne prévoit pas l'inéluctabilité de la révolution. Nous ne sommes pas des charlatans et nous savons trop bien, à l'inverse de certains révolutionnaires fatalistes, que la révolution communiste n'est pas 'aussi certaine que si elle avait déjà eu lieu'. Mais, quelle que soit l'issue définitive de ces combats, que la bourgeoisie essaiera d'échelonner afin d'infliger à la classe une série de défaites partielles préludes à sa défaite définitive, le capitalisme ne peut plus, d'ores et déjà, imposer sa propre réponse à la crise de ses rapports de production sans s'affronter directement au prolétariat." Et c'est justement pour qu'il n'y ait pas la moindre ambigüité que, au début des années 1980, nous avons remplacé la formule "cours à la révolution" par "cours aux affrontements de classe décisifs". Nous n'avons connaissance d'aucune polémique sur ce thème entre le CCI et BC avant que nous ayons modifié notre formulation. Il est parfaitement exact qu'il y a eu une critique par BC/CWO de notre analyse intitulée "le CCI et le cours historique : une méthode erronée". Mais elle a eu lieu en 1987, soit plusieurs années après et il ne peut donc pas s'agir de la "critique constructive reconnue comme telle pas le CCI". D'ailleurs, la critique du BIPR à l'analyse du CCI ne portait pas sur la façon dont il fallait qualifier le cours historique mais sur la notion même de cours historique.[18]
On pourrait se poser la question de l'intérêt du GIGC à revisiter l'histoire de la sorte. La réponse à la question s'esquisse lorsqu'il ajoute : "une grande partie des critiques que Battaglia Comunista avait portées à l’époque étaient justes, nous en reprenons le concept et, nous l’espérons, la méthode qui doit l’accompagner, celle que les camarades de la TCI ont toujours jugée et cataloguée comme idéaliste"[19]. Le GIGC exprime donc son accord avec la TCI et rend hommage à sa méthode. Si le GIGC n'avait pas été un groupe parasite de la pire espèce nous l'aurions interpellé sur son revirement de position alors qu'à l'époque des faits, il critiquait encore avec le CCI le matérialisme vulgaire de la TCI. Aujourd'hui il lui lèche les bottes de façon éhontée.
Et c'est là le sens profond de son entreprise de démolissage de la plateforme du CCI. Il s'agit de renforcer son attitude de flagornerie de la TCI afin de s'attirer encore plus les bonnes grâces de celle-ci. C'est pour le GIGC une question existentielle : pour s'assurer une légitimité et pour être blanchi de ses mensonges et de ses crapuleries, il lui faut la caution d'une organisation historique de la Gauche communiste. Dès la formation de la FICCI, celle-ci a déclaré que le BIPR constituait désormais la force décisive pour la constitution du futur parti mondial du prolétariat. Puis elle a rejeté l'analyse de la période actuelle comme celle de la décomposition du capitalisme ainsi que l'analyse du phénomène du parasitisme politique, deux analyses que ses membres avaient partagées pendant plus d'une décennie mais que rejetait le BIPR (et continue de rejeter la TCI). Aujourd'hui, il faut au GIGC raviver la flamme de son idylle avec la TCI (notamment après une petite brouille avec cette organisation[20]) et pour ce faire quoi de mieux que de reprendre à son compte la critique du BIPR sur le prétendu "conseillisme du CCI", de "découvrir" les grands apports du BIPR et du PCInt à sa propre clarification sur la question du parti et, dernièrement, accueillir avec enthousiasme l'initiative de la TCI en faveur des comités NWBCW.[21]
CCI (08 / 08/ 2023)
[Retour à la série : Le parasitisme politique n'est pas un mythe, le GIGC en est une dangereuse expression [634]]
[1] "Prise de position sur la plateforme du Courant Communiste International [635]". Révolution ou guerre n° 18. Mai 2021.
[2] "Réponse à la Tendance Communiste Internationaliste sur nos "Thèses sur la signification et les conséquences de la guerre en Ukraine [636]"", Révolution ou Guerre n° 22. Septembre 2022
[3] "Premiers commentaires et débats autour de notre plateforme politique [637]". Révolution ou Guerre n° 20. Février 22. Cette brillante caractérisation est le produit d'un "travail" de relecture critique de la plateforme du CCI exposé dans l'article "Prise de position sur la plateforme du Courant Communiste International [638]". Révolution ou Guerre n° 18. Nous reviendrons prochainement en détail sur ce "travail".
[4] "Prise de position sur la plateforme du Courant Communiste International [638]" Révolution ou guerre n° 18. Ironie : à l'appui de ce jugement, le GIGC cite la lettre d'Engel à Joseph Bloch du 22 septembre 1890 : "La situation économique est la base, mais les divers éléments de la superstructure : les formes politiques de la lutte de classe et ses résultats (…), les formes juridiques, et même les reflets de toutes ces luttes réelles dans le cerveau des participants (…) exercent également leur action sur le cours des luttes historiques et, dans beaucoup de cas, en déterminent de façon prépondérante la forme" C'est une citation que le CCI a pleinement reprise à son compte et utilisée à plusieurs reprises, notamment contre la vision matérialiste vulgaire partagée par les courants issus du Partito Comunista Internazionalista (PCInt) fondé en 1945 (le courant "bordiguiste" et le courant représenté aujourd'hui par la Tendance Communiste Internationaliste). Mais le GIGC se garde bien de faire une telle critique à la TCI puisque, à l'égard de celle-ci, son attitude permanente a consisté dans le léchage de bottes.
[5] À ce propos, nos positions de base – présentes au dos de toute nos publications - mettent en avant que "Le CCI se réclame ainsi des apports successifs (…) des fractions de gauche qui se sont se sont dégagées dans les années 1920-30 de la IIIe Internationale lors de sa dégénérescence, en particulier les gauches allemande, hollandaise et italienne." Le GIGC commente ce passage de la sorte : "Nous verrons qu’à l’arrivée, l’esprit de synthèse a laissé peu de place à la gauche italienne et beaucoup à la germano-hollandaise." C'est un mensonge éhonté. Dès sa fondation, le CCI s'est explicitement revendiqué de sa filiation politique avec la Gauche Communiste de France (GCF) qui, elle-même, tout en reprenant à son compte certaines positions de la Gauche germano-hollandaise, se revendiquait fondamentalement de la Fraction de Gauche italienne. C'est ce que nous rappelions à la fin des années 1990 dans la présentation de notre brochure La Gauche communiste de France [639] : "… il importe de souligner que l’étude des efforts visant à la constitution d’un courant de la Gauche communiste en France met clairement en relief la participation de premier plan de la Gauche communiste italienne à ces efforts ainsi que la méthode qui était la sienne. Nous ne saurions trop insister sur la méthode défendue, durant cette période, par la Gauche italienne (…) … alors que la Fraction italienne elle-même, épuisée, a abandonné le combat qu’elle avait mené pendant près de 18 ans en prononçant son autodissolution en mai 1945, c’est la Fraction française de la Gauche communiste, fondée en décembre 1944 et rebaptisée par la suite Gauche communiste de France, qui a repris le flambeau politique de la Fraction italienne." Et, à aucun moment, le CCI ne s'est départi de cette filiation politique. Ainsi, dans notre article publié trois décennies après la fondation du CCI (Les trente ans du CCI : s'approprier le passé pour construire l'avenir [640]), nous écrivions : "Si nous nous revendiquons des apports des différentes fractions de gauche de l'IC, nous nous rattachons plus particulièrement, pour ce qui concerne la question de la construction de l'organisation, aux conceptions de la Fraction de gauche du Parti communiste d'Italie, notamment comme elles se sont exprimées dans la revue Bilan au cours des années 30." De même, dans notre article de 2006, "La Gauche Communiste et la continuité du marxisme" [641], :nous mettions très clairement en évidence la contribution fondamentale de la Gauche communiste d'Italie à la définition politique du CCI : "les contributions théoriques faites par la Gauche communiste d'Italie – qui plus tard engloba des fractions en Belgique, en France et au Mexique – furent immenses et tout à fait irremplaçables. Dans son analyse de la dégénérescence de la révolution russe – qui ne remit jamais en question le caractère prolétarien de 1917 ; dans ses recherches sur les problèmes de la future période de transition ; dans ses travaux sur la crise économique et les fondements de la décadence du capitalisme ; dans sa dénonciation de la position de l’Internationale communiste de soutien aux luttes de "libération nationale" ; dans son élaboration de la théorie du parti et de la fraction ; dans ses polémiques sans relâche, mais fraternelles, avec d’autres courants politiques prolétariens ; en cela et dans beaucoup d’autres domaines, la Gauche italienne a sans aucun doute rempli la tâche qu'elle s'était assignée de développer les bases programmatiques pour les organisations prolétariennes du futur".
[6] Premiers commentaires et débats autour de notre plateforme politique [637]. Révolution ou Guerre n° 20. Février 22. Cette "brillante" caractérisation est le produit d'un "travail" de relecture critique de la plateforme du CCI exposé dans l'article "Prise de position sur la plateforme du Courant Communiste International [638]" - Révolution ou Guerre n°18.
[7] Ce changement de position est pour le moins cocasse de la part de ceux qui se sont prétendus être les "meilleurs défenseurs des positions du CCI" alors qu'ils tentaient de le saborder de l'intérieur. D'ailleurs, il faudrait qu'ils précisent à quelle plateforme de 1945 ils se référent. Celle qui avait été adoptée par la conférence de 1945-46 par le PCInt avait été rédigée par Bordiga, qui n'était même pas membre du Partito, un document qui a fait l'objet de très sévères critiques de la part du PCInt en 1974 puisqu'il affirme que ce document avait été accepté en 1945 "comme une contribution tout à fait personnelle pour le débat du congrès futur" et "reconnu comme incompatible avec les fermes prises de position adoptées désormais par le parti sur des problèmes plus importants, et [que] (…) le document a toujours été considéré comme une contribution au débat et pas comme une plate-forme de fait". Le problème c'est qu'il avait été adopté à l'unanimité (y inclus donc par Damen, principal animateur du PCInt jusqu'à sa mort en octobre 1979) et qu'il avait été publié à l'extérieur comme base d'adhésion au Partito. Peut-être les faussaires du GIGC font-ils référence au document rédigé en 1944 par Damen et considéré comme un "schéma de programme". Ils doivent donc endosser des formulations comme "notre parti, qui ne sous-estime pas l'influence des autres partis de masse, se fait le défenseur du front unique", une politique de l'Internationale communiste lors de sa dérive opportuniste et qui avait été combattue par la Gauche italienne dès le début des années 1920. Pour le lecteur qui souhaiterait s'informer plus sur la vie du PCInt durant les années 1940, nous fournissons une référence critique à celle-ci publiée dans la revue Internationalisme, publication de la Gauche communiste de France, Le deuxième congrès du parti communiste internationaliste (Internationalisme n°36, juillet 1948) [642] ; de même que des références de polémiques écrites par le CCI : Polémique : à l'origine du CCI et du BIPR, I - La fraction italienne et la gauche communiste de France [643] ; Polémique : à l'origine du CCI et du BIPR, II : la formation du Partito Comunista Internazionalista [644].
[9] Revue internationale n° 100.
[14] "Réponse à la Tendance Communiste Internationaliste sur nos "Thèses sur la signification et les conséquences de la guerre en Ukraine [636]"" Révolution ou Guerre n° 22. Septembre 2022
[15] "Réponse à la Tendance Communiste Internationaliste sur nos "Thèses sur la signification et les conséquences de la guerre en Ukraine [636]"" Révolution ou Guerre n° 22. Septembre 2022
[16] Prise de position sur la plateforme du Courant Communiste International [646] Révolution ou guerre n° 18
[17] Prise de position de la TCI sur les thèses (TCI) [647] / Dans l’attente d’une réponse de notre part. Révolution ou Guerre n° 21
[18] Le CCI a répondu à cette critique renvoyant la CWO à un manque total de méthode pour aborder ce genre de question. Lire à ce propos Polémique avec le BIPR [648] sur La méthode marxiste et l'appel du CCI sur la guerre en ex-Yougoslavie.
[19] Prise de position de la TCI sur les thèses (TCI) [647] / Dans l’attente d’une réponse de notre part. Révolution ou Guerre n° 21.
[20] Le GIGC constatant que, malgré son opportunisme, il avait moins de succès que la TCI auprès des nouveaux éléments qui s'approchent de la Gauche communiste, il ne pouvait s'empêcher de tancer la TCI : "de nouvelles forces communistes ont émergé dont Nuevo Curso est l’expression et un facteur, mettant ainsi directement les groupes historiques de la Gauche communiste partidiste devant leur responsabilité historique face à cette nouvelle dynamique et devant laquelle la Tendance Communiste Internationaliste, principale organisation de ce camp, a commencé par s’enfermer dans une attitude, ou des réflexes, relativement sectaire à notre endroit et immédiatiste quant à ces nouvelles forces" ou encore "la TCI pourtant liée organiquement avec le PC d’Italie et la Gauche communiste d’Italie, subit le poids d’un relatif informalisme, du personnalisme et de l’individualisme, et donc de l’esprit de cercle". Ces citations reproduites dans notre articles L'aventurier Gaizka a les défenseurs qu'il mérite : les voyous du GIGC [621] sont extraites du Rapport d’activités de la 2e Réunion générale du GIGC. Révolution ou Guerre n°12.
[21] Et il faut constater que la TCI n'est pas insensible aux campagnes de séduction du GIGC. Depuis la formation de la FICCI, en 2001, l'ancêtre de la TCI, le BIPR, a fait preuve d'une grande bienveillance à son égard ; une attitude qui, globalement, ne s'est pas démentie pendant deux décennies et qui s'est manifestée encore récemment lorsque la TCI s'est appuyée, pour l'organisation d'une réunion publique à Paris du regroupement NWBCW, sur deux membres fondateurs de la FICCI, Juan et Olivier, exclus du CCI en 2003 pour mouchardage. Faut-il rappeler à la TCI la fable d'ésope intitulée Le corbeau et le renard : "Un corbeau, ayant volé un morceau de viande, s’était perché sur un arbre. Un renard l’aperçut, et, voulant se rendre maître de la viande, se posta devant lui et loua ses proportions élégantes et sa beauté, ajoutant que nul n’était mieux fait que lui pour être le roi des oiseaux, et qu’il le serait devenu sûrement, s’il avait de la voix. Le corbeau, voulant lui montrer que la voix non plus ne lui manquait pas, lâcha la viande et poussa de grands cris. Le renard se précipita et, saisissant le morceau, dit : 'Ô corbeau, si tu avais aussi du jugement, il ne te manquerait rien pour devenir le roi des oiseaux.' Cette fable est une leçon pour les sots."
Vie du CCI:
Courants politiques:
Rubrique:
Les fondements marxistes de la notion de parasitisme politique et le combat contre ce fléau
- 452 lectures
Le marxisme et l'histoire de la Première internationale attestent de la validité du concept de parasitisme pour caractériser des comportements destructifs - au sein des organisations politiques du prolétariat - totalement étrangers aux méthodes de la classe ouvrière.
A. Le parasitisme politique n’est nullement "une invention du CCI",
le marxisme l'a combattu dans l'AIT
Comme nous le mettons en évidence dans nos thèses sur le parasitisme[1] -auxquelles sont empruntés beaucoup des développements ci-après- le parasitisme est historiquement apparu en réponse à la fondation de la Première Internationale, qu'Engels décrivait comme "le moyen de progressivement dissoudre et absorber toutes les différentes petites sectes". (Engels, Lettre à Florence Kelly Vischnevetsky, 3 février 1886). L'AIT était en effet un instrument obligeant les différentes composantes du mouvement ouvrier à s'engager dans un processus collectif et public de clarification, et à se soumettre à une discipline unifiée, impersonnelle, prolétarienne, organisationnelle. En effet, "Ayant tiré les leçons des révolutions de 1848, le prolétariat n'acceptait plus d'être dirigé par l'aile radicale de la bourgeoisie et luttait à présent pour établir sa propre autonomie de classe. Mais celle-ci requérait qu'au sein même de ses rangs le prolétariat surmontât les conceptions et les théories organisationnelles de la petite bourgeoisie, de la bohème et des éléments déclassés qui y subsistaient et avaient encore une influence importante".[2]
Or, l’avancée de la lutte du prolétariat avait besoin de ce mouvement impliquant la dissolution et l'absorption à l'échelle internationale de toutes les particularités et autonomies programmatiques et organisationnelles non prolétariennes. C'est d'abord en résistance à ce mouvement que le parasitisme a déclaré sa guerre au mouvement révolutionnaire. C’est l’AIT qui, la première, a été confrontée à cette menace contre le mouvement prolétarien, qui l’a identifiée et combattue. C’est elle, à commencer par Marx et Engels, qui caractérisait comme parasites ces éléments politisés qui, tout en prétendant adhérer au programme et aux organisations du prolétariat, concentrent leurs efforts sur le combat, non pas contre la classe dominante, mais contre les organisations de la classe révolutionnaire. L'essence de leur activité est, en effet, de dénigrer et de manœuvrer contre le camp communiste, tout en prétendant lui appartenir et le servir. C'est ce que synthétise cette phrase du rapport sur l'Alliance[3] au congrès de la Haye rédigé par Engels : "Pour la première fois dans l'histoire de la lutte de classe, nous sommes confrontés à une conspiration secrète au cœur de la classe ouvrière, et destinée à saboter non le régime d'exploitation existant, mais l'Association elle-même qui représente l'ennemi le plus acharné de ce régime." Quant au remède préconisé, il est sans ambigüité : "Il est grand temps, une fois pour toutes, de mettre fin aux luttes internes quotidiennement provoquées dans notre Association par la présence de ce corps parasite." (Engels, "Le Conseil général à tous les membres de l'Internationale", avertissement contre l'Alliance de Bakounine[4]).
B. La résurgence du parasitisme depuis les années 1980
Comme ce fut le cas de l'Alliance dans l’AIT, ce n'est que dans les périodes où le mouvement ouvrier passe d'un stade d'immaturité fondamentale vers un niveau qualitativement supérieur, spécifiquement communiste, que le parasitisme devient son principal opposant. Dans la période actuelle, cette immaturité n’est pas le produit de la jeunesse du mouvement ouvrier dans son ensemble, comme au temps de l’AIT, mais avant tout le résultat des 50 ans de contre-révolution qui ont suivi la défaite de la vague révolutionnaire de 1917-23. Aujourd'hui, c'est cette rupture de la continuité organique avec les traditions des générations passées de révolutionnaires qui explique, avant tout, le poids des réflexes et des comportements anti-organisationnels petit-bourgeois parmi beaucoup d’éléments qui se réclament du marxisme et de la Gauche communiste.
Le parasitisme cible des éléments en recherche vers des positions de classe qui ont du mal à faire la différence entre les véritables organisations révolutionnaires et les courants parasites. C'est ainsi qu'il faut comprendre que, depuis les années 1990 et surtout les années 2000, l'action du parasitisme se soit amplifiée en devenant plus destructrice. Nous sommes actuellement confrontés à de multiples regroupements informels, agissant souvent dans l'ombre, prétendant appartenir au camp de la Gauche communiste, mais qui dédient leurs énergies à combattre les organisations marxistes existantes plutôt que le régime bourgeois. Comme à l'époque de Marx et Engels, cette vague parasitaire réactionnaire a pour fonction de saboter le développement du débat ouvert et de la clarification prolétarienne, et d'empêcher l'établissement de règles de conduite liant tous les membres du camp prolétarien.
Elle a significativement été alimentée par toutes les ruptures qui ont eu lieu dans l'histoire du CCI. Ni motivées ni justifiées par des divergences politiques, celles-ci ont été le résultat de comportements organisationnels non marxistes, non prolétariens, comme l'avaient été ceux de Bakounine dans l'AIT et des mencheviks dans le POSDR en 1903 qui exprimaient la résistance à la discipline organisationnelle et aux principes collectifs.
Face à la classe ouvrière et au milieu politique prolétarien, le CCI n'a jamais caché les difficultés qu'il rencontrait. C'est ainsi qu'au début des années 1980, il s'exprimait en ces termes : "la mise en évidence par les organisations révolutionnaires de leurs problèmes et discussions internes constituent un plat de choix pour toutes les tentatives de dénigrement dont celles-ci font l'objet de la part de leurs adversaires. C'est le cas aussi et particulièrement pour le CCI. Certes, ce n'est pas dans la presse bourgeoise que l'on trouve des manifestations de jubilation lorsque nous faisons état des difficultés que notre organisation peut rencontrer aujourd'hui. Celle-ci est encore trop modeste en taille et en influence parmi les masses ouvrières pour que les officines de propagande bourgeoise aient intérêt à parler d'elle pour essayer de la discréditer. Il est préférable pour la bourgeoisie de faire un mur de silence autour des positions et de l'existence des organisations révolutionnaires. C'est pour cela que le travail de dénigrement de celles-ci et de sabotage de leur intervention est pris en charge par toute une série de groupes et d'éléments parasitaires dont la fonction est d'éloigner des positions de classe les éléments qui s'approchent de celles-ci, de les dégoûter de toute participation au travail difficile de développement d'un milieu politique prolétarien." (résolution adoptée par le 5e Congrès international du CCI, Revue internationale n° 35)
L'ensemble des groupes communistes a été confronté aux méfaits du parasitisme, mais il revient au CCI, parce que c'est aujourd'hui l'organisation la plus importante du milieu prolétarien, et également la plus rigoureuse en termes de respects des principes et des statuts, de faire l'objet d'une attention toute particulière de la part de la mouvance parasitaire. Dans cette dernière on trouvait, et on trouve encore pour certains, des groupes constitués et tous issus du CCI tels le "Groupe Communiste Internationaliste" (GCI) et ses scissions (comme "Contre le Courant"), le défunt "Communist Bulletin Group" (CBG) ou l'ex-"Fraction Externe du CCI" ou encore la "Fraction Interne du CCI" qui a muté quelques années plus tard en "Groupe International de la Gauche Communiste" (GIGC) qui ont tous été constitués de scissions du CCI.
Mais le parasitisme ne se limite pas à de tels groupes. Il est aussi véhiculé par des éléments inorganisés, ou qui se retrouvent de temps à autre dans des cercles de discussion éphémères, dont la préoccupation principale consiste à faire circuler toutes sortes de commérages à propos de notre organisation. Ces éléments sont souvent d'anciens militants qui, cédant à la pression de l'idéologie petite-bourgeoise, n'ont pas eu la force de maintenir leur engagement dans l'organisation, qui ont été frustrés que celle-ci n'ait pas "reconnu leurs mérites" à la hauteur de l'idée qu'ils s'en faisaient eux-mêmes ou qui n'ont pas supporté les critiques dont ils ont été l'objet. Il s'agit également d'anciens sympathisants que l'organisation n'a pas voulu intégrer parce qu'elle jugeait qu'ils n'avaient pas la clarté suffisante ou qui ont renoncé à s'engager par crainte de perdre leur "individualité" dans un cadre collectif (c'est le cas, par exemple du défunt "collectif Alptraum" au Mexique ou de "Kamunist Kranti" en Inde). Dans tous les cas, il s'agit d'éléments dont la frustration résultant de leur propre manque de courage, de leur veulerie et de leur impuissance s'est convertie en une hostilité systématique envers l'organisation. Ces éléments sont évidemment absolument incapables de construire quoi que ce soit. En revanche, ils sont souvent très efficaces, avec leur petite agitation et leurs bavardages de concierges pour discréditer et détruire ce que l'organisation tente de construire.
C. Les principaux groupes parasites depuis les années 1980
On se limitera ici aux groupes suivants : le Communist Bulletin Group (CBG), la Fraction Externe du CCI (FECCI) et la Fraction Interne du CCI (FICCI).
C.1 Le Communist Bulletin Group (CBG)
La lutte contre les clans, que le 11e congrès du CCI avait unanimement soutenue, est transformée par le CBG en une lutte entre clans. Les organes centraux sont inévitablement "monolithiques", l'identification de la pénétration d'influences non-prolétariennes, tâche primordiale des révolutionnaires, est présentée comme un moyen de briser les "opposants". Les méthodes de clarification des organisations prolétariennes - débat ouvert dans toute l'organisation, publication de ses résultats pour informer la classe ouvrière - deviennent la méthode de "lavage du cerveau" des sectes religieuses.
Ce n'est pas seulement le CCI qui est concerné :
"ce n'est pas seulement l'ensemble du milieu révolutionnaire d'aujourd'hui qui est ainsi attaqué ici. C'est toute l'histoire et les traditions du mouvement ouvrier qui sont insultées.
En réalité, les mensonges et les calomnies du CBG sont tout-à-fait dans la ligne de la campagne de la bourgeoisie mondiale sur la prétendue mort du communisme et du marxisme. Au centre de cette propagande, se trouve une seule idée qui porte en elle le plus grand mensonge de l'histoire : la rigueur organisationnelle de Lénine et des bolcheviks conduit nécessairement au stalinisme. Dans la version du CBG de cette propagande, c'est le bolchévisme du CCI qui conduit "nécessairement" à son prétendu “stalinisme”. Évidemment, le CBG ne sait ni ce qu'est le milieu révolutionnaire, ni ce qu'il en est du stalinisme". (Parasitisme politique : le "C.B.G" fait le travail de la bourgeoisie [649]; Revue Internationale n° 83.
C.2 La Fraction Externe du CCI
Dans un article de notre Revue internationale nous écrivions en 1986 :
"Le milieu politique prolétarien, déjà fortement marqué par le poids du sectarisme, comme le CCI l'a souvent mis en évidence et déploré, vient de "s'enrichir" d'une nouvelle secte. Il vient en effet de paraître le n° 1 d'une nouvelle publication intitulée Perspective Internationaliste, organe de la "Fraction Externe du CCI" qui "revendique la continuité du cadre programmatique élaboré par le CCI". Ce groupe est composé des camarades appartenant à la "tendance" qui s'était formée dans notre organisation et qui l'a quittée lors de son 6ème Congrès[5] pour "défendre la plate-forme du CCI". Nous avons déjà rencontré et mis en évidence beaucoup de formes de sectarisme parmi les révolutionnaires d'aujourd'hui, mais la création d'un CCI-bis ayant les mêmes positions programmatiques que le CCI constitue un sommet en ce domaine, un sommet jamais atteint jusqu'à présent. De même, ce qui peut être considéré comme un sommet, c'est la quantité de calomnies que Perspective Internationaliste déverse sur le CCI ; il n'y a guère que le Communist Bulletin Group (formé également d'ex-membres du CCI) qui soit allé aussi loin dans ce domaine. Dès sa création, ce nouveau groupe se place donc sur un terrain que seuls des voyous politiques (qui s'étaient distingués en volant du matériel et des fonds du CCI) avaient par le passé exploité avec autant de ferveur). Même si les membres de la "Fraction" ne se sont nullement rendus responsables de tels actes, on peut dire que leur sectarisme et leur prédilection pour l'insulte gratuite augurent mal de l'évolution future de ce groupe et de sa capacité d'être une contribution à l'effort de prise de conscience du prolétariat. En effet, les petits jeux de la FECCI ne traduisent qu'une chose : une irresponsabilité totale face aux tâches qui incombent aujourd'hui aux révolutionnaires, une désertion du combat militant." (La "fraction externe du CCI" (polémique) [650], Revue Internationale no 45 [651].
C.3 La Fraction Interne du CCI (2001), qui mutera en GIGC (Groupe Internationaliste de la Gauche Communiste) en 2013, constitue sans conteste un pas supplémentaire dans l'ignominie, justifiant ainsi qu'on y dédie une partie importante de ce texte.
D. La FICCI (ancêtre du GIGC), une forme extrême de regroupement parasitaire
Nous rapportons ici une partie de la chaine des évènements ayant conduit à la formation de la FICCI (Fraction interne du CCI), cristallisation dans le CCI d'un corps étranger, en citant un communiqué à nos lecteurs faisant état des agissements, au sein de notre organisation et à l'extérieur de celle-ci, de membres de notre organisation :
"ce qui a posé problème, c'est que, sous le prétexte de (…) désaccords, un certain nombre de militants de la section en France ont mené (…) une politique de violation permanente de nos règles organisationnelles. Sur la base d'une réaction "d'amour propre blessé", ils se sont lancés à corps perdu dans des attitudes anarchisantes de violation des décisions du Congrès, de dénigrement et de calomnies, de mauvaise foi, de mensonges. Après plusieurs manquements organisationnels, dont certains d'une extrême gravité, qui ont nécessité des réactions fermes de l'organisation, ces camarades ont secrètement tenu des réunions pendant le mois d'août 2001 (…) Le procès-verbal d'une des réunions de cette tendance secrète est parvenu à l'organisation, contre la volonté de ses participants. Il a permis que soit clairement mis en évidence, au sein de l'organisation, le fait que ces camarades, en toute conscience de la gravité de leurs actes, étaient en train de fomenter un complot contre l'organisation, faisant ainsi la preuve d'une déloyauté totale envers le CCI, laquelle s'est exprimée en particulier à travers : l'établissement d'une stratégie pour tromper l'organisation et faire passer sa propre politique ; une démarche putschiste/gauchiste posant les problèmes politiques confrontés en terme de "récupération des moyens de fonctionnement" ; l'établissement de liens conférant "une solidarité de fer" entre les participants et contre les organes centraux, tournant ainsi clairement le dos à la discipline librement consentie au sein d'une organisation politique prolétarienne." (Communiqué à nos lecteurs - Une attaque parasitaire visant à discréditer le CCI [652], 21 mars 2002)
Dès sa constitution, la FICCI, s'est toujours présentée comme le meilleur défenseur de la plate-forme et des positions du CCI, à l'exception toutefois de "l'analyse de la phase ultime de la décadence, celle de la décomposition", et des "thèses sur le parasitisme politique". La première exception visait à être plus en phase avec les autres groupes du MPP qui ne partageaient pas l'analyse de la décomposition. La seconde lui permettait de réfuter plus facilement le fait qu'à son tour elle constituait elle-même un regroupement parasitaire, alors même que ses membres étaient jusque-là des défenseurs convaincus de la nécessité du combat contre le parasitisme.
Un rappel[6] de états de service du groupe FICCI / GIGC
Les membres de la FICCI se placèrent eux-mêmes et délibérément en dehors de notre organisation comme conséquence des comportements suivants :
- Violations répétées de nos statuts (notamment le refus de payer l'intégralité de leurs cotisations) et leur refus de s'engager à les respecter dans l'avenir ;
- Refus de venir présenter la défense de leur comportement dans l'organisation face à notre critique de celui-ci alors que le CCI avait organisé une conférence extraordinaire comportant spécifiquement cette question à son ordre du jour ;
- Vol d'argent et de matériel du CCI (fichiers d'adresses et documents internes).
La FICCI comme groupe policier
Finalement les membres de la FICCI furent exclus de notre organisation, non pour ces comportements pourtant intolérables mais pour leurs activités d'indicateurs avec, à leur actif, plusieurs actes de mouchardage. C'est ainsi, notamment, qu'ils publièrent, sur leur site Internet, la date à laquelle devait se tenir une Conférence du CCI au Mexique en présence de militants venus d'autres pays. Cet acte répugnant de la FICCI consistant à faciliter le travail des forces de répression de l'État bourgeois contre les militants révolutionnaires est d'autant plus ignoble que les membres de la FICCI savaient pertinemment que certains de nos camarades au Mexique avaient déjà, dans le passé, été directement victimes de la répression et que certains avaient été contraints de fuir leur pays d'origine.
Mais les comportements de mouchards des membres de la FICCI ne se résument pas à cet épisode. Avant et après leur exclusion du CCI, ils ont systématisé leur travail d'espionnage de notre organisation et rendu compte régulièrement, dans leurs bulletins, des résultats ainsi obtenus (Voir en particulier les bulletins de la FICCI n° 14, 18 et 19).
Leur sordide récolte d'informations est tout à fait significative de la manière dont ces gens concevaient leur "travail de fraction" (commérages, rapports de police). En effet, l'exhibition de telles informations s'adresse également à l'ensemble du CCI, en vue de mettre la pression sur ses militants en leur faisant comprendre qu'ils sont "sous surveillance", que rien de leurs faits et gestes n'échappera à la vigilance de la "Fraction interne".
Ce n'est pas parce qu'il émane de cerveaux malades de persécuteurs obsessionnels qu'il ne faut pas prendre au sérieux un tel travail de flicage de notre organisation et plus particulièrement de certains de ses membres.
Pour conclure sur les comportements policiers de la FICCI, il vaut la peine de signaler la publication par celle-ci d'un texte de 118 pages intitulé "L'Histoire du Secrétariat international du CCI". Ce texte, d'après son sous-titre, prétend raconter "Comment l'opportunisme s'est imposé dans les organes centraux avant de contaminer et entamer la destruction de l'ensemble de l'organisation...". Cet écrit illustre, encore une fois, le caractère policier de la démarche de la FICCI. En effet, il explique la prétendue "évolution opportuniste" du CCI par les "intrigues" d'un certain nombre de personnages malfaisants, en particulier la "compagne du chef" (présentée comme un agent de l'État exerçant son emprise sur le "chef"). C'est comme si la dégénérescence et la trahison du parti bolchevique avaient été le résultat de l'action du mégalomane Staline et non la conséquence de l'échec de la révolution mondiale et de l'isolement de la révolution en Russie. Ce texte relève de la plus pure conception policière de l'histoire laquelle a toujours été combattue par le marxisme.
Mais le caractère policier le plus odieux de ce texte, c'est bien le fait qu'il divulgue de nombreux détails sur le fonctionnement interne de notre organisation et qui sont pain bénit pour les services de police.
La politique de "cordon sanitaire" de la FICCI contre le CCI
Faute d'avoir pu convaincre les militants du CCI de la nécessité d'exclure le "chef" et la "compagne du chef", ce groupuscule parasitaire s'est donné comme objectif d'entraîner derrière ses calomnies les autres groupes de la Gauche communiste afin d'établir un cordon sanitaire autour du CCI et le discréditer (voir ci-après les épisodes de la "réunion publique du BIPR à Paris" et du "Circulo"). En fait ce sont tous les lieux d'intervention du CCI (permanences, réunions publiques, …) que la FICCI ciblait, alors que nous en avions interdit l'accès à ses membres du fait même de leur activité de mouchardage[7]. Alors que nous faisions appliquer notre décision de les écarter de tels lieux, nous avons dû certaines fois faire face à des menaces (dont celle proférée à haute voix de trancher la gorge à l'un de nos camarades) et agressions de ces voyous.
La dégénérescence opportuniste du CCI, proclamée mais jamais démontrée par la FICCI !
La FICCI se présente comme "le véritable continuateur du CCI" qui aurait connu une dégénérescence "opportuniste" et "stalinienne". Elle déclare poursuivre le travail, abandonné à ses dires par le CCI, de défense dans la classe ouvrière des "véritables positions de cette organisation" lesquelles seraient menacées par le développement de l'opportunisme en son sein affectant, en premier lieu, la question du fonctionnement. On a vu dans la pratique de ce groupe sa propre conception du respect des statuts et même des règles de comportement les plus élémentaires du mouvement ouvrier : "s'asseoir dessus", les piétiner avec fureur.
La méthode, consistant à "suggérer" en évitant le problème politique de fond, faisant appel au "bon sens populaire", aux méthodes de la chasse aux sorcières pratiquées au Moyen-âge
C'est ainsi que le CCI a été la cible de nombreuses autres accusations de la part de la FICCI, non évoquées jusqu'ici, et dont voici un tout petit échantillon : le CCI serait aujourd'hui frappé du stigmate "d'un éloignement progressif du marxisme et d'une tendance de plus en plus affirmée à mettre en avant (et à défendre) des valeurs bourgeoises et petites bourgeoises en vogue (le "jeunisme", le féminisme et surtout la "non-violence")" ; le CCI "ferait le jeu de la répression".
L'utilisation par la FICCI, à ses propres fins, d'une réunion publique du BIPR
Le BIPR[8] a été la cible d'une manœuvre osée de la part du la FICCI consistant à organiser, au bénéfice de ce groupe, une réunion publique à Paris, le 2 octobre 2004. En fait, il s'agissait d'une réunion publique conçue pour être au service de la réputation de la FICCI, au détriment de celle du BIPR et en vue de porter une attaque contre le CCI.
L'annonce de cette réunion par le BIPR indiquait que son thème était la guerre en Irak. Par contre, l'annonce qu'en fit la FICCI soulignait toute l'importance de sa propre démarche : "Sur notre suggestion et avec notre soutien politique et matériel, le BIPR va organiser une réunion publique à Paris (RP qui, nous l'espérons, ne sera pas la dernière) à laquelle nous appelons tous nos lecteurs à participer". Ce qu'il ressort de cet appel c'est que, sans la FICCI, cette organisation de la Gauche communiste, qui existe à l'échelle internationale et qui est connue depuis des décennies, n'aurait pas pu prendre l'initiative et organiser la réunion publique !
En fait, ce groupe parasite a utilisé le BIPR comme un "homme de paille" pour sa propre publicité en vue de l'obtention d'un certificat de respectabilité, de reconnaissance de son appartenance à la Gauche communiste. Et la voyoucratie décomplexée n'a pas hésité à utiliser le carnet d'adresse des contacts du CCI (qu'elle avait dérobée avant son départ de l'organisation) pour diffuser son appel à cette réunion publique.
L'alliance de la FICCI avec un aventurier (le citoyen B) en 2004
En 2004, le CCI était entré en relation politique avec un petit groupe en recherche en Argentine, le NCI (Nucleo comunista internacional). Fin juillet 2004, un membre du NCI, Monsieur B. tenta une manœuvre audacieuse : il demanda l’intégration immédiate du groupe au CCI. Il imposa cette exigence malgré la résistance des autres camarades du NCI qui, même s’ils se donnaient aussi comme objectif l’adhésion au CCI, ressentaient la nécessité de réaliser préalablement tout un travail en profondeur de clarification et d’assimilation, le militantisme communiste ne pouvant se baser que sur de solides convictions. Le CCI rejeta cette exigence conformément à notre politique s'opposant aux intégrations précipitées et immatures qui peuvent contenir le risque de la destruction de militants et sont nocives pour l’organisation.
Parallèlement à cela, une alliance s'était nouée entre la FICCI et l'aventurier B, certainement à l'initiative de B, au service d'une manœuvre contre le CCI utilisant, à son insu, le NCI. La manœuvre consistait à faire circuler au sein du milieu politique prolétarien une dénonciation du CCI et de ses "méthodes nauséabondes" qui semblait émaner indirectement du NCI, puisque cette dénonciation était signée d'un mystérieux et fictif "Circulo de comunistas internacionalistas" (soit "CCI" en abrégé !), animé par le citoyen B et qui, selon lui, était supposé constituer le "dépassement politique" du NCI. Ces calomnies furent véhiculées au moyen d'un tract du "Circulo" diffusé par la FICCI à l'occasion de la réunion publique à Paris du BIPR du 2 octobre 2004. Elles furent également mises en ligne en différentes langues sur le site du BIPR. En plus de cibler directement le CCI, le tract en question prenait la défense de la FICCI remettant totalement en cause une prise de position du NCI du 22 mai 2004 qui avait dénoncé ce groupe.
La manière dont le citoyen B a été amené à élaborer sa manœuvre est typique d'un aventurier, de ses ambitions et de son absence totale de scrupules et de préoccupation pour la cause du prolétariat. Le recours aux services d'un aventurier, par la FICCI, pour satisfaire sa haine du CCI et tenter de mettre en place, par le dénigrement public, l'isolement politique de notre organisation, est digne des personnages minables et méprisables qui peuplent le monde mesquin de la petite et de la grande bourgeoisie.
L’utilisation policière par le GIGC des bulletins internes du CCI
Le GIGC ayant eu en sa possession des bulletins internes du CCI, à travers un moyen que nous ignorions, il a fait toute une publicité tapageuse autour de cet évènement, voyant en celui-ci la preuve d'une crise du CCI. Le message que ces mouchards patentés cherchaient alors à faire passer était très clair : "il y a une "taupe" dans le CCI qui travaille main dans la main avec l’ex-FICCI !". C’était clairement un travail policier n’ayant pas d’autre objectif que de semer la suspicion généralisée, le trouble et la zizanie au sein de notre organisation. Ce sont ces mêmes méthodes qu’avait utilisées le Guépéou, la police politique de Staline, pour détruire de l’intérieur le mouvement trotskiste des années 1930. Ce sont ces mêmes méthodes qu’avaient déjà utilisées les membres de l’ex-FICCI (et notamment deux d’entre eux, Juan et Jonas, membres fondateurs du "GIGC") lorsqu’ils faisaient des voyages "spéciaux" dans plusieurs sections du CCI en 2001 pour organiser des réunions secrètes et faire circuler des rumeurs suivant lesquelles l’une de nos camarades (la "femme du chef du CCI", suivant leur expression) serait un "flic".
Le soutien du GIGC a Nuevo Curso et Gaizka[9]
Le CCI avait dénoncé une tentative de falsification des origines réelles de la Gauche communiste émanant d'un blog nommé Nuevo Curso et orchestrée par un aventurier, Gaizka, dont l'objectif n'est nullement de contribuer à clarifier et défendre les positions de ce courant mais de se "faire un nom" dans le milieu politique prolétarien. Cette attaque contre le courant historique de la Gauche communiste vise à transformer celle-ci en une mouvance aux contours flous, amputée des principes prolétariens rigoureux ayant présidé à sa formation, ce qui constitue un obstacle à la transmission aux futures générations de révolutionnaires des acquis du combat des fractions de gauche contre l'opportunisme et la dégénérescence des partis de l'Internationale communiste.
Quant à l'aventurier Gaizka, nous avons fourni à son sujet une quantité importante d'informations, à ce jour non réfutées, concernant les relations de ce Monsieur dans le monde des personnalités de la politique bourgeoise (de gauche surtout mais également de droite). C'est un comportement et un trait de personnalité qu'il partage avec des aventuriers - même s'il est loin, évidemment, d'avoir l'envergure de ces personnages - plus connus dans l'histoire comme Ferdinand Lassalle et Jean Baptiste von Schweitzer qui avaient opéré au sein du mouvement ouvrier en Allemagne au 19e siècle,.
C'est avec beaucoup d'enthousiasme, et de flagornerie, que le GIGC avait salué l'entrée sur la scène politique du blog Nuevo Curso : "L’ensemble des positions qu’il défend sont très clairement de classe et se situent dans le cadre programmatique de la Gauche communiste (…)". De plus, dès lors que notre organisation avait donné suffisamment d'informations aux lecteurs permettant de caractériser Gaizka (le principal animateur de Nuevo Curso) comme un aventurier présentant la particularité d'avoir entretenu, en 1992-94, des relations avec le plus important parti de la bourgeoisie en Espagne à cette époque, le PSOE, il n'y avait plus de doute permis concernant le sens de la démarche de Nuevo Curso visant à dénaturer la Gauche communiste. Pourtant, ce ne sont pas ces informations accessibles à tous (et démenties par personne, nous le répétons) qui ont empêché le GIGC de voler au secours de l'aventurier Gaizka, face à la dénonciation que nous en avons faite : "nous devons souligner qu’à ce jour, nous n’avons constaté aucune provocation, manœuvre, dénigrement, calomnie ou rumeur, lancée par les membres de Nuevo Curso, même à titre individuel, ni aucune politique de destruction contre d’autres groupes ou militants révolutionnaires".[10]
Il est au plus haut point révélateur que, pour écarter toute suspicion d'aventurisme à propos de la personne de Gaizka, l'animateur du GIGC prenne comme critère un ensemble de traits politiques qui le caractérisent lui-même au premier chef, mais pas nécessairement particulièrement Gaizka : provocateur, manœuvrier, dénigreur, calomniateur, destructeur de réputation, …. Quant à Gaizka, bien qu'il ne soit pas de l'envergure d'un Lassalle ou d'un Schweitzer, il "essaie de jouer dans la cour des grands" et il est même parvenu à se faire reconnaître d'un certain nombre d'entre eux grâce à certaines de ses capacités intellectuelles, à défaut de traiter d'égal à égal avec les plus grands comme c'était le cas de Lassalle avec Bismarck. [11]
À sa petite échelle, Gaizka s'imaginait pourvoir jouer un rôle en tant que représentant d'une branche de la Gauche communiste (la Gauche communiste espagnole), inventée de toute pièce par lui-même. La grande ambition de "monsieur GIGC", pour sa part, est de couvrir d'ordures le CCI.
E. En guise de conclusion (provisoire)
Pour illustrer notre analyse du phénomène du parasitisme politique, nous nous sommes principalement appuyés sur l'exemple du GIGC (anciennement FICCI). Le fait que cette organisation constitue une sorte de caricature de parasitisme nous a permis à la fois de dénoncer à nouveau sa crapulerie et sa malfaisance mais aussi de faire mieux ressortir les traits majeurs qui caractérisent ce phénomène et qu'on retrouve dans d'autres groupes ou éléments qui inscrivent leur activité dans une démarche parasitaire, même si c'est de façon moins évidente et plus subtile. Ainsi, le GIGC-FICCI est, à notre connaissance, le seul groupe qui ait adopté de façon délibérée une attitude de mouchard, d'agent conscient de la répression capitaliste. Cependant, en adoptant cette attitude d'agent conscient (même si non rétribué) de l'État bourgeois, ce groupe ne fait qu'exprimer de la façon la plus extrême l'essence et la fonction du parasitisme politique (et qui avaient été déjà analysées, comme on l'a vu, par Marx et Engels) : mener, au nom de la défense du programme prolétarien, un combat déterminé contre les véritables organisations de la classe ouvrière. Et cela, évidemment, pour le plus grand bénéfice de son ennemie mortelle, la bourgeoisie. Et si certains groupes s'abstiennent des outrances du GIGC, préférant pratiquer un parasitisme "soft", plus subtil, cela ne les rend pas moins dangereux, bien au contraire.
De la même façon que les véritables organisations du prolétariat ne pourront assumer, comme l'a démontré toute l'histoire du mouvement ouvrier, le rôle que celui-ci leur a confié qu'en menant un combat déterminé contre la gangrène opportuniste, elles ne pourront être à la hauteur de leur responsabilité qu'en menant un combat aussi déterminé contre la plaie du parasitisme. Cela, Marx et Engels l'avaient pleinement compris à partir de la fin des années 1860, et notamment lors du Congrès de La Haye de la Première Internationale en 1872 même si, par la suite, un grand nombre de marxiste, qui pourtant menaient le combat contre l'opportunisme, tel Franz Mehring, n'ont pas compris le sens et l'importance du combat contre l'Alliance de Bakounine. C'est probablement une des raisons (à côté de la naïveté et des glissements opportunistes) pour lesquelles la question du parasitisme n'est pas comprise dans le milieu politique prolétarien. Mais il ne saurait être question de faire des faiblesses du mouvement ouvrier un argument pour refuser de voir et affronter les dangers qui menacent le combat historique de notre classe. C'est pleinement que nous nous réclamons de l'esprit de cette phrase d'Engels citée au début de l'article : "Il est grand temps, une fois pour toutes, de mettre fin aux luttes internes quotidiennement provoquées dans notre Association par la présence de ce corps parasite."
CCI 07-08-23
[Retour à la série : Le parasitisme politique n'est pas un mythe, le GIGC en est une dangereuse expression [634]]
[1] Construction de l'organisation des révolutionnaires : thèses sur le parasitisme [522]. Revue internationale n° 94
[2] Questions d'organisation, III : le congrès de La Haye de 1872 : la lutte contre le parasitisme politique. [653] Revue internationale n° 87.
[3] "Alliance de la démocratie socialiste", fondée par Bakounine qui allait trouver un terrain fertile dans des secteurs importants de l'Internationale du fait des faiblesses qui pesaient encore sur elle et qui résultaient de l'immaturité politique du prolétariat à cette époque, un prolétariat qui ne s'était pas encore totalement dégagé des vestiges de l'étape précédente de son développement, et notamment des mouvements sectaires.
[4] "Avant de rejoindre l'AIT, Bakounine a expliqué à ses disciples pourquoi l'AIT n'était pas une organisation révolutionnaire : les proudhoniens étaient devenus réformistes, les blanquistes avaient vieilli, et les allemands et le Conseil général que soi-disant ceux-ci dominaient, étaient "autoritaires". Selon Bakounine, ce qui manquait avant tout, c'était la "volonté" révolutionnaire. C'est ça que l'Alliance voulait assurer en passant par-dessus le programme et les statuts et en trompant ses membres.
Pour Bakounine, l'organisation que le prolétariat avait forgée, qu'il avait construite au cours d'années de travail acharné, ne valait rien. Ce qui était tout pour lui, c'étaient les sectes conspiratrices qu'il avait lui-même créées et contrôlées. Ce n'est pas l'organisation de classe qui l'intéressait, mais son propre statut personnel et sa réputation, sa "liberté" anarchiste ou ce qu'on appelle aujourd'hui "réalisation de soi". Pour Bakounine et ses semblables, le mouvement ouvrier n'était rien d'autre que le véhicule de la réalisation de leur individu et de leurs projets individualistes." Questions d'organisation, I : la première internationale et la lutte contre le sectarisme [654]." Revue internationale n° 87.
[5] La Revue Internationale n°44, dans l'article consacré au 6ème Congrès du CCI, rend compte du départ de ces camarades et de leur constitution en "Fraction". Le lecteur pourra s'y reporter, ainsi qu'aux articles publiés dans les Revues n°40 à 43 reflétant l'évolution du débat au sein du CCI.
[6] Les éléments d'information publiés ci-après sont un résumé d'une partie d'un article, L'aventurier Gaizka a les défenseurs qu'il mérite : les voyous du GIGC [655], rendant compte de façon plus détaillée des nuisances de ce groupe parasite.
[8] BIPR : Bureau International pour le Parti Révolutionnaire. Groupe fondé en 1984 par le le Partito comunista internazionalista (Battaglia comunista) et la Communist Worker's Organisation (CWO). Depuis 2009, ce groupe a changé de nom pour devenir la Tendance Communiste Internationaliste (TCI).
[9] Lire notre articles L'aventurier Gaizka a les défenseurs qu'il mérite : les voyous du GIGC [244]. (février 2021)
[10] Nouvelle attaque du CCI contre le camp prolétarien international [68] (1er février 2020)
Vie du CCI:
Histoire du mouvement ouvrier:
Conscience et organisation:
Personnages:
- le citoyen B [660]
- Gaizka [622]
- Ferdinand Lassalle [661]
Courants politiques:
Rubrique:
NUPES : un parti va-t-en-guerre pour défendre l’impérialisme français
- 133 lectures
Le 13 juillet, le Parlement adopte définitivement le projet de « loi de programmation militaire » (LPM) qui prévoit, pour 2024-2030, un budget colossal de 413 milliards d’Euros, en hausse de 40 % par rapport à 2019-2025. Tout le beau monde des élus s’est félicité de l’esprit démocratique qui a régné dans les débats. Lecornu, ministre de la Défense, devait apporter comme cadeau à Macron pour le 14 juillet, l’accord largement majoritaire des députés et des sénateurs, y inclus du Parti socialiste… sauf des écologistes, qui se sont abstenus, de LFI et du PCF qui ont voté contre. Quiconque aurait pu penser que tous ces partis, qui prétendent défendre les ouvriers, se seraient élevés contre un tel budget qui va nécessiter des attaques brutales contre la classe ouvrière. Que nenni ! Ce qu’ils remettent en cause, ce n’est pas la loi elle-même, son budget faramineux, mais les choix du gouvernement.
La gauche du capital pour le renforcement de l’économie de guerre
Quelles critiques portent-ils au gouvernement ? Le groupe écologiste au Sénat, dans son communiqué de presse du 29 juin, « salue les progrès du texte lors de son examen parlementaire, notamment en matière de contrôle parlementaire sur l’exécution de la LPM et surtout sur le contrôle des exportations d’armes de la France. Il est parfaitement conscient du besoin impérieux de reconstituer nos stocks stratégiques pour continuer à aider l’Ukraine et ne conteste pas l’effort qu’engage la Nation en faveur de sa Défense ». Au moins, c’est très clair ! ! Par contre, les sénateurs écologistes auraient souhaité que les plus aisés contribuent plus à l’effort de guerre et que les moyens humains et capacitaires des forces conventionnelles, en particulier de l’armée de terre, soient renforcés. Et pour rajouter un vernis écologiste, les sénateurs demandent à Macron que les mêmes efforts budgétaires soient aussi faits pour assurer la sécurité climatique. Oui pour la guerre, mais… de manière écologique !
Pour le PCF, il faut se libérer de l’OTAN pour se consacrer exclusivement à la défense de la nation et tous les territoires d’outre-mer. Pour ce parti stalinien, il faut une armée forte afin de « sécuriser nos zones économiques exclusives », c’est-à-dire défendre l’impérialisme français face aux autres nations impérialistes. « C’est la raison pour laquelle toutes les dépenses permettant à nos armées de disposer des meilleurs matériels, à la pointe des nouvelles technologies et à nos soldats d’être bien équipés, bien formés, mieux entraînés et mieux rémunérés sont pleinement justifiées. Face au contexte de guerre et de tensions internationales, il fallait augmenter le budget des armées, mais certainement pas le doubler ! » Appréciez la nuance : « il fallait augmenter le budget des armées mais certainement pas le doubler ».
Sur son site où est publiée sa vision de la LPM, LFI emboîte le pas du PCF, en soutenant le principe d’une défense « souveraine » et « indépendante », hors de l’OTAN et de l’Europe, avec la nationalisation des principaux secteurs industriels au service du militaire, avec, cerise sur le gâteau : la suppression du SNU pour la création d’une conscription citoyenne obligatoire socle d’une « Garde nationale citoyenne », d’une durée de 9 mois. Quel est le projet de LFI ? Des jeunes, de 18/25 ans, rémunérés au SMIC, qui auront une formation militaire initiale au maniement des armes et aux manœuvres et des formations ponctuelles dans d’autres secteurs régaliens (aux côtés des effectifs professionnels de la police, gendarmerie, sécurité civile, pompiers, agents des eaux et forêts, premiers secours). Cette période de formation militaire pourrait être prolongée sur la base du volontariat, dans la limite des besoins des armées et des autres secteurs accueillant les recrues ; comporterait un volet d’éducation civique et de formation aux enjeux géopolitiques. Selon LFI, il s’agit pour cette jeunesse de connaître quelles zones de l’impérialisme français défendre. Cette conscription constituera le socle d’une « Garde nationale » renouvelée, ouverte sur la base du volontariat à chaque jeune ayant effectué son service. Elle remplacera le dispositif actuel des réserves de l’armée, de la police et de la gendarmerie, majoritairement composées d’anciens professionnels et donc coupées de la nation. Plus fort que Macron et son SNU ! Embrigadement général de la jeunesse pour défendre la nation et pour en faire des flics !
Et la NUPES peut compter sur le soutien des trotskistes. Des lambertistes du POI (Parti ouvrier indépendant, courant de la FI depuis sa création en 2017) jusqu’à Lutte ouvrière (de manière « critique »), en passant par le Nouveau parti anticapitaliste et la Tendance marxiste internationale, les trotskistes sont un soutien indéfectible de la NUPES et de son programme de militarisation de la société et d’embrigadement du prolétariat. De véritables sergents recruteurs pour les guerres impérialistes.
La gauche et l’extrême gauche aux avant-postes des guerres impérialistes
Depuis l’éclatement de la guerre en Ukraine, toutes les nations capitalistes ont augmenté considérablement leur budget militaire. Les tensions impérialistes sont arrivées à un tel degré que le risque accru de guerre devient de plus en plus palpable, avec en toile de fond une concurrence exacerbée et un développement débridé du chacun pour soi. Tous les États capitalistes sont pris dans cet engrenage infernal, tous les partis bourgeois sont prêts à défendre leurs intérêts par les armes. Pas seulement les fractions de droite, mais aussi celles de gauche et d’extrême gauche comme l’histoire nous l’a appris. La NUPES, avec le PS en son sein qui a voté la LPM, et leurs larbins d’extrême gauche, sont pleinement impliqués dans la défense du capitalisme comme ils l’ont été dans le passé. Pour donner quelques exemples :
– En 1914, les sociales démocraties européennes ont appelé les ouvriers à s’entre-massacrer dans la première grande boucherie mondiale ;
– A la veille de la Deuxième Guerre mondiale, le Front populaire et son homologue corollaire, le Frente popular en Espagne, ont enrôlé le prolétariat dans la lutte contre l’antifascisme en 1936 puis dans la deuxième grande boucherie mondiale, avec le soutien des trotskistes et des anarchistes ;
– le démocrate Roosevelt, quelques années après, a entraîné les États-Unis dans cette même boucherie ;
– les staliniens, avec leurs alliés trotskistes et certains anarchistes, ont été les ardents défenseurs du capitalisme à la sauce « coq gaulois » à travers la Résistance et lors de la Libération de Paris, en août 1944, leurs milices hurlant : « à chacun son boche » ;
– c’est un ministre cdu Parti communiste qui envoie l’aviation massacrer des milliers d’algériens à Sétif, en 1945, au moment de la commémoration de la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Dans d’autres localités d’Algérie, des milliers de nationalistes furent sommairement exécutés par les ministres de gauche sous le gouvernement de De Gaulle ;
– durant la période de la guerre froide, les partis socialistes européens se préparaient à affronter le bloc adverse à travers la défense de la politique atlantiste, alors que dans le même temps, les États-Unis, avec à leur tête les démocrates, perpétraient des massacres au Vietnam en enrôlant la jeunesse américaine ;
– dans les années 1990, ce sont les partis socialistes (Mitterrand, Tony Blair) qui, sous le diktat des États-Unis, se sont vautrés dans la barbarie de la première guerre du Golfe contre l’Irak ;
– et les trotskistes ont aussi leur part de défenseurs des brigands impérialistes, dans les différentes « luttes de libération nationales » au nom de la défense de l’URSS contre le grand méchant américain, et aujourd’hui encore en défense soit de l’Ukraine pour le NPA ou de la Russie pour Lutte ouvrière.
La classe ouvrière ne doit pas se faire d’illusion sur la NUPES et ses acolytes trotskistes. Ce sont des partis bourgeois, des défenseurs de l’ordre capitaliste et de l’impérialisme. Dans les luttes que le prolétariat mène sur son propre terrain pour défendre ses conditions de vie, et qu’il sera obligé de développer dans les semaines, les mois et les années à venir, du fait qu’il va subir des attaques de plus en plus violentes, il lui faudra démasquer tous ces partis qui se prétendent être ses défenseurs alors qu’ils sont ses pires ennemis toujours au service de l’État.
André, 25 juillet 2023
Situations territoriales:
Récent et en cours:
Courants politiques:
- Stalinisme [340]
- Gauchisme [461]
- Trotskysme [468]
- Anarchisme officiel [662]
Rubrique:
Permanence en ligne du 1er septembre 2023
- 74 lectures
Révolution Internationale, section en France du Courant Communiste International, organise une permanence en ligne le vendredi 1er septembre à partir de 20H00.
Ces permanences sont des lieux de débat ouverts à tous ceux qui souhaitent rencontrer et discuter avec le CCI. Nous invitons vivement tous nos lecteurs et tous nos sympathisants à venir y débattre afin de poursuivre la réflexion sur les enjeux de la situation et confronter les points de vue. N'hésitez pas à nous faire part des questions que vous souhaiteriez aborder.
Les lecteurs qui souhaitent participer aux permanences en ligne peuvent adresser un message sur notre adresse électronique ([email protected] [213]) ou dans la rubrique “nous contacter [214]” de notre site internet, en signalant quelles questions ils voudraient aborder afin de nous permettre d’organiser au mieux les débat.
Les modalités techniques pour se connecter à la permanence seront communiquées ultérieurement.
Vie du CCI:
- Permanences [291]
Rubrique:
ICConline - septembre 2023
- 67 lectures
Réponse au camarade Steinklopfer
- 143 lectures
Nous continuons à publier des contributions à un débat interne relatif à la compréhension de notre concept de décomposition, aux tensions inter-impérialistes et à la menace de guerre, et au rapport de forces entre le prolétariat et la bourgeoisie. Ce débat a été rendu public pour la première fois par le CCI en août 2020, lorsqu’il a publié un texte du camarade Steinklopfer dans lequel il exprimait et expliquait ses désaccords avec la résolution sur la situation internationale du 23ᵉ Congrès du CCI. Ce texte était accompagné d’une réponse du CCI et les deux peuvent être consultés ici [498]. La deuxième contribution du camarade (ici [663]) développe ses divergences avec la résolution du 24ᵉ Congrès et le texte ci-dessous est une réponse supplémentaire exprimant la position du CCI. Enfin, il y a une contribution du camarade Ferdinand (ici [664]) qui exprime également ses divergences avec la résolution du 24ᵉ Congrès. Une réponse à ce texte sera publiée en temps utile.
Le CCI est plus ou moins seul à considérer que l’effondrement du bloc impérialiste de l’Est en 1989 a marqué le début d’une nouvelle phase dans la décadence du capitalisme – la phase de décomposition, résultant d’une impasse historique entre les deux principales classes de la société, aucune n’étant capable de faire avancer sa propre perspective face à la crise historique du système : guerre mondiale pour la bourgeoisie, révolution mondiale pour la classe ouvrière. Ce serait l’étape finale du long déclin du mode de production capitaliste, entraînant la menace d’une descente dans la barbarie et la destruction qui pourrait engloutir la classe ouvrière et l’humanité même sans une guerre entièrement mondiale entre deux blocs impérialistes[1].
Les groupes du milieu prolétarien ont rarement, voire jamais, répondu aux Thèses sur la Décomposition qui posaient les bases théoriques du concept de décomposition. Certains, comme les bordiguistes, avec leur idée de l’invariance de la théorie marxiste depuis 1848, ont eu tendance à rejeter le concept même de décadence capitaliste. D’autres, comme la Tendance communiste internationaliste, considèrent comme idéaliste notre conception de la décomposition comme une phase de chaos croissant et de destructivité irrationnelle, même s’ils ne contestent pas que ces phénomènes existent et sont même en augmentation. Mais pour ces camarades, notre conception n’est pas directement basée sur une analyse économique, et ne peut donc pas être considérée comme matérialiste.
En même temps, bien qu’ils situent leurs origines dans la Gauche communiste italienne, ces groupes n’ont jamais accepté notre notion du cours historique : l’idée que la capacité du capitalisme à mobiliser la société pour une guerre mondiale dépend de la question de savoir s’il a infligé une défaite décisive à la classe ouvrière mondiale, en particulier à ses bataillons centraux. C’était assurément l’approche de la Fraction de gauche qui a publié Bilan dans les années 1930, qui insistait sur le fait qu’avec la défaite de la vague révolutionnaire de 1917-23, la voie vers une Seconde Guerre mondiale était ouverte ; et c’était une méthode reprise par le CCI dès sa création. Dans les années 1970 et 1980, nous avons soutenu que, malgré l’aggravation de la crise économique et l’existence de blocs impérialistes stables, le capitalisme était incapable de faire des pas décisifs vers la troisième guerre mondiale parce qu’il était confronté à une génération invaincue de prolétaires qui n’étaient pas prêts à faire les sacrifices exigés par une marche vers la guerre. Aucun de ces arguments n’avait de sens pour la majorité des groupes du milieu qui ne tenaient pas compte du rapport de forces entre les classes pour comprendre la direction que prenait la société[2].
Le concept de cours historique a été un élément clé dans la formulation de la théorie de la décomposition. Dans les années 1970, période caractérisée par des vagues internationales de luttes ouvrières en réponse à la crise économique ouverte, nous considérions encore que la société se dirigeait vers des affrontements de classes massifs dont l’issue déterminerait si la voie était ouverte à la guerre mondiale ou à la révolution mondiale. Cependant, vers la fin des années 1980, malgré l’incapacité de la bourgeoisie à mobiliser la société pour une nouvelle guerre mondiale, il est devenu évident que la classe ouvrière avait de plus en plus de mal à affirmer sa propre perspective révolutionnaire. Paradoxalement, le concept d’un cours historique, d’un mouvement défini vers soit une guerre mondiale, soit une lutte de classe massive, n’était plus applicable dans la nouvelle phase ouverte par l’impasse historique, comme nous l’avons clarifié lors de notre 23ᵉ Congrès international[3].
À quelques exceptions près, la majorité des groupes du milieu ont également rejeté l’une des principales conclusions que nous avons tirées de l’analyse de la décomposition au niveau des conflits impérialistes – une analyse développée dans notre Texte d’orientation de 1990 « Militarisme et décomposition » et sa mise à jour en mai 2022 – à savoir que la tendance croissante au chacun pour soi entre les États, la vague de fragmentation et de désordre qui caractérise cette nouvelle phase, était devenue un élément central de la difficulté pour la bourgeoisie de reconstituer des blocs impérialistes stables[4]. La plupart des groupes considèrent que la formation de nouveaux blocs est à l’ordre du jour aujourd’hui, et affirment même qu’elle est assez avancée.
Bien qu’à notre avis les principales prévisions des Thèses sur la Décomposition et du Texte d’orientation sur le militarisme aient résisté à l’épreuve du temps (cf. rapport du 22ᵉ Congrès [5]), la guerre en Ukraine a mis en évidence la divergence avec les groupes qui voient le mouvement rapide vers les blocs et la menace imminente d’une troisième guerre mondiale.
Des idées similaires sont apparues dans nos propres rangs, comme on peut le voir dans les textes des camarades Steinklopfer et Ferdinand [6]. Ces camarades insistent cependant toujours sur le fait qu’ils sont d’accord avec le concept de décomposition, bien qu’à notre avis certains de leurs arguments le remettent en question.
Dans cet article, nous allons expliquer pourquoi nous pensons que c’est le cas dans la contribution du camarade Steinklopfer. Bien que les positions de Steinklopfer et de Ferdinand soient très similaires, elles ont été présentées comme des contributions individuelles, nous y répondrons donc séparément.
Nous diviserons notre réponse en trois parties : sur les désaccords concernant le concept de base de décomposition ; sur la polarisation impérialiste ; et sur le rapport de forces entre les classes. En répondant aux critiques du camarade Steinklopfer, nous devrons passer un temps considérable à corriger diverses représentations erronées de la position de l’organisation, qui, à notre avis, découlent d’une perte d’acquis de la part du camarade – un oubli de certains éléments de base de notre cadre analytique. Qui plus est, certaines de ces représentations erronées ont déjà été traitées dans des réponses précédentes aux textes du camarade, mais ces dernières ne sont pas prises en compte ou ne font pas l’objet de réponses dans les contributions ultérieures du camarade. C’est le signe d’une réelle difficulté à faire avancer le débat.
Sur le concept de base de décomposition : où est le révisionnisme ?
Selon le camarade Steinklopfer, c’est pourtant le CCI qui « révise » sa conception de la décomposition.
« il y a un fil rouge qui relie entre eux ces désaccords, qui tourne autour de la question de la décomposition. Bien que l’ensemble de l’organisation partage notre analyse de la décomposition comme phase ultime du capitalisme, lorsque nous voulons appliquer ce cadre à la situation actuelle, des différences d’interprétation apparaissent. Ce sur quoi nous sommes tous d’accord est que cette phase terminale, non seulement a été ouverte par l’incapacité de l’une ou l’autre des principales classes de la société d’offrir une perspective à l’humanité toute entière, unir de grandes parties de la société soit derrière la lutte pour la révolution mondiale (le prolétariat), soit derrière la mobilisation pour la guerre généralisée (la bourgeoisie), mais qu’elle y a ses plus profondes racines. Mais, pour l’organisation, il y aurait une seconde force motrice à cette phase terminale, qui serait la tendance au chacun-pour-soi : entre les États, au sein de la classe dominante de chaque État national, dans la société bourgeoise au sens large. Sur cette base, en ce qui concerne les tensions impérialistes, le CCI tend à sous-estimer la tendance à la bipolarisation entre grands États dominants, la tendance vers la formation d’alliances militaires entre États, tout comme il sous-estime le danger grandissant de confrontation militaire directe entre grandes puissances, qui contient une dynamique potentielle vers ce qui ressemble à une Troisième Guerre mondiale, laquelle pourrait potentiellement détruire l’humanité entière ».
Nous reviendrons plus tard sur la question de la sous-estimation de la menace d’une troisième guerre mondiale. Ce que nous voulons préciser à ce stade, c’est que nous ne considérons pas la tendance au « chacun pour soi » comme une « seconde force motrice à cette phase terminale », au sens où elle serait une cause sous-jacente de décomposition, ce qui est sous-entendu dans la phrase du camarade « une seconde force motrice » et explicite lorsqu’il poursuit en disant que « bien que je sois d’accord avec l’idée que le chacun-pour-soi bourgeois est une très importante caractéristique de la décomposition, qui a joué un très grand rôle dans l’ouverture de la phase de décomposition avec la désintégration de l’ordre impérialiste mondial de l’après-Seconde Guerre mondiale, je ne crois pas que c’en soit une des principales causes ». Si nous sommes tous d’accord pour dire que la tendance de chaque État à défendre ses propres intérêts est inhérente à toute l’histoire du capitalisme, même pendant la période des blocs stables – ou comme le dit Steinklopfer, « le chacun-pour-soi bourgeois est une tendance permanente et fondamentale du capitalisme depuis sa naissance » – cette tendance est « libérée » et exacerbée sur un plan qualitatif pendant la phase de décomposition. Cette exacerbation reste un produit de la décomposition, mais elle est devenue un facteur de plus en plus actif dans la situation mondiale, un obstacle majeur à la formation de nouveaux blocs.
Cela nous amène à un deuxième désaccord clé sur le concept de décomposition – la compréhension que la décomposition, tout en faisant fructifier toutes les contradictions existantes du capitalisme décadent, prend le caractère d’un changement qualitatif. Selon Steinklopfer, « Comme je le comprends, l’organisation a migré vers la position que, avec la décomposition, le chacun-contre-tous a acquis une qualité nouvelle par rapport à la précédente phase du capitalisme décadent, représentée par une sorte de domination absolue de la tendance à la fragmentation. Pour moi, par contre, il n’y a pas de tendance majeure dans la phase de décomposition qui n’existait pas déjà auparavant, en particulier dans la période de la décadence capitaliste ouverte par la Première Guerre mondiale ».
Il semble qu’il s’agisse là d’un cas évident de « perte d’acquis », d’oubli de ce que nous avons dit nous-mêmes dans nos textes fondamentaux, en l’occurrence les Thèses sur la Décomposition elles-mêmes. Certes, les Thèses conviennent que « Dans la mesure où les contradictions et manifestations de la décadence du capitalisme, qui, successivement, marquent les différents moments de cette décadence, ne disparaissent pas avec le temps, mais se maintiennent, et même s’approfondissent, la phase de décomposition apparaît comme celle résultant de l’accumulation de toutes ces caractéristiques d’un système moribond, celle qui parachève et chapeaute trois quarts de siècle d’agonie d’un mode de production condamné par l’histoire » (Thèse 3). Mais la même thèse souligne ensuite que la phase de décomposition « se présente encore comme la conséquence ultime, la synthèse achevée » de ces caractéristiques : en somme, une telle synthèse marque le point où la quantité se transforme en qualité. Sinon, quel sens y aurait-il à décrire la décomposition comme une nouvelle phase de la décadence ?
Sur la polarisation impérialiste
Si nous revenons au TO sur Militarisme et Décomposition, il devient clair que nous n’avons jamais soutenu que la tendance à la formation de nouveaux blocs disparaît dans la phase de décomposition. « L’histoire (notamment celle du deuxième après-guerre) a mis en évidence le fait que la disparition d’un bloc impérialiste (par exemple l’« Axe ») met à l’ordre du jour la dislocation de l’autre (les « Alliés ») mais aussi la reconstitution d’un nouveau « couple » de blocs antagoniques (Est et Ouest). C’est pour cela que la situation présente porte effectivement avec elle, sous l’impulsion de la crise et de l’aiguisement des tensions militaires, une tendance vers la reformation de deux nouveaux blocs impérialistes ».
Cependant, le TO avait déjà souligné que
« ce n’est pas la constitution de blocs impérialistes qui se trouve à l’origine du militarisme et de l’impérialisme. C’est tout le contraire qui est vrai : la constitution des blocs n’est que la conséquence extrême (qui, à un certain moment peut aggraver les causes elles-mêmes), une manifestation (qui n’est pas nécessairement la seule) de l’enfoncement du capitalisme décadent dans le militarisme et la guerre. D’une certaine façon, il en est de la formation des blocs vis-à-vis de l’impérialisme comme du stalinisme vis-à-vis du capitalisme d’État. De même que la fin du stalinisme ne remet pas en cause la tendance historique au capitalisme d’État, dont il constituait pourtant une manifestation, la disparition actuelle des blocs impérialistes ne saurait impliquer la moindre remise en cause de l’emprise de l’impérialisme sur la vie de la société ». Et il poursuit en disant qu’en l’absence de blocs, les antagonismes impérialistes prendront un caractère nouveau, chaotique, mais non moins sanglant : « Dans la nouvelle période historique où nous sommes entrés, et les événements du Golfe viennent de le confirmer, le monde se présente comme une immense foire d’empoigne, où jouera à fond la tendance au « chacun pour soi », où les alliances entre États n’auront pas, loin de là, le caractère de stabilité qui caractérisait les blocs, mais seront dictées par les nécessités du moment. Un monde de désordre meurtrier, de chaos sanglant dans lequel le gendarme américain tentera de faire régner un minimum d’ordre par l’emploi de plus en plus massif et brutal de sa puissance militaire ».
Ce scénario a été amplement démontré par les guerres qui ont suivi dans les Balkans, l’invasion de l’Afghanistan et de l’Irak, la guerre en Syrie, les nombreux conflits en Afrique, etc. En particulier, les tentatives du gendarme américain de maintenir un minimum d’ordre deviendraient un facteur majeur dans l’exacerbation du chaos, comme nous l’avons vu au Moyen-Orient en particulier.
Bien entendu, l’analyse proposée dans le Texte d’orientation sur le militarisme, publié au début des années 1990, présente une limite majeure. S’il démontre à juste titre l’incapacité de nouveaux prétendants tels que l’Allemagne et le Japon à former un nouveau bloc opposé aux États-Unis, il ne prévoit pas la montée en puissance de la Chine et sa capacité à être un défi majeur à la domination américaine. Mais cela invalide-t-il la conclusion du TO selon laquelle la tendance à la formation de nouveaux blocs ne sera pas à l’ordre du jour pendant une période indéfinie ?
Pour répondre à cette question, il est nécessaire d’être clair sur ce que le CCI dit réellement sur le défi chinois aux États-Unis. Selon le camarade Steinklopfer,
« Dans l’analyse actuelle de l’organisation, cependant, la Chine n’est pas et ne sera jamais un concurrent sérieux des États-Unis, parce que son développement économique et technologique est considéré comme « un produit de la décomposition ». Si l’on suit cette interprétation, la Chine ne peut être et ne sera jamais plus qu’un pays semi-développé incapable de rivaliser avec les vieux centres du capitalisme d’Amérique du Nord, d’Europe ou du Japon. Cette interprétation n’implique-t-elle pas que l’idée, sinon d’un arrêt du développement des forces productives – que nous avons toujours, à juste titre, exclu comme caractéristique du capitalisme décadent – du moins de quelque chose qui n’en est pas loin, est maintenant postulée par l’organisation dans la phase finale de la décadence ? Comme un lecteur attentif l’aura noté, le 24ᵉ Congrès a condamné non seulement l’idée d’un défi global de l’impérialisme chinois comme remettant en cause la question de l’analyse théorique de la décomposition – l’idée même que la Chine a renforcé sa compétitivité au détriment de ses rivaux est rejetée comme une expression de mes prétendues illusions sur la bonne santé du capitalisme chinois ».
La position selon laquelle la Chine « ne sera jamais un concurrent sérieux des États-Unis » n’est pas du tout celle de l’organisation. Bien qu’il ait tardé à reconnaître l’importance de la montée de la Chine, depuis quelques années maintenant, le CCI insiste sur le fait que la stratégie impérialiste américaine – assurément depuis les années Obama, à travers la présidence Trump et en continuant sous Biden – est basée sur la compréhension que son principal rival est la Chine, tant sur le plan économique que militaire. Le rapport sur les tensions impérialistes publié dans le sillage de la guerre en Ukraine[7] développe l’argument selon lequel, derrière le piège que les États-Unis ont tendu à la Russie en Ukraine, derrière la tentative de saigner à blanc la Russie, la véritable cible de l’impérialisme américain est la Chine ; et il évoque assez longuement la « polarisation » croissante entre les États-Unis et la Chine comme un facteur central des rivalités impérialistes mondiales. Mais c’est une erreur – et nous pensons que le camarade Steinklopfer y tombe – de confondre ce processus de polarisation, dans lequel les rivalités entre les États-Unis et la Chine prennent de plus en plus le devant de la scène dans les événements mondiaux, avec la formation réelle de blocs militaires, qui impliquerait le développement d’alliances stables dans lesquelles une puissance est capable d’exercer une discipline sur ses « alliés ». Comme nous l’avons dit, le milieu prolétarien a prétendu que la guerre en Ukraine avait marqué une étape importante dans la marche vers de nouveaux blocs militaires, mais en réalité nous avons vu de nouvelles preuves de l’instabilité des alliances existantes :
– Si les États-Unis ont connu un certain succès en revigorant l’OTAN sous leur direction, ils n’ont pas mis fin à la volonté de pays comme l’Allemagne et la France d’adopter une ligne indépendante à l’égard de la Russie, comme en témoignent les tentatives de négociations séparées, la réticence à imposer des interdictions sur l’importation d’énergie russe et, surtout, la relance de la force militaire de l’UE et l’augmentation considérable du budget de la défense de l’Allemagne – une arme à double tranchant qui pourrait aller à l’encontre des intérêts américains à long terme ; entre-temps, la Turquie, membre de l’OTAN, a très clairement joué son propre jeu dans cette situation, comme en témoigne l’accord qu’elle a négocié entre l’Ukraine et la Russie pour permettre l’acheminement de céréales à partir des ports ukrainiens.
– Le « soutien » de la Chine à la Russie a été extrêmement discret malgré les demandes d’aide économique et militaire de la Russie. Il ne fait aucun doute que la classe dominante chinoise est consciente que la Russie est tombée dans le piège américain et sait qu’une Russie affaiblie constituerait un énorme fardeau plutôt qu’un « partenaire » utile.
– Un certain nombre de pays ont maintenu une position indépendante face à l’appel à isoler la Russie, notamment l’Inde et une série de pays d’Amérique du Sud et d’Afrique.
Nous devrions également souligner, en réponse à l’accusation selon laquelle le CCI « sous-estime le danger grandissant de confrontation militaire directe entre grandes puissances », que le rapport nie fermement que l’inexistence de blocs militaires rende le monde plus sûr, au contraire :
« L’absence de blocs rend paradoxalement la situation plus dangereuse dans la mesure où les conflits sont caractérisés par une plus grande imprédictibilité : « En annonçant qu’il plaçait sa force de dissuasion en état d’alerte, le président russe Vladimir Poutine a contraint l’ensemble des états-majors à mettre à jour leurs doctrines, le plus souvent héritées de la guerre froide. La certitude de l’annihilation mutuelle – dont l’acronyme en anglais MAD signifie « fou » – ne suffit plus à exclure l’hypothèse de frappes nucléaires tactiques, prétendument limitées. Au risque d’un emballement incontrôlé » (LMD, avril 2022, p.1). En effet, paradoxalement, on peut soutenir que le regroupement en blocs limitait les possibilités de dérapage
-
à cause de la discipline de bloc ;
-
à cause aussi de la nécessité d’infliger au préalable une défaite décisive au prolétariat mondial dans les centres du capitalisme (cf. l’analyse du cours historique dans les années 1980).
Ainsi, même s’il n’y a pas actuellement de perspective de constitution de blocs ou de troisième guerre mondiale, en même temps, la situation est caractérisée par une plus grande dangerosité, liée à l’intensification du chacun pour soi et à l’irrationalité croissante : l’imprévisibilité du développement des confrontations, les possibilités de dérapages de celles-ci, qui est plus forte que dans les années 50 à 80, marquent la phase de décomposition et constituent une des dimensions particulièrement préoccupante de cette accélération qualitative du militarisme. ».
Le danger esquissé ici n’est pas celui où la bourgeoisie est capable de faire marcher consciemment l’humanité vers une troisième guerre mondiale entre blocs, visant la conquête des marchés et des ressources des puissances rivales. Cela impliquerait que l’une des prémisses clés de la décomposition – l’incapacité de la bourgeoisie à offrir une perspective à l’humanité, aussi barbare soit-elle – ait été retirée de l’équation. Ce serait plutôt l’expression ultime de la propagation de l’irrationalité et du chaos qui sont si centraux dans la phase de décomposition. D’une certaine manière, Steinklopfer le reconnaît lui-même, lorsqu’il dit, plus loin dans le texte, qu’une spirale irréversible de destruction pourrait avoir lieu même sans la formation de blocs : « Il est de la plus haute importance politique de dépasser toute approche schématique, unilatérale de faire de l’existence de blocs impérialistes une précondition des affrontements militaires entre grandes puissances dans la situation actuelle », et il poursuit en affirmant que la tentative même d’empêcher la formation de nouveaux blocs pourrait rendre une troisième guerre mondiale plus probable. La provocation américaine à l’égard de la Russie s’inscrit assurément dans le cadre d’un effort visant à empêcher la formation d’un nouveau bloc entre la Russie et la Chine et elle pourrait effectivement prendre des proportions imprévisibles si une Russie désespérée décidait d’emprunter la voie suicidaire de l’utilisation de son arsenal nucléaire. Mais ce serait l’expression la plus claire de l’avertissement contenu dans les Thèses selon lequel le développement de la décomposition peut compromettre l’avenir de l’humanité même sans une mobilisation générale de la société pour une guerre mondiale.
Sans doute le camarade Steinklopfer fera-t-il référence à un passage prémonitoire de son texte (écrit avant la guerre en Ukraine) où il dit que
« La qualité nouvelle de la phase de décomposition consiste, à ce niveau, dans le fait que toutes les contradictions déjà existantes d’un mode de production en déclin sont exacerbées au plus haut point. Il en va de même avec la tendance au chacun-contre-tous qui est, elle aussi, exacerbée par la décomposition. Mais la tendance à la guerre entre puissances dominantes, et ainsi vers la guerre mondiale, est également exacerbée, comme le sont toutes les tensions générées par les mouvements vers la formation de nouveaux blocs impérialistes et par les tendances visant à les contrecarrer. L’incapacité à comprendre ceci nous amène aujourd’hui à gravement sous-estimer le danger de guerre, en particulier les conflits qui vont sortir des tentatives des États-Unis d’utiliser leur actuelle supériorité militaire contre la Chine, afin de stopper le développement de cette dernière, tout comme nous sous-estimons sérieusement le danger de conflits militaires entre l’OTAN et la Russie (ce dernier conflit étant, au moins à court terme, potentiellement encore plus dangereux que le conflit sino-américain du fait qu’il comporte un risque encore plus grand de déboucher sur une guerre thermonucléaire) ».
Il est assurément vrai que le CCI a initialement sous-estimé l’imminence de l’invasion russe en Ukraine, tout comme nous avons tardé à identifier les manœuvres machiavéliques des États-Unis destinées à attirer la Russie dans ce piège. Mais selon nous, il ne s’agissait pas d’une réfutation de notre cadre théorique sous-jacent, mais plutôt du résultat d’une incapacité à l’appliquer de manière cohérente. Après tout, nous avions déjà considéré la pandémie de Covid-19 comme la preuve d’une nouvelle et très sérieuse accélération de la décomposition capitaliste, et la guerre en Ukraine a pleinement confirmé ce jugement, en montrant que le processus de décomposition n’est pas simplement une descente lente et progressive vers l’abîme, mais sera ponctué de moments d’intensification et d’accélération sévères, comme ceux que nous vivons aujourd’hui.
Enfin, nous devons préciser que notre point de vue selon lequel la montée en puissance de la Chine n’a été possible qu’en conséquence de la décomposition, et à la dissolution des blocs en particulier, n’implique pas qu’il y ait eu un « arrêt du développement des forces productives » empêchant la Chine de devenir un rival sérieux des États-Unis. Au contraire, le développement de la Chine est un exemple éclatant de ce que, à la suite de Marx, nous avons décrit comme « la croissance comme déclin »[8], un processus où l’accumulation même des forces productives entraîne de nouvelles menaces pour l’avenir de l’humanité : par la dévastation écologique, la « production » de pandémies et l’aiguisement des antagonismes militaires. Non seulement la croissance chinoise est le résultat de la décomposition, mais elle est devenue un puissant facteur de son accélération. Argumenter, comme le fait le camarade Steinklopfer, qu’elle a eu lieu « malgré la décomposition » fait sortir la compréhension de l’essor de la Chine de notre cadre général d’analyse.
Sur la lutte de classe
Lorsque nous en arrivons à l’évaluation de l’état actuel de la lutte de classe, nous devons à nouveau consacrer un certain temps dans notre réponse à insister sur le fait que la description de notre position par le camarade Steinklopfer n’est pas du tout exacte.
– Le camarade répète l’argument selon lequel nous ne considérons plus le manque de perspective du prolétariat comme un facteur de recul de la lutte de classe : « Il est déjà frappant dans la résolution du 23ᵉ Congrès que le problème de la faiblesse, bientôt de l’absence de perspective révolutionnaire prolétarienne, n’est pas considéré comme central pour expliquer les problèmes des luttes ouvrières au cours des années 80 ». Nous avons déjà répondu à cette question dans notre précédente réponse publiée à l’article de Steinklopfer sur le 23ᵉ Congrès : « le camarade Steinkopfler suggère que la résolution sur le rapport de forces entre les classes du 23ᵉ congrès ne s’intéresse plus au problème de la perspective révolutionnaire, et que ce facteur a disparu de notre compréhension des causes (et conséquences) de la décomposition. En fait, la question de la politisation de la lutte de classe et des efforts de la bourgeoisie pour empêcher son développement est au cœur de la résolution » [9]. Il ne pouvait guère en être autrement, car toute la base des Thèses sur la Décomposition est l’argument selon lequel si le monde capitaliste est dans un état d’agonie et de désintégration, c’est avant tout parce qu’aucune des deux grandes classes de la société n’est capable d’offrir une perspective pour l’humanité.
– Steinklopfer se trompe également lorsqu’il affirme que le CCI fonde aujourd’hui ses espoirs sur une simple augmentation de la combativité, une sorte de saut automatique vers la conscience révolutionnaire poussé par la crise, une vision conseilliste ou économiste qui néglige le rôle de la théorie révolutionnaire (et donc de l’organisation révolutionnaire). Mais nous n’avons jamais nié la nécessité de la politisation des luttes et le rôle clé des organisations politiques dans cette évolution, ni le poids négatif de la rupture organique et de la séparation des organisations politiques de la classe. Il est certes vrai qu’aucune organisation révolutionnaire n’est à l’abri de faire des concessions aux erreurs conseillistes, économistes ou immédiatistes, mais nous considérons que lorsque de telles erreurs se produisent, elles sont en désaccord avec notre cadre analytique fondamental, ce qui nous donne la capacité de les critiquer et de les surmonter [10].
D’autre part, nous avons considéré que le rejet apparent par Steinklopfer de l’importance centrale de la lutte défensive de la classe ouvrière contre l’impact de la crise économique – explicitement affirmée dans la section finale des Thèses sur la Décomposition comme un antidote vital à l’engloutissement dans le processus de putréfaction sociale – ouvrait la porte aux idées modernistes. Pas dans le sens explicite de ceux qui appellent les travailleurs à abandonner leurs luttes défensives ou qui exigent l’auto-négation immédiate du prolétariat dans le processus révolutionnaire. Le camarade, dans son récent texte, affirme clairement qu’il considère les luttes défensives comme indispensables à la récupération future de l’identité de classe et d’une perspective révolutionnaire. Le problème réside dans la tendance à séparer la dimension économique de la lutte de sa dimension politique et donc à ne pas reconnaître l’élément implicitement politique dans même la plus « petite » expression de la résistance de classe. Dans son texte précédent, il semblait y avoir une expression claire de cette séparation entre les dimensions politique/théorique dans le point de vue apparent selon lequel l’apport théorique de l’organisation révolutionnaire pourrait de lui-même compenser la dimension politique manquante dans la lutte défensive quotidienne, un point de vue que nous avons critiqué comme frisant le substitutionnisme [11]. Dans la nouvelle contribution, Steinklopfer a précisé que le développement de la dimension théorique ne peut pas être l’œuvre d’une minorité seule, mais doit finalement être le travail de millions de prolétaires. C’est bien, mais le camarade affirme ensuite que c’est la majorité du CCI qui l’a oublié. « Cependant, l’organisation a peut-être oublié que les masses prolétariennes sont capables de participer à ce travail de réflexion théorique ». Nous ne l’avons en fait pas oublié. L’une des raisons pour lesquelles nous avons accordé tant d’importance au mouvement des Indignés de 2011, par exemple, était qu’il était caractérisé par une culture du débat très animée dans les assemblées, où les questions sur les origines de la crise capitaliste et l’avenir de la société étaient soulevées et discutées comme étant tout aussi pertinentes pour le mouvement que les décisions sur les formes d’action immédiates[12].
Cependant, il y a une composante très importante dans la capacité de la classe ouvrière « dans sa masse » à se réapproprier la dimension théorique de son combat : le processus de « maturation souterraine », par lequel nous voulons dire que, même dans les périodes où la classe dans son ensemble est en retrait, un processus de politisation peut encore avoir lieu parmi une minorité de la classe, dont certains graviteront bien sûr vers les organisations politiques de la Gauche communiste. C’est cet aspect souvent « caché » de la politisation de la classe qui portera ses fruits dans des mouvements de classe plus étendus et plus massifs.
Dans le rapport sur la lutte de classe au 24ᵉ Congrès du CCI [13], nous avons souligné que le camarade Steinklopfer abandonne ou discrédite le concept de maturation souterraine en affirmant que nous assistons en fait à un processus de « régression souterraine » dans la classe ouvrière. Nous avons soutenu que cela ignore la réalité des éléments en recherche qui répondent à l’état désespéré de la société capitaliste, malgré les difficultés extrêmes évidentes de la classe à prendre conscience d’elle-même à un niveau plus général ; l’organisation révolutionnaire a la tâche d’aider ces éléments à pousser plus loin leurs réflexions et à comprendre toutes leurs implications aux niveaux théorique et organisationnel. D’autre part, le concept de régression souterraine ne peut qu’aboutir à une sous-estimation de l’importance de ce travail envers les minorités en recherche.
Dans le nouveau texte, la position du camarade vis-à-vis de la notion de régression souterraine reste très floue. D’une part, elle n’est ni défendue ni répudiée. D’autre part, juste avant d’accuser le CCI d’oublier que les masses prolétariennes sont capables de réfléchir, il semble se rapprocher de la notion d’une dynamique de maturation souterraine : « Le travail théorique est la tâche, non des révolutionnaires seuls, mais de la classe ouvrière comme un tout. Étant donné que le processus de développement du prolétariat est inégal, il est de la responsabilité particulière des couches les plus politisées du prolétariat de l’assumer ; des minorités, donc, oui, mais cela comprend potentiellement des millions d’ouvriers qui, loin de se substituer eux-mêmes à l’ensemble, pousseront pour impulser et stimuler plus avant les autres. Pour leur part, les révolutionnaires ont la tâche spécifique d’orienter et d’enrichir cette réflexion qui doit être accomplie par des millions. Cette responsabilité des révolutionnaires est au pire au moins aussi importante que celle d’intervenir dans des mouvements de grève, par exemple ». Ce qui reste flou dans l’évaluation du camarade, c’est de savoir si ce potentiel de maturation politique est quelque chose pour l’avenir ou s’il a déjà lieu, même à très petite échelle.
Sur la question des défaites
Ce sur quoi le camarade Steinklopfer continue d’insister dans le nouveau texte est l’importance des revers, des défaites politiques, que la classe ouvrière a subis depuis la résurgence initiale de la lutte de classe à la fin des années 60, qui a mis fin à la période précédente de contre-révolution. Selon lui, la majorité du CCI sous-estime la profondeur de ces défaites et cela – ainsi que notre amnésie sur la capacité des masses à la réflexion théorique – exprime une perte de confiance dans le prolétariat de notre part :
« Cette perte de confiance s’exprime elle-même dans le rejet de toute idée que le prolétariat a subi des défaites politiques importantes au cours des décennies qui ont suivi 1968. Faute de cette confiance, nous finissons par minimiser l’importance de ces très graves revers politiques, en nous consolant avec les luttes défensives quotidiennes, vues comme le principal creuset de la voie à suivre, ce qui est à mes yeux une concession significative à une approche « économiciste » de la lutte de classe déjà critiquée par Lénine et Rosa Luxemburg au début du XXᵉ siècle. La compréhension que le « prolétariat n’est pas vaincu », qui donnait une vision correcte et très importante dans les années 70 et 80, est devenue un article de foi, un dogme creux, qui empêche toute analyse sérieuse, scientifique du rapport de force ».
Énumérant ces défaites, le camarade, dans une proposition d’amendement à la résolution sur la situation internationale du 24ᵉ Congrès, fait référence à (a) l’incapacité de la première vague internationale à développer l’aspect politique de la lutte, un potentiel annoncé notamment par les événements de mai-juin 1968 en France (b) l’impact de l’effondrement du bloc de l’Est et les campagnes contre le communisme qui ont suivi et (c) l’échec de la classe à répondre à la crise économique de 2008, un échec qui a ouvert la voie à la montée du populisme.
Il est difficilement soutenable d’affirmer que le CCI ait rejeté « toute idée que le prolétariat a subi des défaites politiques importantes au cours des décennies qui ont suivi 1968 ». Le camarade Steinklopfer reconnaît lui-même que le concept même de décomposition est basé sur notre reconnaissance que le prolétariat n’a pas été capable de réaliser le potentiel politique révolutionnaire contenu dans les luttes ouvrières des années 70 et 80 ; de plus, la compréhension que l’effondrement du bloc de l’Est a initié un profond recul de la combativité et de la conscience de classe a été au centre de nos analyses au cours des trente dernières années ; et nous pouvons assurément citer un certain nombre d’importants mouvements de classe qui ont été largement défaits par la classe dominante, de la grève de masse en Pologne en 1980 aux mineurs britanniques en 1985, en passant par les Indignés en 2011, etc. (comme Rosa Luxemburg l’a si bien dit, la lutte de classe prolétarienne est la seule forme de guerre dans laquelle la victoire finale ne peut être préparée que par une série de défaites).
Ce que le CCI rejette, ce n’est pas la réalité ou l’importance de défaites, d’échecs ou de revers particuliers, mais l’idée que ceux qui se sont produits depuis les années 1980 constituent une défaite historique comparable à celle des années 20 et 30, dans laquelle la classe ouvrière des principaux centres du capitalisme a été réduite à l’état où elle est prête à accepter d’être emmenée à la guerre pour « résoudre » les problèmes du système. Nous ne pensons pas qu’il s’agisse d’un dogme vide, mais qu’il continue à avoir une valeur opérationnelle, surtout en ce qui concerne la guerre actuelle en Ukraine, où la bourgeoisie des États-Unis et de l’Europe occidentale s’est donné beaucoup de mal pour éviter d’utiliser des troupes sur le terrain, sans parler de toute mobilisation directe des masses prolétariennes dans le conflit entre l’OTAN et la Russie.
Il est certain que, dans la période de décomposition, nous ne pouvons pas envisager une telle défaite historique de la même manière que dans la période 1968-89, où elle aurait été fondée sur la victoire de la bourgeoisie dans une confrontation décisive et directe entre les classes. Dans la période de décomposition, il y a un danger très réel que le prolétariat soit progressivement miné par la désintégration de la société sans même être un défi majeur à la bourgeoisie. Et les révolutionnaires doivent constamment évaluer si ce « point de non-retour » a été atteint. Selon nous, les signes continus de résistance de classe contre les attaques sur le niveau de vie (par exemple en 2019 et encore aujourd’hui, notamment en Grande-Bretagne au moment où nous écrivons ces lignes) est un signe que nous n’en sommes pas encore là ; un autre est l’émergence de minorités de recherche dans le monde entier.
En revanche, le camarade Steinklopfer semble régresser vers l’approche qui était valable dans la période précédente, lorsque le concept du cours historique était pleinement applicable, mais qui ne tient plus la route dans la phase de décomposition. Sans préciser ce qui a changé et ce qui reste inchangé dans la nouvelle phase, le camarade semble dériver vers l’idée que la classe ouvrière a subi une défaite à un niveau historique si important que le cours vers la guerre mondiale a été rouvert. Il ne dit pas quelles conséquences cela peut avoir, notamment pour l’activité de l’organisation révolutionnaire, et il avance de nombreuses mises en garde et réserves : « Non seulement parce que le prolétariat ne veut pas aller vers une telle guerre, mais parce que la bourgeoisie elle-même n’a pas l’intention de faire marcher qui que ce soit vers une nouvelle guerre mondiale ».
Les ambiguïtés de ce genre, comme nous l’avons noté, prolifèrent tout au long du texte et c’est pourquoi nous ne pensons pas que l’analyse actuelle du camarade offre une voie à suivre pour l’organisation.
Amos (août 2022)
[1] « Thèses sur la décomposition [10] », Revue internationale n° 107
[2] Le groupe Internationalist Voice [665] fait ici clairement exception. « Contrairement aux spéculations selon lesquelles cette guerre est le début de la troisième guerre mondiale, nous pensons que la troisième guerre mondiale n’est pas à l’ordre du jour de la bourgeoisie mondiale. Pour qu’une guerre mondiale ait lieu, les deux conditions suivantes doivent être remplies :
– l’existence de deux blocs impérialistes politiques, économiques et militaires ;
– une classe ouvrière vaincue au niveau mondial.
Au cours des dernières décennies, les conditions préalables essentielles à une guerre mondiale n’ont pas été réunies. D’une part, chacun des principaux acteurs – gangsters – pense à ses propres intérêts impérialistes. D’autre part, bien que la classe ouvrière ne soit pas prête à fournir le soutien nécessaire à l’alternative (c’est-à-dire une révolution communiste contre la barbarie du système capitaliste) et qu’elle ait reculé au cours de la dernière décennie, elle n’a pas été vaincue. Par conséquent, les guerres impérialistes qui peuvent s’enflammer ont tendance à se situer à un niveau régional et à être des guerres par procuration. Bien qu’il existe une sorte d’alliance entre la Russie et la Chine, et que certaines actions militaires russes bénéficient du soutien tacite de la Chine, nous ne devons pas oublier que chacune de ces puissances poursuit ses propres intérêts impérialistes, qui entreront inévitablement en conflit les uns avec les autres de temps à autre ».
[3] « Rapport sur la question du cours historique [666] », Revue internationale n° 164.
[4] « Texte d’orientation : militarisme et décomposition [396] », Revue internationale n° 64.
[5] « Rapport sur la décomposition aujourd’hui (Mai 2017) [667] », 22ᵉ Congrès du CCI, Revue internationale n° 164 ; « Militarisme et décomposition (mai 2022) [668] », Revue internationale n° 168.
[6] « Explication des amendements rejetés du camarade Steinklopfer [663] », « Divergences avec la Résolution sur la situation internationale du 24ᵉ Congrès du CCI (explication d’une position minoritaire, par Ferdinand) [664] ».
[7] « Signification et impact de la guerre en Ukraine [434] ».
[8] « Growth as decay [325] ».
[9] « Divergences avec la résolution sur la situation internationale du 23ᵉ congrès [498] ».
[10] Voir par exemple la Revue internationale n° 167, « Rapport sur la lutte de classe internationale au 24ᵉ Congrès du CCI [415] ». Ce rapport appuie une critique faite au rapport sur les luttes ouvrières en France en 2019 adopté par le 24ᵉ Congrès de notre section en France, qui contenait une surestimation du niveau de politisation de ces mouvements, et « ouvrait donc la porte à une vision conseilliste ».
[11] « Divergences avec la résolution sur la situation internationale du 23e congrès [498] ».
[12] Voir « Bilan critique du mouvement des Indignés de 2011 [669] ».
[13] « Rapport sur la lutte de classe internationale au 24ème Congrès du CCI [415] ».
Vie du CCI:
- Débat [670]
Rubrique:
Divergences avec la Résolution sur la situation internationale du 24e Congrès du CCI
- 134 lectures
Dans la continuité des documents de discussion publiés après le 23e Congrès du CCI(1), nous publions de nouvelles contributions exprimant des divergences avec la Résolution sur la situation internationale du 24e Congrès du CCI(2). Comme dans la contribution précédente du camarade Steinklopfer, les désaccords portent sur la compréhension de notre concept de décomposition, sur les tensions inter-impérialistes et la menace de guerre, et sur le rapport de forces entre le prolétariat et la bourgeoisie. Afin d’éviter tout retard supplémentaire lié à la pression de l’actualité, nous publions les nouvelles contributions des camarades Ferdinand et Steinklopfer sans réponse défendant la position majoritaire au sein du CCI, mais nous ne manquerons pas de répondre à ce texte en temps voulu. Nous tenons à préciser que ces contributions ont été écrites avant la guerre en Ukraine.
Le CCI défend le principe scientifique de la clarification par le débat, par le moyen de la confrontation d’arguments fondés sur des faits, dans le but de parvenir à une compréhension plus profonde des questions auxquelles la classe est confrontée. La période actuelle est difficile pour les révolutionnaires. C’était déjà le cas avant la pandémie de Covid, mais au cours des deux dernières années, il a fallu examiner de nouveaux événements et évolutions. Aussi, il n’est pas surprenant qu’au sein d’une organisation révolutionnaire vivante, des polémiques sur l’analyse de la situation mondiale surgissent.
Les principales divergences au sein de l’organisation concernent les questions suivantes, d’une importance cruciale pour les perspectives du prolétariat :
a) Comment évaluer l’actuel rapport de forces entre les classes, après l’abandon du concept de cours historique ? La classe va-t-elle de défaite en défaite, ou avance-t-elle ?
b) Comment mesurer la maturation souterraine de la conscience de classe, le travail de la « vieille taupe » ? Y a-t-il une maturation significative, ou au contraire un recul ?
c) Concernant la situation économique : la crise pandémique produit-elle seulement des perdants, ou y a-t-il dans la situation des gagnants qui peuvent améliorer leur position ?
d) Concernant les tensions impérialistes : y a-t-il des polarisations significatives dans la constellation mondiale qui augmentent le danger d’une guerre généralisée ? Ou bien la tendance du chacun contre tous est-elle dominante, et donc un obstacle à une nouvelle constellation de blocs ?
Déjà après le 23e Congrès du CCI, qui s’est tenu en 2019, l’article de la Revue internationale rendant compte de ses travaux signalait des controverses dans nos rangs sur l’évaluation de la situation mondiale, notamment au niveau de la lutte des classes, ou plus précisément du rapport de forces entre bourgeoisie et prolétariat. La présentation de la Revue internationale n° 164 disait : « Lors du congrès, des divergences sont apparues sur l’appréciation de la situation de la lutte de classe et sa dynamique. Le prolétariat a-t-il subi des défaites idéologiques qui affaiblissent sérieusement ses capacités ? Y a-t-il une maturation souterraine de la conscience ou, au contraire, assistons-nous à un approfondissement du reflux de l’identité de classe et de la conscience ? »
Dans le même temps, en 2019, nous avons abandonné le concept de « cours historique », car nous avons reconnu que la dynamique de la lutte des classes dans la période actuelle de décomposition ne pouvait plus être analysée de manière adéquate dans ce cadre.
Dans les discussions entre 2019 et 2021, et finalement dans la préparation de la Résolution sur la situation internationale du 24e congrès, nous avons été confrontés à la poursuite des divergences dans l’évaluation de la situation mondiale actuelle.
Dans une large mesure, la controverse a été rendue publique en août 2020 dans le cadre d’un « débat interne ». L’article du camarade Steinklopfer, défendant des positions minoritaires, et la réponse du CCI, ont montré que le champ du débat englobait non seulement la question de la dynamique de la lutte de classe et de la conscience de classe, mais dans un sens plus large l’appréciation de la période de décomposition capitaliste, notamment l’application concrète du concept de décomposition – une notion qui, jusqu’à présent, est une caractéristique distinctive du CCI au sein du milieu politique prolétarien.
Puisque j’avais des désaccords similaires à ceux du camarade Steinklopfer avec la position majoritaire dans la période récente, j’ai été invité à les présenter non seulement par le biais de contributions internes mais aussi dans un article pour publication expliquant mes divergences avec la Résolution sur la situation internationale du 24e Congrès.
La plupart des amendements que j’ai proposés à la Résolution du Congrès tournaient autour de la question économique, à savoir la dynamique, le poids et les perspectives du capitalisme d’État chinois. Simultanément, j’ai soutenu de nombreux amendements du camarade Steinklopfer qui défendaient des orientations identiques ou compatibles.
Mes divergences peuvent être résumées sous les rubriques suivantes (les numéros se réfèrent à la version de la Résolution sur notre site web en langue française) :
– la Chine, sa puissance économique et le capitalisme d’État (points 9 et 16 de la Résolution) ;
– l’évolution de la crise économique mondiale et du capitalisme d’État en décomposition (points 14, 15 et 19) ;
– la polarisation impérialiste et la menace de guerre (points 12 et 13) ;
– le rapport de forces entre les classes et la question de la maturation souterraine de la conscience (point 28).
1. L’évolution de la Chine, sa puissance économique et le capitalisme d’État
La Résolution, après avoir montré la décomposition politique et idéologique aux États-Unis et en Europe, dit : « Et tandis que la propagande d’État chinoise met en évidence la désunion et l’incohérence croissantes des « démocraties », se présentant comme un rempart de la stabilité mondiale, le recours croissant de Pékin à la répression interne, comme contre le « mouvement démocratique » à Hong Kong et les musulmans ouïgours, est en fait la preuve que la Chine est une bombe à retardement. La croissance extraordinaire de la Chine est elle-même un produit de la décomposition. » (point 9)
Elle déclare ensuite : « L’ouverture économique au cours de la période de Deng dans les années 80 a mobilisé d’énormes investissements, notamment en provenance des États-Unis, de l’Europe et du Japon. Le massacre de Tiananmen en 1989 a montré clairement que cette ouverture économique a été mise en œuvre par un appareil politique inflexible qui n’a pu éviter le sort du stalinisme dans le bloc russe que par une combinaison de terreur d’État, une exploitation impitoyable de la force de travail qui soumet des centaines de millions de travailleurs à un état permanent de travailleur migrant et de croissance économique frénétique dont les fondations semblent maintenant de plus en plus fragiles. Le contrôle totalitaire sur l’ensemble du corps social, le durcissement répressif auxquels se livre la fraction stalinienne de Xi Jinping ne représentent pas une expression de force mais au contraire une manifestation de faiblesse de l’État, dont la cohésion est mise en péril par l’existence de forces centrifuges au sein de la société et d’importantes luttes de cliques au sein de la classe dominante. » (ibid.)
Au point 16, la Résolution affirme tout d’abord que la Chine est confrontée à la réduction des marchés à travers le monde, à la volonté de nombreux États de se libérer de leur dépendance à l’égard de la production chinoise et au risque d’insolvabilité auquel est confronté un certain nombre de pays impliqués dans le projet de la Route de la Soie, et que la Chine poursuit donc une évolution vers la stimulation de la demande intérieure et l’autarcie au niveau des technologies-clés, afin de pouvoir gagner du terrain au-delà de ses propres frontières et développer son économie de guerre. Ces évolutions, dit la Résolution, provoquent « de puissants conflits au sein de la classe dirigeante, entre les partisans de la direction de l’économie par le Parti communiste chinois et ceux liés à l’économie de marché et au secteur privé, entre les « planificateurs » du pouvoir central et les autorités locales qui veulent orienter elles-mêmes les investissements. » (point 16)
Les affirmations selon lesquelles la Chine est une bombe à retardement, que son État est faible et que sa croissance économique semble chancelante sont l’expression d’une sous-estimation du véritable développement économique et impérialiste de la Chine au cours des quarante dernières années. Vérifions d’abord les faits puis les fondements théoriques sur lesquels repose cette analyse erronée.
Il se peut que les tensions internes en Chine soient en réalité plus fortes qu’il n’y paraît – d’un côté les contradictions au sein de la société en général, de l’autre celles au sein du parti au pouvoir en particulier. Nous ne pouvons pas faire confiance à la propagande chinoise sur la force de son système. Mais ce que les médias occidentaux ou autres non chinois nous disent sur les contradictions en Chine est aussi de la propagande – et en plus c’est souvent un vœu pieux. Les éléments mentionnés dans la Résolution ne sont pas convaincants : un contrôle totalitaire sur l’ensemble du corps social et l’oppression de la « liberté d’expression démocratique » peuvent être des signes d’une faiblesse de la classe dirigeante. Je suis d’accord avec cela. Comme nous le savons depuis la période post-1968 avec un mouvement prolétarien en développement, la démocratie est beaucoup plus efficace pour contrôler la classe ouvrière, et les contradictions sociales en général, que ne le sont les régimes autoritaires. Par exemple, dans les années 1970, la bourgeoisie en Espagne, au Portugal et en Grèce a remplacé les régimes autoritaires par des régimes démocratiques en raison de la nécessité de gérer l’agitation sociale. Mais la classe ouvrière en Chine est-elle dans une dynamique similaire à celle du prolétariat en Europe du Sud dans les années 1970 ? Je pose cette question dans l’optique du rapport de forces entre les classes, que nous ne pouvons finalement mesurer correctement qu’à l’échelle mondiale.
La Résolution traite de la question du rapport de forces entre les classes dans sa dernière partie, et je reviendrai sur ce point. Mais nous pouvons anticiper une chose : il n’y a aucun élément en faveur de la thèse selon laquelle le prolétariat menace le régime de Xi Jinping.
Il en va de même pour d’autres contradictions au sein de la Chine continentale et de son appareil politique. Bien que les divergences d’intérêts entre le Parti au pouvoir et les très riches magnats de la technologie chinoise, comme Jack Ma (Alibaba) et Wang Xing (Meituan), soient évidentes, ces derniers ne semblent pas proposer de modèle alternatif à la République populaire, et encore moins constituer une opposition organisée. Par ailleurs, au sein du Parti, les luttes idéologiques importantes semblent appartenir au passé. Avant 2012 et la présidence de Xi Jinping, le dénommé « débat sur le gâteau » avait lieu dans les hautes sphères du parti : il y avait deux factions. L’une disait que la Chine devait s’attacher à faire grossir le gâteau – l’économie chinoise. L’autre voulait partager plus équitablement le gâteau existant. Un partisan de la seconde position était Bo Xilai, condamné à la prison à vie pour corruption et abus de pouvoir, un an après l’accession de Xi Jinping à la tête du parti et de l’État. Entre-temps, la position du « partage équitable » est devenue la doctrine officielle(3). Et il n’y a aucun signe d’un nouveau débat.
Selon les informations disponibles(4), les purges dans l’appareil de répression ont commencé au début de 2021. Dans la police, la police secrète, le système judiciaire et pénitentiaire, officiellement plus de 170 000 personnes ont été sanctionnées pour cause de corruption. Il s’agit d’un cynique étalage de pouvoir. Il en va de même pour le système de surveillance orwellien. Tout aussi fou est le culte de la personnalité autour de Xi Jinping. Mais est-ce la preuve de la « faiblesse de l’État » ? D’une « bombe à retardement » sous le fauteuil du président ?
En ce qui concerne les contradictions internes de la République populaire, ma thèse est l’opposée. Les cercles dirigeants de ce pays utilisent la crise pandémique pour restructurer son économie, son armée, son empire. Même si la croissance économique en Chine a ralenti ces derniers temps, derrière cela se cache, dans une certaine mesure, un plan calculé de l’élite politique dirigeante pour maîtriser les excès du capital privé et renforcer le capitalisme d’État pour le défi impérialiste. Le Parti coupe les ailes de certaines des entreprises les plus rentables et des magnats les plus riches ; c’est laisser s’échapper l’air de certaines bulles spéculatives afin de contrôler plus strictement l’ensemble de l’activité économique, avec le message propagandiste que tout cela vise à protéger les ouvriers, les enfants, l’environnement et la libre concurrence.
Les purges dans l’appareil de répression et l’étalage du pouvoir autoritaire sont des indices de tensions cachées (pas seulement au Xinjiang et à Hong Kong). Mais aucun modèle alternatif pour le cours du capitalisme d’État chinois n’est visible.
Telle est ma lecture de l’aspect factuel.
Si nous voulons comprendre le sens des divergences actuelles dans l’analyse de la Chine, nous devons examiner la théorie qui sous-tend la position majoritaire et donc la présente Résolution.
Le développement de la Chine a été minimisé dans nos rangs pendant des décennies. Cela est lié à une compréhension erronée et schématique de la décadence capitaliste. L’un de nos textes de référence du début de l’existence du CCI, « La lutte du prolétariat dans la décadence du capitalisme », le formulait ainsi : « La période de décadence du capitalisme se caractérise par l’impossibilité de tout surgissement de nouvelles nations industrialisées. Les pays qui n’ont pas réussi leur « décollage » industriel avant la 1ʳᵉ guerre mondiale sont, par la suite, condamnés à stagner dans le sous-développement total, ou à conserver une arriération chronique par rapport aux pays qui « tiennent le haut du pavé ». Il en est ainsi de grandes nations comme l’Inde ou la Chine dont « l’indépendance nationale » ou même la prétendue « révolution » (lire l’instauration d’un capitalisme d’État draconien) ne permettent pas la sortie du sous-développement et du dénuement. » (« La lutte du prolétariat dans la décadence du capitalisme », 1980, Revue internationale n° 23).
Ce n’est qu’en 2015, dans le cadre du bilan critique de quarante ans d’analyses du CCI, que nous avons reconnu officiellement l’erreur de ce schéma :
• « Cette vision « catastrophiste » est due, en bonne partie, à un manque d’approfondissement de notre analyse du capitalisme d’État […] C’est cette erreur consistant à nier toute possibilité d’expansion du capitalisme dans sa période de décadence qui explique les difficultés qu’a eues le CCI à comprendre la croissance et le développement industriel vertigineux de la Chine (et d’autres pays périphériques) après l’effondrement du bloc de l’Est. » (« 40 ans après la fondation du CCI, quel bilan et quelles perspectives pour notre activité ? », 2015, Revue internationale n° 156).
Mais cette reconnaissance était mitigée. Bientôt les anciens schémas se sont glissés à nouveau dans nos analyses. Les implications de la contradiction entre nos vues « classiques » et la réalité étaient trop radicales. Pour combler cette contradiction, il aurait fallu aller aux racines des lois économiques du mouvement qui sont également à l’œuvre dans le capitalisme décadent. Au lieu de cela, le problème a été réglé avec la formulation « La croissance extraordinaire de la Chine est elle-même un produit de la décomposition. » (point 9 de la présente Résolution, déjà citée ci-dessus) – brillante dans son imprécision. L’idée a été introduite en 2019, avec la Résolution du 23e Congrès international qui disait : « Il a fallu la survenue des circonstances inédites de la période historique de la décomposition pour permettre l’ascension de la Chine, sans laquelle celle-ci n’aurait pas eu lieu. » (Revue internationale n° 164).
Mais alors que cette dernière formulation est correcte dans le sens où l’ouverture du monde à l’investissement du capital (la mondialisation) a eu lieu principalement dans la période de décomposition à la veille et après l’effondrement du système des blocs, et que cela a fait partie des conditions permettant la montée de la Chine comme atelier du monde, la phrase sur sa croissance comme « produit de la décomposition » est un pas en arrière vers la « vision catastrophiste ». Tout est un produit de la décomposition – et toute croissance est donc nulle et fausse. En outre : tout se décompose de manière homogène, une sorte de désintégration en douceur non seulement des relations humaines, de la morale, de la culture et de la société, mais du capitalisme lui-même.
La Résolution actuelle n’est pas en mesure de saisir la réalité de l’essor de la Chine au cours des quatre dernières décennies et de l’expliquer. Comme déjà cité plus haut, elle déclare simplement que « cette ouverture économique a été mise en œuvre par un appareil politique inflexible qui n’a pu éviter le sort du stalinisme dans le bloc russe que par une combinaison de terreur d’État, une exploitation impitoyable de la force de travail qui soumet des centaines de millions de travailleurs à un état permanent de travailleur migrant et de croissance économique frénétique dont les fondations semblent maintenant de plus en plus fragiles. » (point 9)
Une partie de ce raisonnement est tautologique : « l’ouverture économique a été mise en œuvre par […] une croissance économique frénétique » – le succès économique était dû au succès économique.
Pour le reste, la Résolution explique le succès de la Chine par rapport au sort du bloc russe avant 1989 en disant que cette performance était le résultat d’une « combinaison de terreur d’État » et d’une « exploitation impitoyable de la force de travail qui soumet des centaines de millions de travailleurs à un état permanent de travailleur migrant ». Qu’est-ce que cela explique ? La Résolution suggère-t-elle qu’une « combinaison de terreur d’État » et d’« exploitation impitoyable » sont les ingrédients d’un capitalisme réussi ? Et sont-ils distincts du stalinisme en Russie ?
J’ai proposé de supprimer la phrase et soutenu à la place une formulation que le camarade Steinklopfer a suggérée avec l’un de ses amendements : « […] Ce n’est pas un hasard si la Chine, contrairement à l’URSS et à son ancien bloc impérialiste, ne s’est pas effondrée vers la fin du XXe siècle. Son décollage a reposé sur deux avantages spécifiques : sur l’existence d’une gigantesque zone extra-capitaliste interne basée sur la paysannerie transformable en prolétariat industriel, et sur une tradition culturelle particulièrement ancienne et très développée (avant que l’industrialisation moderne ne commence en Europe, la Chine a toujours été l’un des principaux centres de l’économie mondiale, de la connaissance et de la technologie). »
On peut certainement se demander si le terme de « zones extra-capitalistes » est encore adapté pour décrire ce qui est pourtant un fait significatif, à savoir la nouvelle intégration d’une force de travail disponible dans le rapport et l’échange formels entre le capital et le travail salarié. L’idée est claire : le processus d’accumulation du capital en Chine était réel, et pas seulement factice. Il a eu lieu grâce à des ressources qui n’étaient pas encore formellement déterminées comme la vente de la force de travail et l’appropriation par les capitalistes de sa valeur d’usage. Comme pour toute accumulation sous le capitalisme, ce processus dans la Chine post-Mao nécessitait une force de travail nouvellement disponible (et des matières premières, c’est-à-dire dans une large mesure la nature, donc aussi une « zone extra-capitaliste » dans un certain sens). Les anciens paysans des campagnes se sont déplacés vers les villes et ont offert la force de travail nécessaire à l’exploitation capitaliste.
Pour éviter le sort du stalinisme dans le bloc russe, il était également nécessaire que la Chine réadmette la sanction du marché capitaliste (la « main invisible » d’Adam Smith), en particulier à deux niveaux : le licenciement des ouvriers et la mise en faillite des entreprises non rentables. Seules ces mesures mises en œuvre par les cercles dirigeants autour de Deng Xiaoping et après ont permis au secteur du capital privé de fonctionner et à l’économie chinoise de rivaliser avec le reste du monde. Tout cela est négligé par la Résolution existante. Et les amendements qui devraient corriger les lacunes ont été rejetés en expliquant qu’ils remettraient en cause ou relativiseraient « l’impact de la décomposition sur l’État chinois ».
En effet, la réticence de la Résolution à reconnaître la réalité de la force de la Chine est ancrée dans la compréhension de la décadence capitaliste – et donc de la décomposition. Nous n’avons jamais conclu le débat sur les différentes analyses du boom économique de l’après-1945. La position majoritaire au sein du CCI semble être celle définie comme « marchés extra-capitalistes et endettement » (cf. Revue internationale n° 133-141)(5). Cette position théorique estime que les nouveaux marchés nécessaires à la vente d’une production accrue ne peuvent être qu’extra-capitalistes ou créés en quelque sorte artificiellement par la dette. Ceci est cohérent avec une compréhension littérale d’un argument central de L’Accumulation du capital de Rosa Luxemburg(6) – mais en désaccord avec la réalité. Ce n’est pas le bon endroit ici pour une analyse plus approfondie de ce talon d’Achille de l’analyse économique du CCI.
Il suffit, pour comprendre les divergences, de voir que la position officielle du CCI nie le fait que l’accumulation capitaliste signifie aussi la création de nouveaux marchés solvables dans le milieu capitaliste, sur la base d’échanges entre le travail salarié et le capital (bien qu’insuffisants par rapport aux besoins de l’accumulation sans entraves – ce dernier point n’est pas controversé). Parce que l’apparition de nouveaux marchés solvables dans la période de décadence est évidente, la position actuelle du CCI doit expliquer leur création d’une manière ou d’une autre. Et comme les marchés extra-capitalistes significatifs (dans le sens d’acheteurs solvables des marchandises produites) ne peuvent plus être détectés, l’accumulation continue est « expliquée » par la création de dettes, ou par des astuces qui « trichent avec la loi de la valeur ». Je reviendrai sur cette question dans le contexte des points suivants de la Résolution.
2. L’évolution de la crise capitaliste et du capitalisme d’État en décomposition
Sous le titre « Une crise économique sans précédent », la Résolution tente de proposer une analyse des conséquences de la pandémie de Covid-19 sur l’économie mondiale. Si je suis d’accord pour dire que la situation est sans précédent et donc que les conséquences ne sont pas faciles à prévoir, la compréhension de l’accumulation et de la crise capitalistes dans le cadre de la Résolution n’est pas suffisante pour analyser la réalité actuelle et ses forces motrices. De l’avis de la majorité du CCI qui a adopté la Résolution dans sa forme actuelle et rejeté les amendements proposés par Steinklopfer et moi-même, tout est subordonné à la « décomposition », une sorte de fragmentation homogène. Cette compréhension de la période de décomposition est schématique et – dans la mesure où elle nie la persistance de lois capitalistes élémentaires – par exemple la concentration et la centralisation du capital – un abandon du marxisme. Ce point de vue rejette explicitement l’idée que le séisme économique qui se produit en conséquence de la pandémie produit non seulement des perdants mais aussi des gagnants. Il réfute implicitement la persistance de la centralisation et de la concentration du capital, du transfert des profits des sphères moins technologiques vers celles à plus forte composition organique, et nie ainsi une polarisation supplémentaire entre les gagnants et les perdants. La pandémie a accéléré les tendances centrifuges typiques de la période de décomposition, mais pas de manière homogène. Des polarisations différentes ont lieu. Les riches deviennent plus riches, les entreprises rentables plus attractives, les États qui ont bien géré le Covid-19 étendent leurs marchés aux dépens des incompétents et renforcent leur appareil. Ces polarisations et ces disparités accrues dans l’économie mondiale font partie d’une réalité négligée par la Résolution actuelle, qui ne voit que fragmentation, perdants et incertitude. Au point 14, il est dit : « Cette irruption des effets de la décomposition dans la sphère économique affecte directement l’évolution de la nouvelle phase de crise ouverte, inaugurant une situation totalement inédite dans l’histoire du capitalisme. Les effets de la décomposition, en altérant profondément les mécanismes du capitalisme d’État mis en place jusqu’à présent pour « accompagner » et limiter l’impact de la crise, introduisent dans la situation un facteur d’instabilité et de fragilité, d’incertitude croissante. »
La Résolution sous-estime le fait que les économies fortes sont bien mieux loties que les faibles : « L’une des manifestations les plus importantes de la gravité de la crise actuelle, contrairement aux situations passées de crise économique ouverte et à la crise de 2008, réside dans le fait que les pays centraux (Allemagne, Chine et États-Unis) ont été frappés simultanément et sont parmi les plus touchés par la récession, la Chine par une forte baisse du taux de croissance en 2020. » (point 15)
Et elle nie que la Chine sorte gagnante de la situation : « Seule nation à avoir un taux de croissance positif en 2020 (2 %), la Chine n’est pas sortie triomphante ou renforcée de la crise pandémique, même si elle a momentanément gagné du terrain au détriment de ses rivaux. Bien au contraire. » (point 16)
La force motrice d’un capitaliste est la recherche du profit le plus élevé. En période de récession, lorsque tous ou la plupart des capitalistes subissent des pertes, le profit le plus élevé se transforme en perte la plus faible. Les entreprises et les États qui ont moins de pertes que leurs rivaux obtiennent de meilleurs résultats. Dans cette logique, la Chine est jusqu’à présent l’un des gagnants de la crise pandémique. D’ailleurs, les États-Unis sont aussi économiquement mieux lotis que la plupart des pays hautement industrialisés et émergents, en contradiction avec la phrase citée au point 15 de la Résolution.
Les tendances à la polarisation que je mets en avant ne sont pas en contradiction avec le cadre de la décomposition. Au contraire, les disparités croissantes augmentent l’instabilité mondiale. Mais cette instabilité est inégale. La pandémie conduit à une concentration accrue du capital compétitif, au remplacement du travail vivant par des machines et des robots, à une composition organique accrue. Le capital à la composition organique la plus élevée attire une partie des profits produits par les capitaux moins compétitifs. Tout cela se passe sur une base en réduction relative de travail vivant, car une partie de plus en plus importante de celui-ci devient superflue.
D’une part, cela aboutit à un fossé croissant et stupéfiant entre les parties rentables de l’économie mondiale et celles qui ne le sont pas. D’autre part, cela signifie une course sans merci entre les acteurs les plus avancés pour les profits restants.
Ces deux tendances ne renforcent pas la stabilité, mais leur réalité est contestée par la position « décomposition partout ». Cette dernière est une recherche permanente des phénomènes de dislocation et de désintégration, perdant de vue les tendances plus profondes et concrètes typiques des mutations actuelles.
Enfin, la Résolution parle respectivement de « tricheries avec la loi de la valeur » et avec les « lois du capitalisme », sans expliquer ce que sont ces lois et ce que signifieraient ces tricheries :
• « Non seulement le poids de la dette condamne le système capitaliste à des convulsions toujours plus dévastatrices (faillites d’entreprises et même d’États, crises financières et monétaires, etc.) mais aussi, en restreignant de plus en plus la capacité des États à tricher avec les lois du capitalisme, il ne peut qu’entraver leur capacité à relancer leur économie nationale respective. » (point 19)
• « La bourgeoisie continuera à se battre jusqu’à la mort pour la survie de son système, que ce soit par des moyens directement économiques (comme l’exploitation de ressources inexploitées et de nouveaux marchés potentiels, illustrés par le projet chinois de la Nouvelle route de la soie) ou politiques, surtout par la manipulation du crédit et les tricheries avec la loi de la valeur. Cela signifie qu’il peut toujours y avoir des phases de stabilisation entre des convulsions économiques ayant des conséquences de plus en plus profondes. » (point 20)
Ces formulations n’expliquent rien. Elles sont un déguisement improvisé pour l’absence d’un concept clair. Et sans ce dernier, tout ne devient qu’« instabilité et fragilité » et « incertitude croissante ».
3. Polarisation impérialiste et menace de guerre
Une conséquence de la négligence de la polarisation économique par le dernier Congrès international est la sous-estimation des tensions impérialistes et de la menace de guerre.
Après avoir admis que la confrontation croissante entre les États-Unis et la Chine tend à occuper le devant de la scène, et donné des exemples de nouvelles alliances, la Résolution minimise le danger d’une future constellation de blocs avec les mots suivants : « Toutefois, cela ne signifie pas que nous nous dirigeons vers la formation de blocs stables et une guerre mondiale généralisée. La marche vers la guerre mondiale est encore obstruée par la puissante tendance au chacun pour soi et au chaos au niveau impérialiste, tandis que dans les pays capitalistes centraux, le capitalisme ne dispose pas encore des éléments politiques et idéologiques – dont en particulier une défaite politique du prolétariat – qui pourraient unifier la société et aplanir le chemin vers la guerre mondiale. Le fait que nous vivions encore dans un monde essentiellement multipolaire est mis en évidence en particulier par les relations entre la Russie et la Chine. Si la Russie s’est montrée très disposée à s’allier à la Chine sur des questions spécifiques, généralement en opposition aux États-Unis, elle n’en est pas moins consciente du danger de se subordonner à son voisin oriental, et est l’un des principaux opposants à la « Nouvelle route de la soie » de la Chine vers l’hégémonie impérialiste. » (point 12)
Ces phrases sont cohérentes avec l’« incertitude » concernant la question économique et évitent une prise de position claire sur les tendances impérialistes actuelles. La Résolution s’avère tiède lorsqu’elle admet la confrontation évidente entre les États-Unis et la Chine et insiste sur le fait que « toutefois » cela ne signifie pas la « formation de blocs stables ». La position majoritaire n’a pas encore tiré les conséquences de notre reconnaissance, lors du 23e Congrès international, que le concept de cours historique n’est plus utile pour l’analyse du présent. Elle tente toujours de comprendre la situation actuelle dans le cadre du vieux schéma de la Guerre froide, enfoui sous les décombres du mur de Berlin. Que les alliances en formation deviennent vraiment ou non des « blocs stables » n’est pas la question centrale si nous voulons analyser le danger d’une guerre généralisée ou nucléaire, deux menaces très sérieuses pour une perspective communiste.
La Résolution répond à des questions qui ne se posent plus et passe à côté des vraies questions. Je reviendrai sur ce point dans la partie suivante de la critique, consacrée au rapport de forces entre les classes.
Un autre signe révélateur de la persistance de l’ancienne vision est la formulation suivante dans la Résolution : « Bien que nous n’assistions pas à une marche contrôlée vers la guerre menée par des blocs militaires disciplinés, nous ne pouvons pas exclure le danger de flambées militaires unilatérales ou même d’accidents épouvantables qui marqueraient une nouvelle accélération du glissement vers la barbarie. ». (point 13)
La logique capitaliste de la polarisation entre la Chine et les États-Unis les pousse tous deux à trouver des alliés, à participer à la course aux armements et à se diriger vers la guerre. La question de savoir si cette marche est contrôlée ou non est une autre question. Mais il convient tout d’abord de préciser que la Chine et les États-Unis sont tous deux à la recherche d’alliances et se préparent à la guerre. Bien qu’une vision statique puisse nous amener à conclure que nous vivons « encore dans un monde essentiellement multipolaire » (point 12), la dynamique va dans le sens de la bipolarité.
En ce qui concerne la question de la stabilité des alliances et de la discipline de ses composantes, le fait est que les États-Unis sont offensifs dans leur recherche d’alliés face à la Chine. Cette dernière est désavantagée à plusieurs égards – au niveau de son armée, de sa technologie, de la géographie. Mais l’Empire du Milieu rattrape son retard avec détermination sur les premiers plans.
Cela devrait nous rappeler une vieille thèse de la société de classes, appelée le piège de Thucydide, qui dit que « lorsqu’une grande puissance menace d’en évincer une autre, le résultat en est presque toujours la guerre » (Alison Graham, 2015). Thucydide, le père de l’histoire scientifique, a écrit il y a plus de 2 400 ans que la cause première de la guerre du Péloponnèse était « l’accroissement de la puissance d’Athènes et l’inquiétude qu’elle inspirait à Sparte ». Il est certain que nous vivons dans un monde très différent, mais toujours dans une société de classes. Faudrait-il penser que le capitalisme dans sa période de décomposition est plus rationnel et donc plus enclin à éviter la guerre ?
Je pense que le prolétariat des pays centraux est encore un frein sur le chemin d’une guerre généralisée. Je suis d’accord avec cette idée, exprimée dans le point de la Résolution cité plus haut. Cependant, je ne partage pas l’opinion selon laquelle les expressions typiques de la décomposition telles que décrites par la Résolution, comme la « puissante tendance au chacun pour soi et au chaos au niveau impérialiste », constituent de véritables obstacles à des guerres généralisées ou nucléaires. C’est pourquoi j’ai approuvé et soutenu un autre amendement proposé par le camarade Steinklopfer, qui a toutefois été rejeté par la majorité : « Dans tout le capitalisme décadent jusqu’à présent, des deux principales expressions du chaos généré par le déclin de la société bourgeoise – les conflits impérialistes entre États et la perte de contrôle au sein de chaque capital national – dans les zones centrales du capitalisme lui-même, la première tendance l’a emporté sur la seconde. En supposant, comme nous le faisons, que cela continuera d’être le cas dans le contexte de la décomposition, cela signifie que seul le prolétariat peut être un obstacle aux guerres entre les principales puissances, et non cependant les divisions au sein de la classe dirigeante de ces pays. Si, dans certaines circonstances, ces divisions peuvent retarder le déclenchement de la guerre impérialiste, elles peuvent aussi la catalyser. »
Non seulement en ce qui concerne la question des constellations de blocs, mais aussi en ce qui concerne le rôle de la classe ouvrière, nous devons considérer les conséquences de notre dépassement en 2019 du concept de cours historique. En 1978, dans la Revue internationale n° 18, le CCI a formulé les critères d’évaluation du cours historique dans les termes suivants :
« De l’analyse des conditions qui ont permis le déclenchement des deux guerres impérialistes, on peut tirer les enseignements communs suivants :
-
le rapport de forces entre bourgeoisie et prolétariat ne peut se juger que de façon mondiale et ne saurait tenir compte d’exceptions pouvant concerner des zones secondaires : c’est essentiellement de la situation d’un certain nombre de grands pays qu’on peut déduire la nature véritable de ce rapport de forces ;
-
pour que la guerre impérialiste puisse éclater, le capitalisme a besoin d’imposer préalablement une défaite profonde au prolétariat, défaite avant tout idéologique mais également physique si le prolétariat a manifesté auparavant une forte combativité (cas de l’Italie, de l’Allemagne et de l’Espagne entre les deux guerres) ;
-
cette défaite ne se suffit pas d’une passivité de la classe mais suppose l’adhésion enthousiaste de celle-ci à des idéaux bourgeois (« démocratie », « antifascisme », « socialisme en un seul pays ») ;
-
l’adhésion à ces idéaux suppose :
a) qu’ils aient un semblant de réalité (possibilité d’un développement infini et sans heurt du capitalisme et de la « démocratie », origine ouvrière du régime qui s’est établi en URSS) ;
b) qu’ils soient associés d’une façon ou d’une autre à la défense d’intérêts prolétariens ;
c) qu’une telle association soit défendue parmi les travailleurs par des organismes qui aient leur confiance pour avoir été dans le passé des défenseurs de leurs intérêts, en d’autres termes que les idéaux bourgeois aient comme avocat des organisations anciennement prolétariennes ayant trahi.
Telles sont, à grands traits, les conditions qui ont permis par le passé le déclenchement des guerres impérialistes. Il n’est pas dit a priori qu’une éventuelle guerre impérialiste à venir ait besoin de conditions identiques, mais dans la mesure où la bourgeoisie a pris conscience du danger que pouvait représenter pour elle un déclenchement prématuré des hostilités (malgré tous ces préparatifs préalables, même la seconde guerre mondiale provoque une riposte des ouvriers en 1943 en Italie et en 1944/45 en Allemagne), on ne s’avance pas trop en considérant qu’elle ne se lancera dans un affrontement généralisé que si elle a conscience de contrôler aussi bien la situation qu’en 1939 ou au moins qu’en 1914. En d’autres termes, pour que la guerre impérialiste soit de nouveau possible, il faut qu’il existe au moins les conditions énumérées plus haut et si tel n’est pas le cas, qu’il en existe d’autres en mesure de compenser celles faisant défaut. »
Lors du 23e Congrès en 2019, nous avons déclaré que ces critères ne s’appliquent plus à la situation actuelle. Nous devons donc poser la question de savoir si la bourgeoisie, pour déclencher la guerre, a encore besoin d’une « défaite physique » et d’une « adhésion enthousiaste à des idéaux bourgeois ».
4. Le rapport de forces entre les classes et la question de la maturation souterraine de la conscience
Malgré cette controverse théorique générale, au niveau des concepts et des critères d’appréciation, nous semblons d’accord pour dire que le prolétariat reste, pour la bourgeoisie, un obstacle pour mener une guerre que les grands bastions du prolétariat dans les pays centraux auraient à soutenir d’une manière ou d’une autre. La Résolution prétend que le prolétariat n’a pas encore subi la « défaite politique » décisive (point 12). Ce faisant, la position majoritaire persiste dans l’idée centrale du concept du cours historique : soit cours à la guerre, soit cours à la révolution. Ainsi, la matrice de l’époque de la Guerre froide reste pertinente, bien que nous ayons constaté lors du 23e Congrès international que ce schéma n’est finalement plus adapté si l’on veut évaluer le rapport de forces aujourd’hui. Il n’est pas surprenant que cette faiblesse s’exprime également dans les parties de la Résolution qui parlent de la lutte de classe : « Malgré les énormes problèmes auxquels le prolétariat est confronté, nous rejetons l’idée que la classe a déjà été vaincue à l’échelle mondiale, ou qu’elle est sur le point de subir une défaite comparable à celle de la période de contre-révolution, un genre de défaite dont le prolétariat ne serait peut-être plus capable de se remettre. » (point 28)
La phrase est fausse à la fois dans la prémisse et dans sa conséquence apparemment logique.
La question de départ n’est pas exactement de savoir si le prolétariat a déjà été vaincu à l’échelle mondiale, donc définitivement vaincu, ou presque vaincu, dans une mesure comparable à celle de la période de la contre-révolution. Si l’on s’accorde sur le fait que le prolétariat mondial a subi une série de défaites au cours des quelque quarante dernières années, il faut trouver des critères permettant de mesurer l’étendue de cette ou ces défaites. La question n’est pas celle posée par l’horreur de la défaite physique des années 1930, la mort ou la vie, l’extermination du non-identique. Pour l’instant, il ne s’agit pas d’une situation de tout ou rien, mais d’une dégradation progressive de la conscience de classe, au moins dans son étendue. Mon hypothèse est qu’il s’agit d’un processus asymptotique(7) vers la défaite définitive.
La conséquence logique n’est donc pas « un genre de défaite dont le prolétariat ne serait peut-être plus capable de se remettre ». Si l’hypothèse est correcte (un processus graduel de perte de conscience, avant tout de la conscience de son identité de classe distincte), la conclusion doit être : la classe ouvrière peut encore inverser le processus, faire une sorte de demi-tour. Mais elle doit prendre conscience de la dynamique négative. Les révolutionnaires ont la responsabilité d’en parler dans les termes les plus clairs possibles.
La mauvaise matrice se trouve dans la description et la compréhension par la Résolution de l’état concret de la lutte de classe : « Le fait que, juste avant la pandémie, nous avons vu une réapparition fragile de la lutte de classe (aux États-Unis en 2018, et surtout en France en 2019). Et même si cette dynamique a ensuite été largement bloquée par la pandémie et les confinements, nous avons vu, dans un certain nombre de pays, des mouvements de classe significatifs même pendant la pandémie, notamment autour des questions de sécurité, notamment sanitaire, au travail » (ibid.).
La vision sous-jacente est celle d’une dynamique douce vers une conscience de classe plus forte, donc une dynamique positive, ou au moins une sorte de situation statique : ni positive ni négative, donc en quelque sorte neutre, sur la base d’une combativité de classe intacte.
Alors que mon évaluation est celle d’une dynamique de recul de la conscience de classe, une dynamique négative qui doit être inversée. Heureusement, la combativité pointe encore le bout de son nez ici et là. Mais la combativité n’est pas encore la conscience, même une augmentation de la première n’implique pas encore un élargissement ou un approfondissement de la seconde.
L’évaluation correcte de la situation actuelle et de sa dynamique interne est essentielle pour le prolétariat et ses organisations politiques. Les tâches de l’heure pour les révolutionnaires dépendent évidemment de la compréhension de cette situation objective et concrète.
À un autre niveau, nous devons considérer la question de la « vieille taupe » de Marx (dans Le 18 Brumaire de Louis Bonaparte). Nous avons l’habitude de parler de ce phénomène en termes de maturation souterraine de la conscience de classe. La Résolution souligne le potentiel d’un profond renouveau prolétarien dont témoignent, entre autres, « Les signes, petits mais significatifs, d’une maturation souterraine de la conscience, se manifestant par une ébauche de réflexion globale sur la faillite du capitalisme et la nécessité d’une autre société dans certains mouvements (notamment les Indignés en 2011), mais aussi par l’émergence de jeunes éléments en recherche de positions de classe et se tournant vers l’héritage de la Gauche communiste » (ibid.).
La vague formulation sur les « signes, petits mais significatifs, d’une maturation souterraine de la conscience » est un compromis entre deux opposés irréconciliables : en avant ou en arrière ? Quelle direction du mouvement, avancée ou recul de la conscience de classe, y compris concernant ses composantes souterraines, non visibles ?
Dans les discussions avant et pendant le Congrès, j’ai défendu l’idée qu’il n’y a pas de maturation souterraine significative dans la classe. Nous avons besoin du concept de maturation souterraine afin de combattre les visions conseillistes et les pratiques similaires. C’est un acquis du CCI que la maturation souterraine a lieu aussi dans les moments de recul des luttes ou même dans les périodes de contre-révolution.
Mais c’est une autre chose de dire, comme le fait la majorité, que le mouvement de cette maturation est toujours ascendant.
Si l’on affirme que la maturation est en toute période un mouvement croissant, une régression est exclue. Cela signifie que l’on sous-estime deux choses. D’une part, nous sous-estimons la profondeur des difficultés de notre classe, y compris de ses parties les plus conscientes, et d’autre part, nous sous-estimons le rôle et les tâches spécifiques des révolutionnaires dans la période actuelle. Cette tâche n’est pas seulement quantitative, par la diffusion de positions révolutionnaires, mais c’est surtout un travail qualitatif, théorique, d’analyse en profondeur des tendances actuelles dans les différents domaines : les changements dans l’économie, les tensions impérialistes, et la dynamique dans la classe, surtout au niveau de la conscience. Il y a certainement le potentiel pour un développement de la conscience, mais le potentiel et la réalisation ne sont pas la même chose.
Ferdinand, janvier 2022
1 « Divergences avec la résolution sur la situation internationale du 23e congrès [498] », publié sur notre site web.
2 « Résolution sur la situation internationale (2021) [358] », Revue internationale n° 167.
3 Cela n’a pas aidé Bo Xilai, car il était officiellement en prison, non pas en raison de sa prétendue mauvaise orientation politique, mais pour corruption et abus de pouvoir.
4 Si je ne cite pas littéralement d’autres sources, je base les informations de cet article sur Wikipedia et The Economist.
5 Le lecteur attentif de nos résolutions arrivera à cette conclusion bien que les congrès du CCI n’aient sagement jamais soumis les concepts théoriques au vote.
6 Chapitre 26, vers la fin : « Dans le commerce capitaliste intérieur, le capital ne peut réaliser dans le meilleur des cas que certaines parties de la valeur du produit social total : le capital constant usé, le capital variable et la partie consommée de la plus-value. En revanche, la partie de la plus-value destinée à la capitalisation doit être réalisée « à l’extérieur ». »
7 Signifie couramment qu’une tendance tend vers une droite (un maximal théorique) en s’en rapprochant de plus en plus sans jamais l’atteindre.
Vie du CCI:
- Débat [670]
Rubrique:
Réfugiés: l’Europe délègue la sale besogne à Frontex et à des pays tiers
- 88 lectures
Fin juillet, des réfugiés squelettiques, femmes, enfants et hommes mourants de soif, titubants, étaient recueillis à la frontière libyenne par des gardes-côtes. Un peu plus loin dans le désert saharien, plusieurs cadavres étaient retrouvés. Parmi eux, une mère et sa fillette. Insoutenables images ! Le père, qui les attendait déjà sur place, effondré par la nouvelle de leur disparition, exprimait avec douleur qu’il souhaitait « un avenir pour sa fille ». Un événement terrible parmi des milliers d’autres, dans un monde capitaliste sans perspective.
Explosion du nombre de migrants condamnés au pire
Quelques semaines auparavant, le 14 juillet, une n-ième embarcation de fortune, partie de Libye avec 750 personnes à bord coulait après un refoulement (« pushback ») raté de la garde côtière grecque. Face à ces horreurs, seul un faible écho dans les médias. A contrario, à peine huit jours plus tard, la disparition de cinq touristes VIP lors d’une excursion sous-marine vers l’épave du Titanic provoquait une intense couverture médiatique. Ce contraste en dit long sur la politique des États, qui tirent profit d’un fait divers dramatique pour faire oublier les cadavres des migrants noyés en Méditerranée.
La dégradation de la situation globale pousse à des migrations de plus en plus longues, complexes et dangereuses. Aujourd’hui, on enregistre un chiffre record de 110 millions de réfugiés dans le monde, de même qu’une augmentation du nombre des victimes, particulièrement en Méditerranée où la situation est une des pires au monde avec déjà plus de 2.000 victimes depuis le début de l’année 2023. Plus le nombre de migrants augmente, moins l’accès aux pays occidentaux est possible. Politique inhumaine au durcissement redoutable, interdisant dans les faits tout droit à l’exil.
Face à l’accentuation de la barbarie, à l’instabilité et au chaos dans le monde, les États ne se limitent plus à s’afficher comme forteresses imprenables, avec des kilomètres de barbelés et des murailles dressées. Ils se sont dotés de technologies de surveillance et d’outils de flicage visant à verrouiller implacablement l’accès aux frontières. Les pires victimes sont probablement les migrants de l’espace subsaharien et de la corne de l’Afrique. Déjà victimes de la logique capitaliste avec la guerre, les bandes criminelles armées, l’insécurité, le changement climatique avec la sécheresse et la famine, ces populations sont poussées en ultime recours à l’exode.
La politique criminelle des grandes puissances démocratiques
Si le capitalisme en faillite tend à entraîner l’humanité dans les décombres et la pauvreté absolue, les effets destructeurs de la crise qui marquaient plus fortement les pays de la périphérie depuis des décennies touchent désormais plus fortement les pays occidentaux qui refusent de manière drastique la moindre « bouche inutile ». Seuls les réfugiés de l’Ukraine, pour la propagande de guerre, et les migrants les plus riches et diplômés, susceptibles de renflouer quelques secteurs « en tension » pour des conditions de travail pénibles et des salaires de misère, peuvent espérer, après des tracasseries administratives ubuesques, un hypothétique asile en échange d’une exploitation forcenée. Mais pour la majorité des « crèves la faim », l’Union européenne est devenue une destination inaccessible et même mortelle.
Les pays démocratiques ont parallèlement renforcé, avec une brutalité inouïe, tout leur arsenal juridique à des fins de dissuasion, (1) criminalisant davantage les migrants et même les ONG qui viennent en aide aux naufragés. (2)
Pour se délester d’un sale boulot et ne pas trop se salir les mains, les États de l’Union européenne ont surtout complété leur arsenal en externalisant leurs propres frontières, en donnant mandat à des pays tiers, au bord de la Méditerranée, d’assurer la rétention des migrants, déléguant le maintien de l’ordre dans des camps éloignés, hors du territoire européen. Cela, contre rétribution, pour une gestion « offshore » où les maltraitances, la traite d’êtres humains et les tortures sont légions, où les conditions de vie sont souvent proches de l’univers carcéral le plus sordide. Une politique entièrement assumée par l’Union européenne, notamment via les financements de l’Agence Frontex, permettant aux gardes côtes de ces pays tiers de procéder carrément à des refoulements (« pushback ») bien pratiques et pourtant « illégales » au regard des lois occidentales.
Fidèles aux consignes non avouées de l’Union européenne, les autorités tunisiennes, par exemple, comme le montrent les tragédies au Sahara, n’ont pas hésité à abandonner de façon délibérée dans le désert des réfugiés sans eau ni nourriture dans le but de les faire crever ! Une politique monstrueuse qui, outre le chantage pratiqué par les pays tiers pour l’occasion, prend les migrants comme simple monnaie d’échange. La complicité de facto de l’Union européenne avec ces États et leurs méthodes musclées doit empêcher toute demande d’asile : soit maintenir hors circuit les candidats à l’exil en bloquant les frontières ou alors les condamner à mort dans la Méditerranée (ou le désert) s’ils se résignent à partir finalement. Et c’est bien ce qui se produit !
Les États bourgeois, sous leur masque démocratique, sont de véritables assassins ! L’hypocrite « droit » d’asile est bafoué même pour des enfants martyrisés ou en détresse, même pour des gens maltraités ou mutilés. Il y a de quoi avoir la nausée ! Surtout quand, à l’instar de ce que commandite l’Union européenne, les migrants sont parqués contre leur gré par des gardes chiourmes, ceux de l’État Turc, Libyen ou Égyptien, etc.
La manière détournée de laisser crever les migrants, la multiplication des naufrages et des cadavres témoigne non seulement de l’hypocrisie et du cynisme de l’Union européenne, mais aussi et surtout de leurs pratiques criminelles, de leur volonté de liquider de sang-froid les « indésirables ».
Xénophobie et division, deux armes de la bourgeoisie
Pour accompagner ses pratiques ignobles et répugnantes, la bourgeoisie ne se contente pas d’éloigner ou d’éliminer ceux qu’elle n’accepte pas sur son sol. Elle cultive les peurs, instrumentalisant les pires réflexes xénophobes au sein de la population, montant les ouvriers les uns contre les autres, opposant les populations locales aux migrants présentés comme de dangereux concurrents qui viennent « prendre leur place » et « dégrader leurs conditions de vie ».
Cela commence déjà sur la route de l’exode et le passage dans des pays tiers : « En désignant la migration subsaharienne comme un plan criminel pour changer la composition du paysage démographique en Tunisie, le chef de l’État tunisien a fait de tout migrant subsaharien un complice présumé de ce prétendu complot ». (3) De telles politiques encouragent les agressions, les persécutions et autres violences contre les migrants, comme cela s’est produit en de nombreuses occasions dans la ville portuaire tunisienne de Sfax, devenue rapidement un véritable calvaire pour les exilés.
Pour les migrants qui arrivent par miracle dans les pays occidentaux, les souffrances se poursuivent sous la forme de l’exclusion, de préjugés racistes véhiculés par les théories d’extrême droite, instrumentalisées par l’État de manière ignoble d’un côté, mais aussi et surtout par une propagande gauchiste « anti-raciste » de la « défense des droits », opposant sournoisement ouvriers et immigrés, cherchant à pourrir les consciences au détriment d’un véritable combat ouvrier commun. La classe ouvrière doit absolument rejeter tous les préjugés démocratiques, de même qu’elle doit rejeter fermement « les pièges tendus par la bourgeoisie autour de luttes parcellaires (pour sauver l’environnement, contre l’oppression raciale, le féminisme, etc.) qui le détournent de son propre terrain de classe ». (4)
Le seul véritable soutien que les ouvriers peuvent apporter aux migrants persécutés n’est autre que celui de la lutte contre la dégradation de ses conditions de vie et la barbarie croissante, afin d’affirmer à terme le seul projet historique viable : la destruction du capitalisme et l’édification d’une société sans exploitation et sans frontières.
WH, 1 septembre 2023
1 Au Royaume-Uni, par exemple, qui n’est plus membre de Frontex, le projet de loi sur l’immigration illégale interdit aux personnes irrégulières de présenter une demande d’asile ou toute autre demande de protection en vertu de leurs droits fondamentaux, et ce, quelle que soit la gravité de la situation dans laquelle elles se trouvent. En outre, cette loi prévoyait carrément, avant d’être rejetée par la justice, leur expulsion vers un autre pays (comme le Rwanda), sans un semblant de garantie que ces personnes pourraient y obtenir une protection minimale.
2 L’Italie, la Grèce et Malte ont déclenché des enquêtes administratives et pénales à l’encontre des ONG. L’Italie a déjà immobilisé et imposé des sanctions pécuniaires à des navires de sauvetage qui n’auraient pas respecté la nouvelle loi italienne.
3 Cf. « Tunisie : dans la ville portuaire de Sfax, l’espoir blessé des migrants subsahariens », Le Monde (29 juin 2023).
4 « Résolution sur la situation internationale du 25ᵉ Congrès du CCI », Revue internationale n° 170 (2023).
Géographique:
Récent et en cours:
Rubrique:
Réponse à Ferdinand sur les "Divergences avec la Résolution sur la situation internationale du 24e Congrès du CCI"
- 123 lectures
Le texte « Divergences avec la Résolution sur la situation internationale du 24e Congrès du CCI (explication d’une position minoritaire, par Ferdinand) [664] » présente les désaccords du camarade Ferdinand avec l’analyse du CCI de la période présente. Ces divergences recoupent largement, comme il le souligne lui-même (« Puisque j’avais des désaccords similaires à ceux du camarade Steinklopfer »), celles formulées par le camarade Steinklopfer lors du 23ᵉ Congrès du CCI et rappelées par celui-ci dans un texte présentant ses amendements à la résolution du 24ᵉ Congrès du CCI. Nous avons largement répondu à ces divergences en 2019 et plus récemment dans une contribution publiée ici. Les arguments développés dans cette dernière exposent des arguments largement valables également pour l’essentiel des critiques formulées dans le texte de Ferdinand, et nous ne les redévelopperons donc pas ici1.
Cette contribution se centrera plutôt sur la compréhension de la situation en Chine, qui occupe une place importante dans la contribution de Ferdinand. Avant tout, nous sommes d’accord avec Ferdinand lorsqu’il souligne l’importance du débat, en particulier dans une période marquée par l’apparition d’événements nouveaux où « il n’est pas surprenant qu’au sein d’une organisation révolutionnaire vivante, des polémiques sur l’analyse de la situation mondiale surgissent ». De fait, dans une organisation non monolithique comme le CCI, il serait inquiétant que, face aux bouleversements des dernières années, aucun questionnement ou désaccord ne surgisse. Sur ce plan, comprendre « l’évolution de la Chine, sa puissance économique et le capitalisme d’État » constitue une question centrale non seulement pour mieux comprendre la dynamique actuelle du capitalisme mais aussi pour analyser la situation en mettant en pratique la méthode marxiste.
Dès le début de sa contribution, Ferdinand exprime ses critiques concernant l’analyse de la situation en Chine par l’organisation et pose la méthode qu’il a l’intention de développer : « Les affirmations selon lesquelles la Chine est une bombe à retardement, que son État est faible et que sa croissance économique semble chancelante sont l’expression d’une sous-estimation du véritable développement économique et impérialiste de la Chine au cours des quarante dernières années. Vérifions d’abord les faits puis les fondements théoriques sur lesquels repose cette analyse erronée ». Examinons donc de plus près quels sont les faits auxquels il est fait référence ici et ensuite les fondements théoriques que Ferdinand estime erronées. Mais avant cela, qu’en est-il de l’assertion que le CCI a toujours sous-estimé le développement de la Chine et qu’il continue à le faire ?
1. Une sous-estimation continue du développement de la Chine par le CCI ?
Une première manière, insidieuse, de mettre en doute l’analyse de l’organisation est d’affirmer qu’elle aurait toujours négligé le développement de la Chine (« Le développement de la Chine a été minimisé dans nos rangs pendant des décennies ») et qu’elle continue à le faire (« Mais cette reconnaissance était mitigée. Bientôt les anciens schémas se sont glissés à nouveau dans nos analyses »). Or, il est assez inexact de dire que le CCI a négligé pendant des décennies le développement de la Chine.
Ainsi, dès la fin des années 1970, le CCI mettait en évidence une évolution dans le rapport de forces entre les blocs d’une importance capitale pour le futur :
« Comme ailleurs, la devise du capital chinois devient : « exporter ou mourir ». Mais en raison de la faiblesse de son économie et faute de positions sur le marché mondial, la Chine ne peut plus jouer cavalier seul et, en conséquence, est contrainte de s’intégrer plus fortement dans le bloc occidental, comme en témoignent au niveau économique sa balance commerciale et au niveau politique son soutien à toutes « les politiques occidentales ou du tiers-monde hostiles à Moscou » ». (Révolution internationale n° 41 [673], septembre 1977) ;
« Les années passées ont vu un renforcement considérable de l’impérialisme américain et un affaiblissement de son rival russe. L’intégration de la Chine dans le bloc américain et la participation au réarmement de Pékin signifient que le Kremlin rencontrera une force de plus en plus puissante sur sa frontière Est – une force qui barrera fermement la route vers les bases industrielles japonaises. Même les efforts de l’impérialisme russe pour chasser la Chine de la péninsule indochinoise ne peuvent compenser cette victoire de l’impérialisme américain en Extrême-Orient. » (« Rapport sur la situation internationale [674] », 3e congrès international du CCI, 1979, Revue internationale n° 18).
Il s’agit là d’une dynamique cruciale qui s’enclenche dans le courant des années 1960 et 70 à travers la « rupture idéologique avec Moscou » de la Chine, son détachement du bloc russe et, dans le courant des années 1970 (visite de Nixon à Pékin en 1972 et établissement de relations diplomatiques en 1979), le rapprochement progressif du bloc américain afin de « travailler ensemble [et de] s’unir pour contrer l’ours polaire » (Deng Xiaoping en 1979).
Pendant 70 ans (dont 30 ans de domination du parti « communiste »), c’est-à-dire l’essentiel du XXe siècle, la Chine avait été une des expressions les plus manifestes de l’entrée en décadence du capitalisme – économie en ruine, guerres civiles, immixtions et invasions d’impérialismes étrangers, famines gigantesques, flots de réfugiés et massacre de millions de personnes. Son intégration au marché occidental a permis son développement économique et une formidable modernisation technologique, en particulier vers la fin des années 1980 et durant les années 1990. Dans le courant des années 1990 et le début des années 2000, le CCI a progressivement mis en évidence et analysé la montée en puissance de la Chine :
– sur le plan économique, en soulignant que cela ne remettait nullement en question l’analyse de la décadence du capitalisme :
« La décadence du capitalisme n’a jamais signifié un effondrement soudain et brutal du système, comme certains éléments de la Gauche allemande la présentaient dans les années 1920, ni un arrêt total du développement des forces productives, comme le pensait à tort Trotsky dans les années 30. […] la bureaucratie chinoise (figure de proue du « boom » actuel) a réussi le tour de force stupéfiant de se maintenir en vie. Certains critiques vis-à-vis de la notion de décadence du capitalisme ont même présenté ce phénomène comme la preuve que le système a encore la capacité de se développer et de s’assurer une croissance réelle.
En réalité, le « boom » chinois actuel ne remet en aucune façon en question le déclin général de l’économie capitaliste mondiale. Contrairement à la période ascendante du capitalisme :
– la croissance industrielle actuelle de la Chine ne fait pas partie d’un processus global d’expansion ; au contraire, elle a comme corollaire direct la désindustrialisation et la stagnation des économies les plus avancées qui ont délocalisé en Chine à la recherche de coûts de travail moins chers ;
– la classe ouvrière chinoise n’a pas en perspective une amélioration régulière de ses conditions de vie, mais on peut prévoir qu’elle subira de plus en plus d’attaques contre ses conditions de vie et de travail et une paupérisation accrue d’énormes secteurs du prolétariat et de la paysannerie en dehors des principales zones de croissance ;
– la croissance frénétique ne contribuera pas à une expansion globale du marché mondial mais à un approfondissement de la crise mondiale de surproduction : étant donné la consommation restreinte des masses chinoises, le gros des produits chinois est dirigé vers l’exportation dans les pays capitalistes les plus développés ;
– l’irrationalité fondamentale de l’envolée de l’économie chinoise est mise en lumière par les terribles niveaux de pollution qu’elle a engendrés – c’est une claire manifestation du fait que l’environnement planétaire ne peut être qu’altéré par la pression subie par chaque pays pour qu’il exploite ses ressources naturelles jusqu’à la limite absolue pour être compétitif sur le marché mondial ;
– à l’image du système dans son ensemble, la totalité de la croissance de la Chine est basée sur des dettes qu’elle ne pourra jamais compenser par une réelle extension sur le marché mondial.
D’ailleurs, la fragilité de toutes ces bouffées de croissance est reconnue par la classe dominante elle-même, qui est de plus en plus alarmée par la bulle chinoise – non parce qu’elle serait contrariée par les niveaux d’exploitation terrifiants sur laquelle elle est basée, loin de là, ces niveaux féroces sont précisément ce qui rend la Chine si attrayante pour les investissements – mais parce que l’économie mondiale est devenue trop dépendante du marché chinois et que les conséquences d’un effondrement de la Chine deviennent trop horribles à envisager, non seulement pour la Chine – qui serait replongée dans l’anarchie violente des années 30 – mais pour l’économie mondiale dans son ensemble. […]
Il est vrai que l’entrée dans la décadence s’est produite bien avant que ces marchés se soient épuisés et que le capitalisme a continué à faire le meilleur usage possible de ces aires économiques restantes en tant que débouché pour sa production : la croissance de la Russie pendant les années 30 et l’intégration des économies paysannes qui subsistaient pendant la période de reconstruction après la guerre en sont des exemples. Mais la tendance dominante, et de loin, dans l’époque de décadence, est l’utilisation d’un marché artificiel, basé sur l’endettement. » (« Résolution sur la situation internationale [675] », 16e congrès international du CCI, 2005, Revue internationale n° 122)2 ;
– sur le plan de la manifestation de sa puissance impérialiste de plus en plus proéminente dès le début du XXIe siècle :
« En particulier, elle ne saurait décourager la Chine de faire prévaloir les ambitions impérialistes que lui permet son statut récent de grande puissance industrielle. Il est clair que ce pays, malgré son importance démographique et économique, n’a absolument pas les moyens militaires ou technologiques, et n’est pas près de les avoir, de constituer une nouvelle tête de bloc. Cependant, il a les moyens de perturber encore plus les ambitions américaines – que ce soit en Afrique, en Iran, en Corée du Nord, en Birmanie, et d’apporter sa pierre à l’instabilité croissante qui caractérise les rapports impérialistes » (« Résolution sur la situation internationale, 19e congrès international du CCI [676] », 2011, Revue internationale n° 146).
Non pas un manque d’attention porté au développement de la Chine, mais un certain schématisme, en particulier au niveau de la compréhension des manifestations de la décadence, a certes caractérisé l’application et l’approfondissement de ce cadre d’analyse, comme le CCI l’a pointé lui-même lors de son 21e congrès international en 2015 :
« Le déni, dans certains de nos textes clefs, de toute possibilité d’expansion du capitalisme dans sa phase décadente a aussi rendu difficile pour l’organisation d’expliquer la croissance vertigineuse de la Chine et d’autres « nouvelles économies » dans la période qui a suivi la chute des vieux blocs. Alors que ces développements ne remettent pas en question, comme beaucoup l’ont dit, la décadence du capitalisme et en sont d’ailleurs une claire expression, ils sont allés à l’encontre de la position selon laquelle dans la période de décadence, il n’y a strictement aucune possibilité d’un décollage industriel dans des régions de la « périphérie ». Alors que nous avons été capables de réfuter certains des mythes les plus faciles sur la « globalisation » dans la phase qui a suivi l’effondrement des blocs (mythes colportés par la droite qui y voyait un nouveau et glorieux chapitre dans l’ascendance du capitalisme, comme par la gauche qui s’en est servie pour une revitalisation des vieilles solutions nationalistes et étatiques), nous n’avons pas été capables de discerner le cœur de la vérité dans la mythologie mondialiste : que la fin du vieux modèle autarcique ouvrait de nouvelles sphères aux investissements capitalistes, y compris l’exploitation d’une nouvelle source énorme de force de travail prélevée en dehors des rapports sociaux directement capitalistes. » (« Résolution sur la situation internationale [677] », point 10, 21e congrès international du CCI, 2015, Revue internationale n° 156).
« Cependant, nous avons été moins capables de prévoir la capacité de la Russie de ré-émerger en tant que force qui compte sur la scène mondiale, et plus important, nous avons beaucoup tardé à voir la montée de la Chine en tant que nouvel acteur significatif dans les rivalités entre grandes puissances qui se sont développées dans les deux ou trois dernières décennies – un échec étroitement connecté à notre problème de reconnaissance de la réalité de l’avancée économique de la Chine ». (« Résolution sur la situation internationale [677] », point 11, 21e congrès international du CCI, 2015, Revue internationale n° 156).
Toutefois, l’assertion même de Ferdinand que si cela a été le cas dans le passé cela ne peut qu’être toujours le cas aujourd’hui, est un mode d’argumentation fallacieux. Depuis que ce danger a été reconnu par l’organisation, on peut constater que l’attention portée au cadre de compréhension du développement de la Chine a été soutenu dans les analyses récentes de l’organisation :
« Les étapes de l’ascension de la Chine sont inséparables de l’histoire des blocs impérialistes et de leur disparition en 1989 : la position de la Gauche communiste affirmant « l’impossibilité de tout surgissement de nouvelles nations industrialisées » dans la période de décadence et la condamnation des états « qui n’ont pas réussi leur « décollage industriel » avant la première guerre mondiale à stagner dans le sous-développement, ou à conserver une arriération chronique par rapport aux pays qui tiennent le haut du pavé » était parfaitement valable dans la période de 1914 à 1989. C’est le carcan de l’organisation du monde en deux blocs impérialistes adverses (permanente entre 1945 et 1989) en vue de la préparation de la guerre mondiale qui empêchait tout bouleversement de la hiérarchie entre puissances. L’essor de la Chine a commencé avec l’aide américaine rétribuant son changement de camp impérialiste en faveur des États-Unis en 1972. Il s’est poursuivi de façon décisive après la disparition des blocs en 1989. La Chine apparaît comme le principal bénéficiaire de la “globalisation” suite à son adhésion à l’OMC en 2001 quand elle est devenue l’atelier du monde et la destinataire des délocalisations et des investissements occidentaux, se hissant finalement au rang de seconde puissance économique mondiale. Il a fallu la survenue des circonstances inédites de la période historique de la décomposition pour permettre l’ascension de la Chine, sans laquelle celle-ci n’aurait pas eu lieu.
La puissance de la Chine porte tous les stigmates du capitalisme en phase terminale : elle est basée sur la surexploitation de la force de travail du prolétariat, le développement effréné de l’économie de guerre du programme national de « fusion militaro-civile » et s’accompagne de la destruction catastrophique de l’environnement, tandis que la « cohésion nationale » repose sur le contrôle policier des masses soumises à l’éducation politique du Parti unique et la répression féroce des populations allogènes du Xinjiang musulman et du Tibet. En fait, la Chine n’est qu’une métastase géante du cancer généralisé militariste de l’ensemble du système capitaliste : sa production militaire se développe à un rythme effréné, son budget défense a été multiplié par six en 20 ans et occupe depuis 2010 la 2e place mondiale » (« Résolution sur la situation internationale [62] », 23e congrès international du CCI, 2019, Revue internationale n° 164).
En réalité, ce n’est pas la sous-estimation de l’expansion de la Chine qui pose problème à Ferdinand, mais le cadre d’interprétation même qui est exploité (« la formulation « La croissance extraordinaire de la Chine est elle-même un produit de la décomposition. » »). Pour Ferdinand, l’examen des « faits » en eux-mêmes démontrerait déjà l’inconsistance de l’approche du CCI.
2. Quelle sanction des faits ?
Ferdinand veut examiner « les faits », mais il commence par sélectionner ceux qui lui conviennent : « Nous ne pouvons pas faire confiance à la propagande chinoise sur la force de son système. Mais ce que les médias occidentaux ou autres non chinois nous disent sur les contradictions en Chine est aussi de la propagande – et en plus c’est souvent un vœu pieux. ». Dès lors, il peut balayer d’un trait les « faits » avancés par l’organisation (« Les éléments mentionnés dans la Résolution ne sont pas convaincants ») tout en sélectionnant les sources qu’il estime « crédibles » (« je base les informations de cet article sur Wikipedia et The Economist »).
En conséquence, les « faits » qu’il daigne examiner se limitent uniquement à la question des tensions internes au sein des classes dirigeantes. Et qui plus est, son mode d’argumentation est des plus curieux :
– Ferdinand compare de manière absurde les changements de l’ordre de bataille au sein de certaines bourgeoisies en Europe de l’Ouest dans les années 1970, sous la pression de la lutte de classe, avec l’exacerbation des tensions internes entre cliques au sein des bourgeoisies nationales, qui est avant tout un phénomène de la phase de décomposition du capitalisme et plus spécifiquement de sa dernière décennie. Elle découle en effet de la pression de plus en plus forte que les différentes bourgeoisies ressentent aux niveaux économique et impérialiste et de la difficulté de garder le contrôle sur l’ensemble du système politique (comme le surgissement du populisme aux États-Unis ou en Grande-Bretagne, mais également les tensions entre cliques au sein de l’appareil d’État en Chine).
– il avance l’idée fausse et saugrenue que le CCI défendrait « la thèse selon laquelle le prolétariat menace le régime de Xi Jinping ».
Cette argumentation cache en réalité (a) une sous-estimation du poids de la décomposition sur l’appareil politique de la bourgeoisie et (b) une tendance à voir la forme du capitalisme chinois comme une forme “avancée” de capitalisme, comme dans les pays européens, et pas comme une expression caricaturale du pourrissement du capitalisme. Le fait que Ferdinand puisse imaginer que la question ne serait pas une lutte de factions au sein du parti-état stalinien mais consisterait à proposer un modèle alternatif (« aucun modèle alternatif pour le cours du capitalisme d’État chinois n’est visible »), par des factions bourgeoises à l’extérieur et à l’intérieur du parti, montre à quel point il ne voit pas combien le système de capitalisme d’État stalinien en Chine ne représente pas une expression de force du capitalisme mais est au contraire un pur produit de la barbarie, de la décadence et de la décomposition.
Dans cette perspective, son analyse de la répression des capitalistes privés souligne singulièrement le manque de méthode dans son approche des « faits » : il pointe la récente répression des capitalistes privés (« Le Parti coupe les ailes de certaines des entreprises les plus rentables et des magnats les plus riches ; c’est laisser s’échapper l’air de certaines bulles spéculatives afin de contrôler plus strictement l’ensemble de l’activité économique »). Mais que prouve cette mise sous tutelle plus stricte des entreprises privées par l’État ? Le contexte de la phase de décomposition, mis en évidence par le CCI, permet précisément d’appréhender que la « reprise en main » de secteurs entiers de l’économie par le parti, qui souligne la rigidité du système politique stalinien chinois sous pression sur les plans économique et impérialiste, tout comme d’ailleurs les tensions entre factions en son sein, sont essentiellement une expression de FAIBLESSE du régime et non de sa force.
Tandis que les « faits » qu’il veut bien examiner se limitent à la question des tensions au sein des classes dirigeantes, il reste silencieux sur la multitude d’éléments avancée par l’organisation qui attestent des difficultés de la Chine, depuis le rapport sur les tensions impérialistes de juin 2018 [678] (Revue internationale n° 161) jusqu’au rapport sur la pandémie et le développement de la décomposition [356], adopté au 24e congrès international du CCI en 2021 (Revue internationale n° 167) :
« À plus long terme, l’économie chinoise est confrontée à une délocalisation des industries stratégiques par les États-Unis et les pays européens et aux difficultés de la « nouvelle route de la soie » à cause des problèmes financiers liés à la crise économique et accentués par la crise du Covid-19 (financement chinois mais surtout niveau d’endettement de pays « partenaires » comme le Sri-Lanka, le Bangladesh, le Pakistan, le Népal…) mais aussi par une méfiance croissante de la part de nombreux pays et à la pression antichinoise des États-Unis. Aussi, il ne faut pas s’étonner qu’en 2020, il y a eu un effondrement de la valeur financière des investissements injectés dans le projet « Nouvelle route de la soie » (−64 %).
La crise du Covid-19 et les obstacles rencontrés par la « nouvelle Route de la Soie » ont également accentué les tensions de plus en plus manifestes à la tête de l’État chinois, entre la faction « économiste » qui mise avant tout sur la mondialisation économique et le « multilatéralisme » pour poursuivre l’expansion capitaliste de la Chine et la faction « nationaliste » qui appelle à une politique plus musclée et qui met en avant la force (« la Chine qui a vaincu le Covid ») face aux menaces intérieures (les Ouïghours, Hong-Kong, Taïwan) et extérieures (tensions avec les USA, l’Inde et le Japon). Dans la perspective du prochain Congrès du Peuple en 2022 qui devrait nommer le nouveau (l’ancien ?) président, la situation en Chine est donc également particulièrement instable. »
Depuis lors, tous les rapports sur les tensions impérialistes ont avancé de nombreux éléments concernant la gestion calamiteuse de la crise du Covid : l’accumulation des problèmes pour l’économie chinoise, la stagnation des « nouvelles routes de la soie » et l’accentuation des antagonismes au sein de la bourgeoisie chinoise. Le rapport sur les tensions impérialistes de novembre 2021 [679] (Revue internationale n° 167) synthétise les difficultés de la Chine sur les différents plans :
« La Chine a connu ces dernières décennies une ascension fulgurante sur les plans économique et impérialiste, qui en a fait le challenger le plus important pour les États-Unis. Cependant, comme l’illustrent déjà les événements de septembre 2021 en Afghanistan, elle n’a pu profiter, ni de la poursuite du déclin américain, ni de la crise de la Covid-19 et de ses conséquences pour renforcer ses positions sur le plan des rapports impérialistes, bien au contraire. Nous examinons les difficultés auxquelles la bourgeoisie chinoise est confrontée sur le plan de la prise en charge de la Covid, de la gestion de l’économie, des rapports impérialistes et des tensions en son sein. »
Sur chacun de ces plans, des éléments précis sont fournis pour illustrer que « loin de tirer profit de la situation actuelle, la bourgeoisie chinoise, comme les autres bourgeoisies, est confrontée au poids de la crise, au chaos de la décomposition et aux tensions internes, qu’elle tente par tous les moyens de contenir au sein de ses structures capitalistes d’État désuètes ». (Rapport sur les tensions impérialistes de novembre 2021 [679], Revue internationale n° 167). Malheureusement, elles sont toutes soigneusement ignorées par Ferdinand.
Qu’est-ce qui pousse alors le camarade à contester l’affirmation que « la Chine est une bombe à retardement », alors que cela ne peut être fondé sur un suivi insuffisant ou un manque de preuves, surtout dans la période présente, de la part du CCI, comme toutes les références à nos textes de congrès le montrent ? Les éléments discutés ci-dessus ne constituent-ils, en fin de compte, qu’un rideau de fumée qui doit cacher la véritable raison de son désaccord, à localiser alors au niveau des « fondements théoriques » ?
3. Une application schématique et erronée de la décadence et de la décomposition, mais par qui ?
Ferdinand entend démontrer par plusieurs questions que ce qui est en jeu est « une compréhension erronée et schématique de la décadence capitaliste ».
La première question abordée est l’idée que le CCI sous-estimerait la tendance vers la constitution de nouveaux blocs (« la Résolution minimise le danger d’une future constellation de blocs »), qui, pour Ferdinand, serait pourtant dominante : « La logique capitaliste de la polarisation entre la Chine et les États-Unis les pousse tous deux à trouver des alliés, à participer à la course aux armements et à se diriger vers la guerre ». Cette analyse fait toutefois abstraction des caractéristiques de la phase actuelle de décomposition qui :
(a) contrecarre radicalement cette tendance au regroupement en blocs impérialistes comme ceux qui ont marqué la période de la « Guerre froide ». Cela a clairement été posé par le CCI dès 1990 :
« la tendance à un nouveau partage du monde entre deux blocs militaires est contrecarrée, et pourra peut-être même être définitivement compromise, par le phénomène de plus en plus profond et généralisé de décomposition de la société capitaliste tel que nous l’avons déjà mis en évidence » (« Après l’effondrement du bloc de l’Est : déstabilisation et chaos [680] », 1990, Revue internationale n° 61).
« ce n’est pas la disparition du partage du monde en deux constellations impérialistes résultant de l’effondrement du bloc de l’Est qui pouvait remettre en cause une telle réalité. En effet, ce n’est pas la constitution de blocs impérialistes qui se trouve à l’origine du militarisme et de l’impérialisme. C’est tout le contraire qui est vrai : la constitution des blocs n’est que la conséquence extrême (qui, à un certain moment peut aggraver les causes elles-mêmes), une manifestation (qui n’est pas nécessairement la seule) de l’enfoncement du capitalisme décadent dans le militarisme et la guerre. » (« Texte d’orientation Militarisme et décomposition [396] », 1990, Revue internationale n° 64).
Ainsi, dans le contexte actuel de la guerre en Ukraine, les positionnements de l’Inde envers les États-Unis et la Russie, de la Chine envers la Russie ou de la Turquie envers l’OTAN (dont le pays est membre) et la Russie soulignent (parmi d’autres exemples) combien c’est l’instabilité qui caractérise les rapports entre puissances impérialistes et non pas la constitution de blocs impérialistes.
(b) n’implique nullement une réduction de la barbarie militaire, du danger de guerre, comme nous le signalions déjà il y a plus de 30 ans :
« les affrontements militaires entre États, même s’ils ne sont plus manipulés et utilisés par les grandes puissances, ne sont pas près de disparaître. Bien au contraire, comme on l’a vu dans le passé, le militarisme et la guerre constituent le mode même de vie du capitalisme décadent que l’approfondissement de la crise ne peut que confirmer. Cependant, ce qui change avec la période passée, c’est que ces antagonismes militaires ne prennent plus à l’heure actuelle la forme d’une confrontation entre deux grands blocs impérialistes » (« Résolution sur la situation internationale [681] », juin 1990, Revue internationale n° 63) ;
« […] la fin des blocs ne fait qu’ouvrir la porte à une forme encore plus barbare, aberrante et chaotique de l’impérialisme. » (« Texte d’orientation Militarisme et décomposition [396] », 1990, Revue internationale n° 64).
Et face à l’interprétation de Ferdinand que « Faudrait-il penser que le capitalisme dans sa période de décomposition est plus rationnel et donc plus enclin à éviter la guerre ? », c’est tout le contraire qui est vrai : le CCI a mis en évidence que l’instabilité et le chaos actuels découlant de la tendance au chacun pour soi ne réduisent pas le militarisme et le danger de guerre mais rendent paradoxalement le danger de spirale nucléaire plus réel que lors de la “Guerre froide” entre blocs (cf. le rapport « Signification et impact de la guerre en Ukraine [434] », 2022, Revue internationale n° 168).
Un autre point qui marquerait le schématisme du CCI selon Ferdinand est la non-reconnaissance que le capitalisme d’État chinois sortirait grand gagnant de la situation et se renforcerait : « La Résolution sous-estime le fait que les économies fortes sont bien mieux loties que les faibles […] Et elle nie que la Chine sorte gagnante de la situation […] la Chine est jusqu’à présent l’un des gagnants de la crise pandémique ». D’après Ferdinand en effet, « Les cercles dirigeants de ce pays utilisent la crise pandémique pour restructurer son économie, son armée, son empire. Même si la croissance économique en Chine a ralenti ces derniers temps, derrière cela se cache, dans une certaine mesure, un plan calculé de l’élite politique dirigeante pour maîtriser les excès du capital privé et renforcer le capitalisme d’État pour le défi impérialiste ».
Le CCI ne nie nullement que dans cette phase de décomposition croissante, des bourgeoisies nationales peuvent, temporairement et dans certaines régions, profiter de la situation : pendant la première décennie de la phase de décomposition, les États-Unis ont pu sembler réussir à imposer leur hégémonie globale (première guerre du Golfe, accords de Dayton pour l’ex-Yougoslavie) ; aujourd’hui même, certains pays producteurs de pétrole ou de gaz encaissent une manne inespérée de dollars ; de même, la Chine a effectivement connu une expansion économique remarquable entre 1990 et 2016. Toutefois, la vraie question à expliquer est la suivante : de quoi cette expansion est-elle le produit ?
Pour le CCI, l’entrée du capitalisme depuis 1989 dans la phase finale de sa décadence, la phase de décomposition, permet de situer et de comprendre à la fois les ingrédients de l’émergence soudaine de la Chine mais aussi les fragilités et les contradictions internes et externes qui menacent son expansion. Cette contextualisation est précisément ce que Ferdinand évite de faire de manière extensive et explicite.
Par ailleurs, contrairement à Ferdinand qui semble voir le capitalisme d’État stalinien comme le moteur dynamique du développement de la Chine, la Gauche Communiste de France, dans sa revue Internationalisme en 1952, soulignait déjà que le capitalisme d’État n’est pas fondamentalement une solution aux contradictions du capitalisme, même s’il peut en retarder les effets, mais est une expression de ces contradictions :
« Puisque le mode de production capitaliste est entré dans sa décadence, la pression pour lutter contre ce déclin avec des mesures capitalistes d’État est croissante. Cependant, la tendance à renforcer les organes et les formes capitalistes étatiques est tout sauf un renforcement du capitalisme ; au contraire, elle exprime les contradictions croissantes sur le terrain économique et politique. Avec l’accélération de la décomposition dans le sillage de la pandémie, nous assistons également à une forte augmentation des mesures capitalistes d’État ; celles-ci ne sont pas l’expression d’un plus grand contrôle de l’État sur la société mais constituent plutôt l’expression des difficultés croissantes à organiser la société dans son ensemble et à empêcher sa tendance croissante à la fragmentation. » (« Résolution sur la situation internationale [358] », point 23, 24ᵉ congrès international du CCI, 2021, Revue internationale n° 167).
Dans ce cadre, l’implosion du bloc de l’Est a aussi signifié la faillite du capitalisme d’État stalinien, particulièrement dépassé et inefficace. Or, si la Chine, en passant du côté américain, a été capable de s’ouvrir aux capitalistes privés et au marché mondial (où elle a joué un rôle central dans la politique de mondialisation de l’économie), elle a gardé les structures surannées du capitalisme d’État stalinien, qui implique nécessairement (a) une liberté étroitement surveillée et relative pour les capitaux et les capitalistes privés, (b) une peur bleue de tout conflit social qu’il ne peut affronter qu’à travers une répression brutale et (c) des luttes machiavéliques et sans pitié entre factions rivales au sein du parti-État.
La question centrale qui transparaît confusément à travers une forêt d’éléments spécifiques est que le cadre de la décomposition mis en avant par le CCI implique une approche univoque :
« […] tout est subordonné à la « décomposition », une sorte de fragmentation homogène » » et passe à côté de certaines des caractéristiques centrales du capitalisme : « Cette compréhension de la période de décomposition est schématique et – dans la mesure où elle nie la persistance de lois capitalistes élémentaires – par exemple la concentration et la centralisation du capital – un abandon du marxisme ».
Or :
(a) la compréhension de la décomposition en tant que cadre dominant pour saisir le développement de la situation de ces quarante dernières années a été mise en évidence par le CCI vers la fin des années 1980 et confirmée par le déroulement des événements qui ont ébranlé l’ordre mondial et les rapports entre les classes depuis 1989-1990 :
« Depuis un an, la situation mondiale a connu des bouleversements considérables qui ont modifié de façon très sensible la physionomie du monde telle qu’il était sorti de la Seconde Guerre impérialiste. Le CCI s’est appliqué à suivre de très près ces bouleversements :
– pour rendre compte de leur signification historique ;
– pour examiner dans quelle mesure ils infirmaient ou confirmaient les cadres d’analyse valables auparavant.
C’est ainsi que ces événements historiques (agonie du stalinisme, disparition du bloc de l’Est, désagrégation du bloc de l’Ouest), s’ils n’avaient pu être prévus dans leur spécificité, s’intégraient parfaitement dans le cadre d’analyse et de compréhension de la période historique présente élaboré antérieurement par le CCI : la phase de décomposition » (« Texte d’orientation Militarisme et décomposition [396] », 1990, Revue internationale n° 64).
Cette situation a provoqué une dynamique de pourrissement sur pied du capitalisme accentuant des caractéristiques déjà présentes depuis son entrée en décadence, tels l’explosion irrationnelle du militarisme, une foire d’empoigne impérialiste, le chaos ou la difficulté pour la bourgeoisie à garder le contrôle de son appareil politique, mais qui deviennent des caractéristiques dominantes de cette phase finale :
« il est indispensable de mettre en évidence la différence fondamentale qui oppose les éléments de décomposition qui ont affecté le capitalisme depuis le début du siècle et la décomposition généralisée dans laquelle s’enfonce à l’heure actuelle ce système et qui ne pourra aller qu’en s’aggravant. Là aussi, au-delà de l’aspect strictement quantitatif, le phénomène de décomposition sociale atteint aujourd’hui une telle profondeur et une telle extension qu’il acquiert une qualité nouvelle et singulière manifestant l’entrée du capitalisme décadent dans une phase spécifique – la phase ultime – de son histoire, celle où la décomposition devient un facteur, sinon le facteur, décisif de l’évolution de la société. » (« Thèses sur la Décomposition [10] », 1990, Revue internationale n° 107).
Pourquoi Ferdinand ne se positionne-t-il pas par rapport à la prédominance de ce cadre dans la phase ultime de la décadence capitaliste, celle de la décomposition sociale, discuté et approuvé unanimement par l’organisation, et rappelé dans le préambule de la résolution sur la situation internationale du 24e congrès international du CCI [358] ? (2021, Revue internationale n° 167) :
« Cette résolution s’inscrit dans la continuité du rapport sur la décomposition présenté au 22e congrès du CCI, de la résolution sur la situation internationale présentée au 23e congrès, et du rapport sur la pandémie et la décomposition présenté au 24e congrès. Elle est basée sur l’idée que non seulement la décadence du capitalisme passe par différents stades ou phases, mais que nous avons depuis la fin des années 1980 atteint sa phase ultime, la phase de décomposition ».
(b) Est-ce que ce cadre de compréhension de la situation implique, comme Ferdinand l’affirme, « l’oubli » par le CCI de certaines tendances inhérentes au capitalisme, telle la tendance à la concentration et la centralisation, encore accentuées en décadence ? Loin de les nier, le CCI a mis en évidence combien la mise en œuvre de ces tendances exacerbe encore plus le chaos et la barbarie de la période :
« dans la continuité de la plate-forme de l’Internationale communiste de 1919, qui non seulement insistait sur le fait que la guerre impérialiste mondiale de 1914-18 annonçait l’entrée du capitalisme dans « l’époque de l’effondrement du Capital, de sa désintégration interne, l’époque de la révolution communiste du prolétariat », mais encore soulignait également que « l’ancien « ordre » capitaliste a cessé de fonctionner ; son existence ultérieure est hors de question. Le résultat final du mode de production capitaliste est le chaos. Ce chaos ne peut être surmonté que par la classe productive et la plus nombreuse – la classe ouvrière. Le prolétariat doit établir un ordre réel – l’ordre communiste ». Ainsi, le drame auquel l’humanité est confrontée se pose effectivement en termes d’ordre contre chaos. Et la menace d’un effondrement chaotique était liée à « l’anarchie du mode de production capitaliste », en d’autres termes, à un élément fondamental du système lui-même – un système qui, suivant le marxisme, et à un niveau qualitativement plus élevé que dans tout mode de production antérieur, implique que les produits du travail humain deviennent une puissance étrangère qui se dresse au-dessus et contre leurs créateurs. La décadence du système, du fait de ses contradictions insolubles, marque une nouvelle spirale dans cette perte de contrôle. Et comme l’explique la Plate-forme de l’IC, la nécessité d’essayer de surmonter l’anarchie capitaliste au sein de chaque État-nation – par le monopole et surtout par l’intervention de l’État – ne fait que la pousser vers de nouveaux sommets à l’échelle mondiale, culminant dans la guerre mondiale impérialiste. Ainsi, alors que le capitalisme peut à certains niveaux et pendant certaines phases retenir sa tendance innée au chaos (par exemple, à travers la mobilisation pour la guerre dans les années 1930 ou la période de boom économique qui a suivi la guerre), la tendance la plus profonde est celle de la « désintégration interne » qui, pour l’IC, caractérise la nouvelle époque. » (« Résolution sur la situation internationale [358] », 24ᵉ congrès du CCI, 2021, Revue internationale n° 167).
Il apparaît donc que les divers désaccords de Ferdinand en rapport avec l’analyse de la Chine viennent fondamentalement d’une assimilation insuffisante des tendances centrales de la phase de décomposition. En réalité, en partant de ce cadre et en reprenant les éléments convoqués dans les points précédents, on ne peut qu’appréhender le développement de la Chine comme « un produit de la décomposition ». Certes, Ferdinand affirme qu’il est d’accord avec cette dernière : « Les tendances à la polarisation que je mets en avant ne sont pas en contradiction avec le cadre de la décomposition », il y aurait juste le CCI qui exagère avec sa « décomposition partout ». En réalité, et l’examen des points précédents le confirme, Ferdinand manifeste une incompréhension profonde de la décomposition et une phrase est particulièrement illustrative de ceci : « Cette dernière [la position « décomposition partout »] est une recherche permanente des phénomènes de dislocation et de désintégration, perdant de vue les tendances plus profondes et concrètes [nous soulignons] typiques des mutations actuelles ». En d’autres mots, le chacun pour soi, le chaos et l’individualisme exacerbé ne constitueraient pas des tendances fondamentales de la période présente : dès lors, malgré l’expression formelle d’un accord avec ce cadre, transparaît en réalité, à travers un nuage de fumée, une remise en question concrète de celui-ci par une approche détournée et empirique.
4. Comment progresser dans le débat ?
Avec Ferdinand, nous avons commencé par souligner l’importance de ce débat. Pour Ferdinand, celui-ci consiste en une confrontation de théories et d’affirmations. Ainsi, il le souligne dans sa contribution sur l’analyse de l’émergence de la Chine : « ma thèse est l’opposée. Les cercles dirigeants de ce pays utilisent la crise pandémique pour restructurer son économie, son armée, son empire ». Or, Ferdinand rappelle, au début de son texte, qu’un débat au sein du CCI doit se développer avec méthode. Rappelons en quoi consiste la conception marxiste du débat :
« Contrairement au courant bordiguiste, le CCI n’a jamais considéré le marxisme comme une « doctrine invariante », mais bien comme une pensée vivante pour laquelle chaque événement historique important est l’occasion d’un enrichissement. En effet, de tels événements permettent, soit de confirmer le cadre et les analyses développés antérieurement, venant ainsi les conforter, soit de mettre en évidence la caducité de certains d’entre eux, imposant un effort de réflexion afin d’élargir le champ d’application des schémas valables auparavant mais désormais dépassés, ou bien, carrément, d’en élaborer de nouveaux, aptes à rendre compte de la nouvelle réalité. Il revient aux organisations et aux militants révolutionnaires la responsabilité spécifique et fondamentale d’accomplir cet effort de réflexion en ayant bien soin, à l’image de nos aînés comme Lénine, Rosa Luxemburg, la Fraction Italienne de la Gauche Communiste Internationale (Bilan), la Gauche Communiste de France, etc., d’avancer à la fois avec prudence et audace :
– en s’appuyant de façon ferme sur les acquis de base du marxisme ;
– en examinant la réalité sans œillères et en développant la pensée sans « aucun interdit non plus qu’aucun ostracisme » (Bilan).(« Texte d’orientation Militarisme et décomposition [396] », 1990, Revue internationale n° 64).
Bref, un débat ne consiste pas simplement en une libre « confrontation d’arguments fondés sur des faits », d’une libre opposition d’« hypothèses », d’une juxtaposition de « théories », « d’opinions » avancées par une « majorité » et une « minorité » comme le camarade le laisse transparaître à diverses occasions (« confrontation d’arguments fondés sur des faits » ; « il n’y a aucun élément en faveur de la thèse selon laquelle le prolétariat menace le régime de Xi Jinping […], ma thèse est l’opposée » ; « nous devons examiner la théorie qui sous-tend la position majoritaire et donc la présente Résolution »). Le point de départ d’un débat est avant tout le cadre partagé par l’organisation, adopté et précisé par les différents rapports de ses congrès internationaux.
En conséquence, l’approche du CCI n’est nullement dogmatique mais applique simplement la méthode marxiste lorsqu’elle confronte des éléments nouveaux au cadre partagé, communément acquis sur la base des débats passés dans l’histoire du mouvement ouvrier, afin d’évaluer en quoi ces éléments nouveaux confirment ou au contraire remettent en question le cadre d’analyse acquis. Par contre, derrière l’approche formellement systématique de Ferdinand, qui présente point par point ses commentaires critiques à la résolution sur la situation internationale, adoptée par le CCI lors de son dernier congrès international, se cache la confusion d’une démarche qui vise à voiler le fait que le camarade tend en réalité à remettre en question le cadre en partant d’une autre logique implicite.
R. Havanais, novembre 2022.
1« Explication des amendements rejetés du camarade Steinklopfer [663] », « Réponse au camarade Steinklopfer, août 2022 [682] ».
2En réalité, l’endettement ne crée nullement un véritable « marché » mais consiste à injecter des sommes toujours plus importantes dans l’économie en acompte de la production attendue des années à venir. Dans ce sens, la dette représente un poids qui pèse de plus en plus lourdement sur l’économie. Ainsi, le niveau d’endettement de la Chine est gigantesque (300 % du PIB en 2019).
Vie du CCI:
- Débat [670]
Rubrique:
Bulletin de discussion de groupes de la Gauche communiste - Printemps 2023
| Fichier attaché | Taille |
|---|---|
| 1.7 Mo |
- 331 lectures
Vie du CCI:
- Débat [670]
- Correspondance avec d'autres groupes [250]
Courants politiques:
- Gauche Communiste [163]
Rubrique:
Une "conférence" du "communisme de gauche" à Bruxelles?... Un leurre pour qui veut s’engager dans le combat révolutionnaire!
- 323 lectures
En juillet dernier, l’information était divulguée que, fin mai 2023, s’était tenue à Bruxelles, à l’initiative du groupe Perspective Internationaliste et du Forum pour la Gauche Communiste Internationaliste ‘Controverses’1, une « Conférence » réunissant une petite vingtaine de participants, individus ou représentants de groupes politiques faisant partie selon les organisateurs de la « Gauche internationaliste » ou encore du « communisme de gauche ». Cette réunion s’est tenue de manière quasi clandestine/ secrète, sur la base d’invitations confidentielles et d’une sélection des participants par les organisateurs « strictement pour des raisons financières » (la ficelle est un peu grosse). Voilà qui ressemble fort à une réunion de conjurés ; mais alors, une conjuration contre qui et dans quel but ?
Dès sa fondation et dans le prolongement de la politique de la Gauche communiste, le CCI a toujours prôné avec acharnement la discussion entre groupes révolutionnaires en vue d’une confrontation et clarification de leurs positions ou de prises de positions communes face au développement de la lutte de classe : « Avec ses moyens encore modestes, le CCI s’est attelé à la tâche longue et difficile du regroupement des révolutionnaires à l’échelle mondiale autour d’un programme clair et cohérent. Tournant le dos au monolithisme des sectes, il appelle les communistes de tous les pays à prendre conscience des responsabilités immenses qui sont les leurs, à abandonner les fausses querelles qui les opposent, à surmonter les divisions factices que le vieux monde fait peser sur eux […]. Fraction la plus consciente de la classe, les communistes se doivent de lui montrer son chemin en faisant leur le mot d’ordre : REVOLUTIONNAIRES DE TOUS LES PAYS, UNISSEZ-VOUS ! » (2)
La constitution même du CCI, en particulier à partir d’une proposition du groupe Internationalism (États-Unis) en 1972 de mettre en place une correspondance internationale, a été le produit d’un long processus de confrontation politique ouverte entre divers groupes autour des questions centrales pour le développement de la lutte prolétarienne. Par la suite, le rôle moteur du CCI dans l’organisation et la tenue des conférences des groupes de la Gauche communiste, convoquées par le groupe Battaglia Comunista dans les années 1978-1980 ou récemment dans la publication d’une « Déclaration commune de groupes de la Gauche communiste internationale sur la guerre en Ukraine » en 2022, témoignent de l’importance que le CCI accorde à la discussion entre révolutionnaires.
Cependant, pour le CCI, il a toujours été fondamental que ces discussions se développent de manière publique, à partir d’une base politique commune claire de positions de classe entre les organisations invitées et d’objectifs annoncés bien établis, afin de contribuer au développement de la conscience de classe : « La vie des groupes révolutionnaires, leurs discussions et leurs désaccords font partie du processus de prise de conscience qui se développe au sein de la classe ouvrière ; c’est pourquoi, nous sommes radicalement contre toute politique de “discussions cachées” ou d’“accords secrets” ». (3)
Cette rencontre bruxelloise non seulement a été organisée « en cachette », mais ne manifeste de plus pas la moindre ambition militante. S’il y avait une « convergence d’objectifs » (dixit les organisateurs) entre les participants, ce n’était sûrement pas celui de prendre position en tant que militants révolutionnaires par rapports aux défis cruciaux auxquels la classe ouvrière est confrontée : aucune déclaration commune de la part de ces prétendus « internationalistes » pour prendre position sur un évènement historique majeur comme la guerre en Ukraine, sur la destruction et la crise du climat ou la déstabilisation économique. La bourgeoisie, lors du sommet de Davos début 2023, a été plus claire et explicite qu’eux ! Aucune prise de position non plus sur la vague de luttes récente et ses perspectives… Comment des éléments qui se proclament « communistes » peuvent-ils rester silencieux sur les enjeux du moment ? Pour le CCI, la préoccupation militante est une composante incontournable d’une conférence de communistes, dans la mesure où celle-ci cherche toujours à dégager une plus grande compréhension de la situation mondiale, de la crise dans laquelle est plongé le capitalisme mondial et ses perspectives du point de vue de classe du prolétariat, ainsi que les tâches qui en découlent pour les groupes révolutionnaires.
Et qu’en est-il de la dynamique des discussions ? On nous apprend que les participants se sont réunis « pour parler et s’écouter » et qu’ils « ont été exposés à des idées différentes ». Cependant, aucun texte conjoint n’a été publié avant la conférence pour annoncer et préparer ses objectifs ou après pour présenter le fruit des travaux de celle-ci. Or, pour les révolutionnaires, l’approfondissement des positions est un processus vivant qui implique une discussion franche des positions et la confrontation politique des désaccords, dans la mesure où cette dynamique fait partie du processus de prise de conscience qui se développe au sein de la classe ouvrière. La simple juxtaposition d’analyses clinquantes lors de la rencontre de Bruxelles, tout comme le fait d’avoir consciemment évité toute confrontation des positions, révèlent qu’elle n’était qu’une foire aux positions, un marché aux palabres où chacun cultive son dada, un de ces colloques académiques de singes savants, se gargarisant de « théorie ». Bref, elle se situait à l’opposé de la tradition de la confrontation politique revendiquée par la Gauche communiste dans le but de clarifier les positions politiques et les enjeux de la lutte de classe.
En réalité, une confrontation politique fructueuse n’est possible que si les bases politiques de la rencontre sont cohérentes et claires. Pour le CCI, s’il y a bien « la nécessité fondamentale du travail de regroupement, il met en garde aussi contre toute précipitation. Il faut exclure tout regroupement sur des bases sentimentales et insister sur l’indispensable cohérence des positions programmatiques comme condition première du regroupement ». (4) Or, la base commune de la réunion, définie vaguement comme « une résistance, un questionnement critique permanent fondamental du Mode de Production Capitaliste », ne peut qu’engendrer la plus grande confusion et un désaccord des plus profonds sur le cadre d’appréhension pour déterminer la situation dans laquelle se trouve le capitalisme (en déclin ou pas ? Et ceci depuis quand ?), une question centrale pour défendre des orientations pour le combat prolétarien, ainsi que sur la situation et les potentialités de la classe ouvrière et surtout sur son mode d’organisation. Concernant la dernière question, l’importance des révolutionnaires, de leur rôle et de leur organisation a d’ailleurs été totalement escamotée lors de cette réunion.
Pourtant, en y regardant de plus près, il y a bien une base commune évidente entre la plupart des participants, que ceux-ci préfèrent sans doute garder dans l’ombre : c’est la conviction que le marxisme et les acquis des combats de la Gauche communiste depuis cent ans sont obsolètes et doivent être « complétés », voire « dépassés » par le recours à différentes théories anarcho-conseillistes, modernistes ou écologistes radicales. C’est bien pour cela qu’ils se nomment « pro-révolutionnaires », en se voyant comme une sorte d’ « amicale pour la propagation de la révolution » et non plus comme des militants et organisations produits du combat historique de la classe ouvrière. En conséquence, leur objectif non avoué mais réel est de jeter à la poubelle les leçons des dernières 55 années de luttes ouvrières et les résultats de cent ans de combats de la Gauche communiste internationaliste, de remettre en question les acquis organisationnels de celle-ci : la conception militante de l’organisation politique communiste comme produit du combat historique du prolétariat et comme avant-garde politique dans la lutte au profit d’une vision d’un cercle d’intellectuels réfléchissant au futur de l’humanité et rêvant d’avoir un impact révolutionnaire sur celui-ci.
Bref, cette réunion constituait bien une « conjuration » visant à discréditer et à dévaloriser les positions et les combats de la Gauche communiste internationaliste, à remplacer ses acquis politiques et organisationnels « obsolètes » par la fumisterie théorique et le chacun pour soi organisationnel d’un soi-disant pôle « pro-révolutionnaire ». Dans la perspective d’un tel « révisionnisme » destructeur, ce n’est nullement à cause d’un oubli ou par « manque de place » ou encore « de financement », comme ils le suggèrent, que les promoteurs n’ont pas invité le CCI à cette conférence. Bien au contraire, c’est délibérément, de manière pleinement consciente : le but était d’éviter la confrontation politique que le CCI aurait forcément recherché à travers la dénonciation de la supercherie, dans la mesure où l’objectif prioritaire de cette conférence « Potemkine », celui sur lequel l’essentiel des participants se retrouvent pleinement, ce n’est pas de clarifier et d’approfondir les positions, mais au contraire de mettre en avant un communisme de gauche factice, de déployer un leurre aguichant servant avant tout à égarer les éléments en recherche d’une perspective révolutionnaire et à participer ainsi à la mise en place d’un « cordon sanitaire » afin d’éviter qu’ils rejoignent les positions de la Gauche communiste et particulièrement du CCI. Cette supercherie est à l’opposé d’un instrument pour le combat prolétarien, c’est un barrage visant à empêcher le développement et le renforcement des avant-gardes révolutionnaires.
CCI, 15 septembre 2023
2Manifeste du CCI [686], janvier 1976
3« Rencontre internationale convoquée par le PCI-Battaglia Comunista [687] », Revue internationale n° 10 (1977).
4Ibid.
Rubrique:
Émeutes en France: “Le Prolétaire” a-t-il compris ce qu’est la lutte de classe? (Non)
- 253 lectures
Dans son article « Les réactions aux émeutes : Entre condamnations brutales et “compréhensions” hypocrites [688] », Le Prolétaire, journal du Parti Communiste International (PCI-Le Prolétaire) croit déceler dans les positions du CCI à l’égard des émeutes en France pire qu’une « hypocrisie » : le CCI serait carrément à la remorque de l’organisation bourgeoise Lutte Ouvrière et des garde-chiourmes syndicaux. En adversaire de la violence de classe, « le CCI se met ainsi du côté d’un mouvement bien ordonné, pacifique et contrôlé par le collaborationnisme syndical ».
Quelle bévue le CCI a-t-il pu commettre pour mériter une telle sentence ? Il a osé exprimer ce que Le Prolétaire qualifie de « condamnation des émeutes », cette « révolte des jeunes prolétaires » animée par « la haine contre l’ordre établi nécessaire à la lutte révolutionnaire ».
Le miroir aux alouettes du “Prolétaire”
Mais Le Prolétaire a des arguments, et pas des moindres ! Il croit nous clouer le bec en balançant doctement un extrait de l’Adresse du Comité central à la Ligue des communistes [689] : « Bien loin de s’opposer aux prétendus excès, aux exemples de vengeance populaire contre des individus haïs ou des édifices publics auxquels ne se rattachent que des souvenirs odieux, il faut non seulement tolérer ces exemples, mais encore en assumer soi-même la direction ».
Nous aurions sans doute été foudroyés par la honte si Le Prolétaire ne s’était pas piteusement pris les pieds dans le tapis. Dans ce texte, Marx et Engels parlent, en effet, de l’attitude du prolétariat face… aux révolutions bourgeoises du XIXᵉ siècle contre le féodalisme ! La « vengeance populaire contre des individus haïs ou des édifices publics » qu’il fallait « tolérer » consistait, en l’occurrence, à « mettre à exécution [les] présentes phrases terroristes » de la petite-bourgeoisie démocratique dans le contexte de la lutte de la bourgeoisie allemande contre la monarchie et ses palais ! À l’époque de l’ascendance du capitalisme, alors que les conditions historiques n’étaient absolument pas réunies pour le développement de la lutte révolutionnaire du prolétariat, ce texte ne cesse d’ailleurs d’insister sur la nécessité pour le prolétariat de « s’organiser » par lui-même et de « centraliser » le plus possible son combat. Tout l’inverse de la passion du Prolétaire pour les émeutes !
Il ne s’agit pas seulement d’une gaffe un peu ridicule, mais d’une preuve supplémentaire (s’il en fallait encore une) que le PCI ne comprend pas ce qu’est la lutte de classe et qu’il est incapable de l’inscrire dans un cadre historique : il pioche dans les vieux textes du mouvement ouvrier ce qui semble s’appliquer plus ou moins à la situation présente sans se poser la moindre question. Le rapport du PCI à la méthode marxiste, ce n’est pas la démarche historique de Marx et Engels, de Lénine et de Luxemburg, ni celle de la Gauche communiste d’Italie, c’est faire l’exégèse maladroite d’un texte qui paraît, de loin, confirmer des impressions empiriques ! Il suffit donc au PCI de jauger les émeutes au doigt mouillé, de constater que des prolétaires y participent pour tomber en pâmoison devant une flambée de violences urbaines qui ne se situe absolument pas sur le terrain de la lutte de classe, et y voir un lien avec les combats du prolétariat à l’époque des révolutions bourgeoises.
“Le Prolétaire”, une boussole qui montre le Sud
Avec un ersatz de démarche marxiste en bandoulière, Le Prolétaire analyse les émeutes sur la base d’une série de critères abstraitement déterminée par l’auto-proclamé « Parti » et applicable à chaque lutte quelle que soit la situation : la composition sociologique d’un mouvement, la perception à vue de nez d’une « haine contre l’ordre établi », le niveau d’affrontement suffisant avec les « bureaucraties syndicales », la clarté jugée plus ou moins satisfaisante des ouvriers vis-à-vis « de la révolution et des voies qui y conduisent »… En guise de méthode, le PCI nous sert donc une savante recette de cuisine composée d’ingrédients de son choix dans laquelle chaque lutte ou expression de colère sont analysées pour elles-mêmes, sans relation avec la situation historique, la dynamique générale du combat ouvrier et le rapport de force entre les classes.
Cette démarche conduit finalement Le Prolétaire a des positions clairement opportunistes. Il affirme ainsi sans rire que « la violence des émeutiers était tout sauf aveugle ; […] leurs cibles ont été prioritairement des commissariats et des postes de police, des prisons et des institutions étatiques, des mairies, etc., avant même le pillage de grandes surfaces et de magasins divers ». C’est vraiment cela commencer à se confronter à l’État bourgeois, camarades ? Le Prolétaire a-t-il exactement la même vision de la lutte de classe que le pire des black-blocs ? C’est d’autant plus navrant que les émeutes ne sont même pas comparables à l’idéologie des black-blocs qui, eux, s’imaginent vraiment s’attaquer aux symboles du capitalisme en détruisant les vitrines des banques. Lors des émeutes, les jeunes balançaient des feux d’artifice sur des commissariats comme ils pillaient les supermarchés, ils brûlaient les mairies comme la bagnole du voisin, sans autre aiguillon que leur rage et leur impuissance.
“Le Prolétaire” perdu dans le brouillard de l’histoire
À notre tour, donc, d’asséner au PCI un « sage précepte », mais de Lénine cette fois : « “Notre doctrine n’est pas un dogme, mais un guide pour l’action”, ont toujours dit Marx et Engels, se moquant à juste titre de la méthode qui consiste à apprendre par cœur et à répéter telles quelles des “formules” capables tout au plus d’indiquer les objectifs généraux, nécessairement modifiés par la situation économique et politique concrète à chaque phase particulière de l’histoire ». Contrairement à la démarche empirique pour le moins frivole du Prolétaire, le mouvement ouvrier a toujours insisté sur l’importance d’analyser avec précision et méthode le contexte dans lequel se déroule une lutte pour en saisir la signification réelle et ses perspectives. La dynamique internationale de la lutte de classe, quelle que soit la radicalité ou la massivité apparente de telle ou telle expression de colère, est évidemment un point de référence essentiel. Sans un cadre d’analyse rigoureux, le PCI est condamné à tâtonner dans le brouillard de l’histoire.
C’est ainsi que Trotsky, incapable comme le PCI de saisir l’importance du contexte historique, pensait que « la révolution française [avait] commencé » avec les immenses grèves de 1936 en France. Contrairement à la grande clarté de la Gauche italienne, il contribuait par-là à désorienter bien des militants restés fidèles à la cause du prolétariat.
En réalité, après la défaite de la vague révolutionnaire de 1917-1923 et le triomphe de la contre-révolution stalinienne, le prolétariat subissait un profond recul de sa conscience qui allait le mener à la Guerre mondiale derrière l’idéologie bourgeoise de l’antifascisme. Ce seul exemple devrait suffire à démontrer que la combativité et la massivité ne constituent pas en elles-mêmes des critères suffisants.
Inversement, lorsque le mouvement de Mai 68 éclatait, les conditions historiques avaient radicalement changé par rapport à 1936. Ce mouvement était marqué par le retour de la crise, après la période de reconstruction, et le surgissement d’une génération de jeunes ouvriers qui n’avait pas subi de plein fouet les pires atrocités de la contre-révolution. Ce qui fût alors la plus grande grève de l’histoire et qui a été le point de départ de plusieurs vagues de luttes de par le monde pendant deux décennies, avait été précédé par de multiples petites grèves, insignifiantes en apparence et largement encadrées par les syndicats, mais qui revêtaient en réalité une importance historique.
Un “sage précepte” du CCI au “Prolétaire”
Les conditions de la lutte de classe ne sont donc pas toujours tout à fait les mêmes à chaque étape de l’évolution historique. Voyons brièvement comment le CCI analyse la situation actuelle et quelles implications il en tire pour comprendre la lutte de classe et les violences urbaines que nous venons de connaître.
Dans le prolongement de Mai 68, le rapport de force favorable au prolétariat ouvrait la voie à une dynamique vers des affrontements décisifs avec la bourgeoisie. Mais dans les années 1980, bien que la combativité de la classe ouvrière a empêché la bourgeoisie de mettre en avant sa seule « réponse » à la crise historique du capitalisme (la guerre mondiale), l’incapacité du prolétariat à sortir du carcan syndical et des mystifications démocratiques ne lui ont pas, non plus, permis de porter plus en avant la perspective révolutionnaire. Ceci a abouti à une situation d’impasse marquée par l’effondrement du bloc de l’Est et toute la campagne sur la « mort du communisme » et le « triomphe de la démocratie ». C’est ce que le CCI a identifié comme la phase ultime de la décadence du capitalisme, sa décomposition, qui n’a cessé d’attiser à l’extrême des phénomènes caractéristiques du pourrissement de la société : accroissement des catastrophes en tout genre, du chaos et du chacun pour soi sur la scène impérialiste, sur le plan social et politique, montée en puissance des idéologies les plus irrationnelles et mortifères, du désespoir, du « no futur », etc.
Cette situation nouvelle a impliqué un recul important des luttes de la classe ouvrière pendant plus de trente ans, malgré des expressions sporadiques de combativité (CPE, Indignés, Occupy…). Le prolétariat britannique, pourtant l’un des plus expérimentés et combatifs de l’histoire, représentait la quintessence de ce recul, puisque jusqu’en 2022, il est resté largement passif et résigné face aux attaques extrêmement brutales portées par la bourgeoisie.
L’accélération récente de la décomposition, marquée par la pandémie de Covid-19 et, plus encore, par la guerre en Ukraine, n’ont fait qu’amplifier la crise profonde dans laquelle s’enfonce le capitalisme. Tous les effets délétères de la décomposition se sont encore plus approfondis, s’alimentant les uns les autres dans une sorte de « tourbillon » incontrôlable.
Cependant, alors que la crise devient de plus en plus insoutenable, le prolétariat commence à réagir : d’abord en Grande-Bretagne où, pour la première fois depuis plus de trente ans (!), le prolétariat a crié son raz-le-bol, mois après mois, à travers d’innombrables grèves, puis, presque simultanément, dans de nombreux pays, notamment en France, en Allemagne, en Espagne, en Hollande… mais aussi au Canada, en Corée et, aujourd’hui, aux États-Unis.
À l’occasion de la réforme des retraites en France, des millions d’ouvriers se sont retrouvés dans les rues, affirmant à chaque manifestation la nécessité de lutter tous ensemble, commençant, de façon embryonnaire, à faire le lien avec les luttes des autres pays, à se remémorer ses expériences (notamment le CPE et Mai 68) et s’interroger sur les moyens de la lutte. Malgré le poids du corporatisme et ses immenses difficultés pour affronter les syndicats et tous les amortisseurs sociaux et idéologiques que sécrète la bourgeoisie, le prolétariat commence à se reconnaître comme une classe, à lutter massivement à l’échelle internationale, à exprimer des réflexes de solidarité et de combativité que nous n’avions observé que très marginalement depuis des décennies. C’est une véritable rupture avec la situation précédente de passivité à laquelle nous assistons ! Mais l’absence de cadre d’analyse pousse Le Prolétaire à ne voir dans cette rupture que la « défaite » de vulgaires « mobilisations moutonnières ».
La période actuelle voit donc à la fois la décomposition s’accélérer brutalement, avec tout ce qu’elle charrie de désespoir et d’absence de perspective, mais aussi le retour de la combativité ouvrière. Cela signifie que le développement de la lutte de classe ouvrière va nécessairement se heurter à des expressions de désespoirs et d’impuissance en son sein, qui demeureront des fardeaux pour le prolétariat et que la bourgeoisie ne va cesser de promouvoir. Les émeutes et les mouvements interclassistes comme les « gilets jaunes » en sont des illustrations caricaturales !
Les émeutes n’ont, en effet, rien apporté d’autres qu’étaler au grand jour l’impuissance totale d’une jeunesse désespérée : il n’a pas fallu une semaine à l’État pour rétabli l’ordre et réprimer férocement les émeutiers. Surtout, les violences urbaines ont été un véritable frein au développement de la lutte de classe. En divisant pour rien les ouvriers, elles ont donné à la bourgeoisie une opportunité pour tenter de saper la combativité et l’unité qui commencent à émerger, à travers une campagne dont les derniers échos en date sont l’ignoble propagande raciste du gouvernement sur « l’interdiction de l’abaya à l’école ».
Une large partie de la gauche du capital a également profité de la situation pour pourrir la réflexion en cours du prolétariat sur les moyens de la lutte : « vous désiriez plus de radicalité durant la lutte contre la réforme des retraites : voilà un exemple qui fait trembler la bourgeoisie ! », « vous souhaitiez une plus grande unité des travailleurs : vive la convergence des gilets jaunes et des jeunes de banlieue ! »…
L’irresponsabilité du “Prolétaire”
Et le PCI, victime de sa propre confusion, de son incapacité à comprendre la lutte de classe, s’est finalement placé dans le sillage des gauchistes.
Quand la classe ouvrière a tant besoin de développer son unité, Le Prolétaire chante les louanges de violences urbaines qui ont été une formidable occasion pour la bourgeoisie de diviser les prolétaires, non seulement en France, mais aussi à l’échelle internationale où la presse a fait ses gorges chaudes des émeutes pour mieux discréditer la violence de classe et les manifestations massives ! Quand la classe ouvrière a tant besoin de développer sa conscience, son organisation et ses méthodes de lutte, Le Prolétaire présente des violences aveugles, où se mêlent destructions de locaux municipaux et pillage de supermarchés, comme le sommet de la lutte de classe ! Quand la classe ouvrière a tant besoin de retrouver sa confiance en elle-même, Le Prolétaire jette, d’un air dégoûté, un mouchoir sur ses luttes « moutonnières » et présente ses pas en avant comme des « défaites » !
La légèreté avec laquelle Le Prolétaire examine les émeutes n’est donc pas seulement inconsistante, elle est surtout irresponsable. Car le PCI, contrairement aux partis trotskistes et à toute l’extrême-gauche du capital, est une organisation de la Gauche communiste. Malgré tous nos désaccords, le PCI appartient au camp du prolétariat et a, de ce fait, une responsabilité vis-à-vis du mouvement ouvrier et de la classe ouvrière. Plutôt que de confronter ses positions sérieusement avec les autres organisations du milieu politique prolétarien, plutôt que faire preuve du minimum de solidarité et de fraternité qui devrait l’animer à l’égard de ce même milieu, il met sur un pied d’égalité une officine bourgeoise telle que Lutte Ouvrière et le CCI, au milieu d’un article indigent, sans se soucier le moins du monde des responsabilités politiques qui lui incombent.
Cette irresponsabilité, le PCI l’exprime également à l’égard des ouvriers qui se rapprochent des positions de la classe ouvrière dont il contribue à entretenir la confusion à force de contorsions opportunistes et de renoncement à faire vivre le précieux héritage du mouvement ouvrier : la méthode marxiste.
EG, 20 septembre 2023
Vie du CCI:
- Polémique [246]
Récent et en cours:
- Emeutes [690]
Courants politiques:
- Gauche Communiste [163]
- PCI (Le prolétaire) [691]
Rubrique:
Face au tourbillon de la décomposition capitaliste, seule la lutte de classe offre une perspective à l'humanité
- 262 lectures
La nouvelle flambée de barbarie en Israël et Palestine nous oblige à changer le thème de cette réunion publique qui devait, initialement, se concentrer sur la crise environnementale.
Après la guerre en Ukraine, ce nouveau conflit confirme une fois de plus que la guerre joue un rôle central dans ce que nous avons appelé « l’effet tourbillon », c’est-à-dire l’interaction accélérée de toutes les expressions de la décomposition capitaliste, menaçant de plus en plus la survie même de l’humanité. Il est vital pour les révolutionnaires de mettre en avant une position internationaliste claire contre toutes les confrontations impérialistes qui se répandent à travers le monde.
Il ne s’agit toutefois pas de sous-estimer que la destruction capitaliste de la nature fait partie intégrante de cette menace. En effet, l’intensification de la guerre et du militarisme ne peut qu’aggraver la crise environnementale, tout comme l’approfondissement de celle-ci ne peut qu’alimenter des rivalités militaires de plus en plus chaotiques.
Cela ne signifie pas non plus que tout espoir en l’avenir est perdu. Le retour de la lutte de classe qui a commencé en Grande-Bretagne, il y a plus d’un an, et qui s’impose maintenant aux États-Unis, montre que la classe ouvrière n’est pas vaincue et que sa résistance à l’exploitation contient les germes du renversement révolutionnaire de l’ordre mondial actuel.
Toutes ces questions seront débattues lors de nos prochaines réunions publiques.
Le CCI organise ces réunions publiques dans plusieurs villes :
Paris : 21 octobre 2023 de 15h00 à 18h00, au CICP, 21 ter rue Voltaire (métro « Rue des Boulets »).
Marseille : 21 octobre 2023 de 15h00 à 18h00, Local Mille Babords, 61 Rue Consolat.
Lille : 28 octobre 2023 de 15h00 à 18h00, Café « Les Sarrasins », 52 rue des Sarrasins (métro « Gambetta »).
Nantes : 4 novembre 2023, à partir de 15H00, Salle de la Fraternité, 3 rue de l'Amiral Duchaffault, 44100 Nantes, (Station de tramway "Duchaffault", ligne 1).
Toulouse : 4 novembre 2023 de 14h00 à 17h00, Maison de la citoyenneté, 5 rue Paul Mériel (métro « Jean Jaurès »)
Lyon : 4 novembre 2023. Pour des raisons indépendantes de notre volonté, la réunion publique prévue dans cette ville ne pourra pas se tenir sur place. Une réunion publique en ligne est organisée à partir de 14H00. Les personnes souhaitant y participer peuvent adresser un message sur notre adresse électronique ([email protected] [213]) ou dans la rubrique “nous contacter [214]” de notre site internet. Les modalités techniques pour se connecter à la réunion publique seront communiquées ultérieurement.
Vie du CCI:
- Réunions publiques [219]
Récent et en cours:
- environnement [289]
Rubrique:
ICConline - octobre 2023
- 58 lectures
Chine: la crise économique exacerbe les tensions sociales et politiques
- 85 lectures
La Chine subit la plus grande crise économique de ses dernières 50 années et ceci dans un contexte de pression économique et militaire intense de la part des États-Unis : « La Chine est prise dans la dynamique mondiale de la crise, son système financier étant menacé par l’éclatement de la bulle immobilière. Le déclin de son partenaire russe et la rupture des « routes de la soie » vers l’Europe en raison de conflits armés ou du chaos environnemental causent des dégâts considérables. La forte pression des États-Unis accroît encore ses difficultés économiques. Et face à ses problèmes économiques, sanitaires, écologiques et sociaux, la faiblesse congénitale de sa structure étatique stalinienne constitue un désavantage majeur ».[1]
Dans un tel contexte, la plongée dans le rouge des principaux indicateurs économiques du pays ne peut qu’inquiéter au plus haut point l’État stalinien et son parti-État. La croissance économique est au plus bas depuis 45 ans (moins de 5%), les exportations régressent (-8,3% sur un an) et la consommation intérieure est anémique. Tandis que la demande intérieure est dans une spirale déflationniste, la dette du gouvernement - en particulier des autorités régionales - et des entreprises est colossale. La dette publique et privée chinoise, qui dépassait 250 % du PIB en 2021 atteindrait les 300 % du PIB à la mi-2023 (selon la Banque des Règlements Internationaux (BRI) de Bâle, Suisse). L’ampleur catastrophique des problèmes est particulièrement visible dans le secteur de l’immobilier, qui représente près de 30% du PIB national chinois : après la faillite d’Evergrande et le défaut de paiement annoncé pour Country Garden, qui compte 4 fois plus de projets que la première, il y aurait 648 millions de m² de logements invendus en date de fin août dernier, l’équivalent de 7,2 millions de logements[2] . En conséquence, le système bancaire et de crédit est sous pression face à la crise de confiance des consommateurs et à l’attitude attentiste des milieux d’affaires qui se gardent d’investir en attendant de voir la suite des événements.
Plus préoccupant encore pour la bourgeoisie chinoise est la fuite des capitaux, la chute des investissements étrangers, au plus bas depuis 25ans, que Pékin tente d’enrayer par des campagnes massives envers les investisseurs. Cependant, la réélection de Xi Jinping et le traitement qu'il a réservé aux « entrepreneurs privés chinois » tel Jack Ma ( Grupo Ant et Alibabá), dont beaucoup ont dû fuir au Japon, n'inspirent pas confiance. La fuite des capitaux vers d’autres pays comme le Vietnam, l’Indonésie, l’Inde ou le Mexique n’est d’ailleurs pas seulement l’expression du manque de « garanties » en Chine ; les coûts de transport et les salaires y ont grimpé en flèche, de sorte qu’aujourd’hui, l’Inde et, dans une moindre mesure, le Vietnam et d’autres pays de l’Indopacifique concurrencent la Chine : « Tout le monde souhaite soit vendre ses opérations en Chine ou, s’ils produisent en Chine, ils sont à la recherche d’endroits alternatifs pour le faire. [Cette situation] est dramatiquement différente, comparé à il y a seulement cinq ans »[3]
Bref, loin de constituer, comme en 2008, la locomotive qui relance l’économie mondiale, la Chine connaît une crise économique profonde qui menace d'entraîner le reste du monde dans une accentuation des soubresauts économiques et dont l’impact social se fait de plus en plus sentir dans le pays même. L’effondrement de l’immobilier entraîne des manifestations de petits épargnants, qui voient leurs économies de toute une vie s’envoler en fumée. La situation de l’emploi des jeunes est tout aussi préoccupante : 21,3% des jeunes Chinois sont au chômage, selon les derniers chiffres officiels (17 juillet 2023). En réalité, selon des économistes locaux, le taux de chômage des 16-24 ans serait deux fois plus élevé (46,5% au lieu de 19,7% en mars !), dans la mesure où près de 20% des jeunes urbains sont des « tangping » (litt. des « restés allongés »), qui ont décidé de s’extraire délibérément de la « compétition socio-économique », vu la saturation désespérée du marché de l’emploi, au point que l'État chinois manipule la publication de chiffres par peur d’un accès de panique auprès des investisseurs, ce qui aggraverait encore la crise actuelle et menacerait même la stabilité sociale et politique. Le mécontentement social gronde en effet après les années d’enfermement inhumain lié à la politique « zéro Covid » et aux nouvelles mesures de régulation des soins de santé. La déstabilisation économique et sociale exacerbe aussi les luttes des travailleurs contre les arriérés de salaire, les fermetures ou les délocalisations d’usines, qui mènent souvent à des confrontations violentes avec les services de sécurité des entreprises. Ces grèves et protestations se sont fortement multipliées en 2023, représentant le double du nombre enregistré en 2022[4] .
Cette détérioration de la situation économique et sociale provoque aussi des remous politiques de plus en plus visibles jusqu’au sommet de l’État, tels des absences remarquées de Xi lors de forums internationaux (forum économique des BRICS en Afrique du Sud, réunion du G20 en Inde) ou encore la « disparition » des ministres des affaires étrangères Qin Gang et de la défense Li Shangfu, de même que plusieurs généraux dirigeant la « Force des missiles » et le département du développement de l’équipement de l’armée chinoise. L’éviction de dirigeants proches de Xi et nommés par lui après le dernier Congrès du PCC pour des raisons de « conduite personnelle » ou de « corruption » souligne que Xi Jinping est de plus en plus personnellement pointé du doigt comme responsable, depuis en particulier sa politique catastrophique « zéro Covid » qui a provoqué des dégâts considérables sur les plans économique mais également social. Il aurait subi en août des critiques acerbes lors de la réunion d’été traditionnelle des caciques du régime dans la station balnéaire de Beidaihe où un bilan de l’état de la Chine est dressé. Des anciens dirigeants à la retraite lui auraient adressé des reproches d’une virulence jamais observée auparavant, ce qui semble indiquer que les confrontations entre « économistes » et « nationalistes » s’intensifient à nouveau face au danger de déstabilisation économique et sociale qui fait peur à ce régime de type stalinien. Une atmosphère délétère et des tensions extrêmes se développent au sein du PCC. Dans un tel climat de lutte de factions au sein du parti-État, l’avenir est incertain et Xi pourrait utiliser le levier de la fuite en avant dans un nationalisme exacerbé pour s’imposer, comme cela a souvent été le cas en Chine lorsque les problèmes intérieurs s’accumulent.
Le projet de « Grande Chine » de XI Jinping, qu’il espérait consolider d’ici 2050, semble aujourd’hui fortement menacé : les tendances actuelles indiquent que le pays ne deviendra pas la première puissance économique du monde dans un avenir prévisible. Confrontée à une crise économique et financière risquant de plonger le pays dans un chaos social généralisé, à une pression de plus en plus écrasante des États-Unis et à une opposition croissante au sein du parti, la politique de Xi sera marquée plus que jamais par l’imprévisible, mais également par un risque de décisions irrationnelles qui menacent d’entraîner le monde dans un tourbillon de chaos, de barbarie et d'affrontements militaires sans précédents.
09.10.23 / Fo & RH
[1] Résolution sur la situation internationale, pt 5. 25e Congrès du CCI, Revue internationale 170, 2023.
[2] Lire P.-A. Donnet, Chine : comment la folie des grandeurs mène l'économie à la ruine, Asiayst, 01.10.23)
[3] (un spécialiste britannique de la gestion de portefeuilles, cité dans P.-A. Donnet, Chine : la crise économique, prélude d'un hiver politique et social ? Asialyst, 07.09.23)
[4] Voir le China Labour Bulletin
Géographique:
- Chine [281]
Personnages:
- Xi Jinping [692]
- Jack Ma [693]
- Qin Gang [694]
- Li Shangfu [695]
Récent et en cours:
- Evergrande [696]
- Alibabá [697]
- tangping [698]
Rubrique:
Confrontation américano-chinoise : La dynamique du capitalisme en décomposition mène à toujours plus de guerres
- 73 lectures
Si la guerre en Ukraine retient l’attention des journaux du monde entier, il y a cependant toujours en arrière-fond la confrontation entre les deux puissances majeures d’aujourd’hui, les États-Unis et, face à eux, leur challenger principal, la Chine, qui s’intensifie de manière de plus en plus ouverte et violente. Au sein de la bourgeoisie américaine, il y a homogénéité entre ses factions principales sur le fait qu’il faut empêcher à tout prix la Chine de se renforcer en tant que puissance mondiale ambitionnant de détrôner les États-Unis : « La réaction des États-Unis face à leur propre déclin et à la montée en puissance de la Chine n'a pas été de se retirer des affaires mondiales, mais au contraire, ils ont lancé leur propre offensive visant à limiter les progrès de la Chine, depuis le « virage vers l'Est » d'Obama jusqu’à l'approche plus directement militaire de Biden, en passant par l’intensification de la guerre commerciale sous Trump (provocations autour de Taiwan, destruction de ballons espions chinois, formation d'AUKUS, nouvelle base américaine aux Philippines, etc.). L'objectif de cette offensive est d'ériger un mur de feu autour de la Chine, bloquant sa capacité à se développer en tant que puissance mondiale » (Résolution sur la situation internationale, pt 4. 25e Congrès du CCI, Revue internationale 170, 2023).
La bourgeoisie chinoise sous pression face à l’offensive US
Militairement, malgré un renforcement impressionnant de son armement depuis une dizaine d’années, la Chine est encore largement en infériorité par rapport à la puissance américaine et elle développe dès lors une stratégie à long terme visant à jeter les bases économiques globales de sa montée en puissance impérialiste. Bref, ce dont la Chine a besoin, c’est du temps et c’est précisément ce que l’Oncle Sam ne tient absolument pas à lui accorder.
Les États-Unis ont fortement affaibli l’« allié stratégique » de Pékin, la Russie, piégée par eux dans une guerre de plus en plus destructive en Ukraine. La Chine a fort bien compris le message d'avertissement des Américains et a réagi avec prudence, car elle ne veut pas subir des sanctions qui rendraient sa situation économique encore plus compliquée. L’extension du chaos guerrier et l’accumulation de dettes des États impliqués ont provoqué la stagnation, voire le blocage, de son projet impérialiste pharaonique, la Nouvelle Route de la Soie, ce qui est un autre facteur qui met la Chine en difficulté. D’autre part, la guerre commerciale, initiée sous l’administration Trump et accentuée par Biden, exerce une pression étouffante sur l’économie chinoise : rappelons l’interdiction imposée à Huawei d’utiliser les systèmes de Google et les droits de douane sur l'aluminium chinois, ou encore l’interdiction pour les investisseurs américains d'investir en Chine dans le développement et la production de microprocesseurs et la pression sur des états « alliés » pour ne pas exporter vers la Chine des machines pouvant servir à fabriquer des micropuces.
Sur le plan militaire, les États -Unis ont peaufiné le blocage des côtes chinoises et de ce fait accentué la pression sur la Chine. En août, un traité de défense mutuelle a été signé à Camp David entre le Japon, la Corée du Sud et les États-Unis. Biden a réitéré l’engagement des États-Unis à défendre militairement Taiwan en cas d’attaque chinoise et lui fournit massivement des armes. Enfin, l’attitude agressive de la Chine en mer de Chine a permis aux Américains de resserrer leurs liens avec les Philippines ou avec le Vietnam, en particulier à travers la visite de Biden à Hanoi en septembre pour proposer une « alliance stratégique » à un pays avec lequel les entreprises américaines de l'industrie militaire, telles Lockheed Martin et Boeing, ont déjà des liens économiques importants. Si on ajoute à ce dispositif les bases US sur les îles d’Okinawa et de Guam, il est évident que le dispositif américain limite de plus en plus étroitement les ambitions chinoises en direction des routes maritimes. Enfin, le QUAD (Japon, Inde, États-Unis et Australie), un groupe de « défense mutuelle » visant à faire de l’Indo-Pacifique un lieu de « paix et de prospérité » (sic !), a déclaré lors de sa récente réunion en mai à Hiroshima : « Nous nous opposons fermement à la déstabilisation ou aux actions unilatérales visant à modifier le statu quo par la force ou la coercition. ». S’il n’y a aucune mention de la Chine et de ses menaces contre Taiwan, le message est cependant sans ambigüités.
Les réactions tous azimuts de la bourgeoisie chinoise
Face à une telle situation, Pékin est obligée de réagir, mais le mélange hypocrite de provocations et de diplomatie des Américains (ils ont envoyé 13 délégations à Pékin au cours des 3 derniers mois dans le but de "négocier") amène la Chine à réagir dans différentes directions.
D’une part, ses actions militaires envers Taïwan deviennent de plus en plus menaçantes : la Chine multiplie des exercices militaires dans le détroit de Taiwan pour accréditer l’idée qu’une éventuelle invasion se prépare, et elle construit également des îles artificielles sur des récifs controversés de la mer de Chine pour y installer de nouvelles bases militaires dans le but en particulier de contrôler une zone où 60% du commerce naval mondial passe. Elle intensifie également la course aux armements pour renforcer son appareil militaire, en particulier sa flotte de guerre. Enfin, elle multiplie les déclarations martiales : ainsi, le ministre chinois de la Défense, Wei Fenghe, a déclaré : « Si quelqu'un ose séparer Taiwan de la Chine, nous n'hésiterons pas à nous battre. Nous nous battrons coûte que coûte et jusqu'au bout. C'est la seule option ».
Cette agressivité ne se manifeste d’ailleurs pas seulement envers les États-Unis mais également envers ses voisins : Pékin est aux prises avec l’Inde dans un conflit territorial qui mène régulièrement à des affrontements armés ; la réaction de la Chine face au déversement par le Japon d'eaux contaminées par les radiations dans l'océan Pacifique est un autre exemple de l'acrimonie dans les relations entre les deux nations, la première ayant interdit l'entrée des produits marins japonais sur son territoire, sachant que l'industrie de la pêche japonaise est très importante pour l'économie nippone. Sur le plan économique, la Chine a aussi pris des mesures de rétorsion envers les États-Unis, par exemple en décidant d'interdire, début septembre, l'usage des iPhones dans ses services publics. Si cela a fait perdre à Apple immédiatement 200 milliards de dollars en bourse, l'aspect irrationnel de la mesure apparaît toutefois à travers le fait que la Chine est le principal fabricant de ces téléphones portables et qu’il est possible à cause de la mesure qu'Apple soit amené licencier des travailleurs chinois.
D’autre part, la Chine s’est lancée dans une opération diplomatique de grande envergure visant à montrer qu’elle est une « force de paix » et que ce sont les Américains qui mènent une politique guerrière. Elle a été l’artisan de la réconciliation spectaculaire entre l’Iran et l’Arabie Saoudite et a même offert ses bons offices pour des négociations de paix entre la Russie et l’Ukraine. Lors de la récente réunion des BRICS en Afrique du Sud, Xi Jinping a poussé à l'expansion des BRICS en proposant 6 nouveaux membres et la création d'une monnaie commune ; si la dernière proposition s’est heurtée à l’hostilité de l’Inde, l'Arabie saoudite, l'Iran, les Émirats Arabes Unis, l’Égypte, l'Éthiopie et l'Argentine ont été intégrés comme nouveaux membres. Cette politique chinoise révèle son influence croissante au Moyen-Orient. En l'absence d'une capacité militaire capable de rivaliser avec les États-Unis, la Chine utilise surtout la « diplomatie des crédits financiers » pour gagner de l'influence dans le monde. Cependant, cette arme comporte de nombreux risques. Ainsi par exemple, la faillite du Sri Lanka empêche la Chine d’annuler la dette du Pakistan pour le moment, vu le risque d’extension du problème du remboursement.
L’absence de Xi Jinping à réunion du G20 à New Delhi en septembre constitue une première pour le président chinois qui assistait toujours aux réunions de ce groupe de pays et illustre bien le dilemme dans lequel se trouve la Chine : d’un côté, Xi a voulu montrer qu’il ne tient plus à reconnaître l’ordre mondial dicté par les États-Unis et découlant de la seconde guerre mondiale ; mais fondamentalement, son absence est un aveu de faiblesse face à l’agressivité américaine dans l’Indo-Pacifique, au renforcement des relations entre les États-Unis et l’Inde de Modi et à ses propres difficultés économiques et politiques.
Face à l’offensive américaine, la Chine manœuvre pour gagner du temps, mais les Américains ne sont pas disposés à le lui accorder. Les provocations américaines et leur politique d'enfermement s’accentuent visant à étrangler le dragon chinois, ce qui ne peut qu’accentuer l’imprévisibilité de la situation et le risque de réactions irrationnelles qui multiplieront les confrontations guerrières et intensifieront le chaos.
09.10.23 / Fo & RH
Géographique:
- Chine [281]
Personnages:
- Obama [699]
- Trump [700]
- Biden [395]
- Wei Fenghe [701]
- Xi_Jinping [702]
- Modi [703]
Rubrique:
En mémoire de notre camarade Miguel
- 100 lectures
Notre camarade Miguel nous a quittés. Né en 1944, il s'est révolté très jeune contre cette société de barbarie et d'exploitation qu'est le capitalisme. Il comprenait la nécessité de lutter pour une nouvelle société, mais en même temps, ce qui se passait en URSS, présentée comme la "patrie du socialisme", le faisait beaucoup douter de ce soi-disant "communisme". À cette époque, d'autres "alternatives" étaient en vogue. L'une d'entre elles était la Yougoslavie de Tito, un pays "non aligné"[1] offrant un "socialisme autogéré". Il y a émigré, étudié et travaillé, et s'est vite rendu compte qu'il n'y avait rien de socialiste dans ce pays, qu'il s'agissait d'une autre des nombreuses variantes du capitalisme d'État. De cette expérience décevante est née sa conviction qu'aucune des "Mecques du socialisme" (Russie, Yougoslavie, Albanie, Chine, Cuba, etc.) n'était du communisme ni même "en transition vers le communisme", mais qu'il s'agissait d'États capitalistes où l'exploitation régnait avec la même fureur que dans les pays officiellement capitalistes.
De retour en Espagne, il a travaillé dans une entreprise très importante, Standard Eléctrica. C'était un ouvrier conscient et combatif, qui participait activement aux nombreuses grèves qui secouaient alors l'Espagne, dans le cadre du renouveau historique du prolétariat dont l'expression la plus avancée fut la grande grève de mai 68 en France. C'était l'époque (1972-76) où la dictature franquiste était incapable de faire face à l'immense vague de luttes et où la bourgeoisie envisageait la fameuse "transition", pour passer de la dictature franquiste à la dictature démocratique, c'est-à-dire que l'État capitaliste abandonnait le franquisme et son catholicisme national comme des vieilleries inutiles et s'entourait d'armes démocratiques pour mieux affronter la classe ouvrière : syndicats "ouvriers", élections, "libertés"...
Rapidement, le camarade se forge une seconde conviction : les syndicats, tant le vieux syndicat vertical du franquisme que les "syndicats ouvriers" (CCOO, UGT et compagnie) sont des organes de l'État bourgeois, des serviteurs inconditionnels du capital, prêts à saboter les grèves, à diviser les travailleurs, à les détourner dans des voies sans issue. Membre de l'UGT, il finit par déchirer sa carte de membre après être intervenu dans une assemblée.
Cette période lui apporte aussi une autre expérience concluante : affilié à l'un des nombreux groupes trotskistes (la Ligue Communiste), il souffre dans sa chair de ce qu'est le gauchisme, celui qui se charge avec un langage ouvriériste radical de récupérer les militants qui rompent avec le PC ou les syndicats et recherchent une véritable alternative prolétarienne internationaliste. Ils critiquaient l'URSS, mais appelaient à la défendre en tant qu'"État ouvrier dégénéré" ; ils prétendaient être "contre la guerre impérialiste", mais soutenaient la guerre au Viêt Nam et d'autres guerres impérialistes au nom de la "libération nationale" ; ils critiquaient les syndicats, mais appelaient à y participer pour les "gagner pour la classe" ; ils critiquaient les élections, MAIS appelaient à voter pour "gagner un gouvernement ouvrier PC-PSOE" ; ils parlaient de "démocratie dans l'organisation", mais c'était un panier de vipères où les différents gangs se battaient à mort pour le contrôle de l'organisation en recourant aux manœuvres, à la calomnie et à toutes les bassesses imaginables.
Ni le cauchemar du "socialisme autogestionnaire" yougoslave, ni le sabotage syndical, ni la souricière du gauchisme n'ont empêché le camarade de rechercher des positions véritablement communistes. Dans cette recherche, il a contacté le CCI et a entrepris une série de discussions très approfondies, tirant des leçons de toutes les expériences qu'il avait vécues, pour finalement décider d'y adhérer en 1980.
Depuis lors, il a été un militant fidèle à la cause du prolétariat, réfléchissant et intervenant toujours dans les réunions, essayant de contribuer à l'élaboration commune de nos positions. Il a surtout été très actif dans les luttes de classe, participant en tant que travailleur à de nombreuses luttes (Telefonica, Standard), ainsi qu'à des luttes telles que Delphi, SEAT, les réunions de chômeurs, etc. Il n'hésitait pas à intervenir dans les assemblées, à affronter les manœuvres syndicales, à proposer des mesures pour renforcer l'assemblée et à chercher à étendre la lutte pour rompre l'isolement. De même, il se rendait dans les réunions où il pouvait y avoir des discussions d'intérêt pour la clarification révolutionnaire où il n'hésitait pas à intervenir de façon claire et courageuse en défendant les positions du CCI.
Il a également beaucoup contribué à la diffusion de la presse. Il distribuait régulièrement nos publications dans les librairies, les bibliothèques, il était constamment à la recherche de nouveaux centres de distribution. Lors des manifestations, assemblées, rassemblements, etc., il était le premier à diffuser la presse de la CCI avec un enthousiasme et une persévérance tout à fait exemplaires.
Il était toujours disponible pour les activités de l'organisation et menait un travail enthousiaste de collecte de presse et de livres révolutionnaires, mais aussi sur tous les sujets intéressant la lutte révolutionnaire de la classe ouvrière. La bibliothèque qu'il a réussi à constituer est un trésor pour la transmission des traditions et des positions des organisations communistes.
Il est resté militant jusqu'à la dernière minute. Atteint d'une maladie douloureuse, il demandait à tous les camarades qui lui rendaient visite quelles avaient été les discussions, il nous demandait de lui lire les textes internationaux de l'organisation, il écoutait avidement tout ce qu'on lui disait. Il était, tout simplement, UN MILITANT COMMUNISTE DU PROLETARIAT. C'est avec une grande tristesse que nous écrivons ces lignes, mais nous le faisons déterminés et encouragés par son militantisme, prêts à continuer le combat et à gagner des jeunes qui, aujourd'hui, seront confrontés aux pièges qu'il a dû surmonter et chercheront les réponses qu'il a trouvées et qui ont motivé toute sa vie.
[1] À l'époque, il existait ce que l'on appelait le "mouvement des non-alignés", des pays qui prétendaient se situer en dehors des deux blocs impérialistes qui dominaient le monde : les États-Unis et l'URSS. L'un de ses promoteurs était Tito, le président yougoslave qui fut l'une des vedettes de la célèbre conférence de Bandung en 1955.
Rubrique:
L’émeute n’est pas une arme de la classe ouvrière
- 187 lectures
Nous publions ci-dessous un courrier de lecteur signé Tibor, suivi de notre réponse. Nous ne pourrons traiter ici de l’ensemble des points soulevés par ce texte très riche, comme nous ne considérons pas notre réponse comme un point final au débat. Au contraire, nous encourageons tous nos lecteurs, et Tibor lui-même évidemment, à se saisir de ce début d’échanges pour poursuivre la discussion, par de nouveaux courriers ou lors de nos réunions publiques et permanence.
Chers camarades,
Voici comment Friedrich Engels décrivait les émeutes de la bière en Bavière qui eurent lieu au début du mois de mai 1844 : « La population laborieuse s’est regroupée en masse, a marché dans les rues, a attaqué des bâtiments officiels, brisé des vitres et détruit tout ce qui se trouvait sur son passage pour protester contre la hausse du prix de sa boisson préférée. […] Maintenant que le peuple a, pour la première fois, pris conscience qu’il pouvait modifier le système fiscal en effrayant le gouvernement, il apprendra vite qu’il est tout aussi facile de l’effrayer pour des affaires encore plus importantes. » (Souligné par moi, Tibor). Il pourrait donc apparaître a priori que la position authentiquement marxiste sur les émeutes soit un acquis du patrimoine révolutionnaire. En réalité, il n’en est rien. Ainsi, à l’occasion des émeutes de juin 2023 s’étant déclarées en France à la suite du meurtre du jeune Nahel par la police, les organisations de la gauche communiste ont défendu des positions parfois radicalement opposées. Tandis que certaines organisations ont salué ce mouvement, tout en insistant de façon plus ou moins prononcée sur ses limites évidentes, d’autres groupes, comme le CCI auquel s’adresse ce courrier, n’ont pas manqué de dénoncer l’impasse des « violences aveugles ». Ces divergences de taille montrent que loin d’être une évidence, la question des émeutes mérite de faire l’objet d’une clarification et d’une confrontation. C’est ce que ce courrier cherche à faire.
Les émeutes des banlieues s’inscrivent-elles sur le terrain de la classe ouvrière ?
Contrairement à ce qu’affirme l’extrême-gauche du capital, « tout ce qui bouge » n’est pas nécessairement « rouge », ou, exprimée de façon moins caricaturale, tout mouvement social n’exprime pas nécessairement la lutte de classe du prolétariat. Afin de savoir si un mouvement s’inscrit ou non sur le terrain du prolétariat, il importe de procéder avec méthode et de répondre à un certain nombre de questions. Schématiquement, les marxistes disposent de plusieurs moyens pour identifier la nature de classe d’un mouvement : la composition sociale des participants et participantes ; les méthodes et moyens de lutte employés ; la nature de classe des revendications. Une fois ces points envisagés, ce que nous allons faire dans la suite de ce courrier, il importe encore de replacer cette analyse dans une perspective dynamique et historique, ce qui sera fait dans un second temps.
Causes et composition sociale des émeutes
Commençons tout d’abord par la composition sociale des émeutiers. A priori personne ne nie l’appartenance de la majorité des émeutiers au prolétariat. Ce serait en effet faire preuve d’une méconnaissance évidente de la situation dans les banlieues françaises que de nier l’appartenance d’une majorité de ses habitants et habitantes à la classe ouvrière. Quand ils ne sont pas confrontés au chômage et à la pauvreté, ces prolétaires travaillent pour de grandes plateformes logistiques (Amazon) ou dans un auto-entrepreneuriat fictif visant à dissimuler la forme salariale d’exploitation (Uber, Deliveroo, etc.). Pour tout matérialiste, attaché à identifier les causes économiques et sociales qui produisent en dernière instance ces émeutes, il est évident que ces soulèvements s’expliquent d’une part par le fait que cette fraction du prolétariat est soumise d’un côté à une exploitation forcenée, se caractérisant notamment par une plus grande misère, un chômage plus important ou encore l’absence des palliatifs habituels (services publics). D’autre part, ils ont également pour causes une répression étatique sans limites, avec humiliations, contrôles au faciès, meurtres et un véritable racisme d’État encouragé par la police et la justice. Ces émeutes sont donc une réaction directe à une exploitation et à une répression de classe, ce que tout révolutionnaire devrait saluer comme une rupture du statu quo et un refus par une fraction du prolétariat de continuer à subir des conditions de vie et de travail insupportables. Quant aux arguments voyant dans les jeunes émeutiers une incarnation du sous-prolétariat avec ses délinquants et autres voyous, ceux-ci ne résistent pas à l’analyse dans la mesure où ce sont précisément dans les quartiers contrôlés par les dealers que rien n’a bougé, du fait de la nécessité pour ces groupes criminels de maintenir les « affaires » là où les émeutes représentent une menace pour ce commerce. Plus, ce sont même parfois les dealers qui ont agi pour mettre un terme aux émeutes. Si le CCI semble bien voir la composition sociale prolétarienne des émeutiers et les causes sociales et économiques de leur combat, il ne voit même pas ce qu’il y a de progressiste dans ce refus de continuer à subir sans broncher la violence de classe (alors même qu’il se réjouit, à raison, des nombreux slogans « enough is enough » et « trop c’est trop » que l’on rencontre dans les autres mouvements sociaux à l’échelle mondiale).
Méthodes et moyens de lutte
Il est néanmoins évident que les causes et la composition sociale d’un mouvement ne sauraient suffire à prouver la nature de classe d’un mouvement. Cela nous conduit à aborder la question des méthodes de lutte. Et de toute évidence, c’est là le cœur de mon désaccord avec l’analyse du CCI. La thèse du CCI s’exprime de la façon suivante : les émeutes sont un danger pour le prolétariat. Nous avons déjà mentionné qu’Engels soutenait en 1844 la forme émeutière de lutte. De nombreux groupes prolétariens ont défendu des positions similaires. Un exemple parmi d’autres est le groupe résistant du troisième camp OCR pendant la Seconde Guerre mondiale qui mentionne parmi les luttes politiques à caractère prolétarien, les luttes anti-police et les émeutes à caractère revendicatif. À rebours de ces positions traditionnelles et historiques, citons l’article du CCI : « La classe ouvrière possède ses propres méthodes de lutte qui s’opposent radicalement aux émeutes et aux simples révoltes urbaines. La lutte de classe n’a strictement rien à voir avec les destructions et la violence aveugles, les incendies, le sentiment de vengeance et les pillages qui n’offrent aucune perspective. » En contrepoint, citons à nouveau l’article de Friedrich Engels : « La population laborieuse s’est regroupée en masse, a marché dans les rues, a attaqué des bâtiments officiels, brisé des vitres et détruit tout ce qui se trouvait sur son passage pour protester contre la hausse du prix de sa boisson préférée. […] La police, qui est comme partout particulièrement impopulaire dans le peuple, était violemment attaquée, battue et maltraitée par les émeutiers. » Cela suffit à prouver que sur cette question, le CCI révise l’acceptation marxiste de la violence, en rejetant par principe la violence spontanée et incontrôlée. Au contraire, les marxistes, bien loin de dénoncer les violences, comme n’importe quel vulgaire bourgeois ou comme le groupe gauchiste Lutte ouvrière (NB : le CCI se plaît à rejeter toute critique de ses positions sur les émeutes comme exprimant une position en tous points similaires à celle des groupes gauchistes, trotskistes, maoïstes, anarchistes, etc. Comment explique-t-il que sa position de dénonciation de la violence aveugle et sans perspectives des émeutes soit la même, mot pour mot, que celle du groupe gauchiste Lutte ouvrière ?), défendent la même perspective que Marx quand il écrivait dans l’Adresse de la Ligue des Communistes de 1850 : « Bien loin de s’opposer aux prétendus excès, aux exemples de vengeance populaire contre des individus haïs ou des édifices publics auxquels ne se rattachent que des souvenirs odieux, il faut non seulement tolérer ces exemples, mais encore en assumer soi-même la direction ». (Souligné par moi, Tibor). Remarquez que dans la phrase du CCI, la notion de « vengeance » est opposée à la lutte de classe tandis que chez Marx, elle est non seulement tolérée mais doit également être organisée par les révolutionnaires communistes. Ce que ces exemples montrent, c’est que le CCI rompt avec l’analyse marxiste de la violence de classe, se refusant, pour des raisons idéalistes et métaphysiques, à soutenir la violence, dès lors qu’elle est spontanée ou minoritaire, et ce même si c’est une partie de la classe qui y a recours. À un niveau plus fondamental, c’est sur le rapport entre violence et conscience que le CCI révise le marxisme. Pour lui, une lutte consciente sera la moins violente possible. Inversement, une lutte violente témoignera de la faiblesse du prolétariat. C’est en opposition totale avec les appels de Marx, d’Engels, de Lénine, de Trotsky, de Miasnikov ou encore de Bordiga à la terreur de classe. La lutte de classe c’est, comme l’affirmait Marx en reprenant une formule de Georges Sand, « le combat ou la mort, la lutte sanguinaire ou le néant. C’est ainsi que la question est invinciblement posée. » Dès lors, les formes de violence spontanées et minoritaires, loin d’être des impasses, témoignent d’une conscience, même embryonnaire, de cette réalité. C’est un point d’appui pour la lutte future du prolétariat. Le principal reproche que le CCI fait à cet argument est que la violence contribue à la division du prolétariat alors même que le but de la lutte de classe est la recherche d’une unité toujours plus grande. De toute évidence, il s’agit là d’une nouvelle position dogmatique et métaphysique du CCI. L’unité n’est pas une fin en soi, elle n’est qu’un moyen vers le but qui est celui de contribuer à la conscientisation du prolétariat qu’il a des intérêts qui lui sont propres, qui viennent s’opposer radicalement à ceux de la bourgeoisie, nécessitant dès lors une offensive finale contre la bourgeoisie et pour l’instauration du communisme. Défendre l’unité comme un dogme à chaque moment de la lutte est une erreur dangereuse. Au cours d’un épisode révolutionnaire, l’unité n’est pas une donnée initiale, elle ne représente qu’une perspective à moyen ou long-terme. Cela s’explique par l’hétérogénéité de la conscience de classe au sein du prolétariat. Un exemple suffira à prendre conscience de ce fait : à l’automne 1918, pendant la révolution allemande, les positions stratégiques et tactiques de Karl Liebknecht devaient nécessairement contribuer à diviser le prolétariat entre avant-garde consciente et arrière-garde restée sur le terrain bourgeois. Ce sont précisément les sociaux-démocrates qui dénonçaient Liebknecht comme un diviseur et se faisaient les parangons de l’unité. Avec ses appels métaphysiques à l’unité, le CCI aurait donc dû se trouver aux côtés du SPD. Heureusement, il est trop révolutionnaire pour se laisser mystifier par ses propres erreurs théoriques. Dès lors, ce que cet exemple illustre, c’est qu’il est erroné de demander à toute lutte de contribuer à l’unité. Si celle-ci reste une perspective, elle ne saurait être atteinte au début d’un mouvement et les révolutionnaires n’ont absolument pas à craindre de briser l’unité si cela bénéficie, comme avec le recours à la violence, à sa lutte de classe.
La nature de classe des revendications
Enfin, la dernière dimension à étudier est celle des revendications et de leur nature de classe ou non. C’est là que s’exprime toute la faiblesse de ces émeutes. La clarté des revendications et des perspectives qu’exprime un mouvement est le produit de la conscience manifestée par ce mouvement. En l’occurrence, il est indéniable que cette conscience de classe était seulement embryonnaire et que les participants et participantes n’avaient pas conscience d’appartenir à une classe sociale aux intérêts communs, à savoir le prolétariat. Cela se manifeste de façon extrêmement claire par le fait qu’outre les violences de classe (contre la police, les mairies, les préfectures, les centres commerciaux, les prisons et autres incarnations du capitalisme et de l’État bourgeois répressif), les émeutiers s’en sont également pris à leur propre classe, que ce soit physiquement en prenant à partie des prostituées (sans doute pour des motifs de puritanisme complètement étrangers à la classe ouvrière) ou matériellement en attaquant des voitures (de prolétaires !), des écoles ou encore des hôpitaux, services publics, qui bien que simples palliatifs, restent malgré tout utile pour la vie quotidienne d’une grande majorité du prolétariat. Le CCI a donc raison quand il affirme que ces luttes ne contribuent pas à l’unification du prolétariat. Mais à cela, deux remarques sont immédiatement nécessaires. Contrairement à ce qu’il affirme quand il prétend que les émeutes sont condamnées par une majorité du prolétariat des banlieues, les témoignages tendraient plutôt à montrer le soutien des aînés à la révolte des jeunes. Néanmoins, il ne s’agit ici que de témoignages, et il est absolument impossible pour des révolutionnaires que d’évaluer scientifiquement le degré d’adhésion ou de rejet au sein du prolétariat des banlieues vis-à-vis des émeutes. La seconde remarque à faire est que même s’il est évident que la bourgeoisie fait et fera tout son possible pour diviser le prolétariat en insistant sur la violence et les limites de ces luttes pour provoquer l’indignation du reste du prolétariat, la tâche des révolutionnaires, plutôt que de crier avec les loups et de mêler ses cris à ceux de la bourgeoisie et de certains prolétaires, est bien plutôt de refuser cette division et de contribuer par sa propagande à montrer que tous ces prolétaires, qu’ils participent aux émeutes, ou qu’ils les réprouvent, contaminés par la propagande mensongère des médias bourgeois, appartiennent à une seule et même classe et ont des intérêts communs. C’est cette tâche que le CCI abandonne quand il se contente de dénoncer les émeutes.
Une analyse comparée de la lutte contre la réforme des retraites et des émeutes au niveau de la conscience
En définitive, quel est le degré de conscience de ces luttes ? Tout d’abord, il importe de replacer ces luttes dans leur dynamique historique. Elles surgissent à la suite de décennies de recul de la conscience de classe à l’échelle mondiale (depuis au moins les années 1980 et les nombreuses défaites rencontrées par le prolétariat). Il serait absurde (et le CCI en convient) de reprocher aux luttes actuelles de ne pas être au niveau de la conscience des années 1970, et a fortiori, des années 1920. Pourtant, alors que le CCI en convient pour les luttes économiques, il rejette cet argument pour les émeutes et se contente de dénoncer l’absence de conscience. Au contraire, une analyse comparée des luttes contre la réforme des retraites et des émeutes dresse un tout autre tableau, beaucoup plus dialectique et anti-schématique, que celui du CCI. C’est ce que je me propose de faire pour conclure ce courrier.
Être conscient d’être un prolétaire implique trois choses : 1) la conscience d’appartenir à une seule et même classe exploitée avec des intérêts communs ; 2) la conscience d’avoir des intérêts antagoniques et radicalement opposés à ceux de la bourgeoisie ; 3) la nécessité de s’auto-organiser hors de tout cadre bourgeois. Or, il apparaît qu’au regard de ces trois critères, chacun de ces deux mouvements est le miroir inversé de l’autre. Ainsi, la lutte contre la réforme des retraites doit être saluée pour sa massivité et sa tendance à l’unification de l’ensemble du prolétariat, indépendamment du métier, de l’âge, du genre, etc. (même si les impasses localistes et corporatistes ont été encouragées par les syndicats, et que le prolétariat n’a pas été encore en mesure de les rejeter). C’est un point de départ salutaire pour de futures luttes. Par contre, les deux autres dimensions ont manqué cruellement. L’encadrement syndical, qui s’est maintenu du début à la fin du mouvement, a conduit à l’organisation de manifestations-promenades guillerettes et légalistes où la haine de la bourgeoisie et la compréhension de la nécessité d’une lutte radicale et violente contre la classe ennemie faisaient complètement défaut. De même, l’auto-organisation n’est jamais parvenue à s’exprimer, ce qui est l’une des causes majeures de la défaite du mouvement. À nouveau, ces limites étaient inévitables dans la phase historique actuelle mais elles doivent être dénoncées si le prolétariat veut tirer les leçons de la défaite pour aller de l’avant. Si on observe maintenant les émeutes au regard de ces mêmes trois critères, on constate que l’auto-organisation fait également défaut, non pas dans la mesure où ce mouvement est organisé par la bourgeoisie (syndicats, gauchistes) mais dans la mesure où il n’est pas organisé du tout. Par contre, là où l’unité faisait la force du mouvement contre la réforme des retraites, son absence fait la faiblesse des émeutes. Par l’action de la bourgeoisie et du fait de la faiblesse de la conscience au sein de la classe, les émeutiers ont été opposés au reste du prolétariat, et cette division entre prolétaires n’a jamais été remise en question (y compris par le CCI). Enfin, la dimension de compréhension de la nécessaire lutte contre la bourgeoisie, la haine de l’ennemi, était bien présente dans les émeutes, alors qu’elle était absente dans le cadre de la lutte contre la réforme des retraites.
En conclusion, il ne s’agit donc pas (comme ce fut le cas dans un autre courrier de lecteur dont les enjeux étaient relativement similaires à ceux actuels) de s’interroger sur lequel de ces deux mouvements est le plus radical. Il ne s’agit pas non plus de prendre l’un de ces deux mouvements comme modèle et l’autre comme incarnation de toutes les impasses et de tous les pièges de la bourgeoisie. Il s’agit plutôt, dans le cadre d’une analyse dialectique, attentive à appréhender la nature nécessairement contradictoire des phénomènes sociaux, d’identifier aussi bien les signes d’un réveil de la conscience au sein de la classe ouvrière que les manifestations des faiblesses encore extrêmement importantes de la classe dans le cadre de sa lutte contre la bourgeoisie. Cette tâche qui est celle des révolutionnaires fait clairement défaut dans l’analyse du CCI.
Tibor
Réponse du CCI
Avant tout, nous voulons saluer ce courrier, pour plusieurs raisons :
– Par ce texte, Tibor participe à la nécessité pour les révolutionnaires de débattre, de confronter les divergences et les arguments, afin de parvenir aux positions les plus claires et les plus justes possibles.
– Le camarade a fait un véritable effort théorique pour exposer les différentes positions en jeu et pour fonder sa critique sur l’histoire du mouvement ouvrier.
– Comprendre la réelle nature des émeutes de banlieues et leur impact sur la classe ouvrière est effectivement une question très importante pour l’avenir.
La charge de Tibor contre la position du CCI sur les émeutes des banlieues en France est sévère : « le CCI révise l’acceptation marxiste de la violence » ; « comme n’importe quel vulgaire bourgeois ou comme le groupe gauchiste Lutte ouvrière » ; « pour des raisons idéalistes et métaphysiques » ; « il s’agit là d’une nouvelle position dogmatique et métaphysique du CCI » ; « le CCI aurait donc dû se trouver aux côtés du SPD »…
Nous répondrons à ces critiques par la suite. Mais le plus important est ici de souligner dans quel cadre, Tibor porte ces critiques : « Tandis que certaines organisations ont salué ce mouvement, tout en insistant de façon plus ou moins prononcée sur ses limites évidentes, d’autres groupes, comme le CCI auquel s’adresse ce courrier, n’ont pas manqué de dénoncer l’impasse des “violences aveugles”. Ces divergences de taille montrent que loin d’être une évidence, la question des émeutes mérite de faire l’objet d’une clarification et d’une confrontation. C’est ce que ce courrier cherche à faire ». « Heureusement, [le CCI] est trop révolutionnaire pour se laisser mystifier par ses propres erreurs théoriques ». Autrement dit, le camarade Tibor conçoit bien ce débat au sein du milieu politique prolétarien, dans le camp révolutionnaire. Et c’est dans ce cadre que se placera aussi notre réponse, en se voulant à la fois fraternelle et sans concession.
Avec quelle méthode lire les textes classiques du marxisme ?
Commençons directement par ce qui peut paraître comme le socle le plus solide de la démonstration du camarade : ses citations historiques.
C’est en reprenant quelques mots d’Engels puis de Marx que Tibor croit prouver que « le CCI révise l’acceptation marxiste de la violence ». Seulement, l’approche historique nécessite de comprendre les écrits dans leur contexte, dans leurs combats et dans leur évolution.
Quand Engels décrit les émeutes de la bière de Munich, on est en 1844, l’Allemagne est encore la Prusse, le roi Louis Ier gouverne et la féodalité s’accroche au pouvoir contre les assauts de la bourgeoisie naissante. Le mouvement prolétarien est dans sa phase d’immaturité, et ses luttes consistent le plus souvent à pousser le plus loin possible les avancées de la bourgeoisie révolutionnaire contre la féodalité réactionnaire. L’insurrection de juin 1848 en France n’a pas encore eu lieu. Or, c’est ce mouvement qui fera apparaître pour la première fois avec netteté le clivage de classe et la force autonome du prolétariat capable de se dresser directement face à la République bourgeoise : « fut livrée la première grande bataille entre les deux classes qui divisent la société moderne ». (1) Quatre années plus tôt, en 1844, au-delà de toute l’immaturité et des limites du mouvement lié à l’époque, Engels salue donc la révolte de deux-mille ouvriers et la prise de conscience de leur force collective parce qu’il s’agit alors d’un petit pas en avant.
Quant à la citation de Marx, datée de 1850, le camarade effectue presque un contresens. La « vengeance populaire contre des individus haïs ou des édifices publics » qu’il fallait « tolérer » consistait, en l’occurrence, à « mettre à exécution [les] présentes phrases terroristes » de la petite-bourgeoisie démocratique dans le contexte de la lutte de la bourgeoisie allemande contre la monarchie et ses palais. Ce texte ne cesse d’ailleurs d’insister sur la nécessité pour le prolétariat de « s’organiser » par lui-même et de « centraliser » le plus possible son combat : « … il faut que les ouvriers soient armés et bien organisés. Il importe de faire immédiatement le nécessaire pour que tout le prolétariat soit pourvu de fusils, de carabines, de canons et de munitions et il faut s’opposer au rétablissement de l’ancienne garde nationale dirigée contre les ouvriers. Là où ce rétablissement ne peut être empêché, les ouvriers doivent essayer de s’organiser eux-mêmes en garde prolétarienne, avec des chefs de leur choix, leur propre état-major et sous les ordres non pas des autorités publiques, mais des conseils municipaux révolutionnaires formés par les ouvriers. Là où les ouvriers sont occupés au compte de l’État, il faut qu’ils soient armés et organisés en un corps spécial avec des chefs élus ou en un détachement de la garde prolétarienne. Il ne faut, sous aucun prétexte, se dessaisir des armes et munitions, et toute tentative de désarmement doit être repoussée, au besoin, par la force. Annihiler l’influence des démocrates bourgeois sur les ouvriers, procéder immédiatement à l’organisation propre des ouvriers et à leur armement et opposer à la domination, pour le moment inéluctable, de la démocratie bourgeoise les conditions les plus dures et les plus compromettantes : tels sont les points principaux que le prolétariat et par suite la Ligue ne doivent pas perdre de vue pendant et après l’insurrection imminente ».
Voilà la réalité du mouvement à cette époque, son contexte et ses buts. Quel rapport avec les émeutes des banlieues d’aujourd’hui ? Le camarade croit-il vraiment que les émeutes de cet été ont fait prendre conscience à la classe ouvrière qu’elle pouvait « effrayer le gouvernement » et lui apprendre « qu’il est tout aussi facile de l’effrayer pour des affaires encore plus importantes » ?
Le camarade voit-il maintenant le gouffre qui sépare les récentes émeutes écrasées en moins d’une semaine par la répression policière et les combats de classe des années du milieu du XIXᵉ siècle qui permettaient à Marx et Engels de fixer comme but de « procéder immédiatement à l’organisation propre des ouvriers et à leur armement » ?
Poursuivons. Parce qu’en réalité l’action révolutionnaire de Marx et Engels va à l’exact opposé de ce que croit trouver Tibor dans quelques phrases mal comprises. Dans La situation de la classe laborieuse en Angleterre, publié en allemand en 1845, Engels esquisse les grandes lignes du développement de la révolte de la classe ouvrière : « La première forme, la plus brutale et la plus stérile, que revêtit cette révolte fut le crime. L’ouvrier vivait dans la misère et l’indigence et il voyait que d’autres jouissaient d’un meilleur sort. Sa raison ne parvenait pas à comprendre pourquoi, précisément lui, devait souffrir dans ces conditions, alors qu’il faisait bien davantage pour la société que le riche oisif. Le besoin vainquit en outre le respect inné de la propriété ; il se mit à voler… Mais les ouvriers eurent tôt fait de constater l’inanité de cette méthode. Les délinquants ne pouvaient par leurs vols, protester contre la société qu’isolément, qu’individuellement ; toute la puissance de la société s’abattait sur chaque individu et l’écrasait de son énorme supériorité ».
Ni Marx, ni Engels ne voyaient la violence et l’infraction à la loi comme révolutionnaire en soi et ils étaient prêts à critiquer les actions qui vont contre le développement de la lutte de la classe ouvrière, même quand elles apparaissaient comme spectaculaires et provocatrices. Ainsi, en 1886, Engels a vivement attaqué l’activité de la Fédération sociale-démocrate et son organisation d’une manifestation de chômeurs qui, tout en passant par Pall Mall et d’autres quartiers riches de Londres sur le chemin de Hyde Park, a attaqué des magasins et pillé des boutiques de vin. Engels a fait valoir que peu de travailleurs y avaient pris part, que la plupart des personnes impliquées « étaient sorties pour rigoler et dans certains cas, étaient déjà à moitié bourrées » et que les chômeurs qui y avaient participé « étaient pour la plupart de ce genre qui ne souhaitent pas travailler : des marchands de quatre saisons, des oisifs, des espions de la police et des voyous ». L’absence de la police était « tellement visible que ce n’était pas seulement nous qui croyions qu’elle était intentionnelle ». Quoi qu’on puisse penser de certaines expressions d’Engels aujourd’hui, sa critique essentielle suivant laquelle « ces messieurs socialistes [c’est-à-dire les dirigeants de la FSD] sont déterminés à faire apparaître de façon immédiate un mouvement qui, ici comme ailleurs, réclame nécessairement des années de travail » demeure pleinement valable. La révolution n’est pas le produit du spectacle, de la manipulation ou du pillage.
Aborder l’histoire ex nihilo, en figeant quelques phrases, en les extrayant de leur contexte, en leur faisant dire ainsi ce que l’on espère, comme les religieux font avec leurs versets, n’est-ce pas plutôt cela qui constitue une démarche « dogmatique », « idéaliste » et « métaphysique » ? (2)
Les émeutes de banlieues d’aujourd’hui constituent un danger pour la lutte de classe à venir
Sur de ces fondations historiques bancales, le camarade Tibor élève les murs porteurs de son argumentaire. Selon lui, compte-tenu de la faiblesse actuelle de la lutte du prolétariat, de ses illusions vis-à-vis de l’État, de la démocratie, etc., la « haine » des émeutiers envers les flics et les représentants de l’ordre est un pas en avant :
– « Il s’agit plutôt, dans le cadre d’une analyse dialectique, attentive à appréhender la nature nécessairement contradictoire des phénomènes sociaux, d’identifier aussi bien les signes d’un réveil de la conscience au sein de la classe ouvrière que les manifestations des faiblesses encore extrêmement importantes de la classe dans le cadre de sa lutte contre la bourgeoisie ».
– « … la dimension de compréhension de la nécessaire lutte contre la bourgeoisie, la haine de l’ennemi, était bien présente dans les émeutes, alors qu’elle était absente dans le cadre de la lutte contre la réforme des retraites ».
Pour vérifier cette « analyse dialectique » et effectivement « contradictoire », partons de la description que le camarde fait lui-même de ces fameuses émeutes : « La dernière dimension à étudier est celle des revendications et de leur nature de classe ou non. C’est là que s’exprime toute la faiblesse de ces émeutes. […] Cela se manifeste de façon extrêmement claire par le fait qu’outre les violences de classe (contre la police, les mairies, les préfectures, les centres commerciaux, les prisons et autres incarnations du capitalisme et de l’État bourgeois répressif), les émeutiers s’en sont également pris à leur propre classe, que ce soit physiquement en prenant à partie des prostituées (sans doute pour des motifs de puritanisme complètement étrangers à la classe ouvrière) ou matériellement en attaquant des voitures (de prolétaires !), des écoles ou encore des hôpitaux, services publics, qui bien que simples palliatifs, restent malgré tout utile pour la vie quotidienne d’une grande majorité du prolétariat ».
Nous sommes bien d’accord avec le camarade : pouvoir se déplacer, ne serait-ce que pour aller au boulot, se soigner, apprendre à lire et à écrire… « restent malgré tout utile pour la vie quotidienne d’une grande majorité du prolétariat ». Mais, le camarade peut-il sérieusement affirmer qu’attaquer des prostituées, brûler les voitures de ses voisins, des bus, des écoles, des hôpitaux… en quoi est-ce comparable aux actions violentes du prolétariat des années 1850 ?
Le camarade a raison sur un point, les émeutiers sont très majoritairement des enfants de la classe ouvrière. Il décrit d’ailleurs fort justement la réalité des banlieues : « Ce serait en effet faire preuve d’une méconnaissance évidente de la situation dans les banlieues françaises que de nier l’appartenance d’une majorité de ses habitants et habitantes à la classe ouvrière. Quand ils ne sont pas confrontés au chômage et à la pauvreté, ces prolétaires travaillent pour de grandes plateformes logistiques (Amazon) ou dans un auto-entrepreneuriat fictif visant à dissimuler la forme salariale d’exploitation (Uber, Deliveroo, etc.) ». Et les émeutiers sont la partie la plus écrasée, rejetée, exclue de cette classe ouvrière précarisée. Le camarade y voit là une preuve de la nature ouvrière de leurs explosions de violences. En réalité, justement à cause de l’absence encore aujourd’hui d’un mouvement ouvrier suffisamment puissant pour entraîner dans le sillage de sa lutte les parties les plus affaiblies d’elles-mêmes et toutes les couches de la société, cette jeunesse ouvrière marginalisée ne peut que sombrer dans le nihilisme, la violence aveugle, la haine et la destruction. Voilà quelle réalité éclairent les voitures, les bus et les écoles brûlées. Une explosion de colère qui se retourne contre la classe ouvrière elle-même.
Oui, mais ils ont aussi brûlé des « centres commerciaux », « incarnations du capitalisme » entend-on protester le camarade Tibor. Il y a là un malentendu entre le romantisme du camarade qui voit ces émeutes de loin et les émeutiers eux-mêmes. Il y a en effet eu des magasins pillés et des centres commerciaux incendiés. Mais pour les émeutiers, il ne s’agissait pas d’attaquer le capitalisme et ses symboles. Bien au contraire ! Ces attaques reflètent la domination de la culture marchande plutôt qu’un défi à celle-ci. La notion de « shopping prolétarien », élaborée par certains, peut sembler opposée aux lois et à la morale bourgeoises, mais est étrangère au cadre prolétarien de l’action collective pour défendre des intérêts communs. L’acquisition individuelle de marchandises n’échappe jamais réellement aux prémisses les plus basiques de la propriété capitaliste. Au mieux, une telle appropriation individuelle peut permettre à l’individu et à ses proches de survivre un peu mieux qu’avant. C’est compréhensible, mais ce n’est absolument pas une menace pour la domination bourgeoise, ni même une velléité de menace.
Il reste encore ce que le camarade nomme « les violences de classe » : « contre la police, les mairies, les préfectures, les prisons et autres incarnations du capitalisme et de l’État bourgeois répressif ». Ici, ce n’est plus un simple malentendu, c’est du pur aveuglement. Ces émeutes ne sont même pas comparables à l’idéologie des black-blocs qui, eux, s’imaginent vraiment assaillir le capitalisme en s’attaquant à ses symboles. Lors des émeutes, les jeunes balançaient des feux d’artifice sur des commissariats et des caillasses sur les flics sans autre aiguillon que leur rage face aux contrôles incessants, au harcèlement quotidien, aux violences humiliantes, au racisme coutumier et parfois au meurtre, ignominieusement appelé « bavure ». C’est une explosion de colère impuissante. Le camarade connaît cet argument, et il croit y répondre en affirmant : « … quel est le degré de conscience de ces luttes ? Tout d’abord, il importe de replacer ces luttes dans leur dynamique historique. Elles surgissent à la suite de décennies de recul de la conscience de classe à l’échelle mondiale (depuis au moins les années 1980 et les nombreuses défaites rencontrées par le prolétariat). Il serait absurde (et le CCI en convient) de reprocher aux luttes actuelles de ne pas être au niveau de la conscience des années 1970, et a fortiori, des années 1920. Pourtant, alors que le CCI en convient pour les luttes économiques, il rejette cet argument pour les émeutes et se contente de dénoncer l’absence de conscience. Au contraire, une analyse comparée des luttes contre la réforme des retraites et des émeutes dresse un tout autre tableau, beaucoup plus dialectique et anti-schématique, que celui du CCI ». Guy Debord a souvent affirmé que la dialectique pouvait casser des briques, mais nous doutons quand-même de l’utilisation qu’en fait le camarade Tibor dans le cadre émeutier.
Dans ces quelques lignes, il y a une incompréhension, celle de la différence radicale de nature entre le mouvement social contre les retraites et les émeutes. En manifestant, en se regroupant dans la rue, par centaines de milliers, en commençant à se reconnaître comme des travailleurs, en percevant la force d’être unis, les ouvriers se battent sur leur terrain de classe. Quel que soit leur niveau de conscience, leur lutte permet de nourrir leur réflexion et leur organisation. Cette approche dynamique est essentielle. La dialectique, c’est le mouvement. Où mène l’émeute ? Où mènent ces nuits durant lesquelles des gamins de 14-17 ans sortent pour piller les magasins et affronter une police surarmée ? À un développement de la conscience de la classe ouvrière ? À un renforcement de sa capacité à s’organiser ? Absolument pas. Les émeutes mènent à la destruction, au chaos. Elles sont le contraire de la perspective que peut offrir la lutte du prolétariat.
D’ailleurs, on voit déjà comment ces émeutes évoluent décennies après décennies. 2005 en France, 2011 en Angleterre, 2023 de nouveau en France… la tendance est vers de plus en plus de violence et de pillages. Elles touchent des parties de plus en plus larges de la jeunesse, en ne se limitant plus simplement aux banlieues mais en touchant aussi les petites villes de campagne confrontées à l’explosion du chômage et à l’absence d’avenir. Et, en face, une police de plus en plus armée et meurtrière.
Pour se convaincre de la différence de nature entre ces deux types de mouvements, le camarade devrait se pencher sur ce qu’en dit la bourgeoisie. Ce que dit et fait « l’ennemi de classe » est toujours riche en enseignements. À l’échelle internationale, les émeutes sont chaque fois sur-médiatisées. Les journaux se répandent en images chocs, c’est au journaliste qui montrera la plus grosse flamme. En 2005, la Une des journaux aux États-Unis titraient « Paris is burning » (Paris brûle). La bourgeoisie serait-elle devenue suicidaire en exposant ainsi de si belles preuves de « la haine de l’ennemi de classe » ? Ou bien idiote en faisant la publicité de luttes représentant une avancée pour la conscience révolutionnaire du prolétariat ?
Une autre hypothèse est peut-être plus crédible : la bourgeoisie étale les émeutes parce que ces destructions étayent sa propagande, diffusent l’idée que toute révolte est destruction, que toute violence mène au chaos. En accentuant la peur, la bourgeoisie profite des émeutes pour pousser au repli, pour atomiser, pour enfoncer le clou du sentiment d’impuissance et, in fine, pour présenter l’État comme le garant de l’ordre et de la protection.
Par contre, quand un mouvement social se développe, le black-out est la règle. Les informations sont diffusées au compte-gouttes. Que sait-on des grèves actuelles aux États-Unis ? Rien, mis à part que Biden et Trump sont allés rendre visite aux grévistes. Quelles images ont été diffusées lors du mouvement social en France ? Celles de poubelles qui brûlent ! Celles des black-blocs s’affrontant aux rangées de CRS ! Quand des millions de manifestants se rassemblent sur un terrain de classe, les médias braquent leur projecteur sur dix poubelles en flammes et cinquante jeunes recouverts de noir balançant des pavés ! En 2006, lors du mouvement contre le CPE en France, quand des milliers d’étudiants précaires se rassemblaient en assemblées générales et attiraient à eux, dans la rue, de plus en plus de travailleurs, de chômeurs, de retraités, le grand journal Times, dont la portée et la réputation internationale n’est plus à faire, titrait : « Riots » (« Émeutes ») ! N’est-ce pas là un élément qui devrait lui aussi faire réfléchir le camarade ?
Pour Tibor, se confronter directement à la police, s’attaquer aux commissariats et autres bâtiments étatiques est un pas en avant vers la reconnaissance de « l’ennemi de classe ». Mais n’est-ce pas précisément le piège qu’a tendu la bourgeoisie à la classe ouvrière lors du dernier mouvement en France ? En donnant l’ordre à ses flics de provoquer, d’exciter, que cherchait-elle si ce n’est de faire dégénérer les manifestations dans la violence stérile ? Pour faire peur, pour décourager à venir se rassembler dans la rue, pour empêcher toute discussion et développement de la conscience.
C’est là un piège classique. Déjà, en mai 1968, les premiers à jeter des pavés pour entraîner derrière eux les plus combatifs dans une bagarre perdue d’avance avec les CRS étaient les infiltrés, les traîtres, les indics. Parce que ce type de confrontation aux flics ne sert pas la classe ouvrière, elle sert la classe dominante ! L’histoire du mouvement ouvrier nous enseigne que la meilleure réaction face ce piège est l’exact opposé de la confrontation stérile, l’exact opposé de la tentation émeutière. En ne cédant pas aux provocations lors du mouvement contre les retraites en France, les travailleurs se sont inscrits dans une longue tradition prolétarienne.
Voilà ce que nous écrivions en 2006 déjà : « Les étudiants et les jeunes en lutte ne se font aucune illusion sur le rôle des prétendues “forces de l’ordre”. Elles sont les “milices du capital” (comme le scandaient les étudiants) qui défendent, non pas les intérêts de la “population” mais les privilèges de la classe bourgeoise. […] Cependant, certains de ceux qui étaient venus prêter main forte à leurs camarades enfermés dans la Sorbonne ont tenté de discuter avec les gardes mobiles […]. Ceux qui ont essayé de discuter avec les gardes mobiles ne sont pas des naïfs. Au contraire, ils ont fait preuve de maturité et de conscience. Ils savent que derrière leurs boucliers et leurs matraques, ces hommes armés jusqu’aux dents sont aussi des êtres humains, des pères de famille dont les enfants vont être eux aussi frappés par le CPE. Et c’est ce que ces étudiants ont dit aux gardes mobiles dont certains ont répondu qu’ils n’avaient pas d’autre choix que d’obéir ». (3)
Voilà ce qu’écrivait Trotski au sujet de la confrontation d’avec les Cosaques, ces « perpétuels fauteurs de répression et d’expéditions punitives » (4), en 1917 : « Cependant, les Cosaques attaquaient la foule, quoique sans brutalité […] ; les manifestants se jetaient de côté et d’autre, puis reformaient des groupes serrés. Point de peur dans la multitude. Un bruit courait de bouche en bouche : “Les Cosaques ont promis de ne pas tirer”. De toute évidence, les ouvriers avaient réussi à s’entendre avec un certain nombre de Cosaques.[…]. Les cosaques se mirent à répondre individuellement aux questions des ouvriers et même eurent avec eux de brefs entretiens […]. Un des authentiques meneurs en ces journées, l’ouvrier bolchevik Kaïourov, raconte que les manifestants s’étaient tous enfuis, en certains points, sous les coups de nagaïka de la police à cheval, en présence d’un peloton de Cosaques ; alors lui, Kaïourov, et quelques autres ouvriers qui n’avaient pas suivi les fuyards se décoiffèrent, s’approchèrent des Cosaques, le bonnet à la main : “Frères Cosaques, venez au secours des ouvriers dans leur lutte pour de pacifiques revendications ! Vous voyez comment nous traitent, nous, ouvriers affamés, ces pharaons [les policiers à cheval]. Aidez-nous !” Ce ton consciemment obséquieux, ces bonnets que l’on tient à la main, quel juste calcul psychologique, quel geste inimitable ! Toute l’histoire des combats de rues et des victoires révolutionnaires fourmille de pareilles improvisations ».
En réalité, derrière ce désaccord sur la nature des émeutes, s’en cache un plus profond : ce qu’est la violence de classe. Nous ne pouvons développer ici ce point. Nous encourageons nos lecteurs à creuser la question et à venir en débattre avec nous, par écrit ou lors de nos réunions publiques.
Notre position est synthétisée dans notre article « Terreur, terrorisme et violence de classe [572] », disponible sur notre site internet. Nous nous limiterons ici à une seule citation : « Dire et redire cette tautologie “violence = violence” et se contenter de démontrer que toutes les classes en usent, pour établir sa nature identique, est aussi intelligent, génial, que de voir une identité entre l’acte du chirurgien faisant une césarienne pour donner naissance à la vie et l’acte de l’assassin éventrant sa victime pour lui donner la mort, par le fait que l’un et l’autre se servent d’instrument qui se ressemblent : le couteau exerçant sur un même objet : le ventre, et une même technique apparemment fort semblable : celle d’ouvrir le ventre. Ce qui importe au plus haut point ce n’est pas de répéter : violence, violence, mais de souligner fortement leur différence essentielle et dégager le plus clairement possible ce en quoi, pourquoi et comment la violence du prolétariat se distingue et diffère de la terreur et du terrorisme des autres classes ».
Pour renverser le capitalisme et construire la véritable communauté humaine mondiale, la classe ouvrière sera obligée, dans le futur, de se défendre aussi par la violence contre la terreur de l’État capitaliste et de toutes les forces d’appoint de son appareil répressif, mais la violence de classe du prolétariat n’a strictement rien à voir avec les méthodes des émeutes des banlieues.
Dans les années à venir, le capitalisme va continuer de plonger dans la crise économique, dans la guerre, dans la dévastation écologique, dans la barbarie. Deux types de mouvements vont se développer : d’un côté, les réactions de désespoir et les explosions de violence nihiliste ; de l’autre, les mouvements sociaux sur le terrain de la classe ouvrière, avec toutes ses faiblesses, mais porteuse de solidarité, de discussion et d’espoir.
Si, pour les révolutionnaires, toutes les réactions des opprimés, tous les cris de douleur et de révolte, attirent la sympathie, la vraie solidarité est celle qui pointe les pièges et les impasses, celle qui participe au développement de la conscience ouvrière, à son organisation et à sa perspective révolutionnaire.
L’effort collectif de clarification doit se poursuivre, parce qu’il s’agit là, à terme, d’une question vitale pour la lutte de la classe ouvrière, et donc pour toute l’humanité.
Pawel, 3 octobre 2023
1 Marx, Lutte de classe en France (1850).
2 Quant à l’appui historique qu’espère trouver le camarade auprès de l’OCR (« Un exemple parmi d’autres est le groupe résistant du troisième camp OCR pendant la Seconde Guerre mondiale qui mentionne parmi les luttes politiques à caractère prolétarien, les luttes anti-police et les émeutes à caractère revendicatif »), c’est un appui qui se dérobe et finit de faire trébucher Tibor. Rappelons simplement ce qu’écrivaient nos ancêtres d’Internationalisme en août 1946 à ce sujet : les OCR ont « séjourné trop longtemps dans le trotskisme, d’où ils ne se sont dégagés que très tard, reproduisant encore, cette agitation pour l’agitation, c’est-à-dire l’agitation dans le vide, faisant de cela le fondement de leur existence en tant que groupe. [...] Dans l’échec de l’OCR, ils ne voient pas la rançon de la formation précipitée d’une organisation qu’ils voulaient achever, et qui fut en réalité artificielle, hétérogène, groupant des militants sur un vague programme d’action, imprécis et inconsistant. » (Internationalisme n° 12). De la quarantaine de militants constituants l’OCR en 1944, seulement un an après, dès la fin de la guerre, une partie rejoint le bordiguisme et l’autre moitié se tourne vers… l’anarchisme. Cette organisation disparaîtra totalement en 1946. Cette référence historique qui mène à la faillite n’est pas due au hasard, elle est le résultat logique de la position défendue par le camarade. C’est vers ce genre de références et d’exemples que mène le chemin emprunté par ce courrier.
3 « Les CRS à la Sorbonne : Non à la répression des enfants de la classe ouvrière ! [704] » (Tract de 2006).
4 Histoire de la Révolution russe (1931).
Vie du CCI:
- Courrier des lecteurs [252]
Récent et en cours:
- Emeutes [690]
Rubrique:
L’anarchisme au service de la guerre
- 160 lectures

Comme nous avons pu le rappeler dans bon nombre de nos articles, les gauchistes sont les pires et les plus sournois va-t-en-guerre. Ils utilisent un langage « marxisant » et toutes sortes de contorsions pour tenter de pousser les prolétaires à accepter non seulement de soutenir un camp dans les conflits impérialistes, mais aussi, quand c’est possible, de les enrôler comme chair à canon. Si les trotskistes sont de fervents défenseurs du militarisme, les anarchistes ne sont pas en reste. (1) Eux aussi s’avèrent être des sergents recruteurs de la pire espèce et mêmes de très bons petits soldats. Ainsi, comme le démontre un lien sur un site anarchiste [705] en rapport avec la CNT « Vignoles », une réunion publique tenue par des anarchistes ukrainiens déverse une infâme propagande guerrière. Ces rabatteurs pour le massacre impérialiste s’expriment de la sorte : « Nous, “Колективи Солідарності / Solidarity Collectives” (anciennement “Operation Solidarity”), sommes un groupe anti-autoritaire d’Ukrainiennes et Ukrainiens qui se sont regroupé·es lorsque l’invasion russe a commencé. Notre objectif est de soutenir nos camarades qui se battent au front et d’aider celles et ceux qui sont victimes de l’invasion russe […] L’Ukraine n’a pas d’autre choix, globalement, que de se défendre par les armes. C’est pourquoi de nombreux Ukrainiens et Ukrainiennes, y compris des camarades anti-autoritaires, voir anti-militaristes, ont rejoint des unités armées, volontairement et consciemment ». (2) En promouvant de façon aussi cynique et décomplexée le recrutement pour le front, ces anarchistes assument pleinement leur rôle de rabatteurs pour le massacre impérialiste et alimenter le militarisme.
Ces crapules, qui font la grande fierté de la CNT « Vignoles », osent même réclamer… des équipements militaires ! Parmi les beaux jouets demandés, on se contentera de ne relever qu’un petit échantillon :
– Motorola DP 4400 digital
– walkie-talkies
– DJ Mavic 3 or 3 pro or 3T
– drones (not classic version)
– off road vehicles 4X4 (L200, navarra, hilux, T5 or equivalent)
– Thermal imagers Pvs-14
– Active military headphones (ear defender headphones)
– starlink satellites
ou encore :
– Ballistic helmets
– ballistic prospective plates
– optics for rifles, etc.
Comme on peut le constater, ces « anti-autoritaires » ajoutent ainsi leur ignoble contribution au chaos mondial en se vautrant sans vergogne dans la fange du militarisme. La classe ouvrière doit rester sourde face à leurs cris guerriers qui n’expriment que la barbarie guerrière, celle qu’alimente au quotidien la putréfaction du capital.
WH, 10 octobre 2023
1 Il faut cependant souligner que certains anarchistes se situent sur le terrain de l’internationalisme, comme le KRAS en Russie. Nous renvoyons à notre série d’articles sur « les anarchistes et la guerre » :
– « Les anarchistes et la guerre (1ᵉ partie) [706] ».
– « Les anarchistes et la guerre (2ᵉ partie) : la participation des anarchistes à la Seconde Guerre mondiale [192] ».
– « Les anarchistes et la guerre (3ᵉ partie) : de la Seconde Guerre mondiale à aujourd’hui [707] ».
2 Souligné par nous.
Récent et en cours:
- Guerre en Ukraine [397]
- CNT [708]
Courants politiques:
- Anarchisme officiel [662]
Rubrique:
“Révolution Permanente”, une organisation gauchiste comme les autres: au service du capital!
- 629 lectures
Deux ans à peine après sa scission avec le NPA, au sein duquel elle avait œuvré pendant près d’une décennie, Révolution Permanente (RP), nouvelle organisation dans le paysage trotskiste, est presque devenue un succès médiatique. Présente dans les manifestations, dans les universités, dans les entreprises et le web, son discours est très attractif : appel à la solidarité, à la lutte radicale, à se soutenir, à défendre les minorités opprimées, critique des centrales syndicales et des élections, défense de l’auto-organisation des ouvriers, soutient officiel à l’internationalisme…
Tout au long du mouvement contre la réforme des retraites, RP a su adapter son discours à l’état d’esprit du prolétariat. Alors que les manifestations éparses organisées par les syndicats n’étaient pas à la hauteur de la combativité et du mécontentement des ouvriers, RP dénonçait les « dates isolées posées par l’intersyndicale […] très en dessous des potentialités et des aspirations présentes à la base ».
Ce discours en apparence novateur et radical a de quoi séduire. En réalité, la bourgeoisie a clairement perçu la reprise de la combativité au sein de la classe ouvrière et l’émergence d’une réflexion au sein de minorités en recherche des positions de classe. Avec RP, la bourgeoisie s’est dotée d’un nouvel outil plus performant, disposant visiblement de moyens conséquents, et tout aussi bourgeois que le NPA. Car dans la stricte continuité du trotskisme, RP ne fait que recycler les vieilles positions traditionnelles de l’extrême gauche du capital.
RP, la voiture balais du syndicalisme
« Face à la stratégie de la défaite de l’intersyndicale, la grève du 28 mars doit poser la question de l’organisation à la base pour élargir la grève, soutenir la mobilisation des secteurs en reconductible et organiser la solidarité contre la répression policière ». En effet, la stratégie de luttes des syndicats a fait l’objet de critiques dans de petites minorités ouvrières. Pourquoi éloigner autant les dates de manifestations les unes des autres ? Pourquoi si peu d’assemblées générales et de discussions à la fin des manifestations ? Pourquoi, malgré une intersyndicale « unie comme jamais », nous ne parvenons pas à faire reculer le gouvernement ? À toutes ces questions, RP répond, en apparence de manière radicale : « Dans l’époque actuelle de crise impérialiste, les syndicats et leurs directions sont devenus des outils du capitalisme ».
Mais derrière ces faux discours révolutionnaires se cache un piège subtil et vieux comme le gauchisme : afin de semer la confusion sur la nature bourgeoise et étatique de toutes les organisations syndicales, RP introduit une distinction entre « les dirigeants syndicaux » et les ouvriers de « la base ». Ce n’est pas le syndicalisme qui n’est plus adaptée au besoin de la lutte et a fini par s’intégrer à l’appareil d’État, c’est un problème de bureaucrates véreux et traîtres. Et, en toute logique, après avoir dit que les syndicats sont des « outils du capitalisme », RP ajoute aussitôt : « les travailleurs de base doivent se battre pour arracher le contrôle aux bureaucraties et pour vaincre les directions syndicales afin de contrôler démocratiquement leurs syndicats, en les utilisant comme des outils de lutte de classe contre les patrons et l’État ». RP cache ainsi la réelle fonction des syndicats au sein de l’appareil d’État : saboter les luttes de la classe ouvrière, la réduire à l’impuissance en l’enserrant dans le périmètre de l’ordre bourgeois.
Cette nouvelle mouture de gauchisme utilise les mêmes vieilles ficelles que tous les groupes trotskistes avant elle : adopter un discours radical envers les syndicats pour mieux rabattre la classe ouvrière vers… le syndicalisme. Ce double langage est typique des organisations trotskistes qui disent une chose et son contraire, afin de semer délibérément la confusion.
L’entrisme ou le noyautage pour « réorienter les syndicats dans la bonne direction » est pratiquée depuis des lustres par les ancêtres de RP. Cette pratique a enfermé et mystifié des générations d’ouvriers pour les orienter vers les pièges du radicalisme syndical, détournant la question centrale de l’auto-organisation, c’est-à-dire la prise en main des luttes par les ouvriers eux-mêmes en dehors et contre les syndicats.
L’histoire du mouvement ouvrier nous enseigne exactement l’inverse de ce que prétend RP. En 1980 en Pologne, par exemple, faisant face à une énième attaque contre leurs conditions de vie (en l’occurrence, une augmentation de 60 % du prix de la viande), les ouvriers se sont mis en grève spontanément et ont su étendre rapidement leur grève de masse à tout le pays, menaçant même de l’étendre au-delà. Leur arme ? L’auto-organisation et la tenue d’assemblées générales (appelées MKS) ! Les ouvriers ne se sont pas contentés de faire des déclarations, ils ont pris eux-mêmes l’initiative des luttes et de leur extension, sans les syndicats qui étaient directement perçus comme intégrés à l’État stalinien. Cette dynamique a rendu possible le développement d’un rapport de forces favorable aux ouvriers. Les assemblées générales étaient ouvertes et retransmises en direct par des hauts parleurs dans la rue, là où se trouvaient les masses, les délégués étaient révocables. Si ces derniers ne défendaient pas correctement les positions pour lesquelles ils étaient mandatés, les assemblées en changeaient. Ce mouvement tenu entre les mains de la classe a fait trembler toute la bourgeoisie polonaise et internationale !
C’est d’ailleurs pourquoi les bourgeoisies européennes sont vite venues en aide au gouvernement polonais… avec la création d’un nouveau syndicat ! Pour combler le vide laissé par un syndicat officiel totalement discrédité et mettre un terme à la prise en main de la lutte par les ouvriers eux-mêmes, la bourgeoisie a créé de toute pièce Solidarnosc, avec le soutien actif du syndicat « radical » de l’époque : la CFDT française. Présenté comme un syndicat libre, moderne, démocratique, avec à sa tête un ouvrier réputé très combatif, Lech Walésa, Solidarnosc pouvait avoir la confiance des travailleurs pour mieux les déposséder de la lutte et reprendre la conduite du mouvement dans un seul intérêt : celui de l’État.
Le résultat fut immédiat : finis les haut-parleurs pour suivre les négociations (à cause de soi-disant problèmes « techniques »), finis les délégués révocables, finies les Assemblées souveraines… les « experts de la lutte » étaient là. Le travail de sabotage avait commencé. Les revendications à l’origine d’ordre politique et économique (entre autre, revalorisation des salaires) se centraient désormais sur les intérêts des syndicats (la reconnaissance de syndicats indépendants) plutôt que sur ceux des ouvriers. Progressivement, Lech Walesa a éteint toute velléité de lutte : « Nous n’avons plus besoin d’autres grèves car elles poussent notre pays vers l’abîme, il faut se calmer ».
Pour terminer, fin 1981 et courant 1982, les derniers bastions de combativité, isolés et épuisés, ont été violemment réprimés : arrestations et répressions meurtrières furent les conséquences du travail de sape de Solidarnosc ! Et l’ancien syndicaliste Walésa deviendra même par la suite…chef de l’État polonais.
Le syndicalisme « de base », cette marchandise toxique que nous vend RP et toutes les autres organisations trotskistes avant elle, n’est que de la poudre aux yeux pour mieux cacher la réalité : quel que soit le nom qu’on lui donne, une instance syndicale est une arme de la bourgeoisie contre la classe ouvrière !
RP et la camelote des « coordinations »
Pour enfoncer un peu plus le clou de sa pseudo-radicalité ouvrière, RP reprend à son compte toutes les entourloupes trotskistes sur le travail des « coordinations » ! « Alors que le mouvement contre la réforme des retraites et le gouvernement Macron s’intensifie dans la jeunesse, la coordination des assemblée générales des universités mobilisés est un enjeu clé pour arracher une victoire. En ce sens, la construction de la coordination nationale étudiante du 1ᵉʳ et 2 avril prochain est une tâche centrale pour tous les étudiant.es mobilisés ». Pour démystifier ce discours d’apparence radicale et d’intransigeance, il suffit encore de rappeler l’expérience du mouvement ouvrier.
Fin des années 1980, en France, ont eu lieu plusieurs vagues de luttes, toutes happées par des « coordinations », alors que la confiance dans les syndicats était largement entamée suite à vingt années de sabotage systématique des luttes. En 1988, nous dénoncions ces manœuvres : les coordinations « surgissent, ou apparaissent au grand jour, au moment des mobilisations de la classe ouvrière dans un secteur et disparaissent avec elles. Il en a été ainsi, par exemple, des coordinations qui avaient surgi lors de la grève dans les chemins de fer en France fin 1986. Et c’est justement ce caractère “éphémère” qui, en donnant l’impression qu’ils sont des organes constitués par la classe spécifiquement pour et dans la lutte, qui les rend d’autant plus pernicieux ». « En réalité, l’expérience nous a montré que de tels organes, quand ils n’étaient pas préparés depuis de longs mois à l’avance par des forces politiques précises de la bourgeoisie, étaient “parachutés” par celles-ci sur un mouvement de luttes en vue de son sabotage. Déjà, dans la grève des chemins de fer en France, nous avions pu constater comment la “coordination des agents de conduite”, en fermant complètement ses assemblées à tous ceux qui n’étaient pas conducteurs, avait contribué de façon très importante à l’isolement du mouvement et à sa défaite. Or cette “coordination” s’était constituée sur la base de délégués élus par les assemblées générales des dépôts. Pourtant, elle avait été immédiatement contrôlée par des militants de la Ligue Communiste (section de la 4ᵉ Internationale trotskiste) [ancêtre du NPA et de RP] qui, évidemment, ont pris en charge le sabotage de la lutte comme c’est leur rôle. Mais avec les autres “coordinations” qui ont surgi par la suite, déjà avec la « coordination inter-catégorielle des cheminots » (qui prétendait combattre l’isolement corporatiste), et plus encore avec la « coordination des instituteurs » qui est apparue quelques semaines après, on a constaté que ces organes étaient constitués de façon préventive avant que les assemblées générales n’aient commencé à envoyer des délégués. Et à l’origine de cette constitution on retrouvait toujours une force bourgeoise de gauche ou gauchiste, preuve que la bourgeoisie avait compris le parti qu’elle pouvait tirer de ces organismes ». (1) Ces coordinations étaient parfois elles-mêmes des sous-marins syndicaux, animées par des syndicalistes « de base » dont la casquette enlevée était souvent celle d’un syndicat officiel ou d’une officine trotskiste.
RP, promoteur des luttes parcellaires
Pour se présenter comme une authentique organisation prolétarienne, RP met en avant la défense des intérêts des plus faibles. Dès leur page d’accueil, on peut y voir en bonne place des thématiques telles que « Racisme et violences d’État » ou « Genre et sexualités ». Dans ce monde pourrissant, les idéologies les plus nauséabondes se frayent de plus en plus facilement un chemin. Et c’est avec dégoût et horreur que l’on voit s’exacerber les discriminations, le racisme, l’homophobie…
Alors oui, ça révolte ! Ça donne envie de hurler de colère ! Ça donne envie de se battre tout de suite, là, maintenant ! Pour cela, RP se prétend « du côté des travailleurs, de la jeunesse, des femmes, des personnes LGBT, des quartiers populaires et de tous les exploités et opprimés ». Mais suivre RP est encore un véritable piège !
Les luttes parcellaires représentent un danger pour la classe, en particulier pour la jeune génération de travailleurs sans expérience mais profondément révoltée par l’état de la société. Aujourd’hui, le prolétariat a perdu ses repères, il ne se reconnaît plus en tant que classe révolutionnaire. C’est pourtant la première étape pour retrouver le chemin du combat révolutionnaire, seul à même de mettre fin à toutes les inégalités révoltantes faites aux femmes, aux homosexuels, aux étrangers et à toutes les autres conséquences de ce monde en putréfaction que sont la crise environnementale, la faim dans le monde, les violences racistes de la police, etc. Et il n’y a que la classe ouvrière, seule classe révolutionnaire, qui puisse changer cet état de fait !
RP, en mettant en avant les oppressions « des travailleurs, de la jeunesse, des femmes, des personnes LGBT, des quartiers populaires et de tous les exploités et opprimés » cherche, en fait, à diluer la classe ouvrière et à la détourne vers des luttes parcellaires qui ne sont que des impasses.
Concrètement, quand un mouvement démarre contre le racisme, contre l’inégalité homme-femme, contre la violence policière… l’objectif de la plupart des manifestants est de faire reculer le racisme, l’inégalité homme-femme, etc. Autrement dit : d’aménager le capitalisme, de le rendre plus « humain » ou « démocratique ». Quand la classe ouvrière se met en lutte contre ses conditions de travail et de vie, elle se bat contre ce qui fonde le capitalisme : l’exploitation. C’est pourquoi, fondamentalement, derrière chaque grève se cache la question de la révolution. Et c’est seulement cette dynamique qui peut réellement s’attaquer aux racines de la discrimination et des inégalités.
En prônant les luttes parcellaires, RP, dans la continuité du NPA, empêche le prolétariat de développer sa réflexion en tant que classe exploitée. En prônant les luttes parcellaires, RP ramène les ouvriers sur le terrain des luttes interclassistes et petites bourgeoises, celle de l’aménagement du capitalisme alors que celui-ci va être de plus en plus barbare et inégalitaire. RP empêche toute réflexion prolétarienne de se développer en cherchant à effacer l’identité de classe pour la remplacer par celle des femmes ou des noirs ou de toute minorité opprimée !
RP reprend donc tout le savoir faire du trotskisme, avec un semblant de toilettage, pour mieux rabattre les ouvriers les plus combatifs et les plus conscients sur le terrain de la bourgeoisie et pourrir la réflexion des ouvriers en recherche des positions de classes. Même double discours hypocrite et mystificateur que le NPA, la LCR ou LO avant elle, tant sur les syndicats et les moyens de la lutte, que sur les élections, les luttes parcellaires. Depuis son soutien « critique » à l’impérialisme russe durant la Seconde Guerre mondiale, le trotskisme est définitivement passé dans le camp de la bourgeoise. RP, nouvelle officine de la bourgeoisie, ne fait pas exception !
Élise, 15 septembre 2023.
1 Octobre 1988 : Bilan de la lutte des infirmières (…) Les coordinations : la nouvelle arme de la bourgeoisie [709]. Cette brochure est disponible en ligne sur notre site web.
Récent et en cours:
- Réforme des retraites [526]
- Révolution Permanente [568]
Courants politiques:
- Trotskysme [468]
Rubrique:
Séisme au Maroc et inondations en Libye: le capitalisme est un système criminel
- 42 lectures
Le tremblement de terre qui a frappé le Maroc, le 8 septembre derniers, et les inondations spectaculaires suite à la rupture de deux barrages en Libye, peu de temps après, nous confrontent de nouveau à l’horreur quotidienne et à la folie meurtrière du capitalisme.
La responsabilité du capitalisme
Après la Turquie, où la terre a tremblé cet hiver, faisant 46 000 victimes et déplaçant deux millions de personnes dans des tentes de fortune, c’est au tour de la Libye et du Maroc de plonger dans le deuil. Le tremblement de terre très violent au Maroc, d’une magnitude de 7 sur l’échelle de Richter, s’explique par le fait d’une région traversée par des lignes de failles où les secousses d’ampleurs peuvent se produire en faisant de nombreux dégâts et victimes. Dans les années 1960, la ville d’Agadir au Maroc avait déjà été détruite a plus de 70 % et plus de 12 000 personnes avaient péri au cours de ce grand séisme. En 2004, plus de 600 morts avaient été déplorés à Al Hoceïma. Tout comme les pluies diluviennes qui se sont déversées en Libye, ces phénomènes sont toujours présentés par la bourgeoisie comme de simples conséquences des caprices de la nature. L’humanité paraît ainsi comme impuissante face à ce qui ressemble à une fatalité, exposée à d’implacables lois de la nature.
Mais si tous ces phénomènes sont bien naturels, les catastrophes qu’ils engendrent ne le sont nullement ! Non seulement elles se multiplient et s’accumulent du fait du réchauffement climatiques ou d’infrastructures vétustes, mais elles transforment toujours davantage ces situations en véritables catastrophes sociales. Ainsi, en Libye, le chiffre des inondations impressionne et donne le vertige : dans la ville du Nord-est de Derna, l’OMS évoque un chiffre, jugé très en deçà de la réalité, proche des 4 000 morts. Une véritable hécatombe ! Et la responsabilité de la bourgeoisie dans la catastrophe est nettement plus visible qu’au Maroc. Elle saute clairement aux yeux ! La terrible destruction de Derna n’est pas uniquement due à la tempête Daniel, mais essentiellement au fait que les deux barrages qui se sont effondrés n’ont pas été entretenus malgré les avertissements désespérés sur leur état de délabrement. L’effondrement de l’État libyen et l’absence totale de toute forme d’infrastructure opérationnelle et d’une réponse coordonnée ont très fortement aggravé l’impact de la catastrophe.
Ces événements constituent un nouveau réquisitoire contre le capitalisme. Ce sont les populations les plus pauvres qui sont exposées et sacrifiées sur l’autel du profit et de lois, non pas « naturelles », mais liées à la logique marchande propre au capitalisme et à sa dynamique mortifère. Dans la province d’Al Haouz, au sud-ouest de Marrakech, c’est dans les quartiers populaires ou dans les zones rurales pauvres excentrées et délaissés que les victimes et les destructions ont été les plus nombreuses. Les constructions à étages souples, meilleur marché, se sont systématiquement effondrées. Non seulement les bâtiments construits au rabais sont légions, mais les normes antisismiques datant de 2002 restent sans effets dans ces périmètres aux bâtis vétustes. Or c’est ici que vit la grande majorité des prolétaires et des couches populaires, en contraste avec les beaux quartiers beaucoup moins affectés, voire épargnés. Il en va de même pour les espaces inondés de Libye où les plus pauvres étaient les plus exposés. La monstruosité d’un mode de production obsolète et chaotique provoque des souffrances sans fin et des destructions massives.
Le cynisme de la bourgeoisie
La corruption et l’incurie de la classe dominante, l’absence de prévention et d’anticipation, les populations doivent désormais supporter le cynisme et l’abandon au profit de la débrouille individuelle. Les enfants eux-mêmes sont mis à contribution dans les décombres ! Alors que lors des guerres, comme en Ukraine, les moyens de destruction déployés avec une logistique impressionnante et une organisation millimétrée sont sans commune mesure, les secours proposés aux populations victimes des catastrophes paraissent indigents. Le chaos et la cacophonie sur les lieux des sinistres (quand il y a des secours !) révèlent encore et toujours le vrai visage du capitalisme et de la classe dominante.
Le piège serait de voir un élan de « solidarité » véritable dans les propositions d’aide des différents États et structures internationales humanitaires. Il s’agit, au contraire, d’une « ingérence » à peine masquée, d’une couverture permettant aux pays impliqués dans les secours d’étendre leur influence, de renforcer leurs positions pour défendre leurs sordides intérêts : ce que l’on appelle pudiquement le « soft power ». Durant les années 1990-2000, il faut se souvenir que c’est au nom d’interventions « humanitaires », sous la couverture de l’ONU et des ONG complices que les grandes puissances impérialistes avançaient leurs pions dans des zones géostratégiques, notamment en Afrique et au Moyen-Orient. Cela, au plus grand bénéfice du « hard power » que sont les armes ! Les combats pour les marchés de la reconstruction sont, au fond, secondaires. Les mensonges et l’hypocrisie de la bourgeoisie en matière humanitaire n’ont d’ailleurs plus de limites !
De l’autre côté, il existe une rhétorique chauvine et nationaliste répugnante qui refuse « l’aide étrangère » au motif que « le Maroc peut se débrouiller seul ». Le refus de l’aide française au profit d’autres pays comme le Qatar relevait très explicitement d’une rivalité impérialiste. Et tant pis pour le bon peuple de Sa Majesté qui crèvera en silence pour la « grandeur » du Royaume marocain !
Avec l’accélération de la décomposition du système capitaliste, tous ces phénomènes destructeurs seront de plus en plus fréquents et amplifiés par le contexte de chaos croissant, de crise économique aiguë où les conflits guerriers, comme celui qui sévit en Ukraine, vont se développer. A, 29 septembreGéographique:
Récent et en cours:
- Séisme au Maroc [710]
- inondations en Libye [711]
Rubrique:
ICConline - novembre 2023
- 42 lectures
Permanence en ligne du 2 décembre 2023
- 69 lectures
Le Courant communiste international organise une permanence en ligne le samedi 2 décembre 2023 à 15h.
Ces permanences sont des lieux de débat ouverts à tous ceux qui souhaitent rencontrer et discuter avec le CCI. Nous invitons vivement tous nos lecteurs, contacts et sympathisants à venir y débattre afin de poursuivre la réflexion sur les enjeux de la situation et confronter les points de vue.
Les lecteurs qui souhaitent participer aux permanences en ligne peuvent adresser un message sur notre adresse électronique ([email protected] [213]) ou dans la rubrique “contact [214]” de notre site internet, en signalant quelles questions ils voudraient aborder afin de nous permettre d’organiser au mieux les débats. Les modalités techniques pour se connecter à la permanence seront communiquées par retour de courriel.
Vie du CCI:
- Permanences [291]
Rubrique:
Guerre au Proche-Orient: un pas supplémentaire dans la barbarie et le chaos mondial
- 201 lectures
Le 7 octobre, sous une pluie de roquettes, une horde d’islamistes rependait la terreur sur les localités israéliennes entourant la bande de Gaza. Au nom d’une « juste vengeance » contre « les crimes de l’occupation », au nom des « musulmans du monde entier » contre le « régime sionisme », le Hamas et ses alliés ont lancé des milliers de « combattants » fanatisés commettre les pires atrocités sur des civils sans défense, des femmes, des vieillards et même des enfants. La sauvagerie du Hamas n’a eu aucune limite : assassinats, viols, tortures, enlèvements, des écoles ciblées, des innocents pourchassés jusque dans leur maison, des milliers de blessés…
Les ignobles exactions du Hamas à peine repoussées, Tsahal déchaînait à son tour toute sa puissance meurtrière sur la bande de Gaza au nom du combat de « la lumière » contre « les ténèbres ». À l’heure où nous écrivons ces lignes, l’aviation israélienne bombarde sans relâche l’enclave surpeuplée sur laquelle règne le Hamas, emportant sans distinctions civiles et terroristes, tandis que Tsahal vient de couper la bande de Gaza en deux et d’encercler sa capitale. En faisant « pleuvoir le feu de l’enfer sur le Hamas », le gouvernement de Netanyahou rase aveuglément les habitations et emporte lui aussi dans la tombe des milliers de victimes innocentes, dont plusieurs milliers d’enfants.
Un conflit totalement irrationnel
L’attaque du Hamas a sidéré le monde entier. Israël, un État dont la bourgeoisie cultive jour après jour, année après année, un sentiment de citadelle assiégée dans la population, un État doté de services de renseignement, le Mossad et le Shin Bet, parmi les plus réputés du monde, un État allié de longue date des États-Unis et leur arsenal de surveillance… Israël n’a, semble-t-il, rien vu venir : ni les exercices suspects du Hamas, ni la concentration des milliers de roquettes et d’hommes. L’État hébreu n’a pas non plus tenu compte des multiples avertissements, notamment ceux de l’Égypte voisine.
Plusieurs hypothèses peuvent expliquer cette surprise :
– Netanyahou et sa clique sont tellement divisés et stupides, marqués par le poids du populisme et des pires aberrations religieuses, centrés sur la défense de leurs petits intérêts immédiat et obsédés par le contrôle de la Cisjordanie et la « reconquête de la terre promise », qu’ils ont peut-être sous-estimé l’imminence de l’attaque en concentrant les forces de Tsahal dans cette région.
– Tellement contestée par une partie de la bourgeoisie israélienne, de l’armée et des services secrets, il est aussi possible que Netanyahou ait délibérément ignoré les alertes pour tenter de reprendre le contrôle de la situation politique en Israël en réalisant « l’union nationale ». Comme il est tout à fait possible qu’une partie de l’appareil d’État n’ait pas informé le gouvernement de l’imminence de l’attaque pour l’affaiblir davantage.
Ce qui est sûr, en tout cas, c’est qu’avant le 7 octobre, Netanyahou a fait tout son possible pour renforcer le pouvoir et les moyens du Hamas dans la mesure où cette organisation était, comme lui et l’ensemble de la droite Israélienne, totalement opposée aux accords d’Oslo de 1993 (1) qui prévoyaient une autonomie de la Palestine. C’est « Bibi » lui-même qui a revendiqué cette politique : « Quiconque veut contrecarrer la création d’un État palestinien doit soutenir le renforcement du Hamas et transférer de l’argent au Hamas. Cela fait partie de notre stratégie » Ces propos ont été tenus par Netanyahou le 11 mars 2019 aux députés du Likoud (rapportés par le grand quotidien israélien Haaretz du 9 octobre dernier).
Pour le moment, il est difficile de déterminer les causes de ce fiasco des forces de sécurité israéliennes. Mais chacune des deux hypothèses, tout comme la dynamique dans laquelle s’enfonce le Moyen-Orient révèlent le chaos croissant qui règne dans l’appareil politique de la bourgeoisie israélienne : instabilité des coalitions gouvernementales, corruption massive, procès pour fraude, magouilles législatives, réforme judiciaire très contestée qui dissimule mal des règlements de comptes au sein de l’appareil d’État, délires suprémacistes des ultra-orthodoxes… Tout cela dans un contexte de hausse de l’inflation et d’explosion considérable de la pauvreté.
Quant aux prétendus « résistants » du Hamas, la présence-même de cette organisation, concurrente d’une OLP pourrie jusqu’à la moelle, à la tête de la bande de Gaza est une expression caricaturale du chaos et de l’irrationalité dans laquelle a plongé la bourgeoisie palestinienne. Quand le Hamas ne réprime pas dans le sang les manifestations contre la misère comme en mars 2019 (ce qui laisse suffisamment entrevoir le sort du « peuple palestinien » une fois « libéré » du « colonialisme sioniste »…), quand ses dirigeants mafieux ne se gavent pas d’aides internationales (le Hamas est une des plus riches organisations terroristes de la planète), quand il ne fomente pas d’attaques terroristes, ce groupe sanguinaire prêche une idéologie des plus obscurantistes, racistes et délirantes.
L’État d’Israël et le Hamas, à des moments et avec des moyens différents, ont pratiqué la politique du pire qui a conduit aux massacres d’aujourd’hui. Une politique qui, en fin de compte, ne pourra bénéficier à aucun des deux belligérants mais qui va étendre encore plus les destructions et la barbarie.
L’accélération du chaos au niveau mondial
Le conflit israélo-palestinien n’a évidemment rien d’un conflit strictement local. Moins de deux ans après le déclenchement de la guerre en Ukraine, alors que toute une série de conflits se ravivent dans les Balkans, dans le Caucase ou le Sahel, cette conflagration sanglante n’est pas qu’un énième épisode d’un conflit qui dure depuis des décennies. Il s’agit, au contraire, d’une nouvelle étape significative dans l’accélération du chaos mondial.
Dans un avenir proche, l’hypothèse qu’Israël soit contraint de mener une guerre sur trois fronts contre le Hamas, le Hezbollah et l’Iran n’est pas à écarter. Une extension du conflit aurait des répercussions mondiales majeures avec, en premier lieu, un énorme afflux de réfugiés venus de Gaza ou de la Cisjordanie et la déstabilisation des pays limitrophes d’Israël. Elle aurait également des conséquences immédiates particulièrement dévastatrices pour l’ensemble de l’économie mondiale, compte tenue de l’importance du Moyen-Orient dans la production d’hydrocarbures.
L’importation du conflit en Europe, avec une série d’attentats meurtriers, n’est aussi pas à négliger. Déjà, un attentat revendiqué par l’État islamique a été perpétré en Belgique. Un professeur a également été sauvagement assassiné en France le 13 octobre par un jeune islamiste, moins d’une semaine après l’offensive du Hamas.
Mais il ne suffit pas d’attendre l’extension du conflit pour en mesurer la dimension immédiatement internationale. (2) L’ampleur de l’attaque du Hamas et le niveau de préparation qu’elle a exigé laissent peu de doutes sur l’implication de l’Iran qui est visiblement prête à mettre le feu à toute la région pour la défense de ses intérêts stratégiques immédiats et tenter de sortir de l’isolement. C’est un véritable piège qu’a tendu la République islamique à Netanyahou. C’est aussi la raison pour laquelle Téhéran et ses alliés ont multiplié les provocations avec les tirs de missiles du Hezbollah et des Houthis (Yémen) sur des positions israéliennes. La Russie a sans doute également joué un rôle dans l’offensive du Hamas : c’est un moyen, du moins elle l’espère, de fragiliser le soutien des États-Unis et de l’Europe à l’Ukraine.
Même si la violence ne devait pas se répandre à tout le Moyen-Orient dans l’immédiat, la dynamique de la déstabilisation est inéluctable. À ce titre, la situation ne peut qu’inquiéter la Chine : cela fragiliserait, non seulement, son approvisionnement en hydrocarbures, mais représenterait aussi une entrave considérable à la construction de ses « routes de la soie » avec ces gigantesques infrastructures portuaires, ferroviaires ou d’hydrocarbures. Cependant, la Chine, qui se retrouve ici dans une position ambivalente, pourrait également contribuer au chaos en finissant par soutenir ouvertement l’Iran, espérant ainsi desserrer la pression américaine dans le Pacifique.
Ce conflit montre à quel point chaque état applique de plus en plus, pour défendre ses intérêts, une politique de « terre brûlée », en cherchant, non plus à gagner en influence ou conquérir des intérêts, mais à semer le chaos et la destruction chez ses rivaux.
Cette tendance à l’irrationalité stratégique, aux visions à court terme, à l’instabilité des alliances et au chacun pour soi n’est pas une politique arbitraire de tel ou tel État, ni le produit de la seule stupidité de telle ou telle fraction bourgeoise au pouvoir. Elle est la conséquence des conditions historique, celles de la décomposition du capitalisme, dans lesquelles s’affrontent tous les États. (3) Avec le déclenchement de la guerre en Ukraine, cette tendance historique et le poids du militarisme sur la société se sont profondément aggravés. Le conflit israélo-palestinien confirme à quel point la guerre impérialiste est désormais le principal facteur de déstabilisation de la société capitaliste. Produit des contradictions du capitalisme, le souffle de la guerre nourrit en retour le feu de ces mêmes contradictions, accroissant, par le poids du militarisme, la crise économique, le désastre environnemental, le démembrement de la société… Cette dynamique tend à pourrir tous les pans de la société, à affaiblir toutes les nations, à commencer par la première d’entre elles : les États-Unis.
L’affaiblissement irrémédiable du leadership américain
Les chefs d’État occidentaux se sont précipités au chevet d’Israël avec, dans un premier temps, une certaine fébrilité et des doutes sur la meilleure manière de gérer la situation. On a ainsi vu le président français, une fois n’est pas coutume, se ridiculiser dans un grand-écart diplomatique, appelant à mobiliser contre le Hamas la coalition créée en 2014 contre l’État islamique, avant de piteusement rétropédaler dans la soirée.
En se ruant à Tel Aviv et dans les pays voisins d’Israël, les puissances européennes cherchent à profiter de la situation pour reprendre pieds dans la région. Mais c’est encore Biden qui a donné le ton en tentant de faire pression sur Israël pour éviter un bain de sang trop important dans Gaza. Il a également envoyé deux porte-avions dans la zone afin d’adresser un message de fermeté au Hezbollah et à l’Iran.
Lorsque les États-Unis ont opéré, sous l’ère Obama, leur « pivot stratégique » vers l’Asie (politique poursuivie par Trump et Biden), ils n’ont pour autant pas abandonné leur influence au Proche et Moyen-Orient. Washington a œuvré, avec les Accords d’Abraham notamment, à établir un système d’alliance entre Israël et plusieurs pays arabes, en particulier l’Arabie Saoudite, pour contenir les aspirations impérialistes de l’Iran, déléguant à l’État hébreu la responsabilité du maintien de l’ordre.
Mais c’était sans compter la dynamique d’instabilité croissante des alliances et de tendance profonde au chacun pour soi. Car la bourgeoisie israélienne n’a cessé de faire passer ses propres intérêts impérialistes devant ceux des États-Unis. Alors que Washington privilégie une « solution » à deux États, Netanyahou a multiplié les annexions en Cisjordanie, risquant de mettre le feu à la région, tout en comptant sur le soutien militaire et diplomatique américain en cas d’aggravation du conflit. Les États-Unis se retrouvent aujourd’hui mis au pied du mur par Israël, contraints de soutenir la politique irresponsable de Netanyahou.
La réaction pour le moins musclée de Biden montre le peu de confiance que l’administration américaine accorde à la clique de Netanyahou et une inquiétude face à la perspective d’un embrasement catastrophique du Moyen-Orient. Le conflit israélo-palestinien est un nouveau point de pression sur la politique impérialiste des États-Unis, qui pourrait s’avérer calamiteux en cas d’élargissement. Washington devrait alors assumer une présence militaire considérable et un soutien à Israël qui ne pourraient que peser, non seulement sur l’économie américaine, mais également sur son soutien à l’Ukraine et, plus encore, sur sa stratégie pour endiguer l’expansion de la Chine.
Le discours pro-palestinien de la Turquie, membre « incorrigible » de l’OTAN, va également contribuer à affaiblir les États-Unis dans la région, tout comme les tensions entre Israël et plusieurs pays d’Amérique Latine, vont sans doute accentuer les tensions avec son parrain nord-américain. Washington tente donc d’empêcher que la situation échappe à tout contrôle… ambition parfaitement illusoire, à terme, compte tenu de la dynamique funeste dans laquelle sombre le Moyen-Orient.
L’impact de la guerre sur la classe ouvrière
Les images des exactions du Hamas et de Tsahal ont fait le tour du monde et, partout, la bourgeoisie nous a appelés à choisir un camp. Sur toutes les chaînes de télévision et dans tous les journaux, à gauche comme à droite, une immonde propagande belliqueuse, souvent grossière, parfois plus subtile, se déchaîne en intimant à chacun de choisir entre la « résistance palestinienne » et la « démocratie israélienne », comme s’il n’y avait d’autres choix que de soutenir l’une ou l’autre de ces cliques bourgeoises sanguinaires.
Une partie de la bourgeoisie, notamment en Europe et en Amérique du Nord, déchaîne une campagne féroce pour légitimer la guerre et les exactions de l’armée israélienne : « Nous défendons le droit d’Israël d’exister, de se défendre et de garantir la sécurité de son peuple. Et nous comprenons parfaitement qu’il faut combattre le terrorisme » (Meloni). Bien sûr, les bourgeoisies se parent de toutes les vertus humanitaires en déplorant hypocritement les victimes civiles dans la bande de Gaza. Mais, rassurez-vous, bonnes gens, Scholz en est certain : « Israël est un État démocratique guidé par des principes très humanitaires et nous pouvons donc être certains que l’armée israélienne respectera les règles découlant du droit international dans tout ce qu’elle fait ».
La bourgeoisie peut aussi s’appuyer sur ses partis de gauche pour alimenter sa sale propagande nationaliste. Quasiment tous prônent la défense de la Palestine. Leurs discours vont de la prétendue défense des populations palestiniennes victimes des bombardements au soutien sans vergogne des barbares du Hamas. Instrumentalisant le dégoût légitime que suscitent les bombardements à Gaza, des manifestations pro-palestiniennes gigantesques ont ainsi été organisées à Londres ou à Berlin.
Il est vrai que la classe ouvrière n’est aujourd’hui pas en mesure de s’opposer directement à la guerre et ses horreurs. Mais choisir un camp impérialiste contre un autre est un piège mortel. Parce que c’est accepter la logique de la guerre qui est « la haine, les fractures et les divisions entre les êtres humains, la mort pour la mort, l’institutionnalisation de la torture, la soumission, les rapports de force, comme seule logique de l’évolution sociale ». (4) Parce que c’est croire sur parole les mensonges éhontés que la bourgeoise répète à chaque conflit : « Après cette guerre, la paix reviendra ». Parce que c’est surtout se ranger derrière les intérêts de la bourgeoisie (défendre coûte que coûte le capital national quitte à conduire l’humanité dans la tombe) et renoncer au combat pour la seule perspective réellement capable de mettre un terme à la dynamique meurtrière du capitalisme : le combat pour la défense des intérêts historique du prolétariat, le combat pour le communisme.
Les ouvriers en Israël et en Palestine vont très certainement se laisser embarquer, dans leur grande majorité, sur le terrain du nationalisme et de la guerre. Cependant, à travers la série inédite de luttes dans de nombreux pays, en Grande-Bretagne, en France et aux États-Unis notamment, la classe ouvrière a montré qu’elle était capable de se battre, si ce n’est contre la guerre et le militarisme eux-mêmes, mais contre les conséquences économiques de la guerre, contre les sacrifices exigés par la bourgeoisie pour alimenter son économie de guerre. C’est une étape fondamentale dans le développement de la combativité et, à terme, de la conscience de classe. (5) La guerre au Moyen-Orient, avec l’approfondissement de la crise et les besoins supplémentaires en armements qu’elle va engendrer aux quatre coins de la planète, ne fera qu’accroître les conditions objectives de cette rupture.
Mais cette guerre porte en elle des dangers encore imprévisibles pour la classe ouvrière. Si les massacres devaient encore s’aggraver ou s’étendre, le sentiment d’impuissance et les divisions au sein de la classe ouvrière risquent de constituer un obstacle significatif pour le développement de son effort de combativité et de réflexion. Comme en témoignent les manifestations pro-palestiniennes, le conflit au Proche-Orient risque d’avoir un impact très négatif sur la classe ouvrière, particulièrement en France, au Royaume-Uni ou en Allemagne, pays dans lesquels la présence de nombreux juifs et musulmans, conjuguée au discours incendiaire des gouvernements, rend la situation plus qu’explosive.
La guerre israélo-palestinienne provoque sans conteste un sentiment d’impuissance et des déchirures dramatique au sein de la classe ouvrière. Mais l’immensité des dangers et de la tâche à accomplir ne doivent pas nous pousser au fatalisme. Si, aujourd’hui, la classe dominante bourre le crâne des ouvriers avec sa propagande nationaliste et guerrière, la crise dans laquelle s’enfonce le capitalisme crée aussi les conditions pour qu’éclatent, à terme, des luttes massives et qu’émerge une réflexion, d’abord dans les minorités révolutionnaires, puis au sein de la classe tout entière.
EG, 6 novembre 2023
1 Signés par Arafat, ancien président de l’OLP, et Yitzhak Rabin, premier ministre d’Israël.
2 Les mensonges éhontés des gauchistes et des staliniens de tous poils, qui déforment la position des bolcheviques sur les luttes de libération nationale (déjà erronée à l’époque) pour justifier leur soutien cynique à la « cause palestinienne » au nom de la lutte d’un « peuple opprimé » contre le « colonialisme sioniste », est une pure hypocrisie. Il est plus qu’évident que le Hamas est un pion dans le grand échiquier impérialiste international, largement soutenu et armé par l’Iran et, dans une moindre mesure, par la Russie.
3 À ce sujet, nous invitons nos lecteurs à consulter deux de nos textes sur le sujet :
– l’actualisation de « Militarisme et décomposition [668] », Revue internationale n° 168 (2022) ;
– le troisième manifeste du CCI : « Le capitalisme mène à la destruction de l’humanité… Seule la révolution mondiale du prolétariat peut y mettre fin [626] », Revue internationale n° 169 (2022).
4 Troisième manifeste du CCI : « Le capitalisme mène à la destruction de l’humanité… Seule la révolution mondiale du prolétariat peut y mettre fin [626] », Revue internationale n° 169 (2022).
5 Pour développer la réflexion sur la réalité de la rupture qui s’opère actuellement au sein de la classe ouvrière : « La lutte est devant nous ! [712] », Révolution internationale n° 499 (2023).
Géographique:
- Moyen Orient [60]
- Israel [260]
- Palestine [261]
Récent et en cours:
Rubrique:
Mexique : l'ouragan Otis, une démonstration du caractère destructeur du capitalisme
- 63 lectures
Une fois de plus, la bourgeoisie de tous bords, devant les cadavres, l'impuissance, le désespoir et la souffrance de centaines de milliers de personnes, en grande majorité des travailleurs, se montre dans toute sa bassesse et sa vilenie à l'occasion de l'ouragan Otis, qui a frappé Acapulco et ses environs (environ un million d'habitants) avec une force de 250 km/h pendant deux heures, frappant tout sur son passage.
L'état de Guerrero, et en particulier la municipalité d'Acapulco, est une région avec une concentration de zones touristiques où sont installés des hôtels et des condominiums luxueux, mais en même temps, il y a une dissémination désordonnée de colonies, habitées par des travailleurs et une grande masse appauvrie qui, face à des pénuries chroniques, deviennent des proies faciles pour les offres des mafias qui opèrent avec la drogue en collusion avec le gouvernement et les hommes d'affaires "respectables". Les données officielles, bien que biaisées, peuvent néanmoins être utilisées pour mettre en évidence la situation de la population dont le travail crée les profits des employeurs. Les données de 2022 montrent que 52% des habitants d'Acapulco sont pauvres et que 16,7% sont au seuil de l'extrême pauvreté[1]. C'est précisément cette population qui a été la plus touchée, et c'est pourquoi Otis a mis en évidence le caractère destructeur de la bourgeoisie, qui se manifeste dans la dégradation de l'environnement dont cette classe est responsable, du fait de son incapacité à prévenir puis à limiter les effets de telles catastrophes, mais aussi à travers son l'hypocrisie par l'utilisation politique du malheur des prolétaires et des autres exploités.
Le capitalisme, destructeur de l'environnement
L'ouragan Otis, de magnitude de 5, est de ce fait considéré comme un phénomène anormal, une exception par rapport à la classification scientifique. Les organismes chargés de surveiller ces phénomènes avaient estimé que la "tempête Otis" deviendrait un ouragan de catégorie 1, mais en peu de temps, elle est passée dans la catégorie 5. Bien que les études visant à comprendre et à expliquer la formation de ce phénomène ne soient pas terminées, des scientifiques tels que Suzana Camargo, de l'université de Columbia, Matthew Cappucci et Jason Samenow, du National Hurricane Center, et Jim Kossin, de la First Street Foundation, et d'autres, ont rapidement présenté leurs analyses et s'accordent à dire qu'il existe des preuves que le changement climatique est à l'origine de cet ouragan. Ils s'accordent aussi pour prédire que des phénomènes comme Otis se répéteront plus fréquemment, ce qui implique que le réchauffement climatique (l'océan habituellement à 26° était à 31°) - nié par des personnes et des secteurs de la bourgeoisie comme Trump - va conférer aux tempêtes tropicales un comportement imprévisible aux conséquences très destructrices, plaçant ainsi la population dans un état de vulnérabilité accrue. Il y a cependant une limite dans l'argumentation de ces scientifiques lorsqu'ils qualifient le phénomène du réchauffement climatique comme le "produit de l'homme"[2], la destruction de l'environnement étant le résultat du mode de production capitaliste.
En d'autres occasions, nous avons déjà mis en évidence que "le capitalisme a toujours pollué l'environnement, depuis le 19ème siècle où il était encore un facteur de progrès. L'accumulation du capital est le but suprême de la production capitaliste et peu importe le sort réservé à l'humanité ou à l'environnement... si c'est rentable, c'est bon ! […] Mais lorsque ce système entre dans sa phase de déclin historique au début du 20ème siècle, la destruction de l'environnement prend une autre dimension, elle devient implacable, à l'image du combat sans merci que se livrent les rats capitalistes entre eux pour se maintenir sur le marché mondial. Réduire au maximum les coûts de production pour être le plus compétitif possible est devenu une règle de survie incontournable. Dans ce contexte, les mesures visant à limiter la pollution industrielle constituent clairement une dépense insupportable "[3].
Il est d'ores et déjà clair que le réchauffement climatique, et la crise environnementale en général, constituent une menace pour l'humanité. Le Secrétaire général de l'ONU lui-même, Antonio Guterres (dans son message de septembre 2022), reconnaît que "la crise climatique nous tue", mais il ne dira jamais que c'est le capitalisme qui a généré cette crise.
Un ouragan imprévisible et l'indolence des Etats
Le gouvernement se réfugié derrière la soudaineté de la mutation d'une tempête en ouragan pour justifier son manque de prévention et expliquer l'ampleur des destructions qui ont provoqué l'isolement de la zone affectée en coupant les routes, les liaisons téléphoniques, l'électricité et immobilisant les aéroports. Autant d'excuses au retard de l'action de l'État pour secourir la population qui a tout perdu, meubles, vêtements mais aussi des membres de la famille.
Les témoignages recueillis par certains médias montrent l'abandon, pendant plusieurs jours, dans lequel a été laissée la population des quartiers et des agglomérations où vivent les travailleurs. Le gouvernement, qui prétend s'occuper "d'abord des pauvres", a envoyé l'armée, la marine et la garde nationale pour donner la priorité aux zones "importantes" pour la capitale. "Alors que les autorités s'efforçaient de rétablir l'ordre dans le centre touristique d'Acapulco - se frayant un chemin entre les arbres tombés devant les hôtels de grande hauteur et rétablissant l'approvisionnement en électricité - les personnes les plus pauvres de la ville [...] ont déclaré qu'elles se sentaient abandonnées..." (www.latimes.com/espanol [713]).
C'est dans ces maisons, où les services sont toujours précaires, que les morts et les disparitions se sont accumulées et que les pénuries ont conduit à la faim et à une spéculation extrême, en particulier sur les aliments. Par exemple, un kilo de tortilla, qui est l'aliment de base de la population, se vend, une semaine après la survenue d'Otis, jusqu'à 150 pesos (8,5 dollars) alors qu'il coûtait environ 20 pesos auparavant.
Hypocrisie et rapacité du gouvernement de gauche et de ses opposants
Les opposants de droite du gouvernement ont reçu comme un cadeau la nouvelle des destructions et des morts causées par l'ouragan. Bien qu'ils pleurnichent hypocritement et feignent la douleur, ils se réjouissent du fait que c'est précisément pendant la campagne électorale qu'Otis est apparu, car cela leur permet d'utiliser la négligence du gouvernement pour se montrer "critiques et responsables" et gagner la sympathie, en feignant d'oublier que le PRI et le PAN, lorsqu'ils étaient au gouvernement, se sont comportés de façon situation similaire. En effet, bien que López Obrador affirme, en prétendant se distinguer de ses adversaires, que "nous ne sommes pas pareils", ils le sont, car tant la droite dans l'opposition que la gauche au pouvoir agissent pour la défense et la protection du capital sans se soucier des vies humaines. À titre d'exemple, il convient de rappeler que, lors du tremblement de terre de 1985, dans les quartiers des usines, les militaires ont empêché les tentatives spontanées de sauvetage des travailleurs piégés dans les décombres, parce que la priorité était de s'occuper des machines et des coffres forts !
C'est l'hypocrisie et l'ambition qui se dégagent de chaque discours et de chaque acte du gouvernement et des opposants, et c'est pourquoi les travailleurs ne peuvent abandonner leur volonté et nourrir leur espoir dans aucun des camps bourgeois en conflit, car comme toutes les factions de la bourgeoisie dans le monde, leur véritable objectif est la recherche de la perpétuation de ce système d'exploitation.
Le scénario de la faim et de la mort que la bourgeoisie impose au monde avec les guerres et les désastres écologiques, avance comme un tourbillon destructeur qui ne laisse aucun doute sur le danger que représente le capitalisme pour l'humanité.
Ce que nous disions en 2005, face à la situation révélée par l'ouragan Katrina, est aujourd'hui plus clair et plus urgent à méditer par tous les exploités : " La guerre, la famine et les désastres écologiques, voilà le futur où le capitalisme nous mène. S'il y a un espoir pour l'avenir de l'humanité, c'est que la classe ouvrière mondiale développe la conscience et la compréhension de la véritable nature de la société de classe et prenne en main la responsabilité historique de se débarrasser de ce système capitaliste anachronique et destructeur et de le remplacer par une nouvelle société contrôlée par la classe ouvrière, ayant pour principe la solidarité humaine authentique et la réalisation des besoins humains "[4]
RM, 2 Novembre 2023
[1] Ils définissent les niveaux de pauvreté selon des critères techniques, de sorte que les "pauvres" sont les personnes qui couvrent de manière précaire leurs besoins de base en matière d'alimentation et de services, tandis que l'"extrême pauvreté" représente la population dont les revenus ne lui permettent pas de couvrir ses besoins minimaux en matière d'alimentation et encore moins pour d'autres services de base.
[2] Cet aspect a été particulièrement souligné par Cappucci et Samenow.
[3] Lire "Le monde à la veille d'une catastrophe environnementale (I) [714]" et "Le monde à la veille d'une catastrophe environnementale (II) - Qui est responsable ? [715]".
[4] Cyclone Katrina : le capitalisme est responsable de la catastrophe sociale [716]. Revue internationale n°123, 4ème trimestre 2005.
Géographique:
- Mexique [21]
Le vrai père de la bombe atomique et des crimes nucléaires, c'est le capitalisme
- 138 lectures
“On a su que le monde ne serait plus le même. Quelques personnes ont ri, d'autres ont pleuré mais la plupart sont restées silencieuses. Je me suis rappelé la phrase de l’Écriture hindoue, le Bhagavad Gita ; Vishnu tente de persuader le Prince d'accomplir son devoir et, afin de l'impressionner, prend sa forme aux bras multiples et dit: “Maintenant je suis devenu la Mort, le destructeur des mondes”. Je suppose que nous avons tous pensé cela, d'une façon ou d'une autre”
C’est ainsi que s’exprima Robert Oppenheimer en 1965 pour raconter ce qu'il ressentit lorsqu'il assista au premier essai nucléaire dans le désert du Nouveau Mexique en juillet 1945.
Le film de Christopher Nolan retrace le cas de conscience de ce scientifique, connu comme « le père de la bombe atomique ».
Il est vrai que Robert Oppenheimer a été dépassé par la monstruosité de ce à quoi il a grandement contribué : mettre au point un engin de mort qui dépassait de très loin ce qui existait auparavant. Cette nouvelle arme atomique allait faire 210 000 morts les 6 et 9 août 1945 à Hiroshima et Nagasaki. Sans compter le nombre incalculable des décès ultérieurs suite aux graves conséquences des effets des radiations qui ont perdurées de très longues années par la suite.
Alors oui, au cours de la guerre, la justification idéologique était toute trouvée pour le gouvernement américain. L’Allemagne nazi menait des recherches pour fabriquer une arme puissante et destructrice. La défense du « monde libre », de la démocratie, justifiait de tout faire pour combattre le nazisme, de développer des armes suffisamment puissantes capables de détruire cet ennemi de la civilisation qui exterminait les juifs.
Oppenheimer était juif et a été sensible à cette propagande.
Le processus de réalisation de la bombe fut lancé, Oppenheimer et son équipe de savants sont allé au bout de ses recherches. Il fit, à la veille de la Conférence de Potsdam, des essais concluants en plein désert du Sud des États-Unis en juillet 1945.
Mais alors, en 1945, pourquoi poursuivre ce programme militaire alors que l’Allemagne était vaincue ?
L’alibi de défense de la civilisation contre la barbarie nazie ne tenait plus.
Personnage très contradictoire, Oppenheimer était convaincu qu’il œuvrait pour la paix dans le monde en ayant construit un engin de mort dépassant tout ce qui avait été construit jusqu’alors, permettant d’éviter des guerres dans le futur par effet de dissuasion.
Le but de Truman, le président américain qui ordonna l’holocauste nucléaire, ainsi que son complice Winston Churchill était tout autre.
A l’opposé des tombereaux de mensonges colportés depuis 1945 sur la prétendue victoire de la démocratie synonyme de paix([1]), la seconde boucherie mondiale est à peine terminée que se dessine déjà la nouvelle ligne d’affrontement impérialiste qui va ensanglanter la planète. Yalta([2]) contenait la fracture impérialiste majeure entre le grand vainqueur de 1945, les États-Unis, et son challenger russe. Puissance économique mineure, la Russie put accéder, grâce à la Seconde Guerre mondiale, à un rang impérialiste de dimension mondiale, ce qui ne pouvait que menacer la superpuissance américaine. Dès le printemps 1945, l’URSS utilise sa force militaire pour se constituer un bloc dans l’Est de l’Europe. Yalta n’avait fait que sanctionner le rapport de forces existant entre les principaux requins impérialistes qui étaient sortis vainqueurs du plus grand carnage de l’histoire. Ce qu’un rapport de forces avait instauré, un autre pouvait le défaire. Ainsi, à l’été 1945, la véritable question qui se pose à l’État américain n’est pas de faire capituler le Japon le plus vite possible comme on nous l’enseigne dans les manuels scolaires, mais bien de s’opposer et de contenir la poussée impérialiste du « grand allié russe » !
C’est ainsi que ce film de Christopher Nolan veut montrer comment un brillant chercheur passionné de culture et pétris d’humanisme va se trouver au centre d’événements historiques qui le dépassent, mais dont il est à la fois acteur et victime de ceux-ci.
Mais ce film fait également une large part au contexte qui régnait lors des premières années de la guerre froide, celle du maccarthysme. La chasse aux éléments « subversifs », les « communistes » liés à l’URSS de Staline dont Oppenheimer sera victime ([3]) avant d’être ensuite réhabilité par J.F. Kennedy en 1962.
Dans le contexte actuel de guerre en Ukraine et de manœuvre de l’impérialisme américain contre la Russie, ce film semble apparaître comme prémonitoire. Vu la barbarie de la Russie en Ukraine actuellement, la politique américaine et anglaise à la fin de la Seconde Guerre mondiale n’était-elle pas justifiée ?
L’industrie du cinéma a depuis longtemps été largement utilisée pour la propagande des États. Déjà, avant la Seconde Guerre mondiale, l’État américain a demandé à Walt Disney d’aller promener sa petite souris en Amérique du Sud pour contrer la montée de la propagande nazie.
L’une des conditions du plan Marshall, en 1947, pour les pays européens l’acceptant était de laisser diffuser largement les œuvres cinématographiques américaines dans les salles de cinéma. Encore une fois, il s’agissait de contrer l’influence grandissante de l’URSS, au lendemain de la guerre, en donnant une image démocratique, de liberté, des États-Unis.
Le combat idéologique entre les deux blocs a été assimilé à la lutte de la « démocratie » contre la dictature «communiste». Chaque fois, les démocraties occidentales ont prétendu mener le combat contre un système fondamentalement différent du leur, contre des « dictatures » ([4]). Il n'en est rien : il s’agit bien de deux politiques issues du même système capitaliste !
Cette vision idyllique et naïve de la «démocratie» est un mythe. La «démocratie» est le paravent idéologique qui sert à masquer la dictature du capital dans ses pôles les plus développés. Il n'y a pas de différence fondamentale de nature entre les divers modèles que la propagande capitaliste oppose les uns aux autres pour les besoins de ses campagnes idéologiques de mystification. Tous les systèmes soi-disant différents par leur nature, qui ont servi de faire-valoir à la propagande démocratique depuis le début du siècle, sont des expressions de la dictature de la bourgeoisie, du capitalisme.
Comme l’affirmait Oppenheimer en 1945, le monde ne sera en effet plus jamais le même.
Le capitalisme c’est la guerre. Depuis la fin de la Seconde guerre mondiale, il n’y a pas eu de Troisième Guerre mondiale. La compétition entre les deux blocs américain et russe, est restée une « guerre froide », dans le sens où elle n'a jamais pris la forme d’un conflit ouvert. Elle fut plutôt menée à travers une série de guerres par procuration entre États locaux et autres « mouvements de libération nationale » accomplissant la sale besogne alors que les deux superpuissances fournissaient les armes, le renseignement, le support stratégique et la justification idéologique.
Depuis l’effondrement du bloc de l’Est à la fin des années 80, ce n’est pas un « nouvel ordre mondial » qui s’est imposé.
Mais c’est, au contraire, à une accélération de la barbarie et du chaos auquel le monde est confronté. La guerre en Ukraine et maintenant le conflit au Moyen Orient en sont les dernières manifestations guerrières avec ce que cela signifie comme massacres de populations entières, sans défense, avec les destructions massives que cela entraîne.
Le capitalisme entraîne la société humaine dans un abîme sans fin.
Plus que jamais l’alternative est : Communisme ou destruction de l’humanité !
CT
[1] Voir notre article « 50 ans après : Hiroshima, Nagasaki, ou les mensonges de la bourgeoisie » :
https://fr.internationalism.org/rinte83/hiroshima.htm#_ftnref2 [717]
[2] La conférence de Yalta est une réunion des principaux responsables de l'Union soviétique [718] (Joseph Staline [719]), du Royaume-Uni [720] (Winston Churchill [721]) et des États-Unis [722] (Franklin D. Roosevelt [723]). Les buts de la conférence de Yalta étaient les suivants :
- adopter une stratégie commune afin de hâter la fin de la Seconde Guerre mondiale [724] ;
- régler le sort de l’Europe [725] après la défaite du Troisième Reich [726] ;
- garantir la stabilité du nouvel ordre mondial après la victoire. (Wikipedia)
[3] Il s’était vu reproché d’avoir eu des liens, dans sa jeunesse, avec le Parti « Communiste » américain (il était plutôt démocrate, soutenant Roosevelt). Le véritable reproche pour l’accuser d’être un agent soviétique était son refus de mettre en œuvre ses grandes qualités scientifiques pour la fabrication de la bombe H.
[4] Voir notre article « Le mensonge de l’État ‘ démocratique ‘» : https://fr.internationalism.org/rinte76/mensonge.htm [223]
Vie du CCI:
Personnages:
- Robert_Oppenheimer [728]
- Christopher_Nolan [729]
- Truman [730]
- Winston Churchill [731]
- J.F._Kennedy [732]
- Staline [733]
- Walt_Disney [734]
- Marshall [735]
Questions théoriques:
- Guerre [26]
- Impérialisme [45]
Rubrique:
Réunions publiques de la TCI: une véritable faillite politique!
- 452 lectures
Le 22 et le 29 septembre dernier, la Tendance Communiste internationaliste a tenu deux réunions publiques, respectivement à Paris et Saint-Nazaire. Le CCI a toujours considéré que les discussions, le débat, la confrontation des positions est une tâche et une responsabilité fondamentales entre les groupes de la Gauche communiste. C’est pourquoi nous sommes intervenus dans ces deux réunions en mobilisant également de nombreux sympathisants pour contribuer à ce que le débat soit le plus riche possible.
Mais à en croire les bilans de ces réunions publiés sur le site de la TCI, notre attitude aurait été animée d’une toute autre intention.
Dans la RP de Paris, « la réunion qui aurait pu beaucoup plus approfondir tous les aspects de la situation actuelle et ses conséquences pratiques, a été quelque peu détournée de son but par des camarades du CCI. » Dans celle de Saint-Nazaire, ce serait pire : « l’intervention du CCI avait été coordonnée dans le but de dénaturer le débat, lequel a été orienté dans une mise en accusation frontale autant que fantaisiste de nos positions. En dépit de notre refus de le suivre sur cette voie, ses militants ont pourri le débat en brandissant toutes sortes de détails extrapolés ou invérifiables, à mille lieues des préoccupations des autres participants. »
Autrement dit, le CCI aurait fomenté un plan délibéré pour saboter le déroulement de réunions publiques d’une organisation de la Gauche communiste. Ces accusations balancées publiquement et sans le moindre argumentaire sont lourdes de conséquences. Alors soyons un peu plus consistants et honnêtes que la TCI en commençant par rectifier les multiples mensonges proférés dans ces deux bilans.
I - Détournement de la discussion ou lutte pour la confrontation des positions ?
Après avoir écouté, durant près d’une heure, l’exposé du présidium (complété par deux interventions de Battaglia communista et de Internationalist Workers’ Group, deux groupes affiliés à la TCI), le CCI s’est inscrit dans la discussion. Notre première intervention a essayé de démontrer que :
1 - Contrairement à l’analyse développée dans la présentation, la guerre impérialiste dans la période de décadence du capitaliste n’est absolument pas une solution à la crise économique. Bien au contraire, elle ne fait que l’aggraver et plonge l’humanité dans une spirale de destruction et de chaos. Elle acquiert un caractère de plus en plus irrationnel du point de vue du capitalisme.
2 - Contrairement à l’idée développée également dans l’exposé, nous n’adhérons pas à l’analyse d’une tendance à la formation des blocs préfigurant le cours vers une troisième guerre mondiale. Nous pensons plutôt que la tendance au chacun pour soi entre les États impérialistes ne peut que provoquer une multiplication des conflits guerriers engendrant toujours plus de chaos et de destruction et pouvant conduire à la fin de l'humanité même en l'absence de guerre mondiale.
C’est pourquoi, comme nous l’avons souligné aussi bien à Paris qu’à Saint Nazaire, l’analyse abstraite et erronée de la TCI sur la guerre impérialiste l’amène à sous-estimer profondément la gravité de la situation !
Mais la prétendue entreprise de sabotage du CCI ne s’arrêterait pas là puisque, par la suite, nous aurions porté l’attention « sur des points assez secondaires » et tenté de « dévier la discussion sur la question syndicale ». Si effectivement, dans la réunion de Paris, le CCI est intervenu pour affirmer l’appartenance des syndicats et du syndicalisme à l’État bourgeois, c’est justement face à l’ambiguïté contenue dans les propos du représentant de Battaglia communista déplorant que les syndicats n’étaient pas assez combatifs et ne faisaient pas ce qu’il fallait pour développer les luttes. Il n’y a donc rien d’étonnant, comme l’indique le bilan de la réunion de Paris, que le membre de la CNT/AIT (organisation libertaire se concevant justement comme une fédération de syndicats) ait été à 100% en « accord politiquement » avec la position de la TCI.
D’ailleurs, nous avons pu constater la même complaisance à l’égard des syndicats, une semaine plus tard, dans la réunion de Saint-Nazaire, puisque la TCI ne s’est pas vraiment démarquée de la position défendue par le représentant du groupe gauchiste Lutte ouvrière appelant justement à travailler dans les syndicats ! Une intervention de la CWO a même affirmé que « cela fait sens d’adhérer au syndicat si tous les collègues de travail y sont » laissant donc penser qu’il serait parfois nécessaire d’être présent dans ces organes de l’État.
Devant de telles concessions sur une position aussi importante pour la classe ouvrière, il était indispensable de rappeler et de réaffirmer haut et fort ce qui constitue un des acquis programmatiques de la Gauche communiste, que la TCI est sensée partager mais qu’elle est incapable de défendre !
De toute manière, cette « parenthèse » sur les syndicats ne nous a pas empêché pour autant d’intervenir sur des questions plus centrales posées dans la discussion. C’est pourquoi, nous avons également pris position, dans les deux réunions, sur le rôle des organisations de la Gauche communiste face à la guerre impérialiste.
Dans ces interventions nous avons défendu :
- - La validité de la Déclaration commune des groupes de la Gauche communiste contre la guerre impérialiste. Cette démarche, en continuité avec le combat des Bolcheviks à Zimmerwald, est une politique concrète visant à s’inscrire dans un processus vers le regroupement des forces révolutionnaires par la défense des principes et des méthodes du mouvement révolutionnaire([1]).
- - Le caractère artificiel et surtout dangereux de la politique de « front uni » avec des groupes anarchistes et gauchistes (soi-disant internationalistes), défendue par la TCI à travers la promotion des comités NWBCW([2]).
- - Qu’en se référant à « L’appel à un front prolétarien uni » lancé par le Parti communiste internationaliste (PCint) en 1944, la TCI s’inscrit dans la continuité de la démarche opportuniste contenue dans cet appel adressé implicitement aux bases des anciens partis ouvriers (Parti socialiste et Parti communiste)([3]).
Il est malheureux que la TCI n’ait pas pris tout ceci au sérieux et se soit contentée de nous taxer, sans le moindre argument, « d’idéalistes » tout juste bons à faire des « déclarations platoniques »
II - « Frénésie sectaire » ou claire démarcation vis-à-vis du gauchisme ?
En fin de compte, toutes les accusations éhontées proférées dans les bilans : la « mise en accusation frontale » de ses positions, « la dénaturation du débat », l’« attitude de provocation et de mise en cause ubuesque », le « parasitage de la discussion », etc. démontrent surtout une véritable aversion à l’encontre de ceux qui ont su défendre clairement et avec détermination les principes et la tradition de la Gauche communiste.
Animée par la volonté de gagner toujours plus d’influence et l’esprit de rivalité, la TCI est prête au contraire à flatter n’importe qui et à se compromettre pour n’importe quoi ! Cette démarche suicidaire la mène même à brouiller la frontière de classe avec des organisations gauchistes comme LO dont le militant présent à Saint Nazaire est considéré comme un « camarade ». On nous accuse même de s’en être pris personnellement à lui alors que nous n’avons fait que dénoncer Lutte ouvrière comme un groupe gauchiste ayant pour fonction de dévoyer l’internationalisme.
En réalité, l’ouverture maximale avec tout ce qui se trouve à sa droite et le refus catégorique de discuter avec la gauche est une démarche typique de l’opportunisme. La même hostilité avait gagné l’Opposition de gauche et Trotsky dans les années 30 à l’encontre de la fraction de gauche du Parti communiste d’Italie qui incarnait la position la plus claire face à la dégénérescence opportuniste de l’Internationale communiste.
III - La défense des principes et des comportements prolétariens
Il nous serait enfin reproché de « remettre sur le tapis de vieilles lunes de plus de vingt ans. La TCI fait ici certainement référence à la déclaration que nous avons lue 30 minutes avant la fin de la réunion de Paris dans laquelle nous avons dénoncé la présence de deux individus exclus du CCI au début des années 2000 pour avoir publié des renseignements qui exposaient nos camarades à la répression étatique, une activité que nous avons dénoncée comme du mouchardage.([4]) Ces derniers n’ont jamais renié leurs comportements. L’un est même membre de la TCI depuis plusieurs années et faisait partie du présidium. En fait, c’est surtout cette interpellation qui enrage la TCI et qu’elle tente de cacher par tous les moyens, en la réduisant à de simples « histoires anciennes peu politiques » et en nous accusant d’avoir, à travers ça, « parasité la discussion ».
Jusqu’à preuve du contraire, les mouchards n’ont jamais eu leur place dans le camp révolutionnaire. C’est pourquoi nous estimons qu’il était de notre responsabilité d’interpeller la TCI sur ce problème, en défendant, une fois encore, les principes hautement politiques du prolétariat. Au lieu de cela, tous les militants de la TCI présents sur place ont préféré se boucher les oreilles et prendre la défense de ces individus. Nous avons au moins la confirmation que cette organisation, qui a la prétention de participer à la formation du futur parti des révolutionnaires, est prête à accepter n’importe qui dans ses rangs, y compris des individus aux comportements de flics et des voyous !
Ce n'est d’ailleurs pas la première fois qu’elle pactise avec des éléments troubles. En 2004, le BIPR (l’ancêtre de la TCI) avait publié sur son site internet les calomnies proférées à l’égard du CCI par le fameux Citoyen B et le « Cercle des Communistes Internationalistes » avant de les retirer en catimini après s’être aperçu du caractère mensonger de ces déclarations([5]). La TCI n’a toutefois jamais fait la critique de cette démarche totalement irresponsable de sa part et n’en a donc tiré aucune leçon.
IV - La TCI incapable de faire la critique des erreurs du passé
Plutôt que d’affronter sérieusement toutes ces questions, la TCI préfère donc les esquiver. Pire, elle nous exhorte à mettre les désaccords de côté et appelle au grand rassemblement et à l’unité de tous ceux qui se réclament, de près ou de loin, de l’internationalisme, sans la moindre clarification sur les principes. C’est une démarche que le mouvement ouvrier connaît bien et que dénonçait d’ailleurs Bordiga en 1926 à l’Exécutif de l’Internationale communiste : « l'expérience montre que l'opportunisme entre toujours dans nos rangs sous le masque de l'unité. Il est de son intérêt d'influencer la masse la plus grande possible, aussi fait-il toujours ses propositions dangereuses sous le masque de l'unité. »
C’est avec la même démarche opportuniste qu’a été fondé en 1943 le plus lointain ancêtre de la TCI : le Parti Communiste internationaliste (PCint) dans lequel avaient été admis sans la moindre critique :
1- Des éléments de la minorité de la fraction italienne qui était partie se battre aux côtés des Républicains durant la Guerre d’Espagne.
2- Vercesi et tous ceux qui, au cours de la Seconde Guerre mondiale, avait participé au Comité de Coalition antifasciste de Bruxelles.([6])
C’est donc cette très vieille tare politique qui constitue la source de l’opportunisme de la TCI aujourd’hui. Dès lors, son refus de l’affronter de front, son incapacité à faire la critique de son propre passé la condamne à reproduire toujours les mêmes erreurs.
Dans les bilans des deux réunions, la TCI appelle le CCI à se ressaisir, elle nous exhorte même de à nous excuser pour l’attitude négative que nous aurions adoptée au cours des discussions. Allons camarades, ne soyez pas ridicules.
Nous pensons avoir démontré la responsabilité dont nous avons fait preuve au cours de ces deux réunions en œuvrant à la confrontation des positions politiques et en étant capables de défendre les positions et les principes de la Gauche communiste. Nous ne pouvons hélas pas en dire autant de la TCI dont l’esquive et le refus de débattre, la compromission avec des éléments gauchistes, l’acceptation des comportements de flics et de voyous sont autant de symptômes de la maladie qui ronge cette organisation et la mène inexorablement vers le néant ! Comme le disait Lénine : "Un défenseur de l'internationalisme qui n'est pas en même temps un adversaire très cohérent et déterminé de l'opportunisme est un fantôme, rien de plus."
31 octobre 2023,
CCI.
[1] « Déclaration commune de groupes de la Gauche communiste internationale sur la guerre en Ukraine [438] », Révolution internationale n°493, (avril - juin 2022).
[2] Pour avoir une analyse plus complète de notre position voir : « La “Tendance Communiste Internationaliste” et l’initiative “No War But the Class War” : un bluff opportuniste qui affaiblit la Gauche communiste [736] », Révolution internationale, n°499, octobre - décembre 2023.
[3] Idem.
[4] Pour avoir davantage de précisions sur les comportements de ces deux individus, lire notamment : « Attaquer le CCI : la raison d’être du GIGC [615] », ICConline, (janvier 2023).
[5] « Lettre ouverte aux militants du BIPR (Décembre 2004) [245] », ICConline, (avril 2021).
[6] Cette démarche politique totalement aberrante a été particulièrement critiquée par la Gauche communiste de France dans l’article « A propos du Ier congrès du Parti communiste internationaliste d’Italie » dans le n°7 de la revue Internationalisme : « Dans la Fraction Italienne, une minorité se sépare ou est exclue, et ira rejoindre l'Union Communiste alliée du POUM. Cette minorité - qui, de 1936 à 1945, est restée hors de la Fraction, contre qui s'est formée la Gauche Communiste Internationale, qui garde et se réclame toujours de ses positions - se trouve aujourd'hui faisant partie du nouveau Parti en Italie. En 1945, après 6 ans de lutte contre la ligne marxiste et révolutionnaire de la Fraction, la tendance Vercesi crée le Comité de Coalition Antifasciste où elle collabore, dans une union sacrée originale, avec tous les partis de la bourgeoisie. De ce fait, précipitant la discussion politique, théorique la Fraction est amenée à exclure cette tendance de son sein. Aujourd'hui, cette tendance, sans avoir rien renié de ses positions et de sa pratique, se trouve être partie intégrante du nouveau Parti en Italie et occupe même une place importance dans la direction. Ainsi, la Fraction - qui a exclu la minorité en 1936-1937 et la tendance Vercesi au début 1945 - se trouve dissoute elle-même fin 1945 mais unie à ceux-là même qu'elle avait exclus ; et cette union c'est... le Parti. »
Vie du CCI:
- Polémique [246]
- Interventions [492]
Courants politiques:
- TCI / BIPR [247]
Questions théoriques:
- Opportunisme & centrisme [737]
- Guerre [26]
Rubrique:
Marche contre l’antisémitisme en France: la bourgeoisie cherche à piéger le prolétariat sur le terrain du nationalisme
- 129 lectures
S’il y a bien un événement que tous les médias ont commenté pendant plusieurs semaines, c’est sans conteste la marche contre l’antisémitisme du 12 novembre. Lancée à l’initiative des présidents du Sénat et de l’Assemblée nationale, elle a été présentée comme « transpartisane ». Elle a rassemblé toute la bourgeoisie… ou presque : les « Insoumis », ont préféré organiser un petit défilé en marge pour « dénoncer l’extrême-droite », apportant ainsi leur précieuse contribution à la propagande nationaliste et démocratique de l’État.
Il est clair que le nombre d’actes antisémites a explosé ces dernières semaines. Même s’il est évident que cela servira de prétexte à l’État pour renforcer davantage son arsenal policier, ces actes ignobles alimentent une ambiance de pogrom et de tensions communautaires. L’antisémitisme peut prendre la forme de théories du complot sur un prétendu contrôle des États ou de la finance par les juifs mais peut aussi s’exprimer par des actes violents, comme la profanation de sépultures ou les agressions.
Cela n’est malheureusement pas quelque chose de nouveau. Même avant l’arrivée du nazisme en Allemagne, des idées de cet acabit étaient légion, notamment en Europe de l’Est. Les révolutionnaires ont longtemps fait l’objet d’accusations de « judéo-bolchévisme ». Trotsky et d’autres militants Juifs ont ainsi fait l’objet de campagnes de dénigrement avec, pour point d’orgue, les pogroms antisémites lors de la guerre civile russe.
Désormais, derrière les expressions d’antisémitisme les plus sordides de l’ultradroite, ces idées sont répandues parfois de manière plus sournoise. Derrière le terme « d’anti-sionisme » se cache ainsi parfois une idéologie haineuse contre l’ensemble des juifs. Il est clair par exemple que l’Iran n’a pas hésité à brouiller les frontières entre opposition à la politique d’Israël et attaques antisémites pour servir ses intérêts impérialistes. Cet État n’hésite pas à cultiver des liens avec la clique de Dieudonné et Alain Soral. (1) Même le leader des prétendus « modérés » du Fatah (2) Mahmoud Abbas a utilisé à plusieurs reprises des clichés antisémites. (3) Ces propos sont du pain béni pour le gouvernement de Netanyahou qui n’hésitera pas à les montrer comme preuve du caractère criminel de la Palestine… alors que sa majorité au Knesset n’a eu aucun problème pour tenir des propos racistes de la pire espèce pour justifier le bombardement de civils.
Alors que l’antisémitisme revient en force, les discours les plus racistes se répandent dans la bouche des politiciens de tout bord et dans la presse. On a ainsi pu voir une partie de la bourgeoisie instrumentaliser les actes antisémites pour déchaîner une odieuse campagne anti-Arabe qui a abouti à la décente de nervis néo-nazis à Romans-sur-Isère, qui se sont senti pousser des ailes pour tabasser des Arabes.
Tous ces actes odieux provoquent une indignation légitime dans le monde entier. Néanmoins, la bourgeoisie les utilise pour faire tomber les ouvriers dans le piège de la défense des soi-disant valeurs « démocratiques » et justifier son soutien à la barbarie que déchaîne Israël à Gaza. C’est tout le sens de la « marche contre l’antisémitisme ». Cette marche fait immédiatement penser au rassemblement défendant la « liberté d’expression » après l’attentat contre les locaux de Charlie Hebdo en 2015.
La banderole « Pour la République, contre l’antisémitisme » donne le ton : on assiste en réalité à une instrumentalisation d’événements tragiques au bénéfice de l’Union Nationale, qui est en réalité un moyen d’attaquer la conscience de classe. En clair, l’État, ses partis et autres ONG ramènent le prolétariat sur le terrain de la défense de la nation et de la démocratie : celui de « l’union sacrée ».
Parmi les invités de cette marche, on peut compter de nombreux membres du parti au pouvoir Renaissance. Les récentes actions du gouvernement sur l’immigration, sur la répression à Mayotte ou encore ses discours sur la laïcité en dit long sur l’hypocrisie de leur présence. Il y avait également l’ancien Président Nicolas Sarkozy qui n’a pas hésité à faire appel aux services de Patrick Buisson pour ses idées rétrogrades. A cela s’ajoute la présence de Marine Le Pen et celle du trublion Eric Zemmour dont les sorties racistes n’ont pas besoin d’être rappelées.
Cette mascarade ne serait néanmoins pas complète sans le rôle des partis de gauche. Toujours en train de cultiver son image de « résistant » contre le « patronat », Jean-Luc Mélenchon et La France Insoumise ont refusé de participer à cette marche. Sa justification est la présence de partis d’extrême droite à la manifestation. Il s’est même fendu sur les réseaux sociaux d’une phrase qui ne cache pas la nature nationaliste de son point de vue : « Le rejet de l’antisémitisme est plus large en France. Ils l’ont rabougri et rendu ambigu. Le peuple français restera uni malgré ses dirigeants ».
En plus de reprendre le slogan de l’anti-fascisme cher à ses ancêtres staliniens et plus récemment des anti-populistes, « l’insoumis » n’a pas hésité à remplir son discours d’illusion sur les « luttes contre les discriminations ». Son parti a organisé un rassemblement alternatif pour « tous les combats antiracistes ». Non seulement LFI récupère à sa manière ces événements tragiques mais cherche aussi à utiliser une arme fréquemment utilisée contre la nouvelle génération de la classe ouvrière : les luttes sur un terrain bourgeois.
Mais l’élément le plus important de ces campagnes est la promotion de l’idée qu’il faudrait choisir un camp dans le conflit israélo-palestinien. La lutte contre l’antisémitisme est utilisée comme marque de soutien à Israël tandis que le soutien de certaines parties de la gauche à la Palestine est loin d’être un secret. Bien loin d’être réellement opposées, ces deux manifestations jouent un rôle complémentaire dans la confusion qu’elles instillent au sein du prolétariat. Le choix d’un camp impérialiste est une idée que les ouvriers doivent absolument rejeter. La seule réponse possible pour arrêter le carnage impérialiste est la lutte de classe et le refus de soutenir toute forme de nationalisme, peu importe sa forme.
Edgar, 1er décembre 2023
1« Les étranges liens de Dieudonné avec l’Iran » [738], Le Figaro (8 janvier 2014)
2Composante principale de l’OLP et membre de l’Internationale Socialiste
3« Abbas accuse les rabbins de vouloir empoisonner les puits palestiniens, Israël crie à la calomnie » [739], France 24 (23 juin 2016)
Situations territoriales:
Récent et en cours:
Rubrique:
ICConline - décembre 2023
- 41 lectures
Guerre au Proche-Orient: À la logique de mort du capitalisme, le trotskisme répond présent!
- 201 lectures
La défense intransigeante de l’internationalisme et de son vieux mot d’ordre : « Les prolétaires n’ont pas de patrie ! », est plus que jamais la clé du combat du prolétariat, une frontière de classe entre le prolétariat et la bourgeoisie.
Nombre de groupes de la gauche de l’appareil politique de la bourgeoisie, les trotskistes, les anarchistes ou les maoïstes se targuent depuis des décennies d’être les défenseurs de la cause prolétarienne et de son combat contre le capitalisme. Alors que les tueries entre Israël et le Hamas font rage, leur pseudo-internationalisme s’est révélé, une nouvelle fois, n’être qu’un bluff et une mystification ! Alors le déluge de feu de Tsahal répond à la sauvagerie sans limite du Hamas, toutes leurs prises de position aboutissent à un même résultat : pousser les ouvriers à choisir un camp impérialiste contre un autre. En clair, ils ne sont que des rabatteurs sur le terrain du bourbier nationaliste !
Le trotskisme, nationaliste encore et toujours !
Une partie des gauchistes, un peu partout dans le monde, n’a pas hésité à glorifier les actes ignobles du Hamas après leur attaque sauvage du 7 octobre. Les néo-maoïstes français de la Ligue de la Jeunesse Révolutionnaire (LJR) ont ainsi titré : « Le déluge d’Al Aqsa est un glorieux phare dans la nuit qu’est l’impérialisme ». Un summum dans l’ignominie guerrière ! Il en est de même du groupe trotskyste espagnol El Militant-Izquierda Revolucionaria qui n’a pas hésité à brandir triomphalement le « droit du peuple palestinien à l’autodéfense armée » pour se féliciter des exactions de cette bande de gangster et d’assassin qu’est le Hamas ! Idem, en Grande-Bretagne, où le trotskiste Socialist Workers Party a lancé sans aucune vergogne son cri de guerre : « le peuple palestinien a parfaitement le droit de répondre comme bon lui semble à la violence de l’État israélien ».
Mais derrière cette coterie de va-t-en-guerre éhontés, d’autres groupes gauchistes, dans une parfaite répartition de la sale besogne idéologique, ont promu des formes beaucoup plus sournoises de nationalisme.
Dans d’autres groupes trotskistes, les propos sont un peu plus subtils mais la logique est la même : derrières leurs slogans « résolument internationalistes », comme l’affirme, par exemple, le Nouveau Parti Anticapitaliste (NPA), la défense d’un camp impérialiste contre un autre est indéfectible. Ils persistent et signent dans leur nationalisme putride : « depuis des décennies, (et avant lui la LCR), le NPA défend que, comme les autres peuples du monde, les Palestinien(ne)s ont des droits, nationaux et démocratiques, reconnus par l’ONU ».
Ces « droits », ce sont ceux de la nation et son État (démocratique ou non), expressions par excellence de la dictature de la classe dominante, celle qui imposent au prolétariat palestinien et à la population en général, d’être la chair à canon de ses velléités impérialistes depuis plus de cinquante ans !
Le nationalisme palestinien, qu’il se présente comme « marxiste », « laïque » ou « islamiste », s’est toujours mis au service des forces impérialistes en présence. Le Hamas est, de fait, une clique à la tête d’un État, une faction de la bourgeoisie palestinienne qui exploite et impose sa dictature sur la population de Gaza, sur le prolétariat palestinien. Il traite ses travailleurs comme n’importe quel autre régime capitaliste. L’une des plus grandes ironies de ce cauchemar est que le Hamas doit dans une large mesure son existence à Israël qui a initialement encouragé son développement pour faire contrepoids à l’OLP.
Les défenseurs de la barbarie… mais démocratiquement !
Révolution Permanente (RP), organisation scissionniste du NPA qui tend à développer des liens avec d’autres groupes trotskystes en Europe, comme le Klasse gegen Klasse en Allemagne, en remet une couche avec une sidérente mauvaise foi : « L’aventurisme, les exactions et massacres du Hamas contre des civils sont à la hauteur de l’impasse qu’il constitue pour la cause palestinienne, parce qu’il ne porte pas de véritable programme social et démocratique […]. Et pourtant, le Hamas, à la différence de Daech et d’Al Qaida, a une assise populaire, quand bien même l’absence d’élection et de tout cadre démocratique […] empêche de mesurer exactement le degré de soutien du Hamas à Gaza et ailleurs dans les territoires ».
Quelle hypocrisie éhontée pour faire accepter l’inacceptable et justifier les massacres barbares du Hamas ! Assise populaire ? Les exactions du Hamas seraient donc plus légitimes si des élections étaient venues les entériner ? Est-ce sur la base de son « assise populaire » qu’en septembre 2006, quelques mois après son accès au pouvoir, des grèves massives et des manifestations ont été organisées pour exiger que le gouvernement du Hamas règle plusieurs mois de salaires impayés ?
Voilà une belle illustration de la mystification démocratique ! Sous couvert d’un discours « critique », les va-t-en-guerre du NPA utilisent le « label démocratique » pour mieux justifier les massacres perpétrés par la soldatesque d’un camp impérialiste.
L’ignominie de la propagande trotskiste n’a donc pas de limites et vire souvent à l’insoutenable. Mais la sauvagerie et les atrocités de ce conflit sont telles qu’elles gênent parfois aux entournures certains de ces groupes et les amènent à prendre un peu de « distance » avec les propos de leurs « camarades ».
De telles expressions de contorsions radicales se retrouvent, ainsi, dans un des groupes trotskistes les plus sournois, expert en double langage et faux-fuyants, l’inénarrable organisation trotskiste française : Lutte Ouvrière (LO), qui s’est fendue tout dernièrement d’un article très critique vis-à-vis du NPA et de Révolution Permanente. LO leur reproche un discours nationaliste trop outrancier qui ne percevrait pas « la nature de classe, bourgeoise, du Hamas, ni sa politique nationaliste et réactionnaire […]. Qualifier le Hamas de “principale organisation de la résistance” palestinienne est un abus de langage, pour ne pas dire une escroquerie ».
Diable ! LO dénoncerait donc la barbarie de toutes les factions bourgeoises et renoncerait à sa logique de défense des « luttes de libération nationale » ?… Sûrement pas ! « Si une partie des masses palestiniennes font confiance au Hamas, lui en tout cas ne leur fait pas confiance […] le Hamas agit et décide hors de tout contrôle de la population palestinienne et des plus pauvres. Ses méthodes ne visent pas à permettre aux révoltés de prendre conscience de leur force, de s’organiser et de faire un apprentissage politique. L’attaque du 7 octobre a été lancée par sa direction hors de tout contrôle et de toute discussion ». En clair, la sauvagerie peu démocratique du Hamas a « déçu » LO ! Rien de moins !
Ah ! Si seulement des « discussions démocratiques » avaient pu avoir lieu avant le 7 octobre pour planifier l’attaque du Hamas, les atrocités auraient pu avoir un profil plus présentable à en croire LO. Au royaume du sordide, la « subtile » Lutte Ouvrière détrône les plus outranciers des groupes trotskistes pour vendre sa camelote nationaliste et guerrière.
Quelle perspective pour le prolétariat selon le trotskisme ?
Laissons parler à nouveau Révolution Permanente : « En perspective, il ne faut pas penser la mobilisation contre la guerre, la lutte de libération nationale palestinienne et la perspective de la révolution prolétarienne comme des voies séparées. Elles peuvent et doivent au contraire s’entretenir l’une l’autre ». Ça a au moins le mérite d’être clair !
Non seulement le prolétariat palestinien doit continuer à servir de chair à canon pour la cause nationaliste de sa bourgeoisie mais plus largement la lutte prolétarienne doit « entretenir » et nourrir les luttes de libération nationale. Il y avait belle lurette que l’internationalisme de pacotille des trotskistes avait été jeté par la fenêtre, mais ils assument là ouvertement leur rôle de sergents recruteurs pour la cause nationale.
Quelles que soient les contorsions alambiquées ou non des organisations trotskistes, elles demeurent des rabatteurs indéfectibles de la bourgeoisie dans ses confrontations sur le terrain national.
Depuis la Seconde Guerre mondiale, le trotskisme est définitivement passé dans le camp de la bourgeoisie en contribuant à embrigader le prolétariat dans la guerre contre le fascisme. Depuis, ces groupes bourgeois ont, partout dans le monde, méthodiquement incité les ouvriers à choisir un camp impérialiste contre un autre. Pendant la guerre froide, ils ont confirmé leur soutien inconditionnel à l’URSS et ses prétendues « luttes de libération nationale » (Cambodge, Vietnam, Cuba…) contre les États-Unis. Lors de la guerre en Irak, ils ont déterminé que le « bon camp » était… « le camp du peuple irakien face aux agresseurs anglo-américains » !
Plus récemment, plusieurs groupes trotskistes n’a eu de cesse de dénoncer « la Russie de Poutine » dans la guerre en Ukraine, appelant le « peuple ukrainien » à se faire massacrer dans les tranchées. D’autres officines trotskistes, comme LO fidèle à son dogme d’une Russie qui ne serait pas impérialiste, n’hésitent pas à subtilement soutenir Poutine en suggérant que le seul impérialisme qui vaille la peine d’être dénoncé est celui de l’OTAN et de Biden.
Le trotskisme, parce qu’il est une idéologie bourgeoise, pousse donc inéluctablement la classe ouvrière dans les bras des prétendues luttes de libération nationale, en réalité la défense d’un camp impérialiste contre un autre : le camp des « agressés » face aux « agresseurs », le camp de la démocratie face au fascisme, le camp des « pays pauvres » face aux « pays riches », précédemment le camp de la « patrie socialiste soviétique » face à l’impérialisme occidental, etc.
Il n’y a pas de solution aux bains de sang sans fin au Moyen-Orient et dans le monde entier en dehors de la lutte des classes internationale et de la révolution prolétarienne mondiale. Toutes les formes de nationalisme, tous ses défenseurs, y compris les plus radicaux, sont des ennemis mortels de la classe ouvrière et de sa perspective révolutionnaire.
Stopio, 5 décembre 2023
Récent et en cours:
- Conflit israélo-palestinien [262]
- Lutte Ouvrière [570]
- NPA [740]
- Révolution Permanente [568]
Courants politiques:
- Trotskysme [468]
Rubrique:
Mort de Kissinger: La bourgeoisie perd un grand défenseur du capitalisme
- 55 lectures
Né en Bavière en 1923, d’origine juive, le jeune Heinz Alfred Kissinger sera obligé de migrer avec sa famille vers les États-unis afin d’échapper au nazisme. Devenu « Henry » il obtiendra la nationalité américaine en 1943, s’engagera comme soldat dans les rangs du renseignement militaire puis rejoindra ensuite les services du contre-espionnage. De retour en Amérique à la fin de la guerre, il poursuivra de brillantes études à l’Université de Harvard et enseignera les sciences politiques, se spécialisera dans les relations internationales. Sa carrière de diplomate prendra une véritable dimension planétaire sous l’ère Nixon. Il deviendra alors, durant toute la guerre froide, une figure emblématique incontournable de la tête du bloc occidental face à l’URSS.
Derrière sa « part d’ombre », le visage de l’impérialisme
Conformément à son rang et aux services rendus à la nation américaine, une « pluie d’hommages » est venue des grandes chancelleries pour honorer le défunt Kissinger. Biden saluera son « esprit acéré », Xijingping le « diplomate de légende », Scholz un « grand diplomate », Macron un « géant de l’histoire », etc.
Dans un exercice de fausse opposition, la figure controversée du diplomate américain a fait l’objet de « critiques » par les partis de gauche, les gauchistes et plusieurs médias, stigmatisant la « face sombre » du personnage. Indéniablement, dès son arrivée à la Maison-Blanche comme conseiller à la sécurité nationale en 1969, puis comme secrétaire d’État en 1973, Kissinger inspirait peu de sympathie, au point où Nixon, très méfiant, avait décidé de le mettre sous écoute. Une pratique courante qui fera scandale plus tard et lui coûtera son poste lors de l’affaire du Watergate. (1) Kissinger lui-même usait des mêmes méthodes à l’encontre de ses propres collaborateurs qui, eux aussi, n’appréciaient nullement cet infatigable manipulateur, connu pour son autoritarisme, sa froideur, ses mensonges et son manque total de scrupule. Bref, un profil propre à tous les grands représentants de la bourgeoisie et autres défenseurs du capitalisme. Mais en polarisant quasi exclusivement sur la personnalité de Kissinger, cette propagande est venue masquer que les décisions qu’il avait prises, effectivement criminelles, étaient avant tout l’émanation d’une logique de domination propre à l’impérialisme et donc à celle du système capitaliste.
Tout ceci ne retire rien à la responsabilité de Kissinger et de Nixon ni de leurs exactions, mais cela ne saurait dédouaner la politique inévitablement barbare d’un système décadent qui a généré deux guerres mondiales, des blocs impérialistes antagoniques risquant même d’engloutir l’humanité dans l’apocalypse nucléaire. Ce n’est que dans ce cadre que l’on peut appréhender les grands crimes qui ont effectivement été commis durant la guerre froide suite à des décisions venant bel et bien du sommet de l’État américain.
Et ce fut bien le cas lors des terribles bombardements massifs au Cambodge commencés dans le plus grand secret dès 1969 face aux menaces des troupes du nord Vietnam. Les États-Unis ont alors préventivement largué 540 000 tonnes de bombes, provoquant un déluge de feu tuant de 50 000 à 150 000 civils. Les transcriptions déclassifiées d’écoutes téléphoniques prouvent que Kissinger a bien transmis au général Alexander Haig les ordres de bombarder : « une campagne de bombardement massif au Cambodge […] c’est un ordre, il faut le faire. Tout ce qui vole, sur tout ce qui bouge. Vous avez compris ? ». Glaçant… Le Cambodge, devenu le pays le plus bombardé de l’histoire, a sombré alors dans une barbarie qui a favorisé l’arrivée au pouvoir des Khmers rouges et du régime sanglant de Pol Pot.
Ces crimes ne sont pas uniquement le produit d’une décision venant d’une personnalité sans scrupule. Il s’agit d’une politique planifiée, basée sur la stratégie de la terreur, destinée à contrer le bloc ennemi : l’URSS. Une telle démarche n’est absolument pas contradictoire avec la politique de « détente » qui repose elle-même sur le principe d’un « équilibre de la terreur ». La doctrine de « dissuasion nucléaire », défendue par tout le camp occidental, n’était donc pas limitée au spécialiste Kissinger. (2)
Profitant des dissensions croissantes entre l’URSS et la Chine à la fin des années 1960, pour promouvoir la « détente » et prenant aussi des distances avec l’ostpolitik du Chancelier Willy Brandt, (3) Kissinger défendait fermement la continuité d’une même stratégie « d’endiguement » initié par le Président Truman après la Seconde Guerre mondiale. Là aussi, de manière discrète, la politique de « détente » allait exercer une pression destinée à isoler davantage l’URSS. Une politique cachée, minutieuse et systématique, dont Kissinger avait été l’acteur principal, le fin négociateur, aboutissait alors avec succès pour le camp occidental. Sa politique permit en même temps, grâce à de nombreux contacts discrets avec le ministre chinois Zhou Enlai, d’officialiser le voyage de Nixon à Pékin en 1972. Une politique qui allait porter ses fruits avec le basculement officiel de la Chine dans le camp occidental.
Suite au Traité de Paris l’année suivante, qui allait déboucher sur des pourparlers au Moyen-orient et sur la fin de la guerre du Vietnam, Kissinger allait recevoir… le prix Nobel de la paix ! Ce fut naturellement un véritable tollé qui allait même conduire à la démission de deux membres du prix Nobel (4)
Pour desserrer l’étau de cette offensive américaine très habile, le bloc soviétique allait riposter par des tentatives de déstabilisation en essayant de contrer la pression accrue du bloc occidental. Dans ce contexte, l’élection du « socialiste » Salvador Allende au Chili en 1973 allait être perçue comme une véritable menace pour Washington. L’assassinat d’Allende et le putsch aboutissant à l’arrivée du général Pinochet au pouvoir ont, pour le moins, été grandement favorisés (si ce n’est exécuté) par la CIA et la politique des États-unis. La contre-offensive américaine usait bel et bien de la terreur. La preuve en est qu’elle fermera totalement les yeux sur les tortures et les exécutions sommaires du nouveau régime chilien et de bien d’autres. Le rôle de Kissinger et son autorité sur la CIA, leurs soutiens aux nombreuses dictatures, font des années 1970 et 1980 sur ce plan des « années noires ».
Le machiavélisme de la bourgeoisie
La « realpolitik » de Kissinger est en réalité celle de tout le bloc occidental. Elle a contribué, par la ruse et la séduction, le mensonge, la dissimulation, la manipulation et la violence, à orchestrer les nombreux coups d’État, à organiser les bombardements massifs sur les civils, favorisant ainsi le terreau des épurations ethniques et des massacres. Tout cela, au nom de la « démocratie ».
Le plus ignoble est cette capacité de la bourgeoisie aujourd’hui à utiliser ses propres crimes passés pour alimenter encore la propagande démocratique afin de mystifier la classe ouvrière en tentant de dédouaner son propre système d’exploitation des destructions et massacres de masse. « Pour perpétuer sa domination sur la classe ouvrière, il est vital pour la bourgeoisie de maintenir en vie la mystification démocratique, et elle s’est servie et continue de se servir de la faillite définitive du stalinisme pour renforcer cette fiction. Contre ce mensonge d’une prétendue différence de nature entre “démocratie et totalitarisme”, toute l’histoire de la décadence du capitalisme nous montre que la démocratie s’est tout autant largement vautrée dans le sang que le totalitarisme, et que ses victimes se comptent par millions. Le prolétariat doit aussi se rappeler que jamais la bourgeoisie “démocratique” n’a hésité, pour défendre ses intérêts de classe ou ses sordides intérêts impérialistes, à soutenir et encenser les plus féroces dictateurs. Souvenons-nous du temps où les Blum, les Churchill, etc., appelaient Staline, “Monsieur Staline”, et où celui-ci était nommé “l’homme de la Libération” ! Plus près de nous, rappelons-nous du soutien apporté à S. Hussein ou encore à Ceausescu, félicité par De Gaulle et décoré par Giscard. La classe ouvrière doit faire sien le fait que la démocratie, hier, aujourd’hui, et plus encore demain, n’a jamais été et ne sera jamais autre chose que le masque hypocrite avec lequel la bourgeoisie recouvre le visage hideux de sa dictature de classe, pour mieux l’enchaîner et la réduire à merci ». (5)
Henry Kissinger a été un représentant typique de cette classe bourgeoise, séparant de manière radicale morale et politique : « un pays qui exige la perfection morale dans sa politique étrangère n’atteindra ni la perfection ni la sécurité » dira-t-il. Jusqu’à la fin de sa carrière officielle en 1977 et bien au-delà, Kissinger continuera à influencer la vie politique américaine, comme en témoignent ses soutiens ouverts à Reagan, ses conseils à Bush Jr. et à bien d’autres. En juillet dernier, âgé de 100 ans, il restait toujours influent et même en mesure de voyager. Il fut reçu par Xi Jinping en personne à Pékin, quelques mois seulement avant sa disparition.
WH, 10 décembre 2023
1 Le Watergate est une affaire d’espionnage politique avec écoutes qui aboutit, en 1974, à la démission du Président Richard Nixon.
2 Afin de cultiver la crainte chez les « Soviétiques », Kissinger laissait entendre habilement que Nixon pouvait être « incontrôlable », c’est-à-dire prêt à utiliser la bombe atomique à tout moment. Bref, un partage du travail dans lequel Kissinger passait pour le « gentil » et Nixon le « dangereux méchant ».
3 Cette politique visant à normaliser les relations avec l’Union soviétique était considéré avec méfiance par les Américains.
4 Le chanteur américain Tom Leher dira que « la satire politique est devenue obsolète depuis que Henry Kissinger a reçu le prix Nobel de la paix ». Françoise Giroud parlera d’un « prix Nobel de l’humour noir ».
5 « Souvenons-nous : les massacres et les crimes des “grandes démocraties” [741] », Revue internationale n° 66 (1991).
Personnages:
- Henry Kissinger [742]
- Richard Nixon [743]
Evènements historiques:
- guerre froide [744]
- guerre du Vietnam [745]
Rubrique:
Décès d’un jeune à Crépol : La violence de la société capitaliste
- 89 lectures
Dans la nuit du samedi 18 au dimanche 19 novembre, Thomas, 16 ans, a été mortellement touché par un coup de couteau à la suite d’une bagarre causée par un incident mineur (des réflexions au sujet d’une coiffure) qui a mal tourné à la fin d’un bal à Crépol (Drôme). Immédiatement, une réaction incendiaire d’une partie de l’extrême droite (hors RN) et de la droite, accusant des « étrangers » d’avoir commis ce crime.
Quelques jours plus tard, « des dizaines d’individus encagoulés se sont dirigés vers le quartier de la Monnaie, à Romans-sur-Isère (Drôme), une ville située à 15 km de Crépol, dans le but d’opérer une expédition punitive, aux cris de “justice pour Thomas”. Les auteurs et complices présumés du meurtre de Thomas seraient, en partie, originaires de cette cité » (Le Monde du 30 novembre).
Face à cela, on ne peut que noter les atermoiements et la cacophonie de la classe dominante. Par exemple, Eric Ciotti (Les Républicains) a d’abord refusé, dimanche, de condamner cette expédition punitive, avant de faire machine arrière, sous la pression du gouvernement, alors même qu’à ce jour, les investigations policières ne sont pas terminées et qu’il existe encore des inconnues quant au déroulement précis de la soirée qui a abouti à ce drame. De son côté, le gouvernement, tout cherchant à se donner une image de fermeté, a tenté d’apaiser la situation : « un proche du président de la République dénonce “la fable insensée” véhiculée par l’extrême-droite sur l’imminence d’une “guerre civile” ».
Ce drame intervient dans un contexte où l’accélération de la décomposition de la société capitaliste génère toujours plus de violence sociale, comme on a pu le mesurer encore récemment lors des émeutes à Dublin. Une violence qui s’est encore exacerbée un peu partout depuis le déclenchement de la guerre au Moyen-Orient, et qui vient gangrener le tissu social. De telles violences ne font à leur tour qu’aggraver le phénomène qui alimente la montée du populisme, les idéologies racistes d’extrême-droite et les théories délirantes sur le « grand remplacement ».
Fondamentalement, la bourgeoisie est impuissante, de plus en plus ballottée par une situation qui menace son ordre et tend à empoisonner sa vie politique. Pourquoi la bourgeoisie a-t-elle jeté autant d’huile sur le feu, depuis tant d’années à propos de l’Islam et de l’immigration ? Pour diviser la classe ouvrière, naturellement, mais aussi, initialement pour tenter d’instrumentaliser et de diaboliser l’extrême droite en vue de renforcer l’idéologie démocratique.
Or, aujourd’hui, le phénomène tend à échapper aux apprentis sorciers et inquiète. Une partie de la presse s’est ainsi montrée étonnamment prudente à la suite du Procureur de la République qui a initialement menti en affirmant qu’il est « faux d’affirmer que le groupe hostile serait composé d’individus tous originaires de la même ville et du même quartier ». Même Darmanin, pourtant habitué à la surenchère xénophobe, s’est déclaré « scandalisé » par les manifestations de l’extrême-droite et a menacé de dissoudre trois groupuscules. Tout comme Véran qui à dénoncer ces « factions d’ultradroite animées par la haine et le ressentiment ».
Pourquoi cette tentative de calmer la situation ? D’abord parce que le camp présidentiel est en train de se déchirer sur la nouvelle Loi Immigration et cette ambiance délétère ne fait que renforcer l’électorat du RN. Mais surtout, le rôle majeur de l’État, est de maintenir la cohésion de la société. Or la situation de crise politique qui affecte l’ensemble de la classe politique rend cette tache de plus en plus difficile et délicate. La fraction la plus lucide de la bourgeoisie, elle-même en partie déjà affectée, se rend compte que la situation est explosive, qu’il existe un risque de fragmentation sociale. Même Marine Le Pen a critiqué les propos incendiaires de Zemmour pour mieux se présenter en garante de la cohésion de la Nation, apte à diriger l’État.
Ce drame illustre bien, par ses conséquences, le processus de décomposition de la société capitaliste, au niveau mondial. Même si le fait d’instrumentaliser de tels drames et d’attiser les haines communautaires constitue un moyen de diviser les luttes des ouvriers et pourrir leur conscience, de tels phénomènes sont des produits de la décomposition du capitalisme qui ne fait que dégrader l’ensemble du corps social et ne sauraient être celui d’une simple volonté politique.
La bourgeoisie française se retrouve aujourd’hui coincée entre deux exigences : - d’une part, l’urgence de renforcer ses attaques contre la classe ouvrière pour résister à la crise économique qui ne cesse de s’aggraver, ce qui explique les campagnes de division, y compris racistes.
- d’autre part, il y a la nécessité de maintenir un minimum de cohésion sociale pour empêcher la société de sombrer dans un chaos (tel qu’on le voit, par exemple, en Amérique Latine) qui risquerait de bloquer encore plus toute l’activité politique et économique avec le danger d’une déstabilisation accrue.
Un autre facteur d’instabilité est la porosité de la jeunesse des « quartiers défavorisés » à la décomposition sociale ambiante, avec le risque à ce que les quartiers s’enflamment de nouveau à terme.
Les débats actuels concernant la nouvelle loi sur l’immigration à l’Assemblée nationale, au-delà des réelles querelles politiciennes, montrent les hésitations et l’impasse dans laquelle se trouve la bourgeoisie. Dans tous les cas, la situation ne pourra que se durcir pour les immigrés déjà largement criminalisés, sans que cela ne règle pour pourtant les contradictions croissantes au sein de la vie politique.
La bourgeoisie n’a pas intérêt à laisser le populisme se développer et gagner en influence de voix le RN pour les futures élections. Une victoire du RN aux élections ne pourrait que fragiliser davantage la bourgeoisie française et aggraverait une crise politique qui est en train, manifestement, de s’installer durablement.
L, 15 décembre 2023
Situations territoriales:
Personnages:
Récent et en cours:
- extrême-droite [747]
- violence [748]
- Populisme [293]
Rubrique:
Révolution Permanente: Une contribution permanente à la politique anti-ouvrière de l’État
- 202 lectures
Il y a huit ans, une nouvelle organisation au nom « prometteur » de Révolution Permanente, faisait son apparition au sein du courant trotskiste, avec pour vocation de s’inscrire « dans le projet plus large de redonner une vitalité aux idées marxistes et révolutionnaires, en démontrant qu’elles n’ont pas vocation à rester confinées dans les bibliothèques, les caves ou les musées, mais gardent au contraire toute leur actualité pour comprendre le monde dans lequel nous vivons et former de nouvelles générations militantes prêtes à le transformer ».
À quoi pouvait-on s’attendre de la part de ce nouveau groupe politique trotskiste si ce n’est qu’il assume une fonction anti-ouvrière au même titre que ses pairs qui, depuis la Seconde Guerre mondiale, n’ont jamais manqué une occasion de trahir l’internationalisme prolétarien. Les partis de la Quatrième International avaient alors choisi le camp de l’impérialisme de l’URSS, face à d’autres impérialismes. 1
Quant à sa déclaration d’intention « en vue de revitaliser » les idées marxistes, s’agissant d’une organisation passée dans le camp de la bourgeoise2, on devait s’attendre à ce qu’elle soit plus dynamique que les autres chapelles trotskystes, à travers un langage parfois plus radical, dans son rôle de saboteur de la lutte et de la prise de conscience du prolétariat. S’il y a quelque chose qui change par rapport au NPA, dont elle est une scission, c’est effectivement qu’avec un langage plus radical et combatif que les « anti-capitalistes » elle pourra avoir un impact encore plus négatif sur les éléments qui s’éveillent à la politique révolutionnaire, comme on l’a vu dans les manifestations en France contre la réforme des retraites.
Le groupe Révolution Permanente se présente en France comme « une organisation politique révolutionnaire » mais « avec un point de vue assumé : du côté des travailleurs, de la jeunesse, des femmes, des personnes LGBT, des quartiers populaires et de tous les exploités et opprimés ». « Révolution Permanente s’inscrit dans le projet plus large de redonner une vitalité aux idées marxistes et révolutionnaires ». Le groupe appartient d’ailleurs à une « Fraction trotskyste pour la Quatrième Internationale3 », ce qui est clair : « … nous entendons contribuer aux débats au sein de l’extrême-Gauche nationale et internationale, dans le cadre de notre lutte pour reconstruire une internationale de la révolution socialiste, la IVe Internationale4 ». Quant à son nom, il fait référence à la théorie de la « révolution permanente » de Trotsky.
Cette organisation se présente également comme faisant partie d’un « réseau international en 7 langues », qui regroupe plusieurs organisations basées dans certains pays d’Amérique du Sud et centrale, mais aussi aux États-Unis, en Italie, en Espagne et en Allemagne : « 15 journaux, 7 langues, la même voix ». Nous verrons qu’il y a quand même des nuances politiques entre ces organisations et qu’elles ne constituent aucunement une organisation internationale.
Le nouveau groupe a déjà gagné ses galons dans La lutte contre la réforme des retraites où il a été très présent.
Il a effectué au cours du mouvement de contestation de la réforme des retraites une intervention importante, dont nous avons mis en évidence la logique profonde : dans une intervention vidéo5, le candidat à la présidentielle et principal porte-voix de Révolution Permanente Anasse Kazib, se dit très « critique de l’intersyndicale et pour plusieurs raisons : la première et la plus importante, c’est parce que moi, je suis pour l’auto-organisation ; je suis pour que la grève appartienne aux grévistes, dans les assemblées générales, dans les coordinations de travailleurs, dans les rencontres interprofessionnelles » ; « intersyndicale n’est pas synonyme de victoire, au contraire, ça fait presque trente ans maintenant que le mouvement ouvrier perd systématiquement contre les réformes des gouvernements successifs » La conséquence devrait être simple : les syndicats, notamment quand ils sont unis, parce qu’ils ne permettent aucunement l’auto-organisation et de lutter victorieusement, sont en fait des outils de l’État pour saboter les luttes. Depuis longtemps déjà les syndicats sont devenus des obstacles à la lutte de classe, comme en avaient témoigné durant la révolution en Allemagne en 1919 les confrontations de la classe ouvrière à cet ultime rempart de l’ordre capitaliste et comme cela n’a cessé d’être confirmé depuis lors. En effet, ils ne peuvent échapper à leur absorption par l’État partout dans le monde. Leurs « méthodes de lutte » sont basées sur l’enfermement local et corporatiste de la lutte, non seulement ils ne permettent pas aux ouvriers de l’emporter, mais permettent à la bourgeoisie de les diviser et de détruire la principale force de la classe ouvrière : son unité.
Or par la bouche de son principal porte-voix, Révolution Permanente nous dit que « l’unité syndicale, c’est dans le combat, c’est dans la rue, c’est là où on montre l’unité syndicale, c’est lorsqu’on fait des tournées de piquets, qu’on montre qu’on est du côté des travailleurs, qu’on est opposé aux réquisitions, qu’on fait front avec les travailleurs devant les CRS pour empêcher les réquisitions. Mais mille fois oui à cette unité syndicale-là ! ».
Donc, d’un côté l’intersyndicale n’a jamais permis aux ouvriers de l’emporter, mais d’un autre côté il faut qu’elle montre qu’elle est du côté des travailleurs ! Révolution Permanente nous sert donc un discours d’apparence « critique » mais servant à masquer que l’intersyndicale ne peut qu’être un facteur de défaite systématique pour le mouvement. Autrement dit, en cachant soigneusement le fait que les syndicats sont des organes bourgeois totalement intégrés à l’appareil d’état. Elle renforce très clairement le localisme et le corporatisme dans la classe ouvrière par une série d’articles sur des luttes locales, sans jamais chercher à faire le lien entre elles : à Brest, à Toulouse, à Vulaines sur Seine, à Châtillon… La confusion orchestrée, la contradiction dans les discours ne permettent aucunement aux ouvriers en lutte de comprendre qui sont leurs véritables ennemis, que leur lutte ne peut l’emporter que par l’unité et le combat contre les diviseurs syndicaux, et de fait contribue à détruire l’unité dont le mouvement a besoin pour l’emporter. Le soutien aux caisses de grève locales6 renforce d’ailleurs clairement l’isolement des luttes et les mystifications syndicales. Il n’est d’ailleurs dans ce discours jamais question d’unité et d’autonomie de la classe ouvrière, seulement de l’unité syndicale. Révolution Permanente n’a donc aucunement pour but de faire triompher les luttes, mais plutôt de renforcer les forces d’encadrement syndicales par la division en amplifiant la difficulté pour les ouvriers de s’auto-organiser en-dehors et contre les syndicats. Comme le font déjà tous les groupes trotskystes, ajouterons-nous.
Le soutien au parlementarisme et à la démocratie bourgeoise
Le fait de présenter un candidat à l’élection présidentielle française, de constamment chercher à soutenir des candidats aux élections partout où elle est présente fait déjà de Révolution Permanente un solide défenseur de la démocratie bourgeoise7. Mais cela va plus loin : ce groupe défend bec et ongles une vision politique profondément démocratique, notamment par son soutien à l’antifascisme8 et par la dénonciation des pratiques « antidémocratiques » de Macron et de ses soutiens politiques. Dans un article de mai dernier Révolution Permanente se plaint que la bourgeoisie utilise son Parlement pour… faire passer des lois anti-ouvrières ! « A n’en pas douter, la présidente de l’Assemblée nationale Yaël Braun-Pivet est tout aussi préoccupée que ses collègues macronistes par la nouvelle crise parlementaire qui l’attend le 8 juin. Mais elle est sans doute beaucoup plus lucide sur le caractère explosif des outils antidémocratiques que mobilise le régime pour faire passer en force ses mesures antisociales.9 » A aucun moment n’est invoqué ce que Lénine écrivait sur la démocratie bourgeoise : « La croissance du mouvement révolutionnaire prolétarien dans tous les pays suscite les efforts convulsifs de la bourgeoisie et des agents qu’elle possède dans les organisations ouvrières pour découvrir les arguments philosophico-politiques capables de servir à la défense de la domination des exploiteurs. La condamnation de la dictature et la défense de la démocratie figurent au nombre de ces arguments. Le mensonge et l’hypocrisie d’un tel argument répété à satiété dans la presse capitaliste et à la conférence de l’Internationale jaune de Berne en février 1919 sont évidents pour tous ceux qui ne tentent pas de trahir les principes fondamentaux du socialisme ». Effectivement, les « efforts convulsifs » de Révolution Permanente pour essayer de nous faire avaler que le Parlement serait un lieu de lutte pour la classe ouvrière montrent clairement le caractère profondément bourgeois de cette organisation. Et cette démonstration, Lénine la poursuite de façon implacable : « Tous les socialistes en démontrant le caractère de classe de la civilisation bourgeoise, de la démocratie bourgeoise, du parlementarisme bourgeois, ont exprimé cette idée déjà formulée, avec le maximum d’exactitude scientifique par Marx et Engels que la plus démocratique des républiques bourgeoises ne saurait être autre chose qu’une machine à opprimer la classe ouvrière à la merci de la bourgeoisie, la masse des travailleurs à la merci d’une poignée de capitalistes.10 » Révolution Permanente passe délibérément sous silence cette leçon authentique et précieuse des révolutionnaires du passé… et ce n’est donc pas par hasard.
Le nationalisme de Révolution Permanente
Dans un article publié sur son site où elle critique les positions prises par le NPA sur la guerre en Ukraine, Révolution Permanente nous dévoile sa vision des rapports impérialistes ; en critiquant la prise de position claire et nette du NPA qui s’est engagé dans la défense de l’impérialisme ukrainien, allié à un certain nombre de pays dont les États-Unis, Révolution Permanente se donne une apparence d’internationalisme prolétarien : c’est une « guerre réactionnaire », et « Contrairement aux regroupements de cette « gauche » pro-impérialiste, il y a urgence à commencer à regrouper les forces qui s’opposent à la guerre et qui dénoncent aussi bien le Kremlin que l’OTAN d’un point de vue de classe.11 »
Une organisation prolétarienne ne saurait mieux dire. Là où ça se gâte, c’est lorsque Révolution Permanente nous explique pourquoi elle ne soutient pas l’Ukraine ou le Kremlin dans ce conflit : « Le conflit en Ukraine n’est en effet pas comparable à ceux de la guerre d’Algérie, du Vietnam ou d’autres guerres anticoloniales et anti-impérialistes, car ce qui se joue en Ukraine ne se réduit pas juste à un affrontement entre Kiev et Moscou.12 » Pour Révolution Permanente, il y a donc lieu de soutenir un conflit guerrier qui est une « guerre anticoloniale et anti-impérialiste », et la guerre d’Algérie, celle du Vietnam ou la Guerre d’Espagne en faisaient donc logiquement partie selon elle.
Sauf que tous les conflits de décolonisation dont nous parle Révolution Permanente ont tous été des conflits de nature impérialiste . Ils ne se sont jamais réduits à un affrontement entre la métropole et sa colonie, l’implication d’autres puissances dans ceux-ci a toujours été une réalité. En quoi la guerre d’Algérie, où le FLN était soutenu à la fois par les États-Unis et l’URSS contre la vieille puissance coloniale française, ou la Guerre du Vietnam, conflit de la Guerre froide à part entière avec la participation de l’URSS et de la Chine contre les États-Unis, ont-ils été « anti-impérialistes » ? On ne le saura pas, *** la démonstration de Révolution Permanente s’arrête là. Ces conflits ont tous été des moments de l’affrontement des blocs impérialistes rivaux de la Guerre froide, le Viêt-Cong n’ayant jamais eu la capacité à lui seul d’affronter et la France et les États-Unis. De la même façon, le conflit en Algérie a surtout montré que les deux superpuissances s’étaient circonstanciellement alliées contre la France, en fournissant une aide militaire et surtout diplomatique au FLN et à ses soutiens : l’épisode de l’expédition de Suez est assez parlante à ce sujet. Quant à la Guerre d’Espagne, l’implication des grandes puissances de l’époque pour soutenir l’un ou l’autre des deux camps en présence ne permet aucun doute sur le caractère impérialiste de cet épisode, avec la lamentable trahison de l’internationalisme prolétarien par les Trotskystes à travers la défense de l’État capitaliste républicain.
En ce qui concerne la guerre en Ukraine, Révolution Permanente nous indique très clairement qu’il s’agit d’un conflit qui sert à « affaiblir la Russie (mais aussi la Chine dont la Russie est devenue le principal allié) et préserver l’ordre mondial dominé par les États-Unis. » La différence avec la guerre du Vietnam ne saute pas aux yeux à première vue, et pour tout dire la vision de Révolution Permanente d’une « guerre de libération nationale » non plus…
Le dit « droit à l’autodétermination », qui permettrait selon Révolution Permanente de faire la différence entre une guerre impérialiste et une lutte nationale contre la domination coloniale, est une idée fausse et dangereuse, bourgeoise. Si l’idée de « libération nationale »a pu être soutenue par le mouvement ouvrier, comme lors du « Printemps des peuples » en 1848/49 – au cours duquel F. Engels lui-même s’est engagé dans les combats d’Elberfeld pour l’unité allemande –, c’est uniquement dans le cadre de la phase d’ascendance du capitalisme, pour un mouvement possiblement progressiste à l’époque.. Mais cette idée de « l’autodétermination nationale », si elle a existé dans la Seconde Internationale, a été fermement combattue par toute une partie de la Gauche, notamment par Rosa Luxemburg, qui la première a montré les fondements réels de l’impérialisme dans le déclin historique du capitalisme.
Contrairement à ce que tout le mouvement trotskyste peut nous dire aujourd’hui, l’impérialisme n’est pas une caractéristique particulière à une nation, c’est – comme l’écrivait Lénine – le stade où en est arrivé l’ensemble du capitalisme depuis un siècle. Ainsi que l’expliquait Rosa Luxemburg, dans L’accumulation du Capital, aucun Capital national ne saurait se soustraire aux conditions générales du monde capitaliste. .. Dans la période actuelle le nationalisme, idéologie propre à la bourgeoisie, permet de justifier ces luttes incessantes entre bourgeoisies, qui ne concernent aucunement le prolétariat : « Les ouvriers n’ont pas de patrie. On ne peut leur ravir ce qu’ils n’ont pas13 », comme le disait déjà le Manifeste communiste de Marx et Engels, en… 1847 !
Toutes les nations sont impérialistes, dans un monde où il ne peut en être autrement. L’impérialisme, c’est la défense de ses intérêts propres par une bourgeoisie nationale, Face à l’impasse économique mondiale, à l’exacerbation des contradictions à tous les niveaux, chaque état national est poussée dans la fuite en avant dans le militarisme et la guerre. Ce monde de requins, Révolution Permanente le partage, même si de manière masquée, et pour cela nie son existence.
Révolution Permanente et la logique de guerre
Pour expliquer sa vision de l’impérialisme, on peut se tourner vers le « réseau international » de Révolution Permanente, par exemple le groupe allemand Klasse gegen Klasse, qui publie un texte posant clairement la question : la Russie est-elle impérialiste ?14 L’article ayant été écrit par un Américain qui défend pêle-mêle Cuba, le Venezuela et le Nicaragua contre « l’impérialisme », on sait à quoi s’en tenir sur la réponse. Klasse gegen Klasse dit ne pas partager toutes les conclusions de l’article, mais le publie quand même parce que « l’argument de base sur la question de l’impérialisme russe reste définitivement intéressant pour nos lecteurs. » En gros, KgK ne souhaite pas aller aussi loin que l’auteur, mais partage son argumentation initiale : la Russie n’est pas impérialiste.
A l’appui de cette idée, dans un article de « débat »15, Révolution Permanente développe que la Russie est fondamentalement une nation dominée, et par conséquent ne serait pas impérialiste : en fait, pour Révolution Permanente, « si certaines caractéristiques de l’État russe créent l’« illusion d’une superpuissance », elles masquent une situation en réalité très subordonnée de la Russie. » « … la Russie [agit] comme une sorte d’« impérialisme militaire » (bien qu’elle ne soit pas un pays impérialiste au sens précis du terme : elle n’a pas de projection internationale significative de ses monopoles et de ses exportations de capitaux ; elle exporte essentiellement du gaz, du pétrole et des matières premières) ». Cet article ignore d’une part que l’impérialisme n’est pas une question purement économique, concernant un pays ou un autre, mais l’ensemble du système capitaliste, et son auteur passe également sous silence, de façon intéressée, que la Russie est aussi… le second exportateur d’armes du monde. L’impérialisme n’est pas spécifiquement lié à l’exportation de capitaux, ni au fait qu’un État est plus faible que d’autres, il est la a conséquence inéluctable du développement du mode de production capitaliste au sein duquel chaque bourgeoisie n’a d’autre issue, sous peine de disparition, que la défense acharnée de ses intérêts et donc de son existence face aux rivalités économique et militaires mondiales. Et par conséquent, contrairement à ce qu’affirme plus ou moins clairement Révolution Permanente, la Russie est aussi impérialiste que ses opposants de l’OTAN. Ses interventions militaires en Tchétchénie, en Géorgie, en Ukraine, en Syrie et ailleurs le montrent amplement.
On peut d’ailleurs constater que la position de Révolution Permanente sur la guerre en Ukraine est une merveille d’ambiguïté à des fins d’enfumage ; dans un article portant une critique apparemment très dure à la position du NPA16, et qui n’accole jamais le terme « impérialiste » à la Russie, cette organisation affirme qu’elle considère « que la seule issue progressiste dans cette guerre ne peut venir que de la main de la classe ouvrière, mobilisée de façon totalement indépendante de Poutine, mais aussi du gouvernement Zelensky, des oligarques ukrainiens et des impérialistes de l’OTAN. Cela signifie que la seule façon pour l’Ukraine de retrouver une véritable auto-détermination nationale c’est à travers la révolution ouvrière et socialiste, qui pose les bases de la création d’une Ukraine socialiste et véritablement indépendante. Dans le cadre du capitalisme semi-colonial, il est impensable que l’Ukraine puisse être indépendante réellement de la Russie ou des impérialistes occidentaux. »
D’une part, on peut demander ce qu’est une « véritable auto-détermination nationale » ; le but des communistes n’est pas et n’a jamais été de créer de nouvelles nations qui permettent de diviser encore un peu plus la classe ouvrière mondiale.
D’autre part si d’un côté Révolution Permanente nous dit appeler de ses vœux une révolution ouvrière contre la guerre, et que « cette tâche ne peut pas reposer seulement sur le dos de la classe ouvrière ukrainienne. Ses premiers alliés sont les travailleurs et travailleuses de Russie », elle n’appelle nulle part au renversement de l’État russe, ni à un combat commun contre la bourgeoisie. On touche là le cœur de la réflexion de nos Trotskystes, bien digne de ce que leurs ancêtres faisaient pendant la Seconde Guerre mondiale : appeler les prolétaires allemands à se soulever contre les Nazis, oui ; faire la même chose du côté russe en appelant les prolétaires à renverser l’État soviétique, non. Et on voit que la longue habitude des Trotskystes de toujours chercher un camp à défendre dans une guerre impérialiste, y compris en nous affirmant le contraire, a encore de beaux jours devant elle…
Si la position de Révolution Permanente sur la guerre en Ukraine peut donner l’illusion d’être prolétarienne et internationaliste, le retour du conflit proche-oriental sur le devant de la scène mondiale donne à cette organisation l’occasion de se démasquer en se vautrant dans une défense claire et nette du nationalisme palestinien.
« Free Gaza17 », « Des syndicalistes anglais bloquent une usine d’armement israélienne : workers for a free Palestine18 », « Amplifions le soutien à la Palestine, tous dans la rue à Paris samedi !19», les titres des articles sur la question ne laissent aucun doute sur le soutien de Révolution Permanente à la « cause », nationale palestinienne. L’élément structurant de sa position est le soi-disant « droit à l’autodétermination du peuple palestinien »..
Surtout, Révolution Permanente montre clairement sa nature bourgeoise. Elle appelle « internationalisme » la « solidarité » avec un État palestinien qui est déjà une machine de répression contre les exploités, et qui possède proportionnellement la plus forte proportion de flics par rapport à sa population totale ! Et on doit ajouter que, de toute façon, le prolétariat palestinien de Gaza se trouve déjà sous le joug des Islamistes du Hamas, et quoi que puissent objecter les soutiens de la « cause palestinienne », ils soutiennent la répugnante oppression religieuse menée par le Hamas à Gaza, et celle des Staliniens de l’OLP en Cisjordanie. Cela n’a rien à voir avec l’internationalisme prolétarien, qui en 1914 a été porté haut par le Parti socialiste serbe, lequel a refusé de participer à l’Union sacrée contre l’offensive de l’Autriche-Hongrie contre la Serbie, et par Trotsky, pourchassé sur tous les continents pour avoir dénoncé la guerre impérialiste.
Ce que les communistes appellent internationalisme s’appuie sur l’unité de la classe ouvrière face à ses exploiteurs, quelle que soit leur nationalité. Nous, Communistes internationalistes, appelons le prolétariat israélien ET palestinien à se soulever contre la logique de guerre et à combattre les États israélien ET palestinien, c’est-à-dire refuser l’Union sacrée.
HG, le 30 octobre 2023
1Lire notre article « Le trotskisme et la deuxième guerre mondiale [749] »
2Lire notre brochure Le trotskysme contre la classe ouvrière [516]
7Lire par exemple https://www.revolutionpermanente.fr/Argentine-Avec-Cristian-Castillo-la-... [754]
8https://www.revolutionpermanente.fr/Argentine-voter-pour-un-peroniste-de-droite-pour-faire-barrage-a-l-extreme-droite [755]. Voir aussi https://www.revolutionpermanente.fr/Brest-10-ans-apres-la-mort-de-Clemen... [756]
12Ibid.
16https://www.revolutionpermanente.fr/Guerre-en-Ukraine-Le-NPA-a-la-remorque-de-la-gauche-pro-OTAN [759]. Il peut être utile de rappeler que le Nouveau Parti Anticapitaliste (NPA) est l’organisation dont Révolution Permanente a été exclue.
Récent et en cours:
- Révolution Permanente [568]
Rubrique:
Autorisation du glyphosate par l’UE: Le bal des hypocrites
- 99 lectures
Le glyphosate est un herbicide très efficace. C’est le désherbant le plus vendu au monde; pulvérisé chaque année sur des millions d’hectares, son utilisation a été environ multipliée par cent dans le monde en quarante ans. Mais le glyphosate est classé depuis le 20 mars 2015 comme probablement cancérigène par le Centre international sur le cancer (CIRC) qui regroupe de nombreuses études indépendantes et, entre autres, celles de l’INSERM. Pour sa part, l’Agence européenne de sécurité des aliments (EFSA) conclue (sans surprise) que le produit est sans danger s’il est utilisé « normalement » tout en reconnaissant des lacunes dans les analyses sur les effets délétères potentiels sur les écosystèmes.
Les études d’impact sont biaisées et ne portent que sur le seul glyphosate, alors qu’il est toujours utilisé avec des additifs. En 2023, une étude du CNRS alertait sur la responsabilité des pesticides dans la disparition des oiseaux en Europe qui ont perdu 60 % de leur population en à peine quarante ans, de même que sur la biodiversité des sols. Monsanto, qui produit le Roundup, a répliqué en faisant rédiger des articles favorables, signés par des chercheurs de renom qui se sont ensuite répandus et amplifiés sur les réseaux sociaux, tout en exerçant de fortes pressions sur les scientifiques… et notamment ceux du CIRC. Cette pratique a été révélée par les Monsanto papers.
Cette molécule de synthèse a accompagné le développement de l’agriculture intensive, en favorisant les productions à moindre coût sur des surfaces gigantesques et le glyphosate est l’un 1500 pesticides utilisés dans le monde (450 en Europe). C’est donc l’un des piliers de la production agricole capitaliste dans le monde soumis à une âpre concurrence sur le marché mondial, ce qui éclaire la décision de la Commission européenne, elle-même un haut lieu de la concurrence infra-européenne, de reconduire l’usage du glyphosate pour 10 ans. Les États membres n’étaient pas parvenus à la majorité qualifiée pour moduler le texte initial (par exemple une durée de sept ans) mais l’écrasante majorité étaient d’accord sur la reconduction : le texte a donc été reconduit en l’état, ce qui satisfait tout le monde.
En réalité, on comprend bien que, pour toutes les puissances agricoles dont la France, malgré les intentions démagogiques affichées en 2017 avec Nicolas Hulot comme ministre de l’Écologie, il n’est pas question de renoncer à ce pesticide aussi efficace que controversé, en dépit des risques sanitaires, tant qu’il n’existe pas de solution alternative, selon les mots du gouvernement. La France, voulant ménager les sensibilités écologiques à l’approche des élections européennes, s’est abstenue, prétendant hypocritement que cela équivalait voter contre !
En fait, il y a des alternatives, par exemple mécaniques, mais qui ne font pas le poids comme il transparaît dans le propos d’un agronome : « Ceux qui ont le plus à perdre, ce sont les très grosses exploitations […] Elles ont construit des systèmes très cohérents, conçus dans une extrême dépendance au glyphosate », dont l’utilisation est bien plus rapide et économique que la combinaison d’autres méthodes, qui nécessitent plus de main-d’œuvre et de temps, et donc en ce sens, il n’y a pas d’alternative. Face à la logique capitaliste implacable à laquelle se conforme l’Union Européenne comme l’ensemble des principales puissances agricoles, l’alternative mécanique est inadaptée au marché mondial où la production agricole intensive de l’Europe tient les premiers rangs.
Cette décision a provoqué une large indignation légitime, d’une part, et les protestations hypocrites de la gauche. Tous à gauche citent d’abord la promesse démagogique d’Emmanuel Macron en 2017 d’interdire l’herbicide dans les trois ans… mais elles font rarement référence aux enjeux de la concurrence mondiale et préfèrent montrer du doigt l’influence, selon eux, déterminante des lobbies de l’industrie chimique et de l’agriculture dans cette décision qui est un vieux refrain pratique pour ne pas aller au fond du problème. Ainsi Manuel Bompart (LFI) déclarait : « Le travail de lobbying de ce grand groupe Bayard Monsanto a porté ses fruits » ou encore « Tout le monde sait que les lobbies des pesticides au niveau européen utilisent des moyens financiers considérables pour peser sur les décisions politiques ».
Dans notre article « Derrière les lob [766]bies, la main bien visible du capitalisme d’État [766] », nous disions que « présents à tous les niveaux de la sphère politique, les lobbies font partie de la défense de chaque capital national, dont l’État est le garant ». La gauche présente les lobbies comme des entités « extérieures » à l’État. En réalité, ils font partie intégrante du capitalisme d’État. Il n’y a qu’à voir la pléthore de capitalistes qui accompagne les chefs d’État en voyage quand des contrats économiques majeurs sont en jeux. Présenter mensongèrement les États comme des entités « neutres », qui pourraient échapper à la « logique libérale » des patrons et des lobbies, est le fonds de commerce de l’idéologique démocratique en général et des gauchistes en particulier. Il est en réalité le principal administrateur du capital national et entretient de ce fait, des rapports très étroits avec les entreprises.
La France s’est alignée sur la FNSEA nous dit-on, mais depuis quand les intérêts respectifs devraient diverger ou du moins dans quel monde ? Pour Lutte Ouvrière : « Tant que les industriels contrôleront la production, avec le soutien des États à plat ventre devant les intérêts des capitalistes, la santé passera après les profits ». C’est une vision mensongère de l’État, faible et lâche, qui induit là-aussi une séparation entre l’État et le capitalisme, alors que depuis l’apparition du capitalisme d’État, précisément, lors de la Première Guerre mondiale et la période de décadence, l’État contrôle toute la vie sociale et seul celui-ci peut prendre en main l’économie nationale de façon globale et centralisée et atténuer la concurrence interne qui l’affaiblit afin de renforcer sa capacité, à affronter comme un tout la concurrence entre nations sur le marché mondial.
Ce que ne veulent pas dire toutes les officines de gauche ou gauchistes, c’est que les États et leurs industriels ne peuvent pas faire autrement que défendre leurs intérêts face à la concurrence mondiale acharnée dans ce secteur stratégique comme dans bien d’autres. Leurs assertions sur les intérêts des lobbies ou les profits des multinationales ne sont des écrans de fumée visant à cacher que le problème mettant en danger la santé humaine, c’est le capitalisme lui-même.
Luc, 19 décembre 2023
Questions théoriques:
- "Ecologie" [290]
Rubrique:
Guerres au Moyen-Orient et en Ukraine, rivalité entre les États-Unis et la Chine… Le capitalisme nous conduit-il vers la troisième guerre mondiale?
- 357 lectures
Après deux ans de conflit en Ukraine sur fond de rivalité sino-américaine et face aux risques d’extension de la guerre au Moyen-Orient, la crainte d’un nouveau conflit mondial s’accroît. Les conditions d’un tel conflit sont-elles réunies ? Assiste-t-on la constitution de nouveaux blocs impérialistes ? Le prolétariat est-il prêt à se laisser embrigader massivement dans un conflit mondial ?
Afin de discuter de ces questions, le CCI organise des réunions publiques, partout où il est présent, en France et dans le monde. Ces réunions sont des lieux de débat ouverts à tous ceux qui souhaitent rencontrer et discuter avec le CCI. Nous invitons vivement tous nos lecteurs, contacts et sympathisants à venir y débattre afin de poursuivre la réflexion sur les enjeux de la situation et confronter les points de vue.
- Paris : samedi 20 janvier de 15h à 18h, CICP, 21ter rue Voltaire, 75011 Paris, métro "Rue des Boulets"
Vie du CCI:
- Réunions publiques [219]
Rubrique:
Les États-Unis, superpuissance dans la décadence du capitalisme, aujourd'hui épicentre de la décomposition sociale (Partie II)
- 204 lectures
Le premier volet de cet article[1] a décrit la montée en puissance de l’impérialisme américain, qui devient dans la phase de décadence du capitalisme l’impérialisme dominant, leader du bloc occidental qui finit par triompher du bloc concurrent, le bloc soviétique, à la fin des années 1980. Dans l’introduction de cette première partie, il était déjà souligné que « L'effondrement du bloc de l'Est marque le début d'une phase terminale dans l'évolution du capitalisme : la décomposition sociale », qui va accélérer non seulement l’enfoncement du système bourgeois dans le chaos et la barbarie, mais va entraîner par la même occasion le déclin du leadership américain. Le deuxième volet de cet article se centrera précisément sur la mise en évidence de ce processus qui débute dans les années 1990 : « En 30 ans de pourrissement de la société bourgeoise, les États-Unis sont devenus un facteur d'aggravation du chaos, leur leadership mondial ne sera pas récupéré, peu importe que l'équipe Biden le proclame dans ses discours, ce n'est pas une question de souhaits, ce sont les caractéristiques de cette phase finale du capitalisme qui déterminent le cours des tendances et l'abîme vers lequel le capitalisme nous mène si le prolétariat n'y mettait pas fin par la révolution communiste mondiale »[2].
1. L’implosion du bloc soviétique exacerbe le chacun pour soi et le chaos mondial
L’implosion du bloc de l’Est marque l’ouverture de la période de décomposition du capitalisme, une période où s’accélère dramatiquement la débandade des différentes composantes du corps social dans le « chacun pour soi », l’enfoncement dans le chaos. S'il est un domaine où s'est immédiatement confirmée cette tendance, c’est bien celui des tensions impérialistes : « La fin de la "guerre froide" et la disparition des blocs n'a donc fait qu'exacerber le déchaînement des antagonismes impérialistes propres à la décadence capitaliste et qu'aggraver de façon qualitativement nouvelle le chaos sanglant dans lequel s'enfonce toute la société (...) »[3].
De fait, la totale désagrégation de bloc soviétique mène aussi à l’implosion de l’Union soviétique elle-même, mais elle entraine en corolaire le délitement du bloc US concurrent. Le texte d’orientation « Militarisme et décomposition [396] »[4] examine quel est l’impact de l’entrée du capitalisme décadent dans sa période de décomposition pour le déploiement de l’impérialisme et du militarisme. Il met d’emblée en évidence que la disparition des blocs ne remet pas en cause la réalité de l’impérialisme et du militarisme. Au contraire, ceux-ci deviennent plus barbares et chaotiques : « En effet, ce n'est pas la constitution de blocs impérialistes qui se trouve à l'origine du militarisme et de l'impérialisme. C'est tout le contraire qui est vrai : la constitution des blocs n'est que la conséquence extrême (qui, à un certain moment peut aggraver les causes elles-mêmes), une manifestation (qui n'est pas nécessairement la seule) de l'enfoncement du capitalisme décadent dans le militarisme et la guerre. (…) la fin des blocs ne fait qu'ouvrir la porte à une forme encore plus barbare, aberrante et chaotique de l'impérialisme »[5].
Cette exacerbation de la barbarie guerrière s’exprimera plus concrètement par le biais de deux tendances majeures, qui marqueront le développement de l’impérialisme et du militarisme pendant ces trois dernières décennies :
- Une première caractéristique importante est l’éclatement des appétits impérialistes tous azimuts, ce qui aura pour conséquence la multiplication des tensions et des foyers de conflits : « La différence avec la période qui vient de se terminer, c’est que ces déchirements et antagonismes, qui auparavant étaient contenus et utilisés par les deux grands blocs impérialistes, vont maintenant passer au premier plan. (…) du fait de la disparition de la discipline imposée par la présence des blocs, ces conflits risquent d’être plus violents et plus nombreux, en particulier, évidemment, dans les zones où le prolétariat est le plus faible »[6]. Cette multiplication des antagonismes est par ailleurs une entrave majeure à la reconstitution de nouveaux blocs dans la période actuelle.
- La deuxième tendance qui découle de l’exacerbation du chacun pour soi est l’explosion d’un chaos sanglant et en corollaire les tentatives de contenir celui-ci, qui constituent tous les deux des facteurs d’aggravation de la barbarie guerrière : « le chaos régnant déjà dans une bonne partie du monde et qui menace maintenant les grands pays développés et leurs rapports réciproques, (…) face à la tendance au chaos généralisé propre à la phase de décomposition, et à laquelle l’effondrement du bloc de l’Est a donné un coup d’accélérateur considérable, il n’y a pas d’autre issue pour le capitalisme, dans sa tentative de maintenir en place les différentes parties d’un corps qui tend à se disloquer, que l’imposition du corset de fer que constitue la force des armes. En ce sens, les moyens mêmes qu’il utilise pour tenter de contenir un chaos de plus en plus sanglant sont un facteur d’aggravation considérable de la barbarie guerrière dans laquelle est plongé le capitalisme »[7].
De fait, face à cette tendance historique prédominante au chacun pour soi, les États-Unis, seule superpuissance subsistante, vont mener une politique visant à contrecarrer cette tendance et à maintenir leur statut déclinant en exploitant en particulier leur supériorité militaire écrasante pour imposer leur leadership sur le monde et en particulier sur leurs « alliés » : "Confirmed as the only remaining superpower, the USA would do everything in its power to ensure that no new superpower - in reality no new imperialist bloc - could arise to challenge its 'New World Order'"[8]. Ainsi, l’histoire des 35 dernières années est caractérisée non seulement par une explosion du « chacun pour soi », mais aussi par les tentatives continuelles de la part des États-Unis de maintenir leur position hégémonique dans le monde et de contrer le déclin inévitable de leur leadership. Ces initiatives incessantes des États-Unis pour maintenir leur leadership face à des menaces qui surgissent de toute part ne feront cependant qu’accentuer le chaos et la plongée dans le militarisme et la barbarie, dont Washington est en fin de compte l’instigateur principal. De plus, ces initiatives feront apparaître des dissensions internes au sein de la bourgeoisie américaine sur la politique à mener, qui s’accentueront avec le temps.
2. Un « nouvel ordre mondial » contre l’expansion du chaos
Face à la disparition des blocs et à l’intensification du chaos, le président des États-Unis, Georges W. Bush senior suscite l’invasion du Kuweit par les forces irakiennes, afin de permettre à Washington de mobiliser une large coalition militaire internationale autour des USA pour « punir » Saddam Hussein.
2.1. La première guerre du Golfe vise à contrer la montée du « désordre mondial »
La 1ère guerre du golfe (1991) vise en réalité à faire un « exemple » : face à un monde de plus en plus gagné par le chaos et le « chacun pour soi », le gendarme mondial américain veut imposer un minimum d'ordre et de discipline, en premier lieu aux pays les plus importants de l'ex-bloc occidental. La seule superpuissance qui se soit maintenue veut imposer à la « communauté internationale » un « nouvel ordre mondial » sous son égide, parce que c'est la seule qui en ait les moyens mais aussi parce que c'est le pays qui a le plus à perdre dans le désordre mondial : " En 1992, Washington adopte consciemment une orientation très claire pour sa politique impérialiste dans la période d’après-guerre froide, à savoir une politique basée sur "l'engagement fondamental de maintenir un monde unipolaire dans lequel les États-Unis n'aient pas d'égal. Il ne sera permis à aucune coalition de grandes puissances d'atteindre une hégémonie sans les États-Unis" (prof. G. J. Ikenberry, Foreign Affairs, sept-oct. 2002). Cette politique vise à empêcher l’émergence de toute puissance en Europe ou en Asie qui puisse remettre en cause la suprématie américaine et jouer le rôle de pôle de regroupement pour la formation d’un nouveau bloc impérialiste. Cette orientation, initialement formulée dans un document de 1992 (1992 Defense Planning Guidance Policy Statement) rédigé par Rumsfeld, durant la dernière année du premier mandat Bush, établit clairement cette nouvelle grande stratégie"[9].
En vérité, la politique de Bush senior, loin de faire entrer la planète dans un « nouvel ordre mondial » sous la supervision de Washington, ne représente qu’une tentative désespérée des États-Unis de contenir l’expansion foudroyante du « chacun pour soi » ; elle va fondamentalement aboutir à une accentuation du chaos et des confrontations guerrière : six mois seulement après la guerre du Golfe, l'explosion de la guerre en Yougoslavie, venait déjà confirmer que le "nouvel ordre mondial" ne serait pas dominé par les Américains, mais par le « chacun pour soi » rampant.
La guerre civile sanglante résultant de l’éclatement de l’ex-Yougoslavie (1995-2001) voit se manifester et s’opposer les appétits impérialistes des différents « alliés de l’ex-bloc américain : la France et l’Angleterre soutiennent la Serbie, l’Allemagne la Croatie et la Turquie la Bosnie : « 6) Le conflit dans l’ex-Yougoslavie, enfin, vient confirmer une des autres caractéristiques majeures de la situation mondiale : les limites de l'efficacité de l'opération « Tempête du Désert » de 1991 destinée à affirmer le leadership des États-Unis sur le monde. Comme le CCI l'a affirmé à l'époque, cette opération de grande envergure n'avait pas comme principale cible le régime de Saddam Hussein ni même les autres pays de la périphérie qui auraient pu être tentés d'imiter l'Irak. Pour les États-Unis, ce qu'il s'agissait avant tout d'affirmer et de rappeler, c'était son rôle de « gendarme du monde » face aux convulsions découlant de l'effondrement du bloc russe et particulièrement d'obtenir l'obéissance de la part des autres puissances occidentales qui, avec la fin de la menace venue de l'Est, se sentaient pousser des ailes. Quelques mois à peine après la guerre du Golfe, le début des affrontements en Yougoslavie est venu illustrer le fait que ces mêmes puissances, et particulièrement l'Allemagne, étaient bien déterminées à faire prévaloir leurs intérêts impérialistes au détriment de ceux des États-Unis »[10]. Finalement, c’est en enserrant de façon croissante l'ensemble du monde dans le corset d'acier du militarisme et de la barbarie guerrière, en intervenant militairement, d’abord aux côtés de la Croatie, puis de la Bosnie contre la Serbie, que le président Clinton va contrer les appétits impérialistes des pays européens en imposant sous son autorité la « pax americana » dans la région (accords de Dayton, déc. 1995).
L’opération « Tempête du désert », loin d’avoir réprimé la contestation du leadership US et les divers appétits impérialistes, a exacerbé la polarisation. Ainsi, les moudjahidines qui combattaient les russes en Afghanistan s’élèvent contre les « croisés » US (constitution de Al-Qaïda sous la direction de Osama bin Laden) et s’inspirent de l’échec de l’intervention américaine en Somalie (opération "Restore Hope" de 1993 à 1994) pour entamer dès la fin 1998 une campagne d’attentats djihadistes anti-américains. Après l’échec de son armée lors de l’invasion du Sud-Liban, la droite israélienne dure monte au pouvoir en 1996 (1er gouvernement Netanyahu) contre la volonté du gouvernement américain qui soutenait Shimon Peres, laquelle droite fera tout à partir d’alors pour saboter le processus de paix avec les Palestiniens (les accords Israélo-palestiniens d’Oslo), qui constituait un des plus beaux succès de la diplomatie de Washington dans la région. Enfin, le massacre de centaines de milliers de Tutsis et de Hutus en 1994 au Rwanda lors de la guerre entre clans locaux, soutenus chacun par des impérialismes occidentaux, exprime de manière dramatique à quoi mène l’intensification du « chacun pour soi » impérialiste.
Une des expressions les plus manifestes de la contestation du leadership américain est l'échec lamentable en février 1998 de l'opération « Tonnerre du désert », qui visait à infliger une nouvelle « punition » à l'Irak et, au-delà de ce pays, aux puissances qui la soutiennent en sous-main, notamment la France et la Russie. Les entraves posées par Saddam Hussein à la visite des « sites présidentiels » par des inspecteurs internationaux ont conduit la superpuissance à une nouvelle tentative d'affirmer son autorité par la force des armes. Mais cette fois-ci, contrairement au lancement de missiles sur l’Irak qu’elle imposa encore en 1996, elle a dû renoncer à son entreprise face à l'opposition résolue de la presque totalité des États arabes, de la plupart des grandes puissances et au soutien (timide) de la seule Grande-Bretagne. Le contraste entre la « Tempête du désert » et le « Tonnerre » du même nom met en évidence l’approfondissement de la crise du leadership des États-Unis. Bien sûr, Washington n'a nul besoin de la permission de quiconque pour frapper quand et où il le veut (ce qu’il a d’ailleurs fait fin 1998 au moyen de l’opération "Renard du Désert"). Mais en menant une telle politique, les états-Unis se placent précisément à la tête d'une tendance qu'ils veulent contrer, celle du chacun pour soi, alors qu’ils avaient momentanément réussi à l’éviter durant la guerre du Golfe. Pire encore : pour la première fois depuis la fin de la guerre du Vietnam, la bourgeoisie américaine (les partis Républicain et Démocrate) s'est montrée incapable de présenter un front uni vers l'extérieur, alors qu'elle était en situation de guerre.
2.2. Le surgissement de tensions explicites au sein de la bourgeoisie US
L’érosion de la capacité de la bourgeoisie américaine à gérer adéquatement le jeu politique se manifeste à la fin de la "guerre froide" et à l’entrée dans la période de décomposition du capitalisme, au début des années 1990, en particulier à travers la candidature « indépendante » de Ross Perot en ’92 et en ’96. " Cette tendance générale à la perte de contrôle par la bourgeoisie de la conduite de sa politique, si elle constitue un des facteurs de premier plan de l'effondrement du bloc de l'Est, ne pourra que se trouver encore accentuée avec cet effondrement, du fait:
- de l'aggravation de la crise économique qui résulte de ce dernier;
- de la dislocation du bloc occidental que suppose la disparition de son rival;
- de l'exacerbation des rivalités particulières qu'entraînera entre différents secteurs de la bourgeoisie (notamment entre fractions nationales, mais aussi entre cliques au sein d'un même État national) l'éloignement momentané de la perspective de la guerre mondiale"[11].
Cette tendance à la perte de contrôle du jeu politique s’exprimera ouvertement en 1998, en pleine opération "Renard du Désert". Pour la première fois depuis la fin de la guerre du Vietnam, la bourgeoisie américaine va se montrer incapable de présenter un front uni vers l'extérieur, alors qu'elle est en situation de guerre. Au contraire, la procédure d'« impeachment » contre Clinton, intensifiée durant les événements, met en évidence combien les politiciens américains, plongés dans un véritable conflit interne, au lieu de désavouer la propagande des ennemis de l'Amérique selon laquelle Clinton avait pris la décision d'intervenir militairement en Irak à cause de motivations personnelles (le "Monicagate"), y ont apporté leur crédit.
3. La croisade contre les « États voyous »
La résolution du congrès de RI en 1998, après l’échec de l’opération « Tonnerre du désert », était prémonitoire : « Si les États-Unis n'ont pas eu l'occasion, au cours de la dernière période, d'employer la force de leurs armes et de participer directement à ce « chaos sanglant », cela ne peut être que partie remise, dans la mesure, notamment, où ils ne pourront pas rester sur l'échec diplomatique essuyé en Irak »[12].
3.1. L’attaque terroriste de 9/11 engendre la « war against terror »
Avec la venue au pouvoir de Georges W. Bush junior et de son équipe de « néoconservateurs » (le vice-président D. Cheney, le secrétaire à la défense D. Rumsfeld, son adjoint Paul Wolfowitz et J. Bolton), Washington concentre son attention sur les « États voyous », tels la Corée du Nord, l’Iran ou l’Irak, qui menaceraient l’ordre mondial par leur politique agressive et leur soutien au terrorisme. Les attentats d’Al-Qaïda du 11 septembre 2001 sur le sol américain amènent le président Bush junior à appeler à une « croisade contre le terrorisme » et à déclencher une « War against terror » conduisant à l’invasion de l’Afghanistan et surtout de l’Irak en 2003. Malgré toutes les pressions américaines et la présentation de « fake news » à l’ONU visant à mobiliser la « communauté internationale » derrière leur opération militaire contre « l’axe du mal », les États-Unis échouent en fin de compte à mobiliser les autres impérialismes contre Saddam et doivent envahir quasiment seuls l’Irak avec pour seul allié significatif l’Angleterre de Tony Blair. « Si les attentats du 11 septembre ont permis aux États-Unis d'impliquer des pays comme la France et l'Allemagne dans leur intervention en Afghanistan, ils n'ont pas réussi à les entraîner dans leur aventure irakienne de 2003, réussissant même à susciter une alliance de circonstance entre ces deux pays et la Russie contre cette dernière intervention. Par la suite, certains de leurs "alliés" de la première heure au sein de la "coalition" qui est intervenue en Irak, tels l'Espagne et l'Italie, ont quitté le navire. Au final, la bourgeoisie américaine n'a atteint aucun des objectifs qu'elle s'était fixés officiellement ou officieusement : l'élimination des "armes de destruction de masse" en Irak, l'établissement d'une "démocratie" pacifique dans ce pays, la stabilisation et un retour à la paix de l'ensemble de la région sous l'égide américaine, le recul du terrorisme, l'adhésion de la population américaine aux interventions militaires de son gouvernement »[13].
Malgré un engagement colossal de soldats, d’armes et de moyens financiers, ces interventions inconsidérées des « neocons » mènent à un enlisement et à l’échec final, souligné par le retrait d’Irak (2011) et d’Afghanistan (2021). Elles mettent particulièrement en lumière que la prétention des USA de jouer au « shérif mondial » n’a fait qu’intensifier le chaos guerrier et barbare : "L’attaque des Twin Towers et du Pentagone par Al Qaeda le 11 septembre 2001 et la riposte militaire unilatérale de l’administration Bush ouvre toute grande la « boîte de pandore » de la décomposition : avec l’attaque et l’invasion de l’Irak en 2003 au mépris des conventions ou des organisations internationales et sans tenir compte de l’avis de ses principaux « alliés », la première puissance mondiale passe du statut de gendarme de l'ordre mondial à celui d'agent principal du chacun pour soi et du chaos. L’occupation de l’Irak, puis la guerre civile en Syrie (2011) vont puissamment attiser le chacun pour soi impérialiste non seulement au Moyen-Orient mais sur toute la planète"[14]. Cette ouverture de la boîte de Pandore de la décomposition s’est manifestée en particulier par la multiplication des attentats terroristes dans les métropoles occidentales (Madrid, 2004, Londres, 2005) et par une multiplication tous azimuts des ambitions impérialistes de puissances telles la Chine et la Russie, bien sûr, de l’Iran, de plus en plus audacieuse et agressive, mais aussi de la Turquie, de l’Arabie Saoudite, voire des Émirats du Golfe ou du Qatar, qui déboucheront sur des conflits barbares, comme les guerres civiles en Lybie ou en Syrie dès 2011 et au Yémen à partir de 2014, le surgissement d’organisations terroristes particulièrement cruelles comme l’OEI provoquant une nouvelle vague d’attentats et la « crise des réfugiés » causée par l’afflux soudain et incontrôlé de personnes non identifiées en l’Europe en 2015.
3.2. L’aventurisme des « neocons » révèle les contradictions croissantes entre factions bourgeoisies.
Si l’impasse patente de la politique des États-Unis et la fuite en avant aberrante dans la barbarie guerrière soulignent le net affaiblissement de leur leadership mondial, elles font aussi plus que jamais apparaître au grand jour les contradictions internes et les fractures entre factions de la bourgeoisie américaine. Déjà, G. Bush junior avait obtenu la présidence à travers des « élections volées », qui illustraient le caractère instable de « l’appareil démocratique américain » : son adversaire, Al Gore, avait obtenu 500.000 voix de plus que lui, mais la décision concernant la répartition des grands électeurs ne tomba que 36 jours plus tard, plus spécifiquement en Floride, dont le frère de Bush était le gouverneur. "Une parodie populaire de l'élection a commencé à circuler sur Internet, demandant ce que les médias diraient si, dans un pays africain, il y avait une élection controversée dans laquelle le candidat gagnant était le fils d'un ancien président, qui avait été directeur des forces de sécurité de l'État (CIA), et où la victoire était déterminée par un décompte contesté des bulletins de vote dans une province gouvernée par un frère du candidat à la présidence".[15] Les péripéties marquant les élections de 2000 exprimaient déjà clairement la difficulté de la bourgeoisie à gérer son système politique face aux tendances centrifuges de plus en plus manifestes.
Ceci est d’autant plus vrai que des factions liées au fondamentalisme chrétien, ont commencé à peser sur la scène politique américaine. Déjà présentes dans le parti républicain à l'époque de Reagan, elles se sont renforcées et radicalisées dans les « États ruraux » du fait du chaos croissant et du manque d'espoir pour l'avenir. Ainsi, il y a eu l’émergence du « Tea Party », qui jouera un rôle important dans le torpillage des projets de l’administration Obama, accusant le président d’être « marxiste » et un « agent musulman ». Le Tea Party n’était pas seulement composé de fondamentalistes chrétiens, mais aussi de suprémacistes blancs, de militants anti-immigrés, de membres de milices, etc., tout un cocktail qui a infiltré le Parti républicain et menaçait de plus en plus la stabilité du système politique. Fédérées autour de l’opposition à « l’establishment à Washington », ces factions sont à la base de la propagation de l’idéologie populiste, sur laquelle va surfer Donald Trump.
Ces tensions centrifuges au sein de la bourgeoisie américaine se sont nettement manifestées à travers la fuite en avant dans l’aventure irakienne catastrophique adoptée par les « pieds nickelés » de l’administration Bush jr pour assurer le maintien de la suprématie américaine : « L'accession en 2001 à la tête de l'État américain des "neocons" a représenté une véritable catastrophe pour la bourgeoisie américaine. La question qui se pose est : comment a-t-il été possible que la première bourgeoisie du monde ait fait appel à cette bande d'aventuriers irresponsables et incompétents pour diriger la défense de ses intérêts ? Quelle est la cause de cet aveuglement de la classe dominante du principal pays capitaliste ? En fait, l'arrivée de l'équipe Cheney, Rumsfeld et compagnie aux rênes de l'État n'était pas le simple fait d'une monumentale "erreur de casting" de la part de cette classe. Si elle a aggravé considérablement la situation des États-Unis sur le plan impérialiste, c'était déjà la manifestation de l'impasse dans laquelle se trouvait ce pays confronté à une perte croissante de son leadership, et plus généralement au développement du "chacun pour soi" dans les relations internationales qui caractérise la phase de décomposition »[16].
3.3. La présidence d’Obama : une tentative vaine de restaurer le multilatéralisme
L’administration Obama a tenté de réduire les conséquences catastrophiques de l’unilatéralisme aventuriste promu par Bush junior. Tout en rappelant au monde la supériorité technologique et militaire absolue des États-Unis à travers l’exécution de Ben Laden en 2011 par une opération commando spectaculaire au Pakistan, elle a essayé de remettre le multilatéralisme à l’ordre du jour en tentant d’impliquer les « alliés » de Washington dans la mise en œuvre de la politique américaine. Cependant, elle n’est pas arrivée à contrer véritablement l’explosion des ambitions impérialistes diverses : la Chine a mis en œuvre son expansion économique et impérialiste à travers le déroulement des « nouvelles routes de la soie » à partir de 2013 ; quant à l’Allemagne, si elle a évité toute confrontation directe avec les États-Unis, vu la supériorité militaire écrasante de Washington, elle a renforcé de manière masquée ses prétentions à travers une collaboration économico-énergétique croissante avec la Russie ; la France et l’Angleterre pour leur part ont pris l’initiative d’intervenir en Lybie pour chasser Kadhafi ; la Russie et l’Iran ont renforcé leurs positions au Moyen Orient en profitant de la guerre civile en Syrie ; enfin, en Ukraine, confronté à la victoire des partis pro-occidentaux lors de la « révolution orange », Poutine a occupé militairement la Crimée et soutenu des milices pro-russes dans le Donbass en 2014. Face à l’ascension de la Chine comme le principal challenger menaçant l’hégémonie US, des débat intenses se sont engagés au sein de l’administration Obama, de l’appareil étatique et plus largement de la bourgeoisie américaine sur une réorientation de sa stratégie impérialiste.
Bref, « La politique du « passage en force », qui s’est particulièrement illustrée durant les deux mandats de George Bush fils, a conduit non seulement au chaos irakien, un chaos qui n’est pas près d’être surmonté, mais aussi à un isolement croissant de la diplomatie américaine (…). De son côté, la politique de « coopération », qui a la faveur des démocrates, ne permet pas réellement de s’assurer une « fidélité » des puissances qu’on essaie d’associer aux entreprises militaires, notamment du fait qu’elle laisse une marge de manœuvre plus importante à ces puissances pour faire valoir leurs propres intérêts »[17].
4. La politique « America First » rompt avec l’ambition d’instaurer un nouvel ordre mondial
Tandis que la politique de « gendarme du monde » engloutissait à pure perte des budgets pharamineux et entraînait un déploiement massif de militaires dans le monde (des « boots on the ground ») et des pertes conséquentes, et alors que les masses ouvrières ne sont pas prêtes à se laisser embrigader (cf. les grosses difficultés à recruter des soldats sous Bush junior pour la guerre en Irak), Donald Trump est élu président en 2017 après une campagne centrée sur le mot d’ordre « America First ». Celui-ci exprime fondamentalement une reconnaissance officielle de l’échec de la politique impérialiste américaine des 25 dernières années et un recentrage de celle-ci sur les intérêts immédiats des États-Unis : « L’officialisation par l’administration Trump de faire prévaloir sur tout autre principe celui de la défense de leurs seuls intérêts en tant qu’état national et l’imposition de rapports de force profitables aux États-Unis comme principal fondement des relations avec les autres États, entérine et tire les implications de l’échec de la politique des 25 dernières années de lutte contre le chacun pour soi en tant que gendarme du monde et de la défense de l’ordre mondial hérité de 1945.(…) »[18].
4.1. La « vandalisation » des rapports impérialistes
La politique « l’Amérique d’abord », mise en œuvre par le populiste Trump, va de pair avec une « vandalisation » des rapports entre puissances. Traditionnellement, afin de garantir un certain ordre dans les relations internationales, les États fondaient leur diplomatie sur un principe, résumé par la formule latine suivante : "pacta sunt servanda" - les traités, les accords sont supposés être respectés. Lorsqu’on signe un accord mondial -ou multilatéral- on est censé le respecter, du moins en apparence. Les États-Unis, sous Trump abolissent cette convention : "Je signe un traité, mais je peux l'abolir demain". Cela s'est produit avec le Pacte transpacifique (PPT), l'Accord de Paris sur les changements climatiques, le traité nucléaire avec l'Iran, l'accord final sur la réunion du G7 au Québec. A leur place, Trump prône des négociations entre États, favorisant le chantage économique, politique et militaire pour imposer sans détour ses intérêts (cf. la menace de représailles contre les entreprises européennes qui investissent en Iran). « Ce comportement de vandale d’un Trump qui peut dénoncer du jour au lendemain les engagements internationaux américains au mépris des règles établies représente un nouveau et puissant facteur d’incertitude et d’impulsion du chacun pour soi. Il forme un indice supplémentaire de la nouvelle étape que franchit le système capitaliste dans l’enfoncement dans la barbarie et l’abîme du militarisme à outrance »[19].
- Les décisions imprévisibles, les menaces et les coups de poker de Trump ont pour effets :de saper la fiabilité des USA comme allié : les rodomontades, les coups de bluff et les brusques changements de position de Trump non seulement ridiculisent les États-Unis, mais mènent au fait que de moins en moins de pays leur font confiance. En Europe, Trump remet l’OTAN en question, s’oppose ouvertement à l’UE et plus spécifiquement à la politique de l’Allemagne ;
- d’accentuer le déclin de la seule superpuissance : l’impasse de la politique américaine est accentuée de manière éclatante à travers les agissements de l’administration Trump. Lors du G20 en 2019, l’isolement des États-Unis était évident sur les questions du climat ou de la guerre commerciale. Par ailleurs, l’engagement russe en Syrie pour sauver Assad a fait reculer les USA et a renforcé l’agressivité militaire et la force de nuisance de Moscou dans le monde, alors même que les États-Unis n’ont pu contenir l’émergence de la Chine du statut d’outsider au début des années ’90 vers celui d’un challenger sérieux qui se présente comme le champion de la mondialisation à travers l’expansion des « nouvelles routes de la soie ».
- de déstabiliser la situation mondiale et d'augmenter les crispations impérialistes, comme on le voit au Moyen-Orient, où le refus américain de s’engager trop directement sur le terrain exacerbe l’action centrifuge des différentes puissances, petites et grandes, de l’Iran à l’Arabie Saoudite, d’Israël à la Turquie, de la Russie au Qatar, dont les appétits impérialistes divergents entrent constamment en collision : la politique de Washington est devenue plus que jamais un facteur direct d’aggravation du chaos sur un plan global.
En conséquence, « La situation actuelle se caractérise par des tensions impérialistes partout et par un chaos de moins en moins contrôlable, mais surtout par son caractère hautement irrationnel et imprévisible, lié à l’impact des pressions populistes, en particulier au fait que le pouvoir le plus fort du monde est aujourd’hui dirigé par un président populiste aux réactions capricieuses »[20].
Cependant, sous l’administration Trump, une polarisation de plus en plus nette contre la Chine se dessine dans la politique impérialiste américaine visant à contenir et à briser l’ascension du challenger chinois. En 2011 déjà, l’administration Obama avait décidé d’accorder une importance stratégique plus élevée à la confrontation avec la Chine qu’à la guerre contre le terrorisme : « Cette nouvelle approche, appelée « pivot asiatique », fut annoncée par le président américain au cours d’un discours prononcé devant le parlement australien le 17 novembre 2011 »[21]. Encore remise en question par l’émergence de l’Organisation de l’État Islamique sous Obama, la réorientation stratégique de la politique impérialiste américaine vers l’Extrême-Orient s’impose clairement sous Trump, malgré une dernière poche de résistance des tenants de la « croisade » contre les "États voyous", tels l’Iran (le Secrétaire d’Etat Pompeo et J. Bolton). La « Stratégie de Défense Nationale » (SDN), publiée en février 2018, stipule que « la guerre globale contre le terrorisme est suspendue » tandis que la « compétition entre grandes puissances » devient une orientation cardinale[22]. Ceci va impliquer un tournant important dans la politique américaine :
- La guerre commerciale avec la Chine est intensifiée en vue de ralentir son développement économique et de l’empêcher de développer les secteurs stratégiques menaçant directement l’hégémonie américaine.
- La course aux armements est relancée par les États-Unis (remise en cause des accords multilatéraux de limitation des armements FNI et START) afin de conserver leur avance technologique et d’épuiser ses rivaux (selon la stratégie éprouvée ayant entrainé l’effondrement de l’URSS). Une VIe composante de l’US Army est constituée, destinée à "dominer l’espace", afin de contrecarrer les menaces de la Chine dans le domaine satellitaire.
Quoi qu’il en soit, « La défense de leurs intérêts en tant qu’état national épouse désormais celle du chacun pour soi qui domine les rapports impérialistes : les États-Unis passent du rôle de gendarme de l’ordre mondial à celui de principal agent propagateur du chacun pour soi et du chaos et de remise en cause de l’ordre mondial établi depuis 1945 sous leur égide »[23].
4.2. Les tendances centrifuges au niveau de l’appareil politique américain s’intensifient
L’arrivée au pouvoir de Trump a fait pleinement éclater au grand jour l'énorme difficulté de la bourgeoisie de la première puissance mondiale à « gérer » son cirque électoral et à contenir les tendances centrifuges qui croissent en son sein : « La crise de la bourgeoisie américaine n'est pas le résultat de l'élection de Trump. En 2007, le rapport constatait déjà la crise de la bourgeoisie américaine en expliquant : « C'est d'abord cette situation objective -situation qui exclut toute stratégie à long terme de la part de la puissance dominante restante- qui a permis d'élire et réélire un régime aussi corrompu, avec à sa tête un président pieux et stupide [Bush junior]. (...), l'administration Bush n'est rien d'autre que le reflet de l'impasse dans laquelle se trouve l'impérialisme américain ». Cependant, la victoire d'un président populiste (Trump), connu pour prendre des décisions imprévisibles, n'a pas seulement mis en lumière la crise de la bourgeoisie américaine, mais a également mis en évidence l'instabilité croissante de l'appareil politique de la bourgeoisie américaine et l'exacerbation des tensions internes »[24]. Le vandalisme populiste de Trump ne fait donc qu’exacerber les tensions déjà existantes au sein de la bourgeoisie américaine.
Différents éléments vont mener ces tensions à un paroxysme : (a) Le besoin constant d’essayer de cadrer l’imprévisibilité des décisions présidentielles mais surtout (b) l’option de Trump de se rapprocher de Moscou, l’ancien ennemi qui n’hésite pas à s’immiscer dans la campagne électorale américaine (le « Russiagate »), une perspective totalement inacceptable par une majorité de la bourgeoisie US, et (c) son refus d’accepter le verdict électoral mettent en évidence une situation politique explosive au sein de la bourgeoisie américaine et son incapacité croissante à contrôler le jeu politique.
(a) une lutte incessante pour "cadrer" le président a marqué toute la présidence et s’est jouée à plusieurs niveaux : une pression exercée par le Parti Républicain (échec des votes sur la suppression de l’Obamacare), une opposition aux plans de Trump par ses ministres (le ministre de la Justice qui refuse de démissionner ou les ministres des affaires étrangères et de la défense qui « nuancent » les propos de Trump), une lutte constante pour la prise de contrôle du staff de la Maison Blanche par les « généraux » (les ex-généraux Mc Master et ensuite Mattis). Toutefois, ce cadrage n’empêche pas les « dérapages », comme lorsque Trump conclut un « deal » avec les Démocrates pour contourner l’opposition des Républicains à l’augmentation du plafond de la dette ;
(b) Trump et une faction de la bourgeoisie américaine envisageaient un rapprochement, voire une alliance avec la Russie de Poutine contre la Chine, une politique qui avait divers partisans au sein de l’administration présidentielle, comme le premier Secrétaire d’État Tillerson, le ministre du commerce et Ross ou même le beau-fils du président, Kushner. Cette orientation s’est toutefois heurtée à l’opposition de larges parties de la bourgeoisie américaine et à une résistance de la plupart des structures de l’État (l’armée, les services secrets), qui n’étaient nullement convaincues par une telle politique pour des raisons historiques (l'impact de la période de la « guerre froide ») et à cause de l’immixtion russe lors des élections présidentielles (le « Russiagate »). Si Trump n’a jamais voulu exclure une amélioration de la coopération avec la Russie (Trump a par exemple suggéré de réintégrer la Russie dans le Forum des pays industriels), l’approche des fractions dominantes de la bourgeoisie américaines, concrétisée aujourd’hui par l’administration Biden, a au contraire toujours considéré la Russie comme une force hostile au maintien du leadership des États-Unis.
(c) Lors des élections présidentielles de novembre 2020, les oppositions entre fractions bourgeoises prennent quasiment un tour insurrectionnel : des accusations de fraude électorale sont lancées de part et d’autre et finalement, Trump refuse de reconnaître le résultat des élections. Le 6 janvier 2021, à l’appel de Trump, ses partisans marchent sur le parlement, le prennent d’assaut et occupent le Capitole, le « symbole de l'ordre démocratique », pour faire annuler les résultats annoncés et déclarer Trump vainqueur. Les divisions internes au sein de la bourgeoisie américaine se sont aiguisées au point où, pour la première fois dans l'histoire, le président candidat à sa réélection accuse le système du pays « le plus démocratique du monde » de fraude électorale, dans le meilleur style d'une « république bananière ».
5. La politique de provocation envers le challenger chinois
Malgré le vandalisme et l’imprédictibilité du populiste Trump et la fragmentation croissante au sein de la bourgeoisie américaine sur la manière de défendre son leadership, l’administration Trump a adopté une orientation impérialiste en continuité et en cohérence avec les intérêts impérialistes fondamentaux de l’État américain, qui font globalement consensus au sein des secteurs majoritaires de la bourgeoisie américaine : défendre le rang de première puissance mondiale indiscutée des États-Unis en développant une attitude offensive envers leur challenger chinois. Cette polarisation envers la Chine, désignée comme une « menace constante »[25], devient incontestablement l’axe central de la politique étrangère de J. Biden. Ce choix stratégique des États-Unis implique une concentration des forces américaines en vue de la confrontation militaire et technologique avec la Chine. Si déjà en tant que gendarme mondial, les États-Unis exacerbaient la violence guerrière, le chaos et le chacun pour soi, la polarisation actuelle envers la Chine n’est en rien moins destructive, bien au contraire. Cette agressivité se manifeste :
- sur le plan politique à travers des campagnes démocratiques en défense des droits des Ouïghours et des « libertés » à Hong Kong, la défense de la démocratie à Taïwan, ou encore par des accusations systématiques d’espionnage et de piratage informatique envers la Chine, avec de lourdes mesures de rétorsion en représailles ;
- sur le plan économique, par des lois et décrets, tels que la « Inflation Reduction Act » et la « Chips in USA Act », qui soumettent les exportations de produits de firmes technologiques chinoises (par exemple, Huawei) vers les États-Unis à de lourdes restrictions sur le plan de tarifs douaniers protectionnistes, à des sanctions contre la concurrence déloyale, mais qui imposent surtout un blocage du transfert de technologie et de la recherche vers Pékin ;
- au niveau militaire par des démonstrations de force assez explicites et spectaculaires visant à endiguer la Chine : une multiplication d’exercices militaires impliquant la flotte US et celles d’alliés en mer de Chine du Sud, l’engagement par Biden d’un soutien militaire à Taïwan en cas d’agression chinoise, l’établissement d’un cordon sanitaire autour de la Chine par la conclusion d’accords de soutien militaire (l’AUKUS, entre les USA, l’Australie et la Grande-Bretagne), de partenariats clairement orientés contre la Chine (le Quad impliquant le Japon, l’Australie et l’Inde), mais aussi en ravivant des alliances bilatérales ou en signant de nouvelles avec la Corée du Sud, les Philippines ou le Vietnam.
D’autre part, la fragmentation considérable de l’appareil politique américain s’est encore étendue, malgré la victoire démocrate aux présidentielles et la nomination à la présidence de J. Biden. Les élections de mi-mandat en 2022, la candidature de Trump pour un nouveau mandat et les tensions entre Démocrates et Républicains au Congrès ont confirmé que les fractures sont toujours aussi profondes et exacerbées entre les partis, de même que les déchirements à l’intérieur de chacun des deux camps. Le poids du populisme et des idéologies les plus rétrogrades, marquées par le rejet d’une pensée rationnelle et cohérente, loin d’être enrayé par les campagnes visant la mise à l’écart de Trump, n’a fait que peser de plus en plus profondément et durablement sur le jeu politique américain et tend constamment à entraver la mise en œuvre de l’offensive contre la Chine.
Ces deux tendances, l’intensification d’une offensive polarisée vers la provocation du challenger chinois d’une part et l’accentuation du chaos et du chacun pour soi que cela provoque, mais aussi les tensions internes entre factions de la bourgeoisie américaine de l’autre, vont marquer les deux événements majeurs des rapports impérialistes de ces dernières années, la guerre meurtrière en Ukraine et la boucherie entre Israël et le Hamas.
5.1. La guerre en Ukraine accentue la pression sur le challenger chinois
Si la guerre en Ukraine a bien été initiée par la Russie, elle est la conséquence de la stratégie d’encerclement et d’étouffement de celle-ci mise en place par les États-Unis. A travers le déclenchement de cette guerre meurtrière, ces derniers ont réussi un coup de maître dans l’intensification de leur politique agressive contre les challengers potentiels. « A Washington, beaucoup attendaient cela depuis belle lurette : une occasion pour l’Amérique d’exhiber ses états de service de grande puissance dans un duel avec un concurrent de poids, plutôt que dans des opérations incertaines contre des fanatiques religieux pauvrement armés »[26]. En effet, cette guerre s’inscrit dans des objectifs bien plus ambitieux qu’un simple coup d’arrêt signifié aux ambitions de la Russie : « L’actuelle rivalité américano-russe ne s’explique pas par une quelconque crainte que Moscou puisse dominer l’Europe, mais plutôt par le comportement hégémonique de Washington »[27].
Certes, de manière immédiate, le piège fatal tendu à la Russie vise à infliger un affaiblissement important de sa puissance militaire subsistante et à la dégradation radicale de ses ambitions impérialistes : « Nous voulons affaiblir la Russie de telle manière qu’elle ne puisse plus faire des choses comme envahir l’Ukraine » (le ministre de la défense américain Lloyd Austin lors de sa visite à Kiev le 25.04.22)[28]. La guerre a aussi pour objectif de démontrer la supériorité absolue de la technologie militaire américaine par rapport aux armes rustiques de Moscou.
Ensuite, l’invasion russe a permis de resserrer les boulons au sein de l’OTAN sous le contrôle de Washington en contraignant les pays européens réticents à se ranger sous la bannière de l’Alliance, en particulier l’Allemagne, alors qu’ils avaient tendance à développer leur propre politique envers la Russie et à ignorer l’OTAN, qu’il y a quelques mois encore, le président français Macron avait prétendu être en « état de mort cérébrale ».
Mais surtout, l’objectif prioritaire des Américains était incontestablement d’adresser un avertissement non équivoque à leur challenger principal, la Chine (« voilà ce qui vous attend si vous vous risquez à tenter d’envahir Taiwan »). Cela constituait le point d’orgue d’une dizaine d’années de renforcement de la pression sur le challenger principal menaçant le leadership US. La guerre a affaibli le seul partenaire intéressant pour la Chine, celui qui pouvait en particulier lui fournir un apport sur le plan militaire, et a de surcroît mis en difficulté le projet d’expansion économique et impérialiste de Pékin, la nouvelle route de la soie, dont un axe important passait par l’Ukraine.
Les centaines de milliers de victimes civiles et militaires, l’extension de la barbarie guerrière en Europe centrale, les risques de dérapage nucléaire, le chaos économique mondial ne sont pour les États-Unis que des « effets collatéraux » négligeables de leur offensive pour garantir le maintien de leur leadership.
5.2. La guerre de Gaza intensifie le chacun pour soi et perturbe la polarisation américaine envers Pékin
Après l’attaque surprise et les massacres barbares perpétrés par le Hamas et la riposte sanguinaire d’Israël écrasant sous les obus et les bombes des dizaines de milliers de civils, la présence quasi permanente de dirigeants américains à Tel Aviv (le président Biden s’y est rendu en personne et le Secrétaire d’État A. Blinken ou le ministre de la Défense L. Austin y passent presque chaque semaine) souligne la fébrilité et la perplexité de la superpuissance américaine sur la meilleure manière de gérer la situation. En exerçant une pression permanente sur le gouvernement israélien tout en gardant le contact avec les gouvernements arabes, ils tentent de limiter la soif de vengeance barbare des Israéliens dans Gaza ou en Cisjordanie et d’éviter un embrasement général de la région.
Lorsque les États-Unis ont opéré, depuis l’ère Obama, leur « pivot asiatique », ils n’ont pas pour autant abandonné toute ambition d’influence au Proche et Moyen-Orient. Washington a œuvré, avec les Accords d’Abraham notamment, à établir un système d’alliance entre Israël et plusieurs pays arabes, en particulier l’Arabie Saoudite et les Émirats Arabes Unis, pour contenir les aspirations impérialistes de l’Iran, déléguant à l’État hébreu la responsabilité du maintien de l’ordre dans la région. Mais c’était sans compter avec la dynamique d’instabilité croissante des alliances et la tendance profonde au chacun pour soi. Car la bourgeoisie israélienne n’hésite plus à faire passer ses propres intérêts impérialistes devant son allégeance traditionnelle envers les États-Unis. Alors que Washington privilégiait une « solution » à deux États, Netanyahou et les factions de droite de la bourgeoisie israélienne, encouragés par Trump, ont multiplié les annexions en Cisjordanie tout en mettant les Palestiniens totalement hors-jeu. Ils jouaient clairement avec le feu dans la région, mais comptaient sur le soutien militaire et diplomatique américain en cas d’aggravation des tensions. En conséquence, les États-Unis se retrouvent aujourd’hui mis au pied du mur par Israël, contraints de soutenir la politique irresponsable de Netanyahou et de remettre en question la stratégie du « Pivot asiatique » qui visait précisément à extirper les États-Unis des conflits sans fin qui ravagent le Proche-Orient afin qu’ils puissent se centrer sur l’endiguement du challenger chinois. Or, aujourd’hui, ils se voient obligés d’envoyer des forces navales conséquentes en Méditerranée orientale, d’intervenir en Mer Rouge, de renforcer leurs contingents en Irak et en Syrie.
La réaction pour le moins volontaire de l’administration Biden montre le peu de confiance qu’elle accorde à la clique de Netanyahou et son inquiétude face à la perspective d’un embrasement catastrophique du Moyen-Orient. Le conflit israélo-palestinien constitue un nouveau point de tension pour la politique impérialiste des États-Unis, qui pourrait s’avérer calamiteux en cas d’élargissement. Washington devrait alors assumer une présence militaire considérable et un soutien à Israël qui ne pourraient que peser, non seulement sur l’économie américaine, mais également sur son soutien à l’Ukraine et, plus encore, sur sa stratégie pour endiguer l’expansion de la Chine. Par ailleurs, le discours propalestinien de la Turquie, membre « incorrigible » de l’OTAN, va également contribuer à accroître le risque d’élargissement des confrontations, tout comme les critiques virulentes des pays arabes comme l’Égypte ou l’Arabie Saoudite. Washington tente donc d’empêcher que la situation échappe à tout contrôle… ambition parfaitement illusoire, à terme, compte tenu de la dynamique funeste dans laquelle sombre le Moyen-Orient.
5.3. L’explosion des contradictions au sein de son appareil politique mine la politique impérialiste des États-Unis
Pendant ce temps, les États-Unis entrent dans une période de campagne électorale et la déstabilisation de l’appareil politique américain accentue l’imprévisibilité de ses orientations politiques sur les plans intérieur et extérieur. Les blocages récurrents au Congrès ont confirmé que les fractures sont toujours aussi profondes et exacerbées entre Démocrates et Républicains, de même que les déchirements à l’intérieur de chacun des deux camps, comme l’attestent l’élection compliquée du « speaker » Républicain à la chambre des représentant ou le débat parmi les Démocrates sur l’âge avancé de J. Biden pour une éventuelle réélection. En même temps, les campagnes visant la mise à l’écart de Trump (e. a. les différents procès intentés contre lui), n’ont fait que diviser de plus en plus profondément et durablement la société américaine et rendre « the Donald » plus populaire que jamais dans une frange non négligeable de l’électorat américain.
La nouvelle candidature présidentielle de Trump pour les élections de 2024, toujours plébiscité par plus de 30% des américains (soit près des 2/3 des électeurs républicains) et donné largement favori pour l’investiture républicaine, fait peser dès à présent une dose d’incertitude sur la politique américaine et joue un rôle dans le positionnement de Washington dans les deux conflits analysés ci-dessus : en Ukraine, le soutien militaire massif à Zelenski est dès à présent mis en question par le refus de la majorité républicaine d’entériner les budgets pour l’Ukraine et Poutine compte sur le fait qu’une réélection de Trump changera la donne sur le terrain ; en Israël, Netanyahou et les factions de droite misent sur le soutien inconditionnel de la droite religieuse républicaine pour contrer la politique de l’administration Biden en attendant, eux aussi, le retour du « messie » Trump.
Bref, cette imprédictibilité de la politique américaine n’engage pas d’autres pays à prendre pour argent comptant les promesses des États-Unis et constitue en elle-même (en plus de sa politique de polarisation) un facteur d’intensification du chaos dans le futur.
Conclusion
La guerre actuelle au Moyen-Orient n’est donc pas le résultat de la dynamique de formation de blocs impérialistes, mais du « chacun pour soi » ; Tout comme la confrontation en Ukraine, cette guerre confirme la tendance dominante de la situation impérialiste mondiale : une irrationalité croissante alimentée d’une part par la tendance de chaque puissance impérialiste à agir pour elle-même et d’autre part, par la politique sanglante de la puissance dominante, les États-Unis, visant à contrer son inévitable déclin en empêchant le surgissement de tout challenger potentiel.
Quoi qu’il en soit et quel que soit l’aboutissement de ces conflits, l’actuelle politique de confrontation de l’administration Biden, loin de produire une accalmie dans les tensions ou d’imposer une discipline entre les vautours impérialistes,
- accentue les tensions économiques et militaires avec l’impérialisme chinois ;
- exacerbe les contradictions entre impérialismes, que ce soit en Europe centrale ou au Moyen-Orient ;
- intensifie les contradictions au sein des diverses bourgeoisies, aux États-Unis, en Russie, en Ukraine ou en Israël bien sûr, mais également en Allemagne ou en Chine.
Contrairement au discours de ses dirigeants, la politique offensive et brutale des États-Unis est donc à la pointe de la barbarie guerrière et des destructions de la décomposition.
La lutte de l’impérialisme américain contre son inévitable déclin est depuis plus de 30 ans plus que jamais un facteur central d’accentuation des tensions et du chaos. Le succès initial de l’actuelle offensive américaine était fondé sur une caractéristique mise en évidence dès le début des années 1990 dans le Texte d’Orientation « Militarisme et décomposition [396]»[29], la surpuissance économique et surtout militaire des États-Unis, qui dépasse la somme des puissances potentiellement concurrentes. Aujourd’hui, les USA exploitent à fond cet avantage dans leur politique de polarisation. Celle-ci n’a cependant jamais amené plus d’ordre et de discipline dans les rapports impérialistes mais a au contraire multiplié les confrontations guerrières, a exacerbé le chacun pour soi, a semé la barbarie et le chaos dans de nombreuses régions (Moyen-Orient, Afghanistan, Europe centrale, …), a intensifié le terrorisme, a provoqué d’énormes vagues de réfugiés et a multiplié tous azimuts les appétits des petits et des grands requins.
Depuis plus de 30 ans également, les tensions politiques croissantes au sein de la bourgeoisie US sont exploitées pour mystifier la lutte du prolétariat américain, en tentant de mobiliser ce dernier dans la lutte contre les « élites au pouvoir », en essayant de le diviser entre ouvriers « autochtones et « immigrés illégaux », ou alors en voulant le mobiliser pour la défense de la démocratie contre la droite raciste et fasciste. Les luttes ouvrières de 2022 et 2023 aux États-Unis constituent, dans un tel contexte une claire expression du refus de la classe ouvrière américaine de se laisser entraîner sur le terrain bourgeois et de leur volonté de se défendre de manière unitaire en tant que classe exploitée contre toute attaque contre leurs conditions de vie et de travail.
20.12.2023 / R.H. & Marsan
[1] Les États-Unis : superpuissance dans la décadence du capitalisme et aujourd'hui épicentre de la décomposition sociale (1ère partie) [767], Revue Internationale 169, 2022.
[2] Id.
[3] Résolution sur la situation internationale [768], pt 6, 9e congrès du CCI, Revue internationale n°67, 1991.
[4] Revue internationale 64, 1991.
[5] Texte d’Orientation Militarisme et décomposition [396], Revue Internationale 64, 1991.
[6] Id.
[7] Id.
[8] Résolution sur la Situation Internationale [769], pt 4, 15ième Congrès International du CCI, Revue internationale 113, 2003.
[9] Notes sur l'histoire de la politique impérialiste des Etats-Unis depuis la seconde guerre mondiale, 2e partie [770], Revue Internationale 114, 2003.
[10] Résolution sur la situation internationale [771], 10e Congrès International du CCI, Revue Internationale 74, 1993.
[11] THESES : la décomposition, phase ultime de la décadence capitaliste [10], thèse 10, Revue Internationale 107, 2001,
[12] Résolution sur la situation internationale [772], pt 8, 13e congrès de Révolution Internationale, Revue internationale 94, 1998.
[13] Résolution sur la situation internationale [773], pt 8, 17ième Congrès International du CCI, Revue internationale 130, 2007.
[14] Rapport sur la pandémie et le développement de la décomposition [356], Revue internationale 167, 2021.
[15] Internationalism 116, winter 2000-2001.
[16] Résolution sur la situation internationale [773], pt 9, 17ième Congrès International du CCI, Revue internationale 130, 2007.
[17] Résolution sur la situation internationale, pt 7, 18ième Congrès International du CCI, Revue internationale 138, 2009.
[18] Résolution sur la situation internationale, pt 13, 23e Congrès International du CCI, Revue internationale 164, 2020.
[19] Ibid.
[20] Analyse de l’évolution récente des tensions impérialistes (juin 2018) [774], Revue Internationale 161 [775], 2018.
[21] Le repli américain aura duré six mois … », Monde diplomatique, mars 2022.
[22] Déclaration du ministre de la Défense James Mattis le 26.04.2018 devant le Comité des forces armées du Sénat des États-Unis.
[23] Résolution sur la situation internationale [62] pt 10, 23ième Congrès International du CCI, Revue internationale 164, 2020.
[24] Rapport sur l’impact de la décomposition sur la vie politique de la bourgeoisie, 23ième congrès du CCI [776], 2019, Revue internationale 164, 2020. La citation dans l’extrait est tirée du rapport (non publié) sur la vie de la bourgeoisie du 17e congrès.
[25] Lloyd Austin, Memorandum for all department of defense employees, mars 2021.
[26] Le repli américain aura duré six mois … », Monde diplomatique, mars 2022.
[27] « Pourquoi les grandes puissances se font la guerre », Monde diplomatique, août 2023.
[28] La fraction Biden voulait aussi par ailleurs « faire payer » la Russie pour leur ingérence dans les affaires internes américaines, par exemple leurs tentatives de manipuler les dernières élections présidentielles.
[29] Revue internationale 64, 1991.
Questions théoriques:
- Impérialisme [45]
Rubrique:
Une réaction prolétarienne mais opportuniste à la dégénérescence de l’IC
- 176 lectures
Le 15 octobre 1923, 46 membres du parti bolchevik faisaient parvenir une lettre secrète au Bureau politique du Comité central du parti pour dénoncer notamment l’étouffement bureaucratique de la vie interne au sein du parti. La « plate-forme des 46 » marquait ainsi l’acte de naissance de l’Opposition de gauche avec Trotsky comme figure de proue.
Les groupes trotskistes situent leurs racines dans l’Opposition de gauche qui donna naissance en 1938 à la IVe Internationale dont ils se revendiquent
Toutefois, ils n’ont généralement pas jugé utile de célébrer cet anniversaire et son restés bien discrets sur leur prétendue filiation. Pour autant, le lien qu’ils tracent (et qu’ils ont toujours tracé) entre les révolutionnaires des années 20 et eux-mêmes se résume à ériger en principes politiques immuables ce qui constituait les “erreurs” du mouvement ouvrier de l’époque et non les positions révolutionnaires que la vague révolutionnaire de 17-23 avait permis de dégager. D’ailleurs, ce sont ces mêmes positions erronées qui servirent de terreau aux positions fondamentales du “trotskisme” qui, depuis la seconde guerre mondiale, sert de caution de « gauche » à la politique de l’État bourgeois contre la classe ouvrière.
Les conséquences désastreuses du reflux de la révolution sur l’IC
L’échec sanglant du prolétariat en Allemagne d’abord, en Hongrie ensuite, au cours de l’année 1919, fut le crépuscule de la vague révolutionnaire ayant surgi en octobre 1917 en Russie. S’en suivit le reflux des luttes dans le monde et le renforcement de l’isolement de la révolution en Russie. Cette situation pesa d’un poids très lourd sur l’Internationale communiste (IC) et le parti bolchevik qui commencèrent à adopter des mesures opposées aux intérêts de la classe ouvrière : soumission des soviets au Parti, embrigadement des ouvriers dans les syndicats, signature du traité de Rapallo([1]), répression sanglante des luttes ouvrières (Kronstadt, Petrograd 1921). L’adoption de telles orientations ne firent qu’accélérer le reflux de la révolution dont elles étaient elles-mêmes l’expression, suscitant des réactions de gauche aussi bien dans l’IC que dans le parti bolchevik. Lors du IIIe congrès de l’I.C. (1921), la gauche germano - hollandaise regroupée dans le KAPD, dénonça le retour au parlementarisme, au syndicalisme, comme une remise en cause des positions adoptées au Ier congrès en mars 1919. C’est aussi à ce congrès que la “Gauche Italienne” réagit vivement contre la politique sans principe d’alliance avec les “centristes” et la dénaturation des P.C. par l’entrée en masse de fractions issues de la social-démocratie.
Une réaction prolétarienne à la dégénérescence de l’Internationale communiste
Mais c’est en Russie même qu’apparurent les premières oppositions. Dès 1918, la revue « Kommunist » groupée autour de Boukharine, Ossinsky et Radek mettait en garde le parti contre le danger d’assumer une politique de capitalisme d’État. Entre 1919 et 1921, plusieurs groupes (« Centralisme démocratique », « l’Opposition ouvrière ») exprimèrent également une réaction à la percée de la bureaucratie au sein du parti ainsi qu’à la concentration croissante du pouvoir décisionnaire entre les mains d’une minorité. Mais la réaction la plus cohérente à la dérive opportuniste du parti bolchevik fut le « Groupe ouvrier » de Miasnikov qui dénonça le fait que le parti sacrifiait peu à peu les intérêts de la révolution mondiale au profit des intérêts de l’État russe. Toutes ces tendances, résolument prolétariennes, n’ont donc pas attendu Trotsky et l’Opposition de gauche pour lutter en faveur de la défense de la révolution et de l’Internationale Communiste.
En réalité, c’est seulement après la faillite politique de l’IC en Allemagne en 1923 et en Bulgarie en 1924, que commença à se constituer au sein du parti bolchevik et plus précisément dans ses sphères dirigeantes, le courant connu sous le nom d’ « Opposition de gauche ». Le sens de sa lutte peut se résumer à son propre mot d’ordre : « feu sur le koulak, le Nepmen, le bureaucrate ». Autrement dit, il s’agissait d’attaquer à la fois la politique interclassiste de l’« enrichissez-vous à la campagne » prônée par Boukharine et, la bureaucratie rampante du parti et ses méthodes. Sur le plan international, les critiques de l’Opposition se concentrèrent sur la formation du Comité anglo-russe et la politique de l’IC dans la Révolution chinoise. Mais en fait, toutes ces questions pouvaient se résumer à un seul et même combat, celui de la défense de la révolution prolétarienne contre la théorie du « socialisme dans un seul pays ». Autrement dit, la lutte pour la défense des intérêts du prolétariat mondial contre la politique nationaliste de la bureaucratie stalinienne.
C’est donc bien en tant que réaction prolétarienne aux effets désastreux de la contre-révolution que naquit l’Opposition de gauche en Russie.
Mais son apparition tardive pesa lourdement sur ses conceptions et sur sa lutte. Elle s’avéra en fait incapable de comprendre la nature réelle du “phénomène stalinien” et “bureaucratique”, prisonnière de ses illusions sur la nature ouvrière de l’État russe. C’est ainsi que, tout en critiquant les orientations de Staline, elle fut partie prenante de la politique de mise au pas de la classe ouvrière par la militarisation du travail sous l’égide des syndicats et se fit même le chantre du capitalisme d’État par une industrialisation accélérée.
Incapable de rompre avec les ambiguïtés du parti bolchevik sur la défense de la « Patrie soviétique », elle ne fut donc pas en mesure de mener un combat résolu et cohérent contre la dégénérescence de la révolution et resta toujours en deçà des oppositions prolétariennes qui s’étaient manifestées dès 1918. À partir de 1928, de plus en plus d’oppositionnels subirent la répression stalinienne. Ils furent pourchassés et assassinés par les staliniens. Trotsky, lui, fut expulsé d’URSS.
L’Opposition de Gauche internationale reprend à son compte les erreurs de l’IC
Mais dans d’autres sections de l’Internationale communiste, des tendances oppositionnelles à la politique de plus en plus contre-révolutionnaire de cette dernière se manifestèrent. A partir de 1929, un regroupement autour et sous l’impulsion de Trotsky se constitua et prit le nom d’« Opposition de Gauche internationale » (OGI). Celle-ci constituait le prolongement de l’Opposition de Gauche en Russie en reprenant ses principales conceptions. Mais, par beaucoup d’aspects, cette opposition fut un regroupement sans principes de tous ceux qui prétendaient vouloir faire une critique de gauche du stalinisme. S’interdisant toute véritable clarification politique en son sein, laissant à Trotsky la tâche de principal porte-parole et théoricien, elle s’avéra incapable de mener un combat déterminé et cohérent pour la défense de la continuité du programme et des principes communistes. Pire, sa conception erronée de « l’État ouvrier dégénéré » la mena en définitive à prendre la défense du capitalisme d’État russe. Par exemple, en 1929, l’Opposition prit la défense de l’intervention de l’armée russe en Chine suite à l’expulsion de fonctionnaires soviétiques par le gouvernement de Tchang Kai Tchek. À cette occasion, Trotsky lança le mot d’ordre tristement fameux : « Pour la patrie socialiste toujours, pour le stalinisme, jamais ! ». En dissociant les intérêts staliniens (donc capitalistes) des intérêts nationaux de la Russie, ce mot d’ordre ne pouvait que précipiter la classe ouvrière dans la défense de la patrie, traçant la voie au soutien de l’impérialisme soviétique. Cette politique opportuniste s’incarna également dans la défense de la politique de Front uni avec la social - démocratie et les alliances de Front populaire en faveur de l’anti-fascisme, dans la défense des mots d’ordre démocratiques ou encore dans la position « des droits des peuples à disposer d’eux-mêmes ».
En définitive, chaque nouvelle tactique de Trotsky et de l’Opposition ne fut qu’un pas supplémentaires dans la capitulation et la soumission à la contre - révolution.
Le combat de la gauche italienne pour le travail de fraction au sein de l’OGI
Cette dérive catastrophique se concrétisa également sur le plan organisationnel. Contrairement, à la fraction de gauche du Parti communiste d’Italie, l’Opposition fut incapable de comprendre et d’assimiler le rôle que devait jouer les organisations restées fidèles au programme et aux principes communistes alors que la révolution était défaite et les partis communistes passés dans le camp de la contre-révolution. En se concevant comme une simple « opposition loyale » à l’IC avec pour objectif de la redresser de l’intérieur, l’OGI ne fut pas en mesure de tirer les leçons de l’échec de la vague révolutionnaire et d’aller à la racine des erreurs de l’Internationale communiste.
Jusqu’en 1933, date où la fraction sera définitivement exclue de l’OGI, la fraction de gauche du Parti Communiste d’Italie, mena le combat au sein de l’Opposition internationale, afin que cette dernière se mette sur les rails d’un travail de fraction permettant d’assumer la continuité du programme et des principes communistes en vue de l’ouverture d’une nouvelle période révolutionnaire et la formation du parti des révolutionnaires : « Dans le passé, nous avons défendu la notion fondamentale de la "fraction" contre la position dite "d’opposition". Par fraction nous entendions l’organisme qui construit les cadres devant assurer la continuité de la lutte révolutionnaire, et qui est appelée à devenir le protagoniste de la victoire prolétarienne. Contre nous, la notion dite "d’opposition" a triomphé au sein de l’Opposition Internationale de gauche. Cette dernière affirmait qu’il ne fallait pas proclamer la nécessité de la formation des cadres : la clef des évènements se trouvant entre les mains du centrisme et non entre les mains de la fraction. Cette divergence prend actuellement un aspect nouveau, mais il s’agit toujours du même contraste, bien qu’à première vue il semble que le problème consiste aujourd’hui en ceci : pour ou contre les nouveaux partis. Le camarade Trotsky néglige totalement, et pour la deuxième fois, le travail de formation des cadres, croyant pouvoir passer immédiatement à la construction de nouveaux partis et de la nouvelle internationale »([2]). L’incapacité de Trotsky et de l’opposition à s’inscrire dans un travail de fraction de gauche, l’amena donc à concevoir la formation du parti comme une simple histoire de tactique où la volonté de quelques-uns pouvait se substituer aux conditions historiques. Cette démarche relevant davantage de la magie que du matérialisme occultait évidemment « les conditions de la lutte de classes telles qu’elles se trouvent données contingentement par le développement historique et le rapport de forces des classes existantes »[3].
Sans véritable boussole politique, l’Opposition ne pouvait qu’être ballotée aux grès des évènements de l’histoire. D’où, l’appel à former la IVe Internationale (1938) alors que la classe ouvrière est mobilisée pour la défense des intérêts des différents impérialismes et que le monde est à la veille de sombrer dans une deuxième boucherie mondiale.
Ainsi, loin d’apporter une contribution crédible permettant de préparer les conditions pour le futur parti, la trajectoire de l’Opposition de gauche affaiblit considérablement le milieu révolutionnaire et fut une source de confusion et de désorientation au sein des masses ouvrières dans le cœur de la nuit de la contre-révolution. Le mouvement trotskiste quant à lui le destin de toute entreprise opportuniste. En prenant la défense de l’URSS et du camp anti - fasciste durant la IIe Guerre mondiale, il trahit l’internationalisme prolétarien et passa avec armes et bagages dans le camp de la bourgeoisie. Ses avortons, les organisations trotskistes actuelles, se placeront dès lors du côté de l’État bourgeois.[4]
A contrario, en étant en mesure de comprendre son rôle historique, la fraction italienne fut en mesure de défendre et de préserver le programme communiste et les principes organisationnels. Elle fut capable de préparer l’avenir en permettant à la Gauche communiste de France d’abord (1944 - 1952), au CCI ensuite de reprendre à leur compte cet héritage politique et assumer la continuité historique de l’organisation des révolutionnaires en vue de contribuer à la formation du futur parti, indispensable pour le triomphe de la révolution prolétarienne.
Vincent,
(16 décembre 2023).
[1] Diplomatie secrète d’État à État : droit pour les troupes allemandes de s’entraîner sur le territoire russe.
[2] Revue Bilan, n°1, (novembre 1933).
[3] "Les méthodes de la Gauche communiste et celle du trotskisme", Internationalisme n°23, (juin 1947).
[4] Il faut néanmoins noter que pendant les prémisses de la deuxième guerre mondiale, Trotsky a eu encore la force de réviser intégralement toutes ses positions politiques notamment sur la nature de l’URSS. Il disait dans une dernière brochure “L’URSS en guerre” que si le stalinisme sortait vainqueur et renforcé de la guerre, alors il faudrait revoir le jugement qu’il portait sur l’URSS. C’est ce que fit Natalia Trotsky en utilisant la logique de pensée de son compagnon et en rompant avec la IVe Internationale sur la nature de l’URSS, le 9 mai 1951[20], comme d’autres trotskistes notamment Munis. (Trotsky, le "Révolutionnaire", l'"Internationaliste [777])
Conscience et organisation:
- La Gauche Italienne [778]
Courants politiques:
- Gauche Communiste [163]
- Trotskysme [468]
Questions théoriques:
- Opportunisme & centrisme [737]
Rubrique:
ICConline - 2024
- 245 lectures
ICConline - janvier 2024
- 48 lectures
Polémique avec “Il Partito Comunista”: Une intervention opportuniste dans la lutte des ouvriers aux États-Unis
- 151 lectures
Depuis l’été 2022, l’intervention des révolutionnaires dans les luttes de la classe ouvrière est devenue une perspective de plus en plus concrète du fait que, après trois à quatre décennies de profond recul de la combativité et de la conscience dans la classe, le prolétariat a finalement à nouveau redressé la tête. La résurgence des luttes, qui a commencé par l’« été du mécontentement » en Grande-Bretagne, a été suivie de grèves, de manifestations et de diverses protestations ouvrières dans nombre d’autres pays, dont les États-Unis1.
Le Parti Communiste International, l’une des organisations de la Gauche Communiste qui publie Il Partito Comunista, a relaté son intervention dans plusieurs grèves ouvrières ces dernières années aux États-Unis, parmi lesquelles celle de quelques 600 ouvriers municipaux du traitement des eaux qui a débuté le 3 février 2023 à Portland dans l’Oregon. Cette grève a été saluée par des expressions de solidarité des autres ouvriers municipaux, certains rejoignant même les piquets. Au cours de cette grève, Il Partito a publié un article et diffusé trois tracts dans lesquels il dénonce le capitalisme en tant que système dictatorial d’exploitation, et tirait la leçon que : « ce n’est qu’en unissant ses armes au-delà des secteurs et des frontières que la classe ouvrière pourra véritablement lutter pour mettre fin à sa condition d’exploitation dans le capitalisme.2 »
Dans les conditions actuelles de renouveau international et historiquement significatif des luttes, après des décennies de désorientation et d’isolement, se lancer dans une lutte est en soi déjà une victoire. C’est pourquoi il est certainement important de signaler, comme l’a fait Il Partito, que les travailleurs municipaux de Portland ont été capables de développer leur unité et leur solidarité en réponse à l’intimidation, à la criminalisation et aux menaces de la bourgeoisie3.
Mais les révolutionnaires ne peuvent s’en tenir là. Dans l’intervention avec la presse, les tracts ou autre, ils doivent mettre en avant des perspectives concrètes, comme appeler les ouvriers à étendre la lutte au-delà de leur propre secteur, en envoyant des délégations vers d’autres lieux de travail et bureaux. Comme l’un de nos récents articles le souligne, dès aujourd’hui les ouvriers doivent « lutter tous ensemble, en réagissant de façon unitaire et en évitant de s’enfermer dans des luttes locales, au sein de son entreprise ou de son secteur4».
Mais pour cela, pour renforcer la lutte, la question centrale que les révolutionnaires doivent clairement poser aux ouvriers est : qui est aux côtés de la lutte et qui est contre elle ? Et à ce propos, le PCI ne diffuse qu’un brouillard mystificateur.
L’opportunisme sur la question syndicale…
Pour la Gauche communiste, le syndicalisme en tant que tel, c’est-à-dire non seulement les directions syndicales mais aussi les structures de base des syndicats, est devenu une arme de la bourgeoisie contre la classe ouvrière. Le syndicalisme, par définition une idéologie qui contraint la lutte dans les limites des lois économiques du capitalisme, est devenu anachronique dans le siècle des guerres et des révolutions, comme les révolutionnaires de la Première Guerre mondiale et la vague révolutionnaire qui a débuté en 1917 l’ont clairement montré. Les nouvelles conditions de l’ère actuelle nécessitent que les luttes aillent au-delà des particularismes du lieu de travail, de la région et de la nation, et prennent un caractère massif et politique. Parce que les syndicats n’ont plus aucune utilité pour la lutte ouvrière, la bourgeoisie a pu s’en emparer et les utiliser contre la tendance des luttes à l’auto-organisation et à l’extension. Dans une telle période, défendre les méthodes de lutte des syndicats comme un authentique moyen de développer la combativité dans la classe ouvrière n’est rien d’autre qu’une concession à l’idéologie bourgeoise, une forme d’opportunisme.
Confronté au problème des formes d’organisation que requiert la défense des conditions de vie de la classe ouvrière, qu’il les appelle syndicats de classe, réseaux ou coordinations, Il Partito défend une position opportuniste qu’il justifie comme suit : « depuis la fin du XIXe siècle, la soumission progressive des syndicats à l’idéologie bourgeoise, à la nation et aux États capitalistes5 » est une véritable tendance. Mais il n’explique pas comment il est possible que tous les syndicats ont été intégrés dans l’État capitaliste depuis les premières décennies du XXe siècle. Pour Il Partito, tout cela semble être une pure coïncidence, du fait qu’il n’explique pas que les conditions objectives ont fondamentalement changé depuis lors. Par contraste, il clame que les attaques économiques contre les ouvriers « mèneront à un renouveau des vieux syndicats libérés de l’idéologie bourgeoise » et « dirigés par le Parti communiste ». Ces syndicats seront même « un instrument puissant et indispensable pour le dépassement révolutionnaire du pouvoir bourgeois »6.
En d’autres termes : après la trahison des vieux syndicats, de nouveaux syndicats de classe vont émerger et, dans la bonne tradition bordiguiste, il est clair que, s’ils sont dirigés par un véritable Parti révolutionnaire, ils rempliront un rôle révolutionnaire. Mais ici il est nécessaire de sortir Il Partito de son rêve, vu que les conditions de la lutte révolutionnaire ont radicalement changé depuis le début du XXe siècle. Cela veut dire que la lutte ne peut plus du tout « être préparée à l’avance au niveau organisationnel, du fait que la lutte prolétarienne tend à aller au-delà de la lutte strictement économique pour devenir une lutte sociale, directement confrontée à l’État, qui se politise et demande la participation des masses de la classe. […] Le succès d’une grève ne dépend plus de fonds financiers collectés par les ouvriers, mais fondamentalement de leur capacité à étendre leur lutte.7 »
Et à cause de ces nouvelles conditions, les syndicats ne correspondent plus aux besoins de la lutte prolétarienne, et même le fait d’être dirigés par un Parti authentiquement révolutionnaire n’y changerait rien. La tentative de Il Partito de défendre l’existence d’organes permanents de lutte, au cours d’expressions ouvertes de lutte comme lors de périodes de leur absence, est de toute façon vouée à la faillite. Un renouveau des syndicats en tant qu’authentiques organisations de la classe ouvrière n’existe que dans l’imagination d’Il Partito, pour lequel le rôle du Parti dans la lutte non seulement est décisif, mais semble même être capable d’invoquer le pouvoir surnaturel d’adapter les syndicats aux besoins réels de la lutte ouvrière.
…mène les ouvriers sur la mauvaise voie
Le premier tract diffusé au cours d’une manifestation le dimanche 28 janvier était intitulé « Ouvriers municipaux de Portland : combattez pour la liberté de faire grève », une « liberté » attaquée par la proclamation de l’état d’urgence par la municipalité.
Avec la revendication de la « liberté de faire grève », ce tract a immédiatement mis les ouvriers sur la mauvaise voie. Au XIXe siècle, lorsque les syndicats étaient encore des organisations utiles de la classe ouvrière, dont le rôle était d’améliorer les conditions de vie et de travail au sein du capitalisme, une telle revendication était indubitablement correcte. Mais aujourd’hui, alors que les syndicats sont devenus une partie de l’État capitaliste, les ouvriers n’ont rien à gagner à soutenir le droit de faire grève. Une telle revendication en réalité n’est plus qu’un combat pour que les syndicats aient le contrôle des luttes ouvrières. La classe ouvrière n’a aucunement besoin de se battre pour la légalisation de ses propres grèves, parce que dans les conditions du capitalisme d’État totalitaire toute grève capable de créer un véritable rapport de force avec la bourgeoisie est par définition illégale. Le but de cette campagne pour le droit de grève est principalement de garantir que la lutte reste confinée aux étroites limites légales imposées par la politique bourgeoise et le contrôle syndical. Si la bourgeoisie garantit le droit de grève, le but en est d’abord de réduire les luttes ouvrières à d’inoffensives protestations, dans le but de faire pression sur l’un des « partenaires de négociations ».
Après la grève des travailleurs municipaux de Portland, les camarades de Il Partito ont, au printemps de cette année, « mis en place, en compagnie d’autres militants syndicaux, une coordination qu’ils ont appelée Class Struggle Action Network (CSAN), dont le but est l’unité des luttes ouvrières.8 » Ce CSAN est intervenu par exemple dans la grève des infirmières de juin dernier. Mais quelle est réellement la nature de ce CSAN ? Quelle pourrait être la perspective d’un tel réseau, « dont le but est d’unifier les luttes ouvrières »?
Ce CSAN n’est pas apparu en réaction à un besoin particulier des ouvriers de prendre la lutte dans leurs propres mains, pour envoyer des délégations massives aux autres travailleurs, pour organiser des assemblées générales ouvertes à tous les ouvriers ou pour tirer les leçons afin de préparer de nouvelles luttes. Rien de tout cela ; le Réseau a été créé complètement en-dehors de la dynamique concrète de la lutte par les camarades d’Il Partito, « inspirés par les mêmes principes et méthodes qui ont permis la création du Coodinamento Lavoratorie Lavoratrici Autoconvocati en Italie9 » au cours des années 80. Et sur le site web de ce Réseau10, on peut lire, et ce n’est pas un accident, un article d’Il Partito qui exprime clairement que le but est de travailler « à la renaissance des syndicats de classe ».
Comme nous l’avons souligné plus haut, les syndicats sont aujourd’hui des instruments de l’État bourgeois et toute renaissance sous la forme d’une organisation réellement prolétarienne est impossible. Ainsi, la politique d’Il Partito ne peut qu’enfermer les ouvriers combatifs dans une lutte vaine et décourageante. Dans ce contexte, le CSAN connaîtra le même destin que tout organe créé artificiellement : soit rester un appendice d’Il Partito11, soit devenir une expression radicale du syndicalisme bourgeois. Mais plus sûrement il disparaîtra après les tentatives d’Il Partito de le maintenir artificiellement en vie. Ainsi il pourra enterrer cet enfant mort-né en silence, sans qu’il soit nécessaire de tirer d’autres leçons de cette expérience.
Dans la grève des travailleurs municipaux, « des camarades ont participé aux piquets et aidé les ouvriers à les renforcer12 ». L’article sur l’intervention dans la lutte des infirmières ne parle que de l’intervention des « participants aux piquets de solidarité » du CSAN. Cela donne l’impression qu’il n’y a eu en fait aucune intervention d’Il Partito distincte et séparée du Réseau. Ainsi les camarades d’Il Partito ont participé sur une base individuelle aux piquets de grève en février aussi bien qu’en juin. Mais pourquoi ? Parce que les ouvriers ne peuvent prendre eux-mêmes cette tâche en main ? Ou les camarades qui y ont participé l’ont-ils fait en tant que délégués d’autres lieux de travail ? Les réponses à ces questions ne se trouvent pas dans les articles d’Il Partito. Fondamentalement, derrière l’intervention d’Il Partito, nous devons souligner une grosse ambiguïté sur le rôle de l’avant-garde révolutionnaire de la classe.
La responsabilité des révolutionnaires
En premier lieu, la tâche de l’organisation politique de classe n’est pas d’aider la classe à renforcer un piquet de grève, de collecter de l’argent pour soutenir financièrement une grève, ni d’assumer d’autres tâches pratiques pour les ouvriers grévistes. Les ouvriers sont tout-à-fait capables de faire tout cela eux-mêmes, sans qu’on le fasse à leur place. Une organisation communiste a autre chose à faire, et ce n’est ni technique, ni matériel, mais essentiellement politique. La lutte de la classe ouvrière doit être renforcée par l’intervention politique organisée de l’organisation révolutionnaire.
En lien avec cette orientation d’être un facteur politique actif du développement de la conscience et de l’action autonome de la classe ouvrière, les organisations communistes doivent mettre en avant une analyse des conditions de la lutte de classe, lucide et dotée d’une méthode claire, afin d’être capables de dénoncer et combattre ces ennemis de la classe ouvrière que sont les syndicats. Il Partito, qui justifie de façon irresponsable la possibilité de réhabiliter le syndicalisme ou le combat à travers les syndicats, malgré des décennies de sabotage et d’enfermement des luttes par ces organes, ne peut dans ce cadre qu’affaiblir le combat de classe des ouvriers. Non seulement cette forme d’opportunisme sème la confusion, mais elle ne peut que mener les ouvriers dans une impasse.
Dennis, 15 novembre 2023
1 Lire notre tract : Grèves et manifestations aux Etats-Unis, en Espagne, en Grèce, en France… Comment développer et unir nos luttes ?, https://fr.internationalism.org/content/11186/greves-et-manifestations-a... [779]
3 Ibid.
6 Ibid
7 La lutte du prolétariat dans le capitalisme décadent, Revue Internationale n°23, https://fr.internationalism.org/rinte23/proletariat.htm [115]
9 Ibid.
11 Le premier bulletin « syndicaliste de classe » du CSAN en octobre a déjà annoncé « la réunion mensuelle collectivement organisée du CSAN [qui] fonctionnera elle-même sur le modèle du centralisme démocratique ».
Courants politiques:
- Bordiguisme [785]
Rubrique:
Rejoignez le compte Twitter/X du CCI
- 135 lectures
Retrouvez le CCI sur Twitter/X [786].
Depuis de nombreuses années, nous intervenons sur les forums politiques pour partager nos articles, annoncer la parution de notre presse, les réunions publiques et les permanences du CCI. Le travail indispensable de diffusion des positions révolutionnaires, nous le poursuivons désormais sur les réseaux sociaux.
C’est pourquoi nous faisons appel à tous nos lecteurs et tous nos sympathisants qui désirent collaborer à la diffusion de la presse du CCI : rejoignez @CCI_Officiel sur Twitter/X [786], abonnez-vous et diffusez le plus largement possible les publications du CCI.
Vie du CCI:
- Interventions [492]
Rubrique:
Un siècle après sa mort… Lénine demeure un exemple pour tous les militants communistes
- 213 lectures
La bourgeoisie a toujours pris le plus grand soin à dénaturer l’histoire du mouvement ouvrier et dépeindre ceux qui s’y sont illustrés sous des traits soit inoffensifs, soit repoussants. La bourgeoisie le sait autant que nous, et c’est pourquoi elle s’efforce encore par tous les moyens possibles de dénaturer ou masquer la transmission des combats des grands révolutionnaires du passé et des apports au mouvement ouvrier pour les effacer de la mémoire historique du prolétariat alors que l’une de ses armes fondamentales dans la continuité de son affrontement au capitalisme réside dans sa conscience de classe, qui se nourrit inévitablement de la théorie révolutionnaire, la théorie marxiste, comme des leçons et des expériences de ses combats. Aujourd’hui, un siècle après la mort de Lénine, on doit s’attendre de nouveau à des attaques idéologiques contre le grand révolutionnaire qu’il a été, contre tous ses apports aux combats du prolétariat : théoriques, organisationnels, stratégiques…
La falsification de Lénine par la bourgeoisie
Si Marx est présenté comme un philosophe audacieux et quelque peu subversif, dont les apports prétendument surannés auraient cependant permis au capitalisme d’éviter ses pires travers, il ne peut en être de même pour Lénine. Lénine a participé et joué un grand rôle dans la plus grande expérience révolutionnaire du prolétariat, il a participé à un événement qui a fait trembler les bases du capitalisme. Cette expérience fondamentale et d’une très grande richesse en termes de leçons pour les combats futurs du prolétariat, Lénine en a laissé de grandes traces à travers ses nombreux écrits. Mais bien avant la révolution d’Octobre, Lénine avait contribué de façon déterminante à dessiner les contours de l’organisation du prolétariat tant sur le plan politique que stratégique. Il a mis en œuvre une méthode dans le débat, la réflexion et la construction théorique qui sont des armes essentielles pour les révolutionnaires aujourd’hui.
Tout ça, la bourgeoisie le sait aussi. Lénine n’était pas un « homme d’État » comme la bourgeoisie en produit tout le temps, mais bien un militant révolutionnaire engagé au sein de sa classe. C’est cela que la bourgeoisie cherche à cacher le plus, en présentant Lénine comme un homme autoritaire, décidant seul, écartant ses contradicteurs, appréciant la répression et la terreur au seul profit de ses intérêts personnels. De cette façon, la classe dominante peut tracer une ligne directe continue, un trait d’égalité entre Lénine et Staline qui aurait parachevé l’œuvre du premier en instaurant un système de terreur en URSS qui serait l’exact aboutissement des desseins personnels de Lénine.
Pour parvenir à cette conclusion, outre un flot permanent de mensonges éhontés, la bourgeoisie s’attarde sur les erreurs de Lénine en les isolant de tout le reste, et surtout du processus de débat et de clarification au sein duquel ces erreurs se posaient et pouvaient y être naturellement dépassées. Elle les isole aussi du contexte international de défaite du mouvement révolutionnaire mondial qui n’a pas permis à la révolution russe de continuer son œuvre et l’a fait reculer vers un capitalisme d’État singulier et placé sous la poigne de Staline.
Les gauchistes, trotskystes en tête, ne sont pas les derniers pour capitaliser leurs mystifications idéologiques sur les erreurs de Lénine, en particulier lorsqu’il s’est lourdement trompé et illusionné sur les luttes de libération nationale et sur les potentialités du prolétariat des pays de la périphérie du capitalisme (théorie du maillon faible). Les gauchistes ont instrumentalisé et instrumentalisent encore aujourd’hui ces erreurs pour déchaîner leur propagande bourgeoise belliciste pour pousser les prolétaires à devenir de la chair à canon dans les conflits impérialistes à travers leurs mots d’ordre nationalistes et de soutien d’un camp impérialiste contre un autre, totalement à l’opposé de la perspective révolutionnaire et internationaliste que défendait avec détermination Lénine. Même chose pour la fausse conception de Lénine sur les trusts et les grandes banques, selon laquelle la concentration du capital faciliterait la transition vers le communisme. Les gauchistes s’en sont emparés pour revendiquer les nationalisations des banques et grandes industries et promouvoir ainsi le capitalisme d’État comme un tremplin vers le communisme, quand ce n’était pas pour justifier leur argumentation mensongère que l’économie « soviétique » et la brutalité de l’exploitation en URSS n’étaient pas pour autant du capitalisme.
Mais Lénine ne peut absolument pas se résumer en le réduisant aux erreurs qu’il a commises. Il ne s’agit pas pour autant de les ignorer. D’abord parce que celles-ci apportent d’importantes leçons au mouvement ouvrier grâce à un examen critique. Mais aussi parce qu’il ne peut être question, face au portrait repoussant qu’en fait la bourgeoisie, d’ériger Lénine en leader parfait et omniscient.
Lénine était, en effet, un combattant de la classe ouvrière dont la ténacité, la perspicacité organisationnelle, la conviction et la méthode forcent le respect. Son influence sur le cours révolutionnaire au début du siècle dernier est indiscutable. Mais tout ceci se place dans un contexte, un mouvement, un combat, un débat international sans lesquels Lénine n’aurait rien pu faire, rien apporter au mouvement révolutionnaire de la classe ouvrière, tout comme Marx n’aurait pas pu agir et réaliser son œuvre immense au service du prolétariat ni apporter son engagement et son énergie militante à la construction d’une organisation prolétarienne internationale sans un contexte historique d’émergence politique de la classe ouvrière.
C’est seulement dans de telles conditions que les individualités révolutionnaires s’expriment et donnent le meilleur d’elles-mêmes. C’est dans des conditions historiques particulières que pendant toute sa courte vie, Lénine a construit et légué un apport fondamental pour l’ensemble du prolétariat, sur le plan organisationnel, politique, théorique et stratégique.
Le militant, le combattant
Loin d’être un intellectuel académique, Lénine était avant tout un militant révolutionnaire. L’exemple de la conférence de Zimmerwald (1) est frappant à ce niveau. Alors que Lénine a toujours été un défenseur acharné de l’internationalisme prolétarien, se positionnant à la pointe du combat contre la faillite de la deuxième Internationale qui entraînera le prolétariat dans la guerre en 1914, il se retrouvera à la pointe du combat pour faire vivre la flamme internationaliste alors que les canons se déchaînaient en Europe.
Mais la conférence de Zimmerwald ne regroupait pas que des internationalistes convaincus, on y trouvait aussi beaucoup de défenseurs d’illusions pacifistes qui affaiblissaient le projet de Lénine de combattre la folie nationaliste qui maintenaient le prolétariat sous une chape de plomb. Pourtant Lénine, au sein de la délégation bolchevique, saura comprendre que le seul moyen de lancer un appel d’espoir au prolétariat, à ce moment-là, nécessitait des compromis importants avec les autres tendances de la conférence.
Mais il continuera le combat, même après la Conférence, pour clarifier les questions en jeu en portant une critique résolue au pacifisme et aux illusions dangereuses qu’il véhiculait. Cette constance, cet acharnement à défendre ses positions tout en les renforçant par l’approfondissement théorique et la confrontation des arguments est au cœur d’une méthode qui doit inspirer tout militant révolutionnaire aujourd’hui.
Le défenseur de l’esprit de parti
Sur le plan organisationnel, Lénine a apporté une immense contribution militante lors des débats qui ont agité le deuxième congrès du Parti russe en 1903. (2) Il avait déjà esquissé les contours de sa position en 1902 dans Que faire ?, une brochure publiée comme contribution au débat au sein du parti dans lequel il s’opposait aux visions économistes qui se développaient, et promouvait au contraire une vision d’un parti révolutionnaire, c’est-à-dire une arme pour le prolétariat dans son assaut contre le capitalisme.
Mais c’est au cours de ce même deuxième congrès qu’il a su mener un combat déterminant et déterminé pour faire accepter sa vision du parti révolutionnaire au sein du POSDR : un parti de militants, animés par un esprit de combat, conscients de leur engagement et de leurs responsabilités dans la classe face à une conception laxiste de l’organisation révolutionnaire vue comme une somme, un agrégat de « sympathisants » et de contributeurs occasionnels, comme le défendaient les mencheviks. Ce combat sera donc aussi un moment de clarification de ce qu’est un militant dans un parti révolutionnaire : non pas le membre d’un groupe d’amis privilégiant la loyauté personnelle mais le membre d’une organisation dont les intérêts communs, expression d’une classe unie et solidaire, priment sur tout le reste. C’est ce combat qui a permis au mouvement ouvrier d’engager le dépassement de « l’esprit de cercle » vers « l’esprit de parti ».
Ces principes ont permis au parti bolchevik de jouer un rôle moteur dans le développement des luttes en Russie jusqu’à l’insurrection d’Octobre en s’organisant comme parti d’avant-garde, défendant les intérêts de la classe ouvrière et combattant toute intrusion d’idéologies étrangères en son sein. Ces principes, nous continuons à les défendre et à nous en revendiquer comme seul moyen de construire le parti de demain.
Dans son ouvrage Un pas en avant, deux pas en arrière, Lénine revient sur ce combat du deuxième congrès et démontre à chaque page la méthode qu’il a employée pour parvenir à clarifier ces questions : patience, ténacité, argumentation, conviction. Et non pas, comme la bourgeoisie voudrait nous le faire croire : autoritarisme, menace, exclusion. La quantité impressionnante d’écrits qu’a laissés Lénine suffit déjà à comprendre à quel point il défendait et faisait vivre le principe d’une argumentation patiente et déterminée comme seul moyen de faire avancer les idées révolutionnaires : convaincre plutôt qu’imposer.
Le défenseur de la perspective révolutionnaire
Quatorze ans après le congrès de 1903, en avril 1917, Lénine revint d’exil et appliqua la même méthode pour amener son parti à clarifier les enjeux de la période. Les fameuses Thèses d’Avril (3) listeront en quelques lignes des arguments forts, clairs et convaincants pour éviter au parti bolchevik de s’enfermer dans la défense du gouvernement provisoire de nature bourgeoise et engager le combat pour une deuxième phase révolutionnaire.
Il ne s’agit pas d’un texte écrit par Lénine au nom du parti qui l’aurait d’emblée accepté tel quel, mais une contribution à un débat qui se déroulait dans le parti et par lequel Lénine cherche à convaincre la majorité. Dans ce texte, Lénine définit une stratégie basée sur le caractère minoritaire du parti au sein des masses, qui nécessite une discussion et une propagande patiente : « expliquer patiemment, systématiquement, opiniâtrement ». Voilà ce que fut Lénine en réalité, que la bourgeoisie continue à dépeindre comme « autocrate et sanguinaire »…
Lénine ne cherchait jamais à imposer et toujours à convaincre. Pour cela, il devait développer des arguments solides et pour cela, il devait développer sa maîtrise de la théorie : pas pour sa culture personnelle mais pour mieux la transmettre à l’ensemble du parti et de la classe ouvrière comme une arme pour ses combats futurs. Une démarche qu’il résume lui-même : « il n’y a pas de mouvement révolutionnaire sans théorie révolutionnaire » et qu’un ouvrage particulièrement important permet de comprendre de façon concrète : L’État et la révolution. (4) Alors que dans les Thèses d’Avril Lénine met en garde contre l’État issu de l’insurrection de février et met en avant la nécessité de construire une dynamique révolutionnaire résolument contre cet État, en septembre, il sent que le sujet devient de plus en plus crucial et s’engage dans la rédaction de ce texte pour développer une argumentation basée sur les acquis du marxisme sur la question de l’État. Ouvrage qu’il ne finira jamais puisque ce travail sera interrompu par l’insurrection d’Octobre.
Là encore, s’illustre la méthode de Lénine. La bourgeoisie aime mettre en avant des hommes présentés comme des leaders naturels dont l’autorité ne relève que de leur « génie », leur « flair ». Lénine au contraire doit sa capacité à convaincre à un profond engagement pour la cause qu’il défend. Plutôt que chercher à imposer son point de vue en profitant de son autorité au sein du parti ou en manigançant en coulisses, il se plonge dans les travaux du mouvement ouvrier sur la question de l’État pour approfondir le sujet et mieux argumenter en faveur de la rupture avec l’idée sociale-démocrate de simplement s’emparer de l’appareil d’État existant pour faire ressortir la nécessité impérieuse de le détruire.
Un révolutionnaire ne peut « découvrir » la bonne stratégie par son seul génie, mais par une compréhension profonde des enjeux de la situation et du rapport de forces entre les classes. Cela s’illustre de façon exemplaire en juillet 1917. (5) Alors qu’en avril, le parti bolchevik lançait le mot d’ordre « tout le pouvoir aux soviets » pour orienter la classe ouvrière contre l’État bourgeois issu de la révolution de février, en juillet à Petrograd, le prolétariat commençait à s’opposer de façon massive au pouvoir démocratique. La bourgeoisie fit alors ce qu’elle sait faire le mieux : elle tendit un piège au prolétariat en cherchant à provoquer une insurrection prématurée qui lui aurait permis de déchaîner une répression sans limites, en particulier contre les bolcheviks.
La réussite d’une telle entreprise aurait sans doute compromis de façon déterminante la dynamique révolutionnaire en Russie et la révolution d’Octobre n’aurait sans doute pas eu lieu. À ce moment-là, le rôle du parti bolchevik a été fondamental pour expliquer à la classe ouvrière que le moment n’était pas venu de mener l’assaut, et qu’ailleurs qu’à Petrograd, le prolétariat n’était pas prêt et serait décimé.
Pour parvenir à la clarté sur les mots d’ordre à mettre en avant à tel ou tel moment déterminé, il fallait être capable de comprendre de façon profonde où en était le rapport de force entre les deux classes déterminantes de la société mais il fallait aussi avoir la confiance du prolétariat au moment où celui-ci, à Petrograd, ne jurait que par le renversement du gouvernement. Cette confiance n’était pas acquise par la force, la menace ou un quelconque artifice « démocratique », mais par la capacité à orienter la classe de façon claire, profonde, argumentée. Le rôle de Lénine dans ces événements a sans doute été crucial, mais ce sont ses années de combat incessant et patient, depuis la fondation du parti moderne du prolétariat en 1903 jusqu’à ces journées de juillet en passant par Zimmerwald, par les Thèses d’Avril 1917, qui ont permis au parti bolchevik d’assumer le rôle qui devait être le sien dans chaque période et ainsi être reconnu par l’ensemble du prolétariat comme le véritable phare de la révolution communiste.
La bourgeoisie pourra toujours dépeindre Lénine comme un stratège avide de pouvoir, un homme orgueilleux ne souffrant ni la contestation, ni la reconnaissance de ses erreurs, elle pourra toujours réécrire l’histoire du prolétariat russe et de sa révolution sous cet éclairage, la vie et l’œuvre de Lénine sont un démenti constant de ces manœuvres idéologiques grossières. Pour tous les révolutionnaires d’aujourd’hui et de demain, la profondeur de son engagement, la rigueur dans son application de la théorie et de la méthode marxistes, la confiance inaltérable qu’il en tire dans la capacité de sa classe à conduire l’humanité vers le communisme font de Lénine, un siècle après sa mort, un exemple d’une infinie richesse de ce que doit être un militant communiste.
GD, janvier 2024
1 Cf. « Zimmerwald (1915-1917) : de la guerre à la révolution [787] », Revue Internationale n° 44 (1986).
2 Le but de cet article n’est pas de revenir sur les détails de ce combat, nous renvoyons nos lecteurs à l’article que nous avons écrit à ce sujet : « Histoire du mouvement ouvrier. 1903-1904 : La naissance du bolchevisme » Partie [788] 1, Partie [789] 2 et Partie [790] 3, Revue internationale 116, 117 et 118.
3 Cf. dans notre brochure sur Octobre 1917 : « Les “Thèses d’avril”, phare de la révolution prolétarienne [791] ».
4 Cf. « “L’État et la Révolution », une vérification éclatante du marxisme [792] », Revue Internationale n° 91 (1997).
5 Cf. dans notre brochure sur Octobre 1917 : « Les journées de Juillet, le parti déjoue une provocation de la bourgeoisie [793] ».
Histoire du mouvement ouvrier:
Conscience et organisation:
Personnages:
- Lénine [796]
Rubrique:
Permanence en ligne le samedi 17 février 2024
- 95 lectures
Le Courant Communiste International organise une permanence en ligne le samedi 17 février 2024 à 15h.
Ces permanences sont des lieux de débat ouverts à tous ceux qui souhaitent rencontrer et discuter avec le CCI. Nous invitons vivement tous nos lecteurs et tous nos sympathisants à venir débattre afin de poursuivre la réflexion sur les enjeux de la situation et confronter les points de vue. N'hésitez pas à nous faire part des questions que vous souhaiteriez aborder.
Les lecteurs qui souhaitent participer aux permanences en ligne peuvent adresser un message sur notre adresse électronique ([email protected] [213]) ou dans la rubrique « nous contacter [214] » de notre site internet, en signalant quelles questions ils voudraient aborder afin de nous permettre d’organiser au mieux les débat.
Les modalités techniques pour se connecter à la permanence seront communiquées ultérieurement.
Vie du CCI:
- Permanences [291]
Rubrique:
Semaine d'action de Prague: Réponse au bilan de la CWO
- 136 lectures
Comme nous l'avons écrit dans notre deuxième article sur la "Semaine d'action de Prague"[1], différents groupes ont tenté de dresser un bilan de ce qui s'est passé lors de l'événement de Prague, une tentative de rassembler les opposants à la guerre impérialiste de nombreux pays différents. Dans cet article, nous examinerons la contribution de la Communist Workers Organisation [2] (dans un article ultérieur, nous traiterons des perspectives après la Semaine d'action de Prague).
L'article de la CWO présente son point de vue selon lequel la crise pousse le capitalisme vers une nouvelle guerre mondiale visant à dévaloriser le capital. Nous ne développerons pas ici nos désaccords avec cette approche de la situation mondiale actuelle et de la dynamique actuelle des guerres impérialistes. Mais nous voulons réagir à la manière dont la CWO traite une expérience historique clé du mouvement ouvrier - la conférence de Zimmerwald de 1915, qui a été la première tentative majeure des internationalistes de tous les camps belligérants de se réunir et de lancer un appel contre la guerre impérialiste. La CWO semble minimiser l'importance de cet événement en insistant sur le fait qu'il s'inscrit dans le cadre de l'échec général de la gauche révolutionnaire de la Deuxième Internationale à rompre à temps avec la social-démocratie : "même l'exemple de la gauche de Zimmerwald qui s'est réunie bien après le début de la guerre", disent-ils, n'est pas un exemple à imiter. Oui, il est vrai que la gauche internationale a attendu trop longtemps pour commencer un travail de fraction organisé contre l'opportunisme croissant de la Deuxième Internationale dans la période précédant la guerre, et ce retard a rendu difficile une réponse internationale face au déclenchement de la guerre et à la trahison de toute l'aile opportuniste de la social-démocratie après 1914. Mais cela ne signifie pas que nous ne pouvons pas tirer de leçons de l'expérience de la gauche de Zimmerwald. Au contraire, l'attitude des bolcheviks et d'autres à Zimmerwald - à la fois en reconnaissant l'importance de participer à la Conférence et en s'opposant avec intransigeance aux erreurs centristes et pacifistes de la majorité de ses participants - nous fournit un exemple clair quant à la façon de répondre à des événements tels que la Semaine d'Action de Prague. En d'autres termes, la nécessité d'être présent à un tel événement, d'une part, et, d'autre part, d'intervenir avec une critique claire de toutes ses confusions et insuffisances. Ceci est particulièrement vrai si l'on considère que certaines des forces politiques clés de la Semaine d'action, en particulier le groupe Tridni Valka, rejettent tout simplement toute l'expérience de Zimmerwald comme n'étant rien d'autre qu'un carnaval pacifiste[3]. En même temps, la leçon que la CWO tire de Zimmerwald - la nécessité de se regrouper le plus tôt et le plus largement possible, avant que la guerre ne soit déclarée - les conduit à une approche totalement dépourvue d'esprit critique à l'égard des éléments avec lesquels ils tentent de se regrouper. Nous y reviendrons.
Une explication partielle du chaos à Prague
Comme la plupart des autres comptes rendus, l'article de la CWO commence par souligner que "du point de vue de l'organisation, ce fut un désastre (c'est nous qui soulignons). Les participants peuvent ne pas être d'accord sur les responsabilités, mais le fait est que certains événements n'ont pas eu lieu du tout, que d'autres ont été peu fréquentés, que des personnes s'étaient vu promettre un logement et qu'elles n'en ont pas eu, et que finalement, le vendredi, le lieu du congrès a été annulé. En l'absence de toute communication de la part des organisateurs, une cinquantaine de participants se sont réunis et ont organisé leur propre congrès. Les discussions se sont poursuivies pendant de nombreuses heures et, bien que les organisateurs initiaux aient fini par trouver un autre lieu, le congrès auto-organisé avait déjà prévu de se tenir le lendemain. Le samedi, deux événements distincts ont donc eu lieu : le congrès officiel et le congrès auto-organisé (bien que certains participants aient visité les deux au cours de la journée).[4]
Nous ne pouvons qu'être d'accord sur le fait qu'il s'agissait d'un désastre au niveau de l'organisation, mais le compte-rendu de la CWO ne va pas plus loin dans l'analyse des raisons de ce désastre. Il ne s'agit pas ici de blâmer, mais de rechercher les raisons politiques de l'échec. Comme nous avons tenté de le montrer dans notre premier article sur Prague[5] , une telle enquête ne peut éviter une critique de l'approche activiste et anti-organisationnelle de la majorité des participants - un problème enraciné dans les conceptions anarchistes et exacerbé par les divers efforts visant à exclure la Gauche communiste des débats.
La question de l'organisation est une question politique à part entière, mais le compte rendu de la CWO semble restreindre le "point de vue politique" aux conceptions plus générales des différents participants. Néanmoins, il a tout à fait raison lorsqu'il souligne qu'à ce niveau, "le véritable clivage qui est apparu était entre les militants qui cherchaient des solutions immédiates sur la façon d'arrêter la guerre, et ceux qui avaient une orientation de lutte de classe, qui avaient une perspective à plus long terme et comprenaient que les guerres, en tant que produit du système capitaliste, ne peuvent être arrêtées que par la lutte massive des travailleurs".
C'est précisément ce que nous avons dit dans nos propres articles sur Prague. Cependant, là encore, il manque quelque chose dans le compte-rendu de la CWO. Comme nous l'avons souligné dans notre premier article, en proposant cette approche générale, "on a pu constater qu'il y avait une convergence entre les interventions de la TCI et du CCI, dont les délégations se sont rencontrées plus d'une fois pour comparer leurs notes sur l'évolution de la discussion".
L'article de la CWO affirme que l'un des aspects positifs de l'événement de Prague a été les nombreux contacts et discussions informelles qui ont eu lieu en marge des réunions principales, et nous sommes d'accord avec cela. Mais ce qu'ils évitent de dire, c'est qu'au sein de l'assemblée "auto-organisée" elle-même, leur délégation a pu, pour la première fois depuis de nombreuses années, travailler de manière constructive avec le CCI, et que cela est dû en grande partie au fait que, malgré de nombreux désaccords, nous partageons la tradition du marxisme et de la Gauche communiste, ce qui a permis aux deux organisations d'offrir une véritable alternative à l'activisme stérile qui domine dans la majorité de ce milieu. Ainsi, dans les interventions des deux organisations à Prague, l'accent a été mis sur la primauté d'un débat sérieux sur la situation mondiale par rapport à une fixation immédiate sur "ce que nous pouvons faire aujourd'hui" ; une insistance sur le rôle central de la lutte des travailleurs dans le développement de toute opposition réelle à la guerre impérialiste, et une affirmation que seul le renversement du capitalisme par la classe ouvrière peut mettre fin à la spirale mortelle de la guerre et de la destruction qui s'est installée dans le capitalisme décadent.
Une longue histoire d'opportunisme et de sectarisme
Nous ne pensons pas que le CWO souffre ici d'un simple trou de mémoire. Il s'agit plutôt d'une pratique adoptée par la CWO/TCI et ses précurseurs depuis longtemps : une politique du "tout le monde sauf le CCI". Cette attitude était déjà visible dans l'approche du Partito Comunista Internazionalista en 1943-1955 - l'organisation d'où la TCI tire ses origines. Comme nous l'avons montré dans plusieurs articles, le PCInt a été, dès sa création, opportuniste dans son intervention auprès des groupes partisans en Italie et auprès d'un certain nombre d'éléments qu'il a laissé entrer dans le Parti sans demander aucun compte de leurs déviations passées et même de leurs trahisons : c'est le cas de Vercesi, ancien militant de la fraction italienne qui s'était engagé dans le frontisme antifasciste pendant la guerre, ou des éléments qui s'étaient détachés de la Fraction pour combattre dans les milices du POUM en Espagne. Et cet opportunisme s'accompagne d'une approche sectaire à l'égard de ceux qui portaient une critique de gauche au PCInt, à savoir la Gauche communiste de France, avec laquelle celui-ci refusait toute discussion. Même approche de la part de Battaglia Comunista (l'affilié italien de la TCI) et de la CWO dans le sabotage des conférences de la Gauche communiste à la fin des années 1970 - dans le triste sillage duquel Battaglia et la CWO, s'étant effectivement débarrassés du CCI, ont organisé une "nouvelle" conférence avec un groupe de staliniens iraniens[6] . Un exemple clair d'opportunisme vers la droite, vers même l'aile gauche du capitalisme, et de sectarisme vers la gauche du camp prolétarien, le CCI.
Aujourd'hui, cette politique se poursuit par le refus systématique du travail en commun entre les principaux groupes de la gauche communiste au profit de la recherche d'alliances avec toutes sortes d'éléments – depuis des anarchistes jusqu'à ceux qui, à notre avis, sont de faux communistes de gauche qui ne peuvent jouer qu'un rôle destructeur à l'égard du milieu prolétarien authentique. L'exemple le plus évident de ces derniers est le "Groupe International de la Gauche Communiste", un groupe qui n'est pas seulement une formation parasite, dont la raison d'être est de calomnier le CCI, et qui s'est activement engagé dans le déballage public de la vie interne du CCI[7] , et c'est pourtant avec ce groupe que la TCI a formé son groupe No War But the Class War en France). Le choix de la TCI de rejeter les propositions du CCI pour un appel commun de la Gauche Communiste contre les guerres en Ukraine et au Moyen-Orient, et, à la place, d'opter pour une sorte de "front large" via les groupes "Pas de guerre mais la guerre de classe", n'est que la dernière itération de cette approche .[8]
Avant la réunion de Prague, la CWO a écrit aux organisateurs pour leur suggérer que les huit critères qu'ils avaient proposés pour la participation à la conférence et pour le travail internationaliste commun pourraient à l'avenir facilement être fusionnés avec les cinq points fondamentaux qui définissent les comités "No War But the Class War" (Pas de guerre sauf la guerre de classe)[9]. Il serait utile que la CWO, dans son bilan de la conférence, évalue ce qu'il est advenu de cette proposition.
Pour notre part, nous pensons que ce qui s'est passé à Prague a apporté une réfutation pratique de toute la méthode qui sous-tend l'initiative de NWBCW. Tout d'abord, cela n'a pas persuadé les organisateurs de revenir sur leur refus d'inviter la Gauche communiste à la conférence "officielle", comme cela avait été initialement avancé dans une interview radio avec le comité d'organisation[10] et pleinement confirmé dans le compte-rendu de l'événement rédigé par le groupe Tridni Valka (qui a certainement eu une influence clé sur le comité d'organisation officiel, même s'il affirme qu'il n'en faisait pas lui-même partie)[11] . Comme le montre l'article de Tridni Valka, l'hostilité envers la Gauche communiste dans certaines parties du mouvement anarchiste est très profonde. Ce n'est pas quelque chose qui peut être surmonté en formant des fronts amorphes avec les anarchistes. Au contraire, c'est là le moyen garanti d'éviter un débat réel et approfondi, lequel prendra nécessairement la forme d'une lutte politique patiente et implacable visant à aller aux racines de la divergence entre le marxisme et l'anarchisme. Rien n'indique que la TCI s'engage dans une telle confrontation avec les groupes avec lesquels elle s'est associée dans les commissions du NWBCW.
Deuxièmement, le déroulement des événements de Prague a été une véritable démonstration, d'une part, qu'il ne peut incomber à la Gauche communiste d'"organiser" le mouvement anarchiste fragmenté, politiquement hétérogène et souvent chaotique. Oui, il faut être présent dans ses rassemblements pour plaider pour une cohérence à la fois politique et organisationnelle, mais la tentative d'englober un tel milieu dans des groupes ou des comités permanents ne peut qu'aboutir au sabotage du travail de la Gauche communiste. D'un autre côté, les modestes débuts du travail commun entre la TCI et le CCI à Prague confirment l'opinion du CCI selon laquelle le meilleur point de départ pour que la Gauche communiste ait un impact dans la recherche plus large mais encore très confuse de positions internationalistes est un effort uni basé sur des principes très clairement partagés.
Amos
[2] Initiatives internationalistes contre la guerre et le capitalisme [798] sur le site de la TCI, Organisation affiliée en Grande-Bretagne à la Tendance Communiste Internationaliste.
[3] Ibid note 1.
[4] Ibid note 2.
[6] Lire la troisième conférence des groupes de la gauche communiste [800], International Review 22, et Les conférences internationales de la Gauche Communiste (1976-1980) - Leçons d'une expérience pour le milieu prolétarien [801], Revue internationale 122)
[7] Voir le dernier exploit GIGC : Nouvel acte de mouchardage du GIGC [802] : Appel à la solidarité révolutionnaire et à la défense des principes prolétariens [802]
[8] La “Tendance Communiste Internationaliste” et l’initiative “No War But the Class War”: un bluff opportuniste qui affaiblit la Gauche communiste [736]
[10] Interview with the Organising committee of the Action Week [804] publié à l'origine dans le magazine Transmitter,
[11] [AW2024] Report from Prague [805]. Nous y avons répondu dans notre deuxième article sur la Semaine d'action de Prague (note de bas de page 1).
Vie du CCI:
- Polémique [246]
Courants politiques:
- TCI / BIPR [247]
- Communist Workers Organisation [806]
- Anarchisme & Modernisme [584]
Rubrique:
ICConline - février 2024
- 30 lectures
Colère des agriculteurs: Un cri de désespoir instrumentalisé contre la conscience ouvrière!
- 229 lectures
Depuis le début de l’année, les agriculteurs se mobilisent contre la baisse de leurs revenus. Parti d’Allemagne suite à la suppression des subventions sur le diesel agricole, le mouvement touche désormais la France, la Belgique et les Pays-Bas, et commence à se propager à toute l’Europe. Les agriculteurs sont vent debout contre les taxes et les normes environnementales.
Les plus petits producteurs, étranglés par les prix d’achat de l’industrie agro-alimentaire et la politique de concentration des exploitations sont plongés de longue date dans une pauvreté parfois extrême. Mais avec l’accélération de la crise et la flambée des coûts de production, les conséquences du dérèglement climatiques et du conflit en Ukraine, la situation s’est encore fortement aggravée, au point que même les propriétaires d’exploitations moyennes sombrent à leur tour dans la misère. Des milliers de paysans vivent ainsi un quotidien de privation et d’anxiété qui pousse même nombre d’entre eux au suicide.
Un mouvement sans aucune perspective
Si personne ne peut rester insensible face à la détresse d’une partie du monde agricole, il est aussi de la responsabilité des organisations révolutionnaires de le dire clairement : oui, les petits paysans souffrent énormément de la crise ! Oui, leur colère est immense ! Mais ce mouvement ne se situe pas sur le terrain de la classe ouvrière et ne peut tracer aucune perspective pour son combat. Pire, la bourgeoisie instrumentalise la colère des paysans pour mener une véritable attaque idéologique contre le prolétariat !
Depuis que les travailleurs en Grande-Bretagne ont ouvert la voie à l’été 2022, les mobilisations ouvrières n’ont cessé de se multiplier face aux coups de butoir de la crise : d’abord en France, puis aux États-Unis, au Canada, en Suède et en Finlande récemment. Actuellement, l’Europe connaît une série de mobilisations ouvrières : en Allemagne, les cheminots se sont engagés dans une grève massive, suivis par les pilotes de lignes de la Lufthansa ; la plus grande grève de l’histoire d’Irlande du Nord a éclaté en janvier ; en Espagne et en Italie, les mobilisations se poursuivent dans les transports, tout comme dans le métro de Londres ou le secteur de la métallurgie en Turquie. La plupart de ces luttes sont d’une ampleur jamais vue depuis trois ou quatre décennies. Partout, les grèves et les manifestations éclatent, avec un développement balbutiant mais inédit de la solidarité entre les secteurs, voire par-delà les frontières…
Comment réagit la bourgeoisie face à ces événements historiques ? Par un immense silence médiatique ! Un véritable black-out ! En revanche, il n’aura fallu, initialement, que quelques sporadiques mobilisations paysannes pour que la presse internationale et toutes les cliques politiciennes, de l’extrême-droite à l’extrême-gauche, se jettent sur l’événement et fasse aussitôt monter la pression pour tenter de mieux occulter tout le reste.
Des petits paysans aux propriétaires de grandes exploitations modernes, bien que directement en concurrence, tous se sont retrouvés, avec la sainte onction des médias, autour des mêmes idoles sacrées : la défense de leur propriété privée et de la nation !
Ni les petits paysans ni les petits patrons ne sont porteurs d’un quelconque avenir face à la crise insoluble du capitalisme. Bien au contraire ! Leurs intérêts sont intimement liés à ceux du capitalisme, même si celui-ci, particulièrement sous l’effet de la crise, tend à faire disparaître les exploitations les plus fragiles et à plonger dans la misère une masse croissante d’entre eux. Aux yeux des paysans pauvres, le salut réside dans la défense désespérée de leur exploitation. Et, face à la férocité de la concurrence internationale, face aux très faibles coûts de la production asiatique, africaine ou sud-américaine, leur survie ne dépend que de la défense de « l’agriculture nationale ». Toutes les revendications des agriculteurs, contre « les charges », contre « les impôts », contre « les normes de Bruxelles », toutes ont pour point commun la préservation de leur propriété, petite ou grande, et la protection des frontières contre les importations étrangères. En Roumanie ou en Pologne, par exemple, les agriculteurs dénoncent la « concurrence déloyale » de l’Ukraine, accusée de brader le prix des céréales. En Europe de l’Ouest, ce sont les traités de libre échange qui sont pris pour cible, ainsi que les poids lourds et les marchandises venus de l’étranger. Et tout cela, avec le drapeau national brandit fièrement et des discours infâmes sur le « vrai travail », « l’égoïsme des consommateurs » et des « urbains » ! Voilà pourquoi, les gouvernements et les politiciens de tout bord, si promptes à dénoncer le moindre feu de poubelle et faire pleuvoir les coups de matraques quand la classe ouvrière est en lutte, se sont précipités au chevet de la « colère légitime ».
Un pas de plus dans le chaos social
La situation est néanmoins très préoccupante pour la bourgeoisie européenne. La crise du capitalisme ne va pas cesser. La petite-bourgeoisie et des petits patrons vont sombrer toujours plus nombreux dans la misère. Les révoltes des petits propriétaires acculés ne peuvent que se multiplier à l’avenir et contribuer à accroître le chaos dans lequel plonge la société capitaliste. Cette réalité se constate déjà à travers les destructions aveugles ou les tentatives « d’affamer » les villes.
Surtout, ce mouvement nourrit très clairement le discours des partis d’extrême-droites partout en Europe. Dans les prochaines années, plusieurs pays pourraient basculer dans le populisme et la bourgeoisie sait parfaitement qu’un triomphe de l’extrême-droite aux prochaines élections européennes contribuerait à renforcer davantage la perte de contrôle de la bourgeoisie sur la société, à effriter sa capacité à maintenir l’ordre et assurer la cohésion de la nation.
En France, là où le mouvement semble le plus radical, l’État cherche par tous les moyens à contenir la colère des agriculteurs, alors que l’atmosphère sociale est particulièrement tendue. Les forces de l’ordre sont ainsi priées d’éviter les affrontements et le gouvernement multiplie les « annonces », y compris les plus ignobles (emploi accru de la main d’œuvre étrangère sous-payée, arrêt de la moindre politique en faveur de l’environnement…). En Allemagne, pour ne pas jeter de l’huile sur le feu, Scholz a dû reculer en partie sur le prix du gazole agricole, tout comme l’Union européenne sur les normes environnementales.
Après la révolte, en 2013, des petits patrons bretons en « bonnets rouges », (1) puis le mouvement interclassiste des « gilets jaunes » (2) partout en France, c’est désormais l’Europe entière qui est touché par une poussée de violence de la petite-bourgeoisie sans aucune autre perspective que de mettre la pagaille. Le mouvement des agriculteurs représente donc bel et bien un pas supplémentaire dans la désagrégation du monde capitaliste. Mais, comme de nombreuses expressions de la crise de son système, la bourgeoisie instrumentalise le mouvement des agriculteurs contre la classe ouvrière.
Le prolétariat peut-il profiter de la “brèche ouverte par les agriculteurs” ?
Alors que la classe ouvrière reprend massivement le chemin de la lutte partout dans le monde, la bourgeoisie tente de saper le mûrissement de sa conscience, de pourrir sa réflexion sur son identité, sa solidarité et ses méthodes de lutte, en instrumentalisant la mobilisation des paysans. Et pour ce faire, elle peut, encore et toujours, compter sur ses syndicats et ses partis de gauche, trotskistes et staliniens en tête.
La CGT française a ainsi rapidement appelé les ouvriers à rejoindre le mouvement, tandis les trotskistes de Révolution Permanente titraient vaillamment : « Les agriculteurs terrorisent le gouvernement, le mouvement ouvrier doit profiter de la brèche ». Allons bon ! Si la bourgeoisie craint la dynamique de chaos social contenu dans ce mouvement, qui peut croire qu’une petite minorité de la population, attachée à la propriété privée, pourraient effrayer l’État et son énorme appareil de répression ?
Le mouvement des « bonnets rouges » ou celui des « gilets jaunes » ont illustré à eux seuls la capacité de la bourgeoisie à instrumentaliser et stimuler une « peur » bien calculée pour crédibiliser un gros mensonge contre la classe ouvrière : vos manifestations massives et le baratin de vos assemblées générales ne servent à rien ! Ainsi on voudrait nous faire croire que la bourgeoisie ne craint rien de plus que les blocages et les actions coups de poing minoritaires. Rien n’est plus faux ! Et cela tombe bien, car ces méthodes sont typiquement celles qu’utilisent les syndicats pour diviser et déverser la colère des ouvriers dans des actions parfaitement stériles. Les actes de destruction aveugle ne sapent en rien les fondements du capitalisme et ne contribuent pas à préparer son renversement. Ils sont comme des piqûres d’insectes sur la peau d’un éléphant justifiant toujours plus de répression.
Mais la bourgeoisie ne se contente pas de saboter la réflexion du prolétariat sur les moyens de sa lutte, elle cherche aussi à faire reculer le sentiment qui commence à se développer à travers ses mobilisations, celui d’appartenir à une même classe, victimes des mêmes attaques et contrainte de se battre unie et solidaire. Les partis de gauche s’empressent donc de refourguer leur vielle camelote frelatée sur la « convergence » des luttes du « petit peuple » contre les « riches ».
À propos des manifestations en Allemagne, les trotskistes italiens de La Voce delle Lotte ont ainsi pu écrire que « des actions paysannes massives et des grèves de cheminots ont lieu simultanément. Une alliance entre ces deux secteurs stratégiques aurait une énorme force de frappe ». Toujours les mêmes balivernes ! Ces traditionnels appels à la « convergence » n’ont pour finalité que de noyer la lutte de la classe ouvrière dans la révolte « populaire ».
Malgré tout, la bourgeoisie est confrontée à une grande méfiance des ouvriers à l’égard d’un mouvement peu réprimé (contrairement aux manifestations ouvrières) et qui flirte avec l’extrême-droite et des discours très réactionnaires. Les syndicats et la gauche ont donc dû s’employer à toute sorte de contorsions pour prendre quelques distances avec le mouvement, tout en cherchant à pousser les prolétaires à « s’engouffrer dans la brèche » à travers des grèves en ordre dispersé, corporation par corporation.
La mobilisation des agriculteurs ne peut en aucune façon être un tremplin pour la lutte de la classe ouvrière. Au contraire, les prolétaires qui se laisseraient embarquer derrière les mots d’ordre et les méthodes des agriculteurs, dilués dans des couches sociales fondamentalement opposées à toute perspective révolutionnaire, ne pourraient que subir impuissants la pression du nationalisme et de toutes les idéologies réactionnaires charriées par ce mouvement.
La responsabilité des révolutionnaires envers la classe ouvrière s’exprime inlassablement dans la mise en lumière des pièges qui jalonnent tout son combat et qui, hélas, vont le jalonner encore longtemps. Avec l’approfondissement de la crise, de nombreuses couches sociales, non exploiteuses mais non révolutionnaires, vont être amenées, comme les agriculteurs aujourd’hui, à se révolter, sans avoir la capacité d’offrir une véritable perspective politique à la société. Sur ce terrain stérile, le prolétariat ne peut être que perdant. Seule, la défense de son autonomie de classe exploitée et révolutionnaire peut lui permettre d’élargir toujours plus sa lutte et d’agréger, à terme, d’autres couches à son propre combat contre le capitalisme.
EG, 31 janvier 2024
1 « Les bonnets rouges : une attaque idéologique contre la conscience ouvrière [807] », Révolution internationale n° 444 (2014).
2 « Bilan du mouvement des “gilets jaunes”: Un mouvement interclassiste, une entrave à la lutte de classe [380] », Supplément à Révolution internationale n° 478 (2019).
Géographique:
- Europe [24]
Récent et en cours:
Rubrique:
Correspondance avec Initiative antimilitariste
- 175 lectures
Nous publions ici notre réponse à un message de "Initiative antimilitariste"[1], un réseau principalement basé en Europe de l'Est, qui s'inscrit dans une remise en cause plus large de la logique guerrière du capitalisme à la suite des guerres en Ukraine et au Moyen-Orient. Toute une série de groupes, dont la plupart s'identifient à la tradition anarchiste, ont publié des déclarations et appelé à des conférences pour discuter de "ce qu'il faut faire" face aux perspectives de plus en plus catastrophiques ouvertes par ces guerres.
Nous nous félicitons que le blog de l'AMI ait publié un certain nombre d'articles du CCI sur la guerre et l'internationalisme, notamment une interview de Marc Chirik sur les révolutionnaires face à la Seconde Guerre mondiale, et un article montrant les profondes divergences que la guerre en Ukraine a révélées au sein de la "famille" anarchiste, entre ceux qui cherchent à adopter une position internationaliste claire et ceux qui prônent ouvertement la défense de l'État ukrainien[2]. Dans notre réponse, nous encourageons l'AMI à développer davantage les discussions en cours dans ses rangs, tout en plaidant pour la nécessité de développer une analyse globale qui situe ces guerres dans un contexte historique et mondial. Seule cette analyse peut nous permettre de comprendre les perspectives offertes par le système capitaliste, et surtout les possibilités réelles de lutte de classe et d'intervention des révolutionnaires face à la guerre impérialiste. Sans une telle analyse, il est facile de tomber dans un activisme stérile qui ne peut que déboucher sur la démoralisation étant donné son inévitable incapacité à produire des résultats immédiats.
*******************
De CCI à AMI
Chers camarades,
Désolés pour le retard de notre réponse.
Vous avez mentionné dans votre dernière correspondance que vous discutez des questions suivantes :
- Analyse de l'escalade des conflits au Moyen-Orient
- Comment organiser des actions pratiques contre les guerres capitalistes ?
- Comment transformer les conflits inter-impérialistes en une lutte de classe révolutionnaire ?
Nous aimerions vous soumettre quelques points clés pour contribuer à vos débats.
1) Analyse de l'escalade du conflit au Moyen-Orient
Nous avons publié plusieurs articles d'analyse de la situation - au cas où vous ne les auriez pas vus, nous avons mis les liens à la fin de ce texte.
À partir de ces articles, nous pouvons souligner quelques questions.
La dernière guerre au Moyen-Orient - qui se déroule en même temps que la guerre en Ukraine (laquelle va entrer dans sa troisième année) et les tensions croissantes dans le Caucase, les Balkans et ailleurs - ne peut être déconnectée de la confrontation mondiale entre les États-Unis et la Chine.
Mais, alors que les États-Unis ont été confrontés à plusieurs fiascos au Moyen-Orient (Irak-Syrie-Afghanistan) et ont décidé de concentrer leurs forces pour empêcher la Chine de devenir la première puissance mondiale - ce qui signifie détrôner les États-Unis - la dernière escalade au Moyen-Orient est en quelque sorte une guerre "non désirée" pour les États-Unis.
En particulier, la position des États-Unis au Moyen-Orient a été affaiblie par la façon dont Israël a procédé (en imposant l'exode le plus important jamais réalisé de la population de Gaza et en exerçant des représailles brutales par le biais d'une politique de la terre brûlée).
Par ailleurs, les États-Unis ont entraîné la Russie dans la guerre en Ukraine. La Russie a essayé de reconquérir ses positions perdues à l'époque de l'existence des deux blocs - elle ne peut le faire que militairement - comme elle l'a déjà montré en soutenant farouchement le régime syrien. Cette guerre entre l'Ukraine et la Russie pose aujourd'hui des difficultés croissantes - parce qu'elle est devenue une guerre stagnante et que le soutien à l'Ukraine est devenu de plus en plus impopulaire aux États-Unis.
La montée en puissance de la Chine ne s'est pas faite uniquement grâce à son énorme croissance économique. Elle s'est toujours accompagnée d'une stratégie à long terme de modernisation et d'expansion de son armée, et ses projets de "Route de la soie" révèlent l'ampleur de ses ambitions, tout comme sa volonté d'intégrer Taïwan à la Chine et sa politique de renforcement de sa présence dans la mer de Chine méridionale, toutes choses auxquelles les pays occidentaux se sont opposés. L'Union Européenne, les États-Unis et l'Inde ont adopté l'un après l'autre des projets visant à contrecarrer la Route de la soie.
Nous pouvons constater une aggravation des tensions à l'échelle mondiale, qui engloutissent de plus en plus de pays, et la dernière guerre au Moyen-Orient montre également que les États-Unis perdent de plus en plus le contrôle de leur gendarme (Israël) dans la région. Avec le déclenchement de la Première Guerre mondiale, de la Seconde Guerre mondiale, de la Guerre froide et des nombreuses guerres par procuration qui ont suivi, le militarisme est devenu le mode de survie du système et un véritable cancer qui en ronge le cœur.
Cette dynamique à elle seule montre déjà que nous ne pourrons pas éradiquer le cancer du militarisme si le système n'est pas vaincu.
Dans le même temps, lorsque les principaux politiciens et "experts" se réunissent à Dubaï pour la conférence COP 28, ils montrent que la classe dirigeante est incapable et largement réticente à prendre les mesures nécessaires pour protéger la planète. Laisser le destin de notre planète entre les mains de la classe capitaliste, c'est signer l'arrêt de mort de l'humanité, une raison supplémentaire et urgente de dépasser le système capitaliste.
Nous ne reviendrons pas sur les effets de la crise économique, de la famine, de l'exode massif des réfugiés que nous constatons sur tous les continents, qui sont autant d'expressions de la même impasse dans laquelle le système a conduit l'humanité.
En bref : il n'est pas possible de comprendre ce qui se passe si nous ne regardons qu'un seul aspect, mais nous devons voir la totalité et l'interconnexion entre les différentes composantes destructrices.
Comment voyez-vous ce lien et cette évolution globale à l'échelle mondiale ? Pouvons-nous comprendre les événements dans un pays en les isolant du reste, ou devons-nous les situer dans un cadre global ?
Quelle est votre analyse ? Quels débats avez-vous entre vous à ce sujet ?
Comment voyez-vous ce lien et cette évolution mondiale ? Peut-on comprendre les événements d'un pays en les isolant des autres, ou faut-il les replacer dans un cadre global ?
Nous avons également remarqué que si plusieurs groupes ont réussi à prendre une position claire sur la guerre entre l'Ukraine et la Russie, rejetant le soutien aux deux parties, une position internationaliste claire comme de l'eau de roche contre la guerre au Moyen-Orient a été évitée ou beaucoup plus difficile à prendre pour certains groupes. L'une des raisons est que de nombreux groupes s'accrochent encore à l'idée qu'il pourrait y avoir quelque chose de progressiste derrière la formation d'un État palestinien. Nous défendons la position de la gauche communiste qui, dans la continuité de la défense de l'internationalisme à l'époque de la Première Guerre mondiale, a également défendu l'internationalisme à l'époque de la Deuxième Guerre mondiale et contre les soi-disant luttes de libération nationale. Le soutien à la formation de tout nouvel État dans ce que la Troisième Internationale a appelé "l'époque des guerres et des révolutions" est une idée totalement réactionnaire, qui ne fait qu'encourager de nouvelles guerres ; nous devons nous prononcer pour l'abolition de tous les États. La survie de la planète - de l'humanité - ne peut être assurée par davantage d'États, mais exige précisément l'abolition de tous les États et du nationalisme.
C'était la tradition de la Gauche Communiste de France et de Marc Chirik, dont vous avez publié récemment l'interview.
2) La question des "actions pratiques" contre les guerres capitalistes
Nous aimerions pouvoir faire quelque chose d'immédiat contre la guerre. Notre indignation et notre révolte face aux actes de barbarie en Ukraine ou au Proche-Orient nous poussent à vouloir pouvoir arrêter la machine de guerre tout de suite !
Mais nous devons comprendre que l'indignation ne suffit pas et qu'il n'est pas réaliste d'attendre de la classe ouvrière qu'elle prenne des mesures immédiates, décisives et efficaces contre la guerre sur une base à court terme. Pour pouvoir mettre fin à cette guerre et à toutes les autres, il ne faut rien de moins que renverser le système !
Pour comprendre l'ampleur réelle du défi et la solution nécessaire, il faut revenir à l'histoire.
Il est vrai que les insurrections et les révolutions de la classe ouvrière en 1905 ou pendant la Première Guerre mondiale sont nées d'une réaction contre la guerre. Mais les conditions de la Première Guerre mondiale et celles d'aujourd'hui sont très différentes. Lors de la Première Guerre mondiale, des millions de soldats ont été mobilisés au cœur du capital, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Les armes utilisées pendant la Première Guerre mondiale étaient des canons, de plus en plus de chars, ainsi que des raids aériens et des armes chimiques (gaz). Mais dans les tranchées, les combats se déroulaient toujours "fusil contre fusil". La guerre s'est "enracinée", a stagné, et il y avait encore la possibilité d'un contact direct (cris entre les tranchées). Au bout d'un certain temps, il pouvait donc y avoir une fraternisation dans les tranchées.
Tout cela n'est plus le cas aujourd'hui. Les armes (balles, missiles, drones, bombes, avions, etc.) peuvent voyager sur de longues distances, de sorte que les soldats ne voient même pas l'ennemi.
Lors de la Première Guerre mondiale, les soldats se sont mobilisés massivement au bout d'un certain temps - et pas seulement par désertion. À partir de 1915, les protestations se multiplient dans les rues et les usines, car la guerre est synonyme d'intensification du travail, de militarisation, de "paix sociale" imposée dans les usines et, surtout, de famine. Liebknecht réunit 60 000 ouvriers sur la place de Potsdam, et de plus en plus de manifestations de rue et de grèves sauvages éclatent - le nombre élevé de femmes enrôlées dans les usines jouant également un rôle important. L'ensemble du front militaire et du front intérieur se désagrège. En Russie, les ouvriers commencent à se battre contre les officiers et à fraterniser ; les nombreux paysans qui ont été enrôlés de force réagissent également contre la guerre. Le facteur humain/social joue un rôle essentiel dans la machinerie de guerre. D'août 1914 à février 1917, puis octobre 1917, trois années de massacres se sont écoulées, et même la révolution en Russie n'a pas encore pu arrêter la guerre sur les autres fronts. Ce n'est qu'en novembre 1918, avec l'éclatement de la révolution en Allemagne, que les choses ont pris un tournant décisif pour mettre fin à la guerre mondiale. Les soldats et les marines de Kiel avaient reçu l'ordre de livrer la "dernière bataille" contre l'Angleterre, mais les marins ont compris que cela signifierait leur mort. Les soldats ont donc dû se battre directement pour leur vie, pour leur survie. La combinaison d'un début de fraternisation sur le front militaire et de l'éclatement des luttes sur le front intérieur a forcé la bourgeoisie allemande à réagir.
Ces conditions ne sont plus réunies aujourd'hui. De plus en plus de soldats sont recrutés en Ukraine et en Russie, et il n'y a pas encore eu de réaction significative contre la guerre - même s'il y a eu un exode massif d'hommes d'Ukraine et bien plus encore de Russie pour échapper au recrutement forcé. Une résistance ouverte et massive contre la guerre en Russie reste à venir. Pour l'instant, il semble qu'il n'y ait pas encore de pénurie alimentaire majeure, ni d'effondrement de l'économie. C'est une spécificité de la situation en Russie que l'économie ait été si fortement dépendante des approvisionnements en pétrole et en gaz, de sorte que les sanctions de l'Occident / des États-Unis ont forcé la Russie à vendre davantage à d'autres pays - ce qui a aidé la Russie à gagner du temps et a aidé le régime de Poutine à éviter d'imposer une attaque économique massive à la classe ouvrière. Mais ce "gain de temps" ne durera probablement pas éternellement et la réaction de la classe ouvrière en Russie, qui serait un facteur clé pour s'opposer à la guerre, reste un facteur inconnu et imprévisible. La classe ouvrière ukrainienne est encore plus confrontée à un nationalisme omniprésent. Toute résistance à la guerre risque d'être écrasée par le régime de Zelensky.
C'est pourquoi nous devons nous tourner vers la classe ouvrière de l'Ouest. Parce que la classe ouvrière occidentale ne peut pas être mobilisée directement pour la guerre - la plupart des travailleurs refuseraient de sacrifier leur vie pour la guerre - et parce que les pays de l'OTAN ont soigneusement évité d'envoyer des troupes sur le terrain parce qu'ils savent que la classe ouvrière et peut-être d'autres parties de la population occidentale ne soutiendraient pas une telle démarche. Ainsi, l'Occident a surtout fourni tout l'arsenal nécessaire à la prolongation de la guerre.
Paradoxalement, les réactions du parti républicain aux États-Unis sont très révélatrices. Ils s'opposent de plus en plus à la poursuite du financement de la guerre en Ukraine, car ils estiment que cela se ferait au détriment de l'économie américaine. Ils estiment également que la classe ouvrière n'est pas disposée à sacrifier ses vies, à souffrir de la faim, etc. pour la guerre en Ukraine.
Un autre facteur doit être pris en considération. En Russie, en octobre 1917, la classe ouvrière est parvenue à renverser une bourgeoisie relativement faible et encore isolée à l'époque. La contre-offensive des Blancs, avec la guerre civile, n'a commencé qu'un an plus tard.
Mais la bourgeoisie allemande était beaucoup plus expérimentée et plus puissante et elle a pu mettre fin à la guerre "du jour au lendemain", en novembre 1918, lorsque les marins de Kiel ont commencé à se déplacer et que les soldats et les conseils ouvriers ont commencé à se mettre en place, empruntant la voie de la révolution russe.
Le prolétariat allemand était donc confronté à une bourgeoisie beaucoup plus rusée et intelligente, qui a obtenu le soutien des autres bourgeoisies dès que le prolétariat a commencé à relever la tête en Allemagne.
Aujourd'hui, la classe ouvrière est confrontée à une classe capitaliste de plus en plus pourrie et décomposée, mais malgré sa pourriture, elle est plus déterminée que jamais à unir ses forces si son ennemi mortel, la classe ouvrière, relève la tête. Et ils peuvent aussi compter sur les syndicats, les partis de gauche, etc. pour saboter les luttes des travailleurs. Il ne faut donc pas s'attendre à une dynamique immédiate de radicalisation des luttes contre la guerre.
3) Comment transformer les conflits inter-impérialistes en une lutte de classe révolutionnaire ?
Où se trouve la clé ?
La clé est toujours entre les mains de la classe ouvrière.
Nous pensons que les travailleurs de Grande-Bretagne, de France et, plus récemment, des États-Unis ont commencé à en apporter la preuve. Parce que poussés par l'inflation ou d'autres fortes attaques, les travailleurs de nombreux pays ont commencé à se lever et à rompre une période de plusieurs décennies de passivité et de désorientation face au déroulement des événements. C'est pourquoi nous parlons de "rupture"[3].
Et nous pensons que cette capacité de la classe ouvrière à défendre ses intérêts économiques est la PRÉCONDITION au développement de sa force, de sa confiance en soi, par laquelle la classe peut se reconnaître et comprendre clairement qu'il y a deux classes qui s'opposent l'une à l'autre.
En ce sens, les luttes économiques défensives sont absolument nécessaires. C'est au cours de ces luttes économiques que les travailleurs doivent apprendre à prendre les luttes en main (ce qu'ils n'ont pas fait depuis longtemps), qu'ils doivent réapprendre à identifier leurs véritables ennemis (s'agit-il des migrants, des réfugiés - comme le prétendent tous les populistes et la droite - ou de ceux qui les exploitent ?) et leurs frères et sœurs de classe qui peuvent développer une solidarité de classe en s'unissant et en prenant en charge les luttes eux-mêmes.
Et c'est à travers les luttes économiques défensives que les travailleurs doivent réapprendre à découvrir que la racine des problèmes sont bien plus profondément enracinés dans le système et ne sont pas la faute de quelque banquier pourri et cupide (comme le Mouvement Occupy de 2011 a essayé de nous le faire croire), et aussi que toutes les autres menaces à la survie de l'humanité sont fondamentalement enracinées dans le système. Ce processus de politisation a donc besoin du véritable "feu de la lutte des classes", mais les discussions en cours dans les différentes couches de la classe peuvent être propulsées et catalysées par ces luttes ouvertes.
Rosa Luxemburg a insisté en novembre/décembre 1918 sur le fait qu'il était indispensable que la pression exercée par les usines et les luttes économiques soit beaucoup plus forte, une fois que la "révolution des soldats" s'était essoufflée avec la décision de la bourgeoisie de mettre fin à la guerre.
Telle est la dynamique de la lutte des classes depuis 1905, lorsqu'il est devenu évident que les luttes politiques et économiques devaient se fondre en un seul et même courant - la grève de masse.
En se rassemblant en tant que classe et en luttant pour ses intérêts économiques, la classe ouvrière peut également bloquer l'influence destructrice de toutes sortes de facteurs de division tels que les questions "identitaires" (autour de la race, du sexe, etc.). En étant forcée, par ses luttes économiques, de rechercher la solidarité de tous les autres travailleurs pour s'opposer à l'État et être plus forte que la classe capitaliste par l'extension et l'unification des luttes, la classe ouvrière peut jouer le rôle d'un aimant dans la société, en offrant une perspective à tous ceux qui sont opprimés par le capital - non pas en se dissolvant dans une masse anonyme d'individus, mais en agissant comme une force unie contre la classe dirigeante.
Si nous insistons sur la nécessité pour la classe de développer ses luttes économiques, ce n'est pas que nous fuyons notre responsabilité vis-à-vis de la guerre. Mais c'est la seule façon de développer une réponse efficace. Croire qu'une solution immédiate peut être trouvée par une sorte d'"Action" minoritaire est une impasse, et finira par démoraliser ceux qui y participent.
Il est indispensable de comprendre, comme le soulignait Pannekoek dans son célèbre livre Révolution mondiale et tactique communiste de 1920, que la révolution prolétarienne est la première révolution de l'histoire qui dépende entièrement de l'action collective, consciente et massive de la classe ouvrière. Elle ne peut compter sur aucune autre force que sa propre force - sa conscience et sa solidarité, sa capacité d'unification.
Créer des illusions sur une issue facile et rapide est trompeur et démoralisant. C'est pourquoi nous avons rejeté le projet de la Tendance Communiste Internationaliste de créer des comités contre la guerre. Selon nous, ces comités rendent confus le rôle essentiellement politique que les organisations révolutionnaires doivent jouer face aux guerres impérialistes. Nous avons écrit plusieurs articles à ce sujet.[4]
Peu après la guerre, nous avons également pris position sur cette question dans un article intitulé "Militarisme et décomposition", que nous citons ici :
"Par le passé nous avons fait la critique du mot d'ordre de "défaitisme révolutionnaire". Ce mot d'ordre mis en avant au cours de la Première Guerre mondiale, notamment par Lénine, se basait sur une préoccupation fondamentalement internationaliste : la dénonciation des mensonges colportés par les social-chauvins affirmant qu'il était nécessaire que leur pays remporte préalablement la victoire pour permettre aux prolétaires de ce pays de s'engager dans le combat pour le socialisme. Face à ces mensonges, les internationalistes ont mis en relief que ce n'était pas la victoire d'un pays qui favorisait le combat des prolétaires de ce pays contre leur bourgeoisie mais au contraire sa défaite (comme l'avaient illustré les exemples de la Commune de Paris après la défaite face à la Prusse et de la Révolution de 1905 suite à la débâcle de la Russie face au Japon). Par la suite, ce mot d'ordre de "défaitisme révolutionnaire" a été interprété comme le souhait par le prolétariat de chaque pays de voir sa propre bourgeoisie être défaite afin de favoriser le combat pour le renversement de celle-ci ce qui, évidemment, tourne le dos à un véritable internationalisme. En réalité, Lénine lui-même (qui en 1905 avait salué la défaite de la Russie face au Japon) a surtout mis en avant le mot d'ordre de "transformation de la guerre impérialiste en guerre civile" qui constituait une concrétisation de l'amendement que, en compagnie de Rosa Luxemburg et de Martov, il avait présenté et fait adopter au Congrès de Stuttgart de l'Internationale Socialiste en 1907 : "Au cas où la guerre éclaterait néanmoins [les partis socialistes] ont le devoir de s’entremettre pour la faire cesser promptement et d’utiliser de toutes leurs forces la crise économique et politique créée par la guerre pour agiter les couches populaires les plus profondes et précipiter la chute de la domination capitaliste.
La révolution en Russie de 1917 a constitué une concrétisation éclatante du mot d'ordre "transformation de la guerre impérialiste en guerre civile" : les prolétaires ont retourné contre leurs exploiteurs les armes que ces derniers leur avaient confiées pour massacrer leurs frères de classe des autres pays. Cela-dit, comme on l'a vu plus haut, même s'il n'est pas exclu que des soldats puissent encore retourner leurs armes contre leurs officiers (pendant la Guerre du Vietnam, il est arrivé que des soldats américains tuent "par accident" des supérieurs hiérarchiques), de tels faits ne pourraient être que d'ampleur très limitée et ne pourraient constituer en aucune façon la base d'une offensive révolutionnaire. C'est pour cette raison que, dans notre propagande, il convient de ne pas mettre en avant non seulement le mot d'ordre de "défaitisme révolutionnaire" mais aussi celui de "transformation de la guerre impérialiste en guerre civile".
Plus généralement, il est de la responsabilité des groupes de la Gauche communiste de faire le bilan du positionnement des révolutionnaires face à la guerre dans le passé en mettant en évidence ce qui reste valable (la défense des principes internationalistes) et ce qui ne l'est plus (les mots d'ordre "tactiques"). En ce sens, si le mot d'ordre de "transformation de la guerre impérialiste en guerre civile" ne peut dorénavant constituer une perspective réaliste, il convient en revanche de souligner la validité de l'amendement adopté au Congrès de Stuttgart en 1907 et particulièrement l'idée que les révolutionnaires "ont le devoir d’utiliser de toutes leurs forces la crise économique et politique créée par la guerre pour agiter les couches populaires les plus profondes et précipiter la chute de la domination capitaliste". Ce mot d'ordre n'est évidemment pas réalisable dans l'immédiat compte-tenu de la situation de faiblesse actuelle du prolétariat, mais il reste un poteau indicateur pour l'intervention des communistes dans la classe."[5] "
Quant à ce que cela signifie pour le rôle des révolutionnaires, qui sont nécessairement une petite minorité, nous avons essayé de le développer dans notre Déclaration commune contre la guerre en Ukraine et dans notre Appel aux groupes de la Gauche communiste, que vous avez peut-être vus.[6]
Nous serions heureux que vous nous fassiez part des discussions dans vos rangs et nous sommes bien sûr désireux de discuter avec vous directement. Si vous avez des documents que vous nous recommandez de lire, n'hésitez pas à nous les envoyer.
J'espère que nous pourrons bientôt mettre en place un échange direct.
Dans l'attente de votre réponse... et encore une fois désolé pour cette réponse tardive.
Salutations communistes
Le CCI (10 / 12 / 2023)
Sélection de textes
Spirale d’atrocités au Moyen-Orient : la terrifiante réalité de la décomposition du capitalisme [810]
[2] Le mouvement révolutionnaire et la seconde guerre mondiale: interview de Marc Chirik, 1985 [812]; Entre l'internationalisme et "la défense de la nation". L'article de AMI, "Antimilitarisme anarchiste et mythes sur la guerre en Ukraine [813]" est une réponse très claire aux arguments des " anarcho-défensiste".
[3] Voir notre article La lutte est devant nous! [712]
[4] Par exemple, La “Tendance Communiste Internationaliste” et l’initiative “No War But the Class War”: un bluff opportuniste qui affaiblit la Gauche communiste [736].
[6] Déclaration commune de groupes de la Gauche communiste internationale sur la guerre en Ukraine [438] ; Appel de la Gauche communiste [814] (Guerre au Moyen Orient)
Rubrique:
Les travailleurs en Irlande du Nord se joignent à la reprise internationale des luttes
- 71 lectures
Le jeudi 18 janvier a eu lieu la plus grande grève de l’histoire de l’Irlande du Nord. (1) Malgré des conditions glaciales et des températures souvent en dessous de zéro, 170 000 travailleurs étaient mobilisés, des membres de seize syndicats, représentants 80 % du secteur public. Des marches et des rassemblements ont eu lieu dans les villes des six comtés, malgré toutes les divisions sectorielles qui ont affecté la classe ouvrière d’Irlande du Nord. Il y avait des piquets de grève devant les écoles et les hôpitaux, les gares et les dépôts municipaux, ainsi que dans de nombreux autres bâtiments publics. Presque toutes les écoles et établissements d’enseignement supérieur ont été fermés. Tous les transports publics ont été arrêtés. Le lendemain, vendredi 19, des centaines d’employés des transports, d’agents de nettoyage, d’assistants de classe et de conducteurs de véhicules de sablage, étaient en grève pour une deuxième journée.
En apparence, la raison de la grève (et l’explication donnée par les partis de gauche, de droite et du centre) tient uniquement au statut de l’Irlande du Nord. Au cours des deux dernières années, depuis les élections de 2022 au cours desquelles le Sinn Fein a remporté le plus de sièges, le Parti unioniste démocrate (DUP) a fait en sorte à ce qu’il n’y ait ni Assemblée ni Exécutif. Pour cette raison, toutes les revendications salariales dans le secteur public ont été déclarées impossibles car, selon le gouvernement britannique, seul le « gouvernement dévolu d’Irlande du Nord » peut autoriser des augmentations de salaire. En décembre, les conservateurs (Tories) ont proposé 600 millions de livres sterling pour les salaires du secteur public, le tout dans le cadre d’un programme de 3,3 milliards de livres sterling, mais à condition de mettre fin au blocage des Institutions.
En réponse, le DUP a accusé le secrétaire nord-irlandais Chris Heaton-Harris d’avoir tenté de les faire chanter, affirmant que l’argent devrait quand même être remis. Pendant ce temps, le Sinn Fein a affirmé que les travailleurs ne pourront être satisfaits que si l’Assemblée et l’Exécutif sont réactivés. Lors des rassemblements du 18 janvier, les dirigeants syndicaux étaient divisés entre blâmer le DUP ou le gouvernement britannique, ou les deux. Même si les syndicats étaient tous d’accord sur le fait que l’argent était là, la réalité est que les travailleurs luttent contre un système qui ne peut pas satisfaire leurs besoins les plus élémentaires.
Bien que la grève ait été largement contrôlée par les syndicats et que les différentes fractions de la classe dirigeante profitent certainement du chaos politique en Irlande du Nord pour tenter d’entraîner les travailleurs derrière leurs querelles, ce mouvement ne sort pas de nulle part. En décembre, des grèves ont eu lieu dans tout le réseau de transport, bus et trains, durant quatre jours différents. Avant cela, en novembre, il y avait eu des grèves dans le secteur des transports et dans le personnel scolaire. Il est vrai que ces mouvements étaient également contrôlés par les syndicats, mais cela montre qu’il existe un réel mécontentement à l’égard des rémunérations des travailleurs. En Grande-Bretagne, il y a eu au moins quelques hausses de salaires, mais le gel des salaires en Irlande du Nord a encore aggravé la situation et les travailleurs ne peuvent plus supporter les effets de la « crise du coût de la vie ». Les luttes ont été engagées en raison d’une réelle détérioration des conditions matérielles des travailleurs, attaqués dans tous les pays. En cela, les luttes des travailleurs d’Irlande du Nord se situent dans la lignée de celles en Grande-Bretagne à partir de 2022, et des mouvements ultérieurs en France, aux États-Unis, au Canada et en Scandinavie. Elles expriment une rupture avec la passivité des trente années précédentes, et témoignent du potentiel de luttes plus approfondies dans le futur : celui du lien entre la classe ouvrière en Irlande, en Grande-Bretagne continentale et en Europe.
Car, 24 janvier 2024
1 Cela exclut évidemment l’action loyaliste imposée par les paramilitaires du Conseil des travailleurs d’Ulster en 1974 qui n’était pas une grève ouvrière… et n’était pas dirigée par un « conseil des travailleurs ».
Géographique:
- Grande-Bretagne [47]
- Irlande [815]
Récent et en cours:
Rubrique:
ICConline - mars 2024
- 58 lectures
Permanence en ligne le samedi 23 mars 2024
- 65 lectures
Le Courant Communiste International organise une permanence en ligne le samedi 23 mars 2024 à 15h.
Ces permanences sont des lieux de débat ouverts à tous ceux qui souhaitent rencontrer et discuter avec le CCI. Nous invitons vivement tous nos lecteurs et tous nos sympathisants à venir débattre afin de poursuivre la réflexion sur les enjeux de la situation et confronter les points de vue. N'hésitez pas à nous faire part des questions que vous souhaiteriez aborder.
Les lecteurs qui souhaitent participer aux permanences en ligne peuvent adresser un message sur notre adresse électronique ([email protected] [213]) ou dans la rubrique « nous contacter [214] » de notre site internet, en signalant quelles questions ils voudraient aborder afin de nous permettre d’organiser au mieux les débat.
Les modalités techniques pour se connecter à la permanence seront communiquées ultérieurement.
Vie du CCI:
- Permanences [291]
Rubrique:
Défense de la plateforme du CCI : les nouveaux mensonges du GIGC
- 237 lectures
Face aux nouvelles calomnies du GIGC[1] en réaction à l'article de défense de notre plateforme[2], nous avons jugé que nous ne pouvions pas les laisser sans réponse, même si cela implique de retarder la sortie d'autres articles planifiés et également dédiés à la défense de notre organisation.
Un conditionnement préalable du lecteur à coup de boules puantes
Le GIGC présente nos articles dénonçant ses critiques mensongères, ses déformations, ses omissions par rapport à notre plate-forme comme un moyen de faire diversion face aux questionnements des militants du CCI et même de contacts au sein du milieu politique prolétarien, par rapport à la supposée dérive politique de notre organisation.
Il commence par disqualifier notre dernier congrès international, mais « dans le vague », en évitant d'être concret et précis, marquant un mépris vis-à-vis de ses travaux sans bien sûr se risquer à en faire une critique politique. Ainsi, il conclut que ce congrès était "Empêtré dans des contradictions théorico-politiques d’ordre idéaliste", que ses travaux "ne représentaient pas d’enjeu particulier pour le camp prolétarien" et ne font qu'exprimer "la marginalisation croissante de notre organisation". À propos de quel document en particulier ? C’est un mystère sur lequel le GIGC reste muet, mais on imagine sans peine qu'il s'agit du rapport sur la "décomposition de la société" dont une partie, "La méthode marxiste, outil indispensable pour comprendre le monde actuel", inclut une réponse argumentée aux critiques de notre "prétendu idéalisme". Évidemment, l’objectif du GIGC n’a jamais été de combattre politiquement nos prétendues "contradictions théorico-politiques d’ordre idéaliste"[3], dans la mesure où la confrontation politique ne l’intéresse pas. La prétendue « critique théorique » du GIGC consiste en une succession de phrases ronflantes sans aucun argument ou preuve qui vise uniquement à nous dénigrer. Dans cette sale besogne, il n’innove pas, il ne fait que suivre la méthode de « débat » des gauchistes ou celle d’un maitre du parasitisme politique, Bakounine, qui adressait au conseil général de l’AIT, les admonitions et accusations les plus bruyantes en vue de cacher ses propres agissements sournois.
Il répand des insinuations sur la vie interne du CCI. Sans aucun élément à l'appui, le GIGC décrète que nos 6 articles de dénonciation de ses méthodes seraient destinés à obliger nos "militants à taire leurs doutes sur les positions, analyses et la dynamique politiques de l'organisation". Au-delà du fait que c'est très méprisant pour tous les militants du CCI, il s'agit d'une tentative supplémentaire d’instiller le venin de la méfiance au sein du milieu politique prolétarien vis-à-vis de "l'organisation stalinienne" que nous serions. À ce propos, nous invitons nos lecteurs à parcourir notre presse afin d'évaluer la manière dont le CCI a toujours rendu compte dans ses colonnes de ses discussions et débats internes, y compris sur les questions organisationnelles. L’attaque « théorique » se double ici d'une attaque « organisationnelle ». Dans sa furie dénigrante - la seule raison d’être du GIGC - il lui faut à tout prix faire apparaitre le CCI de la façon la plus repoussante possible.
Il tente également d’instiller le doute parmi nos contacts en prétendant que le CCI se sert du prétexte des attaques du GIGC pour ne pas répondre "aux questions que les contacts et jeunes militants se rapprochant de la Gauche communiste lui présentent sur les positions des autres groupes, dont la TCI et le GIGC tout particulièrement". Pour information, nous n'avons pas été confrontés à une masse de questions sur les positions du GIGC, même pas une seule en réalité. Mais surtout, nous n’escamotons aucune question ou critique émanant des groupes du milieu politique prolétarien et leurs sympathisants. Néanmoins, si des contacts nous avaient sollicités à propos du GIGC, nous n'aurions pas manqué de leur faire une description circonstanciée des violations de nos statuts et des actes de mouchardage de la FICCI (Fraction Interne du CCI), laquelle trouve aujourd'hui sa continuité dans le GIGC au moyen de changements « programmatiques » qui ne modifient rien à la réalité et l'essence de ce groupe. Rappelons à ce propos qu'à nos yeux, le GIGC, pour être un groupe policier[4], ne fait pas partie du milieu politique prolétarien et encore moins de la Gauche communiste[5].
Le GIGC prétend enfin que le CCI introduirait la division et le sectarisme au sein du camp prolétarien. Toute notre pratique illustre tout le contraire : nous sommes pour une confrontation politique fraternelle mais sans concessions des divergences en sein du milieu politique prolétarien et pour un travail en commun chaque fois que possible, …. Mais tout cela ne peut ni ne doit éluder la nécessaire défense de ce même milieu, notamment à travers le combat contre les mouchards, les aventuriers et les agents de l’État. Nous incitons les lecteurs qui auraient des doutes sur cette question à se référer à l'histoire même du mouvement ouvrier, notamment les combats passés engagés par les révolutionnaires pour exposer les corps parasites en leur sein, comme l'Alliance de Bakounine au sein de l'Association Internationale des Travailleurs, les agents de l'État comme Vogt (auquel Marx a dédié un an de travail sur un livre le démasquant)[6], les aventuriers comme Lassalle et Schweitzer dans la social-démocratie Allemande[7]. Nous nous situons dans cette tradition en dénonçant la FICCI et son avorton, le GIGC [8].
Si le GIGC essaie ici de faire passer la défense intransigeante du milieu prolétarien pour une politique sectaire de division, c'est fondamentalement pour tenter de se blanchir en tant que mouchards, qui n’ont pas hésité à apporter leur soutien à l'indéfendable aventurier Gaizka[9]. Nous appelons à ce propos à la lecture d'un article récent rendant compte de discussions avec la TCI à propos de la question suivante : "un aventurier doit-il être exposé publiquement ?" [10].
Une nouvelle charge fallacieuse contre notre plateforme programmatique
- Selon le GIGC, le CCI esquiverait les critiques à sa plateforme : "Face à notre critique sur tel ou tel point de la plateforme, le CCI nous renvoie aussi à d’autres articles pour établir nos "mensonges et calomnies" (…) Il ne défend pas le point de la plateforme en question, ni ne l’explicite, mais se réfère à un autre texte". Mensonge aisément vérifiable : dans notre article ainsi critiqué[11] par le GIGC,[12] à propos du parlement et du parlementarisme, nous avons effectivement indiqué avoir publié les Thèses de Lénine sur la démocratie. En quoi ceci constitue-t-il la preuve d'une esquive de la critique, vu que, dans le même article, contrairement aux affirmations du GIGC, nous rappelions, citation à l'appui, ce que dit effectivement notre plateforme et qui invalide le reproche de conseillisme qui lui est faite[13]. Nous ajoutions à cette citation du point concerné de notre plate-forme le commentaire suivant : « Ainsi l'idée que ce point de notre plateforme ne prend pas en compte la fonction du Parlement dans la nouvelle période relève de cette démarche, "calomniez, calomniez, il en restera toujours quelque chose" (F. Bacon), quelle que soit l'inconsistance de la calomnie ». Pourtant, dans son article suivant, le GIGC[14] reprend exactement la même critique à l'encontre du même point de notre plateforme avec les mêmes "arguments". Un simple copier-coller ! A l’évidence, la calomnie n'exclut pas le gâtisme !
- Une "preuve" du conseillisme du CCI fabriquée de toute pièce. Pour le GIGC, notre plateforme comprendrait « la thèse centrale de l’économisme et du conseillisme » qui "réduit le rôle du parti à un simple conseiller ou éclaireur de la classe" que "Lénine combattit à raison dans Que faire et que le CCI dut à son tour combattre en son sein dans les années 1980". Le GIGC exhibe, telle un trophée, la preuve accablante de notre conseillisme qui se cacherait derrière la citation suivante : "La conscience de la classe se forge à travers ses luttes, elle se fraye un chemin difficile à travers ses succès et ses défaites". On peut prouver ce que l’on veut avec une phrase sortie de tout contexte. Or bien évidemment, cette phrase n’est pas isolée mais doit être replacée dans le contexte du point concerné de la plateforme :
- Le point au sein duquel a été extrait le passage incriminé, est relatif au rôle des conseils ouvriers : « La forme d'organisation que se donne la classe dans sa lutte révolutionnaire et pour l'exercice de son pouvoir politique est celle des Conseils Ouvriers. Mais si c'est l'ensemble de la classe qui est le sujet de la révolution et qui se regroupe donc dans ces organes au moment de celle-ci, cela ne signifie pas pour autant que le processus de sa prise de conscience soit simultané et homogène. La conscience de la classe se forge à travers ses luttes, elle se fraye un chemin difficile à travers ses succès et ses défaites. »
- Le point de la plateforme qui lui succède traite directement de l'importance du parti pour la victoire de la révolution : "L'organisation des révolutionnaires (dont la forme la plus avancée est le parti) est un organe nécessaire que la classe se donne pour le développement de la prise de conscience de son devenir historique et pour l'orientation politique de son combat vers ce devenir. De ce fait l'existence du parti et son activité constituent une condition indispensable pour la victoire finale du prolétariat." (point 16 c - Les rapports entre la classe et l'organisation des révolutionnaires).
Bref, il s’agit donc ici d’un collage maladroit, d'un montage malhonnête et d’une nouvelle arnaque du GIGC. Le CCI un menteur ? un examen concret de la réalité l'infirme et elle confirme que le GIGC est un faussaire.
- Selon une autre accusation du GIGC nous mentirions lorsque que nous disons ne nous être jamais considérés comme étant un parti (ou un parti en miniature). Le GIGC pointe vers deux citations du CCI où figure l'expression "squelette du futur parti" et qui sont censées illustrer un tel mensonge de notre part. D’abord, le rapport avec les accusations de conseillisme avancées jusqu’alors dans l’article du GIGC, est curieux, puisqu’en quelque sorte, on accuse à présent le CCI exactement du contraire, c’est-à-dire de se considérer dès à présent comme le parti. En fait, il ne faut pas chercher de cohérence politique, puisque, comme nous le soulignons depuis le début, le but recherché n'est autre que de calomnier et de mettre en doute notre honnêteté politique.
Ici , le GIGC identifie, pour les besoins d'une nouvelle entourloupe, rien de moins que "le squelette de l'organisation" avec "l'organisation dans son ensemble". En politique, comme en anatomie, rien n'est plus absurde. Se considérer comme le "squelette du futur parti" ne peut en rien signifier se considérer comme le "parti", ni même comme le "parti en miniature".
Par ailleurs, un examen sur notre site web de tous les passages de nos textes où figure la formulation « le squelette du futur parti » nous montre que l’expression fut avancée pendant une brève période, mais clairement remise en cause par la suite :
- "Nous avons souvent affirmé qu’une des tâches des révolutionnaires était de constituer un pôle de regroupement de l’avant-garde prolétarienne. Il nous faut aujourd’hui comprendre que nous avons à constituer l’axe, le "squelette" du futur parti mondial du prolétariat" (Rapport sur la question de l’organisation de notre courant international [817] ; Revue internationale 1, 1975). Il s'agissait donc d'une perspective que le CCI s'était donnée à un moment de son existence mais qui était encore loin d'être réalisée.
- "Il est de plus en plus clair que le parti du futur ne sera pas le produit d'une addition "démocratique" de différents groupes du milieu, mais que le CCI constitue déjà le squelette du futur parti. Mais pour que le parti devienne chair, le CCI doit prouver qu'il est à la hauteur de la tâche imposée par le développement de la lutte de classe et l'émergence de la nouvelle génération d'éléments en recherche." (Résolution sur la situation internationale [675] du 16e Congrès du CCI (2005, Revue internationale 122)
- "Le congrès a discuté et repris à son compte une critique contenue dans le rapport sur les contacts concernant la formulation suivante contenue dans la résolution sur la situation internationale du 16e congrès du CCI : "le CCI constitue déjà le squelette du futur parti". Mais l'article de bilan de ce congrès revient sur cette formulation : "Il n'est pas possible de définir dès à présent la forme que prendra la participation organisationnelle du CCI à la formation du futur parti puisque cela dépendra de l'état général et de la configuration du nouveau milieu mais aussi de notre propre organisation." ( article bilan du 19e congrès du CCI [818](2011, Revue internationale 146)
En résumé, Les textes cités établissent clairement que le CCI ne s'est jamais considéré comme un parti, mais qu’il se considère comme un groupe politique ayant une "fonction similaire à celle d'une fraction", chargé d'œuvrer à la fondation du futur parti, tout en constituant un pont vers celui-ci[15]. En conclusion, nous avons, là encore, une nouvelle confirmation que le GIGC agit comme un faussaire, mais les ficelles qu'il utilise sont de plus en plus grosses.
- Le GIGC à la rescousse du syndicalisme : nous dénonçons avant tout le GIGC en tant que corps parasite politique et groupe de voyous qui tente de se faire passer pour une organisation de la Gauche communiste tout en centrant sur son action destructrice et calomniatrice contre cette Gauche communiste. Cela ne nous dispense pas de mettre en évidence certaines de ses positions qui appuient sournoisement celles de l'extrême gauche du capital, notamment sur la question syndicale.
Que signifie réellement cette idée, défendue par le GIGC et critiquée dans notre article précédent, selon laquelle le passage des syndicats dans le camp bourgeoisie a été "le produit d’un rapport de forces entre classes" se jouant au sein de ces organes ?
Notre dernier article rejette cette vision en montrant qu'elle revient à défendre qu’ "il existe la possibilité pour la classe ouvrière de maintenir les syndicats en tant qu'arme de sa lutte au moyen d'un combat engagé en leur sein" ! Face au ferme rejet d'une telle méthode d'analyse propre au gauchisme, le GIGC évacue le problème[16] en accordant à chacun le droit de penser ce qu'il veut : "Pour notre part, aucune indignation, ni scandale au mensonge ou à la calomnie ici. Le CCI et d’autres ont tout à fait le droit de penser cela et nous sommes prêts à en débattre." En fait, sa nouvelle théorie sur la question syndicale se marie comme cul et chemise avec sa dépréciation de la contribution de la révolution allemande, qui a précisément mis en évidence le caractère bourgeois des syndicats dans la période de décadence du capitalisme. Cette position du GIGC est une contribution supplémentaire à la confusion politique.
Le GIGC range son article « L’impasse politique du Courant Communiste International [819] (septembre 23) » dans la rubrique de son site intitulée "Lutte contre l'opportunisme", considérant par là-même que, tant notre plateforme que notre organisation, sont opportunistes. Pourtant à l'époque où il s'appelait FICCI, ses membres se prétendaient être les meilleurs défenseurs de la plateforme du CCI, dont le CCI « opportuniste » n’était plus capable d’assumer la défense. Mais voilà que notre plateforme est devenue opportuniste aux yeux du GIGC ! Une incohérence de plus du GIGC, qui ne doit pas masquer que, malgré toutes ses contradictions, il existe une cohérence à sa politique : peu lui importe la plateforme qu'il fait mine de défendre ou qu'il attaque ouvertement, l'essentiel est d’arriver à calomnier et décrédibiliser le CCI.
En conclusion de son texte il déclare que « la confrontation des différentes positions et leur clarification méritent mieux que les insultes et autres dénégations stupides du CCI ». Mais l’ensemble des points traités précédemment réfutent les « contributions à la clarification » dont il s’enorgueillit dans son dernier texte (comme tous les précédents). D’ailleurs, le problème fondamental avec le GIGC ne réside pas dans ses « contributions » politiques ou dans sa critique de celles du CCI, mais se situe fondamentalement dans le fait qu’il constitue un parasite politique au sein du milieu politique prolétarien. Ses prétendus arguments sont des subterfuges ou des mensonges visant à semer le trouble dans ce milieu et à calomnier ses organisations. Mais à force de fourberies il se prend les pieds dans le tapis et alors, pour se tirer d’affaire, il en appelle au débat !
CCI, 30 décembre 2023
[Retour à la série : Le parasitisme politique n'est pas un mythe, le GIGC en est une dangereuse expression [634]]
[1] À travers l'article L’impasse politique du Courant Communiste International [819] (septembre 23)
[2] La pseudo-"critique" de la plateforme du CCI par le GIGC - Un simulacre d’analyse pour discréditer le CCI et sa filiation politique (la Gauche communiste) [617] (août 23)
[3] La citation suivante de notre rapport ne pouvait pourtant pas manquer de susciter la réflexion et le sens du combat politique de tout marxiste conséquent : "Pour ceux qui nous traitent "d'idéalistes", c'est un véritable scandale que d'affirmer qu'un facteur d'ordre idéologique, l'absence d'un projet dans la société, puisse impacter de façon majeure la vie de celle-ci. En réalité, ils font la preuve que le matérialisme dont ils se revendiquent n'est autre qu'un matérialisme vulgaire déjà critiqué en son temps par Marx, notamment dans les Thèses sur Feuerbach. Dans leur vision, les forces productives se développent de manière autonome. Et le développement des forces productives est seul à dicter les changements dans les rapports de production et les rapports entre les classes."
[4] Lire à ce propos Questions d'organisation I : la première internationale et la lutte contre le sectarisme [654] ; II : la lutte de la première internationale contre l' « alliance » de Bakounine [820] ; III : le congrès de La Haye de 1872 : la lutte contre le parasitisme politique [653] ; IV : la lutte du marxisme contre l'aventurisme politique [821].
[5] Il importe à ce sujet de relever comment le GIGC tente d'invalider la qualification que nous en faisons, un groupe policier, en invoquant le fait que certains de ses membres n'ont jamais appartenu à la FICCI (voir note de bas de page 5 de l'article du GIGC). Que certaines positions politiques aient changé, que des nouveaux membres soient arrivés, la raison d'être de la FICCI n'a pas changé pour autant, car elle est toujours portée par les éléments exclus de notre organisation notamment pour avoir publié un document interne de 114 pages, reproduisant de nombreux extraits des réunions de notre organe central international, avec la mention des noms des militants, soi-disant pour étayer leurs accusations contre le CCI. Ce document qui livrait consciemment à la police des informations sensibles permettant de favoriser le travail de celle-ci, démontrait en réalité, leur haine contre notre organisation.
Qu'est-ce qui change avec le GIGC ? : "À peine né, ce petit avorton dénommé “Groupe international de la Gauche communiste” lance son cri primal en déchaînant une propagande hystérique contre le CCI, comme en témoigne le placard publicitaire affiché sur son site Web : “Une nouvelle (ultime ?) crise interne dans le CCI !” accompagné bien sûr d’un “Appel au camp prolétarien et aux militants du CCI”. Ce prétendu “Groupe international de la Gauche communiste” sonne le tocsin et crie à tue-tête qu’il est en possession des Bulletins internes du CCI. En exhibant leur trophée de guerre et en faisant un tel tintamarre, le message que ces mouchards patentés cherchent à faire passer est très clair : il y a une “taupe” dans le CCI qui travaille main dans la main avec l’ex-FICCI ! C’est clairement un travail policier n’ayant pas d’autre objectif que de semer la suspicion généralisée, le trouble et la zizanie au sein de notre organisation. Ce sont les mêmes méthodes qu’avait utilisées le Guépéou, la police politique de Staline, pour détruire de l’intérieur le mouvement trotskiste des années 1930" (Communiqué à nos lecteurs: le CCI attaqué par une nouvelle officine de l’État bourgeois [822].)
[6] Voir El caso Vogt: el combate de los revolucionários contra la calumnia I [823] et El caso Vogt: el combate de los revolucionários contra la calumnia II [824]
[7] Lassalle et Schweitzer: la lutte contre les aventuriers politiques dans le mouvement ouvrier [657].
[8] Voir note 5.
[9] Lire notre articles L'aventurier Gaizka a les défenseurs qu'il mérite : les voyous du GIGC [244]. (février 2021)
[11] La pseudo "critique" de la plateforme du CCI par le GIGC - Un simulacre d’analyse pour discréditer le CCI et sa filiation politique (la Gauche communiste)
[12] Dans "Prise de position sur la plateforme du Courant Communiste International [635]". Révolution ou guerre n° 18. Mai 2021.
[13] La plateforme du CCI ne se limite pas à invoquer "la seule impossibilité de réforme dans la décadence" pour fonder le fait que le parlement ne pouvait plus être utilisé par le prolétariat. En effet, elle dit : "La seule fonction qu'il [le parlement] puisse assumer, et qui explique son maintien en vie, est une fonction de mystification. Dès lors, prend fin toute possibilité, pour le prolétariat, de l'utiliser de quelque façon que ce soit. En effet, il ne peut conquérir des réformes devenues impossibles à travers un organe qui a perdu toute fonction politique effective. À l'heure où sa tâche fondamentale réside dans la destruction de l'ensemble des institutions étatiques bourgeoises et donc du Parlement, où il se doit d'établir sa propre dictature sur les ruines du suffrage universel et autres vestiges de la société bourgeoise, sa participation aux institutions parlementaires et électorales aboutit, quelles que soient les intentions affirmées par ceux qui la préconisent, à insuffler un semblant de vie à ces institutions moribondes" (point 8 de la plateforme du CCI. La mystification parlementaire et électorale)."
[14] L’impasse politique du Courant Communiste International [819] (septembre 23) Révolution ou guerre n° 25, rubrique "Lutte contre l'opportunisme".
[15] Rapport sur le rôle du CCI en tant que "Fraction" [630], Revue internationale 156
[16] À travers l'article L’impasse politique du Courant Communiste International [819] (septembre 23)
Vie du CCI:
Personnages:
Courants politiques:
Rubrique:
Réunion publique à Madrid: L’inestimable contribution de “Bilan” à la lutte pour le parti mondial du prolétariat
- 124 lectures
Le 27 janvier, le CCI a tenu une réunion publique à Madrid, en présentiel et en ligne, sur la contribution de Bilan à la lutte pour le parti mondial du prolétariat. Ce n’était pas un appel à discussion dans le vide, car nous avons pu constater qu’il existe un intérêt pour Bilan dans le milieu politique qui s’était déjà exprimé auparavant à deux reprises à Madrid.
Pourquoi organisons-nous une réunion publique sur “Bilan” ?
Les organisations communistes d’aujourd’hui ne sont rien sans leur pleine inscription dans la continuité historique critique des organisations communistes du passé. Nous revendiquons deux maillons de cette continuité : Bilan et Internationalisme.(1) Comme nous le disions dans l’annonce de la réunion publique : « le prolétariat a besoin de son parti mondial et pour le former, lorsque ses luttes atteindront une force internationale massive, sa base sera la Gauche communiste dont nous nous réclamons […] La réunion publique que nous proposons vise à susciter un débat afin de dresser un bilan critique de la contribution de Bilan, pour apprécier là où Bilan est pleinement valable, là où il faut le critiquer, là où il faut aller plus loin. Ses forces, ses erreurs, son expérience organisationnelle et théorique sont des matériaux indispensables à la lutte des révolutionnaires d’aujourd’hui ».
Nous invitons les lecteurs à poursuivre le débat par des contributions ou en participant aux réunions publiques et permanences du CCI.
La continuité historique critique du marxisme
Un participant a engagé le débat en déclarant que le marxisme est quelque chose de dogmatique, d’immuable. Pour lui, le marxisme ne doit pas prendre en compte l’évolution de la situation historique mais doit rester figé et bloqué sur des positions affirmées dès les origines du marxisme. Il s’est lui-même qualifié à cet égard de « sclérosé » et même de « trapézoïde » et est allé jusqu’à dire que seuls les morts changent. Les participants sur place et ceux qui ont participé par Internet ont avancés les arguments suivants contre ce point de vue :
– Dans le marxisme il y a des positions de base et des principes qui ne changent pas et ne changeront pas : que la lutte des classes est le moteur de l’histoire, que la lutte de classe du prolétariat est la seule qui puisse mener au communisme, que chaque mode de production, et donc aussi le capitalisme, connaît une époque ascendante et une époque de décadence, que la destruction du capitalisme est nécessaire pour construire le communisme, que la constitution d’un parti mondial est indispensable pour le prolétariat, que le marxisme joue un rôle moteur dans le développement de la conscience de classe, etc.
– Cependant, à partir de ces fondations qui constituent son socle, le marxisme se développe en répondant aux nouveaux problèmes posés par l’évolution du capitalisme et de la lutte de classe, mais aussi en corrigeant les éventuelles erreurs, insuffisances ou limitations liées à chaque époque historique. Cette approche est fondamentale en science, mais elle est plus vitale encore pour le prolétariat qui doit, en tant que classe à la fois exploitée et révolutionnaire, développer son combat pour le communisme en se frayant un chemin à travers d’innombrables erreurs et faiblesses, en tirant les leçons de ses luttes et de ses défaites, en critiquant impitoyablement ses erreurs. Il doit d’autant plus développer son combat en s’appuyant sur une démarche pleinement consciente qu’il ne possède rien d’autre que sa force de travail et qu’il ne peut, contrairement aux classes historiques du passé, développer son projet sans détruire de fond en comble le capitalisme comme extirper les racines de toutes les sociétés d’exploitation.
– Cela s’applique également à ses organisations révolutionnaires, qui doivent être capables d’analyser de manière critique les positions antérieures et leurs propres positions. Ainsi, Marx et Engels ont corrigé en 1872, à la lumière de l’expérience de la Commune de Paris, l’idée que l’État devait être repris tel qu’il était à la classe dominante pour mettre en avant la nouvelle leçon historique qui venait d’être si chèrement acquise par le prolétariat : la nécessité absolue de détruire l’État bourgeois antérieur. Lénine, dans les Thèses d’avril, a mis en avant la nécessité de modifier le programme du parti en y intégrant la position de la nature mondiale et socialiste de la révolution et de la prise du pouvoir par les soviets.
C’est une grave irresponsabilité que de rester dogmatiquement accroché à des positions qui ne sont plus valables. Les partis sociaux-démocrates n’ont voulu appréhender ni la décadence du capitalisme, ni les conséquences qui en découlaient : la fin de la possibilité d'arracher par la lutte à ce système d’exploitation des améliorations et des réformes durables, ni la nature de la guerre impérialiste, ni la grève de masse, etc. Cela les a menés à la trahison. L’Opposition de Gauche de Trotsky s’est dogmatiquement cramponnée à la défense inconditionnelle du programme des 4 premiers congrès de l'IC, ce qui l'ont plongée dans l'opportunisme, et ne s’est jamais rattachée à une démarche critique de la vague révolutionnaire de 1917-1924. Finalement, après la mort de Trotsky, le trotskisme a trahi l’internationalisme prolétarien en soutenant un des camps impérialistes en présence au moment de la Seconde Guerre mondiale et est passé ainsi dans le camp bourgeois.
Une organisation prolétarienne qui n’est pas capable d’une évaluation critique impitoyable de sa propre trajectoire et de celle des organisations précédentes du mouvement ouvrier est condamnée à périr ou à trahir. Bilan nous donne la méthode d’une telle évaluation critique dans l’article « Vers une Internationale deux et trois quarts ? » (Bilan n° 1, novembre 1933) en réponse à l’Opposition de Gauche de Trotsky : « À chaque période historique de la formation du prolétariat en tant que classe, la croissance des objectifs du Parti devient évidente. La Ligue des communistes marchait avec une fraction de la bourgeoisie. La première internationale ébauchera les premières organisations de classe du prolétariat. La Deuxième Internationale fondera les partis politiques et les syndicats de masse des travailleurs. La Troisième Internationale réalisera la victoire du prolétariat en Russie.
À chaque période, nous verrons que la possibilité de former un parti est déterminée sur la base des expériences précédentes et des nouveaux problèmes qui se sont posés au prolétariat. La Première Internationale n’aurait jamais pu être fondée en collaboration avec la bourgeoisie radicale. La Deuxième Internationale n’aurait pas pu être fondée sans la notion de la nécessité de regrouper les forces prolétariennes dans des organisations de classe. La Troisième Internationale n’aurait pas pu être fondée en collaboration avec les forces agissant au sein du prolétariat pour le conduire non pas à l’insurrection et à la prise du pouvoir, mais à la réforme graduelle de l’État capitaliste. À chaque époque, le prolétariat peut s’organiser en classe, et le parti peut se fonder sur les deux éléments suivants :
1. la conscience de la position la plus avancée que le prolétariat doit occuper, l’intelligence des nouvelles voies à emprunter.
2. La délimitation croissante des forces qui peuvent agir en faveur de la révolution prolétarienne ».
Ce travail ne se fait pas en partant de zéro, en prenant pour référence les nouveaux développements isolés, ou en examinant les erreurs possibles sans les confronter aux positions antérieures. Il se fait sur la base d’un examen critique rigoureux des positions antérieures, en voyant ce qui est valable, ce qui est insuffisant ou dépassé, et ce qui est erroné, nécessitant l’élaboration d’une nouvelle position. Un participant, attiré par le miroir aux alouettes des théorisations sur « l’invariance du programme communiste », a proposé d’adapter le marxisme aux théories modernes du comportement humain et de la psychologie, en le combinant avec les nouvelles découvertes scientifiques. Cependant, la méthode marxiste n’opère pas un « changement de position », ni ne s’adapte à des idées apparemment nouvelles, mais procède à un développement et à une confrontation rigoureuse de la réalité avec son propre cadre de départ, ce qui l’enrichit et l’emmène beaucoup plus loin.
Sur la répression de la révolte de Kronstadt
Le participant qui se disait « invariant » a qualifié l’écrasement de Kronstadt de « victoire du prolétariat » et justifiait la répression de Kronstadt en disant que le parti doit imposer sa dictature à la classe. Cette position nous a paru être une monstruosité et nous l’avons mise en avant de la façon suivante, avec le soutien et la participation active de plusieurs autres intervenants. La classe ouvrière n’est pas une masse informe à laquelle il faudrait donner des coups de pied ou de trique pour la faire avancer et la « libérer ». Il est évident que derrière cette défense aveugle de la répression de Kronstadt se cache une vision totalement erronée du parti du prolétariat et de sa relation avec la classe. Le parti prolétarien n’est pas, comme les partis bourgeois, un candidat au pouvoir d’État, un parti d’État. Sa fonction ne peut être d’administrer l’État, ce qui altérera inévitablement son rapport à la classe en un rapport de force, alors que son apport consiste à l’orienter politiquement. En devenant un administrateur de l’État, le parti changera imperceptiblement de rôle pour devenir un parti de fonctionnaires, avec tout ce que cela implique comme tendance à la bureaucratisation. Le cas des bolcheviks est tout à fait exemplaire à cet égard.
Selon un point de vue de « bon sens » logique qui survit dans certaines parties du milieu prolétarien : « le parti étant la partie la plus consciente de la classe, la classe doit lui faire confiance, de sorte que c’est le parti qui naturellement et automatiquement prend le pouvoir et l’exerce ». Cependant, « le parti communiste est une partie de la classe, un organisme que, dans son mouvement, la classe engendre et se donne pour le développement de sa lutte historique jusqu’à la victoire, c’est-à-dire jusqu’à la transformation radicale de l’organisation et des rapports sociaux pour fonder une société qui réalise l’unité de la communauté humaine mondiale ». (2) Si le parti s’identifie à l’État, non seulement il nie le rôle historique du prolétariat dans son ensemble au profit d’une conception bourgeoise de la direction de la société, mais il nie aussi son rôle spécifique indispensable au sein du prolétariat pour pousser avec méthode, bec et ongles, le développement de la conscience du prolétariat, non pas dans un sens conservateur, mais dans la perspective de la révolution et du passage au communisme.
De plus, Bilan, tout en agissant avec plus de prudence et de circonspection sur d’autres questions, avait une position très claire dans sa défense des principes prolétariens pour s’opposer fermement au recours à la violence dans le règlement des problèmes et des différends pouvant surgir au sein même de notre classe : « Il peut y avoir une circonstance dans laquelle une partie du prolétariat – et nous accordons qu’elle peut même avoir été prisonnière involontaire des manœuvres de l’ennemi – peut en venir à combattre l’État prolétarien. Comment faire face à cette situation, en partant de la question de principe que le socialisme ne peut pas être imposé par la force ou la violence au prolétariat ? Il valait mieux perdre Kronstadt que de la conserver du point de vue géographique, car, sur le fond, une telle victoire pouvait avoir plus d’un résultat : altérer les bases mêmes, la substance de l’action menée par le prolétariat ». (3)
La révolution mondiale connaîtra de nombreux épisodes compliqués mais pour défendre son orientation et son développement, elle devra défendre fermement les principes fondamentaux dans les actions du prolétariat. L’un d’entre eux est immuable et invariable : il ne peut et ne doit jamais y avoir de rapports de violence au sein de la classe ouvrière, à plus forte raison en agissant en son nom pour exercer et justifier une répression contre une partie d’entre elle, à plus forte raison lorsque celle-ci représente une tentative de défendre la révolution. L’écrasement de Kronstadt a accéléré l’engagement dans la voie menant vers la dégénérescence et la défaite de la révolution en Russie et vers la destruction de la substance prolétarienne détériorée du parti bolchevik.
Tirer des conclusions militantes des réunions publiques
D’autres discussions très intéressantes et polémiques ont eu lieu, et pas seulement à propos des positions supposées « invariantes ». Nous avons insisté sur la différence substantielle entre la méthode organisationnelle, théorique et historique de Bilan par rapport à celle de l’Opposition de Gauche de Trotsky : (4)
- Bilan est resté fidèle au principe de la lutte contre la déformation des principes par l'idéologie bourgeoise. Alors que l'Opposition de gauche se réclamait des Congrès de l'IC qui théorisaient l'opportunisme et faisaient le lit du stalinisme, les fractions de Gauche firent la critique de toutes ces théorisations opportunistes qui se sont manifestées et développées à partir du Deuxième Congrès. Elles ont mené une patiente lutte polémique pour tenter de convaincre le maximum de forces militantes enfermées dans le cadre opportuniste des “tactiques” de l'Opposition de Gauche.
- Bilan a été capable de faire une critique profonde et rigoureuse, qui lui a permis de tirer des leçons sur des positions erronées de l’IC qui ont ensuite conduit cette dernière à la trahison, comme la tactique de Front unique, la défense des luttes de libération nationale, la lutte démocratique, les milices partisanes... lui permettant de préserver la défense de positions révolutionnaires dans la classe pour l'avenir, dans la lignée des positions défendues par la Gauche communiste.
– Son analyse du rapport de forces entre les classes a été vitale pour déterminer la fonction des organisations révolutionnaires lors de cette période, par opposition à « l’influence permanente sur les masses » que l’Opposition cherchait à gagner à tout prix.
Il existe également des différences substantielles entre la conception de Bilan et celle du KAPD allemand, bien que toutes deux s'inscrivent dans le cadre des positions défendues par la Gauche communiste. Le KAPD, et c’était sa très grande faiblesse, ne s’appuyait pas sur une analyse historique, il rejetait même la continuité du lien révolutionnaire de ses positions avec la révolution d'octobre et négligeait totalement la question organisationnelle. En d’autres termes, c’est Bilan qui nous a légué sa vision du travail politique et organisationnel EN TANT QUE FRACTION : « La fraction est l’organe qui permet la continuité de l’intervention communiste dans la classe, même dans les périodes les plus sombres où cette intervention n’a pas d’écho immédiat. Toute l’histoire des fractions de la Gauche communiste le démontre amplement. À côté de la revue théorique “Bilan”, la fraction italienne publiait un périodique en italien, “Prometeo”, dont le tirage en France était supérieur à celui des trotskistes français, pourtant si adeptes du militantisme ». (5) De même, la Fraction a pour rôle essentiel de poser les bases de la construction du futur parti mondial prolétarien et d’être en mesure d’analyser les mesures concrètes à prendre et le moment où il est nécessaire de commencer à lutter pour la formation directe de celui-ci.
Dans le cadre du travail conçu comme celui d’une fraction, tel que le défendait Bilan, la discussion des réunions publiques doit avoir une orientation MILITANTE et ne pas rester un rassemblement où chacun émet sa propre « opinion », sans parvenir à aucun résultat. Cela a été interprété de la part du participant autodéclaré "sclérosé" comme une manifestation de sectarisme du CCI, un mode de discussion et de recrutement sur une base sectaire et, sous ce prétexte, il s'est opposé aux conclusions tirées et a quitté la réunion en trombe avant de les avoir entendues, entraînant après lui le compagnon avec lequel il était arrivé. (6)
Une réunion prolétarienne doit pouvoir tirer des conclusions qui comprennent le rappel des points d’accord et des points de désaccord dans la discussion, délimitant ainsi consciemment où elle est arrivée ou encore les questions abordées sur lesquelles il y a eu des avancées dans la clarification, et établissant un pont vers d’autres discussions à venir. Dans ce sens, nous avons insisté auprès des deux fuyards pour qu'ils restent afin de présenter leurs éventuels désaccords avec les conclusions. Nous n'avons malheureusement pas réussi à les convaincre car, apparemment, leur goût pour l’éclectisme informel est aussi un principe inamovible !
CCI, février 2024
1Nous nous sommes félicités en particulier de la publication en espagnol de onze numéros de Bilan : « La continuidad histórica, una lucha indispensable y permanente para las organizaciones revolucionarias [833] », publié sur le site du CCI em espagnol (2023).
2 « El partido desfigurado: la concepción bordiguista [834] » Revista internacional nº 23 (1980) et « El Partido y sus lazos con la clase [835] », Revista internacional nº 35 (1983).
3 « La question de l’État », Octobre n°2 (1938).
4 « ¿Cuáles son las diferencias entre la Izquierda Comunista y la IVª Internacional? [836] », publié sur le site du CCI (2007).
5 « La relación entre Fracción y Partido en la tradición marxista II – La Izquierda comunista internacional, 1937-1952 » [837]Revista internacional n.º 61 [837].
6 Il est clair qu’ils ont également oublié le principe de la Gauche communiste de lutter jusqu’au bout au sein du milieu prolétarien afin d’en tirer le plus de clarté et d’enseignements possibles. Nous trouvons très étrange qu’ils revendiquent une continuité avec Bilan, alors qu’il aurait été beaucoup plus cohérent et productif pour la lutte de notre classe qu’ils expriment ouvertement leurs désaccords évidents avec Bilan. Au lieu de cela, ils ont préféré éviter la confrontation des arguments.
Vie du CCI:
- Réunions publiques [219]
Conscience et organisation:
- La Gauche Italienne [778]
Courants politiques:
- Gauche Communiste [163]
Rubrique:
Le combat pour le parti de classe en Grande-Bretagne (1848-1914)
- 173 lectures
Sans un parti révolutionnaire, il ne peut y avoir de révolution réussie. Le combat pour le parti révolutionnaire se pose toujours à un niveau international et historique, découlant de la position du prolétariat en tant que classe exploitée à l’échelle internationale et classe révolutionnaire. Mais il est également important d’examiner les conditions spécifiques (à la fois historiques et géographiques) dans lesquelles cette lutte a lieu. Depuis longtemps, les révolutionnaires en Grande-Bretagne sont ainsi confrontés à la faiblesse de la tradition marxiste et à la force des illusions réformistes. Ces particularités ont rendu la lutte pour le parti de classe dans ce pays particulièrement ardue.
La formation du parti de demain repose, en partie, sur la capacité des révolutionnaires d’aujourd’hui à tirer un maximum de leçons de l’expérience du mouvement ouvrier. C’est pourquoi, la série d’articles (initialement publiée dans World Revolution d’octobre 1996 à septembre 2000) que nous rassemblons ci-dessous vise à fournir un cadre pour comprendre les difficultés qui se sont exprimées dans le combat pour le parti de classe au sein du prolétariat en Grande-Bretagne. D’autant que ce dernier possède une longue histoire, et fait partie des plus expérimentés et combatifs, comme le confirment les nombreux mouvements de grève de ces dernières années et qui ont marqué le premier pas d’une véritable reprise internationale de la lutte de classe. Après 40 ans d’atonie, le prolétariat britannique, comme ses frères de classe ailleurs dans le monde, devra poursuivre son combat et se réapproprier les leçons des expériences du passé pour construire le futur parti mondial indispensable à la lutte révolutionnaire.
CCI, 4 mars 2024
Géographique:
- Grande-Bretagne [47]
Histoire du mouvement ouvrier:
Conscience et organisation:
- Les utopistes [839]
- La Ligue Communiste [840]
- La première Internationale [659]
- La Seconde Internationale [117]
Questions théoriques:
- Parti et Fraction [841]
Rubrique:
Partie 1 : Du chartisme à la Ligue socialiste, le développement de l’organisation de la classe ouvrière
- 125 lectures
Dans le Manifeste inaugural de l’Association Internationale des Travailleurs (AIT) de 1864, Marx écrivait à propos du parti et de la classe ouvrière : « Il est un élément de succès que ce parti possède : il a le nombre. Mais le nombre ne pèse dans la balance que s’il est uni par l’association et guidé par la connaissance ». Il résumait ainsi les conditions fondamentales du succès de la lutte du prolétariat. La tâche principale de la classe ouvrière était énoncée tout aussi succinctement : « La conquête du pouvoir politique est devenue le premier devoir de la classe ouvrière ».
Dès son origine, le prolétariat a, en effet, lutté pour défendre ses intérêts, d’abord par des actions dispersées, puis en prenant de plus en plus conscience de sa force par la combinaison de l’action des syndicats et des organisations politiques. Telle fut sa première tâche et l’objectif fondamental de l’AIT, au sein de laquelle prirent place de nombreuses organisations variées et opposées. (1)
À la fin du XIXe siècle, une situation très différente se présenta : l’économie se développait avec une vigueur jamais vue auparavant et la bourgeoisie s’enrichissait. Cette situation tendait à favoriser la lutte du prolétariat et celui-ci vit de réelles améliorations de ses conditions de vie et de ses droits politiques : « Le prolétariat s’affirme comme force sociale dans la société, même en dehors des moments de lutte ouverte. Il y a toute une vie ouvrière au sein de la société : il y a les syndicats (qui sont des “écoles de communisme”), mais il y a aussi des clubs ouvriers où on parle de politique, il y des “universités ouvrières” où l’on apprend aussi bien le marxisme qu’à lire et écrire, (Rosa Luxembourg et Pannekoek furent enseignants dans la social-démocratie allemande), il y a des chansons ouvrières, des fêtes ouvrières où l’on chante, danse et parle du communisme ». (2)
Les partis sociaux-démocrates et les syndicats étaient « les produits et les instruments des combats de cette période ». La social-démocratie « n’a fait que développer et organiser un mouvement réel qui existait bien avant elle, et s’est développé indépendamment d’elle ». (3) Ainsi, l’activité des partis sociaux-démocrates ne constituait nullement une concession à la bourgeoisie (même si des tendances réformistes apparaissaient) mais plutôt l’activité politique nécessaire au prolétariat dans cette étape de sa lutte et du développement du capitalisme alors ascendant. En pratique, la stratégie de la classe ouvrière s’exprimait dans le concept des programmes « minimum » et « maximum », dont Rosa Luxemburg expliquait ainsi le lien : « Selon la conception courante du parti, le prolétariat parvient, par l’expérience de la lutte syndicale et politique, à la conviction de l’impossibilité de transformer de fond en comble sa situation au moyen de cette lutte et de l’inéluctabilité d’une conquête du pouvoir ». (4)
La Grande-Bretagne, berceau du mouvement ouvrier
Dans quelle mesure la situation qui existait en Grande-Bretagne s’inscrivait-elle dans le cadre que nous venons d’esquisser ?
La position de la Grande-Bretagne en tant que premier pays industriel lui a donné un avantage économique qui a duré plusieurs décennies. Cette situation en a également fait le berceau du mouvement ouvrier à travers, notamment, ce que Marx et Engels ont décrit comme le premier parti politique de la classe ouvrière : le chartisme. Les chartistes représentaient la première tentative consciente de la classe ouvrière de s’affirmer sur le terrain politique. Ils considéraient la lutte pour le suffrage universel comme un moyen pour la classe ouvrière d’accéder au pouvoir, ce qui était une expression de l’immaturité de la lutte à ce stade. Le mouvement chartiste s’est éteint après 1848 et, si les syndicats sont restés forts en Grande-Bretagne, ils ont de plus en plus eu tendance à se tourner vers le réformisme et leur influence ne s’est pas répandue au-delà des ouvriers qualifiés. Aucune organisation politique indépendante n’est apparue pour prendre la place des chartistes. Le mouvement ouvrier est devenu, selon la célèbre phrase d’Engels, « la queue du “Grand parti libéral” », (5) ses dirigeants étant des « coquins » « à la solde de la bourgeoisie ». (6)
Le renouveau du mouvement ouvrier
« Après les crises cycliques de croissance qui, presque tous les 10 ans, avaient frappé le système de 1825 à 1873, le capitalisme connaît jusqu’en 1900, près de 30 ans de prospérité quasi ininterrompue ». (7) Cependant, au cours de cette prospérité, des signes de changements majeurs dans l’économie apparaissent, notamment en Grande-Bretagne où un ralentissement de la croissance a entraîné des difficultés pour les capitalistes et des privations pour une partie de la classe ouvrière. Engels a retracé cette évolution en détail et a conclu que le monopole industriel de la Grande-Bretagne était en train de prendre fin, avec de graves conséquences pour la classe ouvrière.
Dans ce contexte, il percevait également le développement de conditions qui exigeaient que la classe ouvrière reprenne le travail de ses prédécesseurs chartistes : « La vérité est la suivante : pendant la période du monopole industriel de l’Angleterre, la classe ouvrière anglaise a, dans une certaine mesure, partagé les bénéfices du monopole. Ces bénéfices ont été très inégalement répartis. La minorité privilégiée a, certes, empoché le plus, mais même la grande masse a bénéficié au moins temporairement d’une part de temps à autre. Et c’est la raison pour laquelle, depuis l’extinction de l’owenisme, il n’y a pas eu de socialisme en Angleterre. Avec l’effondrement de ce monopole, la classe ouvrière anglaise perdra cette position privilégiée ; elle se retrouvera généralement (à l’exception de la minorité privilégiée et dirigeante) au même niveau que ses collègues étrangers. Et c’est la raison pour laquelle il y aura à nouveau des socialistes en Angleterre ». (8) Engels cherchait à éclairer ce renouveau par une série d’articles dans le Labour Standard, dans lesquels il défend l’importance des syndicats, mais montre aussi leurs limites et plaide pour la création d’un parti ouvrier indépendant. Dix ans plus tard, après avoir assisté à la célébration du 1er mai à Londres, il déclare que « le 4 mai 1890, le prolétariat anglais, se réveillant de quarante ans d’hibernation, a rejoint le mouvement de sa classe ». (9)
Le nouveau syndicalisme
La raison fondamentale de ce changement réside dans la résurgence de la lutte des classes, marquée notamment par une série de grèves victorieuses parmi les travailleurs non qualifiés. Ces grèves ont permis non seulement d’augmenter les salaires, mais aussi de réduire considérablement la durée de la journée de travail. Engels attache une importance particulière à la participation des ouvriers de l’East End de Londres à ces grèves : « Si ces hommes opprimés, la lie du prolétariat, ces hommes à tout faire, se battant tous les matins aux portes des docks pour être engagés, s’ils peuvent combiner et terrifier par leur résolution les puissantes compagnies de dockers, alors vraiment nous ne devons désespérer d’aucune partie de la classe ouvrière ». (10)
Les nouveaux syndicats créés par ces ouvriers pour mener leurs batailles étaient fortement influencés par des socialistes comme Eleanor Marx et Edward Aveling et par des membres de la Fédération sociale-démocrate comme Will Thorne et, en tant que tels, ils différaient nettement des anciens syndicats d’ouvriers qualifiés dont les dirigeants étaient encore liés au parti libéral.
Social Democratic Federation, première organisation marxiste
Au début des années 1880, il n’existe aucune organisation révolutionnaire significative en Grande-Bretagne. Quelques survivants du chartisme et de l’owenisme continuent à se réunir, de petits groupes locaux de socialistes vont et viennent, tandis qu’à Londres, des révolutionnaires exilés d’Allemagne et d’Autriche se regroupent et parviennent même à publier un journal hebdomadaire : Freiheit.
En 1881, une réunion de divers groupes radicaux aboutit à la fondation de la Fédération démocratique sous la direction de Henry Meyers Hyndman, qui se considérait comme un socialiste. La Fédération s’élargit progressivement et attire de nouveaux membres, tels que William Morris, Edward Aveling, Eleanor Marx et Ernest Belfort Box, qui cherchent à la faire évoluer vers le socialisme. En 1884, ces efforts aboutissent à ce que la Fédération soit rebaptisée « Social Democratic Federation » (SDF).
Le programme de la fédération appelle à « la socialisation des moyens de production, de distribution et d’échange, qui seront contrôlés par un État démocratique dans l’intérêt de l’ensemble de la communauté, et l’émancipation complète du travail de la domination du capitalisme et de la propriété foncière, avec l’établissement de l’égalité sociale et économique entre les sexes ». (11) Des points particuliers exigeaient des réformes sur le temps de travail, dans l’emploi des enfants, en faveur d’une éducation gratuite et pour une armée citoyenne. Un journal hebdomadaire, Justice, est lancé et des réunions publiques hebdomadaires sont organisées. Engels considérait cette formation comme opportuniste, lancé sans préparation financière ou littéraire suffisante et écrit par des gens « qui prennent en main la tâche d’instruire le monde sur des sujets dont ils sont eux-mêmes ignorants ». (12) Engels reprochait surtout à la SDF de ne pas comprendre la classe ouvrière ou de ne pas avoir de relations avec elle. Ceci est illustré par l’attitude d’Hyndman à l’égard des syndicats et des grèves que ce dernier décrit comme « différentes formes d’agitation liées à l’ignorance de la classe ouvrière, ou des révoltes désespérées contre une oppression supportable [qui] ne servent qu’à resserrer plus fermement sur leurs membres, les chaînes peut-être un peu dorées de l’esclavage économique ». (13) Le fait qu’il n’y ait aucune reconnaissance du rôle des syndicats dans le développement de la conscience et de l’auto-organisation de la classe ouvrière, qu’Engels avait exposé dans les articles du Labour Standard, reflète de la part d’Hyndman une conception de la classe ouvrière comme une masse inerte qui pouvait réagir aux événements mais qui avait besoin de la direction de leaders (comme lui) pour réaliser quelque chose de constructif. Cela devait être accompli par la propagande et, surtout, par la participation aux élections.
Hyndman, un aventurier du mouvement ouvrier
Si d’autres socialistes de l’époque partagent son schématisme, les efforts d’Hyndman pour manipuler le mouvement ouvrier afin de favoriser sa propre carrière et, surtout, de se faire une place dans l’histoire en tant que « père du socialisme britannique », ont fait de lui un aventurier.
Hyndman avait auparavant été un entrepreneur, se lançant dans le journalisme en Australie, le tourisme en Polynésie et la spéculation financière en Amérique. Au début de l’année 1880, il se trouve en Grande-Bretagne, à la recherche d’un point d’ancrage dans la politique. Il fait la promotion d’un renouveau radical du Parti conservateur auprès du Premier ministre Disraeli et se présente en tant que Tory indépendant aux élections de mars de la même année, au cours desquelles il déclare son opposition à l’autonomie irlandaise, son soutien aux colonies et à une augmentation des effectifs de la marine. (14) Il s’est finalement « converti » au marxisme après avoir lu Le Capital de Marx lors d’un voyage en Amérique suite à l’échec de ces efforts. À son retour, il cherche à rencontrer Marx et, selon les mots de ce dernier, « s’est introduit chez moi ». (15) Lors de la fondation de la SDF, la plateforme programmatique de l’organisation (intitulée « L’Angleterre pour tous » et rédigée par Hyndman) fut distribuée à tous les participants. De grandes parties de ce texte ont été extraites du Capital à l’insu de Marx et sans son consentement, et contiennent des erreurs et des imprécisions. Face aux critiques de Marx, Hyndman s’excusa au motif que « les Anglais n’aiment pas à apprendre chez les étrangers » et que « beaucoup ont horreur du socialisme », ou encore que « le nom de Marx est exécré ». (16) Repoussé par Marx, Hyndman tente d’amadouer Engels, mais ce dernier refuse tout contact tant que la situation avec Marx n’est pas réglée et reste par la suite très critique envers Hyndman.
Cette attitude est souvent présentée comme une animosité personnelle, découlant de la défense de son ami par Engels. En réalité, elle découle d’une analyse politique que Marx et Engels partageaient. Marx résume son point de vue dans la lettre à Sorge que nous avons déjà citée : « Tous ces aimables écrivains de la classe moyenne […] ne pensent qu’à s’enrichir, se faire un nom ou acquérir une influence politique le plus rapidement en se faisant les chantres d’une pensée nouvelle qu’ils ont pu acquérir par une quelconque aubaine favorable. Ce type m’a fait perdre beaucoup de temps par des virées nocturnes où il apprenait de la façon la plus simple qui soit ». Dans les années qui suivirent, Engels, avec l’avantage d’une connaissance plus approfondie, a pu identifier Hyndman assez précisément comme un carriériste et un aventurier. (17)
La naissance de la Ligue socialiste
Dès le début, des tensions apparurent au sein de la SDF causées en grande partie par l’attitude dictatoriale d’Hyndman, mais aussi du fait de différents politiques dont, en particulier, l’accent exclusif attribué au travail dans le Parlement et au nationalisme persistant d’Hyndman.
Les tensions se transformèrent par la suite en lutte ouverte lorsque les manœuvres d’Hyndman en Écosse furent découvertes. Celles-ci comprenaient des tentatives de diffamation à l’encontre d’Andreas Scheu, l’un des adversaires les plus implacables d’Hyndman, et l’envoi de lettres au nom de l’exécutif du parti, non approuvées par ce dernier et qui allaient même à l’encontre de ses décisions. Hyndman fit également circuler des rumeurs selon lesquelles Eleanor Marx et Laura Lafargue (deux des filles de Karl Marx) avaient comploté contre lui. Lors d’une réunion de l’exécutif, les preuves contre Hyndman furent présentées et une motion de censure fut adoptée de peu. La courte majorité, qui comprenait Morris, Aveling, Eleanor Marx et Bax, démissionna alors de l’exécutif pour former la Ligue socialiste : « puisqu’il nous semble impossible de guérir cette discorde, nous […] pensons qu’il est préférable dans l’intérêt du socialisme de cesser d’appartenir au conseil ». (18) Pour Engels, deux autres raisons ont poussé la majorité à cette décision : la possibilité que Hyndman revienne sur ce vote lors d’une conférence ultérieure en la remplissant de délégués fictifs et le fait « que toute la Fédération n’était, après tout, pas mieux qu’un racket ».
Cependant, la conséquence fut que Hyndman resta en sécurité au sein de l’exécutif et continua à contrôler le journal et toutes les branches de la SDF.
Dès le départ, cette situation plaça la Ligue socialiste dans une position de faiblesse, mais permis néanmoins une avancée significative par rapport à la SDF dans un certain nombre de domaines :
– elle rejetait tout nationalisme et chauvinisme, déclarant fermement la nécessité de l’internationalisme : « La Ligue socialiste […] vise à la réalisation d’un socialisme révolutionnaire complet, et sait bien que cela ne pourra jamais se produire dans un pays sans l’aide des travailleurs de toutes les civilisations » ; (19)
– elle défendait la participation active, consciente, de la classe ouvrière à la révolution : « Le mécontentement ne suffit pas […]. Les mécontents doivent savoir ce qu’ils visent. [Cela] doit être, non pas une révolution ignorante, mais une révolution intelligente » ; (20)
– elle adopte une vision plus réaliste du travail à accomplir, en publiant son journal, The Commonweal, de façon mensuelle plutôt qu’hebdomadaire : « Ils vont enfin opérer modestement et conformément à leurs capacités, et ne pas continuer à prétendre que le prolétariat anglais doit instantanément sauter dès que la trompette est sonnée par quelques littérateurs convertis au socialisme ». (21)
Cependant, la Ligue était également marquée par des faiblesses importantes, qui provenaient essentiellement de son incapacité à lier la lutte pour la révolution aux intérêts immédiats de la classe ouvrière. C’était déjà le cas avec la SDF, mais la Ligue socialiste alla encore plus loin, rejetant finalement toutes les réformes, en particulier la participation aux élections, au nom d’une révolution pure et simple. Si on peut attribuer en partie cela au dégoût des fondateurs face aux manœuvres de Hyndman, cela reflète plus fondamentalement leur isolement et leur manque de compréhension de la classe ouvrière. Engels le souligne lorsqu’il décrit Aveling, Bax et Morris comme « trois hommes aussi peu pratiques, deux poètes et un philosophe, qu’il est possible de trouver ». (22)
La deuxième partie de cette série examinera le développement de la SDF et de la Ligue socialiste à la fin des années 1880 et leur relation avec le mouvement ouvrier au sens large.
Publié pour la première fois dans World Revolution n° 198 (octobre 1996).
>>> Retour à l’introduction et au sommaire [842]
1Cf. « La Première Internationale et la lutte contre le sectarisme [654] », Revue internationale n° 84 (1996).
2« Comprendre la décadence du capitalisme (partie 3) : la nature de la social-démocratie [843] », Revue internationale n° 50, (1987).
3Ibid.
4Rosa Luxemburg, Réforme sociale ou Révolution (1898-1899).
5Marx et Engels « Un parti des travailleurs », Collected works vol. 24 (traduit par nous).
6Marx et Engels « Engels à Sorge » et « Engels à Wilhelm Liebknecht », Collected works vol. 45 (traduit par nous).
7« Comprendre la décadence du capitalisme (partie 3) : la nature de la social-démocratie [843] », Revue internationale n° 50, (1987).
8Marx et Engels « L’Angleterre en 1845 et en 1885 », Collected works vol. 26 (traduit par nous).
9Marx et Engels « Le 4 mai à Londres », Collected works vol. 27 (traduit par nous).
10Marx et Engels « À propos de la grève des dockers de Londres », Collected works vol. 26 (traduit par nous).
11Traduit par nous.
12Marx et Engels « Engels à Laura Lafargue, février 1884 », Collected works vol. 46 (traduit par nous).
13Cité dans F.J. Gould, Hyndman : Prophet of Socialism (traduit par nous).
14« The special heritage of our working class », cité par E.P. Thompson, in William Morris : Romantic to Revolutionary (traduit par nous).
15Marx et Engels « Marx à Sorge, décembre 1881 », Collected works vol. 46 (traduit par nous).
16Marx et Engels « Marx à Hyndman, juillet 1881 », Collected works vol. 46 (traduit par nous).
17Marx et Engels « Engels à Bernstein, décembre 1884 », Collected works vol. 47.
18Cité par Thompson, op.cit (traduit par nous).
19« Manifesto of the Socialist League », cité par Thompson, op.cit (traduit par nous).
20William Morris, cité par Thompson, op.cit (traduit par nous).
21Marx et Engels « Engels à Bernstein, décembre 1884 », Collected works vol. 47 (traduit par nous).
22Ibid. (traduit par nous).
Géographique:
- Grande-Bretagne [47]
Conscience et organisation:
- Les utopistes [839]
- La Ligue Communiste [840]
- La première Internationale [659]
- La Seconde Internationale [117]
Evènements historiques:
Questions théoriques:
- Parti et Fraction [841]
Rubrique:
Partie 2 : Le rôle de la Fédération sociale-démocrate
- 92 lectures
Dans la première partie de cette série d’articles [845], nous avons examiné le renouveau progressif du mouvement ouvrier en Grande-Bretagne au début des années 1880. Nous avons cherché à le situer à la fois dans le contexte général du développement du mouvement prolétarien international et dans les conditions spécifiques prévalant en Grande-Bretagne. Les conditions objectives d’un tel renouveau, comme l’a montré Engels, se sont développées au cours des années 1880 et se sont manifestées par une recrudescence de la lutte de classe, en particulier vers la fin de la décennie.
Cependant, le développement des conditions subjectives (la création d’une organisation prolétarienne capable de rallier et de diriger la classe ouvrière) s’avéra beaucoup plus difficile. Notre article a retracé l’émergence de la Fédération sociale-démocrate (Social Democratic Federation – SDF) en 1884 sous la direction de l’aventurier Hyndman et a montré comment il a manœuvré pour asseoir sa position et défaire ceux qui s’opposaient à son règne dictatorial et à ses positions chauvines. Nous avons conclu cette première partie par la scission de William Morris, Belfort Bax, Eleanor Marx et Edward Aveling qui fondèrent la Ligue socialiste fin 1884.
Nous reviendrons sur l’évolution de la Ligue socialiste dans une prochaine partie, mais dans le présent article, nous examinerons de plus près la méthode de la SDF dans la seconde moitié des années 1880 et montrerons comment, sous la direction de Hyndman, elle a œuvré à maintes reprises contre le développement du mouvement ouvrier, en renforçant les tendances au sectarisme et à l’isolement en discréditant le socialisme aux yeux de la classe ouvrière.
Quel type d’organisation ?
Pour comprendre le rôle joué par la SDF et la faction de Hyndman en particulier, il faut commencer par examiner le type d’organisation dont le prolétariat avait besoin pour se défendre et faire avancer ses intérêts à la fin du XIXe siècle. C’est sur la base de ces critères que le rôle de la SDF doit être évalué.
Le développement rapide du capitalisme à cette époque a confronté le prolétariat à une bourgeoisie qui tend à devenir plus forte et plus unifiée. Pour lutter efficacement, la classe ouvrière devait répondre de la même manière, en forgeant un instrument avec une base programmatique et organisationnelle claire, qui reconnaissait le lien entre les luttes immédiates de la classe et son objectif à long terme et qui, de manière cruciale, se voyait comme faisant partie d’un mouvement international.
Les partis sociaux-démocrates et, surtout, la Deuxième Internationale, ont été la réponse du prolétariat. Ces organisations n’ont pas été imposées depuis l’extérieur de la classe, comme la bourgeoisie aime à le prétendre, mais « n’ont fait que développer et organiser un mouvement réel qui existait bien avant elle et s’était développé indépendamment d’elle. Pour le prolétariat la question était (comme aujourd’hui) toujours la même : comment combattre la situation d’exploitation dans laquelle il se trouve ». (1) La social-démocratie était une arme créée par le prolétariat pour mener à bien ses luttes. Elle a marqué un progrès crucial par rapport au passé de par son adhésion au marxisme et son rejet de l’anarchisme, par sa défense du cadre unitaire et politique de l’organisation de la classe et par l’établissement des programmes minimum et maximum.
Ces acquis ne sont pas nés spontanément mais ont été le fruit de luttes déterminées et prolongées au sein du mouvement ouvrier, dans lesquelles la responsabilité principale a incombé à plusieurs reprises à l’aile gauche du mouvement, d’abord pour obtenir des avancées et ensuite pour les défendre contre la tendance au compromis et au réformisme stimulée par le développement apparemment illimité du capitalisme et les réformes que ce développement rendait possibles.
L’élection de 1885 : discréditer le socialisme
Les élections britanniques de 1885 sont les premières à avoir lieu depuis la réforme de 1884 qui, bien que n’allant pas jusqu’au suffrage universel, a considérablement étendu le corps électoral et, selon Engels, a rendu probable l’élection d’un certain nombre de dirigeants ouvriers officiels avec le soutien des libéraux. Engels pensait que cela favoriserait le développement du mouvement ouvrier indépendant puisque ces dirigeants « se montreraient rapidement pour ce qu’ils sont ». (2)
La SDF présente trois candidats, deux à Londres et un à Nottingham. Les dépenses de ceux de Londres sont payées par les Tories (Parti conservateur), suite à un accord conclu par la clique de Hyndman dans le dos de l’organe du SDF. Les candidats ont été délibérément placés dans des circonscriptions libérales fortes où ils étaient voués à l’échec et, le jour du scrutin, ils n’ont obtenu que 59 voix à eux deux. Lorsque la nouvelle de l’accord s’est répandue, la presse libérale a monté une campagne virulente, dénonçant la SDF pour avoir accepté « l’or des Tories » et pour avoir fait leur sale boulot. Hyndman et ses partisans ont prétendu qu’il importait peu de savoir à qui ils prenaient de l’argent, mais dans une lettre à Bernstein, Engels expose clairement les conséquences de l’action de Hyndman : « Hyndman, cependant, savait que prendre l’argent des Tories n’entraînerait rien de moins qu’une ruine morale irréparable pour les socialistes aux yeux de la seule et unique classe dont ils pouvaient tirer des recrues, à savoir les grandes masses ouvrières radicales ». (3) Par conséquent, l’emprise des libéraux sur la classe ouvrière fut renforcée et la création d’une organisation indépendante fut repoussée.
La critique d’Engels, mais pas son analyse, est partagée par la Ligue socialiste, dont l’exécutif adopte une résolution déclarant « que cette réunion considère avec indignation l’action de certains membres de la Fédération sociale-démocrate qui trafiquent l’honneur du Parti socialiste, et qu’elle désire exprimer sa sympathie avec la section de la Fédération qui rejette les tactiques de la bande peu recommandable concernée par les récentes procédures ». (4) Un membre éminent de la Ligue, Adreas Scheu, a condamné Hyndman comme étant « un agent payé par les Tories (ou les libéraux-réactionnaires) dans le but de discréditer le socialisme auprès des masses ». (5)
Au sein même de la SDF, comme le note la résolution de la Ligue, les critiques sont également vives. L’un des candidats a affirmé ignorer cette information et écrit à la presse pour dénoncer l’accord ainsi que « les hommes de la classe moyenne de notre mouvement ». (6) L’opposition est particulièrement forte, parmi les sections provinciales et, suite à l’échec d’une tentative de censure de Hyndman lors d’une réunion à Londres, un grand nombre de militants démissionnent, dont la totalité des sections de Bristol et Nottingham.
S’opposer aux grèves et promouvoir les émeutes
Sous l’influence de Hyndman, et malgré la présence de nombreux syndicalistes, la SDF adopte une attitude très critique, voire hostile, à l’égard des syndicats, affirmant aux travailleurs que les grèves sont futiles : « Il n’y a rien dans les grèves elles-mêmes, qu’il s’agisse d’une augmentation des salaires pour tous, ou de l’adoption d’un salaire minimum pour les catégories de travailleurs les plus modestes dans n’importe quel secteur d’activité, qui puisse émanciper les ouvriers sans propriétés ou les rendre moins dépendants de la classe des possédants et des patrons… ». (7) En revanche, la SDF encourage les rassemblements et les manifestations de chômeurs qui ont assisté à des discours révolutionnaires et ont été incités à adopter des résolutions irréalistes.
Peu après le scandale de l’or des Tories, la SDF a appelé à une manifestation de chômeurs à Trafalgar Square, officiellement en opposition à un rassemblement des Tories sur le « commerce équitable » au même endroit. En réalité, selon Karl Kautsky qui a observé l’affaire, la manifestation de la SDF était principalement composée d’éléments du lumpenprolétariat, tandis que la plupart des véritables travailleurs se trouvaient à l’autre réunion. Après un certain nombre de discours « révolutionnaires », la SDF conduit sa manifestation vers Hyde Park et alors qu’ils traversent les rues cossues de Pall Mall et Picadilly, des émeutes éclatent, des vitrines sont brisées et des magasins saccagés. La SDF et, dans une moindre mesure la Ligue socialiste, considèrent l’émeute comme positive. Pour la SDF, elle permet de sauver ses accréditations « révolutionnaires » après le discrédit du scandale de l’or des Tories, tandis que Morris observe que « toute opposition à la loi et à l’ordre nous est utile ». Une fois de plus, c’est Engels qui en saisit les véritables implications : « L’absence de la police montre que le tapage était voulu, mais que Hyndman et Cie soient tombés dans le piège est impardonnable et les marque finalement non seulement comme des imbéciles impuissants, mais aussi comme des scélérats. Ils voulaient laver le déshonneur de leurs manœuvres électorales et maintenant ils ont fait un tort irréparable au mouvement actuel ». (8) Dans une lettre à Bebel, il condamne la SDF qui cherche à devancer le développement réel du mouvement ouvrier et la compare aux anarchistes. Les procès pour sédition qui s’ensuivirent contre Hyndman et d’autres ne furent pas sérieusement poursuivis et n’aboutirent finalement à rien, mais ils contribuèrent grandement à améliorer la réputation de Hyndman parmi les socialistes et les radicaux.
Les débuts d’un mouvement de masse
Tout au long de l’année 1886 et de l’hiver 1887, la SDF continue d’orchestrer des marches et des manifestations de chômeurs. Celles-ci ont souvent lieu en dehors de Londres et sont bien organisées. En l’absence de toute alternative, la SDF commence à jouer un rôle de premier plan au sein de certains pans de la classe ouvrière.
Au cours de la première partie de l’année, Engels se félicite du manque d’impact de la SDF et de la Ligue socialiste sur la classe ouvrière, mais au fur et à mesure que l’année passe, il reconnaît un changement de la situation. En août, il écrit à Bebel : « La Fédération sociale-démocrate a au moins un programme et une certaine discipline, mais aucun soutien de la part des masses ». Un mois plus tard, il reconnaît que Hyndman a renforcé sa position et en novembre, il affirme que « grâce à la stupidité de tous ses rivaux et adversaires, la Fédération sociale-démocrate commence à devenir une puissance ». (9) Cela se traduit par de nouvelles manifestations de chômeurs à Trafalgar Square au cours de ce même mois, qui cette fois se déroulent dans le calme. Le gouvernement leur donne à nouveau un coup de pouce en menaçant d’abord d’empêcher les manifestations par la force, puis en faisant machine arrière. Engels voyait dans ces développements les débuts d’un mouvement en Grande-Bretagne, mais il prenait soin de préciser ce qu’il entendait par là : « La Fédération sociale-démocrate commence à avoir une certaine puissance, car les masses n’ont absolument aucune autre organisation à laquelle se rallier. Les faits doivent donc être rapportés de manière impartiale, en particulier le fait le plus important de tous, à savoir qu’un mouvement ouvrier véritablement socialiste a vu le jour ici. Mais il faut faire très attention à faire la distinction entre les masses et leurs dirigeants temporaires ». (10) En bref, Engels voyait le développement du mouvement se faire en dépit des manœuvres de Hyndman.
Contre l’unité internationale de la classe ouvrière
Malgré la rhétorique « révolutionnaire » brûlante des discours de Hyndman, la SDF s’est alliée au niveau international avec l’aile réformiste du mouvement ouvrier, puisque l’aile révolutionnaire était résolument marxiste. En particulier, la SDF travaille avec les Possibilistes en France, qui défendent le « socialisme municipal » contre le programme marxiste du Parti Ouvrier Français. En mars 1886, Justice publiait un article qui décrivait les Possibilistes comme la principale organisation socialiste en France, ignorant la création d’un groupe ouvrier à la Chambre des Députés quelques mois auparavant.
L’hostilité de Hyndman à la création d’un mouvement marxiste de la classe ouvrière et sa défense efficace des intérêts de la bourgeoisie, atteignent un point culminant lorsqu’il tente de saboter la fondation de la Deuxième Internationale. Il a été aidé en cela par les Possibilistes français qui, après avoir divisé le mouvement ouvrier en France, espéraient faire de même au niveau international.
En octobre 1887, le congrès du Parti social-démocrate allemand (SPD) a adopté une résolution appelant à un congrès international : « Mais comme à peu près à la même époque les syndicats avaient convoqué le congrès de Londres, le parti allemand était prêt à abandonner son congrès, à condition qu’il soit autorisé à y participer – simplement à y participer ! », cependant « Les conditions de participation formulées par le comité syndical ont abouti à l’exclusion de tous les délégués allemands ». (11) Paul Brousse, le leader des Possibilistes, assiste avec d’autres à la conférence et obtient leur soutien sur leur proposition d’organiser un congrès international en 1889, qui exclurait les autres partis ouvriers français.
Malgré cela, le SPD et Engels maintiennent dans un premier temps leurs efforts pour obtenir un congrès international unique. Une conférence à La Haye en février 1889 propose les conditions d’un congrès unique mais est boycottée par les Possibilistes (tandis qu’Engels critique le fait de ne pas avoir invité la SDF). Les Possibilistes lancent alors des invitations à leur congrès tandis que Hyndman attaque publiquement la Conférence de La Haye comme « une sorte de caucus privé » qui répéterait « les misérables intrigues qui ont brisé l’ancienne internationale ». (12) Ces calomnies ont rendu clairs les enjeux de la situation et la conduite à suivre pour Engels, comme il l’écrit dans une lettre à Sorge en juin : « C’est à nouveau la vieille scission de l’ Internationale qui apparaît ici au grand jour, la vieille bataille de La Haye. Les adversaires sont les mêmes, mais la bannière des anarchistes a été remplacée par la bannière des Possibilistes […] Et la tactique est exactement la même. Le manifeste de la Fédération sociale-démocrate, manifestement écrit par Brousse, est une nouvelle édition de la circulaire Sonvillier » (13) (Correspondance choisie).
Engels milite maintenant avec détermination pour un congrès séparé, s’efforçant de gagner les dirigeants du SPD et de transmettre les leçons acquises avec tant de difficultés dans la lutte contre Bakounine au sein de la Première Internationale. En juillet, les congrès marxiste et possibiliste se tiennent à Paris. Le premier réunit 400 délégués de 20 pays, tandis que le second regroupe un ensemble disparate de syndicalistes (dont un certain nombre ont été attirés par le congrès marxiste), de Possibilistes, de la clique de Hyndman et d’anarchistes unis uniquement par leur opposition au marxisme. Le congrès marxiste a réussi à résister aux tentatives des anarchistes de le perturber et a fait en sorte que la Deuxième Internationale soit fondée sur les avancées organisationnelles réalisées par la Première.
Tentative de séparer le mouvement en Grande-Bretagne
Défait au niveau international, Hyndman n’en poursuit pas moins son offensive contre l’unité du mouvement ouvrier en s’efforçant de le diviser en Grande-Bretagne. Cependant, alors que dans le passé il avait souvent pu dominer les mouvements isolés et fragiles des travailleurs, il va maintenant à l’encontre de la marée montante d’un mouvement qui prend de la force à l’intérieur du pays et s’inspire de l’étranger.
Parmi un certain nombre de résolutions adoptées par le congrès fondateur de la Deuxième Internationale, l’une d’entre elles appelait à des manifestations ouvrières internationales le 1er mai. Cette résolution a été soutenue avec enthousiasme par le syndicat Gas Workers and General Labourers qui, grâce à une lutte victorieuse pour obtenir la journée de huit heures pour les ouvriers du gaz, contenait quelque 100 000 membres. Eleanor Marx et Edward Aveling avaient travaillé activement avec le syndicat et leur réussite était telle qu’Hyndman a jugé nécessaire de les calomnier publiquement en les accusant de recevoir de l’argent du syndicat. Le syndicat appelle désormais à une manifestation de masse à Hyde Park, qui ne se tiendra pas le 1er mai mais le dimanche 4, car cela permettra à un plus grand nombre de travailleurs d’y assister. Le London Trade's Council, qui regroupe les vieux syndicalistes conservateurs qui excluent les ouvriers non qualifiés, s’y oppose. Il fait cause commune avec la SDF et cherche à devancer l’appel des ouvriers du gaz en réservant Hyde Park pour le 4 dans le but d’empêcher une manifestation dominée par la classe ouvrière radicale et les marxistes. Cependant, Aveling fait pression sur les autorités pour qu’elles autorisent la manifestation originale, de sorte que le 4 mai, deux manifestations rivales ont lieu. Le résultat est une nouvelle défaite pour Hyndman et ses alliés. Engels, qui a assisté aux manifestations, a rédigé un compte-rendu saisissant qui met clairement en évidence la signification de l’événement : « D’un côté, nous trouvons des ouvriers conservateurs, dont l’horizon ne s’étend pas au-delà du système du travail salarié, et à côté d’eux une secte socialiste faible mais avide de pouvoir ; de l’autre côté, la grande majorité des ouvriers qui avaient récemment rejoint le mouvement et qui ne veulent plus avoir affaire au manchesterisme (14) des vieux syndicats, préférant gagner eux-mêmes leur émancipation complète, avec des alliés de leur choix, et non avec ceux imposés par une minuscule clique socialiste […] Les petits-enfants des vieux Chartistes montent en première ligne. Depuis huit ans, les larges masses sont passées à l’action, tantôt ici, tantôt là. Des groupes socialistes sont apparus, mais aucun n’a pu dépasser les limites d’une secte ; agitateurs et chefs de parti en puissance, simples spéculateurs et carriéristes parmi eux, ils sont restés des officiers sans armée… Le formidable mouvement des masses mettra fin à toutes ces petites sectes et à tous ces petits groupements en absorbant les hommes et en montrant aux dirigeants la place qui leur revient ». (15) Comme pour confirmer ce dernier point, Engels note que trois sections entières de la SDF ont participé à la manifestation marxiste, plutôt qu’à celle organisée par leurs chefs.
Quelques conclusions au sujet d'Hyndman et de la Fédération
L’analyse d’Engels sur les sectes socialistes se confirme dans le cas de la SDF. Depuis sa formation et jusqu’aux dernières années des années 1880, la SDF a maintenu sa position de plus grande organisation socialiste en Grande-Bretagne et a ainsi pu se placer à la tête du mouvement ouvrier lorsque celui-ci a commencé à se développer. C’est à cette époque que les manœuvres de Hyndman étaient largement couronnées de succès, à la fois pour maintenir sa propre domination et pour s’assurer que le mouvement restait suffisamment petit pour qu’il puisse le manipuler. C’est pourquoi il a permis au scandale de l’or des Tories de discréditer le socialisme aux yeux des masses ouvrières et c’est pourquoi il a préféré diriger les marches des chômeurs plutôt que de participer au syndicalisme et aux grèves.
La montée d’un mouvement ouvrier de masse a inévitablement commencé à affaiblir la position de Hyndman et l’établissement de la Seconde Internationale sur une base marxiste a été un sérieux revers, non seulement pour Hyndman mais pour tous ceux qui, comme lui, ont prospéré sur la faiblesse et la division du prolétariat. La manifestation du 1er mai n’a pas seulement exprimé la croissance du mouvement ouvrier en Grande-Bretagne, elle a également témoigné de la nature internationale du prolétariat, puisque la victoire de 1889 au niveau international a ouvert la voie à la victoire de 1890 au niveau national.
Ces défaites ne signifient pas la fin pour Hyndman, au contraire, il continue à travailler contre l’unité du mouvement ouvrier, notamment en cherchant à introduire le poison du nationalisme dans le mouvement socialiste en menant une campagne contre le « militarisme Hohenzollen » et pour un renforcement de la marine britannique, sur laquel nous reviendrons plus tard. Par-dessus tout, l’héritage durable de la domination de Hyndman sur la SDF fut d’inculquer une attitude puriste, « révolutionnaire », parmi les générations successives de militants de la classe ouvrière, y compris parmi ceux qui s’opposaient à Hyndman. Le mouvement révolutionnaire britannique était en proie à la confusion et même à l’opposition au syndicalisme et à l’obtention de réformes immédiates, ce qui a contribué à une situation où les programmes minimum et maximum de la classe ouvrière étaient incarnés dans des organisations séparées et opposées, au grand détriment des deux, et entraînant l’affaiblissement à long terme du mouvement ouvrier en Grande-Bretagne.
Comment alors comprendre Hyndman et la SDF ? Dans la première partie, nous avons identifié Hyndman comme un aventurier qui a fait passer son intérêt personnel avant le mouvement qu’il prétendait soutenir. En fait, ses actions allaient au-delà de cela puisqu’elles coïncidaient objectivement avec les objectifs de la bourgeoisie qui, à maintes reprises, a cherché à détruire le mouvement révolutionnaire de l’intérieur. De plus, ses contacts avec la bourgeoisie, depuis sa rencontre avec Disraeli en 1880 jusqu’à l’accord avec les Tories en 1885, posent des questions sur sa relation avec l’État. Si nous ne sommes pas en mesure de donner une réponse définitive aujourd’hui, nous pouvons noter qu’à plus d’une reprise, ses contemporains l’ont accusé d’être un agent de la bourgeoisie. Engels, pour sa part, a montré qu’Hyndman se situait dans la continuité de Bakounine et qu’au-delà de leurs différences, ils étaient unis dans la haine du marxisme et l’opposition au développement d’un mouvement révolutionnaire basé sur les principes de centralisation et d’internationalisme. Tous deux étaient des parasites du mouvement ouvrier, opposant leur autorité dictatoriale, fondée sur les affinités, le sectarisme et les intrigues, au fonctionnement collectif et formalisé du prolétariat. Tout comme Engels s’est inspiré de l’expérience de la Première Internationale (16) pour armer la Deuxième, les révolutionnaires d’aujourd’hui doivent à nouveau tirer les leçons du passé pour mener la bataille permanente contre le parasitisme politique et tous ceux qui veulent détruire l’organisation révolutionnaire.
Si nous avons identifié Hyndman comme étant opposé à l’avancement du prolétariat et hostile au marxisme, qu’en est-il de la Fédération dans son ensemble ? Peut-elle être considérée comme une organisation prolétarienne ? La réponse est oui et c’est Engels qui nous donne les raisons d’une telle réponse : notamment dans son insistance à distinguer entre la direction et le corps de l’organisation et, plus généralement, dans son analyse de la manière dont la dynamique de la classe ouvrière peut s’emparer des organisations et les transformer. C’est pourquoi il conseille à Bernstein, à la fin de l’année 1887, de traiter la SDF autrement qu’auparavant, et pourquoi, dans une lettre à Sorge, il critique ceux qui ne regardent que la surface et ne voient « que confusion et querelles personnelles » alors que « sous la surface, le mouvement continue [et] embrasse des sections de plus en plus larges ».
Bien que les origines de la SDF se situent dans une pléthore de groupements essentiellement non-prolétariens et qu’elle n’ait jamais dépassé le stade de la secte, ce serait une grave erreur de ne voir que cela. En dépit de ses origines, la SDF était une organisation socialiste et, en de nombreux points, fermement marxiste, même si la direction était tout aussi fermement hostile au marxisme. La vie prolétarienne au sein de la SDF s’exprimait dans la collaboration des membres, surtout en dehors de Londres, avec d’autres socialistes et dans leur participation à la vie et aux luttes de la classe. La contradiction au sein de l’organisation se traduisait par une opposition récurrente à Hyndman, par la formation et le départ régulier de minorités de gauche. C’est à cette opposition et notamment à l’une de ses expressions les plus significatives, la Ligue socialiste, que nous nous intéresserons dans la prochaine partie de cette série.
North, WR n° 205, juin 1997
>>> Retour à l’introduction et au sommaire [842]
1 « Continuité des organisations politiques du prolétariat : La nature de classe de la social-démocratie », Revue internationale n° 50.
2 Engels, lettre à Bebel (octobre 1885).
3 Ibid.
4 Lee et Archbold, Social-Democracy in Britain (1935).
5 Thompson, William Morris : Romantic to Revolutionary (1955).
6 Engels, lettre à Paul Lafargue (octobre 1885).
8 Engels à Laura Lafargue, Œuvres complètes Vol.47
9 Idem
10 Engels à Herman Schluter, Œuvres complètes, vol. 47
11 Engels/Bernstein L’Internationale ouvrière de 1889 /
12 The life of Eleanor Marx, 1855-1898 : a socialist tragedy, Tsuzuki (1967)
13 La circulaire Sonvillier était une attaque de l’Alliance de Bakounine contre la Première Internationale. Voir Revue internationale n°85 « La 1ère Internationale contre l’Alliance de Bakounine ».
14 Le « Manchesterisme des vieux syndicats » est une référence à leur adhésion aux politiques de « libre-échange » d’un groupe d’économistes bourgeois.
15 Œuvres complètes, Vol. 47
16 Pour en savoir plus sur le combat au sein de la Première Internationale, voir les articles dans les Revues Internationales n° 84, 85, 87 et 88.
Conscience et organisation:
- Les utopistes [839]
- La Ligue Communiste [840]
- La première Internationale [659]
- La Seconde Internationale [117]
Questions théoriques:
- Parti et Fraction [841]
Partie 3 : La Ligue socialiste et la lutte contre le sectarisme
- 90 lectures
Tout au long de l’histoire de la Fédération sociale-démocrate (Social Democratic Federation, SDF), une opposition s’est constamment formée contre les politiques et les pratiques de la clique dirigeante de Hyndman (voir la deuxième partie de cette série [846]). Parfois, cela s’est traduit par la démission de membres isolés : tout au long de son histoire, plusieurs milliers de membres sont passés par la SDF et il est clair que beaucoup d’entre eux ont tout simplement été perdus pour la cause ouvrière. Dans d’autres cas, des factions de gauche organisées ont émergé et ont été soit expulsées, soit sont parties fonder de nouvelles organisations. Dans les années 1880, la Ligue socialiste et la moins connue Union socialiste (Socialist Union, SU), ont été créées, tandis que dans les premières années du XXe siècle, le Parti socialiste de Grande-Bretagne (Socialist Party of Great Britain, SPGB) et le Parti socialiste travailliste (Socialist Labour Party, SLP) ont vu le jour. Ces scissions sont souvent présentées comme la conséquence de conflits de personnalité dûs à la conduite dictatoriale de Hyndman mais, en réalité, elles répondaient aux besoins du mouvement ouvrier de l’époque. Ainsi, si nous avons caractérisé ces organisations comme l’aile gauche du mouvement, cela n’implique pas qu’elles étaient simplement plus « radicales » que la SDF. Dans les années 1880, la tâche prioritaire était de dépasser le sectarisme étroit de la SDF et de construire un mouvement ouvrier de masse. L’Union socialiste, qui a scissionné après le scandale de l’or des Tories, (1) a mis l’accent sur les moyens constitutionnels, en particulier le Parlement, pour y parvenir. Dans les années 1900, la tâche principale était devenue la lutte contre la croissance de l’opportunisme au sein de la Deuxième Internationale, le Parti socialiste de Grande-Bretagne et le Parti socialiste travailliste défendant tous deux la nécessité du renversement du capitalisme par la révolution contre les illusions du réformisme. Si toutes ces organisations présentaient de sérieuses faiblesses et confusions, il est néanmoins essentiel de saisir la dynamique qui les sous-tendait. Une telle compréhension montre clairement que le mouvement ouvrier en Grande-Bretagne n’était pas quelque chose de particulier à ce pays, le produit de son histoire « spécifique » comme on nous le répéte si souvent, mais qu’il s’inscrivait irréfutablement dans le mouvement ouvrier international. En Allemagne, en France et en Russie, il est possible de retracer la même lutte fondamentale pour dépasser d’abord la phase des sectes et des cercles, pour ensuite défendre la nature marxiste et révolutionnaire du mouvement ouvrier contre l’opportunisme et le réformisme. Un examen de l’histoire de la Ligue socialiste, qui est au centre de cette troisième partie de notre série, des luttes qui ont eu lieu en son sein et de son effondrement final, confirme cette analyse.
Le potentiel de la Ligue socialiste
En août 1885, quelques mois après la fondation de la Ligue socialiste, Engels écrit à Kautsky : « Après les élections […], les conditions en faveur de l’émergence d’un mouvement socialiste s’élargiront et se consolideront. C’est pourquoi je suis heureux de constater que le mouvement hyndmanien ne prendra sérieusement racine nulle part et que le mouvement simple, maladroit, merveilleusement gaffeur, mais sincère de la Ligue socialiste gagne lentement mais apparemment sûrement du terrain ». (2). Au début de l’année suivante, dans une lettre à Sorge, après avoir critiqué les manœuvres électorales de la SDF, il conclut « mais s’il s’avère possible d’éduquer au sein de la Ligue socialiste un noyau ayant une compréhension des questions théoriques, des progrès considérables auront été faits vers l’éruption, qui ne saurait tarder, d’un véritable mouvement de masse ». (3) Cette compréhension du potentiel découlant de l’évolution des conditions objectives est la raison fondamentale pour laquelle Engels a apporté son soutien à la création de la Ligue socialiste, en donnant des conseils à Morris, Bax et les Avelings, en aidant à rédiger leur projet de plateforme programmatique et en contribuant à un article dans Commonweal, le journal de la Ligue. Dans ce dernier, il soulignait que c’était la détérioration de la situation économique en Grande-Bretagne qui jetterait les bases de la renaissance du socialisme, le message implicite étant que les socialistes devaient accompagner ce processus, en marchant aux côtés des travailleurs et en cherchant à les pousser vers l’avant, plutôt que de chercher à imposer une doctrine pure de l’extérieur.
La politique et l’organisation de la Ligue
Cette stratégie était clairement exposée dans le projet de plateforme, rédigé par Eleanor Marx et Edward Aveling avec les conseils d’Engels, qui prévoiyait la participation aux élections et le soutien aux syndicats ainsi qu’aux autres organismes socialistes. L’objectif primordial était de « former un parti travailliste socialiste national et international ». (4) Cet objectif fut adopté par le conseil provisoire, formé immédiatement après la scission, mais ensuite renversé, avec le soutien de Morris, lors de la première conférence de la Ligue en juillet 1885 en faveur d’une position anti-électorale.
Dans un certain nombre de domaines, la Ligue a fait des progrès importants. Au niveau programmatique, le Manifeste de la Ligue socialiste mettait l’accent sur le renversement révolutionnaire de la société par un prolétariat conscient de constituer une classe, rejetant « certains plans incomplets de réforme sociale », et déclarant fermement son internationalisme : « pour nous, il n’y a pas de nations, uniquement des masses disparates de travailleurs et d’amis, dont les sympathies mutuelles sont contrôlées ou perverties par des groupes de patrons et d’escrocs dont l’intérêt est d’attiser les rivalités et les haines entre les habitants de différents pays ». Au niveau de l’organisation, et en contraste direct avec la SDF, le journal de la Ligue était considéré comme exprimant les opinions de l’organisation et demeurant sous le contrôle : « Le rédacteur en chef et le sous-rédacteur en chef [Morris et Edward Aveling respectivement] agissent en tant que délégués de la Ligue socialiste, et sous son contrôle direct : toute erreur de principe, par conséquent, et toute déclaration erronée sur les objectifs ou les tactiques de la Ligue, sont susceptibles d’être corrigées par cet organisme ». (5) De façon plus générale, la Ligue a adopté une approche marxiste de l’histoire. On le voit très clairement dans la série « Socialism from the Root up », écrite conjointement par Morris et Bax, et publiée dans le Commonweal entre mai 1886 et mai 1888. La majeure partie de la série est consacrée à une exposition du « socialisme scientifique », comprenant un résumé de l’analyse économique du Capital.
Cependant, les faiblesses qui ont joué un rôle important dans la dissolution finale de la Ligue étaient aussi présentes. Sur le plan programmatique, elle ne parvient pas à saisir le lien entre la lutte pour les réformes immédiates et l’objectif de la révolution, rejetant tous les palliatifs, et en particulier la participation aux élections, en faveur de « la réalisation d’un socialisme révolutionnaire complet ». Sur le plan organisationnel, malgré l’existence d’un conseil exécutif et la tenue de conférences annuelles, la structure était très informelle, les sections conservant un haut degré d’autonomie.
Le résultat est que la Ligue se tint à l’écart des luttes des travailleurs. Si elle prêchait l’importance d’une grève générale, elle ne parvenait pas à saisir le réel potentiel des grèves qui se déroulaient sous son nez, se contentant d’un tract passe-partout qui disait aux ouvriers qu’une grève portant uniquement sur les salaires « sera inutile comme moyen d’améliorer de façon permanente votre condition et constituera une perte de temps et d’énergie, et entraînera entre-temps une grande quantité de souffrances pour vous-mêmes, vos femmes et vos familles ». (6) Une approche similaire a été adoptée à l’égard de la lutte électorale, avec un autre tract passe-partout appelant simplement les ouvriers à ne pas y participer. En conséquence, la Ligue accordait la plus grande importance à l’éducation, Morris affirmant que « l’éducation vers la révolution me semble exprimer en trois mots ce que doit être notre politique ». (7) Les membres de la Ligue ont consacré leurs efforts à la propagation des idées, par voie orale et écrite, participant aux luttes pour la liberté d’expression qui ont marqué le milieu des années 1880, faisant souvent preuve d’un courage, d’un engagement et d’une abnégation extraordinaires pour la cause, mais ne répondant toutefois pas au mouvement ouvrier qui se développait autour d’eux, même lorsque les travailleurs montraient leur volonté d’évoluer vers le socialisme, comme lors des grèves des mineurs en Écosse en 1887, lorsque les ouvriers participaient à des réunions par dizaines de milliers.
Marxisme contre anarchisme
L’isolement de la Ligue de la vie réelle de la classe ouvrière, malgré la sincérité et les efforts de ses membres, provenait de son incapacité à saisir les tâches de l’époque et à construire une organisation capable de les réaliser. Cet échec n’était pas inévitable mais était, fondamentalement, le résultat de la lutte entre les factions marxistes et anarchistes au sein de la Ligue.
Ces factions étaient présentes dès le début. Les anarchistes étaient dirigés par Joseph Lane et Frank Kitz, issus du milieu ultra-radical londonien à la fin des années 1870, qui fondèrent la Labour Emancipation League (LEL) en 1881. Son programme associe diverses revendications classiques des radicaux à celles des chartistes, ainsi que des appels à la collectivisation des moyens de production, tandis que son activité, qui se concentre sur sa base dans l’East End de Londres, prévoiyait de lancer un appel à la grève des loyers. La même année, à l’invitation de Hyndman, elle participa à la conférence qui allait fonder la Fédération démocratique, ancêtre de la SDF, cherchant à « les doter du programme le plus avancé que nous puissions leur imposer ». (8) La LEL s’affilia à la SDF, mais n’y adhèra pas afin de conserver son « autonomie ». Elle prit peu part aux activités de la SDF jusqu’à la scission de 1884, où elle se rangea du côté des sécessionnistes, bien qu’elle ait été invitée à participer à la réunion décisive par Hyndman qui, vraisemblablement, pensait pouvoir compter sur elle une seconde fois. Par la suite, la LEL s’est affiliée à la Ligue. Cette fois, ses membres allaient jouer un rôle beaucoup plus important, Lane et Kitz prenant d’abord place au conseil provisoire puis au conseil exécutif, où ils formèrent le noyau autour duquel la faction anarchiste se développa au sein de la Ligue.
La faction marxiste, qui comprenait Bax, Aveling, Morris et Eleanor Marx, subit son premier revers avec le rejet du projet de plateforme, bien qu’une proposition de Lane visant à transformer la Ligue en une fédération de sections indépendantes ait été rejetée. La plupart d’entre eux, en particulier Morris, ont complètement sous-estimé le danger que représentaient les anarchistes et ont ouvert la porte à leur influence destructrice. Seule Eleanor Marx saisit le danger, écrivant à sa sœur Laura peu après la création de la Ligue : « les anarchistes seront ici notre principale difficulté. Nous en avons beaucoup dans notre Conseil, et peu à peu, ce sera l’enfer. Ni Morris, ni Bax, ni aucun des nôtres ne sait vraiment ce que sont ces anarchistes : jusqu’à ce qu’on le sache, il sera difficile de les combattre ; d’autant plus que beaucoup de nos membres anglais recrutés par les anarchistes étrangers (dont je soupçonne la moitié d’être des agents de police) sont incontestablement les meilleurs hommes que nous ayons ».(9) Ses prédictions se sont rapidement vérifiées. En avril 1886, Engels écrivait à Laura Lafargue : « Ici, tout est embrouillé. Bax et Morris s’enfoncent de plus en plus dans les mains de quelques phraseurs anarchistes, et écrivent des sottises avec une intensité croissante ». (10) En mai, Aveling démissionna de son poste de sous-rédacteur du Commonweal (Bax le remplaça) et peu après, Eleanor Marx cessa d’écrire sa colonne « Notes internationales ». En août, Engels note que « la Ligue traverse une crise ».(11)
La lutte atteignit son paroxysme lors de la troisième conférence en 1887 lorsque les marxistes cherchèrent à renverser la politique anti-électorale et sectaire de la Ligue. La résolution principale, proposée par Mahon, réitèra essentiellement la stratégie du projet de plateforme. Il est possible qu’Engels ait aidé à rédiger cette résolution car, malgré ses réserves sur la capacité de la Ligue, il voyait que le développement d’un large mouvement ouvrier en Grande-Bretagne était imminent. Pendant la préparation de la conférence, les anarchistes mobilisèrent activement leurs forces, tandis que les marxistes restèrent silencieux et inactifs. Lors de la conférence, Morris joua un rôle décisif, cherchant d’abord à repousser la prise de décision, puis se rangeant derrière les anarchistes pour rejeter la résolution marxiste et réaffirmer la politique d’abstention. Par la suite, les marxistes ont tenté de travailler comme une fraction au sein de la Ligue, s’établissant dans la section de Bloomsbury et, paradoxalement, dans la section de Hoxton de la Labour Emancipation League, dans laquelle ils étaient désormais majoritaires. Ce travail semble avoir été mal fait (les anarchistes le présentant comme un complot visant à organiser un « coup d’État » au sein de la Ligue) et, lors de la quatrième conférence, la tentative de changer la politique de la Ligue se solda non seulement par une défaite, mais par l’expulsion de la section de Bloomsbury et la désaffiliation de la LEL de Hoxton. Désormais, la Ligue était aux mains des anarchistes.
Morris, bien que se déclarant fermement marxiste et opposé à l’anarchisme, continuait de sous-estimer la menace que représentaient les anarchistes. Lors de la conférence fondatrice de la Seconde Internationale, il se joignit aux autres membres de la délégation de la Ligue pour protester contre la façon dont on avait traité la tentative des anarchistes de perturber la réunion. Il révèla également sa mauvaise compréhension de la question de l’organisation dans son rapport sur le congrès, lorsqu’il conclut que « de tels rassemblements ne sont pas propices à la bonne gestion des affaires et leur véritable utilité est leur caractère démonstratif, et […] il est préférable de les encadrer en tant que tels ». (12) Ce n’est qu’en 1890 qu’il rompit définitivement avec la Ligue et ce n’est que dans les quelques années qui lui restaient à vivre qu’il commença à saisir la dynamique du mouvement.
Les anarchistes ont progressivement réduit la Ligue à néant, cherchant à se surpasser dans des postures radicales, utilisant Commonweal pour prôner le terrorisme et l’assassinat tout en brisant les sections. Si à ce stade, la présence d’espions de la police et d’agents provocateurs devint évidente (même pour les anarchistes), la période décisive était celle de l’affrontement entre marxistes et anarchistes. Le potentiel de la Ligue à ses débuts a fait en sorte que l’État lui accorde une attention particulière. Nous avons déjà vu qu’Eleanor Marx soupçonnait la présence d’agents de police parmi les anarchistes étrangers mais, étant donné l’expérience de l’État britannique, il est impossible d’exclure la probabilité que parmi les anarchistes autochtones se trouvaient également quelques agents d’État.
Vers le mouvement de masse des ouvriers
La dégénérescence de la Ligue socialiste, comme les manœuvres de la SDF avant elle, a incité d’importantes minorités à tenter de dépasser leurs propres limites. Cela prit diverses formes. Les sections de la Ligue, en particulier celles situées en province, développèrent des liens avec d’autres organismes socialistes locales, dont la SDF, ainsi qu’avec les syndicats. Par exemple, en 1888, les sections d’Écosse ont soutenu la formation du Scottish Labour Party. Mahon, à un moment donné secrétaire de la Ligue et pilier des antiparlementaires, changea de position et quitta la Ligue pour fonder la Northern Socialist Federation et travailler avec la Scottish Land et la Labour League, deux organisations soutenant la participation aux élections et aux syndicats. Cependant, comme nous le verrons plus loin dans cette série, de nombreux militants, dans leur empressement à rompre avec le sectarisme, ont fait le chemin inverse et ont eu tendance à considérer le parlement comme la seule voie vers le socialisme, succombant ainsi aux arguments du réformisme et de l’opportunisme. Encore une fois, cette tendance découlait de la situation objective, où l’expansion continue du capitalisme permettait au mouvement ouvrier d’arracher des concessions à la bourgeoisie.
La promesse de la Ligue socialiste n’a pas été tenue. Elle n’a pas réussi à remplir les tâches qui lui étaient dévolues. Cependant, en cours de route, à travers la lutte pour transmettre le message à la classe et à travers la confrontation avec les anarchistes, un nombre significatif de militants a commencé à comprendre pourquoi et comment faire partie du mouvement de masse. La grande faiblesse était qu’en cours de route, beaucoup de temps et d’énergie avaient été gaspillés. Pendant que les socialistes s’étaient enfermés dans leurs sectes, le mouvement de la classe ouvrière en Grande-Bretagne commençait à se développer et à les laisser sur le carreau. Cela signifiait que les éléments non socialistes et antisocialistes, avec l’aide de l’État, avaient un poids disproportionné au sein du nouveau mouvement. Dans la prochaine partie de notre série, nous examinerons de plus près les débuts de ce mouvement, en prélude à l’examen de la place et du rôle du Parti travailliste indépendant.
North, World Revolution n° 208, octobre 1997
>>> Retour à l’introduction et au sommaire [842]
1La SDF avait présenté aux élections des candidats à Londres et à Nottingham dont les dépenses avaient été payées par le parti Tory suite à un accord conclu par la clique de Hyndman dans le dos de l’organisation. Ces candidatures étaient délibérément situées dans des circonscriptions libérales pour affaiblir ces derniers. Lorsque la nouvelle de l’accord fut divulguée, la presse libérale a lancé une campagne virulente dénonçant la SDF pour avoir accepté « l’or des Tories » et pour avoir fait le sale boulot du parti conservateur. Dans une lettre à Bernstein, Engels expliqua les conséquences de l’action de Hyndman : « Hyndman, cependant, savait que prendre de l’argent aux conservateurs n’entraînerait rien de moins qu’une ruine morale irréparable pour les socialistes aux yeux de la seule et unique classe dans laquelle ils pourraient recruter, à savoir les grandes masses ouvrières radicales ». Finalement, l’emprise des libéraux sur la classe ouvrière s’est renforcée et la création d’une organisation révolutionnaire indépendante a été retardée.
2Engels, Œuvres complètes Vol.47, p.320-1.
3Ibid, p.394
4Thompson, William Morris : Romantic to Revolutionary (1955).
5Introduction au Commonweal n° 1.
6Thompson, William Morris : Romantic to Revolutionary (1955).
7« Our Policy », Commonweal n° 14.
8Quail, The Slow Burning Fuse : The Lost History of the British Anarchists (2019).
9Tsuzuki, The life of Eleanor Marx, 1855-1898 : a socialist tragedy (1967).
10Engels, Œuvres complètes, Vol.47, p.438
11Engels à Bebel, Collected Works Vol 47.
12« Bilan du Congrès de Paris II », Commonweal n° 186.
Histoire du mouvement ouvrier:
Conscience et organisation:
- La Ligue Communiste [840]
- La première Internationale [659]
- La Seconde Internationale [117]
Personnages:
- Hyndman [847]
Questions théoriques:
- Parti et Fraction [841]
Partie 4 : Les années 1880-1890, renouveau de la lutte ouvrière et la réponse socialiste
- 69 lectures
Cette série d’articles [848] a commencé par esquisser la résurgence du mouvement ouvrier en Grande-Bretagne à la fin des années 1880. Elle s’est ensuite penchée sur les rôles particuliers de la Fédération social-démocratique (SDF) et de la Ligue socialiste, concluant que toutes deux n’avaient pas su répondre aux besoins du prolétariat (voir RI 198, 205 & 208). Dans cette quatrième partie, nous reviendrons plus en détail sur le renouveau de la lutte dans les années 1880 et 1890, afin de montrer pourquoi et comment il s’est développé ; nous soulignerons ce qu’il partageait avec le mouvement ouvrier international et ce qui l’en différenciait.
Bilan des rapports de force entre les classes
Bien qu’aucun mouvement politique de masse n’ait été créé en Grande-Bretagne dans les décennies qui ont suivi la défaite du chartisme, la classe ouvrière a néanmoins constitué une force au sein de la société. Les raisons fondamentales sont la force du syndicalisme au sein de la classe ouvrière et la compréhension par la bourgeoisie elle-même de la menace potentielle que représentait le prolétariat. Ces points ont été soulignés par Engels en 1881 dans un article sur les syndicats dans The Labour Standard. « La loi de 1824 [qui a abrogé les Combination Laws qui avaient interdit les syndicats] a rendu ces organisations légales. À partir de ce jour, les travaillistes sont devenus un pouvoir en Angleterre. La masse autrefois impuissante, divisée contre elle-même, ne l’était plus. À la force donnée par l’union et l’action commune s’ajoutait la force d’un échiquier bien rempli – « l’argent de la résistance », comme l’appellent expressément nos frères français » »(1). Les syndicats sont devenus « une puissance dont tout gouvernement de la classe dominante doit tenir compte »(2), obtenant non seulement des concessions économiques, telles que la réglementation des salaires, des horaires et des conditions de travail dans les usines, mais aussi des réformes politiques avec l’extension progressive du droit de vote. Cependant, ils n’ont pas réussi à utiliser ces « nouvelles armes ». La majorité des dirigeants syndicaux restent des libéraux convaincus. En effet, comme l’a montré Engels, c’est la bourgeoisie, « qui connaît leur force mieux qu’eux »(3), qui a pris l’initiative, en « proposant » l’extension du droit de vote à certaines parties de la classe ouvrière. La bourgeoisie était très claire quant à ses objectifs en la matière : « Tout homme qui n’est pas présumé incapable en raison d’une inaptitude personnelle ou d’un danger politique a moralement le droit d’entrer dans le giron de la constitution »(4). Ainsi, alors que la lutte pour le droit de vote était un aspect important de la lutte des classes au sens large à cette époque, son acquisition n’a été une victoire pour la classe ouvrière que dans la mesure où elle a été consciemment utilisée dans le cadre de cette lutte plus large. Engels conclut son article dans The Labour Standard en affirmant que l’incapacité des syndicats à utiliser le droit de vote de cette manière signifiait que la classe ouvrière avait « pris le mauvais virage ».
La lutte syndicale a permis à une partie de la classe ouvrière de bénéficier des avantages découlant de la suprématie économique de la Grande-Bretagne, mais, comme Engels l’a répété à maintes reprises, la lutte syndicale, de par sa nature, ne pouvait pas remettre en question le système salarial lui-même. En outre, le succès même des syndicats a alimenté les illusions sur l’existence d’intérêts communs entre les classes et a contribué à créer un fort soutien au parti libéral au sein d’une grande partie de la classe ouvrière, ce qui a fait en sorte que l’initiative politique relevait davantage de la bourgeoisie que du prolétariat. Pour que cela change de manière décisive, il faudrait un changement tout aussi décisif des conditions objectives.
Le début du déclin du capitalisme britannique
L’industrialisation précoce de la Grande-Bretagne lui a conféré un avantage sur tous ses rivaux, avantage qui a perduré pendant la majeure partie du XIXe siècle. Toutefois, dans les années 1880, des concurrents tels que la France, l’Allemagne et l’Amérique menaçaient ce monopole. Alors que leur capacité de production totale était encore inférieure à celle de la Grande-Bretagne au début de la décennie, leur taux de croissance plus rapide indiquait que cela ne resterait pas longtemps le cas. Cette intensification de la concurrence alimente la croissance de l’impérialisme, chaque nation luttant pour accroître sa part du marché mondial. Les régions du monde jusque-là inexploitées, notamment l’Afrique et l’Asie, sont devenues le centre d’une rivalité intense au cours des dernières décennies du siècle.
En Grande-Bretagne, comme l’a noté Engels, le cycle industriel classique avait commencé à changer, les périodes d’effondrement s’allongeant et la reprise devenant plus difficile : « … ce qui distingue la période actuelle de dépression, en particulier dans les secteurs du coton et du fer, c’est qu’elle a dépassé depuis quelques années sa durée habituelle. Il y a eu plusieurs tentatives de reprise, plusieurs sursauts, mais en vain. Si l’époque de l’effondrement réel a été surmontée, le commerce reste dans un état de langueur et les marchés demeurent incapables d’absorber la totalité de la production »(5). Des dépressions se sont produites à la fin des années 1870 et au milieu des années 1880 (la Grande Dépression), tandis que le taux de croissance diminuait progressivement. Ces évolutions n’ont pas seulement annoncé la fin du monopole économique de la Grande-Bretagne, mais ont également été les premiers signes de la fin de la période d’ascension du capitalisme dans son ensemble et le début de sa période de déclin historique ou de décadence(6).
Parallèlement à l’augmentation des rivalités au sein de la classe capitaliste, ces développements ont également provoqué une intensification de la lutte entre les classes. Les employeurs ont cherché à protéger leurs profits en intensifiant l’exploitation de la classe ouvrière, à la fois par des changements dans les pratiques de travail et par des tentatives de maintien, voire de réduction des salaires. Au tournant du siècle, les salaires ont cessé d’augmenter et ont même régressé. Les récessions ont plongé des centaines de milliers d’ouvriers dans le chômage et la misère, avec des taux de chômage atteignant 12 % en 1879 et 10 % en 1885/6, avant de retomber à 3 % lors de la reprise relative de la fin des années 1890.
Le prolétariat a été très durement touché par ces évolutions et, dans un premier temps, l’adhésion aux syndicats a chuté, mais à partir de la seconde moitié des années 1880, sa combativité s’est progressivement rétablie, avec des grèves importantes dans les mines du Northumberland et dans l’industrie mécanique à Bolton. Ces grèves ont été marquées par une amertume croissante, les employeurs formant des organisations nationales pour protéger leurs intérêts et l’État intervenant dans un certain nombre de grèves, comme à Manningham Mills en 1890, lorsque la police a dispersé les réunions des grévistes. Cette confrontation de plus en plus directe entre les classes érode les illusions qui pèsent sur la classe ouvrière et crée les conditions d’une politisation de la lutte du prolétariat.
La lutte économique
L’aspect le plus significatif des luttes économiques de cette période est la mobilisation des ouvriers non qualifiés. En mars 1889, la mobilisation des travailleurs du gaz à Londres, avec des manifestations régulières de plusieurs milliers de personnes et l’adhésion de 20 000 travailleurs à la National Union of Gasworkers and General Labourers, contraint les employeurs à concéder une journée de 8 heures et une augmentation de salaire. La même année, la grève des dockers londoniens a suscité une solidarité massive, les rassemblements et les manifestations comptabilisant 100 000 ouvriers. Les chiffres officiels pour cette période font état de 119 000 ouvriers impliqués dans des contestations en 1888, 360 000 en 1889 et 393 000 en 1890, pour atteindre un pic de 634 000 en 1893 et se maintenir à un niveau élevé pendant le reste du siècle.
Ce mouvement historique de la classe ouvrière est souvent subordonné à l’histoire du « nouveau syndicalisme » et de ses dirigeants qui, tout en étant d’une grande importance, peut occulter la signification réelle du mouvement. Dans la grève des docks, par exemple, les tentatives précédentes de syndicalisation par Ben Tillet n’ont eu qu’un succès limité et la grève elle-même a commencé parmi des ouvriers non syndiqués qui, bien qu’ils se soient ensuite tournés vers Tillet pour obtenir de l’aide, ont formulé leurs revendications de manière indépendante, comme l’avaient fait auparavant les travailleurs du gaz(7). En outre, si un grand nombre de nouveaux syndicats voient le jour par la suite dans tout le pays, ils se révèlent souvent peu viables, de même que les acquis qu’ils obtiennent. Les dockers durent accepter un compromis (tout en obtenant leur principale revendication de six pence de l’heure et huit pence d’heures supplémentaires) et les travailleurs du gaz furent défaits lors d’une grève à la fin de l’année 1889. Entre 1892 et 1894, les nouveaux syndicats ne comptent que 107 000 membres sur un total de 1 555 000 syndiqués.
Le véritable succès des luttes réside dans la mobilisation de la classe ouvrière, dans ses revendications et dans la détermination avec laquelle elles ont été menées. Les dockers sont restés en grève pendant cinq semaines, forts de la solidarité du prolétariat international. Un acte qui s’inscrit dans la lignée de la fondation de la Deuxième Internationale la même année.
Le fait que des socialistes tels qu’ Eleanor Marx, Will Thorne et Tom Mann aient pu jouer un rôle de premier plan est avant tout la conséquence de la maturation de la conscience de classe du prolétariat britannique. Cela reflète également la capacité de ces socialistes à rompre avec le sectarisme des principales organisations socialistes (même si Thorne et Mann sont restés membres de la SDF) et à comprendre où se situe le véritable mouvement de la classe ouvrière. Ce mouvement n’allait pas dans le sens d’une acceptation immédiate du socialisme, auquel de nombreux ouvriers restaient hostiles, mais dans le sens d’un éloignement de la domination de l’idéologie et de la politique bourgeoises et d’une organisation indépendante de la classe.
La lutte politique
Cette facette de la lutte des classes s’est généralement développée de manière beaucoup plus diffuse et hésitante que les luttes économiques.
Bien que la SDF et la Ligue socialiste n’aient jamais été plus que des sectes, elles ont eu un impact durable dans certaines parties du pays. La SDF était particulièrement présente dans certaines régions d’Écosse et en particulier dans le Lancashire, où l’implication de certains de ses membres dans nombre de conflits industriels avait laissé comme héritage des sections dans des villes telles que Salford, Blackburn et Rochdale. Certaines d’entre elles étaient beaucoup moins sectaires que l’organisation mère et travaillaient volontiers avec d’autres organisations socialistes et syndicales. Les scissions de la SDF (voir la troisième partie de cette série) ont donné naissance à des organisations qui, bien que généralement éphémères, ont laissé quelques traces. Ces organisations ont eu tendance à réagir fortement contre le purisme « révolutionnaire » de la SDF ; la Socialist Union, par exemple, a adopté des positions exclusivement réformistes et légalistes.
En 1888, le Scottish Labour Party a été créé suite à l’échec de Keir Hardie en tant que candidat travailliste indépendant dans la circonscription de Mid Lanark. Bien qu’il cherche à attirer les socialistes, son programme est en grande partie composé de revendications libérales radicales traditionnelles et, plus important encore, il montre une volonté constante de négocier avec le parti libéral pour obtenir des accords électoraux. Malgré cela, l’élection et ses conséquences indiquent que l’emprise du parti libéral s’affaiblit, bien qu’il cherche à réagir en adoptant un programme plus radical lors des élections de 1891. Dans d’autres régions du pays, des efforts similaires pour présenter des candidats travaillistes indépendants aux élections locales et nationales gagnent progressivement du terrain, Hardie étant élu dans la circonscription de West Ham South en 1891.
Dans diverses régions de Grande-Bretagne, des organisations syndicales indépendantes voient le jour. Des syndicats sont créés à Bradford, Halifax, Hartlepool et Keighley, la résolution fondatrice du premier déclarant que « son objectif est de promouvoir les intérêts des ouvriers de toutes les manières jugées opportunes de tout temps […] ses activités doivent être menées indépendamment de la convenance d’un parti politique »(8). À Manchester, un parti travailliste indépendant local est créé en 1892. La quatrième clause de sa constitution stipule que « tous les membres de ce parti s’engagent à s’abstenir de voter pour tout candidat à l’élection d’un organe représentatif qui est, de quelque manière que ce soit, un candidat des partis libéral, libéral-unioniste ou conservateur »(9). Parmi les autres organisations, citons l’Aberdare Socialist Society dans le sud du Pays de Galles et le Newcastle Labour Party.
Un autre aspect important est le développement des journaux travaillistes et socialistes, tels que le Labour Leader, le Labour Elector, le Workman's Times et le Clarion au niveau national, ainsi qu’une multitude de journaux locaux ou sectoriels, tels que The Miner et le Yorkshire Factory Times. Bien que nombre d’entre eux aient été éphémères et que les motivations des propriétaires et des journalistes aient souvent été douteuses, ils exprimaient toujours le mouvement vers l’avant du prolétariat. En 1892, le Workman's Times, édité par Joseph Burgess, un partisan de longue date de l’activité syndicale indépendante, lance un appel aux lecteurs pour qu’ils envoient leurs noms afin de soutenir la formation d’un parti ouvrier indépendant. Plus de 2 000 personnes ont répondu à l’appel et un certain nombre de sections ont été créées, mais sans aucune organisation nationale.
Conclusions
Les évolutions que nous avons esquissées sont souvent présentées comme étant uniquement « britanniques » (reflétant le pragmatisme « de bon sens » de la classe ouvrière britannique) et comme étant simplement la matière première de l’Independant Labour Party qui lui-même n’était qu’une ébauche du Parti travailliste, la destination inévitable de la classe ouvrière. En réalité, comme nous l’avons souligné à maintes reprises, le mouvement de la classe ouvrière britannique faisait partie intégrante du mouvement international, même si, comme pour chaque composante, il était influencé par sa situation particulière.
En premier lieu, la classe ouvrière internationale s’est affirmée comme une classe dont les intérêts propres s’opposent à ceux de la classe dominante. Si cette affirmation trouve sa plus haute expression dans les grands partis sociaux-démocrates de pays comme l’Allemagne et, surtout, dans la création de la Deuxième Internationale, elle se manifeste également dans le dynamisme de la vie sociale du prolétariat, dans ses clubs qui mettent l’accent sur l’éducation et dans la prolifération des journaux, des revues et des pamphlets. Engels a exprimé à plusieurs reprises sa confiance dans le fait que cette dynamique conduirait rapidement les ouvriers au socialisme. Commentant les grèves de 1889, il déclare : « En outre, les gens ne considèrent leurs revendications immédiates que comme provisoires, bien qu’ils ne sachent pas encore pour quel objectif final ils travaillent. Mais cette vague idée est suffisamment enracinée pour qu’ils ne choisissent comme dirigeants que des socialistes ouvertement déclarés. Comme tout le monde, ils devront apprendre par leurs expériences et les conséquences de leurs propres erreurs. Mais comme, à la différence des anciens syndicats, ils accueillent avec mépris et dérision toute suggestion d’identité d’intérêts entre le Capital et le Travail, cela ne prendra pas beaucoup de temps… »(10). C’est cette dynamique qui s’est exprimée avec tant de force lors de la manifestation massive du 1er mai à Londres l’année suivante et qui a incité Engels à déclarer : « Il ne fait aucun doute que le 4 mai 1890, la classe ouvrière anglaise a rejoint la grande armée internationale »(11).
Dans le même temps, cependant, une dynamique opposée est apparue, fondée sur le succès même des syndicats et des organisations indépendantes de travailleurs dans l’obtention de concessions de la part de la classe dirigeante. La bourgeoisie a pu les accorder en raison de l’immense croissance continue du capitalisme. Dans le cas de la Grande-Bretagne, bien qu’elle ait souffert de la perte de son leadership, elle est restée immensément puissante et, à la fin des années 1890, elle a connu une période de prospérité au cours de laquelle la baisse du prix des denrées alimentaires a temporairement compensé le déclin du taux d’augmentation des salaires des ouvriers. Cette situation a favorisé non seulement la recherche de réformes immédiates, mais aussi le développement d’une tendance opportuniste qui a transformé cette erreur en principe politique. Cela a finalement conduit au rejet de la lutte des classes, à l’abandon de l’objectif révolutionnaire du prolétariat et, en fin de compte, à la défense du capitalisme contre la classe ouvrière.
Ce qui a particulièrement marqué la situation en Grande-Bretagne, c’est l’existence d’un certain nombre de facteurs qui ont donné plus de poids à cette tendance :
* Premièrement, la faiblesse du mouvement socialiste en Grande-Bretagne, miné sur le plan organisationnel par le parasitisme de la clique dominante des Hyndman au sein de la SDF et la destruction de la Ligue socialiste par les anarchistes, avec l’aide de l’État. En conséquence, si les socialistes ont joué un rôle actif et significatif dans le mouvement naissant, ils l’ont fait de manière dispersée et inorganisée, gaspillant ainsi une grande partie de leurs efforts. Pour de nombreux ouvriers, le socialisme était identifié aux fanfaronnades « révolutionnaires » de Justice (journal de la SDF) et à la glorification de la violence dans Commonweal (journal de la Ligue socialiste).
* La nature du mouvement syndical en Grande-Bretagne donne un poids supplémentaire au réformisme. Comme nous l’avons vu, les syndicats traditionnels sont restés la force dominante, tandis que les nouveaux syndicats ont été incapables de maintenir leurs membres d’origine et ont progressivement évolué vers des formes d’organisation plus traditionnelles en fonction du métier et du niveau de qualification.
* Le fonctionnement d’organisations telles que la Société fabienne, qui prônait essentiellement une politique opportuniste et de collaboration de classe et s’opposait au marxisme, a donné une nouvelle impulsion au réformisme. Bien que la Société fabienne compte peu de membres, elle est bien organisée et financée, et les inepties des sectes révolutionnaires lui offrent un champ d’action.
* Enfin, l’État lui-même a travaillé activement contre le mouvement de la classe ouvrière. Si l’utilisation d’espions et d’agents provocateurs est l’aspect le plus évident (et même là, il est plus habile que ses homologues continentaux), le plus dangereux est sa capacité à faire des concessions à la lutte des classes, en particulier en jouant la carte de la démocratie par l’extension du droit de vote. Cette capacité a été sous-estimée par l’ensemble du mouvement ouvrier, qui opposait l’oppression de Bismarck en Allemagne et des tsars en Russie aux « libertés » dont jouissait la Grande-Bretagne. Le poids des illusions démocratiques est resté une faiblesse constante du mouvement révolutionnaire en Grande-Bretagne.
Cependant, il est essentiel de souligner que le mouvement qui a vu le jour à la fin des années 1880 et qui s’est épanoui dans les années 1890 était une véritable expression du prolétariat en tant que classe révolutionnaire et qu’il avait le potentiel de se développer en une organisation socialiste de masse telle qu’envisagée par Engels. Contrairement à ce qu’affirment nos historiens bourgeois, il n’était pas prévu qu’elle s’achèverait dans le Parti travailliste. La période qui s’ouvre, et qui durera jusqu’à la Première Guerre mondiale, est celle d’une lutte intense pour la création d’un parti ouvrier de masse et contre l’opportunisme. C’est la première partie de cette lutte, à savoir les années durant lesquelles s’est fondé le Parti travailliste indépendant, que nous aborderons dans le prochain article de cette série.
North, WR n° 213 (Avril 1998)
>>> Retour à l’introduction et au sommaire [842]
1Œuvres complètes, Vol. 24, P. 384
2Ibid, p.386
3Ibid
4Gladstone, cité dans Tom Mann and His Times, par Torr (1956)
5« Iron and Cotton » publié dans Labour Standard 1881 ; Œuvres complètes vol.24, p.411-2
6voir notre brochure La décadence du capitalisme
7Tom Mann's Memoirs, pp. 58 & 61, Tom Mann (1923)
8cité dans British Workers and the Independent Labour Party, p. 179, Howell (1983)
9cité dans Origins of the Labour Party, p. 9, Pelling (1966)
10Engels à Sorge décembre 1889, Origins of the Labour Party, Pelling (1966)
11« May 4 in London », Œuvres complètes vol. 27, p.66
Géographique:
- Grande-Bretagne [47]
Conscience et organisation:
- Les utopistes [839]
- La Ligue Communiste [840]
- La première Internationale [659]
Récent et en cours:
Partie 5 : Le Parti travailliste indépendant et la pression du réformisme
- 32 lectures
>>> Retour à l’introduction et au sommaire [842]
Au cours des années 1890, les partis ouvriers de masse ont réussi à obtenir de nombreuses réformes qui ont amélioré les conditions de vie de la classe ouvrière. Si la lutte pour ces réformes était un aspect important de la lutte des classes à cette époque, l’obtention de réformes comportait le danger de nourrir des illusions sur la possibilité d’une évolution sans heurt du capitalisme vers le socialisme. Toutefois, le fondement marxiste de la plupart de ces partis garantissait, du moins au sein d’une minorité, une opposition déterminée face à la croissance du réformisme et de l’opportunisme, illustrée par les efforts de Rosa Luxemburg au sein du parti social-démocrate allemand. La classe ouvrière britannique a été confrontée à la même situation, à la seule différence qu’elle a cherché à créer un parti de classe face à la vague réformiste et sans fraction marxiste organisée.
Entre la fin des années 1880 et le début des années 1890, la classe ouvrière britannique s’est engagée dans la lutte contre ses exploiteurs de manière décisive et souvent spectaculaire. La partie 4 de cette série a retracé le développement de ce mouvement au niveau économique et politique, notant que ce dernier se caractérisait avant tout par une tendance à se défaire de l’emprise du parti libéral, traditionnellement soutenu par la majorité des électeurs de la classe ouvrière, et à s’orienter vers l’indépendance. Engels a salué cette évolution comme le début d’une dynamique qui conduirait la classe ouvrière au socialisme, balayant les prétentions et la phraséologie de sectes telles que la Fédération social-démocrate (SDF) et d’autres leaders en puissance.
La fondation du Parti travailliste indépendant en janvier 1893 marque une étape importante dans cette dynamique, la classe ouvrière créant une force politique indépendante pour la première fois depuis les Chartistes. Cependant, pour que cette organisation naissante devienne une arme réellement efficace dans la lutte entre le prolétariat et la classe dirigeante, elle devait continuer à progresser sur le plan politique et organisationnel, et c’est là que le nouveau mouvement, composé principalement de jeunes prolétaires relativement inexpérimentés et politiquement non formés, a immédiatement été confronté à des difficultés majeures. Les années précédentes avaient conduit à une situation où il n’y avait pas de fraction marxiste organisée en dehors de la SDF (dominée par la clique de Hyndman), laissant le champ libre à diverses espèces de réformisme et en particulier à la Société fabienne et aux syndicats. Le noyau de militants formés théoriquement que Marx avait espéré voir se développer au sein de la Ligue socialiste n’est jamais apparu et ceux qui se réclamaient du marxisme étaient dispersés dans diverses organisations ou étaient des individus isolés. La véritable question qui se posait à la classe ouvrière était donc de savoir s’il était possible d’approfondir la dynamique, d’identifier et de combattre les forces du réformisme et de l’opportunisme qui se renforçaient dans le mouvement ouvrier international, et de construire un parti qui ne soit pas seulement socialiste, mais aussi marxiste.
Dans cette partie, nous commencerons par examiner la Société fabienne avant de nous pencher sur la fondation du Parti travailliste indépendant et sur la lutte entre les tendances réformistes et révolutionnaires au sein du mouvement ouvrier.
Fabian Society : opposer marxisme et guerre de classes
la Société fabienne a été fondée en 1884, mais ses racines remontent à un groupe appelé The Fellowship of the New Life, créé deux ans plus tôt dans le but d’établir une communauté utopique, bien qu’ils n’aient pu choisir entre Bloomsbury et le Pérou pour le lieu d’implantation. À l’origine, les Fabians étaient exclusivement composés de membres de la petite bourgeoisie et comprenaient des anarchistes et des chercheurs en psychologie. L’écrivain Bernard Shaw fut l’un des premiers membres influents. Si un certain nombre d’ouvriers ont par la suite rejoint les sections provinciales (souvent en combinant leur adhésion à d’autres groupes tels que la SDF et la Ligue socialiste), la direction londonienne est restée pratiquement la même, avec l’ajout de fonctionnaires du gouvernement tels que Sidney Webb, que Shaw a délibérément cherché à recruter pour contrer la « populace ». L’hostilité à la classe ouvrière et au marxisme était au cœur de leur activité théorique et politique. Dans les Fabian Essays in Socialism publiés en 1889, la théorie de la valeur du travail est rejetée au profit de la théorie de « l’utilité finale », tandis que l’analyse de la plus-value est opposée à une théorie fallacieuse de rentabilité. Le rôle de la lutte des classes est ridiculisé et déprécié afin de nier le rôle des révolutions dans l’histoire et de renforcer la notion d’évolution. La conséquence pratique de cette stratégie était de « pénétrer » le parti libéral et, par conséquent, de s’opposer à la dynamique d’indépendance qui animait la classe ouvrière à l’époque. Engels a caractérisé les Fabians comme « une clique de “socialistes” de la classe moyenne de divers calibres, allant des carriéristes aux socialistes sentimentaux et aux philanthropes, unis uniquement par leur crainte de la domination menaçante des travailleurs et faisant tout ce qui est en leur pouvoir pour écarter ce danger en sécurisant leur propre leadership… »(1). Il se montre tout aussi cinglant à l’égard de leur activité : « Les moyens employés par la Société fabienne sont exactement les mêmes que ceux des politiciens parlementaires corrompus : argent, intrigues et carriérisme. C’est la manière anglaise […] Ces gens sont plongés jusqu’au cou dans les intrigues du parti libéral, occupent des postes au sein du parti, comme par exemple Sidney Webb, qui est en général un véritable politicien britannique. Cette aristocratie fait tout ce contre quoi les travailleurs doivent être mis en garde ».
Au cours de la période précédant la conférence de Bradford qui a donné naissance au Parti travailliste indépendant (ILP), les dirigeants de la Société fabienne ont tenté de bloquer cette dynamique. En 1891, Sidney Webb écrivait dans le Workmen's Times : « La nature d’un Anglais ne semble convenir qu’à une lutte politique entre deux partis – le parti de l’ordre et le parti du progrès"(2). Trois mois avant la conférence, alors que sa préparation était activement en cours, il écrivit à nouveau : « Que pouvons-nous faire d’autre que de rire de votre folie […] La seule différence essentielle entre la Société fabienne et la SDF est que la Société fabienne veut d’abord cultiver les prunes et faire les tartes ensuite, tandis que la Fédération veut d’abord faire les tartes et ensuite trouver les prunes. C’est également l’idée du Parti travailliste indépendant, qui s’avère donc n’être rien d’autre qu’une tentative de recommencer ce que fait la SDF… »(3). Cette attaque provoqua une réponse au sein de la Société fabienne de la part d’un individu anonyme qui avait comme signature « Marxian » : « Si les grands pontes de la Société fabienne passaient seulement un peu de temps en dehors de la clique de Libéraux, ils pourraient voir à quel point leurs hypothèses sont erronées »(4). Lorsqu’il devint évident que le Parti travailliste indépendant allait être fondé malgré leurs efforts, la section londonienne de la Société fabienne, qui était composée des « gros bonnets », accepta d’y participer à la seule condition qu’elle puisse conserver une existence distincte, une condition qui n’avait été émise par aucune des autres sections provinciales. A la veille de la conférence, Shaw fit une dernière tentative en déclarant lors d’une réunion des délégués de la Société fabienne que la fondation d’un nouveau parti était prématurée.
La fondation du Parti travailliste indépendant : un pas vers le parti de classe
La Conférence de Bradford rassembla quelque 120 délégués, dont la grande majorité provenait des groupes de travailleurs indépendants nouvellement formés, mais aussi des délégués des organisations syndicales et des comités d’entreprise (Trades Councils), ainsi que des sections provinciales de la Société fabienne et de la SDF. La direction de cette dernière refusa de participer à ce qu’elle décrivit comme « une autre des nombreuses tentatives qui, de temps à autre, ont été entreprises pour faire reculer le véritable mouvement social-démocrate en Grande-Bretagne »(5). Les membres londoniens de la Société fabienne ne sont admis qu’à une voix près, à la suite de critiques sévères de leur comportement antérieur, dont une motion présentée par la section de Liverpool de la Société fabienne.
La conférence vote en faveur de l’adoption du nom Independent Labour Party (Parti travailliste indépendant) plutôt que Socialist Labour Party (Parti travailliste socialiste), mais se fixe alors comme objectif « d’assurer la propriété collective et communautaire des moyens de production, de distribution et d’échange »(6). Son programme comprenait l’abolition des heures supplémentaires, du travail à la pièce et du travail des enfants, la limitation de la journée de travail à 48 heures, l’aide aux malades et aux personnes âgées, l’introduction d’un impôt progressif sur le revenu et le soutien à « toute proposition visant à étendre les droits électoraux et à démocratiser le système de gouvernement ».
Le parti s’organise sur une base fédérale afin d’accommoder les groupes disparates présents à la conférence, mais la SDF et la section londonienne de la Société fabienne rejettent même cette idée, alors même que la plupart des sections provinciales de la Société fabienne se fondent immédiatement dans le Parti travailliste indépendant. La conférence a rejeté une motion interdisant aux membres du Parti travailliste indépendant d’adhérer à d’autres organisations (Shaw a spécifiquement défendu son appartenance à une association libérale), adoptant à la place la déclaration générale selon laquelle « toute personne opposée aux principes du parti ne sera éligible pour en devenir membre ». Conformément au principe fédéral, elle établit un Conseil consultatif national plutôt qu’un organe central plus puissant.
La réussite fondamentale de la conférence est d’avoir rassemblé un grand nombre des forces disparates qui avaient émergé au sein de la classe ouvrière au cours des années précédentes. Si son programme était largement limité aux revendications immédiates et si sa structure était provisoire, la nouvelle organisation n’en marquait pas moins un moment très important dans la vie de la classe ouvrière en Grande-Bretagne. A partir de la dynamique spontanée produite par l’intensification de la lutte des classes, le prolétariat avait forgé un instrument capable d’impulser et d’approfondir cette dynamique de manière consciente et organisée. En bref, il avait jeté les bases du parti de classe.
La faiblesse fondamentale de la nouvelle organisation était l’absence d’un courant marxiste organisé en son sein.
Néanmoins, la première évaluation du Parti travailliste indépendant par Engels était positive : « La Fédération social-démocrate d’une part et la Société fabienne d’autre part n’ont pas été en mesure, en raison de leur attitude sectaire, d’absorber la ruée vers le socialisme dans les provinces, de sorte que la formation d’un troisième parti était plutôt une bonne chose. Mais la ruée est devenue si importante, surtout dans les régions industrielles du Nord, que le nouveau parti était déjà, lors de ce premier congrès, plus fort que la Fédération sociale-démocrate ou la Société fabienne, voire plus fort que les deux ensemble. Et comme la quantité de membres est incontestablement très importante, que le centre de gravité se trouve dans les provinces et non à Londres, le centre des intrigues, et que le point principal du programme est le même que le nôtre, Aveling a eu raison d’adhérer et d’accepter un siège à l’Exécutif. Si les petites ambitions privées et les intrigues des prétendants londoniens sont quelque peu contenues ici et si sa tactique ne s’avère pas trop erronée, le Parti travailliste indépendant peut réussir à détacher les masses de la Fédération social-démocrate et, dans les provinces, de la Société fabienne également, les obligeant ainsi à s’unir »(7).
1893-95 : La croissance du réformisme
Au cours de ses deux premières années d’existence, l’ILP connaît une croissance rapide. En 1895, Keir Hardie revendique 35 000 membres, bien que l’analyse des cotisations versées donne un chiffre légèrement inférieur à 11 000(8). Le Parti travailliste indépendant a également recueilli un nombre important de voix lors de diverses élections locales et s’est employé activement à apporter un soutien aux chômeurs, dont le nombre ne cesse d’augmenter.
Cependant, cet élan vers l’avant ne se fait pas sans opposition, la Société fabienne et le Congrès des Syndicats (Trades Union Congress ou TUC) s’y opposant activement.
La première réaction de la Société fabienne a semblé être celle de reconnaître le bien-fondé de la décision de former l’ILP. En novembre 1893, Shaw et Sidney Webb écrivirent un article intitulé « To Your Tents, Oh Israel ! », qui attaquait le parti libéral et déclarait soutenir une représentation travailliste indépendante, ce qui poussa certains membres libéraux de la Société fabienne à partir. En réalité, il s’agit d’une manœuvre visant à maintenir l’influence de la Société fabienne, comme le reconnaît Beatrice Webb lorsqu’elle évoque leur « crainte d’être laissés pour compte » par l’ILP(9). Shaw, pour sa part, l’a décrit comme une concession aux « esprits les plus ardents » de la Société fabienne(10). Il a été suivi d’une proposition visant à ce que le TUC crée un fonds pour soutenir les candidats travaillistes, mais, en appelant à soutenir tous ces candidats et à ce que les candidats soient sélectionnés par les comités d’entreprise (Trades Councils), qui étaient contrôlés par les syndicats, son véritable objectif était de saper l’ILP.
Le TUC a adopté une attitude plus ouvertement hostile. En réponse aux efforts de l’ILP pour développer un bloc socialiste au sein du TUC, qui avait conduit à l’adoption d’une motion visant à créer un fonds de soutien aux candidats travaillistes indépendants, la commission parlementaire du TUC a proposé un certain nombre de mesures pour contrer l’influence des socialistes. Ces mesures comprenaient l’introduction de votes par carte basés sur l’appartenance syndicale, l’exclusion des comités d’entreprise (où l’ILP avait de nombreux représentants) et la restriction de la participation aux syndicalistes en activité ou aux responsables syndicaux. Ces propositions sont adoptées à une voix près par la commission et transmises au congrès de 1895, tandis que la motion précédente reste caduque.
Plus généralement, l’ILP est confronté à la vague de réformisme qui monte dans le mouvement ouvrier, la lutte pour le socialisme étant réduite à l’obtention de réformes ou confondue avec le renforcement de l’État. En Grande-Bretagne, ces illusions sont propagées par des journalistes populaires tels que Robert Blatchford, rédacteur en chef du Clarion, dont le livre Merrie England, publié en 1894, se vend à 750 000 exemplaires dès la première année. Il fait la distinction entre le socialisme « pratique », qu’il présente comme tout ce qui renforce la main guidant l’État (y compris la Poste et l’éducation obligatoire), et le socialisme « idéal », qui prévoit l’abolition de l’argent et de l’échange et qui est reporté à un avenir lointain. Le socialisme est présenté comme une émanation naturelle du capitalisme : « Le socialisme ne viendra pas par le biais d’un coup d’État soudain. Il naîtra naturellement de notre environnement et se développera naturellement et par degrés […] Il est trop tard pour demander quand nous allons commencer. Nous avons commencé […] Presque toutes les lois sont plus ou moins socialistes, car presque toutes les lois impliquent le droit de l’État à contrôler les individus pour le bénéfice de la nation ». Ceci s’accompagne d’un large éventail de clubs Clarion – cyclisme, vidéo, chorales et scouts – qui dissipent l’énergie militante de la classe tout en semant une dangereuse confusion.
L’ILP lui-même était loin d’être à l’abri de cette vague, notamment parce qu’il considérait les élections comme son principal domaine d’activité. Des carriéristes petits-bourgeois commencent également à être attirés par l’ILP, comme Ramsey Macdonald, qui quitte son poste d’agent rémunéré du parti libéral lorsque celui-ci refuse de l’accepter comme candidat. Lors de la deuxième conférence, en 1894, Keir Hardie est élu président, et déclare avec grandiloquence à l’ILP qu’il a décidé de renoncer à travailler en free-lance. Surtout, aucun groupe marxiste ne s’est encore développé. Aveling, qui s’opposait à Hardie, non seulement ne fut pas réélu au Conseil d’administration, mais fut même exclu de l’ILP en mai 1894.
Engels est désormais beaucoup moins confiant dans la capacité de l’ILP à relever ce défi : « Le Parti travailliste indépendant est extrêmement vague dans ses tactiques, et son chef, Keir Hardie, est un Écossais super rusé, dont les tours démagogiques ne sont pas du tout dignes de confiance ». Cependant, il continue d’affirmer qu’ « il y a de très bons éléments à la fois dans la Fédération sociale-démocrate et dans le Parti travailliste indépendant, en particulier dans les provinces, mais ils sont dispersés… » (11). Quelques mois plus tard, il va plus loin, écrivant qu’il n’y a « que des sectes et pas de parti », tout en insistant sur le fait que « l’instinct socialiste devient de plus en plus fort parmi les masses », tout en soulignant que « la soi-disant “démocratie” est ici très limitée par des obstacles indirects », tels que le coût des journaux politiques, les frais de participation aux élections et la domination des partis existants (12).
Les deux tendances se sont manifestées lors de la deuxième conférence : d’une part, les changements dans la composition du Conseil national d’administration (National Administrative Council, ou NAC) ont donné lieu à de nombreuses tractations en coulisses ; d’autre part, un certain nombre de mesures ont été prises pour renforcer l’organisation. La structure fédérale a été remplacée par une structure unifiée, une évolution qui reflétait simplement la réalité, un projet de constitution a été préparé et un Manifeste national a été adopté.
1895 : Vers la prochaine phase de la lutte
Les élections de 1895 donnent un aperçu de ce que l’ILP a accompli au cours de ses deux premières années d’existence. Superficiellement, l’ILP subit un revers : aucun siège n’est gagné et Hardie perd le sien. la Société fabienne s’en réjouit : " le résultat n’est pas tout à fait insatisfaisant […] le terrain devait être déblayé. L’ILP a achevé son suicide […]Tant que l’ILP existait en tant que force inconnue d’irréconciliables, la politique plus raisonnable d’imprégnation et de nivellement par le haut était totalement mise en échec »(13).
Cependant, en obtenant quelque 40 000 voix pour les 28 candidats qu’il présentait (il convient de rappeler que l’électorat était beaucoup plus restreint à cette époque) et en exposant dans la pratique l’hostilité du parti libéral à la représentation des travaillistes, il avait affirmé la nécessité et le fait de son existence en tant que force politique indépendante. S’il n’a pas évolué de manière décisive vers le statut de parti de classe, il n’est pas non plus retombé dans une secte, contrairement aux commentaires d’Engels. Il restait l’expression vigoureuse de la vie politique de la classe ouvrière et l’arène principale dans laquelle se déroulait la lutte entre les différentes tendances du mouvement ouvrier en Grande-Bretagne. Dans les années qui suivirent immédiatement l’élection, l’accent de cette lutte se déplaça vers la question de l’unité socialiste. Ce sera le sujet de la prochaine partie de notre série.
North, WR n° 215 (juin 1998)
>>> Retour à l’introduction et au sommaire [842]
1 Engels à Kautsky, Correspondance choisie, (1892)
2 Fabian Socialism and English Politics, Mc Briar (1966)
3 Origins of the Labour Party, Pelling (1954)
4 Fabian Socialism and English Politics, Mc Briar (1966)
5 Justice, avril 1893, cité dans The History of the Social-Democratic Federation, Crick
6 British Workers and the Independent Labour Party, Howell (1983)
7 Correspondance choisie, (1892)
8 British Workers and the Independent Labour Party, Howell (1983)
9 Fabian Socialism and English Politics, Mc Briar (1966)
10 Origins of the Labour Party, Pelling (1954)
11 Engels à Sorge, novembre 1894, Correspondance choisie
12 Engels à Hermann Schluter, janvier 1898, Correspondance choisie
Rubrique:
Bulletin de discussion de groupes de la Gauche communiste - Été 2023
- 211 lectures
Nous publions ci-dessous le second bulletin de discussion suite à la Déclaration commune contre la guerre de plusieurs groupes de la Gauche communiste. Ce positionnement et le débat international sont d'une grande importance face à une question aussi cruciale que celle de la défense de l'internationalisme prolétarien défendu traditionnellement par la Gauche communiste. Du fait de cette importance, ce document sera également traduit ultérieurement et publié dans une version française sur notre site.
- Communist Left discussion bulletin n°2 [850]
Vie du CCI:
- Débat [670]
- Correspondance avec d'autres groupes [250]
Courants politiques:
- Gauche Communiste [163]
Rubrique:
Panthéonisation de Manouchian: Un hymne patriotique contre la classe ouvrière
- 115 lectures
Enfin, des résistants « communistes » (entendez par là : « stalinien ») font leur entrée au Panthéon ! Durant tout le mois de février, dans tous les médias, on a parlé que de cela en boucle et célébré « l’Union sacrée » autour de la tombe du « héros ». Pour les députés de gauche qui défendaient ce dossier depuis 2010, c’est la consécration : « un grand moment de consensus » selon le porte-parole de l’Élysée, une « juste réparation mémorielle » d’après le député PCF, Pierre Dharréville. Le gouvernement Macron se gargarise : c’est par lui que sera faite la reconnaissance officielle des hauts faits d’armes et du « soutien à la France » par des combattants du Parti communiste français. La droite et la gauche du capital se sont retrouvés main dans la main pour célébrer le « héros ».
Comme à chaque panthéonisation, le choix du panthéonisé n’est pas dû au hasard des convictions du Président en place. Non, ces campagnes idéologiques savamment orchestrées servent toujours les intérêts idéologiques de l’État bourgeois : la bourgeoisie renforce le bourrage de crâne nationaliste en martelant une propagande valorisant la défense de la « démocratie » et l’esprit de sacrifice « pour la Patrie »… Porter aux nues ce résistant mort pour la défense de la liberté capitaliste alors qu’il luttait contre le fascisme permet de jouer sur la corde sensible de l’héroïsme et de l’abnégation.
Macron peut aussi compter sur les célébrations autour du cercueil de Manouchian pour l’aider à discréditer le RN tout en tentant de rassembler un peu l’électorat autour de lui. Effectivement, le parti populiste de Marine Le Pen ne cesse de monter dans les sondages, tout comme bon nombres de partis populiste en Europe et dans le monde. Et c’est pourquoi Macron l’attaque sur un de ses points faibles : son histoire. La question centrale de cet événement est d’ailleurs très vite devenue : est-ce que, oui ou non, le RN, compte-tenu de son passé, doit participer à la cérémonie ? La panthéonisation s’inscrit dans toute une série de manœuvres visant à renforcer la propagande contre les partis populistes, comme on a pu le voir récemment en Allemagne avec les immenses manifestations contre le « fascisme ». (1)
Toute cette campagne puante n’a fondamentalement qu’un seul but mensonger : celui de faire rentrer dans la tête des ouvriers que l’on peut être « communiste et patriote », que l’on peut être « communiste et participer de son plein gré à la guerre ».
Le PCF, auquel a pleinement adhéré Manouchian, avait trahi depuis bien longtemps le camp prolétarien en passant à la contre-révolution stalinienne. En août 1936, il proclamait à propos de la guerre en Espagne : « Notre parti frère a prouvé à maintes reprises que la lutte actuelle en Espagne ne se déroule pas entre capitalisme et socialisme, mais entre fascisme et démocratie » (sic !) « Dans un pays comme l’Espagne […], la classe ouvrière et tout le peuple ont […] comme seule tâche possible […] non pas de réaliser la révolution socialiste, mais de défendre, de consolider et de développer la révolution bourgeoise démocratique ». (2)
Le PCF s’est prostitué au capital en amenant les ouvriers à s’enrôler dans la guerre, au service d’un bloc militaire capitaliste, au travers une campagne idéologique anti-fasciste assourdissante. En 1939, après la signature du Pacte Germano-Soviétique, le même PCF, obéissant à la même logique d’intérêts impérialistes, a changé de camps appelant « à la fraternisation avec les prolétaires d’Allemagne ». Tout cela, pour retourner sa veste une nouvelle fois après la déclaration de guerre de l’Allemagne à l’URSS qui elle-même s’est retrouvée du « bon côté », celui des Alliés…
C’est toute cette vilenie que symbolise Manouchian, ce « héros » du capital, instrumentalisé aujourd’hui par l’État : un digne représentant de la trahison du PCF en même temps qu’un pur produit du lavage de cerveau engendré par sa propagande de masse.
Refusons cette sinistre propagande patriotarde et cette nouvelle communion théâtralisée derrière le drapeau tricolore. Rappelons-nous que « les prolétaires n’ont pas de patrie » !
B.E., 25 mars 2024
1 Voir à ce propos : « Comment la classe dominante exploite la décomposition de la société contre la classe ouvrière ? [851] » publié sur le site web du CCI.
2 Voir notre brochure : Comment le PCF est passé au service du capital [852].
Situations territoriales:
Personnages:
- Manouchian [853]
- Emmanuel Macron [854]
Rubrique:
ICConline - avril 2024
- 32 lectures
Tuerie terroriste en Russie: le capitalisme s’enfonce toujours plus dans le chaos généralisé!
- 116 lectures
Faisant écho aux 800 civils et 300 soldats israéliens tués lors du raid du Hamas en Israël le 7 octobre dernier, un nouveau déchaînement de barbarie vient ajouter 150 morts et 300 blessés fauchés par balles, certains égorgés au couteau, par un commando de l’État islamique (EI) lors de l’assaut d’un concert rock, le 25 mars, en périphérie de Moscou. Entre ce deux événements tragiques, les horreurs de l’offensive israélienne à Gaza et l’intensification de la guerre sanglante entre la Russie et l’Ukraine n’en finissaient plus d’emporter des innocents dans la tombe et raser des villes entières : la première est responsable de plus de 32 000 morts, dont plus de 13 000 enfants. Et la combinaison mortifère entre la poursuite des bombardements, l’aggravation de la famine et la diffusion des épidémies au sein d’une population littéralement à bout de souffle, ne peut que fortement alourdir bilan. Le deuxième, l’intensification de la guerre en Ukraine, est venue alourdir le bilan de deux ans du conflit ukrainien qui atteint maintenant le chiffre effrayant des 500 000 morts au moins dans les deux camps, sans compter les victimes civiles, les ruines et la désolation qui constituent désormais l’environnement d’une partie de l’Ukraine et qui menace aussi la ville russe de Belgorod régulièrement bombardée par l’artillerie ukrainienne, mais aussi Moscou elle-même et une large partie de la Russie.
Les guerres inhérentes du capitalisme décadent ne sont plus, depuis l’effondrement du bloc de l’Est et la dissolution de celui de l’ouest en 1990, canalisées au niveau mondial à travers les tensions entre deux blocs impérialistes rivaux plus ou moins disciplinés, mais obéissent de plus en plus à la logique du chacun pour soi, au chaos généralisé. L’évolution de la situation mondiale vient fournir une concrétisation caricaturale de cette tendance dans la mesure où un pays, la Russie, est maintenant en guerre avec deux adversaires qui n’ont passé aucune alliance entre eux, respectivement l’Ukraine et l’État Islamique.
Car derrière la monstruosité de l’attentat de Moscou, c’est toute la gravité de la situation mondiale qui transparaît. En incitant la Russie à envahir l’Ukraine afin qu’elle s’affaiblisse dans ce conflit, les États-Unis ne souhaitaient pas provoquer son effondrement, avec tous les immenses risques qu’une dislocation de ce pays comporte. Pourtant, c’est aujourd’hui un risque sérieux.
Une situation de chaos aux marges de la Russie
L’EI, le boucher de l’attentat dans la banlieue de Moscou, est lui aussi emblématique de la tendance au chaos généralisé. De plus en plus, de sinistres milices prennent part aux conflits impérialistes en cherchant à imposer leur loi par la terreur et s’entre-tuent elles-mêmes parfois, toujours sous la bannière de l’intégrisme religieux à l’image d’Al Qaïda, du Hezbollah,…
L’État islamique au Khorassan (l’EI-K), qui a revendiqué l’attaque à Moscou, est une branche afghane du groupe terroriste. Elle a diffusé un message de revendication, accompagné d’une vidéo montrant les quatre assaillants en action. Nul doute possible quant à la signification de cet acte barbare qui est aussi un acte de guerre et n’est pas sans antécédents en Russie. Le 31 décembre 2018, un immeuble d’une ville de l’Oural explosait déjà, tuant 39 personnes. Quelques heures plus tard, la ville était le théâtre d’un affrontement armé. L’EI-K avait récemment fait la démonstration de ses capacités « militaires » puisqu’il est l’origine de l’attaque perpétrée en Iran, le 3 janvier, qui avait fait près de quatre-vingt-dix morts. Ses membres, qui mènent des attaques particulièrement brutales en Afghanistan, contre des écoles de filles ou des hôpitaux, sont même aujourd’hui en lutte ouverte avec les talibans.
La rivalité entre l’EI-K et Moscou est la conséquence d’une fragilisation de la Russie à ses frontières qui a permis l’infiltration du groupe terroriste dans les ex-Républiques soviétiques d’Asie centrale (Kirghizie, Ouzbékistan, Kazakhstan et Tadjikistan dont sont originaires les auteurs de l’attentat) et de certaines républiques autonomes de la Fédération de Russie elle-même. Le rapprochement entre Moscou et les talibans s’explique ainsi par le besoin de la Russie de défendre son influence dans la région. Mais cela signifie pour la Russie l’ouverture d’un deuxième front militaire dans une situation où elle s’épuise dans une guerre interminable en Ukraine.
De grandes difficultés en perspectives pour Poutine et la Russie
La manière dont Poutine a géré l’attentat terroriste à Moscou ne peut qu’entraîner un affaiblissement de sa crédibilité. Sa réaction première consistant à en attribuer la responsabilité directe ou indirecte à l’Ukraine a été grotesque alors que tout désignait l’EI comme responsable, les États-Unis ayant précédemment alerté différents pays, dont la Russie, possiblement ciblés par des attentats terroristes. Lorsqu’il a réalisé son erreur, Poutine en a rajouté dans le grotesque en déclarant que le doute continuait d’exister quant au commanditaire de l’attentat. C’est alors que la revendication de l’attentat par l’EI lui a cloué le bec. Il ne pouvait faire autre chose que profil bas, d’autant moins qu’il existait un précédent venant étayer la vraisemblance de l’alerte transmise par les services de renseignement américains.
En effet, cette attaque terroriste pouvait d’autant moins constituer une surprise pour le Kremlin que « Vladimir Poutine s’alarmait déjà, le 15 octobre 2021, “des ambitions et des forces du groupe djihadiste État islamique en Afghanistan”, soulignant “l’expérience de combat” acquise par ses membres en Irak et en Syrie ». Poutine, s’interrogeant sur la capacité des talibans afghans à vaincre ces groupes armés, estimait alors que « les chefs de l’EI préparent des plans pour étendre leur influence dans les pays d’Asie centrale et des régions russes en attisant les conflits ethno-confessionnels et la haine religieuse ». (1) Qui plus est, l’EI-K avait déjà organisé un attentat contre l’ambassade de Russie à Kaboul en septembre 2022. Poutine vient ainsi de commettre un énorme faux pas, qui ne passera certainement pas inaperçu, au moment où il lance une campagne de conscription de printemps, appelant 150 000 personnes au service militaire obligatoire, en gros : une campagne de réquisition de la chair à canon pour la guerre. Ce faux pas ne peut que miner son autorité et sa légitimité face à ses rivaux.
Alors que la guerre affaiblit toujours un peu plus l’autorité du Kremlin, les risques d’une dislocation pure et simple de la fédération de Russie s’accroissent. Au premier rang des conséquences d’une telle dislocation se trouve la dissémination de l’arsenal nucléaire entre différents seigneurs de guerres aux menées non contrôlables. Cela représenterait aussi une formidable fuite en avant dans le chaos, au cœur d’une région particulièrement stratégique pour l’économie mondiale (matière première, transport…). Ainsi, loin de profiter à un belligérant quelconque ce nouveau foyer de guerre est porteur de conséquences dramatique considérables pour toute une partie du monde.
Fern, 3 avril 2024
1 « Attentat près de Moscou : l’Asie centrale, nouvelle tête de pont de l’organisation État islamique », Le Monde (25 mars 2024).
Géographique:
- Russie, Caucase, Asie Centrale [369]
- Russie [393]
Personnages:
- Poutine [394]
Récent et en cours:
- Guerre en Ukraine [397]
- Attentats [528]
Rubrique:
Permanence en ligne le samedi 27 avril 2024
- 58 lectures
Le Courant Communiste International organise une permanence en ligne le samedi 27 avril 2024 à 15h.
Ces permanences sont des lieux de débat ouverts à tous ceux qui souhaitent rencontrer et discuter avec le CCI. Nous invitons vivement tous nos lecteurs et tous nos sympathisants à venir débattre afin de poursuivre la réflexion sur les enjeux de la situation et confronter les points de vue. N'hésitez pas à nous faire part des questions que vous souhaiteriez aborder.
Les lecteurs qui souhaitent participer aux permanences en ligne peuvent adresser un message sur notre adresse électronique ([email protected] [213]) ou dans la rubrique « nous contacter [214] » de notre site internet, en signalant quelles questions ils voudraient aborder afin de nous permettre d’organiser au mieux les débat.
Les modalités techniques pour se connecter à la permanence seront communiquées ultérieurement.
Vie du CCI:
- Permanences [291]
Rubrique:
Pays-Bas: Populisme et anti-populisme, deux visages politiques de la classe dirigeante
- 90 lectures
Selon les commentateurs bourgeois, un raz-de-marée politique a eu lieu aux Pays-Bas en novembre. Les élections ont failli donner à l’ensemble des partis une majorité absolue, et le PVV de Geert Wilders est devenu de loin le plus grand parti. Un certain nombre de partis traditionnels, piliers du système politique pendant des décennies, ont vu leurs sièges au parlement réduits de moitié, comme les chrétiens-démocrates, ou ont survécu grâce à la formation d’un cartel comme dans le cas des sociaux-démocrates du PvdA dans un cartel avec la Gauche Verte. Dans un précédent article, nous posions la question de la situation politique aux Pays-Bas après les élections : un « nouvel élan » ou encore plus de chaos et d’instabilité ? Il est désormais certain que c’est cette dernière qui dominera de plus en plus la scène politique aux Pays-Bas dans la période à venir.
La croissance constante du populisme aux Pays-Bas
Ce n’est pas la première fois aux Pays-Bas qu’un parti populiste réalise des gains aussi importants. En 2002, la liste Pim Fortuyn l’avait déjà fait, suivie en 2010 par le PVV de Wilders, en 2019 par le Forum pour la démocratie de Thierry Baudet, et lors des élections sénatoriales de 2023 par le Boer Burger Beweging (Mouvement Paysan Citoyen). Mais en novembre 2023, le populisme a réussi à conquérir une position de premier plan sans précédent dans la politique néerlandaise.
En l’absence de l’ancien Premier ministre Mark Rutte, qui avait réussi à neutraliser les précédentes explosions populistes, Wilders a habilement joué sur le mécontentement face à l’austérité existante en émaillant sa propagande d’une campagne ouvertement raciste anti-immigrés pour « faire passer les Néerlandais en première position ». « Nous devons reprendre le contrôle de nos frontières, de notre argent et de nos lois. Nous devons également reprendre notre souveraineté nationale. Nous devons reconquérir les Pays-Bas »[1]. Il s’agit clairement d’une politique de bouc émissaire : les migrants à la recherche d’un logement sont accusés d’être responsables de la pénurie de logements. La gauche qui défend les mesures climatiques est accusée d’être responsable de la hausse du coût de la vie. L’élite politique (qui se « remplissent les poches ») est accusée d’être responsable de la perte de l’identité néerlandaise. C’est ce cocktail démagogique avec lequel le PVV a réussi à attirer près d’un quart des Néerlandais.
Le populisme n’est pas seulement un phénomène néerlandais, mais une réalité mondiale
Bien que les Pays-Bas aient été l’un des premiers pays occidentaux où le populisme a pu acquérir une influence majeure, il ne s’agit pas d’un phénomène typiquement néerlandais. Le populisme s’est déjà fait remarquer par des victoires électorales retentissantes ou des participations gouvernementales dans différents pays : en Europe il y a eu la participation gouvernementale du Mouvement 5 étoiles et de la Ligue du Nord en Italie, ou le « mouvement » pour le Brexit et la clique dirigeante autour de Boris Johnson au sein du parti conservateur en Grande-Bretagne. En Amérique du Sud, il faut pointer la montée en puissance, d’abord de Bolsenaro au Brésil et actuellement de MileÏ en Argentine. Aux États-Unis, le populisme menace à travers la candidature de Trump pour le Parti républicain dans le cadre de l’élection présidentielle de novembre.
Le populisme, qui a le vent en poupe depuis le début du XXIe siècle :
- « n’est pas, bien sûr, le résultat d’une volonté politique consciente de la part des secteurs dirigeants de la bourgeoisie ». Au contraire, elle confirme la tendance à « une perte croissante de contrôle de la classe dominante sur son appareil politique »[2] ;
- s’accompagne d’une « perte fondamentale de confiance dans les 'élites' (...) parce qu’ils sont incapables de rétablir la santé de l’économie, de mettre fin à l’augmentation constante du chômage et de la misère ». Cependant, cette révolte contre les dirigeants politiques n’aboutit en rien à « une perspective alternative au capitalisme »[3].
Le populisme est une expression typique de la pourriture sur pied du capitalisme, une réaction à l’accumulation de problèmes qui ne sont pas vraiment abordés par les partis politiques établis, ce qui conduit à des difficultés croissantes. Tous ces problèmes non résolus alimentent à la fois les contradictions internes entre les fractions bourgeoises et la rébellion de la petite bourgeoisie, et c’est là le terreau du comportement vandaliste des tendances populistes.
Tant que la classe ouvrière ne parviendra pas par le développement de ses luttes à imposer de manière décisive son alternative révolutionnaire à la décomposition capitaliste, les courants populistes continueront à dominer l’agenda politique. Caractérisés par l’absence d’une vision de l’avenir de la société et la tendance à se tourner vers le passé pour chercher des boucs émissaires qu’ils peuvent tenir pour responsables de l’évolution catastrophique actuelle, ces populistes déstabiliseront de plus en plus, avec leurs positions irrationnelles, la scène politique bourgeoise.
Perte de contrôle sur l’appareil politique et antagonismes croissants entre fractions bourgeoises
Dans les années 1990, le système politique néerlandais reposait essentiellement sur 3 ou 4 partis centraux : le CDA chrétien-démocrate, le PvdA socialiste, le VVD et D66 tous deux libéraux. Ces dernières années, il est devenu une mosaïque en constant changement avec un nombre croissant de partis dissidents. Non seulement les députés passent régulièrement d’un parti à l’autre, mais le nombre de partis augmente également régulièrement au cours d’une législature, car des députés quittent leur parti et continuent de siéger comme « faction indépendante ». C’est le résultat, d’une part, de contradictions au sein de la bourgeoisie néerlandaise qui remontent plus clairement à la surface, et d’autre part, d’un mécontentement général à l’égard de la gouvernance des partis traditionnels, qui se traduit par l’émergence de partis qui se profilent autour d’un thème spécifique.
Les contradictions au sein de la bourgeoisie concernant l’emprise croissante de l’UE sur la politique néerlandaise deviennent de plus en plus évidentes à travers l’opposition :
- à ce qui est considéré comme une perte de souveraineté au profit d’un « super-État européen » non démocratique et bureaucratique ; les Pays-Bas ont voté contre l’introduction d’une constitution européenne lors d’un référendum en 2005 ;
- à l’accord d’association avec l’Ukraine en 2016 ; les Pays-Bas ont été le seul pays de l’UE à rejeter l’accord en raison de leur opposition à la prise de décision « antidémocratique » de Bruxelles et pour éviter que la corruption ukrainienne ne déferle sur l’Europe ;
- par les partis populistes à toute participation à une armée européenne et certains s’opposent même à une coopération accrue dans le domaine militaire avec un pays comme l’Allemagne.
En 2024, le Parlement est "occupé" par un éventail de partis populistes, plus ou moins importants, dont les positions convergent quant à leur aversion pour la loi européenne sur la préservation de la nature, leur aversion pour la politique migratoire européenne, pour les livraisons d’armes à l’Ukraine, mais aussi quant à leur opposition à l’UE et l’OTAN. En outre, chacun de ces partis a également son propre thème de prédilection politique : pour le PVV, c'est "moins de Marocains", pour le NSC " à bas les magouilles politiques de l’ombre", et pour le BBB "contre les diktats de La Haye".
Les élections de novembre dernier ont rendu la situation extrêmement compliquée pour la bourgeoisie néerlandaise, en particulier en ce qui concerne l’UE. En effet, avec un ou deux partis populistes au gouvernement, ce qui semble inévitable, un fort vent anti-UE va inévitablement souffler. Ici et là, on parle même d’une « sortie » des Pays-Bas de l’UE (un « Nexit »). Bien qu’il ne mène probablement pas aussi loin que le Brexit, ce vent anti-UE exercera une forte pression sur la position des Pays-Bas au sein de l’UE. Si les différents partis populistes ne font pas confiance aux « l’élites » établies, cela ne signifie pas automatiquement qu’ils se font mutuellement confiance, bien au contraire. Lors des négociations pour la formation d’un nouveau gouvernement, la méfiance mutuelle était déjà nettement présente. L’instabilité du système politique aux Pays-Bas et l’impact de ceci sur la politique à l’égard de l’Europe dans son ensemble menacent de prendre des proportions inquiétantes pour la bourgeoisie.
Campagnes populistes et anti-populistes
Le populisme est une expression typique de la phase de décomposition du capitalisme, du chacun pour soi, des frictions croissantes au sein de la bourgeoisie, qui réduisent de plus en plus la capacité de cette dernière à formuler une réponse cohérente aux différentes manifestations de la crise. Mais la bourgeoisie est assez intelligente pour utiliser les effets négatifs de la décomposition contre son plus grand ennemi : la classe ouvrière. Elle utilise ainsi le phénomène populiste pour créer une contradiction fictive et promouvoir massivement l'anti-populisme :
- D’un côté, les partis populistes imposent leur discours en utilisant « des allégations, des accusations et la diabolisation de l’autre » (Sigrid Kaag du parti de centre-gauche D'66). Ce faisant, ils utilisent une forme de démagogie à l’encontre de l’ordre politique existant et des ‘élites’ politiques dirigeantes, ils dénigrent les mesures prises, ce qui est sans nul doute salué par une partie de la population néerlandaise. Dans le même temps, les partis populistes parviennent également à séduire une partie de la population, non seulement par des mesures irréalistes telles que la fermeture des frontières aux migrants, mais aussi par des mesures « sociales » tout aussi fallacieuses en faveur des "vrais Néerlandais", telles que l’abaissement de l’âge de la retraite, une augmentation du salaire minimum ou une baisse des primes de santé ;
- D’autre part, les organisations de gauche attisent le feu en présentant le populisme comme le plus grand danger qui nous menace. Non seulement l’ultra-gauche, mais même la propagande sociale-démocrate assimile plus ou moins le populisme au totalitarisme, au racisme ou même au fascisme. Frans Timmermans, le candidat de gauche au poste de Premier ministre, s’est immédiatement exclamé après la victoire électorale du PVV : « L’heure est venue pour nous de défendre la démocratie ! ». Aussi, les anti-populistes maintiennent un refus catégorique, pour des "raisons de principe", de participer à une coalition gouvernementale avec le PVV.
Tout comme le Royaume-Uni était divisé il y a quelques années en un camp pro et anti-Brexit, les Pays-Bas sont actuellement divisés en un camp pro-Wilders et un camp anti-Wilders. En attisant cette opposition, la bourgeoisie tente d'attirer une partie de la classe ouvrière derrière elle dans des actions allant de blocages de nouveaux centres pour demandeurs d'asile à des manifestations contre des rassemblements de populistes, qui visent toutes à miner la lutte sur le terrain de classe et à mobiliser les travailleurs sur les objectifs de l'un ou l'autre camp bourgeois.
Quel que soit le camp au pouvoir, les attaques contre les revenus et les conditions de vie des travailleurs se poursuivront sans relâche car elles sont le résultat des ondes de choc militaires, économiques et environnementales qui secouent les fondations du système capitaliste. Les travailleurs doivent donc continuer à mener la bataille sur le terrain où ils peuvent, en toute indépendance, développer pleinement leur force. En suivant l'exemple des travailleurs du Royaume-Uni qui, malgré des années de campagne assourdissante sur le Brexit entre "Remainers" et "Leavers", ont tout de même développé une lutte unie d'un an contre les effets de la crise du "coût de la vie" à partir de l'été 2022. Aux Pays-Bas également, la classe ouvrière a montré il y a un an qu'elle avait la volonté et la capacité de s'opposer aux mesures désastreuses de la bourgeoisie[4]. En s'inscrivant dans la dynamique des luttes ouvrières internationales de l’année écoulée au Royaume-Uni, en France, aux États-Unis, elle peut s’inscrire dans une résistance internationale contre ce système obsolète et moribond, qui va de catastrophe en catastrophe.
Dennis / 2024.04.05
Personnages:
- Wilders [856]
- Geert Wilders [857]
Récent et en cours:
- Elections Pays-Bas [858]
- PVV [859]
- Thierry Baudet [860]
- Pim Fortuyn [861]
- Nexit [862]
Rubrique:
ICConline - mai 2024
- 35 lectures
Guerres entre la Russie et l’Ukraine, Israël et l’Iran... Un pas supplémentaire dans la barbarie capitaliste
- 202 lectures
Les guerres mondiales du XXe siècle ont montré que le capitalisme était devenu un système social totalement obsolète. Elles ont été suivies d’une « guerre froide » entre deux blocs impérialistes, au cours de laquelle les conflits par procuration ont tué autant de personnes que les guerres mondiales. L’ancien système des blocs s’est effondré dans les années 1990, mais les guerres impérialistes n’ont pas disparu. Elles sont simplement devenues plus chaotiques et imprévisibles. Parmi les nombreuses guerres qui ravagent la planète aujourd’hui, le carnage en Ukraine et au Moyen-Orient sont les preuves les plus évidentes (aux côtés d’une crise écologique que le système ne peut pas à résoudre) que le déclin du capitalisme a atteint sa phase terminale, menaçant même la survie de l’espèce humaine.
Afin de discuter de ces questions, le CCI organise des réunions publiques, partout où il est présent, en France et dans le monde. Ces réunions seront l’occasion de débattre du contexte historique de la guerre au Moyen-Orient et de faire valoir que la seule réponse possible à la guerre est la défense intransigeante de l’internationalisme contre toutes les fausses réponses offertes par ceux qui défendent l’une ou l’autre forme de nationalisme, et contre tous les États et gouvernements capitalistes, d’Israël à l’Iran et au Hamas, de la Russie à l’Ukraine, des États-Unis à la Chine. Toutes leurs guerres sont des guerres impérialistes génocidaires, et la seule puissance sur terre qui peut mettre fin au cauchemar du capitalisme en décomposition est la classe ouvrière internationale.
Ces réunions sont des lieux de débat ouverts à tous ceux qui souhaitent rencontrer et discuter avec le CCI. Nous invitons vivement tous nos lecteurs, contacts et sympathisants à venir y débattre afin de poursuivre la réflexion sur les enjeux de la situation et confronter les points de vue.
– Toulouse : samedi 25 mai à 14h, Salle Thierry PREVOT, 3 rue Escoussières Arnaud Bernard 31000 Accès métro ligne B - station métro Jeanne d’Arc. (ATTENTION : changement d'adresse)
– Paris : samedi 25 mai à 15h, CICP, 21ter rue Voltaire, 75011 Paris, métro « Rue des Boulets »
– Nantes : samedi 25 mai à 15h, Salle de la Fraternité, 3 rue de l’Amiral Duchaffault (quartier Mellinet, station tramway Duchaffault, ligne 1)
– Bruxelles: samedi 25 mai à 14h, Pianofabriek, rue du Fort 35, 1060 St Gilles
– Marseille : samedi 1er juin à 15h, Mille Babords. 61 Rue Consolat. Métro « Réformés ».
– Lille : samedi 8 juin à 15h, café les Sarrasins, 52 rue des Sarrasins (métro Gambetta).
– Lyon : samedi 22 juin à 15h, CCO La rayonne, 28 rue Alfred du Musset, 69110 Villeurbanne, métro ligne A « Vaulx-en-Velin La soie ».
Vie du CCI:
- Réunions publiques [219]
Rubrique:
Manifestations pro-palestiniennes dans le monde: Choisir un camp contre un autre, c’est toujours choisir la barbarie capitaliste!
- 343 lectures
L’épouvantable offensive israélienne sur la bande de Gaza a emporté, en quelques mois, des dizaines de milliers de vies dans un torrent furieux de barbarie. Des civils innocents, des gosses et des vieillards meurent par milliers, écrasés sous les bombes ou froidement abattus par la soldatesque israélienne. À l’horreur des balles, il faut encore ajouter les victimes de la faim, de la soif, des maladies, des traumatismes… La bande de Gaza est un charnier à ciel ouvert, une immense ruine symbole de tout ce que le capitalisme a désormais à offrir à l’humanité. Ce qui se passe à Gaza est une monstruosité !
Comment ne pas être écœuré par le cynisme de Netanyahou et sa clique de religieux fanatiques, par le nihilisme froid des assassins de Tsahal ? Comment ne pas s’emporter quand la moindre expression d’indignation est aussitôt qualifiée « d’antisémitisme » par des éditorialistes de bas étage et les propagandistes de Tel Aviv ? Forcément, les images de l’horreur et les témoignages des survivants ne peuvent que glacer le sang. Même au sein de la population israélienne, pourtant traumatisée par les crimes ignobles du 7 octobre et soumise au rouleau compresseur de la propagande belliciste, l’indignation est palpable. Les rassemblements de soutien aux Palestiniens se multiplient dans le monde : à Paris, à Londres et, surtout, aux États-Unis où les campus universitaires sont le théâtre de mobilisations particulièrement étendues.
L’indignation est on ne peut plus sincère, mais les révolutionnaires ont la responsabilité de le dire haut et fort : ces manifestations ne se situent, ni de près ni de loin, sur le terrain de la classe ouvrière. Elles représentent au contraire un piège mortel pour le prolétariat !
Le capitalisme, c’est la guerre !
« Cessez-le-feu immédiat ! », « Paix en Palestine ! », « Accord international ! », « Deux nations en paix ! »… Les appels à la « paix » se sont multipliés ces dernières semaines dans les manifestations et les tribunes. Une partie des organisations de la gauche du capital (les trotskistes, les staliniens et toutes les variantes de la gauche "radicale" comme LFI en France), n’ont que le mot « paix » à la bouche.
C’est une pure mystification ! Les ouvriers ne doivent se faire aucune illusion sur une prétendue paix, ni au Proche-Orient ni ailleurs, pas plus que sur une quelconque solution de la « communauté internationale », de l’ONU, du Tribunal international ou de n’importe quel autre repaire de brigands capitalistes. Malgré tous les accords et toutes les conférences de paix, toutes les promesses et les résolutions de l’ONU, le conflit israélo-palestinien dure depuis plus de 70 ans et n’est pas près de cesser. Ces dernières années, à l’image de toutes les guerres impérialistes, ce conflit n’a fait que s’amplifier, gagner en violence et en atrocité. Avec les récentes exactions du Hamas et de Tsahal, la barbarie a pris un visage encore plus monstrueux et délirant, dans une logique de terre brûlée jusqu’au-boutiste qui montre que le capitalisme ne peut rien offrir d’autre que la mort et les destructions.
Alors, à la question : « la paix peut-elle régner dans la société capitaliste ? », nous répondons catégoriquement : non ! Les révolutionnaires du début du XXe siècle avaient déjà clairement mis en évidence que, depuis 1914, la guerre impérialiste est devenue le mode de vie du capitalisme décadent, le résultat inéluctable de sa crise historique. Et parce que la bourgeoisie n’a aucune solution à la spirale infernale de la crise, il faut le dire très clairement : le chaos et les destructions ne peuvent que se répandre et s’amplifier à Gaza comme à Kiev et partout dans le monde ! La guerre à Gaza menace d’ailleurs d’embraser toute la région.
Le pacifisme, une impasse pour mieux préparer… la guerre !
Mais au-delà de l’impasse que représentent les appels à la paix sous le joug du capitalisme, le pacifisme demeure une mystification dangereuse pour la classe ouvrière. Non seulement cette idéologie n’a jamais empêché une guerre, mais il les a au contraire toujours préparées. Déjà en 1914, la social-démocratie, en posant le problème de la guerre sous l’angle du pacifisme, avait justifié sa participation au conflit au nom de la lutte contre les « fauteurs de guerre » du camp d’en-face et le choix du « moindre mal ». C’est parce qu’on avait imprégné la société de l’idée que le capitalisme pouvait exister sans guerre que la bourgeoisie a pu assimiler le « militarisme allemand », pour les uns, et l’« impérialisme russe », pour les autres, au camp de ceux qui voulaient attenter à la « paix » et qu’« il fallait combattre ». Le pacifisme depuis lors, de la Seconde Guerre mondiale à la guerre en Irak, en passant par les innombrables conflits de la guerre froide, n’a été qu’une succession de complicité éhontée avec tel ou tel impérialisme contre les « fauteurs de guerre » afin de mieux dédouaner le système capitaliste.
La guerre à Gaza n’échappe en rien à cette logique. Instrumentalisant le dégoût légitime que suscitent les massacres à Gaza, la gauche « pacifiste » appelle sans détour à soutenir un camp contre un autre, celui de la « nation palestinienne » victime du « colonialisme israélien », en affirmant, la main sur le cœur : « Nous défendons les droits du “peuple palestinien”, pas le Hamas ». C’est rapidement oublier que « le droit du peuple palestinien » n’est qu’une formule hypocrite destinée à dissimuler ce qu’il faut bien appeler l’État de Gaza, une façon sournoise de défendre une nation contre une autre. Une bande de Gaza « libérée » ne signifierait rien d’autre que consolider l’odieux régime du Hamas ou de toute autre faction de la bourgeoisie palestinienne, de tous ceux qui n’ont jamais hésité à réprimer dans le sang la moindre expression de colère, comme en 2019 lorsque le Hamas, qui vit en véritable prédateur sur le dos de la population gazaouie, a maté avec une brutalité inouïe des manifestants exaspérés par la misère. Les intérêts des prolétaires en Palestine, en Israël ou dans n’importe quel autre pays du monde ne se confondent en rien avec ceux de leur bourgeoisie et la terreur de leur État !
Le trotskisme dans son traditionnel rôle de sergent recruteur
Les organisations trotskistes, particulièrement présentes dans les universités, ne s’embarrassent même plus du verbiage hypocrite du pacifisme pour alimenter la sale propagande belliciste de la bourgeoisie. Sans aucune vergogne, elles appellent à soutenir la « résistance du Hamas ». Au nom des « luttes de libération nationale contre l’impérialisme » (frauduleusement présentée comme une position des bolcheviks sur la question nationale), elles cherchent à mobiliser la jeunesse sur le terrain pourri du soutien à la bourgeoisie palestinienne, avec des relents d’antisémitisme à peine voilés, comme nous avons pu l’entendre dans les universités : « À l’université de Columbia, à New York, des manifestants ont été filmés en train de scander : “[…] Brûlez Tel-Aviv [...] Oui, Hamas, nous t’aimons. Nous soutenons aussi tes roquettes”. Un autre s’écrie : “Nous ne voulons pas de deux États, nous voulons tout le territoire”. Dans la même veine, certains étudiants ne se contentent plus de scander “Du fleuve à la mer, la Palestine sera libre”, ils brandissent désormais des pancartes en arabe. Le problème, c’est qu’il est écrit : “De l’eau à l’eau, la Palestine sera arabe”, c’est-à-dire qu’il n’y aura pas de Juifs du Jourdain à la mer Méditerranée ». (1)
Les organisations trotskistes ont une longue tradition de soutien à un camp bourgeois dans la guerre (Vietnam, Congo, Irak…), d’abord au service des intérêts du bloc de l’Est pendant la guerre froide, (2) puis en faveur de toute expression d’anti-américanisme.
Le conflit israélo-palestinien demeure toutefois un leitmotiv de l’indignation sélective du trotskisme. Hier, la « cause palestinienne » était un prétexte pour soutenir les intérêts de l’URSS dans la région face aux États-Unis. Aujourd’hui, ces organisations instrumentalisent la guerre à Gaza en faveur de l’Iran, du Hezbollah et des « rebelles » Houtis face au même « impérialisme américain » et son allié israélien. L’internationalisme revendiqué du trotskisme, c’est l’Internationale des crapules !
Pour mettre fin à la guerre, il faut renverser le capitalisme
Contrairement à tous les mensonges des partis de gauche du capital, les guerres sont toujours des affrontements entre des nations concurrentes, entre des bourgeoisies rivales. Toujours ! Jamais une guerre n’est menée au profit des exploités ! Ils en sont au contraire les premières victimes.
Partout, les ouvriers doivent refuser de prendre parti pour un camp bourgeois contre un autre. La solidarité des ouvriers ne va ni à la Palestine ni à Israël, ni à l’Ukraine ni à la Russie, ni à aucune nation ! Leur solidarité, ils la réservent à leurs frères de classe vivant en Israël et en Palestine, en Ukraine et en Russie, aux exploités du monde entier ! L’histoire a montré que la seule véritable réponse aux guerres que déchaîne le capitalisme, c’est la révolution prolétarienne internationale. En 1918, grâce à un immense élan révolutionnaire dans toute l’Europe, débuté en Russie un an plus tôt, la bourgeoisie a été contrainte de stopper l’une des plus grandes boucheries de l’histoire.
Certes, nous sommes aujourd’hui encore loin de cette perspective. Pour la classe ouvrière, il est difficile d’entrevoir une solidarité concrète et encore moins de s’opposer directement à la guerre et ses horreurs. Cependant, à travers la série inédite de luttes ouvrières qui frappent de nombreux pays depuis deux ans, en Grande-Bretagne, en France, aux États-Unis, en Allemagne encore récemment, le prolétariat montre qu’il n’est pas prêt à accepter tous les sacrifices. Il est tout à fait capable de se battre massivement, si ce n’est directement contre la guerre et le militarisme, contre les attaques brutales exigées par la bourgeoisie pour alimenter son arsenal de mort, contre les conséquences de la guerre sur nos conditions d’existence, contre l’inflation et les coupes budgétaires. Ces luttes sont le creuset dans lequel la classe ouvrière pourra pleinement renouer avec ses expériences passées et ses méthodes de luttes, retrouver son identité et développer sa solidarité internationale. Elle pourra alors politiser son combat, tracer un chemin en offrant la seule perspective et issue possible : celle du renversement du capitalisme par la révolution communiste.
EG, 30 avril 2024
1 « Most Jews and Palestinians want peace. Extremists, narcissists and other “allies” only block the way [863] », The Guadian (26 avril 2024).
2 Estimant que leur nation respective (la France, le Royaume-Uni, l’Italie…) avait tout intérêt à rejoindre le bloc dirigé par la prétendue « patrie du socialisme dégénérescente »…
Géographique:
Récent et en cours:
Courants politiques:
Rubrique:
Haïti, vitrine du capitalisme en putréfaction
- 72 lectures
La situation d’un certain nombre de pays d’Amérique centrale constitue une caricature de l’enlisement de la société dans la putréfaction du monde capitaliste. Le cas le plus extrême étant certainement celui d’Haïti qui traverse des crises incessantes, toutes plus tragiques les unes que les autres.
La violence et la brutalité se sont fortement intensifiées au cours des derniers mois, en plus de conditions de vie terriblement misérables entraînant l’exode massif de dizaines de milliers d’Haïtiens et la poursuite accélérée de leur émigration. Depuis la fin février, les événements qui se succèdent provoquent l’effroi et donnent le vertige : des prisons ont été prises d’assaut, provoquant l’évasion de plusieurs milliers de détenus, des hôpitaux et des commissariats ont été attaqués par des bandes criminelles… La « crise humanitaire » s’aggrave, la disette et la faim s’intensifient, le choléra a fait son retour, 3334 personnes en 2023 ont été tuées et 1787 autres enlevées, victimes des gangs qui font régner la terreur. Ces gangs contrôlent désormais 80 % de la capitale et les routes alentour, ainsi que le port. Selon l’Organisation internationale pour les migrations, 362 000 personnes, dont la moitié sont des enfants, sont actuellement déplacées en Haïti.
Ce ne sont pas seulement les gangs qui font régner la terreur, mais aussi les milices armées et recrutées par les pouvoirs successifs comme forces d’appoint pour réprimer les révoltes populaires contre la corruption et la misère, en plus de leurs activités mafieuses. Ainsi une manifestation en 2018 contre la vie chère et la corruption a conduit à réprimer sauvagement une « mobilisation populaire » (qui réclamait des poursuites judiciaires contre Jovenel Moïse, l'ancien Président assassiné en 2021) à la Saline, un bidonville de Port-au-Prince. À cette occasion, 71 personnes ont été assassinées et mutilées, des femmes violées, des corps brûlés. L’un des auteurs du massacre, Jimmy Cherizier, alias « Barbecue », doit son surnom à ce forfait ignoble, une pratique largement connue de la « communauté internationale » qui vise à répandre la terreur et la "paix sociale", celle des cimetières au profit de la bourgeoisie et des gangs.
Un rapport de l’ONU cité dans Le Monde pointe les collusions politiques, criminelles et leur terreau : une « situation d’oligopole sur les importations » et « contrôlée par un groupe relativement restreint de familles puissantes, qui mettent leurs intérêts commerciaux concurrents au-dessus de tout ». Les gangs, souligne le rapport, sont « instrumentalisés par l’élite politique et économique ainsi que par de hauts fonctionnaires ». « Le siphonnage des ressources publiques témoigne de la corruption endémique » avec un sabotage délibéré du système judiciaire. L’impunité est totale. Mais le rapport, a priori audacieux, se garde bien de citer les exactions de l’ex-président Moïse, ni l’impopularité du premier ministre démissionnaire Ariel Henry, au bilan catastrophique et qui a bénéficié d’un soutien inconditionnel de la « communauté internationale ».
Cela n’est pas nouveau car Haïti, premier pays affranchi d’une puissance coloniale (la France) en 1804, est depuis des décennies la proie d’affrontements entre gangs rivaux qui font régner la terreur sur tout le pays. Après la succession des juntes militaires suite à l’occupation américaine entre 1915 et 1934, les tristement célèbres milices des « tontons Macoutes » (à la solde du pouvoir sans partage de la famille Duvalier entre 1957 et 1986) ont été remplacées, lors du « rétablissement d’un régime démocratique », par des luttes sanglantes entre bandes et clans rivaux pour la conquête du pouvoir. Les vagues de massacres et la terreur que font régner les criminels sont permanentes depuis 2004, enfonçant toujours davantage le pays le plus pauvre de tout l’hémisphère nord dans une misère effroyable (plus de la moitié de la population vit sous le seuil de pauvreté et souffre d’insécurité alimentaire chronique).
Cette situation est encore aggravée par les ravages d’effroyables et dévastatrices "catastrophes naturelles" dont le tremblement de terre de 2010 qui a fait plus de 300 000 morts. Le pays est devenu une des zones les plus vulnérables aux dérèglements climatiques particulièrement meurtriers (succession de cyclones, d’ouragans ou de sécheresses) avec une écrasante majorité de la population plongée dans des conditions de vie totalement insalubres, favorisant le retour d’épidémies, elles aussi mortelles, comme le choléra, sous le regard complice des puissances tutélaires comme la France et des États-Unis qui soutiennent envers et contre tout les factions bourgeoises locales susceptibles d’assurer un semblant de stabilité politique.
Le très contesté premier ministre a dû démissionner, lâché par les États-Unis, sous la pression, notamment, des bandes armées, dont l’une est dirigée par « Barbecue », promettant l’intensification de la guerre civile en cas de refus. Un conseil présidentiel de transition est en passe d’être nommé depuis la Jamaïque sous la houlette des États-Unis pour choisir un nouveau premier ministre mais déjà les gangs ont déclaré qu’ils n’accepteront aucun accord venant de l’étranger. Les États-Unis, cette fois, ne veulent pas déployer leurs propres forces sur place et s’en remettent à la promesse d’arrivée de policiers kényans pour maintenir l’ordre.
Pour un chercheur haïtien, « Barbecue, un ancien policier, est le Frankenstein qui s’est libéré de son maître » et considère que les gangs « sont plus puissants que le pouvoir politique et les forces de l’ordre » et finalement ont « décidé de s’autonomiser ». En fait, ces comportements abjects sont un pur produit de la putréfaction du capitalisme tel qu’il peut s’exprimer dans la périphérie du capitalisme. Ces quarante dernières années, la vie politique d’Haïti a été bousculée par des coups d’État, des ingérences étrangères, l’insurrection de l’armée et des farces électorales, une instabilité politique qui a « précipité [Haïti] dans le chaos ». Cette situation caricaturale montre sur quoi débouche, à terme, la perte de contrôle de la bourgeoisie sur son appareil politique.
Cette situation est, en effet, loin d’être unique. Le même chaos existe dans d’autres parties du monde : en Amérique centrale, en Amérique du Sud et dans un nombre croissant de pays africains. Certains pays qui n’en étaient pas encore à ce stade voient la menace désormais se préciser. C’est, par exemple, le cas en Équateur présenté jusqu’alors comme un « havre de paix » en Amérique latine. La bourgeoisie et son appareil d’État sont confrontés à un processus de fragmentation accéléré. Ils sont totalement impliqués et compromis dans le narcotrafic qui occupe désormais une place prépondérante dans l’économie nationale. En 2023, la montée spectaculaire de la violence s’est traduite par une augmentation des homicides de 800 % ! L’Équateur est devenu la plaque tournante du trafic de drogue. Les « groupes de délinquance organisée » sont en lien avec diverses mafias concurrentes pour assurer le contrôle du trafic : cartels mexicains, gangs péruviens ou colombiens, bandes mafieuses d’origine albanaise, russe, chinoise ou encore italienne. L’État est très largement gangrené par la corruption et lui-même lié aux plus puissants groupes agroalimentaires du pays également impliqués dans le narcotrafic. La dernière tentative de contrôle du narcotrafic s’est traduite par une flambée inédite de violences au début de l’année 2024, avec des affrontements de rues entre l’armée et les groupes de délinquance organisée, par des prises d’otages de journalistes d’une chaîne de télévision publique, par l’évasion de deux chefs de gangs, par de multiples mutineries dans les prisons aux mains des gangs et une répression brutale ne faisant qu’exacerber les tensions. La militarisation de la société s’est traduite pour la classe ouvrière par une hausse de 15 % de la TVA. La vague de protestations qui a suivi a été durement réprimée par le nouveau gouvernement de Daniel Oboa.
La gangstérisation est de plus en plus endémique au sein d'États comme le Honduras, le Guatemala, le Salvador ou le Mexique, dont les gouvernements successifs nagent depuis des années dans la corruption généralisée. Les gangs y font régner la terreur, contraignant les populations à des exodes massifs dont témoignent les flux incessants de caravanes de migrants qui tentent de gagner par tous les moyens les États-Unis. Cette même situation caractérise depuis des années des pays d’Afrique de l'Est comme la Somalie ou le Soudan ou encore la Libye. Mais ce phénomène de bandes armées et de milices paramilitaires incontrôlables, en lutte pour le pouvoir et le contrôle de territoires, tend à se propager également dans la partie occidentale du continent, qu’elles soient inspirées par le fanatisme religieux (Boko Haram, Al Shaabab, AMQI,…) ou animées par de stricts intérêts mafieux.
La gangstérisation des États, l’instabilité et le chaos, les foyers croissants de conflits impérialistes meurtriers, les multiplications d’attentats terroristes font peser la menace d’un enfoncement de parties de plus en plus larges de l’humanité dans un océan sans fond de barbarie, de misère, de chaos et d’irrationalité.
T. Tor, 5 avril 2024
Géographique:
Récent et en cours:
- Haïti [866]
Rubrique:
Commémoration du génocide au Rwanda : L’impérialisme Français était « acteur » !
- 56 lectures
À l’occasion de la 30ème commémoration du génocide Rwandais, le 7 avril dernier, la « France », nous dit-on, aurait fait une « avancée » en « reconnaissant ses responsabilités » à propos du massacre de plus de 800 000 personnes.
Voici exactement ce qu'elle a reconnu : « En voulant faire obstacle à un conflit régional ou une guerre civile, elle [la France] restait de fait aux côtés d’un régime génocidaire. En ignorant les alertes des plus lucides observateurs, la France endossait une responsabilité accablante dans un engrenage qui a abouti au pire, alors même qu’elle cherchait précisément à l’éviter ». Le compte n'y est pas messieurs les défenseurs des intérêts du capital français. Si, aujourd'hui, vous admettez une demi-vérité quant à l'action de vos prédécesseurs aux côtés d'un régime génocidaire, c'est pour tenter de dissimuler l'autre moitié de cette vérité : Ils étaient sur place pour servir les intérêts du capital français et non pas pour éviter un génocide. Ils y ont même pris part pour défendre la présence de la France au Rwanda contre les intérêts opposés de rivaux impérialistes, les États-Unis en l'occurrence.
Mais il ne faut pas s'y méprendre, les rivaux d'alors de la France au Rwanda ne valaient pas mieux qu'elle. De même qu'aujourd'hui, les complices ou acteurs directs des conflits qui ensanglantent la planète, pourvoyeurs de chair à canon et massacreurs des populations portent une responsabilité énorme dans la généralisation de la barbarie guerrière.
Afin de contrer l’immense propagande et le lavage de cerveau en cours, nous renvoyons le lecteur à un article que nous avions écrit à l’époque des faits pour dénoncer le rôle de l’impérialisme français dans le génocide au Rwanda :
"Rwanda : Les rivalités franco-américaines sont responsables de l'horreur" [Rwanda, Yémen, Bosnie, Corée : derrière les mensonges de « paix », la barbarie capitaliste [334]] – Revue internationale 78.
Questions théoriques:
- Impérialisme [45]
Rubrique:
ICConline - juin 2024
- 43 lectures
Anvers
- 22 lectures
- Calendrier [867]
Adresse:
Café De Zure, Dageraadplaats 4, 2180 Anvers
Date:
Type de rencontre:
Thème:
Introduction:
Permanence du CCI à Anvers le samedi 22 juin 2024
Le CCI organise une permanence le 22 juin de 14H00 à 17H00 à Anvers à l’adresse suivante : Café De Zure, Dageraadplaats 4, 2180 Antwerpen.
Contrairement à une réunion publique où le sujet est déterminé et présenté par le CCI, lors d’une permanence, il est possible d’exposer et de discuter de sujets de ton propre choix ensemble avec le CCI et d’autres participants.
Les sujets peuvent être tirés de l'actualité, mais aussi des leçons tirées des périodes historiques de lutte des classes : guerre, crise climatique, crise économique, populisme, élections, sens des luttes ouvrières aujourd'hui, quelle perspective pour le capitalisme ? etc.
Afin de préparer cette permanence au mieux, nous te demandons de nous prévenir à l'avance par email des sujets sur lesquels tu veux discuter : soit via le formulaire de contact, soit via [email protected] [868].
Fraternellement
Le CCI
Émeutes en Nouvelle-Calédonie: Le nationalisme est un piège mortel pour la classe ouvrière
- 114 lectures
Le 13 mai au soir, la Nouvelle-Calédonie s’est embrasée. Point de départ : la réforme constitutionnelle du corps électoral qui va affaiblir le poids électoral des forces politiques autochtones kanaks. La mobilisation d’une partie de la population, activement soutenue et même poussée par les organisations indépendantistes, s’est rapidement transformée en émeutes sanglantes où au moins sept personnes ont déjà perdu la vie.
Si la colère de la population exprime un véritable ras-le-bol face à l’exclusion sociale, à la misère, au racisme chronique et aux humiliations quotidiennes, le terrain nationaliste de « l’indépendance de la Kanaky » est une pure mystification, et même un piège pour la classe ouvrière en Nouvelle-Calédonie, comme en métropole. Il n’y a donc rien de hasardeux à voir les organisations bourgeoises de gauche et d’extrême-gauche soutenir l’indépendance au nom de leur idéologie frelatée du « droit des peuples à disposer d’eux-mêmes » : il n’existe aucune perspective prolétarienne sur ce terrain nationaliste où se confrontent surtout les intérêts impérialistes dans cette région du monde.
Ni le nationalisme, ni les violences aveugles ne sont un terrain pour la lutte du prolétariat
Le mécontentement social en Nouvelle-Calédonie, immédiatement instrumentalisé sur le terrain du nationalisme, rappelle bien évidemment l’épisode sanglant de l’assaut de la grotte d’Ouvéa en 1988. En pleine campagne électorale présidentielle, les confrontations entre indépendantistes et forces de l’ordre avaient donné prétexte à une hystérie nationaliste et un brin raciste pour le maintien de l’ordre républicain suite à la « sauvagerie » de l’attaque d’un poste de gendarmerie et une prise d’otages par des militants indépendantistes. L’intérêt impérialiste français pour ces îles du Pacifique, même s’il n’était pas menacé ouvertement, ne pouvait être remis en cause ou affaibli. La bourgeoisie avait bien fait valoir l’ « honneur » du drapeau et l’élan « civilisateur » de l’État dans une répression sans filtre et sanglante.
Même si le vernis humaniste du PS de Mitterrand avait donné l’illusion, par la suite, de mieux tenir compte du « peuple kanak », bien évidemment, la plupart des « indigènes » ont continué à porter le fardeau de la misère. Depuis, l’aggravation phénoménale de leurs conditions de vie et leur haine pour l’État français n’ont cessé d’être instrumentalisé par la bourgeoisie kanake pour tenter d’avancer ses pions en direction de l’indépendance.
La violence de la crise actuelle est ainsi bien supérieure à celle de 1984-1988. Les affrontements de l’époque, déjà spectaculaires et sanglantes, s’étaient limités à des confrontations entre petits colons et clans kanaks, avec des attaques ciblées sur les gendarmeries. Nouméa avait été très peu touchée. Tel n’est pas le cas aujourd’hui : incendies de magasins, d’entreprises, d’écoles, de maisons, pillages au cœur des zones urbaines, barrages pour s’opposer aux forces de l’ordre dépêchées par centaines du continent, comme aux milices caldoches issues d’une petite-bourgeoisie néocoloniale, milices qui n’hésitent pas à tirer pour tuer.
Cette flambée de violence est clairement l’expression du chaos généré par une société capitaliste en putréfaction qui n’a plus rien à offrir à l’humanité. Mais ces explosions sociales ne constituent en rien le terreau d’une lutte prolétarienne avec des revendications de classe autonome offrant réflexion, perspective et dynamique de prise en main de la lutte. Face à la paupérisation extrême, face à l’absence de perspective, partout dans le monde, les violences aveugles se multiplient, souvent perpétrées par des jeunes qui n’ont plus aucune confiance en l’avenir, embourbés dans le désespoir et la marginalisation. Cela reste le terrain du nihilisme et d’émeutes désespérées largement instrumentalisée par toutes les forces bourgeoises pour nourrir leurs appétits impérialistes.
Derrière la mobilisation pour la kanaky, les impérialismes aiguisent leurs couteaux
Avec sa proposition de loi « consolidant » le corps électoral, l’État français a la volonté de resserrer les boulons et assurer une cohérence politique sur le territoire néo-calédonien, en limitant les velléités indépendantistes croissantes susceptibles de fragiliser sa stratégie impérialiste dans la région. Le Pacifique est en effet devenu une région stratégique majeure dans les rivalités croissantes entre les grandes puissances, particulièrement autour de la confrontation entre les États-Unis et la Chine. La France cherche ainsi à maintenir sa place sur l’échiquier indo-pacifique déjà mise à mal par les accords de coopération militaire AUKUS (Australie, Royaume-Uni et États-Unis) dont elle s’est fait piteusement éjecter. La Nouvelle-Calédonie demeurer à ce titre un atout impérialiste, et la perte de ce territoire serait un revers de premier ordre. Mais toute la politique du gouvernement Macron tend à balayer tout ce que la bourgeoisie avait patiemment mis en place depuis la fin des années 1980 pour apaiser les confrontations et les tensions sur ces territoires. Il ouvre à nouveau une boîte de Pandore où les factions bourgeoises, particulièrement celles de l’indépendantisme kanak, veulent à nouveau jouer leurs cartes.
Pour les organisations indépendantistes kanakes, les appels à la mobilisation n’ont absolument pas pour objectif de défendre les intérêts ouvriers, mais faire valoir leurs propres intérêts nationalistes en surffant sur la fragilisation de l’impérialisme français dans la région. Et pour ce faire, la bourgeoisie kanake n’a aucun scrupule à s’acoquiner avec les multiples concurrents impérialistes de la France : l’impérialisme russe, d’abord, via ses offensives numériques, notamment sur les réseaux sociaux, pour faire payer à la France son rôle en Ukraine ; mais aussi la Chine impliquée dans la déstabilisation de la position de la France dans une région clé du Pacifique Sud ainsi que par ses mines de nickel... En accueillant les dirigeants indépendantistes kanakes et de Polynésie française pour une conférence sur le « droit à la décolonisation », même l’Azerbaïdjan s’est invitée dans la crise en Nouvelle-Calédonie : une manière de faire payer à la France son positionnement pro-arménien lors de la reprise du Haut-Karabakh.
La bourgeoisie française s’inquiète d’ailleurs de l’onde de choc qui pourrait toucher la Polynésie, Mayotte ou la Réunion, zones excentrées du territoire français, en proie à des situations similaires. Face à ce risque, elle ne peut qu’affirmer avec la pire brutalité que l’impérialisme tricolore ne tergiversera pas en Nouvelle-Calédonie comme ailleurs.
Le « droit des peuples », une arnaque idéologique qui n’a rien à voir avec le marxisme
Avec ses forces politiques de gauche et d’extrême gauche, la bourgeoisie, hypocrite au possible, entretient cependant des illusions indépendantistes. Face au gouvernement garant de « l’unité nationale », la gauche promeut la « conciliation » et l’extrême-gauche applaudit une mobilisation soi-disant « révolutionnaire ». Sous toutes leurs variantes plus ou moins radicales, les partis de gauche multiplient les appels à la solidarité, à la mobilisation sur le terrain pourri du nationalisme et du « droit des peuples » pour pousser des milliers de prolétaires à s’entre-déchirer au seul profit des factions bourgeoises. Mais leurs mots d’ordre mensongers ne s’adressent pas qu’à la population locale, il s’agit surtout faire de « l’indépendance de la Kanaky » (comme de la « résistance palestinienne ») une arme idéologique contre la conscience de l’ensemble de la classe ouvrière.
Pour l’organisation trotskiste Révolution Permanente, le terrain nationaliste est ouvertement assumé et devient un drapeau pour la lutte : « Plus que jamais, la lutte et les revendications du peuple kanak doivent résonner jusque dans l’hexagone, où ces derniers jours ont vu un véritable sursaut dans la mobilisation contre la complicité de l’impérialisme français avec le génocide commis par Israël en Palestine. Cette lutte doit s’allier à la lutte contre la situation coloniale en Kanaky. La lutte pour une véritable auto-détermination doit aussi passer par la dénonciation de cette répression coloniale ».
Pour le NPA-l’Anticapitaliste, même revendication nationaliste : « Le droit international pose clairement le droit à l’auto-détemination du peuple kanak, et l’ONU, sur la base de l’article XI de sa Charte, rappelle chaque année que la Kanaky est classé comme territoire à décoloniser. L’enjeu est plus fort que jamais d’exprimer en France notre solidarité avec le peuple de Kanaky, c’est-à-dire la reprise du processus de décolonisation ». Outre défendre bec et ongles cette revendication bourgeoise du « droit des peuples à disposer d’eux-mêmes », le NPA n’hésite même pas, encore une fois, à en appeler au « droit » bourgeois du panier de crabes de l’ONU, pour faire valoir des revendications nationales.
Pour l’organisation trotskiste Lutte Ouvrière et ses appels plus subtils à « renverser l’ordre capitaliste et l’impérialisme », la logique reste au bout du compte la même : s’indigner comme les autres forces gauchistes face à « cette réforme, votée par un parlement réuni à plus de 17 000 kilomètres des premiers concernés, [qui] vise à rendre les Kanaks minoritaires dans leur propre pays ». Comme le signale le NPA, le nationalisme de l’extrême gauche n’est en aucun cas une nouveauté : « Les militantEs de notre courant ont largement porté la solidarité anticoloniale auprès des Kanak, notamment dans les années 1980, au point que Jean-Marie Tjibaou, en visite à Paris en 1987, rencontre le bureau politique de la LCR et intervient lors la fête de Lutte Ouvrière à notre initiative ».
Toutes ces organisations d’extrême gauche sont ainsi depuis longtemps déjà, les rabatteurs les plus radicaux de la bourgeoisie pour dévoyer la colère et la réflexion ouvrières sur le terrain nationaliste. Pour ces faux-amis de la classe ouvrière, il s’agit systématiquement de choisir un camp impérialiste contre un autre. En aucun cas, ce choix ne doit être celui de la classe ouvrière, ni en Nouvelle-Calédonie ni ailleurs ! Aujourd’hui, se battre sur le terrain « indépendantiste », c’est prendre le risque de crever sous les balles des flics, celles de milices « citoyennes », sans renforcer d’un iota la perspective de la lutte prolétarienne internationale, seule à même d’en finir avec la barbarie capitaliste.
Stopio, 30 mai 2024
Géographique:
Situations territoriales:
Récent et en cours:
- Nouvelle-Calédonie [869]
Rubrique:
L’Anarchist Communist Group franchit une nouvelle étape en soutenant la campagne de guerre nationaliste
- 152 lectures
La défense intransigeante de l’internationalisme face à la guerre impérialiste est un devoir fondamental pour une organisation communiste. Les révolutionnaires doivent être capables de naviguer à contre-courant de la propagande bourgeoise visant à entraîner le prolétariat derrière tel ou tel impérialisme. C’est particulièrement le cas face au déferlement de l’hystérie nationaliste et militariste qui entoure la guerre au Moyen-Orient.
Dans le précédent numéro de World Revolution (WR), nous avions mis en garde contre le danger des concessions de l’Anarchist Communist Group (ACG) qui se rangeait derrière la bourgeoisie palestinienne. Dans un premier temps, nous avions salué le fait que l’ACG défende une position internationaliste en dénonçant les deux camps dans cette guerre. (1) Mais par la suite, nous avions pointé du doigt ses concessions au concept de « libération » des travailleurs palestiniens : « la position défendue par l’ACG dans cet article est très pernicieuse car, à première vue, elle semble effectivement défendre l’internationalisme prolétarien. Mais ce n’est qu’une apparence. Car si on le lit attentivement, c’est le contraire qui se révèle. L’article ne défend pas directement et ouvertement le nationalisme palestinien, mais sa logique, tout son raisonnement, va dans ce sens. Il s’agit, en vérité, d’un exposé très sophistiqué de l’idéologie de la libération nationale ». (2)
Cette défense « sophistiquée » du nationalisme est désormais moins subtile. Dans un article plus récent, (3) contrairement à leur précédent écrit, l’ACG ne dénonce pas clairement la guerre comme étant impérialiste, ni les liens entre les groupes de « résistance » palestiniens et les différentes puissances impérialistes. Au contraire, l’article présente l’État israélien comme le seul responsable de cette guerre. L’ACG déclare bien que : « nous savons pertinemment quel sang coulerait à flots : celui des “déjà dépossédés”, de ceux qui sont toujours les plus grandes victimes des guerres inter-impérialistes, du colonialisme et de l’exploitation : celui de la classe ouvrière ». Mais sans une déclaration claire sur la nature impérialiste des deux camps, cette déclaration reste au mieux ambiguë. Elle ne met certainement pas en garde la classe ouvrière contre le danger de se ranger derrière l’un ou l’autre camp.
Le Hamas a délibérément provoqué l’impérialisme israélien par son massacre dans le sud d’Israël le 7 octobre en adoptant une stratégie de terre brûlée suicidaire visant à saper les relations que développe l’État israélien avec certains autres États du Moyen-Orient. Le Hamas savait parfaitement que son attaque déclencherait un bain de sang. Cependant, pour l’ACG (dans cet article au moins) comme pour la gauche du capital, l’État israélien est l’ennemi. Le Hamas est silencieusement déchargé de son rôle terroriste dans ce cauchemar !
La contradiction entre cet article et le précédent n’est pas expliquée. Cet abandon apparent de l’internationalisme conduit le « radicalement » anti-étatique, anti-autoritaire et anti-impérialiste ACG à étrangement exiger que les autres États impérialistes s’allient à la « colère des gens ordinaires ». « Israël est capable de faire cela [faire la guerre] parce que, malgré toute la colère et l’opposition que ses actions génocidaires suscitent parmi les gens ordinaires, il n’y a pas, jusqu’à présent, d’alliés parmi les États-nations du monde, malgré le dépôt par l’Afrique du Sud d’une plainte pour génocide contre Israël auprès de la Cour internationale de justice, qui pourraient intervenir de manière significative en leur nom ». Quelle intervention l’ACG pense-t-il que ces « États-nations » devraient faire ?
Un indice est donné dans la phrase suivante : « L’Iran et ses alliés du Hezbollah se sont abstenus de s’engager à fond, malgré les provocations d’Israël, parce qu’ils connaissent les conséquences d’une escalade ». L’ACG pense-t-il que ces deux camps impérialistes devraient s’engager « à fond » dans une guerre contre Israël ? Qu’impliquerait un tel engagement si ce n’est une intervention militaire, c’est-à-dire le massacre des ouvriers en Israël, qu’ils soient ou non enrôlés dans Tsahal ? Les camarades de l’ACG doivent vraiment clarifier ce qu’ils veulent dire. Peut-être que le prolétariat devrait désormais soutenir l’impérialisme américain, qui a tenté de freiner l’offensive meurtrière d’Israël à Gaza ?
Afin de poursuivre son soutien à la libération du prolétariat palestinien face à l’oppresseur israélien, l’ACG préconise également que les travailleurs participent au mouvement ouvertement pro-palestinien et gauchiste Workers' for a Free Palestine, qui appelle à « mettre fin aux ventes d’armes à Israël et à ce que le gouvernement britannique soutienne un cessez-le-feu permanent ». Cela signifie-t-il que l’État capitaliste et sa façade démocratique ne sont plus l’ennemi du prolétariat ? Le prolétariat doit-il se mettre à genoux et supplier l’impérialisme britannique de soutenir un accord de paix ? On ne peut que supposer que l’ACG se réjouit du soutien actuel de l’impérialisme britannique à un cessez-le-feu. Un soutien qui dépend bien évidemment de ce que l’impérialisme britannique estime être le mieux pour ses intérêts nationaux.
Des campagnes nationalistes contre le retour de la lutte de classes
L’intérêt national de l’État britannique consiste également à saper la confiance renouvelée et croissante du prolétariat en lui-même. En 2022, au beau milieu de la guerre en Ukraine, le prolétariat britannique a placé ses intérêts de classe au premier plan en élevant ses revendications de classe à travers une série de grèves. Cela a replacé la classe sur le terrain social, après des décennies d’enlisement dans la démoralisation, une perte de vision d’elle-même en tant que classe ayant la force de défendre ses propres intérêts. La classe dominante a voulu décourager davantage le prolétariat en lui donnant un sentiment d’impuissance face à la guerre en Ukraine. Ça n’a pas fonctionné. L’accélération de la crise économique, en partie due à la guerre, a fait remonter à la surface un profond mécontentement.
La bourgeoisie britannique, tout comme le reste de la classe dominante mondiale, a cependant utilisé la guerre à Gaza pour tenter de générer d’importantes divisions au sein de la classe. Semaine après semaine, la bourgeoisie a fait tout son possible pour promouvoir et autoriser les manifestations nationalistes pro-palestiniennes qui ont mobilisé des centaines de milliers de personnes. Les attaques incessantes des médias contre l’antisémitisme et la nature pro-Hamas de ces manifestations ont cherché à accroître les divisions au sein de la classe.
Au lieu d’avertir le prolétariat face au danger des défilés nationalistes, l’ACG les présente comme quelque chose de positif : « Les manifestations à travers le monde se poursuivent avec des centaines de milliers de personnes dans les rues chaque week-end dans les villes et les villages, grands et petits. Dans de nombreux endroits, les manifestations sont devenues plus furieuses, plus désespérées, alors que les forces armées israéliennes continuent d’assassiner en toute impunité ».
En lisant cet article, on se demande si l’ACG défend toujours ses propres objectifs et principes, qui incluent le rejet du nationalisme : « Nous rejetons toutes les formes de nationalisme, car elles ne servent qu’à redéfinir les divisions au sein de la classe ouvrière internationale. La classe ouvrière n’a pas de pays et les frontières nationales doivent être éliminées ».
Les travailleurs n’ont pas de pays mais l’ACG voit quelque chose de positif dans les manifestations contre le terrorisme d’État israélien et est donc en faveur d’une « Palestine libre ». Si l’ACG prenait au sérieux l’élimination des frontières nationales, elle s’opposerait de toutes ses forces à ce slogan.
Le CCI ne se réjouit pas de voir ses avertissements contre les concessions de l’ACG sur la « libération nationale », ainsi qu’au gauchisme, confirmés de manière aussi flagrante. C’est précisément la raison pour laquelle nous avons cherché à dénoncer ces concessions et à avertir les camarades de l’ACG, tout comme ceux qui sont influencés par ce groupe, des dangers auxquels ils sont confrontés.
L’ACG est à la croisée des chemins. Soit il commence à résister à l’influence croissante du gauchisme sur lui, ce qui implique de s’attaquer à sa source sous-jacente : son rejet du marxisme et de son avant-garde contemporaine, la tradition de la gauche communiste. Autrement, il s’engouffrera de plus en plus dans la brèche du gauchisme.
Phil, avril 2024
1« Positions internationalistes contre la guerre [870] », Internationalisme n° 379 (2023).
2« L’Anarchist Communist Group et la guerre à Gaza : Les ambiguïtés de l’internationalisme anarchiste [871] », Révolution internationale n° 500 (2024)
3Voir en anglais « Jackdaw for revolutionary anarchism n°16 [872] », Anarchist Communist Group.
Récent et en cours:
- Conflit israélo-palestinien [262]
- ACG [873]
- Gaza [874]
Courants politiques:
Rubrique:
80 ans du Débarquement: Un show à la hauteur de la propagande mensongère de la bourgeoisie
- 165 lectures
80 ans jour pour jour après le débarquement sur les plages normandes, l’État français célèbre en grande pompe cet événement et lui offre une place de choix au centre de toutes les attentions. Sur toutes les chaînes, dans tous les médias, on ne parle plus que de cela. « Sans ces héros, nous serions encore allemands », avons-nous pu entendre à longueur de journée. « Nous avons un rôle de transmission et de mémoire ». Et Macron de rajouter : « Soyons dignes de ceux qui débarquèrent ici »… avant d’enchaîner sur le soutien infaillible de la France à l’Ukraine : « Votre présence, Monsieur le président d’Ukraine, dit tout cela. Merci au peuple ukrainien, à sa bravoure, à son goût de la liberté. Nous sommes là et nous ne faiblirons pas. Quand guette l’anesthésie et l’amnésie, quand s’endorment les consciences, c’est cet élan intact qui nous entraîne, sans crainte. Voilà pourquoi nous sommes ici ». Tout est dit : voilà pourquoi autant de battage médiatique : célébrons la fin de la plus grande boucherie qu’ait connu l’humanité pour mieux embrigader derrière un autre conflit barbare et meurtrier !
C’est pourquoi nous remettons en avant une série d’articles publiée en 2006 qui dénonçait déjà la propagande mensongère de la bourgeoisie à propos de la Seconde Guerre mondiale et qui sont totalement d’actualité. Tous les chefs d’États présents aux commémorations du D-Day sont tous de l’espèce des grands vautours impérialistes qui alimentent le militarisme et le chaos dans le monde. Tous contribuent froidement à entretenir le conflit en Ukraine et à nourrir une vaste campagne idéologique belliciste face à Poutine, au nom de la « paix ». Cette commémoration n’est qu’une nouvelle propagande détestable destinée à marteler qu’il faudrait accepter les « sacrifices » et « mourir pour la patrie ».
Loin d’apporter la paix à l’humanité, la « victoire de la démocratie sur le fascisme » n’a été qu’un prélude, à la guerre permanente que se livrent toutes les nations, petites ou grandes, au quatre coins de la planète. Le véritable responsable de la Seconde Guerre mondiale, des horreurs du nazisme, des crimes des « alliés » et des guerres innombrables qui ont suivi depuis, c’est le capitalisme !
– Les commémorations de 1944 : 50 ans de mensonges impérialistes (1er partie) [876]
– Les commémorations de 1944 : 50 ans de mensonges impérialistes (2e partie) [877]
Récent et en cours:
- Seconde Guerre mondiale [878]
Rubrique:
Poussée du populisme en Europe, RN aux portes du pouvoir, Nouveau Front populaire… L’avenir appartient à la lutte de classe, pas au cirque électoral!
- 525 lectures
La coterie lepeniste n’avait pas encore consommé son triomphe aux élections européennes que le Président Macron annonçait la dissolution de l’Assemblée nationale et la convocation d’élections législatives dans la foulée. La rumeur d’une dissolution bruissait depuis plusieurs semaines, mais la nouvelle n’a pas manqué d’inquiéter les chancelleries européennes dans un contexte de montée du populisme en Europe et dans le monde. Après Orbán en Hongrie et Meloni en Italie, alors que l’extrême droite est au plus haut en Allemagne et que le clown Farage est en passe de torpiller le Parti conservateur au Royaume-Uni, Macron, tel un joueur de poker, a « balancé sa grenade dégoupillée », offrant au Rassemblement national (RN) l’occasion d’accéder au pouvoir en France.
Le Rassemblement national, pur produit de la crise du capitalisme
Alors que se dessine l’hypothèse d’un gouvernement populiste, le RN s’est empressé de ranger au placard son discours « social » et ses positions les plus radicales sur l’Europe pour tenter de rassurer l’appareil d’État, le patronat et les « partenaires européens ». Pour mener des attaques contre nos conditions de vie, le gouvernement de Bardella ne faiblira pas !
Mais cela ne suffira pas à conjurer l’amateurisme crasse des cadres du RN, les outrances racistes et notoirement rétrogrades de ce parti fondé par la lie de l’extrême droite, tout comme le risque de flambées de violence une fois le résultat connu (1) et l’instabilité politique qui s’installera durablement sur le pays. Et ce d’autant plus que les fractions populistes de la bourgeoisie ont non seulement maintes fois prouvé leur incapacité à défendre efficacement le capital national (comme Trump aux États-Unis ou les partisans du Brexit en Grande-Bretagne), mais sont aussi particulièrement inadaptées pour conduire habilement les « réformes » contre la classe ouvrière. Pour la bourgeoisie, le RN au pouvoir représentera une accélération considérable du chaos social et une onde de choc affaiblissant la France, et par conséquent l’Europe, dans l’arène mondiale.
La poussée de populisme dans le monde n’est donc pas le produit de manœuvres bien orchestrées de la bourgeoisie contre la classe ouvrière, (2) comme le répètent à l’envi les partis de gauche selon qui le « bloc bourgeois » préférerait se jeter dans les bras de l’extrême droite plutôt que dans les leurs. En réalité, aux États-Unis comme en Europe, le populisme est avant tout un pur produit de la profonde décomposition de la société capitaliste.
Les contradictions du système ont atteint un degré si inextricable que la bourgeoisie est désormais incapable de faire face à la crise et au chaos croissant : la précarité généralisée et le chômage de masse, la guerre sur tous les continents, les catastrophes environnementales ou industrielles à répétition, les millions de migrants jetés sur les routes, l’effondrement des systèmes de santé et de l’école, la dégradation continue des conditions de travail, le désespoir, la peur de l’avenir… La classe dominante n’a, aux yeux de tous, plus la moindre perspective à offrir à la société, si ce n’est tenter de « sauver les meubles » au jour le jour. C’est ce contexte de crise et de sauve-qui-peut qui a permis au populisme de prospérer, de promouvoir son idéologie nauséabonde et irrationnelle, de désigner des boucs émissaires à la vindicte, d’encourager le repli identitaire… (3)
La gauche “radicale” ou “modérée”, c’est toujours la bourgeoisie
Alors une question se pose : faut-il aller voter pour barrer la route au racisme éhonté du RN, à son autoritarisme franc du collier et aux promesses d’attaques tous azimuts contre la classe ouvrière, particulièrement les prolétaires issus de l’immigration ? Que Macron réussisse son pari, que le RN ou le « Nouveau Front populaire » (NFP) remportent les élections ou qu’aucune majorité ne s’impose, la crise du capitalisme ne disparaîtra pas. Quelle que soit la clique bourgeoise au pouvoir, de gauche ou de droite, radicale ou modérée, elle ne fera qu’accentuer les attaques contre nos conditions de vie. Le prolétariat n’a rien à défendre, ni à gagner en participant au cirque électoral ! (4)
Le NFP prétend porter un programme de « rupture », mais cette coalition fera comme a toujours fait la gauche depuis un siècle et dans tous les pays : défendre les intérêts du capital national, faire payer la crise aux exploités. La gauche, y compris quand elle se prétend « radicale », a toujours été le bras armé de la bourgeoisie contre la classe ouvrière. En Grèce, Tsípras et son gouvernement « de rupture » ont mené la pire des politiques d’austérité pendant plus de trois ans. La gauche « radicale » espagnole, main dans la main avec le PSOE, a attaqué sans relâche les conditions de vie des travailleurs, des chômeurs, des retraités… Mélenchon, l’ancien apparatchik du Parti socialiste, et sa clique de staliniens repentis ne dérogeront pas à la règle. D’ailleurs, le NFP a déjà promis d’apporter sa contribution au massacre en Ukraine en envoyant des milliards d’euros d’armes et de munitions. Comme Macron ou le Front populaire de Léon Blum, ils exigeront demain des « sacrifices » pour financer la guerre et les sordides intérêts impérialistes de la France !
Il n’y a également aucune illusion à se faire quant au sort des réfugiés avec la gauche au pouvoir : ils pourchasseront impitoyablement les migrants et les laisseront croupir dans des camps de rétention ou se noyer par milliers dans la Méditerranée, comme ils l’ont toujours fait ! Si la marine grecque est aujourd’hui à la pointe de l’ignominie, elle le doit notamment à l’œuvre du « radical » Tsípras (encore lui !) qui n’a pas hésité à signer des accords migratoires ignobles avec la Turquie et fut un artisan zélé de ce véritable « camp de la mort » qu’était celui de Mória. Faut-il encore documenter l’hystérie anti-réfugiés du Parti socialiste en France ou la xénophobie à peine voilée du PCF de Marchais ou de Roussel ? Faut-il rappeler l’abominable « politique migratoire » de la gauche en Espagne ? Le racisme et la xénophobie, les barbelés anti-migrants et les camps de rétention sont loin d’être l’apanage de la seule extrême droite !
“L’antifascisme”, arme de guerre contre la classe ouvrière
Comme en Allemagne avec les récentes manifestations contre l’AfD, la gauche et les syndicats français ont tenté de rejouer les mobilisations démocratiques de 2002, lorsque le FN s’était hissé au second tour de l’élection présidentielle. Il n’y aurait pas d’autre choix que de se mobiliser, non pas en tant qu’ouvriers en lutte, mais dans les urnes, en tant que « citoyens », pour défendre la « démocratie » et barrer la route au « fascisme ». (5)
L’évocation, la larme à l’œil, du « Front populaire » de 1936 s’inscrit pleinement dans cette campagne de propagande. Car le Front populaire, aujourd’hui comme hier, c’est la négation-même du prolétariat. Après la défaite de la vague révolutionnaire débutée en Russie en 1917, le prolétariat est vaincu. En Allemagne, la révolution de 1918-1919 a été écrasée dans le sang. La contre-révolution stalinienne a fauché les révolutionnaires et totalement désorienté la classe ouvrière. C’est sur les cendres de la défaite que la bourgeoisie française pousse au pouvoir Léon Blum et sa coalition avec pour objectif de préparer la guerre. Et c’est au nom de la défense de la démocratie que le Front populaire (qui enfermait déjà les réfugiés espagnols dans des camps de concentration à ciel ouvert) a enchaîné des millions de prolétaires au drapeau de l’antifascisme, militarisant les usines et préparant les esprits au massacre. Son « œuvre » a conduit dans la tombe des millions d’ouvriers pendant la Seconde Guerre mondiale pour une cause, celle de la défense de la nation, qui n’était pas la leur. (6)
La situation historique a bien changé depuis : le prolétariat n’est pas vaincu et n’est pas prêt à se faire trouer la peau pour la défense du drapeau national. Bien au contraire ! Face aux « sacrifices » exigés par « l’économie de guerre » et la concurrence internationale, le prolétariat relève la tête. Depuis deux ans, les luttes massives se multiplient : Royaume-Uni, France, États-Unis, Allemagne, Canada, Finlande… Partout, le prolétariat se bat et commence à retrouver sa combativité, ses réflexes de solidarité, son identité.
Aujourd’hui, la menace que fait peser la propagande antifasciste sur le prolétariat n’est pas l’embrigadement massif dans la guerre, mais la perte de son identité de classe renaissante, condition de son unité et de sa réflexion pour retrouver le chemin de la révolution, de la destruction de l’État bourgeois qu’il soit « démocratique » ou « autoritaire ».
C’est pour cette raison que la bourgeoisie s’est empressée de jeter le discrédit sur « les ouvriers », prétendument réactionnaires et xénophobes, censés voter massivement pour le RN. (7) Cet odieux mensonge n’a pas d’autre objectif que de diviser le prolétariat et marteler l’idée que la classe ouvrière n’est porteuse d’aucun avenir.
Mais la bourgeoisie peut aussi compter sur son nouvel instrument de mystification, le Nouveau Front populaire, pour semer des illusions sur la « démocratie » et les élections, sur la « répartition des richesses », sur un capitalisme plus « écologique », plus « inclusif », plus « juste »… Sous les fenêtres des bureaux où se réunissaient les caciques du NFP pour se partager les circonscriptions, des manifestants, tout de même un peu méfiants vis-à-vis de ces belles promesses, scandaient : « Ne nous trahissez pas ! ». La seule chose que ce Front prétendument populaire ne trahira pas, c’est sa classe : la bourgeoisie !
L’avenir de la société ne se jouera pas dans les urnes mais par la lutte du prolétariat. Le seul moyen de combattre le populisme et l’extrême droite, c’est de lutter contre le capitalisme, contre l’État bourgeois et sa démocratie, contre tous les gouvernements. De droite ou de gauche, « autoritaire » ou « démocratique », « rétrograde » ou « humaniste », la bourgeoisie n’a qu’un seul programme : toujours plus de misère et de précarité, de guerre et de barbarie !
EG, 21 juin 2024
1 Les services de renseignement craignent non seulement des émeutes dans les banlieues et des débordements dans les manifestations « antifascistes », mais aussi les violences racistes de groupuscules d’ultradroite qui pourraient se sentir les ailes pousser avec l’arrivée de Bardella au pouvoir.
2 Même si les partis de droite comme de gauche ont pu, un temps, instrumentaliser l’ex-Front national. Il n’est d’ailleurs pas inutile de rappeler que c’est le Parti socialiste, membre du « Nouveau Front populaire », qui a contribué à l’émergence du Front national dans les années 1980. À l’époque, le président Mitterrand avait orchestré la médiatisation du parti de Jean-Marie Le Pen pour mettre des bâtons dans les roues de la droite. (cf. « Au RN, un autre anniversaire : celui du coup de pouce de Mitterrand [879] », Libération (5 octobre 2022).
3 Sur les racines de la montée en puissance du populisme, voir : « Rapport sur la vie politique de la bourgeoisie : Comment la bourgeoisie s’organise [880] », Revue internationale n° 172 (décembre 2023).
4 Cf. notre brochure : Les élections, un piège pour la classe ouvrière [881].
5 La montée du populisme n’est pas celle du fascisme : Hitler et Mussolini ont conquis le pouvoir parce qu’ils représentaient, face à un prolétariat vaincu et écrasé, l’option la mieux adaptée aux capitaux allemand et italien pour préparer la guerre mondiale, seule « solution » de la bourgeoisie à la crise. Aujourd’hui, même si les illusions sur l’État démocratique ont pris du plomb dans l’aile, la bourgeoisie a toujours besoin de cette mystification pour affronter la classe ouvrière.
6 Cf. notre brochure : Fascisme et démocratie, deux expressions de la dictature du capital [22]. Là aussi, il n’est pas inutile de rappeler que : 1. c’est la démocratie qui a fait le lit du fascisme ; 2. si le régime hitlérien a fait la démonstration d’une barbarie effroyable et inégalée, les Alliés n’étaient pas en reste et ont fait preuve, pendant la guerre, d’une indifférence à l’égard du sort des Juifs qui s’est parfois muée en complicité pure et simple.
7 Sans surprise, les savantes analyses de la bourgeoisie sont un grossier mensonge. D’abord, la classe ouvrière ne se réduit pas à la catégorie socio-professionnelle des travailleurs industriels : contrairement à un « employé » de commerce ou une sage-femme (« profession intermédiaire »), un « chef d’équipe » sur une ligne de production ne fait pas partie de la classe ouvrière. Par ailleurs, même en ne tenant compte que de la catégorie des « ouvriers », c’est l’abstention qui arrive largement en tête !
Situations territoriales:
Personnages:
- Emmanuel Macron [854]
- Marine Le Pen [882]
- Jean-Luc Mélenchon [883]
Récent et en cours:
- Rassemblement national [884]
- Populisme [293]
- Nouveau Front populaire [885]
- Election législatives [886]
- antifascisme [887]
- Elections 2024 [888]
Heritage de la Gauche Communiste:
Rubrique:
ICConline - juillet 2024
- 53 lectures
Face aux mensonges et embrouilles du GIGC Défense de l'intervention du CCI face à la guerre
- 223 lectures
Après avoir rétabli la réalité de notre plateforme calomniée par le GIGC (Défense de la plateforme du CCI : les nouveaux mensonges du GIGC [890]), c'est à présent le contenu de notre intervention face à la guerre que nous devons défendre face aux élucubrations diffamatoires du GIGC attribuant au CCI les démarches ou analyses politiques suivantes : "dissimulation du danger de guerre", "Un internationalisme abstrait et intemporel, basé simplement sur les sentiments et la morale", "l'introduction de l’idéalisme bourgeois dans la doctrine révolutionnaire du prolétariat", …
Le CCI désarmerait le prolétariat face au danger de guerre !
Selon le GIGC, le CCI adopterait face à la guerre une approche qui "ne peut qu’ouvrir la voie à une sorte de pacifisme moral puisqu’elle n’enracine pas l’internationalisme sur le terrain très matériel de la relation dialectique entre le processus même de la guerre impérialiste et celui de la lutte des classes, qui se synthétise dans l’alternative "révolution prolétarienne internationale ou de la guerre impérialiste généralisée", révolution ou guerre."[1]
En quoi cela s'applique-t-il à notre intervention ? Pas un mot ! Du bluff, une contre-vérité enrobée dans une phrase ronflante pour éblouir les suiveurs du GIGC, s'il en est.
À l'inverse de ce que veut faire passer le GIGC, la politique du CCI face à la guerre est parfaitement ancrée dans le contexte de la situation mondiale actuelle et orientée par la perspective de la nécessité de renversement du capitalisme par le prolétariat :
- Dans la période actuelle, le principal facteur de développement de la lutte de classe est déjà et sera de plus en plus l'approfondissement irréversible de la crise du capitalisme, impliquant des attaques économiques de plus en plus profondes et insupportables portées contre la classe ouvrière. Une telle perspective s'illustre déjà à travers la dynamique mondiale de la lutte de classe révélée par le renouveau des luttes au Royaume Unis au printemps 2022, qui a ensuite gagné les principaux pays industrialisés d'Europe et les États-Unis et se trouve régulièrement confirmée depuis lors par de nouvelles luttes[2]. L'intervention du CCI a pour objectif de renforcer à la fois la capacité de la classe à développer ses luttes de résistance face aux attaques et sa conscience de la nécessité de renverser le capitalisme.
- La multiplication et l'aggravation des conflits impérialistes de par le monde constitue une menace croissante pour l'humanité et un facteur de prise de conscience par le prolétariat de la nécessité de renverser le capitalisme ; le CCI n'a évidemment pas attendu les gesticulations et l'esbroufe du GIGC pour développer cette dimension de son intervention.
Quant aux "alertes" du GIGC du type "Au nom de la Décomposition, le CCI n’a-t-il pas écarté définitivement toute perspective de troisième guerre mondiale"[3], elles sont destinées à semer le doute sur la détermination de notre organisation à assumer ses responsabilités face au danger de guerre.
La tentative du GIGC "d'exécuter" la Déclaration commune de groupes de la Gauche communiste sur la guerre en Ukraine
Pour le CCI, cette déclaration témoigne du fait que, "face à l’accélération du conflit impérialiste en Europe, les organisations politiques basées sur l’héritage de la Gauche communiste continuent à brandir la bannière d’un internationalisme prolétarien cohérent et de fournir un point de référence à ceux qui défendent les principes de la classe ouvrière".[4]
Cette initiative, qui visiblement dérange le GIGC, l'amène à balancer tout ce qui lui passe par la tête, sans même le moindre souci de vraisemblance, pour la dénigrer. Aveuglé par sa haine du CCI, il "tire dans le tas" en direction des différents groupes signataires, sans même se soucier des positions réelles des uns et des autres ni du contenu réel de la déclaration, tous étant coupables à ses yeux d'avoir signé une prise de position commune avec le CCI. Ainsi, pour le GIGC, "L’initiative des groupes révolutionnaires que nous qualifierions d’opportunistes, à savoir le CCI et Internationalist Voice, que l’Institut Onorato Damen a rejoint, met en avant la permanence de la guerre impérialiste sous le capitalisme et nie la réalité en cours d’une consolidation des blocs impérialistes …. " [5]
Gros mensonge du GIGC : la Déclaration commune de groupes de la Gauche communistes [438] n'évoque ni les blocs impérialistes, ni l'idée d'une quelconque "permanence de la guerre impérialiste sous le capitalisme". Nous invitons nos lecteurs à s'en rendre compte par eux-mêmes.
Le GIGC rebondit sur son propre mensonge pour, cette fois, agiter l'épouvantail de "la théorie de la décomposition du capitalisme", défendue seulement par le CCI et qui constituerait, selon les termes du GIGC, "le cheval de Troie du CCI par lequel il introduit l’idéalisme bourgeois dans la doctrine révolutionnaire du prolétariat"[6]. Il en rajoute une couche avec cette idée que les conceptions du CCI aboutissent à "une situation dans laquelle l’histoire est au point mort", dans la mesure où "ce n'est plus la lutte entre les classes en conflit dans la société mais plutôt l’effet de la Décomposition sur la société dans son ensemble qui est le facteur déterminant du développement historique."
Notre intention n'est pas ici de convaincre un interlocuteur du camp prolétarien, puisque le GIGC n'en est pas un, mais nous nous devons de rétablir la vérité face aux distorsions que ces parasites font subir à notre analyse de la décomposition, tout comme ils l'ont fait avec le contenu de notre plateforme politique[7]. Que dit réellement le CCI et de quels dangers alerte-t-il ? : "Dans une telle situation où les deux classes fondamentales et antagoniques de la société s'affrontent sans parvenir à imposer leur propre réponse décisive [La guerre pour la bourgeoisie, la révolution pour le prolétariat], l'histoire ne saurait pourtant s'arrêter. Encore moins que pour les autres modes de production qui l'ont précédé, il ne peut exister pour le capitalisme de "gel", de "stagnation" de la vie sociale. Alors que les contradictions du capitalisme en crise ne font que s'aggraver, l'incapacité de la bourgeoisie à offrir la moindre perspective pour l'ensemble de la société et l'incapacité du prolétariat à affirmer ouvertement la sienne dans l'immédiat ne peuvent que déboucher sur un phénomène de décomposition généralisée, de pourrissement sur pied de la société."[8] Quand le CCI écrit "l'histoire ne saurait s'arrêter", "il ne peut exister pour le capitalisme de "gel", de "stagnation" de la vie sociale", le GIGC nous prête l'idée que "l’histoire est au point mort "! On connait l'expression, "qui veut tuer son chien l'accuse de la rage". Elle collerait tout à fait à cette situation si n'est que l'enragé ici n'est pas le CCI, mais bien le GIGC !
Contrairement aux hallucinations de "l'enragé GIGC", "l’histoire ne peut pas être au point mort". En effet, tant que la classe ouvrière constitue une force dans la société, la révolution communiste demeure une possibilité à l'ordre du jour ; l'autre terme de l'alternative étant destruction de l'humanité, comme conséquence soit de la guerre mondiale, soit de l'enfoncement irréversible dans la décomposition. Pour qu'une guerre mondiale puisse avoir lieu il faudrait que deux blocs impérialistes se constituent, ce qui n'est pas actuellement à l'ordre du jour et possiblement ne le sera jamais. Par contre l'enlisement irréversible dans la décomposition est une menace beaucoup plus tangible, en cours de réalisation, et tout aussi catastrophique mais probablement plus terrible encore que la guerre mondiale.
En déconsidérant le CCI et en agitant l'épouvantail de sa "douteuse théorie de la décomposition", le but du GIGC était d'enfoncer un coin entre notre organisation et les autres groupes participant à l'appel, et ainsi d'entraver la possibilité qu'une telle démarche commune puisse être réitérée à un niveau supérieur.
Un appel imaginaire du CCI à un nouveau Zimmerwald présenté par le GIGC comme une manœuvre !
Ainsi, pour le GIGC : "il est curieux, voire ironique, de voir le CCI qui rejette tout danger de guerre impérialiste généralisée, appeler à un nouveau Zimmerwald."[9]
Le CCI n'a jamais appelé à un nouveau Zimmerwald en tant que tel. Pour nous "l'importance réelle et durable de Zimmerwald réside dans le développement d'une ligne internationaliste intransigeante au sein d'une petite minorité appelée la Gauche de Zimmerwald. Cette dernière reconnaissait que la Première Guerre mondiale n'était que le début d'une période historique entière dominée par la guerre impérialiste qui nécessiterait un programme maximal pour la classe ouvrière : guerre civile, renversement des régimes bourgeois, dictature du prolétariat avec une nouvelle Internationale communiste pour remplacer la 2e Internationale chauvine en faillite."[10] Dans et à travers ce débat, Lénine et ceux qui l’entouraient ont forgé un noyau qui allait devenir l’embryon de l’Internationale communiste.
La situation actuelle et ses perspectives -même si elles ne s'énoncent pas en termes de Troisième guerre mondiale entre deux blocs impérialistes constitués- sont suffisamment dramatiques pour justifier une mobilisation de l'avant-garde politique du prolétariat pour préparer les conditions de surgissement du futur parti de la révolution communiste.
Ce n'est pas ainsi que le conçoit le GIGC. Sa logique de groupe parasitaire et policier[11] le conduit à apporter sa petite contribution au sabotage d'un tel projet en balançant les mesquineries qui lui vont si bien et les affabulations qui font partie de sa panoplie politique. Ainsi, il dévoile la prétendue "face cachée" de notre démarche pour une prise de position commune de la Gauche communiste face à la guerre en Ukraine :
a) "Outre le fait que cela lui [le CCI] servirait pour tenter d’exclure les soi-disant parasites d’une telle initiative, en premier lieu notre groupe, accepter son terrain lui permettrait d’imposer son rejet de la perspective et du danger de guerre impérialiste au nom d’une unité artificielle de la conférence. (…) N’est-ce pas précisément ce que l’Istituto O. Damen a dû accepter de fait".
Notre commentaire : Le contenu de la déclaration commune, pas plus d'ailleurs que nos propres positions, ne contient aucune formulation évoquant un quelconque rejet par le CCI de la réalité et de l'aggravation des tensions impérialistes. C'est l'inverse qui est vrai.
b) "Ainsi, dans une telle conférence aujourd’hui, le CCI jouerait le rôle que les centristes kautskistes ont joué au sein des conférences Zimmerwald-Kienthal et bloquerait les internationalistes conséquents d’aujourd’hui, ceux qui placent leur action face à la dynamique et aux étapes vers la guerre impérialiste généralisée."
Notre commentaire : Il va de soi que le GIGC se place dans la catégorie des "internationalistes conséquents d’aujourd’hui". Compte tenu de ce qui précède et si la question n'était pas aussi grave, nous aurions plutôt placé le GIGC dans la catégorie des "comiques indécrottables".
Néanmoins, concernant ce groupe, nous retenons cette caractérisation au sein de notre article "La lutte contre la guerre impérialiste ne peut être menée qu'avec les positions de la gauche communiste [891]", dans la partie "Un rappel des états de service du groupe FICCI / GIGC".
"La coterie parasitaire, un mélange chaotique de groupes et de personnalités, utilise un rabâchage indigeste des positions de la Gauche communiste pour attaquer la Gauche communiste réelle, la falsifier et la dénigrer."[12]
CCI, juin 2024
--------------------------------
[Retour à la série : Le parasitisme politique n'est pas un mythe, le GIGC en est une dangereuse expression [634]]
[1] Sur les différentes prises de position des groupes révolutionnaires depuis l’invasion de l’Ukraine : la question du danger de la guerre impérialiste généralisée [892] (révolution ou guerre 21, juin 2022)
[3] 24e congrès du CCI : la barque de la Décomposition prend l’eau [894]. Révolution ou Guerre n° 20
[4] Déclaration commune de groupes de la Gauche communiste internationale sur la guerre en Ukrain [438]e
[5] Sur les différentes prises de position des groupes révolutionnaires depuis l’invasion de l’Ukraine : la question du danger de la guerre impérialiste généralisée [892] - La prise de position conjointe de groupes de la Gauche communiste.
[6] Sur les différentes prises de position des groupes révolutionnaires depuis l’invasion de l’Ukraine : la question du danger de la guerre impérialiste généralisée [892] - La prise de position conjointe de groupes de la Gauche communiste (CCI).
[7] Lire à ce propos THESES : la décomposition, phase ultime de la décadence capitaliste [10]
[9] Sur les différentes prises de position des groupes révolutionnaires depuis l’invasion de l’Ukraine : la question du danger de la guerre impérialiste généralisée [892] (révolution ou guerre 21, juin 2022)
[11] Dans l'article Les fondements marxistes de la notion de parasitisme politique et le combat contre ce fléau [616], lire "La FICCI (ancêtre du GIGC), une forme extrême de regroupement parasitaire".
Courants politiques:
- FICCI - GIGC/IGCL [524]
Questions théoriques:
- Guerre [26]
- Internationalisme [311]
Heritage de la Gauche Communiste:
- La lutte Proletarienne [401]
Rubrique:
La montée du populisme est un pur produit de la décomposition du capitalisme
- 184 lectures
En Europe, aux États-Unis et un peu partout dans le monde, les formations populistes ou plus traditionnelles d’extrême droite rencontrent des succès électoraux qui semblaient encore inconcevables une décennie auparavant. Cela s’est clairement exprimé lors les élections européennes de juin 2024 : le Rassemblement national (RN) en France, Alternative für Deutschland (AfD – Alternative pour l’Allemagne) ou Fratelli d’Italia (Fdl – Frères d’Italie) ont obtenu des scores impressionnants. En Grande-Bretagne, le Reform UK de Nigel Farage (principal promoteur du Brexit) pourrait absorber de larges pans d'électeurs du Parti conservateur, le plus ancien et expérimenté parti politique de la bourgeoisie. En France, le RN de Marine Le Pen devrait arriver en tête des prochaines élections législatives décrétées en catastrophe par le président Macron et pourrait potentiellement accéder pour la première fois au pouvoir. Et ceci dans un contexte où Trump a survolé les primaires du Parti républicain, surclassé un Biden de plus en plus gâteux lors de leur dernier débat et menace sérieusement de reprendre la Maison-Blanche en novembre prochain…
La bourgeoisie tend à perdre le contrôle de son appareil politique
Les élections européennes ont confirmé la réalité d’un processus de fragilisation qui frappe l’ensemble des appareils politiques de la bourgeoisie dans le monde, non seulement dans les pays de la périphérie du capitalisme, les plus fragiles, des États les plus en vue d’Amérique latine comme le Mexique, le Brésil ou l’Argentine, mais également dans le cœur du capitalisme, celui des grandes puissances démocratiques de l’ouest de l’Europe et des États-Unis.
Après la Seconde Guerre mondiale et jusqu’à l’aube des années 1990, malgré un contexte d’approfondissement continuel de la crise économique, la bourgeoisie avait maintenu une certaine stabilité dans le paysage politique, dominé la plupart du temps par le bipartisme, des alternances ou des coalitions solides, comme c’était le cas, par exemple, en Allemagne (SPD et CDU), en Grande-Bretagne avec les Tories et le Labour, aux États-Unis avec les Démocrates et les Républicains, ou en France et en Espagne avec l’opposition de partis de gauche et de droite. En Italie, la principale force politique garantissant la stabilité de l’État durant toute cette période était la Démocratie chrétienne. Cela permettait de dégager des majorités parlementaires relativement stables dans un cadre institutionnel apparemment bien huilé.
Cependant, dès la fin des années 1980, le capitalisme décadent entrait progressivement dans une nouvelle phase historique, celle de sa décomposition. L’implosion du bloc « soviétique » et le pourrissement sur pied croissant du système allaient accroître les tensions au sein des diverses bourgeoisies nationales et affecter de plus en plus leur appareil politique. L’approfondissement de la crise et l’absence de plus en plus évidente de perspectives, y compris pour certains secteurs de la bourgeoisie et de la petite bourgeoisie, a rogné de plus en plus la « crédibilité démocratique » des partis traditionnels et a fait surgir un peu partout, dès le début du XXIe siècle, des mouvements populistes dénonçant les « magouilles des élites au pouvoir », conjuguée à une montée en puissance de l’abstention et d’une volatilité électorale croissante.
Progressivement, le contrôle de la bourgeoisie sur son système politique a commencé à montrer des failles. En France, après les « cohabitations forcées », la mise en avant de Macron pour contrer la montée du Front national a mené à l’effondrement du Parti socialiste discrédité, et à la fragmentation du parti de droite. Au Royaume-Uni, la bourgeoisie a tenté de récupérer le mouvement populiste en faveur du Brexit à travers le Parti conservateur, ce qui a conduit à sa fragmentation actuelle. En Italie, la Démocratie chrétienne s’est effondrée elle aussi, laissant la place à de nouvelles formations comme Forza Italia (avec à sa tête déjà un leader populiste, Berlusconi), puis à une kyrielle de mouvements populistes et d’extrême-droite à la tête de l’État (le Mouvement 5 Étoiles, la Lega de Salvini, Fratelli d’Italia). Aux Pays-Bas, trois des quatre partis de la majorité parlementaire sont d’inspiration populiste. Aux États-Unis, depuis Bush junior et son administration, des tendances populistes minent de plus en plus fortement le Parti républicain (comme celle du Tea Party, par exemple) et ont mené à la mainmise du populiste Trump sur ce parti.
Avec l’accélération de la décomposition ces dernières années, notamment depuis la pandémie de Covid-19, la vague populiste contraint de plus en plus d’États, à composer avec des fractions bourgeoises marqués par l’irrationalité, la versatilité et l’imprévisibilité. Le populisme est ainsi l’expression la plus caricaturale d’une société de plus en plus marquée par la décomposition du mode de production capitaliste.
La montée du populisme n’est pas, à ce titre, le résultat d’une manœuvre délibérée de la classe dominante. (1) L’effervescence au sein des fractions les plus « rationnelles » de la bourgeoisie face à la percée de ces organisations exprime leur réelle inquiétude. Bien que le populisme soit fondamentalement « l’un des leurs » et que ses discours xénophobes et rétrogrades sont, en vérité, un concentré puant de l’idéologie de la classe bourgeoise (individualisme, nationalisme, domination par la violence…), l’accès des partis populistes et de leurs dirigeants totalement irrationnels et incompétents aux commandes des États ne peut que compliquer davantage la gestion des intérêts de chaque capital national et aggraver le chaos qui se répand déjà partout sur la planète.
Le populisme, produit et accélérateur du chaos et de l’instabilité mondiale
La montée du populisme dans plusieurs pays confirme ce que le CCI avait déjà analysé dans les Thèses consacrées à l’analyse de la période historique de la décomposition et dans lesquelles nous soulignions « la difficulté croissante de la bourgeoisie à contrôler l’évolution de la situation sur le plan politique. À la base de ce phénomène, on trouve évidemment la perte de contrôle toujours plus grande de la classe dominante sur son appareil économique, lequel constitue l’infrastructure de la société. […] L’absence d’une perspective (exceptée celle de “sauver les meubles” de son économie au jour le jour) vers laquelle elle puisse se mobiliser comme classe, et alors que le prolétariat ne constitue pas encore une menace pour sa survie, détermine au sein de la classe dominante, et particulièrement de son appareil politique, une tendance croissante à l’indiscipline et au sauve-qui-peut ». (2)
Cette avancée inévitable de la décomposition capitaliste explique aussi l’échec des mesures prises par les partis traditionnels de la bourgeoisie pour stopper la montée du populisme. (3) Ainsi, la bourgeoisie britannique a tenté de réorienter le désastre du « Brexit » en remplaçant Boris Johnson et Liz Truss par un premier ministre plus responsable, Rishi Sunak en 2022. Mais le « fiable » Sunak a réagi à la défaite aux élections municipales en avançant les élections législatives, ce que de nombreux analystes ont qualifié de « suicide politique » pour les « tories », autrefois l’emblème de la bourgeoisie la plus intelligente et la plus expérimentée du monde. On peut en dire autant d’un Macron, soutenu depuis des années par toutes les forces politiques de la bourgeoisie française (y compris la gauche qui a voté pour lui, rappelons-le, avec une « pince à linge sur le nez » pour empêcher l’arrivée au pouvoir de Le Pen) et qui, en dissolvant précipitamment l’Assemblée nationale, ouvre potentiellement la voie au RN et, quoi qu’il arrive, à l’imprévisible et au chaos. Cette politique de terre brûlée s’oppose complètement aux intérêts des factions qui se veulent les plus responsables au sein de l’appareil politique, comme en témoignent les divisions au sein des partis de droite et la constitution hâtive d’un Nouveau Front Populaire de gauche au parcours incertain. Enfin, aux États-Unis, l’éviction de Trump en 2020 n’a pas aidé le Parti républicain à trouver un autre candidat plus « prévisible ». Le Parti démocrate n’a pas non plus su comment réagir et doit miser aujourd’hui sur un Biden de plus de 81 ans pour stopper Trump.
Que les dirigeants des principaux États capitalistes s’abandonnent aux coups de poker, dans des aventures irresponsables aux résultats imprévisibles, dans lesquels les intérêts particuliers de chaque clique, voire de chaque individu, priment sur ceux de la bourgeoisie dans son ensemble et des intérêts globaux de chaque capital national, est révélateur du manque de perspective, de la prédominance du « chacun pour soi ».
Les conséquences de cette dynamique de perte de contrôle seront nécessairement une accélération importante du chaos et de l’instabilité mondiale. Si la première élection de Trump avait déjà marqué un accroissement de l’instabilité dans les rapports impérialistes, sa réélection signifierait une accélération considérable du chaos impérialiste mondial en reconsidérant, par exemple, le soutien américain envers l’Ukraine ou en soutenant sans réserve la politique de terre brûlée de Netanyahou à Gaza. Le retour de Trump aux affaires aggraverait encore la déstabilisation des Institutions et, plus généralement, la fragmentation du tissu social à l’image de ce qu’a représenté l’assaut du Capitole en janvier 2021. L’aggravation de la crise économique est aussi à prévoir avec l’accentuation du protectionnisme non seulement envers la Chine mais aussi envers l’Europe.
L’impact serait important aussi sur l’Union européenne (UE), déchirée elle aussi par des tensions croissantes autour de la guerre en Ukraine ou du conflit à Gaza, comme on peut le voir en particulier entre la France et l’Allemagne au sujet de l’envoi de troupes sur le sol ukrainien. Ces tensions risquent de croître avec la montée en puissance des forces populistes, qui tendent à être moins hostiles envers le régime de Poutine et moins enclines au soutien financier et militaire à l’Ukraine. Par ailleurs, la politique d’austérité économique de l’UE (limitation des déficits budgétaires, de l’endettement…) s’oppose également au protectionnisme économique et social, prôné par les populistes au nom de la « souveraineté nationale ».
La bourgeoisie tente de retourner les effets de sa décomposition contre le prolétariat
Quelles que soient les difficultés que rencontrent les différentes bourgeoisies pour garder le contrôle sur leur appareil politique, elles tentent par tous les moyens de les exploiter pour contrer le développement des luttes ouvrières, pour contrer la réflexion au sein du prolétariat et empêcher ainsi le développement de la conscience en son sein. Pour ce faire, elle peut compter sur la gauche qui déploie tout son arsenal idéologique et avance de fausses alternatives. En Angleterre, le Parti travailliste se présente comme l’alternative « responsable » pour enrayer le désordre provoqué par la gestion irresponsable du Brexit par les gouvernements conservateurs successifs. En France, face à la décision imprévisible de Macron d’organiser des élections, la grande majorité des forces bourgeoises de la gauche traditionnelle et plus radicale s’est unie au sein d’un « nouveau front populaire » pour s’opposer à l’avènement de l’extrême-droite. En exploitant les oppositions entre secteurs de la bourgeoisie face à la montée du populisme et de l’extrême droite, elle tente de détourner le prolétariat du seul combat qui puisse mener à la libération de l’humanité à travers le renversement du système capitaliste, et à promouvoir de fausses perspectives : la défense de la démocratie. (4) Alors que le vote mobilise les ouvriers comme des « citoyens » atomisés, la gauche présente les résultats électoraux comme un reflet de l’état de conscience de la classe. La bourgeoisie exhibe souvent des cartes montrant la croissance du vote populiste dans les quartiers ouvriers afin de marteler que la classe ouvrière serait la cause de la montée du populisme, qu’elle serait une foule d’ignares sans avenir. Elle sème aussi la division entre les travailleurs « racisés » qui seraient les victimes des travailleurs « blancs privilégiés ».
Il est donc clair que les difficultés politiques accrues pour la bourgeoise ne signifient nullement une opportunité pour le prolétariat de les mettre à profit pour développer son propre combat. Cette situation n’occasionnera nullement un renforcement automatique de la classe ouvrière. C’est au contraire une opportunité utilisée et exploitée idéologiquement par la classe dominante.
Le prolétariat a besoin de politiser ses luttes, mais pas dans le sens prôné par la gauche du capital, en s’engageant dans la défense de la « démocratie » bourgeoise. Il doit au contraire refuser les élections et se battre sur son propre terrain de classe, contre toutes les fractions et expressions du monde capitaliste qui menacent de nous condamner à la destruction et à la barbarie.
Valerio, 1er juillet 2024
1 Cf. « Comment la bourgeoisie s’organise [880] », Revue internationale n° 172 (2024).
2 « La décomposition, phase ultime de la décadence (1991) [10] », Revue internationale n°107 (2001).
4 Cf. notre brochure : Fascisme et démocratie, deux expressions de la dictature du capital [22].
Personnages:
- Donald Trump [896]
- Marine Le Pen [882]
- Emmanuel Macron [854]
Récent et en cours:
- Elections législatives [897]
- Elections 2024 [888]
- Nouveau Front populaire [885]
- Populisme [293]
Rubrique:
L’Inde après les élections: Un mandat étriqué pour Modi et plus de sacrifices pour la classe ouvrière
- 75 lectures
Les élections parlementaires (Lok Sabha) en Inde se sont tenues d’avril à juin dernier. Le prolétariat, comme partout ailleurs, n’avait rien à attendre de ces échéances dont l’issue ne fait que déterminer quelle fraction de la bourgeoisie va assurer sa domination sur la société et sur les ouvriers qu’elle exploite. Ces élections se sont tenues dans un contexte où le capitalisme en déclin plonge toujours davantage l’humanité dans le chaos du fait d’une accélération de sa décomposition sociale, générant des crises multiples (guerre, crise économique, sociale, écologique, climatique…) qui se conjuguent et se renforcent mutuellement, alimentant un tourbillon toujours plus destructeur. En Inde comme ailleurs : « la classe dirigeante est de plus en plus divisée en cliques et en clans, chacun faisant passer ses propres intérêts avant les besoins du capital national. Cette situation fait que la bourgeoisie a de plus en plus de mal à se comporter comme une classe unifiée et à garder le contrôle global de son appareil politique. La montée du populisme au cours de la dernière décennie est le produit le plus clair de cette tendance : les partis populistes incarnent l’irrationalité et le « no future » du capitalisme, en promulguant les théories conspirationnistes les plus absurdes et une rhétorique de plus en plus violente à l’encontre de « l’establishment » politique. Les factions les plus « “responsables” de la classe dirigeante s’inquiètent de la montée du populisme parce que leurs comportements et leurs politiques sont en contradiction directe avec ce qu’il reste du consensus traditionnel de la politique bourgeoise ».1
Fragilisation de l’État indien
Les élections en Inde traduisent et confirment ces difficultés croissantes pour la classe dominante. En effet, les différents mandats de la faction Modi traduisaient déjà depuis ses débuts la confusion entre les intérêts de l’État indien et ceux d’une poignée d’oligarques issus principalement d’une même région, l’État du Gujarat (à l’ouest du sous-continent). Héraut de l’idéologie nationaliste hindoue, au discours à la fois martial et messianique, Narendra Modi reste le porteur d’une vieille tradition qui combattait déjà la vision unitaire et territoriale de la « nation indienne » incarnée par Gandhi (assassiné d’ailleurs en 1948 par un membre issu de cette mouvance hindouiste politique et religieuse radicalisée). À l’instar de Trump, une partie de la campagne de Modi s’était appuyée sur le slogan « rendre à l’Inde sa grandeur »2, faisant référence à l’histoire prétendument glorieuse de la culture hindoue avant qu’elle ne soit colonisée et détruite par les envahisseurs musulmans et chrétiens. Selon ce récit, même après l’indépendance de l’Inde en 1947, la population hindoue avait été freinée par les « élites corrompues » du Congrès national indien (INC).
Modi prétend que la civilisation hindoue est supérieure à toute autre civilisation et qu’elle devrait revendiquer et défendre un statut plus conforme à ses ambitions dans le monde. Modi accompagne ses délires politiques d’un véritable clientélisme et bon nombre de ceux qui avaient intérêt à propulser son idéologie et son parti aux premières loges s’en sont mis plein les poches, à l’image des milliardaires, tels l’ineffable Akshmi Mittal, Mukesh Ambani ou encore Gautam Adani, qui se retrouve par exemple à la tête d’un véritable conglomérat évalué en bourse à près de 240 milliards de dollars, et dont la fortune personnelle a augmenté de 230 % depuis l’arrivée au pouvoir de Modi en 2014 ! Les élections n’ont fait, naturellement, que conforter ces états de faits au détriment des intérêts de l’ensemble de l’État indien.
Au niveau politique, le résultat de ces nouvelles élections parlementaires, loin de marquer une stabilisation de la stucture politique, confirment les difficultés croissantes et une fragilisation du gouvernement, soumis à un discrédit grandissant. Les sondages à la sortie des urnes, prévoyaient une grande victoire du Bharatiya Janata Party (BJP) de Narendra Modi. Mais c’est le contraire qui s’est produit : le BJP a perdu 63 sièges. Cependant, la NDA, l’alliance dirigée par le BJP, a quand même obtenu la majorité absolue (293 des 543 sièges). En conséquence, pour la première fois, Narendra Modi devra gouverner avec une coalition qui s’avère très complexe à mettre en œuvre, car le BJP va désormais être dépendant de ses alliés, entre autres le Telugu Desam Party (TDP) et le Janata Dal (United) (JDU).3 Le poids croissant du chacun pour soi, de dirigeants ambitieux et de forces centrifuges feront que les négociations pour les futurs postes gouvernementaux de la coalition risquent d’être longues et très difficiles. Bon nombre de mesures très controversées que souhaitait prendre le BJP, comme la redistribution du nombre de sièges parlementaires par État, s’annonce désormais très difficile avec un risque de fortes tensions. Toute tentative de conciliation au sein de la coalition se fera nécessairement au détriment d’une autre composante. Ainsi, le risque est grand de voir l’affirmation d’une plus grande autonomie des composantes, notamment de la droite, avec l’organisation paranationaliste hindoue RSS jouant davantage sur son profil paramilitaire menaçant inspiré par les groupuscules violents et radicaux de l’extrême droite en Europe.4
Ainsi affaibli, âgé de 73 ans, le Premier ministre Modi risque donc d’être exposé à de nombreux problèmes, en dépit du mythe « d’invincibilité » qu’il avait voulu construire et de ses ambitions démesurées. L’Inde, comme pour les autres grands pays de la planète, devient de plus en plus instable et difficile à gouverner.
Mystification démocratique et divisions nationalistes
Si les faiblesses croissantes de la bourgeoisie indienne touchent son jeu politique et le rendent plus fragile, cela ne saurait signifier pour autant que le prolétariat pourrait en tirer un quelconque bénéfice. C’est même l’inverse, au vu des mystifications démocratiques renforcées. Les élections du printemps 2024 ont été présentées à la fois par le président du Parti du Congrès, Mallikarjun Kharge comme « une victoire du public et une victoire pour la démocratie », par le Premier ministre Modi comme « la victoire de la plus grande démocratie du monde », mais aussi par Rahul Gandhi comme un effort extraordinaire dans lequel « vous êtes tous venus voter pour la défense de la démocratie et de la constitution » de même que par le Deccan Chronicle5 comme « un témoignage de la résilience de la démocratie indienne ». Toute la bourgeoisie n’est que trop heureuse de jouer à l’unisson de cette mystification démocratique contre la classe ouvrière qui repose sur l’idée que la démocratie est progressiste, qu’elle est un remède à tous les malheurs en affirmant que les très mauvaises conditions de vie de la majorité de la population indienne peuvent être améliorées en élisant un autre gouvernement. De plus, cette idéologie s’accompagne d’une forte propagande nationaliste. Bien entendu, tous les partis bourgeois promettent que les choses iront mieux s’ils sont élus, mais cela est totalement impossible dans les conditions historiques actuelle du capitalisme. Toutes les promesses de prospérité et de libertés démocratiques sont des mensonges cherchant à masquer la dictature du capital et sa faillite. D’ailleurs, malgré un taux de croissance économique annuel moyen de 8 %, les travailleurs souffrent toujours davantage d’années d’exploitation et d’une pauvreté effroyable. Le gouvernement exige pourtant que les travailleurs serrent encore davantage les dents et acceptent encore de nouvelles attaques. Modi demande aux travailleurs du BJP de « faire également des sacrifices pour le pays ». Il mène aussi une croisade religieuse, divisant les travailleurs, favorisant un repli ethnique opposant hindous, chrétiens, sikhs et musulmans. Ces derniers sont présentés comme la cinquième colonne en Inde. Le Cachemire et le Jammu, où vivent presque exclusivement des musulmans, sont soumis à une sorte de loi martiale. Dans le reste du pays, les musulmans, qui représentent 15 % de la population, sont pourchassés par les suprémacistes hindous. Du point de vue des intérêts de la bourgeoisie dans son ensemble, une telle politique est complètement irrationnelle, car au lieu de renforcer la cohésion de la nation, l’une des fonctions principales de l’État, elle l’affaiblit en alimentant un désordre meurtrier.
Contrairement à une personnalité comme Indira Gandhi, qui n’à jamais avancé le projet de faire de l’Inde une « nation hindoue » Modi s’appuie sur de nombreuses milices de terrain en semant partout la terreur. Ainsi, non seulement son gouvernement ne parvient pas à apporter la prospérité et le développement promis, mais il apporte également davantage d’instabilité : sa politique élargit les fissures et accroît les tensions dans la société. En 2023, 428 incidents ont été enregistrés dans 23 États, notamment des intimidations communautaires, des violences envers les vaches sacrées et des lynchages.6 La Cour suprême indienne a signalé à juste titre que la violence des fondamentalistes hindous était en train de devenir « la nouvelle norme ». L’Inde est en train de devenir une poudrière sociale de plus en plus dangereuse, comme l’a affirmé l’évaluation statistique des risques 2023-24, révélant que l’Inde se classe au cinquième rang des pays les plus à risque de massacres parmi les 166 répertoriés.
Le prolétariat : seule véritable alternative
Face à cette situation catastrophique et aux menaces liées à l’instabilité croissante, seule les travailleurs qui font partie de la classe ouvrière internationale sont capables d’avancer une alternative Au cours des cinq dernières années, les travailleurs de différents secteurs ont mené une lutte sur leur propre terrain : dans le secteur de la santé, des transports, dans l’automobile, dans les différents secteurs agricoles, parmi les employés des banques publiques, ainsi que les travailleurs du textile. Il y a même eu trois grèves à l’échelle de l’Inde où les travailleurs hindous et musulmans se sont battus côte à côte. Mais la classe ouvrière en Inde est isolée et n’a pas la conscience de classe et l’expérience de la classe ouvrière d’Europe occidentale ou des États-Unis. Le poison de la campagne idéologique bourgeoise en cours martelant le slogan « les hindous d’abord » (et tous les autres ensuite) et la propagande démocratique qui l’accompagne constituent un obstacle à la reconquête de son identité de classe. Néanmoins, les travailleurs indiens ont montré qu’ils sont capables malgré les campagnes bourgeoises nauséabondes de lutter contre la détérioration de leurs revenus, non pas en termes de religion, de caste ou d’appartenance ethnique, mais en tant que classe dont les intérêts sont partout les mêmes : l’opposé de ceux de la classe exploiteuse, et qui possède la capacité de développer ses luttes à l’échelle mondiale pour la destruction du système capitaliste
D/WH
1Lire sur notre site l’article : La gauche du capital ne peut pas sauver ce système à l’agonie.
2Modi n’a probablement pas formellement prononcé ce slogan, mais c’est le discours de son parti, le BJP.
3Respectivement : les partis du nouveau ministre en chef de l’État fédéral de l’Andhra Pradesh, N. Chandrababu Naidu et celui du ministre en chef chef de l’État fédéral du Bihar Nitish Kumar.
4Il s’agit du Rashtriya Swayamsevak Sangh (RSS) (“organisation patriotique nationale”, une organisation paramilitaire de nationalistes hindous au riche palmarès d’émeutes sanglantes et meurtrières.
5Quotidien indien de langue anglaise.
6Voir : Rising Tide of Hate [898] : India's Decade of Increasing Communal Violence and Discrimination [898], 6 juin 2024.
Géographique:
- Inde [899]
Personnages:
- Modi [703]
Récent et en cours:
- élections en Inde [900]
Rubrique:
Nouvelle réponse à Steinklopfer
- 126 lectures
Avec la publication du dernier texte du camarade Steinklopfer, et la réponse qui suit ici, nous poursuivons, avec un peu de retard, le débat interne sur la situation mondiale et ses perspectives auquel on peut accéder dans un dossier de contributions remontant au 23e congrès du CCI en 2019[1] . Le premier échange de ce débat, sous le titre "Débat interne au sein du CCI sur la situation internationale", publié en août 2020, exposait les principales divergences, entre l'organisation et les camarades en désaccord, autour de l'évolution des antagonismes impérialistes et du rapport de force entre les classes, le camarade Steinklopfer discernant une tendance marquée à la formation de nouveaux blocs impérialistes et à une Guerre mondiale, sur la base d'une évaluation différente de celle du CCI concernant les défaites subies par la classe ouvrière dans les années 1980 et la capacité de cette dernière à entraver la marche vers la guerre mondiale. Mais il abordait également les causes sous-jacentes et les conséquences ultimes de la phase de décomposition.
À travers les deux textes suivants, "Explication des amendements du camarade Steinklopfer rejetés par le Congrès" et "Réponse au camarade Steinklopfer -août 2022", le débat a approfondi notre compréhension de la décomposition ; pour l'organisation, les positions développées par Steinklopfer tendaient à remettre en cause ce concept théorique, même si le camarade prétendait le défendre encore. En mai 2022, nous avons publié une contribution du camarade Ferdinand, qui avait voté pour les amendements proposés par le camarade Steinklopfer. Cet article portait sur l'approche du CCI concernant l'émergence de la Chine en tant que puissance mondiale, et la réponse de l'organisation, "Réponse à Ferdinand", était pour une grande partie destinée à répondre à ce que Ferdinand considérait comme notre sous-estimation de ce développement historique indubitablement important, un développement qui est à nouveau au cœur de la dernière contribution de Steinklopfer et de notre réponse. Dans les deux réponses du CCI, nous avons soutenu que, malgré certaines erreurs initiales, notre reconnaissance de l'importance historique de l'essor de la Chine est claire, la différence portant sur la façon dont nous l'interprétons dans le contexte de la phase terminale du capitalisme.
Nous invitons nos lecteurs à revenir sur ces articles afin de suivre les principaux fils du débat, qui a des implications très concrètes sur notre capacité à analyser les dangers réels auxquels sont confrontés la classe ouvrière et l'ensemble de l'humanité, et à comprendre pleinement à la fois le rôle de la classe ouvrière en tant que pôle alternatif à la barbarie capitaliste et la fonction de l'organisation révolutionnaire dans les conditions actuelles de la lutte prolétarienne.
Il est toujours plus évident que la civilisation capitaliste est à bout de souffle et qu’elle menace de plus en plus la survie de l’humanité. Les fractions les plus intelligentes de la classe dominante le reconnaissent déjà à travers leur notion de «polycrise» mettant en lien les pandémies, l’effondrement économique et écologique ainsi que la prolifération de guerres et de tensions militaires[2] . Pour les différentes composantes du milieu révolutionnaire marxiste, qui ont depuis plus d’un siècle maintenant mis en lumière l’alternative "socialisme ou barbarie", le glissement vers la barbarie devient de plus en plus concret. Mais il existe des divergences importantes entre les organisations de la gauche communiste concernant la forme et la trajectoire précises de ce glissement aujourd'hui, et donc sur les dangers les plus urgents auxquels sont confrontés la classe ouvrière et l'humanité dans son ensemble. La majorité de ces groupes affirment que nous assistons à la formation d'alliances ou de blocs impérialistes stables dominés par un leader incontesté, et donc à une trajectoire définie vers une nouvelle guerre mondiale. Cela implique également que la classe dirigeante a désormais la capacité de mobiliser la classe ouvrière -à l'échelle mondiale- pour l'enrôler dans l'effort de guerre de ces hypothétiques blocs concurrents. En particulier, tant l'organisation que les camarades en désaccord acceptent l'idée que le conflit impérialiste primordial sur la planète oppose les États-Unis à son nouveau challenger, la Chine, et que, surtout depuis le déclenchement de la guerre en Ukraine, il existe un danger croissant d'affrontements militaires non seulement entre des États impérialistes secondaires ou tertiaires, mais aussi entre les grandes puissances elles-mêmes. Nous pouvons également noter que le débat a clarifié certaines interprétations erronées de notre application du concept de décomposition. Par exemple, comme le note le camarade Steinklopfer dans son texte le plus récent : "Une autre clarification est la réponse qu'il apporte à ma critique selon laquelle le CCI considère désormais le "chacun contre tous" impérialiste comme une sorte de deuxième explication principale à l'entrée du capitalisme en décomposition. L'article explique que le CCI considère ce chacun contre tous comme un facteur contributif et non comme une cause de la décomposition. Je l'ai compris maintenant camarades, vous n'entendrez plus cette critique de ma part".
Néanmoins, il reste des désaccords fondamentaux entre les deux points de vue, concernant les implications de la tendance au "chacun pour soi" dans les relations impérialistes, et la capacité de la bourgeoisie à mobiliser la classe ouvrière pour la guerre. Et comme nous essaierons de le montrer à nouveau dans cet article, les positions adoptées par Steinklopfer dans sa contribution la plus récente tendent encore à remettre en cause les fondements de la notion de décomposition du CCI.
Les implications de la montée en puissance de la Chine
Pour Steinklopfer, le changement le plus important survenu depuis 1990 est l'émergence de la Chine en tant que véritable challenger des États-Unis. Comme il le dit dans sa dernière contribution :
- "Nos Thèses sur la décomposition étaient justes au moment où elles ont été écrites. Ces thèses n'ont jamais dit que la tendance à la bipolarisation (au regroupement des rivalités autour de deux protagonistes principaux) ou à la formation de blocs impérialistes disparaissait. Ce qu'elles disent, et à juste titre, c'est qu'au moment de leur rédaction, il n'existait aucun pays (et aucun en vue) capable de rivaliser avec les États-Unis et que, par conséquent, la guerre mondiale n'était plus à l'ordre du jour. Dans cette situation, les Thèses avaient également raison d'insister sur le fait que, même sans guerre mondiale, le capitalisme restait tendanciellement condamné à finir par anéantir notre espèce, à travers des guerres locales, un chaos général, la destruction de la nature, etc. Il n'est pas surprenant que, trois décennies plus tard, la situation ait changé. Avant tout parce que la Chine est en train de développer le potentiel mondial nécessaire pour défier les États-Unis. Mais aussi parce que l'impérialisme russe a retrouvé sa capacité de contre-attaque (une puissance avec de nombreuses faiblesses, mais qui possède toujours des fusées intercontinentales qui menacent l'Amérique).
La montée en puissance de la Chine a remis la question de la guerre mondiale à l'ordre du jour de l'histoire. Cela représente, dans un sens, une sorte de "normalisation" par rapport à l'histoire du capitalisme décadent. La période après 1989, pendant laquelle la classe dirigeante ne se préparait pas à une guerre mondiale, était une exception à la règle. Une exception qui est désormais révolue. Cela ne signifie pas qu'une Troisième Guerre mondiale est inévitable : pendant toute la durée de la guerre froide, elle était également à l'ordre du jour, et pourtant elle n'a jamais éclaté. Ce dont nous pouvons être sûrs, en revanche, c'est que le prolétariat, l'humanité dans son ensemble et la planète devront payer un prix terrible pour le conflit sino-américain, d'une manière ou d'une autre, quelles que soient les formes qu'il prendra".
Comme nous le disons dans notre actualisation de "Militarisme et décomposition (mai 2022) [668] –Revue internationale 168), lorsque nous avons analysé les possibilités de formation de nouveaux blocs impérialistes en 1990, nous n'avons pas pris en compte la montée en puissance de la Chine sur le plan économique et impérialiste. Il s'agit certainement d'une évolution d'une importance énorme et il ne fait aucun doute que, contrairement aux candidats que nous avions envisagés à l'époque (l'Allemagne et le Japon), la Chine s'est révélée être un challenger plus crédible à la domination mondiale des États-Unis. Malgré leurs profondes divisions, toutes les principales factions de la bourgeoisie américaine reconnaissent la nécessité de bloquer l'ascension de la Chine et, au moins depuis l'administration Obama, ont élaboré une stratégie d'encerclement de la Chine par le biais d'alliances militaires telles qu'AUKUS et la Quad, d'une pression économique croissante et de la tentative d'affaiblir l'"ami" militaire le plus puissant de la Chine, la Russie, en l'entourant de pays membres de l'OTAN et en la poussant à riposter en Ukraine. La Chine a elle aussi sa stratégie pour atteindre l'hégémonie mondiale, en renforçant sa puissance économique sur une longue période, en élargissant sa présence commerciale (et militaire) grâce à la construction des "nouvelles routes de la soie", et en se préparant ainsi aux confrontations impérialistes plus directes du futur.
Cependant, la réalité de cette "bipolarisation" entre les États-Unis et la Chine, et l'existence réelle de ces stratégies impérialistes à plus long terme, ne signifient pas que nous serions maintenant beaucoup plus avancés vers la constitution de nouveaux blocs impérialistes que nous ne l'étions en 1990. Certes, la Chine constitue maintenant un concurrent sérieux pour le rôle de leader du bloc, mais en même temps, s'est également renforcée la contre-tendance du chacun pour soi au niveau des relations internationales, et au sein des bourgeoisies nationales. L'imprévisibilité de la vie politique de la classe dirigeante américaine en est un signe clair. Une victoire de Trump lors des prochaines élections mettrait à mal la stratégie de l'administration actuelle vis-à-vis de la Chine en adoptant une attitude beaucoup plus conciliante à l'égard de la Russie, contrairement aux efforts actuels des États-Unis pour faire pression sur la Russie et affaiblir sa capacité à agir en tant qu'allié militaire sérieux de la Chine.
Trump donnerait également les coudées franches à Israël pour poursuivre sa politique de la terre brûlée au Moyen-Orient, ce qui ne peut avoir pour résultat que d'intensifier l'instabilité et la barbarie dans toute la région ; et l'attitude du "payez ou sinon", de Trump à l'égard des pays de l'OTAN, réduirait à néant les efforts de Biden pour ramener l'OTAN dans le giron militaire américain. Mais même si Biden gagne, cela n'améliorera pas substantiellement la capacité des États-Unis à imposer leur volonté à Israël ou à discipliner leurs "alliés" en Europe, où de puissantes forces centrifuges sont en gestation. Si la guerre en Ukraine, à première vue, semblait se conformer au modèle de deux camps clairement définis, typique de la période 1945-89, la guerre au Moyen-Orient et l'attaque terroriste IS-K à Moscou, exprimant une nouvelle menace aux frontières asiatiques de la Russie, ont notamment mis en lumière la nature véritablement chaotique des conflits inter-impérialistes d'aujourd'hui.
De leur côté, les rêves de la Chine de forger une alliance solide contre les États-Unis se heurtent également à des obstacles importants. La période de son "miracle économique" touche à sa fin sous le poids d'une vaste accumulation de dettes ; ces faiblesses économiques, associées à l'instabilité croissante au Moyen-Orient et ailleurs, menacent l'avenir de l'ensemble de son projet de "route de la soie" ; alors que dans le même temps, la puissance économique incontestable de la Chine rend tous ses voisins et alliés potentiels, y compris la Russie, extrêmement méfiants à l'idée de se soumettre à une nouvelle forme de domination chinoise.[3]
Bien entendu, plus les États-Unis intensifieront leur encerclement de la Chine, plus cette dernière sera poussée à se venger, notamment en envahissant Taïwan, ce qui provoquerait nécessairement une réponse militaire de la part des États-Unis, avec des risques d'escalade nucléaire non moins importants et peut-être même plus importants que ceux qui sont actuellement inscrits dans la guerre en Ukraine. Le camarade Steinklopfer se félicite que la réponse précédente qui lui a été adressée reconnaisse "que le danger de conflits atomiques incontrôlés est plus grand que pendant la guerre froide - et que ce danger continue de croître". Mais pour nous, de telles catastrophes incontrôlées sont profondément ancrées dans le processus même du chacun pour soi, du chaos impérialiste croissant, et sont donc tout à fait compatibles avec l'analyse théorique de la décomposition. Pour Steinklopfer, en revanche, la formation de blocs et une marche "contrôlée" vers la guerre mondiale ne contredisent pas la théorie de la décomposition :
- "Selon la réponse d'août 2022, Steinklopfer et Ferdinand insistent toujours sur le fait qu'ils sont d'accord avec le concept de décomposition, bien qu'à notre avis, certains de leurs arguments le remettent en question.
Quels sont ces arguments ?
Le premier argument cité est que Steinklopfer et Ferdinand ne comprennent pas que le chacun pour soi de la bourgeoisie est devenu un obstacle majeur à la formation de nouveaux blocs.
"Oui, je ne comprends pas cela. La formation de blocs impérialistes n'est elle-même pas l'opposé diamétral du chacun pour soi, mais au contraire un produit du chacun pour soi. Les blocs sont une forme possible prise par la lutte de chacun contre tous, puisque la concurrence est inhérente au capitalisme. Que cette lutte des États-nations les uns contre les autres prenne une forme plus chaotique et débridée, ou qu'elle prenne la forme d'alliances, voire de blocs, dépend des circonstances. Quelles circonstances ? Après 1989, les circonstances étaient telles qu'elles excluaient la formation de nouveaux blocs, et nos thèses ont eu raison de le reconnaître. La circonstance la plus importante était qu'il ne restait plus qu'une seule superpuissance, les États-Unis, de sorte que tous les autres avaient le souci primordial d'éviter que leur propre marge de manœuvre ne soit réduite ou éliminée par ce seul géant. Aujourd'hui, les circonstances changent. Si la Chine parvient à poursuivre son ascension actuelle, de sorte qu'elle deviendrait une deuxième superpuissance aux côtés de l'Amérique, tous les autres pays se trouveront de plus en plus contraints de choisir entre Washington et Pékin (ou, pour le dire plus correctement, ils devront définir eux-mêmes laquelle des deux puissances représente la plus grande menace pour leurs propres intérêts)"".
Mais notre position sur la possibilité de nouveaux blocs (développée non pas tant dans les Thèses sur la décomposition que dans le texte d'orientation Militarisme et décomposition (octobre 1990) [668], publié en octobre 1990 ) ne se limitait pas au truisme selon lequel les blocs sont, en dernière analyse, le produit de la concurrence capitaliste, mais soutenait qu'en plus de l'absence d'un véritable candidat pour un nouveau leader, le désordre croissant de la nouvelle phase constituait lui-même une contre-tendance à la formation de nouveaux blocs. Dans la nouvelle période, citant le fait que "les tendances centrifuges entre tous les États, suite à l'exacerbation des antagonismes nationaux, ne peuvent qu'être accentuées", il poursuit :
- "plus les différentes fractions d'une bourgeoisie nationale tendent à s'entre-déchirer avec l'aggravation de la crise qui attise leur concurrence, et plus l'État doit se renforcer afin de pouvoir exercer son autorité sur elles. De même, plus la crise historique, et sa forme ouverte, exercent des ravages, plus une tête de bloc doit être forte pour contenir et contrôler les tendances à sa dislocation entre les différentes fractions nationales qui le composent. Et il est clair que dans la phase ultime de la décadence, celle de la décomposition, un tel phénomène ne peut que s'aggraver encore à une échelle considérable.
C'est pour cet ensemble de raisons, et notamment pour la dernière, que la reconstitution d'un nouveau couple de blocs impérialistes, non seulement n'est pas possible avant de longues années, mais peut très bien ne plus jamais avoir lieu : la révolution ou la destruction de l'humanité intervenant avant une telle échéance.(…)
Dans la nouvelle période historique où nous sommes entrés, et les événements du Golfe viennent de le confirmer, le monde se présente comme une immense foire d'empoigne, où jouera à fond la tendance au "chacun pour soi", où les alliances entre États n'auront pas, loin de là, le caractère de stabilité qui caractérisait les blocs, mais seront dictées par les nécessités du moment. Un monde de désordre meurtrier, de chaos sanglant dans lequel le gendarme américain tentera de faire régner un minimum d'ordre par l'emploi de plus en plus massif et brutal de sa puissance militaire.".
En quelques années, comme indiqué précédemment, nous avions conclu que, loin de maintenir un minimum d'ordre, le recours croissant des États-Unis à la force militaire, surtout en Afghanistan et en Irak, était devenu un facteur principal d'extension et d'intensification du désordre, et ce bien avant l'accélération marquée de la décomposition et du chaos dans les années 2020.
Nous pouvons ajouter qu'il est sûrement significatif que le camarade Steinklopfer ne mentionne pas le fait que l'événement fondateur qui a permis de parler de la décomposition comme d'une phase qualitativement nouvelle dans la vie du capitalisme était précisément l'effondrement d'un bloc impérialiste entier sans guerre mondiale - une expression profonde du processus de "désintégration intérieure" (pour reprendre le terme utilisé pour définir la nouvelle époque de décadence lors du congrès fondateur du Comintern en 1919) qui s'est imposée dans la phase finale de cette époque.
Ce que les Thèses sur la décomposition montrent clairement, et nous le répétons, c'est que la société se putréfie, se désagrège, parce qu'aucune des deux classes n'est capable d'offrir une perspective pour le futur ; et pour la classe dirigeante, il s'agit de la capacité d'unir la société derrière cette perspective, comme ce fut le cas pendant les années de la contre-révolution, lorsque la classe ouvrière avait subi une défaite frontale et historique. Nous reviendrons sur ce point lorsque nous examinerons la situation du prolétariat mondial aujourd'hui, mais nous devons d'abord examiner une question qui contribue davantage à la surestimation par le camarade de la capacité de la bourgeoisie à maintenir son contrôle sur la société : la question de l'écologie, de la destruction capitaliste de la nature.
Décomposition et croissance des "forces destructrices"
Dans l'Idéologie allemande de 1845 -alors que le capitalisme avançait vers son zénith- Marx et Engels prévoyaient déjà que "Dans le développement des forces productives, il arrive un stade où naissent des forces productives et des moyens de circulation qui ne peuvent être que néfastes dans le cadre des rapports existants et ne sont plus des forces productives, mais des forces destructrices (le machinisme et l'argent)". Dans leur impatience de voir la révolution prolétarienne, ils considéraient ce changement de qualité comme plus ou moins imminent. Ils ont rapidement tiré les leçons des révolutions de 1848 et conclu que le capitalisme avait encore du temps devant lui avant que sa crise historique n'ouvre la porte à la révolution communiste ; mais Marx en particulier est revenu sur cette question vers la fin de sa vie, dans ses recherches sur les anciennes formes communautaires et les problèmes croissants du "métabolisme" de l'homme avec la nature, se demandant -face à la nécessité de répondre aux questions posées par les révolutionnaires en Russie- s'il serait nécessaire que chaque pays passe par les feux du développement capitaliste, avec toutes ses conséquences destructrices, avant qu'une révolution mondiale ne devienne une possibilité réelle. Là encore, la conquête effective du globe par l'impérialisme dans la dernière partie du XIXe siècle a montré que le processus de destruction brutale des formes précapitalistes et de pillage des ressources naturelles était inéluctable. Mais cette course effrénée n'a fait qu'accélérer le moment où le capitalisme a plongé dans son époque de "désintégration intérieure", signalée par le déclenchement de la Première Guerre mondiale, lorsque la révolution s'est présentée non seulement comme possible mais comme une nécessité si l'humanité voulait éviter une régression catastrophique.
Contre de nombreuses interprétations erronées, le CCI a toujours insisté sur le fait que la décadence du capitalisme ne signifie pas un arrêt du développement des forces productives, et peut même inclure un développement prodigieux dans certaines branches de la production. Cependant, précisément parce que la survie continue du capitalisme a été un fardeau sur le dos de l'humanité qui devient de plus en plus lourd au fil des décennies, nous voyons de plus en plus les forces productives du capital se transformer en forces destructrices. L'expression la plus évidente de ce changement est le développement du cancer du militarisme -une économie de guerre permanente pour répondre aux besoins d'une guerre impérialiste quasi-permanente. Ceci est classiquement illustré par l'avènement des armes nucléaires, dans lesquelles les progrès les plus profonds de la science ont été rassemblés pour produire des armes qui pourraient facilement détruire toute vie sur Terre, une sinistre réalisation des mots de Marx dans son discours à l'anniversaire du Journal du Peuple, en avril 1856 : "L'humanité acquiert la maîtrise de la nature, mais, en même temps, l'homme devient l'esclave des hommes et de sa propre infamie. La pure lumière de la science elle-même semble avoir besoin, pour resplendir, du contraste de l'ignorance. Toutes nos découvertes et tout notre progrès ont pour résultat, semble-t-il, de doter les forces matérielles d'une vie intelligente et de ravaler l'homme au niveau d'une simple force matérielle."[4]
Autre exemple frappant : le développement spectaculaire de l'informatique, d'internet et de l'intelligence artificielle. Potentiellement un moyen de raccourcir la journée de travail et de supprimer les travaux répétitifs et épuisants, le capital décadent s'est emparé de l'ordinateur et d'Internet pour brouiller la distinction entre vie professionnelle et vie privée, pour licencier massivement, pour diffuser les intoxications idéologiques les plus pernicieuses, tandis que la généralisation de l'intelligence artificielle -même si ses dangers potentiels peuvent être délibérément exagérés pour cacher des dangers plus imminents résultant de la production capitaliste- apparaît désormais non seulement comme une menace pour l'emploi, mais comme un moyen potentiel de remplacement et de destruction de l'espèce humaine.
Dans la réponse du camarade Steinklopfer, en revanche, le côté destructeur du "développement des forces productives" du capitalisme semble être gravement sous-estimé. Ainsi, pour lui, la transformation de millions de paysans en ouvriers par le miracle économique chinois, accompagnée de l'urbanisation frénétique de tout le pays, ne semble être qu'un gain pour la future révolution prolétarienne : "Au cours des 30 dernières années, c'est jusqu'à un demi-milliard de paysans en Chine qui ont été prolétarisés, ce qui constitue de loin le développement numérique le plus massif du prolétariat dans l'histoire du capitalisme. De plus, ce nouveau prolétariat gigantesque est, dans une large mesure, très habile, éduqué et inventif. Quel gain pour les capacités productives de l'humanité ! Quel potentiel surtout pour l'avenir !"
La classe ouvrière mondiale, en avançant vers la révolution, exploitera certainement le potentiel de ces nouvelles masses prolétariennes. Mais Steinklopfer ne mentionne pas le fait que l'industrialisation et l'urbanisation rapides de la Chine au cours des dernières décennies ont également été un facteur d'accélération de la crise écologique mondiale, y compris la gestation de pandémies comme l'explosion du Covid 19. Comme l'expliquent les "Thèses sur la décomposition", la prolongation de la vie du capital dans la phase de décomposition ne doit absolument pas être considérée comme une condition préalable nécessaire à la révolution prolétarienne mondiale. Au contraire, elles insistent sur le fait que la décomposition est essentiellement un facteur négatif dans le développement de la conscience de classe prolétarienne, tandis que la "mondialisation" du capital alimentée par la dette au cours des dernières décennies menace avant tout de saper les bases naturelles d'une future société communiste. Une fois de plus, nous pensons qu'il s'agit là d'une preuve supplémentaire que Steinklopfer, bien qu'il prétende être d'accord avec les thèses sur la décomposition, s'y oppose en réalité au niveau le plus essentiel.
Une autre preuve de la sous-estimation de la question écologique par Steinklopfer se trouve dans ce passage : "Bien que nous ne devions certainement pas sous-estimer les dangers gigantesques découlant de la relation destructrice du capitalisme avec la nature (dont la guerre impérialiste est une partie essentielle), il est tout à fait possible que la société bourgeoise -par ses manipulations technologiques et autres- puisse repousser l'extinction de notre espèce par des crises environnementales pour les 50 ou cent prochaines années (au prix d'une barbarie innommable, par exemple d'éventuels génocides contre les mouvements de réfugiés climatiques".
Dans cette optique, la destruction de la nature semble agir en quelque sorte "en parallèle" à la poussée guerrière, même si le camarade reconnaît que la guerre impérialiste en fait partie. Mais ce qui a été souligné par le CCI, en particulier depuis le début de la présente décennie, c'est l'interaction croissante entre la crise écologique et la guerre impérialiste : une démonstration lucide en est fournie par le coût écologique des guerres actuelles en Ukraine et au Moyen-Orient (augmentation rapide des émissions toxiques, menace de destruction de l'agriculture et de famine, danger de pollution nucléaire et d'autres formes de pollution, réduction des mesures "vertes" prévues par les gouvernements occidentaux afin de dédier plus de ressources à la guerre, etc.). Simultanément, l'épuisement des ressources naturelles et la course à l'exploitation des sources d'énergie restantes ne peuvent qu'exacerber la concurrence nationale et donc militaire. Nous pouvons également ajouter qu'un certain nombre d'études scientifiques ont montré que les "solutions technologiques" proposées par le capitalisme pour lutter contre le changement climatique (telles que l'injection massive de dioxyde de soufre dans la haute atmosphère terrestre afin d'épaissir artificiellement la couche de particules d'aérosols réfléchissant la lumière, ou l'idée de la bioénergie avec capture et stockage du carbone - BECCS) sont plus que susceptibles d'exacerber le problème à plus ou moins long terme.[5]
La classe ouvrière et le danger de guerre
(a) La question des "idéologies de bloc"
Nous avons déjà évoqué l'incapacité de la bourgeoisie à mobiliser la classe ouvrière des pays capitalistes centraux en vue d'une guerre mondiale. À un premier niveau, cela s'exprime par la résistance continue de la classe ouvrière aux tentatives de la bourgeoisie de réduire le niveau de vie dans "l'intérêt national", c'est-à-dire les intérêts impérialistes de l'État-nation. Mais le problème auquel est confrontée la bourgeoisie est également d'ordre idéologique. Pour rassembler différents pays autour d'un bloc impérialiste, il faut un ciment idéologique unificateur, comme l'antifascisme et la défense de la démocratie dans les années 30 et 40. À cette "idéologie de bloc" globale ont rapidement succédé, à la fin des années 40 et au cours des décennies suivantes, les fables de l'"antitotalitarisme" à l'Ouest et de la "défense de la patrie socialiste" à l'Est, bien qu'il faille dire que la capacité de la classe dirigeante de l'Ouest à changer d'ennemi, de l'Allemagne nazie à la Russie stalinienne, et à s'en tirer, n'aurait pas été possible si la contre-révolution n'avait pas encore battu son plein. En tant que force unificatrice, elle n'avait pas le pouvoir de l'antifascisme, car l'influence de l'idéologie stalinienne sur la classe ouvrière en Occident était encore forte à cette époque. Quoi qu'il en soit, l'un des signes que la période contre-révolutionnaire touchait à sa fin dans les années 1960 était la tendance de la classe ouvrière à se détacher de certains des principaux thèmes de l'idéologie bourgeoise. L'une des expressions de ce phénomène a été le développement de ce que l'on appelle le "syndrome du Vietnam" aux États-Unis, un aveu ouvert de l'incapacité de la classe dirigeante à poursuivre la mobilisation directe de la jeunesse prolétarienne au nom de l'"endiguement du communisme".
En cette période de décomposition, il est évident que la classe dirigeante des pays centraux manque sérieusement d'une idéologie qui pourrait servir à convaincre la classe ouvrière qu'il vaut la peine et qu'il est nécessaire de se sacrifier sur les autels de la guerre impérialiste. La "guerre contre la terreur", conçue expressément aux États-Unis pour remplacer l'anticommunisme comme justification de la guerre, s'est soldée par les fiascos de l'Afghanistan et de l'Irak et a donné naissance à encore plus de formes de terrorisme, comme l'État islamique. Il est vrai que l'appel à défendre la démocratie contre les "autocraties" en Russie, en Chine, en Iran et en Corée du Nord a été ressorti de la naphtaline, mais étant donné l'extrême scepticisme à l'égard du "processus démocratique" dans les pays avancés, il y a encore du chemin à parcourir avant qu'une nouvelle croisade pour la démocratie puisse être utilisée par la bourgeoisie pour huiler les rouages de la machine de guerre ; et bien que ce scepticisme soit en grande partie pris en main par les forces du populisme plutôt que par une critique prolétarienne de la démocratie, le populisme lui-même n'est pas plus efficace en tant qu'idéologie de guerre, car il est un produit direct de la décomposition et des fractures de la classe dirigeante qui en résultent ; et il ne peut s'alimenter qu'en attisant davantage ces divisions, réelles ou imaginaires (guerres culturelles, dénonciation des élites, transformation des immigrés en bouc-émissaires, etc.) Il n'est pas chargé de guider les grands États-nations dans un effort de guerre (ce qui n'exclut pas, bien sûr, le recours à des actes de guerre hautement "irresponsables" lorsqu'il s'empare des rênes du gouvernement).
Nous pourrions ajouter que le leader potentiel d'un nouveau bloc -la Chine- est beaucoup trop dépendant de sa méthode de gouvernement soit par la répression flagrante, soit par la pression économique, tout en manquant de la force idéologique nécessaire pour attirer d'autres forces mondiales dans son orbite. Ce que les commentateurs bourgeois aiment appeler le "capitalisme léniniste" est beaucoup moins efficace à ce niveau que les proclamations "socialistes" et "anti-impérialistes" de l'ex-URSS ou de la Chine elle-même sous Mao.
Ce sont des problèmes réels pour la bourgeoisie d'aujourd'hui, mais ils brillent par leur absence dans les arguments de Steinklopfer.
(b) Encore une fois sur la question des défaites
La réponse du camarade Steinklopfer aborde bien sûr la question des défaites subies par la classe ouvrière en évaluant la capacité de la classe dirigeante à entrer en guerre. Il expose sa position dans la deuxième partie de sa réponse (point 4) :
- "Depuis 1968, le prolétariat a subi un certain nombre de défaites. L'un des aspects les plus positifs de la présente réponse à Steinklopfer est qu'elle reconnaît plus clairement la réalité de ces défaites. Elle reconnaît à la fois la défaite de la politisation après 1968 et celle de la perte de l'identité de classe et de l'objectif communiste révolutionnaire par la classe ouvrière autour de 1989. Et elle reconnaît maintenant (comme Steinklopfer l'avait précédemment souligné) que la compréhension de ces défaites est cohérente avec notre théorie de la décomposition. Il s'agit là d'un véritable progrès si l'on considère qu'il n'y a pas si longtemps, l'organisation affirmait que tout discours sur les défaites était défaitiste....
En tout état de cause, nous sommes d'accord sur le fait que le prolétariat peut encore se remettre de ses faiblesses actuelles. Les défaites dont nous parlons ici ne font pas partie d'une contre-révolution, puisqu'elles n'ont pas été précédées d'une révolution ou d'une tentative de révolution. Cependant, il est extrêmement difficile de juger de la nature et de l'impact précis de ces défaites, car elles sont historiquement sans précédent. Jamais auparavant le prolétariat n'avait perdu son identité de classe et son objectif révolutionnaire comme il l'a fait actuellement. Tout cela rend plus difficile d'estimer par quels moyens la classe peut récupérer ses forces et à aller à nouveau de l'avant".
En réalité, l'organisation n'a pas découvert l'idée de défaites il y a quelques années lorsque la réponse précédente à Steinklopfer a été écrite, et elle pensait que le simple fait de parler de défaites était "défaitiste", elle devrait se critiquer pour cela. Comme nous l'avons dit dans la réponse précédente, le CCI a toujours adhéré à cette citation de Rosa Luxemburg : "la révolution est la seule forme de "guerre" -et c'est une autre loi particulière de l'histoire- dans laquelle la victoire finale ne peut être préparée que par une série de "défaites"" ("L'ordre règne à Berlin", 1919). Dans les années 1980, par exemple, nous avons écrit sur la grave défaite de la grève de masse en Pologne et de la grève des mineurs en Grande-Bretagne. La résolution sur le rapport de forces entre les classes du 23e congrès explique clairement que cette dernière s'inscrivait dans une contre-offensive globale de la classe dominante qui, avec les effets croissants de la décomposition sur la classe ouvrière, explique son incapacité à faire avancer la troisième vague de luttes depuis 1968, ce qui a certainement exacerbé l'énorme impact des campagnes idéologiques autour de l'effondrement du bloc de l'Est en 1989.
La question qui nous oppose ici n'est pas de savoir si l'on parle ou non de défaites, mais de la nature, de la qualité de ces défaites. Pour nous, la notion même de décomposition est fondée sur l'argument selon lequel la classe des pays avancés, à aucun moment depuis les années 80, n'avait subi une défaite frontale, historique, comparable à ce qu'elle avait vécu dans les années 20, 30 et 40. C'est pourquoi nous avons parlé d'une impasse et non d'une victoire de la bourgeoisie. C'est pourquoi nous soutenons toujours que les conditions préalables à la mobilisation de la classe pour une guerre mondiale restent les mêmes. Selon nous, la preuve de cette absence de défaite historique et de la capacité continue du prolétariat à répondre à la crise capitaliste est fournie par la rupture de la lutte des classes qui se poursuit depuis les mobilisations du prolétariat en Grande-Bretagne à l'été 2022 et qui n'a pas faibli. Le camarade Steinklopfer ne mentionne pas ces événements historiquement importants dans son texte. Il est vrai que celui-ci a été écrit en septembre 2022, avant que la reprise des luttes ne soit confirmée par l'éclosion de mouvements dans d'autres pays (notamment en France) mais, même à l'automne 2022, il aurait été possible de faire une évaluation préliminaire du mouvement en Grande-Bretagne et de l'analyse qu'en fait l'organisation - plus particulièrement de notre insistance sur le fait que ces luttes marquent le début de la récupération de la perte de l'identité de classe mentionnée dans la réponse de Steinklopfer.
(c) Sur le développement de la conscience de classe
Dans les deux parties de la réponse du camarade Steinklopfer, figurent deux points sur la question spécifique de la conscience de classe. Dans la première partie, il reprend nos critiques à son idée selon laquelle, au lieu d'assister à une "maturation souterraine" de la conscience de classe, nous vivons en réalité un processus de "régression souterraine".
- "Mais il y a une autre idée dans la Réponse, qui est que je nie la validité du concept de maturation souterraine. Cette idée est basée sur le fait que j'ai parlé d'une "régression souterraine", c'est-à-dire d'une stagnation ou d'une régression de l'avant-garde politisée dans son ensemble. Tout cela pose une question très intéressante : la maturation souterraine est-elle nécessairement toujours un processus linéaire, accumulatif, dans lequel aucune stagnation et surtout aucune régression n'est possible ? Pourquoi en serait-il ainsi ? Parce que la réalité change constamment, les travaux politiques et théoriques doivent nécessairement suivre les évolutions. S'ils ne le font pas, cela ne représenterait-il pas une sorte de régression du développement souterrain de la conscience du milieu révolutionnaire ?"
Pour commencer, la réponse du camarade fait fausse route lorsqu'il demande "la maturation souterraine est-elle toujours un processus linéaire et accumulatif" ? Nous n'avons jamais parlé de la maturation de la conscience dans la classe, qu'elle soit ouverte ou cachée, au grand jour ou souterraine, comme d'un processus linéaire qui doit toujours aller de l'avant. Ce que nous avons dit depuis que nous avons commencé à utiliser cette idée dans les années 1980, c'est que, même dans les périodes où stagne la conscience dans la classe, la conscience de classe, la conscience communiste, peut s'approfondir et progresser grâce aux activités théoriques des révolutionnaires, comme elle l'a fait dans les années 1930 par exemple grâce au travail des fractions de gauche. En même temps, nous avons soutenu qu'un tel processus de maturation ne se limite pas à la réflexion et à l'élaboration des organisations politiques, mais peut aussi se développer à une échelle beaucoup plus large, surtout dans les périodes où la classe ouvrière n'a pas été écrasée par la contre-révolution. À notre avis, les mouvements de grève actuels témoignent précisément d'un tel processus, qui n'est pas seulement une réponse aux attaques immédiates auxquelles la classe est confrontée, mais la manifestation d'un mécontentement qui s'est accumulé pendant des années ("trop c'est trop"), et qui a également donné des signes d'une réapparition de la mémoire ouvrière, comme dans les références aux luttes de 1968 et de 2006 dans le mouvement en France. Parallèlement à cela, on voit apparaître des éléments plus directement politisés à la recherche de positions claires, notamment autour du problème de l'internationalisme. Tels sont les fruits d'une véritable croissance souterraine et les révolutionnaires commettraient une grave erreur en ne les remarquant pas. Enfin, s'il est vrai qu'une partie de la gauche communiste "régresse" dans l'opportunisme ou reste paralysée par des formules dépassées, nous ne pensons pas que le CCI lui-même soit victime d'une telle stagnation ou d'un tel retour en arrière, même si le combat contre l'influence de l'idéologie dominante est nécessairement permanent pour toutes les organisations révolutionnaires.
Le deuxième point concerne le lien entre les différentes dimensions de la lutte des classes : économique, politique et théorique.
- "Ma divergence est que je suis en désaccord avec l'organisation parce qu'elle pense que la lutte économique est le creuset principal du redressement de la classe, à partir duquel le développement politique et théorique peut se faire. Pour moi, au contraire, ce creuset principal n'existe pas. Le prolétariat ne peut commencer à avancer que lorsqu'il progresse sur les trois niveaux. Notre attente que la politisation en particulier se développe à partir des luttes économiques a déjà été démentie dans les années 1980. Pourquoi aurait-elle plus de succès maintenant en l'absence d'une identité de classe et d'une perspective révolutionnaire ? Il n'y a pas un seul creuset principal. Lorsque le prolétariat progresse, il le fait selon les trois dimensions de sa lutte historique : les dimensions économiques, politique et théorique.
En fait, jamais dans l'histoire du prolétariat, ses organisations politiques et ses œuvres théoriques ne se sont développées unilatéralement à partir de la lutte économique. Au 19ème siècle, les organisations révolutionnaires du prolétariat en Europe (comme le mouvement chartiste en Grande-Bretagne ou la social-démocratie en Allemagne) se sont développées à partir d'une rupture politique avec la bourgeoisie progressiste, dans certains cas même révolutionnaire, sur la base de la reconnaissance : notre but n'est pas la révolution bourgeoise mais la révolution prolétarienne. La même chose s'est produite, sous une forme plus embryonnaire, déjà en 1525 pendant la guerre des paysans en Allemagne et pendant les révolutions bourgeoises anglaise et française. Aujourd'hui, l'un des points de départ devra être la rupture avec les illusions réformistes bourgeoises, la reconnaissance que la voie à suivre se trouve réellement au-delà du capitalisme".
Bien qu'affirmant l'unité de ces trois dimensions, nous pensons que le camarade persiste en fait à isoler l'économique des aspects politiques et théoriques. Les luttes du prolétariat ne sont pas restées sur le plan purement économique après les jours grisants de mai-juin 68 à Paris. Le côté inévitablement politique de tout mouvement de grève digne de ce nom était déjà affirmé par Marx et Engels dans la période ascendante, mais c'est encore plus vrai à l'époque de la décadence où la tendance de la lutte est de se heurter au pouvoir de l'État. Les travailleurs polonais de 1976 et 1980 le savaient parfaitement, tout comme les mineurs britanniques en 1972,74 et 84. Le problème, bien sûr, est que la possibilité de pousser plus loin cette politisation implicite a été et continue d'être entravée par la domination idéologique de la bourgeoisie, activement imposée par les forces chargées de maintenir la lutte des classes sous contrôle, en particulier les syndicats et les partis de gauche. Mais il n'en reste pas moins que la nécessité de développer une vision plus large et plus profonde de l'orientation de la lutte des classes, en la reliant à l'ensemble de l'avenir de l'humanité, nécessite le stimulus de la crise économique et la volonté des travailleurs de se battre sur leur propre terrain. Cette approche a déjà été mise en avant dans les parties finales des Thèses sur la décomposition, et est confirmée une fois de plus par le renouveau actuel des luttes de classe qui font les premiers pas vers la récupération de l'identité de classe, en trouvant une voie à travers le brouillard de confusion créé par le populisme, la politique identitaire et les mobilisations interclassistes. Et le combat pour faire avancer la dimension politique et théorique de ces mouvements revient plus spécifiquement à l'organisation révolutionnaire. D'autre part, la tendance à séparer la dimension économique de la dimension politique de la lutte des classes, que nous pouvons encore discerner dans le texte de Steinklopfer, a toujours été le premier pas vers la vision moderniste qui voit la classe ouvrière piégée dans sa résistance purement économique, voire pleinement intégrée à la société bourgeoise. En même temps, à part souligner la nécessité pour l'organisation révolutionnaire de développer ses armes théoriques (ce que personne ne désapprouve en soi), l'ensemble des implications pour notre activité militante - défense et construction de l'organisation, intervention dans la lutte des classes -reste inexploré dans les contributions de Steinklopfer et Ferdinand, et devrait être approfondi dans la discussion si on veut qu'elle avance.
Amos, avril 2024
[1] Dossier: Internal debate on the world situation [901], ICC Online.
[2] See Update of the Theses on Decomposition (2023) [902], International Review 170
[3] Steinklopfer n'est pas d'accord pour dire que les États-Unis ont poussé la Russie à envahir l'Ukraine parce qu'une telle tactique contient le risque d'une escalade nucléaire. Mais de tels risques n'ont jamais empêché le bloc occidental de s'engager dans la même stratégie d'encerclement et de provocation contre l'URSS pendant la guerre froide -une stratégie que les États-Unis considèrent comme un grand succès, puisqu'elle a conduit à l'effondrement de l'"Empire du Mal" sans conflit militaire mondial. Comme Steinklopfer le dit lui-même, "le monde est entre les mains d'imbéciles" , tout à fait prêts à risquer l'avenir de l'humanité pour défendre leurs intérêts impérialistes.
[4] Les révolutions de 1848 et le prolétariat [903]. K. Marx.
[5] Voir par exemple la critique des solutions technologiques proposées par Jason Hickel, dans "Less is More, How Degrowth will save the world", 2020. Hickel critique également de façon convaincante les idées du "Green New Deal" de la gauche. Mais les théoriciens de la "décroissance" - y compris le "communisme de la décroissance" de Kohei Saito - restent encore dans l'horizon du capitalisme, comme nous visons à le montrer dans un prochain article.
Vie du CCI:
- Débat [670]
Personnages:
- Steinklopfer [904]
- Ferdinand [905]
- Obama [699]
- Jason Hickel [906]
- Kohei Saito [907]
- Mao [908]
- Rosa Luxemburg [909]
- Engels [910]
Questions théoriques:
- Décomposition [517]
Rubrique:
Élections aux États-Unis, en Grande-Bretagne et en France: La gauche du capital ne peut pas sauver ce système à l’agonie
- 175 lectures
La montée du populisme est un produit direct de la décomposition du capitalisme et a créé de profondes divisions au sein de la classe dirigeante. Aux États-Unis, le Parti démocrate semble paralysé dans ses efforts pour empêcher Trump de revenir à la présidence, une issue qui accélérerait le glissement vers le chaos tant aux États-Unis qu’à l’échelle internationale. En France et en Grande-Bretagne, l’histoire est un peu différente, avec Macron et le « Nouveau Front populaire » qui s’allient pour bloquer l’arrivée au pouvoir du Rassemblement national, et le Labour qui écrase un parti Tory profondément gangrené par le populisme. Malgré cela, les forces du populisme et de l’extrême droite continuent de croître sur le terreau d’une société en décomposition.
La CCI organisera une réunion publique internationale en ligne pour discuter de cette situation parce que nous pensons qu’il est vital :
– d’analyser et comprendre les conflits entre les différentes factions de l’ennemi de classe
– Dénoncer les principales attaques idéologiques qui accompagnent ces événements, notamment la « défense de la démocratie contre le fascisme "
– Dégager les véritables intérêts de la classe ouvrière face à ces mystifications : ne pas se fier aux urnes ou à l’élection au parlement de partis qui prétendent parler en son nom, mais se défendre par une lutte collective et indépendante, en jetant les bases d’une confrontation politique avec l’ensemble du système capitaliste.
La réunion se tiendra le samedi 20 juillet entre 15h et 18h (heure française).
Si vous souhaitez participer, veuillez nous envoyer un courriel à l’adresse suivante : [email protected] [911]
Vie du CCI:
- Réunions publiques [219]
Rubrique:
JO de Paris: Un faste indécent à l’image du système capitaliste pourrissant
- 235 lectures
Les prochaines olympiades qui se dérouleront à Paris du 26 juillet au 11 août, suivies des jeux paralympiques du 28 août au 8 septembre ne semblent pas s’engager sous les meilleurs auspices. Dans un contexte de guerre en Europe et de fortes tensions géopolitiques, de crise économique et d’incertitudes politiques, ces Jeux ont du mal à enthousiasmer les foules. Aux tracasseries ordinaires des Parisiens exposés aux désagréments des préparatifs depuis des mois, il faut ajouter l’énorme hausse des tarifs des transports urbains et, surtout, la véritable « chasse aux pauvres » qui s’est emparée de la capitale.
Un véritable “nettoyage social”
Afin de pas ternir « l’image de la France » et le grand spectacle programmé aux abords de la Seine, la bourgeoisie a expulsé sans ménagement les « indésirables ». On assiste ainsi à un « déplacement massif et forcé des populations fortement précarisées. Depuis 2021-2022, on a constaté une hausse de 40 % des expulsions des lieux informels (squats, bidonvilles, campements de tentes…) situés à proximité des sites olympiques à Paris et Saint-Denis ainsi que des 25 espaces d’animations en marge des compétitions, dispersés dans la capitale. Sont concernés des personnes migrantes, des mineurs non accompagnés, les sans-abri ou encore les travailleuses du sexe ». (1) Pour l’État, seul compte son image sur la scène internationale !
Le nombre des expulsés s’est même accéléré brutalement à l’approche des échéances olympiques. La « chasse aux pauvres » a conduit à l’ouverture des hypocritement nommés « sas d’accueil temporaires » en régions (Lyon, Marseille, Toulouse, Bordeaux, Besançon, Rouen, Orléans, etc.). En catimini, des cars se succèdent pour déplacer les indésirables vers ces lieux volontairement excentrés. Finalement, bon nombre d’entre eux se retrouvent de nouveau à la rue… mais loin de la « fête du sport » !
Le renforcement de la surveillance et de la répression
Cette entreprise barbare et inhumaine est étroitement liée à une obsession sécuritaire qui conduit aussi l’État à accroître, de manière inouïe, son dispositif de surveillance et de répression. À mesure que s’exacerbe la crise du système capitaliste et les tensions sociales qui l’accompagnent, ce type de manifestations, JO ou autres grandes compétitions internationales, conduisent les forces de répression à quadriller l’espace, déployer des moyens aux proportions inédites, ouvertement totalitaires.
Déjà lors des précédents JO en Europe, ceux de Londres en 2012, le dispositif de sécurité s’apparentait à une véritable opération militaire : « on a compté 12 000 policiers en service et 13 500 militaires disponibles, c’est-à-dire plus que les troupes anglaises déployées en Afghanistan (9500 soldats) ! Plus que les 20 000 soldats de la Wehrmacht à Munich en 1936 ! A cela, on doit ajouter encore 13 300 agents de sécurité privés ! Un dispositif ultra-rapide de missile sol-air avait carrément été installé sur un immeuble, dans une zone densément peuplée, près du principal site olympique pour parachever le bouclier antiaérien ». (2)
Les moyens déployés pour ces nouvelles olympiades seront cependant largement supérieurs. Les besoins journaliers en agents de sécurité ont été estimés de 22 000 à 32 000 et il est même question de mobiliser l’armée ! Mais le caractère inédit est l’usage de la vidéo-surveillance algorithmique, autrement dit, l’exploitation de l’intelligence artificielle pour une surveillance policière hors normes. Cela, avec près de 15 000 vidéo-caméras. (3) Ces caméras sont capables d’analyser les comportements des individus et même potentiellement de collecter des données biométriques. Nul doute que ces dispositifs vont être pérennisés après les JO, comme après à chaque mise en œuvre « exceptionnelle », préparant ainsi à terme l’officialisation de la reconnaissance faciale (pour l’instant pratiquée mais non autorisée). Ce que la Chine a réalisé pour fliquer sa population fait pâlir d’envie tous les États « démocratiques ». D’ailleurs, cette technologie très intrusive a déjà été testée en France dans bon nombre de villes : l’exemple le plus connu étant celui de la ville de Nice.
Nulle illusion à se faire, ces dispositifs « testés » ont clairement pour but de s’installer et anticipent déjà tout mouvement de contestation sociale. Les JO sont une aubaine pour préparer la répression des futures luttes ouvrières !
Gabegie et corruption
Bien entendu, face aux inquiétudes et critiques, la bourgeoisie a prétendu que ces JO étaient bénéfiques pour l’emploi et pour l’économie. La réalité est beaucoup moins reluisante. Si certaines bonnes affaires permettent à des entreprises de s’en mettre plein les poches, une grande partie de l’activité correspond à la mobilisation de secteurs improductifs, sans compter les scandales de corruptions qui ont déjà commencé à éclater. Une grande partie de l’activité sera d’ailleurs générée par du travail gratuit, celui des 45 000 bénévoles employés durant toute la durée des JO. Comme à l’habitude, on verra bien fleurir tout un tas de slogans publicitaires et les spectateurs seront soumis au traditionnel matraquage publicitaire. Mais l’emploi réel ne sera ni pérennisé ni à la hauteur des espérances.
Contrairement à l’idée d’un possible « coup de fouet » pour l’économie, il ne faudra compter que sur « des bénéfices économiques très limités, voire nuls à moyen terme […] aucun impact macroéconomique significatif n’est attendu ». (4) En général, les JO ont plutôt plombé les économies à défaut de les booster. L’exemple des Jeux de Rio est à cet égard assez significatif : outre les scandaleux déplacements forcés de populations et une empreinte carbone négative, avec en plus quelques scandales financiers, le bilan de ces Jeux de Rio s’est soldé par un déficit abyssal (équivalant à 130 millions d’euros).
Un immense mégaphone pour la propagande nationaliste
Alors quel est l’intérêt des JO ? La vision partagée par toute la bourgeoisie peut se résumer à cette intervention de Christophe Lepetit, responsable des études économiques au Centre de droit et d’économie du sport (CDES) : « On n’accueille pas un événement sportif pour générer de la croissance économique, mais pour des raisons géopolitiques et sociales, pour le positionnement de la France à l’international ». Que doit-on entendre par « raisons géopolitiques et sociales » ? Rien d’autre qu’une propagande nationaliste visant à renforcer le sentiment d’appartenance à une « patrie ». Mais à travers l’exaltation et les effusions nationalistes apparemment « inoffensives » et « joyeuses », à travers la célébration de « l’unité » et de la « grandeur » nationales, la bourgeoisie tente surtout de valoriser l’adhésion à ses propres intérêts économiques et impérialistes, comme aux sacrifices qu’ils exigent. D’où cette énième cérémonie grandiose. « La mise en scène sportive à des fins de propagande, contrairement à ce que laisse entendre l’histoire officielle, n’est pas une particularité du nazisme ou du stalinisme, mais une pratique généralisée à tous les pays. Il suffit de se rappeler les protocoles et les fastes d’ouverture des Jeux olympiques de Pékin en 2008 ou de Londres en 2012, ou encore de l’entrée des équipes nationales de football au moment des grandes rencontres, pour s’en convaincre. Les grands shows sportifs permettent de provoquer de fortes émotions collectives guidant facilement les esprits vers un univers de codes et de symboles nationaux […]. Souvent accompagnées de musiques militaires, les compétitions internationales sont systématiquement précédées ou clôturées par les hymnes : “Ces rapports sont ceux de confrontations de toutes sortes où le prestige national est en jeu ; le rituel sportif est donc à ce niveau un rituel de la confrontation entre nations”. Dans ces brefs moments d’unions sacrées, les classes sociales sont “fondues”, niées, les spectateurs ouvertement appelés à se lever et à chanter les yeux fixés sur le drapeau national ou sur l’équipe qui l’incarne par ses couleurs ». (5)
C’est, en réalité, pour ces raisons surtout idéologiques que les JO sont organisés, avec pour objectif de favoriser le poison nationaliste et pour le pays organisateur, de « tenir son rang international ». En l’occurrence pour l’État français, l’occasion de soigner son image de leader européen au sein du couple franco-allemand flageolant et faire oublier momentanément son recul militaire et politique sur la scène impérialiste, suite aux déboires en Afrique et aux nombreuses pressions subies dans le Pacifique. Ces Jeux ont également pour objectif de marginaliser et isoler davantage la Russie en exerçant une pression politique à son encontre.
Au moment où nous écrivons ces lignes, le grand battage médiatique, hormis le ridicule suivi du parcours de la flamme olympique, n’a pas encore réellement commencé (J-15). Mais nul doute qu’un énorme battage patriotique sera au rendez-vous. Face à cette nouvelle campagne idéologique, dans un contexte ou le militarisme est omniprésent, nous ne pouvons que rappeler les mots de Rosa Luxemburg au moment de la Grande Guerre, lors des premières hécatombes sanglantes : « Les intérêts nationaux ne sont qu’une mystification qui a pour but de mettre les masses populaires laborieuses au service de leur ennemi mortel : l’impérialisme ». (6) Il s’agit bien d’un des objectifs majeurs de ces Jeux !
WH, 11 juillet 2024
1 « Pour les JO, on expulse en masse migrants, travailleuses du sexe, sans-abri… », Reporterre (26 juin 2024).
2 « Le sport dans le capitalisme décadent (de 1914 à nos jours) (Histoire du sport dans le ca [912]pitalisme, [912] partie II) [912] », dans Révolution internationale n° 438 (2012).
3 Selon Katia Roux, d’Amnesty International-France, cette surveillance automatisée « n’a jamais démontré son efficacité contre la criminalité et le terrorisme, alors que ses conséquences sur les libertés fondamentales, elles, sont avérées ».
4 « Les Jeux olympiques, un gouffre financier pour la France ? », Euractiv (10 mai 2024).
5 « Le sport dans le capitalisme décadent (de 1914 à nos jours) (Histoire du sport dans le capitalisme, partie II) [912] », dans Révolution internationale n° 438 (2012).
6 Brochure de Junius (1915).
Géographique:
- France [336]
Récent et en cours:
- JO de Paris [913]
Rubrique:
Tentative d’assassinat contre Donald Trump: La bourgeoisie américaine s’enlise dans le bourbier de l’instabilité
- 192 lectures
Quelques jours après la tentative d’assassinat contre Donald Trump qui a coûté la vie à l’un de ses supporters, il est encore trop tôt pour déterminer le mobile exact du tireur et les raisons de la défaillance du service chargé de la protection de l’ex-Président. L’attaque a cependant bouleversé la campagne électorale en permettant au camp Républicain de faire un pas supplémentaire vers la victoire. Touché à l’oreille, le visage en sang et le poing levé, presque miraculé, la réaction bravache de Trump, déjà favori des sondages, contraste clairement avec les signes perceptibles de gâtisme de son adversaire Démocrate. Quoi qu’il en soit, cet événement est une nouvelle manifestation de l’instabilité croissante au sein de la bourgeoisie américaine.
Exacerbation de la violence politique aux États-Unis
Les États-Unis ont une longue tradition d’assassinats politiques qui ont atteint par quatre fois le plus haut sommet de l’État. Mais, après le meurtre de la députée britannique Jo Cox en pleine campagne du Brexit en 2016, après la tentative d’assassinat qui a ciblé Bolsonaro au Brésil en 2018, après le meurtre de l’ancien Premier ministre japonais Shinzō Abe en 2022, après la tentative d’assassinat du premier ministre slovaque Robert Fico en mai 2024 ou l’agression dont a été victime en pleine rue la première ministre danoise Mette Frederiksen en juin dernier, cette nouvelle attaque s’inscrit dans un contexte de violences et de tensions politiques exacerbées de par le monde. Partout, la terreur et le terrorisme se banalisent et marquent peu à peu de leur empreinte les rapports politiques de la bourgeoisie : menaces, insultes, xénophobie décomplexée, violence des groupuscules d’extrême droite, implication des gangs dans les processus électoraux, règlement de compte entre cliques bourgeoises, coups de force… ce chaos rampant, qui était jusque-là contenu dans les pays les plus fragilisés d’Amérique latine ou d’Afrique, commence, toute proportion gardée, à devenir la norme dans les principales puissances du capitalisme.
Aux États-Unis, alors que les institutions « démocratiques » ont notamment pour rôle de garantir l’unité de l’État, leurs difficultés croissantes à contenir et à confiner la violence des rapports entre fractions bourgeoises rivales témoignent d’une véritable gradation des tensions. L’atmosphère de violence est à son comble. Trump lui-même n’a cessé, depuis son départ de la Maison-Blanche et sa tentative avortée de sédition contre le Capitole, de jeter de l’huile sur le feu, remettant en cause les résultats des élections, refusant de reconnaître sa défaite, promettant d’abattre son bras vengeur sur les « traîtres », les « menteurs », les « corrompus ». Il n’a cessé d’hystériser le « débat public », de raconter bobard sur bobard, de chauffer à blanc ses partisans… L’ex-Président s’est révélé être un maillon essentiel d’une véritable chaîne de violence qui déborde de tous les pores de la société et qui a fini par se retourner contre lui.
Vers toujours plus d’instabilité
Qu’un personnage à ce point irresponsable et grotesque ait pu balayer tout ce qu’il y avait d’un tant soit peu capable d’assurer efficacement la gestion de l’État bourgeois au sein du parti Républicain, qu’il ait seulement pu se présenter à la présidentielle sans rencontrer de sérieuses difficultés, ni politiques, ni même juridiques (malgré les nombreuses tentatives de ses adversaires), est en soi le signe éclatant de l’impuissance et de l’instabilité profonde dans laquelle s’enfonce l’appareil politique américain.
Mais si Trump est bel et bien le porte-voix de toute une atmosphère de violences sociales et politiques, un facteur actif de déstabilisation, il n’est que l’expression caricaturale de la dynamique dans laquelle s’enfonce toute la bourgeoisie. Car le camp Démocrate, bien qu’un peu plus soucieux de freiner ce processus, contribue tout autant à l’instabilité mondiale.
Certes, après la politique incohérente et imprédictible de l’administration Trump, Biden s’est montré plus efficace pour défendre les intérêts de la bourgeoisie américaine, mais à quel prix ? Alors que les guerres en Afghanistan et en Irak, qui avaient pour objectif de freiner le déclin du leadership américain en s’imposant comme « gendarme du monde », avaient mené à un fiasco évident et exacerbé le chaos au Moyen-Orient et dans le monde, Biden a poussé la Russie à intervenir en Ukraine. (1)
Ce massacre à grande échelle s’enlise semaine après semaine et semble ne pas avoir de fin. Avec l’explosion de l’inflation et le renforcement de la crise mondiale, avec l’accroissement des tensions impérialistes et l’approfondissement considérable de l’économie de guerre sur tous les continents, le conflit en Ukraine n’a fait qu’engendrer toujours plus de déstabilisation à une échelle plus vaste encore, y compris aux États-Unis.
Biden a parallèlement renforcé les tensions avec la Chine dans tout le Pacifique, faisant planer le risque d’une confrontation directe. La guerre à Gaza, que le Président américain n’est pas parvenu à contrôler et à contenir, a également considérablement accentué le déclin de la puissance américaine, ce qui engendrera tôt ou tard une réaction des États-Unis d’une barbarie encore plus démesurée.
Et voilà désormais le locataire de la Maison-Blanche réduit à tenter de s’accrocher pitoyablement au pouvoir, alors qu’une grande partie de son camp le pousse ouvertement à se retirer ! Mais par qui remplacer Biden ? Les Démocrates sont divisés et discrédités, à peine capables de s’entendre sur un remplaçant. Tous sont déjà prêts à s’écharper. Même la vice-Présidente Harris, la seule à pouvoir s’imposer, est très impopulaire au sein même de son propre camp. Entre Trump, Biden, Harris… il ne reste à la bourgeoisie américaine que de mauvaises options, signe de sa grande fragilité.
Autre signe des tensions extrêmes entre les camps Républicain et Démocrate, Trump n’était pas sorti de l’hôpital, qu’ils s’accusaient mutuellement, avec beaucoup de véhémence, d’être responsables de l’attaque. Trump et Biden, tout de même conscients de la situation explosive, ont momentanément tenté d’apaiser ce climat incendiaire au nom de l’unité nationale… avant que ne se déverse à nouveau un torrent de fake-news et d’accusations sans fondement.
Mais la division entre les partis bourgeois, les luttes intestines acharnées en leur sein, les coups de poker permanents, les rivalités d’égos, les coups de poignards, les stratégies de terre brûlée, tout cela est loin d’être l’apanage de la seule bourgeoisie américaine. La campagne électorale en Amérique fait bien sûr écho à la situation de nombreux États en Europe ou ailleurs, dont la France est le dernier exemple éclatant. Le capitalisme pourrit sur pied et cela a des conséquences sur tous les plans (impérialistes, sociaux, économiques, environnementaux…), entraînant les appareils politiques de la bourgeoisie dans une logique de sauve-qui-peut et une spirale inéluctable d’instabilité où chaque clique bourgeoise tente tant bien que mal de tirer la couverture à soi… même au détriment des intérêts généraux de la bourgeoisie.
Il n’y a rien à attendre des élections
Malgré les difficultés croissantes de la bourgeoisie à contrôler son propre appareil politique, elle sait encore parfaitement utiliser la mystification démocratique pour réduire la classe ouvrière à l’impuissance. Alors que le prolétariat doit développer son combat contre l’État bourgeois la bourgeoisie nous enferme, à travers les élections, dans de faux dilemmes : quel parti serait le plus apte à assurer la gestion de l’État bourgeois ? Alors que le prolétariat doit chercher à s’organiser en classe autonome, les élections réduisent les ouvriers à l’état d’électeurs-citoyens, tout juste bons à choisir, sous la pression du rouleau compresseur de la propagande, quelle clique bourgeoise sera chargée d’organiser leur exploitation.
Il n’y a donc rien à attendre des prochaines élections. Si Biden (ou son remplaçant) devait finalement l’emporter, la politique belliciste de l’Administration Biden et tout le chaos mondial qu’elle a engendré s’intensifieront davantage pour maintenir coût que coût le rang des États-Unis dans l’arène mondiale. Si Trump confirmait en novembre les prédictions de victoire, la politique déstabilisatrice et erratique de son premier mandat reviendrait avec plus de force et d’irrationalité. Son colistier, J.D. Vance, s’adresse plus directement à la classe ouvrière et l’exploitation démagogique de sa propre histoire personnelle de victime oubliée de l’Amérique rurale et désindustrialisée lui permet de renforcer son camp et son influence en misant sur les « indécis » pour les convaincre d’une prétendue « nouvelle voie » possible derrière son mentor miraculé.
Que Trump ou Biden l’emporte, la crise historique dans laquelle s’enfonce le capitalisme ne disparaîtra pas, les attaques continueront à pleuvoir et la violence aveugle ne cessera pas de se déchaîner.
Face à la décomposition du monde capitaliste, la classe ouvrière et son projet révolutionnaire représentent la seule véritable alternative. Alors que les guerres, les catastrophes ou la propagande viennent sans cesse heurter ses luttes et sa réflexion, depuis deux ans, le prolétariat renoue partout avec sa combativité et commence peu à peu à retrouver la conscience d’être une seule et même classe. Partout, de petites minorités émergent et réfléchissent sur la nature du capitalisme, sur les causes de la guerre et sur la perspective révolutionnaire. Avec toutes ses élections, la bourgeoisie cherche à briser cette combativité et cette maturation, elle cherche à empêcher toute politisation des luttes. Malgré les promesses (évidemment, jamais tenues) d’un capitalisme plus « juste », plus « écologique », plus « pacifique », malgré la culpabilisation féroce de « ceux qui ne barrent pas la route au fascisme » dans les urnes, ne nous y trompons pas : les élections sont bel et bien un piège pour la classe ouvrière !
EG, 19 juillet 2024.
1 Washington avait pour objectif d’affaiblir la Russie de sorte qu’elle ne puisse constituer une alliée de poids de la Chine dans l’éventualité d’un conflit dirigé contre cette dernière. Il s’agit donc d’isoler un peu plus la Chine tout en portant un coup à son économie et sa stratégie impérialiste en coupant ses « nouvelles routes de la soie » à travers l’Europe de l’Est.
Géographique:
- Etats-Unis [184]
Personnages:
- Donald Trump [896]
- Joe Biden [914]
Récent et en cours:
- élections aux États-Unis [915]
Rubrique:
ICConline - août 2024
- 31 lectures
Nouvel acte de mouchardage du GIGC: Appel à la solidarité révolutionnaire et à la défense des principes prolétariens
- 447 lectures
Le Groupe international de la Gauche communiste (GIGC) vient, une nouvelle fois, de moucharder. Dans son dernier bulletin, sous le titre « Contre l’individualisme et l’esprit de cercle 2.0 des années 2020 », on peut lire : « la pratique des réunions par vidéo tend malheureusement à se substituer aux réunions physiques. Nous n’avons rien, bien au contraire, contre l’organisation de réunions vidéo entre camarades isolés, surtout au niveau international, qui ne peuvent pas se réunir sur le même lieu. Par contre, le fait que les militants tendent à ne plus faire l’effort, à considérer même comme superflu, de se déplacer et de participer à des réunions physiques, en présentiel comme disent les managers dans les entreprises, est une régression par rapport à un acquis et un principe d’organisation du mouvement ouvrier ». Et ce passage de renvoyer à une note de bas de page : « Nous savons, par exemple, que le CCI ne tient plus de réunions locales, même lorsqu’il a plusieurs membres dans la même ville. Il tient des réunions “transversales”, “réunissant” des membres de différents endroits, donc isolés de leurs camarades avec qui ils sont censés intervenir en cas de luttes ouvrières ou autres, mais restant confortablement chez eux. Les critères pour dispatcher les membres dans telle ou telle réseau vidéo ne peuvent qu’être arbitraires et personnalisés. Un remake moderne de la bolchevisation zinoviéviste des partis communistes au début des années 1920, qui avait substitué les réunions par section territoriale ou locale par la création des cellules d’entreprise et que la Gauche d’Italie avait dénoncé avec force ».
Voilà le GIGC en train d’informer publiquement l’État et toutes les polices du monde de comment le CCI organise ses réunions internes ! C’est la raison d’être de ce groupe : surveiller le CCI pour divulguer sur son site internet le maximum d’informations sur notre organisation et ses militants.
Pour rappel, le GIGC ou son ancêtre la prétendue « Fraction Interne du CCI » (FICCI) (1) ont déjà divulgué publiquement :
- la date où devait se tenir une conférence de notre section au Mexique en présence de militants venus d’autres pays. Cet acte répugnant, consistant à faciliter le travail de répression de l’État bourgeois, est d’autant plus ignoble que ses membres savaient pertinemment que certains de nos camarades au Mexique avaient déjà, dans le passé, été victimes de la répression et que certains avaient été contraints de fuir leur pays d’origine.
- les véritables initiales d’un de nos camarades avec la précision qu’il était l’auteur de tel ou tel texte compte tenu de « son style » (ce qui est une indication intéressante pour les services de police).
- et même, régulièrement, des extraits de nos bulletins internes !
Mais le lecteur attentif aura peut-être noté deux petits mots sous la plume du GIGC qui sont, en fait, directement inspirés des techniques de flics : « nous savons »…
« Nous savons, par exemple, que le CCI… ». Ici, ce groupe atteint des sommets de cynisme. Il veut nous montrer qu’il sait, qu’il sait ce qui se passe dans le CCI, qu’il sait parce qu’il a un informateur, un indic, une taupe. Ce faisant, il veut jeter la suspicion dans nos rangs, distiller le poison de la méfiance.
Depuis sa naissance, chaque fois que le GIGC parvient à glaner dans les égouts un « scoop » sur la vie interne du CCI, il le claironne à tue-tête. En 2014, dès son deuxième, numéro le GIGC publiait ainsi des extraits de nos bulletins, en se vantant d’exploiter là une « fuite » (selon leur propre terme). Comble de la manipulation, il soulignait même dans une note de bas de page : « Nous nous sommes engagés à ne pas divulguer publiquement comment et par qui nous avions reçu les bulletins internes du CCI. Néanmoins, nous pouvons assurer que la “source” est hors de tout soupçon d’appartenance à des services policiers ou autres ».
Dans son dernier bulletin, le GIGC poursuit son œuvre, toujours à travers une note de bas de page : « les bulletins internes du CCI contiennent de nombreuses contributions sur le sujet. Il serait certainement utile de les rassembler et de les publier un jour ».
Victor Serge dans son livre Ce que tout révolutionnaire doit savoir de la répression, met clairement en évidence que la diffusion du soupçon et de la calomnie est l’arme privilégié de l’État bourgeois pour détruire les organisations révolutionnaires : « la confiance en le parti est le ciment de toute force révolutionnaire […] Les ennemis de l’action, les lâches, les bien installés, les opportunistes ramassent volontiers leurs armes dans les égouts ! Le soupçon et la calomnie leur servent à discréditer les révolutionnaires […]. Ce mal (le soupçon entre nous) ne peut être circonscrit que par un grand effort de volonté ». Le GIGC use exactement des mêmes méthodes que celles du Guépéou, la police politique de Staline, pour détruire de l’intérieur le mouvement trotskiste des années 1930. Le CCI ne tombera pas dans ce piège.
Mais en agissant de la sorte, le GIGC ne s’attaque pas seulement à notre organisation. Il encourage le développement des mœurs de voyous et de mouchards, il brise le tabou de la délation, il gangrène tout le milieu prolétarien. Pire, le GIGC commet tous ces crimes au nom de la Gauche communiste ! C’est pourquoi nous appelons toutes les organisations révolutionnaires, toutes les minorités, tous les individus voulant sincèrement défendre la révolution prolétarienne et ses principes, à dénoncer publiquement ces actes de mouchardage.
Seule la plus grande fermeté politique sur les principes, la plus solide solidarité entre révolutionnaires, peut constituer une digue face à ces immondices.
CCI
1 Le GIGC est né en 2013 de la fusion de cette fameuse FICCI d’avec le groupe Klasbatalo de Montréal.
Courants politiques:
- FICCI - GIGC/IGCL [524]
Rubrique:
Permanence en ligne le samedi 31 août 2024
- 116 lectures
Le Courant Communiste International organise une permanence en ligne le samedi 31 août 2024 à 15h.
Ces permanences sont des lieux de débat ouverts à tous ceux qui souhaitent rencontrer et discuter avec le CCI. Nous invitons vivement tous nos lecteurs et tous nos sympathisants à venir débattre afin de poursuivre la réflexion sur les enjeux de la situation et confronter les points de vue. N'hésitez pas à nous faire part des questions que vous souhaiteriez aborder.
Les lecteurs qui souhaitent participer aux permanences en ligne peuvent adresser un message sur notre adresse électronique ([email protected] [213]) ou dans la rubrique « nous contacter [214] » de notre site internet, en signalant quelles questions ils voudraient aborder afin de nous permettre d’organiser au mieux les débat.
Les modalités techniques pour se connecter à la permanence seront communiquées ultérieurement.
Rubrique:
Derrière la “sainte icône” de l'abbé Pierre, le visage de la violence capitaliste
- 134 lectures
L’abbé Pierre décédé en 2007 est aujourd’hui accusé de plusieurs agressions sexuelles. Elles font suite à un premier témoignage en 2023 « faisant état d’une agression sexuelle commise par l’abbé Pierre sur une femme » et qui était adressé à Emmaüs International, Emmaüs France et la Fondation Abbé-Pierre. Depuis l’enquête diligentée par Emmaüs a permis de recueillir les récits de sept victimes donc l’une mineure pour des faits s’étalant de 1970 à 2005 : « Ces révélations bouleversent nos structures, au sein desquelles la figure de l’abbé Pierre occupe une place majeure », a réagi le mouvement Emmaüs dans un communiqué. Le « choc » est immense dans la société, tant le personnage, longtemps « personnalité préférée des Français », et son association ont bénéficié d’un large soutien au fil des décennies, des médias et des politiciens de gauche comme de droite. Emmaüs n’a pas été dans le déni (cette fois-ci !). Ce changement de posture suit celui de l’Église laquelle a dû faire face, au niveau mondial, à de très nombreux scandales. Mais ce changement ne s’explique pas par une empathie toute chrétienne envers les victimes avérées ou potentielles pour des affaires souvent couvertes ou étouffées par la hiérarchie (parfois impliquée elle-même) pendant des décennies mais plus sûrement par le choc de confiance à l’intérieur de l’Église comme à l’extérieur et la volonté de freiner l’hémorragie des fidèles.
La sacralisation de l’Abbé Pierre est aujourd’hui fortement écornée par ses comportements ignobles et le silence de son entourage et de l’Église. (1) Il ne faut cependant pas oublier que sa figure du « saint homme » a aussi été l’instrument de toute une idéologie de fausse solidarité basé sur l’exploitation sociale de la misère. Le mouvement Emmaüs rassemble aujourd’hui plus de 30 000 personnes (bénévoles, compagnes et compagnons, salariés et salariés en insertion) dans toute la France. Il est également présent dans 37 pays du monde. Les communautés connaissent nombre de conflits sociaux : pour les travailleurs et parmi les plus fragiles, les sans-papiers (délivrable sous condition suivant l’avis du directeur au bout de trois ans !), c’est 40 heures par semaine et de 150 à 300 € par mois. Des communautés qui connaissent une multiplication des grèves comme dans le Nord en 2023. Martin Hirsch, un temps président d’Emmaüs, puis nommé au gouvernement, a concocté à ces travailleurs un statut particulier (OACAS) car il n’en avait aucun mais qui les exclut du droit de travail classique : « En excluant les compagnons du droit du travail, ce statut OACAS les prive surtout de la possibilité d’avoir recours aux Prud’hommes en cas de conflit avec un responsable. Il les prive également du salaire minimum légal, ainsi que d’un contrat de travail, d’où les expulsions sans préavis. “Avec ce texte, on a tout simplement légalisé l’esclavage”, se désole Victor, un ancien bénévole ». (2)
L’association du « saint homme » est une entreprise d’exploitation capitaliste profitant d’une main d’œuvre fragile avec l’alibi de l’insertion. Toute entreprise de ce type tient objectivement un rôle d’encadrement des travailleurs les plus pauvres et, en dénaturant la solidarité, en éloignant les exploités de la véritable solidarité de classe, elle joue un rôle d’amortisseur de la colère sociale comme beaucoup d’association de ce type face à la crise capitaliste. Dès lors, on comprend le soutien du monde politique, de la bourgeoisie en général, et de l’État. Loin de lutter contre les conséquences et encore moins les causes de la misère et contre toutes les formes d’exclusion comme le prétend sa charte, Emmaüs en vit et la perpétue, elle en est le produit. Emmaüs est bien une claire expression de la violence sociale institutionnalisée.
ETH, 3 août 2024
1 De cette série de témoignage ressort « une forme de sidération lors des faits » une forme d’emprise alimentée par le statut de l’abbé Pierre et une forme d’idolâtrie : « J’ai l’habitude de me défendre. Mais là, c’était Dieu. Comment vous faites quand c’est Dieu qui vous fait ça ? ».
2 « Emmaüs : Certaines communautés sont des zones de non-droit », Reporterre (28 juin 2022).
Situations territoriales:
- France [508]
- Situation sociale en France [323]
Personnages:
- Abbé Pierre [916]
Récent et en cours:
- Emmaüs [917]
Rubrique:
ICConline - septembre 2024
- 39 lectures
Émeutes racistes en Grande-Bretagne: Face à la division, notre seul moyen de défense, c’est la lutte de classe!
- 63 lectures
Dans la Russie des tsars, comme en Europe occidentale au Moyen-âge, tout commençait souvent par une folle rumeur : les Juifs avaient sacrifié l’un de nos enfants lors d’un rituels diaboliques. De sinistres groupes politiques, les « Cent noirs », incitaient les couches les plus misérables de la population à attaquer un autre groupe de pauvres, les Juifs des ghettos, pour les violer, les piller et les tuer. La police officielle restait le plus souvent inactive. C’était le pogrom.
Les choses ont beaucoup changé depuis… mais pas complètement. Dans le Royaume-Uni de 2024, de folles rumeurs circulent sur l’identité du jeune homme détraqué qui a perpétré un véritable massacre d’enfants à Southport. Et une foule déchaînée, souvent composée de personnes issues des couches les plus défavorisées de la population, s’en est prise à d’autres groupes, parfois encore plus désespérés.
Cette fois-ci, cependant, la cible principale n’est pas les Juifs, mais les musulmans et les demandeurs d’asile. Parmi les forces politiques qui alimentent la violence, on trouve les adorateurs traditionnels des nazis, qui voient toujours la main de la « juiverie mondiale » derrière chaque problème social et politique. Mais nombre d’entre eux, comme la vedette d’extrême droite Tommy Robinson, ont compris que l’islamophobie rapporte beaucoup plus aujourd’hui, et prétendent même être les meilleurs défenseurs des Juifs face à la menace islamiste. Et l’esprit du pogrom perdure…
Mais ce qui perdure par dessus tout, c’est la volonté de la bourgeoisie de « diviser pour mieux régner » : diviser tous les exploités et les opprimés pour mieux les affaiblir, les empêcher de voir que la véritable cause de leur misère n’est pas une catégorie particulière des exploités et des opprimés, mais le système social de leurs exploiteurs. C’est ce système, le capitalisme mondial, qui est responsable à la fois des guerres et de la destruction écologique qui a jeté sur les routes de l’exil un nombre de réfugiés sans précédent. C’est ce même système qui est responsable de la crise économique et de l’austérité qui réduit partout le niveau de vie et l’accès aux produits de première nécessité.
Autre différence majeure avec la Russie de la fin du XIXe siècle : ces « émeutes raciales » sont le produit d’un capitalisme obsolète depuis plus d’un siècle et qui se dirige aujourd’hui vers un effondrement chaotique. Les violences récentes en Grande-Bretagne sont l’expression de ce chaos, d’une perte de contrôle croissante de la part de la classe dirigeante sur la situation sociale.
Les factions les plus « responsables » de la classe dirigeante ne veulent pas de ce désordre dans les rues. L’une des principales raisons pour lesquelles le parti travailliste est arrivé au pouvoir était de « rétablir l’ordre » au niveau politique après le bordel créé par un parti conservateur profondément infecté par le vandalisme politique du populisme. D’où la réaction très ferme du gouvernement, qui a menacé les émeutiers de recourir à « toute la force de la loi » et a prévu de constituer une « armée permanente » de policiers formés pour faire face aux désordres. Aujourd’hui, la police ne reste pas inactive face aux pillages et aux destructions perpétrés par l’extrême droite. Au contraire, elle se présente comme un défenseur résolu des mosquées et des hôtels hébergeant des demandeurs d’asile, et elle arrête en masse les émeutiers d’extrême droite, tandis que les tribunaux les condamnent dans les jours qui suivent leur arrestation.
Le capitalisme utilise sa propre décomposition contre nous
Cela signifie-t-il que le parti travailliste et la police sont désormais de véritables amis de la classe ouvrière ? Pas du tout ! Alors que le capitalisme est train de s’enfoncer dans la crise, la bourgeoisie sait que le plus grand danger auquel elle est confrontée, c’est la classe ouvrière internationale, c’est le risque de la voir prendre conscience qu’elle est une force sociale qui a la capacité non seulement de résister à l’exploitation capitaliste, mais aussi de renverser le système tout entier. C’est pourquoi nos dirigeants sont parfaitement disposés à utiliser la désintégration de leur propre société pour entraver le développement d’une véritable conscience de classe :
– en intensifiant leurs campagnes permanentes autour de la « défense de la démocratie contre le fascisme », qui est déjà un thème central des élections en Europe, en France et aux États-Unis, et qui vise à entraîner les travailleurs dans l’impasse que sont les urnes et dans l’idée qu’ils devraient soutenir une faction de la classe dirigeante contre l’autre.
– En renforçant l’appareil répressif de l’État tout en « démocratisant » l’image de la police. Aujourd’hui, cet appareil peut être dirigé contre la « voyoucratie d’extrême droite », mais demain, il peut être et sera utilisé contre les luttes de la classe ouvrière. N’oublions pas comment la police a été utilisée comme une « armée permanente » contre la lutte des mineurs en 1984-85. C’est la même police avec la même fonction : protéger l’ordre capitaliste.
– En détournant l’attention de la politique d’austérité que le gouvernement travailliste commence déjà à mettre en œuvre. Dès ses premiers jours au pouvoir, le gouvernement travailliste, qui a opportunément découvert dans les compte de l’État un « déficit abyssal » dissimulé, a annoncé des mesures qui laissent présager de futures attaques contre les conditions de vie de la classe ouvrière : refus de supprimer la politique qui limite les allocations familiales à deux enfants, suppression des allocations de chauffage pour les retraités, sauf pour les couches les plus pauvres…
Il ne faut pas oublier que l’extrême droite et les populistes ne sont pas les seuls à s’en prendre aux immigrés. La « One Nation Tory » Theresa May était chargée de créer « une atmosphère hostile aux immigrants illégaux » sous le gouvernement Cameron, tandis que la principale critique des travaillistes à l’égard des gadgets des Tories, comme le programme pour le Rwanda, a été qu’il n’était pas rentable. Aux États-Unis, malgré toute la grandiloquence de Trump contre l'’« invasion étrangère », les administrations démocrates sous Obama et Biden n’ont pas été moins impitoyables en procédant à des déportations massives. Toutes les fractions de la bourgeoisie défendent l’économie et les frontières nationales qui, dans la lutte brutale de tous contre tous sur le marché mondial, sont de plus en plus organisées autour d’une sorte d’État forteresse pour empêcher les importations et la main-d’œuvre « étrangères » d’entrer.
La lutte des classes est notre seule arme
En réponse au déchaînement des émeutes, la classe ouvrière et la population dans son ensemble ont manifesté une indignation et un sentiment de révolte considérables. La volonté de l’extrême droite d’instrumentaliser les meurtres de Southport comme prétexte pour attaquer les minorités ethniques et les migrants a été accueillie avec le dégoût qu’elle méritait par ceux qui ont été le plus directement touchés par les meurtres. Il y a eu un certain nombre de gestes de soutien envers les principales cibles de la violence, comme à Southport même où les résidents locaux se sont rassemblés pour réparer les dommages causés à la mosquée frappée par les émeutiers. Le 7 août, face à la menace de nouvelles attaques contre les centres d’aide aux immigrés dans tous les pays, des milliers de personnes sont descendues dans la rue à Londres, Manchester, Liverpool, Newcastle, Bristol, Brighton et ailleurs pour empêcher le saccage des centres (dans la plupart des cas, les menaces n’ont pas abouti et l’extrême droite ne s’est pas manifestée).
Mais il ne faut pas se faire d’illusions. Ces réactions compréhensibles ont été immédiatement instrumentalisées par la machine de propagande du capitalisme pour présenter l’image d’une « vraie Grande-Bretagne » respectueuse de la loi, tolérante et multiculturelle. Suite aux mobilisations du 7 août, la quasi-totalité de la presse, de gauche comme de droite, s’est engouffrée dans cette propagande. Le plus révélateur est peut-être le titre du 8 août du Daily Mail, un journal de droite qui a joué un rôle central dans la campagne de peur contre les immigrés clandestins. Sa première page présentait une photo de la manifestation de Walthamstow (peut-être la plus importante du pays) et titrait : « Les manifestants contre la haine ont affronté les voyous ».
En dehors des grands médias, l’extrême gauche du capital, les trotskistes en particulier, ont joué un rôle clé en appelant à ces mobilisations et en essayant de créer de nouvelles versions du front populaire. En bref, ils ont fourni une couverture de gauche à la campagne de défense de la démocratie contre le fascisme.
La classe ouvrière ne peut se défendre et résister aux attaques contre n’importe laquelle de ses fractions, qu’elle soit « indigène » ou « immigrée », qu’en se battant sur son propre terrain, celui de la lutte contre la dégradation de ses conditions de vie exigée par le capitalisme en crise, une lutte qui a les mêmes objectifs et les mêmes intérêts dans tous les pays. La classe ouvrière britannique doit se débarrasser de nombreux fardeaux du passé, en particulier le poids hérité de l’apogée impériale de la Grande-Bretagne.
Mais nous ne devons pas oublier que la Grande-Bretagne a été le lieu de naissance du premier parti ouvrier indépendant, les Chartistes, puis de la Première Internationale en collaboration avec les travailleurs français. En 2022, ce sont les travailleurs britanniques qui ont joué un rôle central dans la renaissance des mouvements de classe après des décennies de résignation. Leur slogan était « trop c’est trop », un slogan que l’extrême droite a essayé de voler. Mais en 2022, ce slogan, repris par les travailleurs en France et ailleurs, ne signifiait pas « trop d’étrangers » mais « trop d’austérité », « trop d’inflation », « trop d’attaques ».
En 1905, face aux grèves de masse dans tout l’empire russe, le régime tsariste a répondu par son stratagème habituel : attiser les pogroms pour briser l’unité des travailleurs et dresser les paysans contre eux. À l’époque, les travailleurs avaient créé leurs propres organisations indépendantes, les soviets, et l’une de leurs fonctions était d’organiser la défense armée des quartiers juifs menacés par les émeutiers. Aujourd’hui, les travailleurs ne disposent pas de telles organisations indépendantes. Mais le développement futur de la lutte des classes devra recréer des organes d’auto-organisation de masse qui peuvent non seulement défendre la classe contre toutes les attaques du capital, mais aussi mener une offensive politique visant à renverser l’ensemble du système.
Amos, 9 août 2024
Géographique:
- Grande-Bretagne [47]
Récent et en cours:
- Émeutes racistes [918]
Rubrique:
À bas la supercherie de la démocratie bourgeoise!
- 282 lectures
Au cours des derniers mois, les médias du monde entier (qui sont détenus, contrôlés et dictés par la classe capitaliste) ont été préoccupés par les cirques électoraux qui se sont déroulés en France, en Grande-Bretagne, ainsi que dans le reste du monde comme au Venezuela, en Iran et en Inde, et maintenant de plus en plus aux États-Unis.
Le thème dominant de la propagande sur les mascarades électorales a été la défense de la façade démocratique du régime capitaliste. Une façade conçue pour cacher la réalité d’une crise économique insoluble, le carnage de la guerre impérialiste, la paupérisation de la classe ouvrière, la destruction de l’environnement, la persécution des réfugiés… C’est la feuille de vigne démocratique qui masque la dictature du capital, quel que soit le parti qui accède au pouvoir dans l’État bourgeois, qu’il soit de droite, de gauche ou du centre, « fasciste » ou « antifasciste ».
On demande à la classe ouvrière de faire un faux choix entre l’un ou l’autre gouvernement capitaliste, tel ou tel parti ou dirigeant et, de plus en plus aujourd’hui, d’opter entre ceux qui prétendent respecter les protocoles démocratiques établis de l’État bourgeois et ceux qui, comme la droite populiste, traitent ces procédures avec un mépris assumé, plutôt qu’avec le mépris dissimulé des partis démocratiques libéraux.
Venez discuter et débattre de l’alternative politique que la Gauche communiste propose pour la classe ouvrière dans les réunions publiques du CCI.
Paris : le 5 octobre à 15H00 au CICP (21ter rue Voltaire, 75011, métro « rue des boulets »).
Marseille : le 5 octobre à 15H00, local Mille Bâbords (61 Rue Consolat, métro « Réformés »).
Nantes : le 5 octobre, à 15H00, salle de l’Égalité (6 boulevard Léon Jouhaux, tramway ligne 1 vers F. Mitterrand, station « Égalité »).
Toulouse : le 5 octobre à 14H00, 3 rue Escoussières (quartier Arnaud-Bernard), Accès métro ligne B - station Jeanne d’Arc.
Lyon : le 19 octobre à 15H00, au CCO 28 rue Alfred de Musset . Villeurbanne. Salle des jeunes ouvrières. Métro A arrêt Vaulx - en - Velin la Soie.
Vie du CCI:
- Réunions publiques [219]
Rubrique:
Pour un Appel de la Gauche communiste contre la campagne internationale en faveur de la démocratie bourgeoise
- 296 lectures
Courant communiste international à :
-
Tendance communiste internationaliste
-
PCI (Programma Comunista)
-
PCI (Il Comunista)
-
PCI (Il Partito Comunista)
-
Istituto Onorato Damen
-
Internationalist Voice
et au groupe Perspective communiste internationaliste (Corée)
Chers camarades,
Nous vous joignons une proposition d’appel de la Gauche communiste contre l’énorme campagne internationale de la bourgeoisie en défense de la « démocratie » contre le populisme et l’extrême droite. Tous les groupes de la Gauche communiste, malgré leurs différences, sont issus de la seule tradition politique qui a rejeté les faux choix gouvernementaux que la bourgeoisie utilise pour dissimuler sa dictature permanente et détourner la classe ouvrière de son terrain de lutte. Il est vital que ces groupes produisent aujourd’hui une déclaration commune qui constitue un point de référence pour la défense des intérêts politiques et de la lutte du prolétariat, et qui représente une alternative claire aux mensonges hypocrites de la classe ennemie.
Merci de répondre rapidement à cette lettre et à cette proposition. Notez que les formulations de l’appel proposé peuvent être discutées et modifiées dans le cadre de sa délimitation de classe.
Dans l’attente d’une réponse de votre part.
Salutations communistes
CCI, 30 août 2024
Proposition d’appel
Appel de la gauche communiste contre la campagne internationale de mobilisation en faveur de la démocratie bourgeoise
Pour la lutte implacable de la classe ouvrière contre la dictature de la classe capitaliste !
Contre la supercherie de la démocratie bourgeoise et ses faux choix !
Au cours des derniers mois, les médias du monde entier (qui sont contrôlés et aux ordres de la classe capitaliste) se sont polarisés sur le carnaval électoral qui s’est déroulé en France, puis en Grande-Bretagne, et dans le reste du monde comme au Venezuela, en Iran et en Inde, et maintenant de plus en plus aux États-Unis.
Le thème dominant de la propagande électorale est la défense de la façade démocratique des gouvernements au service de la domination capitaliste. Une façade conçue pour cacher la réalité de la guerre impérialiste, de la paupérisation de la classe ouvrière, de la destruction de l’environnement, de la persécution des réfugiés. C’est la feuille de vigne démocratique qui masque la dictature du capital, quel que soit le parti (de droite, de gauche ou du centre) qui accède au pouvoir politique dans l’État bourgeois.
On demande à la classe ouvrière de faire de faux choix entre un gouvernement capitaliste ou un autre, entre tel ou tel parti ou dirigeant, et, de plus en plus aujourd’hui, d’opter pour ceux qui prétendent respecter les règles démocratiques de l’État bourgeois, contre ceux qui, comme la droite populiste, les traitent avec un mépris ouvert, plutôt que dissimulé comme le font les partis démocratiques.
Cependant, au lieu de choisir qui va l’exploiter et la réprimer pendant plusieurs années, la classe ouvrière doit défendre ses propres intérêts de classe en matière de salaires et de conditions de vie et chercher à conquérir son propre pouvoir politique – des objectifs que le tapage autour de la démocratie est destiné à dévoyer et à faire apparaître comme impossibles.
Quels que soient les résultats des élections, dans ces pays et dans d’autres, la même dictature capitaliste du militarisme et de la pauvreté subsistera et s’aggravera. En Grande-Bretagne, pour prendre un exemple, où le Parti travailliste de centre gauche vient de remplacer un gouvernement Tory influencé par le populisme, le nouveau premier ministre n’a pas perdu de temps pour renforcer l’implication de la bourgeoisie britannique dans la guerre entre la Russie et l’Ukraine et pour maintenir et accentuer les attaques contre la classe ouvrière afin de contribuer à financer ses entreprises impérialistes.
Quelles sont les forces politiques qui défendent réellement les intérêts de la classe ouvrière contre les attaques croissantes de la classe capitaliste ? Pas les héritiers des partis sociaux-démocrates qui ont vendu leur âme à la bourgeoisie pendant la Première Guerre mondiale et qui, avec les syndicats, ont mobilisé la classe ouvrière pour le massacre de plusieurs millions de personnes sous l’uniforme et dans les tranchées. Ni les derniers apologistes du régime « communiste » stalinien qui a sacrifié des dizaines de millions de travailleurs pour les intérêts impérialistes de la nation russe pendant la Seconde Guerre mondiale. Ni le trotskisme ou le courant anarchiste officiel qui, malgré quelques exceptions, ont apporté un soutien critique à l’un ou l’autre camp dans ce carnage impérialiste. Aujourd’hui, les descendants de ces dernières forces politiques se rangent, de manière « critique » derrière la démocratie bourgeoise libérale et de gauche contre la droite populiste pour contribuer à démobiliser la classe ouvrière.
Seule la Gauche communiste, bien que peu nombreuse, est restée fidèle à la lutte indépendante de la classe ouvrière au cours des cent dernières années. Lors de la vague révolutionnaire ouvrière de 1917-23, le courant politique dirigé par Amadeo Bordiga, qui dominait alors le Parti communiste italien, a rejeté le faux choix entre les partis fasciste et antifasciste qui avaient conjointement œuvré pour écraser violemment la poussée révolutionnaire de la classe ouvrière. Dans son texte « Le principe démocratique » de 1922, Bordiga a dénoncé la nature du mythe démocratique au service de l’exploitation capitaliste et du meurtre.
Dans les années 1930, la Gauche communiste a dénoncé les fractions de gauche et de droite de la bourgeoisie, fascistes ou antifascistes, qui préparaient le bain de sang impérialiste à venir. Lorsque la Seconde Guerre mondiale a éclaté, seul ce courant a pu maintenir une position internationaliste, appelant à la transformation de la guerre impérialiste en guerre civile par la classe ouvrière contre l’ensemble de la classe capitaliste dans chaque nation. La gauche communiste a refusé le choix macabre entre le carnage démocratique ou fasciste, entre les atrocités d’Auschwitz ou d’Hiroshima.
C’est pourquoi, aujourd’hui, face aux campagnes renouvelées supportant ces faux choix, tous en faveur des régimes capitalistes, destiné à aligner la classe ouvrière derrière la démocratie libérale, ou le populisme de droite, le fascisme ou l’antifascisme, les différentes expressions de la Gauche communiste, quelles que soient leurs différences politiques, ont décidé de lancer un appel commun à la classe ouvrière :
À BAS LA FRAUDE DE LA DÉMOCRATIE BOURGEOISE QUI DISSIMULE LA DICTATURE DU CAPITAL ET SON MILITARISME IMPÉRIALISTE !
CONTRE L’AUSTÉRITÉ DE LA DÉMOCRATIE CAPITALISTE ET L’INTÉRÊT NATIONAL, VIVE LA LUTTE DU PROLÉTARIAT INTERNATIONALE POUR LA DÉFENSE DE SES INTÉRÊTS DE CLASSE !
POUR LA RÉVOLUTION DE LA CLASSE OUVRIÈRE AFIN DE DÉPOSSÉDER LA BOURGEOISIE DU POUVOIR POLITIQUE, D’EXPROPRIER LA CLASSE CAPITALISTE ET DE METTRE FIN AUX CONFLITS FRATICIDES IMPOSÉS AU PROLÉTARIAT PAR LES ÉTATS-NATIONS CONCURRENTS !
Vie du CCI:
Courants politiques:
- Gauche Communiste [163]
Rubrique:
Disparition de Michel Olivier: L’indécente occasion d’une nouvelle campagne anti-CCI
- 507 lectures
Nous avons appris le décès, le jeudi 3 juillet, de Michel Olivier. Militant à partir de 1969 du groupe Révolution Internationale (qui deviendra en janvier 1975 la section du CCI en France), il est resté membre de notre organisation jusqu’à son exclusion en 2003. Durant trois décennies il a été un camarade estimé et apprécié, un militant réputé pour son dévouement et sa loyauté. Ses connaissances sur l’histoire du mouvement ouvrier international comme sur l’histoire de la France et de nombreux autres pays permettaient de nourrir les débats et la réflexion de tous. Plus marquant encore était son engagement entier à défendre l’organisation, à lutter contre l’individualisme, à se dresser contre l’esprit de cercle et le clanisme.
Ce n’est qu’au début des années 2000 que sa trajectoire prend une tout autre direction. Olivier va se fourvoyer, s’engager dans une impasse de laquelle il ne sera plus jamais capable de sortir. En compagnie d’autres militants, et en partie entraîné par eux, il va se lancer dans une campagne contre une militante, Louise, considérée comme « indigne » et même comme un « flic ». Une commission spéciale, après une investigation très sérieuse, a mis en évidence le caractère totalement infondé et absurde de ces accusations. Refusant d’accepter cette conclusion, les procureurs de cette camarade, lesquels, en réalité, n’avaient pas supporté des critiques politiques qu’elle avait portées contre les positions de certains d’entre eux, se sont engagés dans une démarche destructrice contre le CCI. Cette démarche était portée par l’orgueil blessé, la haine et la « solidarité de fer » envers les copains, et consistant d’abord en des réunions secrètes visant à « reprendre le contrôle de l’organisation » (1) puis en des violations répétées des statuts et en des provocations systématiques destinées à contraindre le CCI à prendre des sanctions aussitôt dénoncées comme un « étouffement des débats ».
Parmi les exploits de ce groupe de militants, qui a pris le nom de « Fraction Interne du CCI » (FICCI), il faut signaler encore des calomnies odieuses contre notre organisation transmises aux groupes de le Gauche communiste puis rendues publiques sans oublier le vol du matériel de notre organisation (moyens financiers, adresses des abonnés, archives). (2) Il faut noter que ces militants, et notamment Olivier, qui ont en permanence accusé le CCI de les bâillonner, « d’étouffer les débats », ont refusé de participer aux réunions (conférence extraordinaire, congrès) auxquelles ils étaient conviés pour présenter et défendre leurs positions face à tous les membres de notre organisation.
Mais si Olivier et ses amis ont finalement été exclus du CCI, ce n’est pas à cause de tous ces manquements organisationnels mais bien parce qu’ils se sont comportés comme des mouchards en publiant sur leur site web des informations favorisant le travail de la police. (3) En prenant cette décision, le CCI n’a fait que mettre en pratique ce principe fondamental, vital, du mouvement ouvrier : pas de mouchard dans les rangs de la classe ouvrière, pas de mouchard au sein de ses organisations révolutionnaires ! (4)
Comment expliquer une trajectoire politique si tragique et déshonorante de la part d’Olivier ? Comment un militant dévoué et sincère durant des décennies a pu ainsi dériver pour finir par se vautrer dans les comportements les plus crasses et indignes ? Il est arrivé à Olivier ce qui est arrivé à beaucoup d’autres révolutionnaires avant lui : par affinitarisme, par loyauté envers ses amis, il a choisi de partir à la dérive avec eux plutôt que de rester fidèle aux principes prolétariens. L’exemple le plus célèbre d’une telle trajectoire est celui de Martov. Militant estimé de tout le POSDR (l’organisation révolutionnaire russe du début du siècle dernier), il n’a pas supporté de voir ses amis Axelrod, Potressov et Zassoulitch critiqués lors du congrès de 1903 pour leur manque total d’implication dans la vie du journal du Parti, l’Iskra (ce qui était pourtant leur mandat) et moins encore la proposition de Lénine de modifier la composition du comité de réaction en conséquence (c’est-à-dire, sans eux). « Solidaire » de ses amis « victimes », Martov fit alors le choix de défendre les intérêts de son cercle plutôt que ceux du Parti. Cette bifurcation va l’emmener très loin dans la calomnie contre Lénine et les Bolcheviks. Cela dit, jamais Martov ne commettra comme la FICCI des actes de mouchardage !
En 2001, lors de l’une de nos dernières discussions avec lui, quand il était encore militant, Olivier avait été convaincu par nos arguments lui montrant son erreur (au sujet des calomnies qu’il participait à répandre sur notre camarade Louise). Mais au moment de partir, il avait conclu par : « vous avez raison, mais quand je vais retourner avec les autres, je ne pourrais pas résister, je les suivrais, je le sais ». La messe était dite…
Ces dernières années, il avait tenu parfois à certains éléments gravitant autour de lui comme du CCI un discours de demi-aveu, reconnaissant ses « erreurs » qu’il jugeait « anciennes ». Mais il a finalement été incapable de maintenir ces propos en public, peut-être par orgueil, peut-être encore et toujours par fidélité avec son principal comparse qui, lui, continue aujourd’hui encore cette même politique systématique de mouchardage par la voix du GIGC (Groupe International de la Gauche Communiste, nouveau nom de la FICCI) : Juan.
Mais, plus que tout, ce qui explique à quel point Olivier a pu aller loin dans la dérive, et ensuite être incapable d’en revenir, c’est le manque de fermeté du milieu politique prolétarien. Loin de dénoncer tous ces agissements, les groupes de la Gauche communistes les ont ignorés. Pire, certains ont même adopté envers eux une attitude des plus complaisantes. Il n’y avait donc pas de digue.
Les mouchards, les parasites et leur « hommage » à Olivier
Évidemment, sur le site du GIGC (l’ex-FICCI), Juan a utilisé la mort d’Oliver pour poursuivre son œuvre, sa tentative de destruction du CCI dans laquelle il l’aura finalement entraîné jusqu’au bout. Son texte répète une fois encore le mensonge qu’Olivier et toute la bande furent les victimes des « manœuvres de coulisse et des manipulations psychologiques [...] par ceux qui, dans l’ombre, voulaient éliminer la “vieille garde” du CCI ». Et pour bien jouer sur la corde sensible, afin d’éviter toute réflexion réelle sur les faits, l’article de Juan finit par une vibrante tirade : « Nous fûmes tous frappés et affectés par nos exclusions et surtout les conditions scandaleuses de celles-ci tout comme par nos dénonciations publiques par le CCI. Michel sans doute plus que tout autre ». Ici, sous la plume volontairement sentimentaliste de Juan, ce qui devient scandaleux n’est pas le mouchardage mais sa dénonciation ! (5)
Comme il fallait s’y attendre, ce texte a été relayé par d’autres groupes et éléments dont une des principales vocations est de couvrir de boue le CCI. C’est ainsi qu’on retrouve le texte de Juan sur le blog Pantopolis géré par le « docteur » Philippe Bourrinet dont nous avons déjà souligné les mensonges et l’imposture animés par sa haine obsessionnelle envers le CCI. (6)
Le coup de poignard de la TCI
Beaucoup plus étonnant, et beaucoup plus grave, est de constater qu’un groupe authentique de la Gauche communiste, de notre courant historique, ait pu lui aussi participer à cette campagne de calomnie.
La TCI (Tendance Communiste Internationaliste) a en effet publié dans toutes ses langues un article en « Mémoire de notre camarade Olivier » qui ose affirmer sans rougir : « À vingt ans, il s’était rapproché des positions de la Gauche communiste internationale, née dans les années 1920, et participé à la fondation du Courant communiste international (CCI). Grâce à son talent et son dévouement, il a joué un rôle actif et dirigeant jusqu’à ce que, au début des années 2000, lui et d’autres camarades soient mis à la porte ou forcés de partir, en subissant des accusations infamantes autant qu’infondées. En réalité, comme toujours dans ces cas-là, les calomnies contre Olivier et d’autres camarades visaient à discréditer ces critiques politiquement gênants, qui ne partageaient pas et s’opposaient à la nouvelle orientation prise par l’organisation qu’ils avaient contribué à créer. D’autres camarades auraient été si profondément démoralisés et déçus de ces attaques qu’ils en auraient abandonné le militantisme révolutionnaire. Mais Olivier, parmi quelques rares autres, a conservé son énergie. Après avoir participé pendant une courte période à l’activité de la Fraction Interne du CCI (FICCI), il s’est engagé avec la Tendance Communiste Internationaliste ». Une note de bas de page enfonce le clou : « Pour un historique plus détaillé et d’autres aspects de la vie d’Olivier, nous renvoyons les lecteurs à l’article signé par le camarade Juan pour le GIGC, qui a en commun avec lui une partie de son parcours politique ainsi que des rapports d’amitié ».
Ici, un court rappel s’impose. Dès 2002, face aux agissements de Juan et d’Olivier, et de toute la bande, nous n’avons cessé de demander au BIPR (l’ancêtre de la TCI) d’étudier cette affaire, de prendre position, en lui fournissant toutes les preuves des actes réels de cette FICCI. Pendant des années, le BIPR (puis la TCI) a refusé systématiquement notre demande, argumentant : « ce sont vos affaires, nous ne prendrons pas position ». Puis, les années passant, et devant l’amoncellement de preuves flagrantes, la TCI a changé son argument pour justifier de ne rien voir, de ne rien entendre, de ne rien dire : « C’est une vieille histoire ».
Quand la TCI a collaboré avec Juan et le GIGC pour former un « comité » NWBCW (No War But the Class War) sur Paris et que nous avons dénoncé publiquement la présence de ces mouchards, la TCI a répété « ce sont de vieilles histoires ».
Quand la TCI a intégré Olivier comme militant et que, lors de l’une de ses réunions publiques, nous lui avons publiquement demandé des comptes sur la présence de ce mouchard dans ses rangs, la TCI a répété « ce sont de vieilles histoires ».
Et voilà qu’au pire des moments, lorsque la tristesse et l’émotion d’un décès surviennent, la TCI (toujours sourde et aveugle aux preuves) retrouve soudain l’usage de la parole pour se joindre au chœur des calomnies du GIGC et de Juan !
La TCI a la mémoire courte. Son prédécesseur, le BIPR avait adopté un comportement similaire en 2004, lorsqu’un individu vivant en Argentine, le Citoyen B, avait créé un site web pour monter une fable de toutes pièces dans le seul but de salir la réputation du CCI. Le BIPR avait alors fait de la publicité à cet individu louche et à tous ses mensonges grossiers, n’hésitant pas à republier en plusieurs langues les accusations les plus folles et saugrenues de ce Monsieur. Quand nous avions fait la preuve irréfutable de la supercherie, le BIPR avait discrètement retiré de son site toute trace de ses méfaits, afin de ne pas être ridicule trop longtemps. (7) Mais ses militants n’ont malheureusement tiré aucune leçon de cette histoire honteuse. Pire encore, aux calomnies du GIGC, la TCI en rajoute une couche. Quand la TCI comprendra-t-elle que le copinage avec des éléments comme Juan, dont la raison de vivre est de vomir sa haine contre le CCI, est une insulte aux principes de la Gauche communiste, que la calomnie et le mensonge ne peuvent, en aucune façon, servir la cause de la révolution communiste ? (8)
L’extrême gauche du capital se joint à la campagne
Un point devrait particulièrement faire réfléchir la TCI. Son article et celui du GIGC ont tous deux été republiés par l’extrême-gauche du capital, par exemple en France sur le site Matière et révolution du groupe trotskiste La Voix des Travailleurs.
Pourquoi des organisations gauchistes se font-elles ainsi le relais de l’hommage à Olivier et les calomnies contre le CCI par le GIGC et la TCI ? Parce que les défenseurs de la bourgeoisie sont toujours intéressés à calomnier les organisations révolutionnaires, à colporter les mensonges qui les salissent. Tout dénigrement d’un groupe de la Gauche communiste est pour eux une aubaine.
Il en avait été de même lors du combat de la Première Internationale (l’AIT) contre les manœuvres de l’Alliance de Bakounine en 1872. Toutes les calomnies et insinuations diffusées par les partisans de l’Alliance avaient été immédiatement reprises dans les organes de presse bourgeois :
- « Remarquons en passant que le Times, ce Léviathan de la presse capitaliste, le Progrès (de Lyon), journal de la bourgeoisie libérale, et le Journal de Genève, journal ultra-révolutionnaire, accablèrent la Conférence des mêmes reproches et se servaient presque des mêmes termes que les citoyens Malon et Lefrançais. » (Les prétendues scissions dans l’Internationale, Marx et Engels, 1872).
- « Toute la presse libérale et celle de la police se trouva ouvertement à ses côtés [de l’Alliance] ; dans sa diffamation personnelle du Conseil général, elle fut soutenue par les soi-disant réformateurs de tous les pays. » (Appendice au Rapport publié par ordre du Congrès international de La Haye, 1872).
La presse et les politiciens bourgeois déclarèrent que le combat contre le bakouninisme n’était pas une lutte pour des principes mais une lutte sordide pour le pouvoir au sein de l’Internationale. Ainsi, Marx était censé avoir éliminé son rival Bakounine au travers d’une campagne de mensonges. Exactement les mêmes mots que ceux employés par la TCI ! « Comme toujours dans ces cas-là, les calomnies contre Olivier et d’autres camarades visaient à discréditer ces critiques politiquement gênants, qui ne partageaient pas et s’opposaient à la nouvelle orientation prise par l’organisation ». Non, camarades ! Le combat qu’a mené, mène et mènera le CCI est celui de la défense des principes du mouvement ouvrier contre les comportements indignes : contre le vol, contre la calomnie, contre le mouchardage. Comme le firent Marx, Engels et l’AIT avant nous. Comme le firent Lénine et les Bolcheviks. Rosa Luxemburg et les Spartakistes. Tous nos prédécesseurs !
Que les mouchards poursuivent leur œuvre, que les parasites les rejoignent, que la gauche de la bourgeoisie en profite… tout cela est dans l’ordre des choses. Ils profitent ici tous de la triste trajectoire d’Olivier, militant sincère devenu acteur d’une politique désastreuse et haineuse. Mais qu’un groupe comme la TCI, représentant de la Gauche communiste, devant normalement porter des principes historiques du mouvement ouvrier, puisse se vautrer à ce point dans les égouts est une infamie, un coup de poignard dans le dos du CCI et de celui de toute la Gauche communiste.
CCI, 21 septembre 2024
1 Les termes entre guillemets figurent dans les procès-verbaux de ces réunions tombés « par accident » entre les mains du CCI.
2 À l’occasion du décès d’Olivier, un long article a été publié par Gieller sur son blog « Le prolétariat universel ». Étant proches, il s’adresse à lui dans une sorte de lettre-hommage qu’il lui tend dans la mort (en le prénommant affectueusement Gaston pour sa prétendue nature gaffeuse). On peut notamment y lire : « L’argent que possède le CCI te tourmentait avec quelques autres qui se posaient la question de comment le récupérer. [...] Gaston tu fis la proposition au PDG de Smolny, Éric, de leur “demander de l’argent [au CCI] pour publier Bilan et les laisser faire une postface, ce qu’ils refuseront. Ainsi Éric aura le beau rôle et on pourra rire pour voir ce que fera le CCI”.
Avec ma réplique j’avais été très méchant avec toi : “pire tu imagines une ‘négo’ dans l’espoir de vraiment tuer la secte, ‘négo’ glauque : co-publier Bilan avec l’argent de celle-ci dans l’espoir de remettre en selle le magouilleur individualiste Éric, grand seigneur vexé d’avoir été chatouillé en politique ! [...]”.
Et pourtant on t’avait servi de gardes du corps ! Lorsque l’orga lui avait intimé de rendre les archives, tu avais acquiescé puis tu avais fait appel à notre compagnie de vigiles amateurs. On était cinq costauds au premier étage (dont je tais les noms) pour te soutenir au cas où cela tournerait mal. Depuis la fenêtre on vit arriver les cinq membres de l’organe central déjà tous blanchis sous le harnais… organisationnel. Par après, Gaston remonta les marches en riant : “je les ai bien baisés, je ne leur ai remis que de la merde, j’ai gardé les archives importantes” ».
Une phrase de l’article de Gieller résume le sens réel de toute l’activité politique d’Olivier depuis 2002 (ainsi que de celle de ces comparses, d’ailleurs), quand il cite ce qu’Olivier lui avait explicitement formulé : « il faut maintenant que le CCI disparaisse et vite ». Et nous pourrions ajouter : « par tous les moyens ».
3 Nous avons démontré dans notre presse la nature policière des agissements des membres de la FICCI et explicité la façon dont le CCI a réagi à ces agissements. Voir notamment les articles : « Défense de l’organisation : les méthodes policières de la “FICCI” [919], « XV [920]e Congrès du CCI : Renforcer l’organisation face aux enjeux de la période » et « Les réunions publiques du CCI interdites aux mouchards [656] ». Nous encourageons nos lecteurs, et particulièrement ceux qui pourraient être sceptiques face à nos affirmations, à lire ces articles qui établissent, avec de nombreuses preuves irréfutables, la véracité de nos accusations contre la FICCI et aussi que nous avons laissé à ses membres toute possibilité de se défendre avant leur exclusion.
4 Voir à ce sujet notre article : « Le combat des organisations révolutionnaires contre la provocation et la calomnie [921] »
5 Rappelons au passage que ce Juan « affecté » n’a pas hésité à frapper à coups de poing au visage l’un de nos camarades, ou que lui et Olivier ont soutenu Pédoncule, l’un de leurs comparses d’alors, quand celui-ci a menacé un militant du CCI de l’égorger au couteau s’il le croisait seul dans une rue.
6 Voir notre article : « Conférence-débat à Marseille sur la Gauche communiste : le Docteur Bourrinet, un faussaire qui se prétend historien [520] »
7 Voir à ce sujet « Lettre ouverte du CCI aux militants du BIPR (Décembre 2004) [922]"
8 Comble de la farce, lors de la dernière réunion publique de la TCI à Londres, lorsque nous avons demandé en fin de discussion comment ils avaient pu publier de tels mensonges contre nous, la TCI nous a répondu qu’il était indigne d’utiliser un décès pour parler d’une telle chose ! Nous avons dû leur rappeler sobrement que… c’était eux qui faisaient cette chose.
Courants politiques:
- TCI / BIPR [247]
- FICCI - GIGC/IGCL [524]
Rubrique:
ICConline - octobre 2024
- 20 lectures
Les implications mondiales des élections américaines (16 novembre 2024)
- 202 lectures
La classe ouvrière n'a pas à choisir entre Trump et Harris, entre les Républicains et les Démocrates. Quel que soit le vainqueur, la classe ouvrière sera soumise aux attaques brutales contre ses conditions de vie exigées par la crise économique et le développement de l'économie de guerre. Quel que soit le vainqueur, les travailleurs seront confrontés à la nécessité de se défendre en tant que classe contre ces attaques.
Mais cela ne signifie pas que nous pouvons ignorer la campagne électorale et ses conséquences. Elles révèlent que les divisions au sein de la bourgeoisie américaine, la classe dirigeante de ce qui reste le pays le plus puissant du monde, sont de plus en plus aiguës et violentes. Les États-Unis sont devenus l'épicentre de la décomposition du système capitaliste mondial et, quel que soit le président qui sortira des urnes le 5 novembre, l'élection servira à exacerber encore plus ces divisions, avec de graves conséquences à la fois aux États-Unis et sur la scène mondiale.
Les révolutionnaires ont donc pour tâche non seulement de dénoncer la fraude de la démocratie bourgeoise, mais aussi d'analyser les implications mondiales de l'élection américaine, de les placer dans un cadre cohérent qui nous permettra de comprendre comment la fragmentation de la classe dirigeante américaine est un facteur actif de la seule perspective que la bourgeoisie peut offrir à l'humanité : une plongée accélérée dans la destruction et le chaos.
Nous invitons tous ceux qui veulent lutter pour un avenir différent à participer à cette réunion, le 16 novembre 2024 à 15h.
La langue principale de la réunion sera l'anglais, mais nous aurons la possibilité de traduire sur place dans d'autres langues. Si vous souhaitez participer, écrivez-nous à [email protected] [911], en indiquant si vous pouvez suivre et contribuer en anglais ou en précisant dans quelle autre langue vous auriez besoin de le faire.
Vie du CCI:
- Réunions publiques [219]
Rubrique:
ICConline - Novembre 2024
- 71 lectures
Grèves aux États-Unis, au Canada, en Italie… Depuis trois ans, la classe ouvrière se bat contre l’austérité !
- 138 lectures
Partout, la bourgeoisie fait pleuvoir les licenciements, multiplie les coupes budgétaires drastiques, comprime les salaires sous les coups de l’inflation, précarise et exploite toujours plus. Et les attaques ne sont pas près de s’arrêter ! La crise du capitalisme est insoluble et considérablement aggravée par les guerres et le chaos qui se répandent partout, à l’image des conflits très meurtriers en Ukraine ou au Proche-Orient. Pour financer les massacres, la bourgeoisie ne cesse d’accroître ses folles dépenses militaires et d’exiger toujours plus de sacrifices aux exploités. La classe ouvrière est encore incapable de se dresser directement contre ces conflits, mais elle n’est pas prête à accepter les attaques sans réagir.
La classe ouvrière lutte massivement contre l’austérité
À la fin du mois d’août, alors que la hausse des prix continue de peser lourdement, les travailleurs du fret ferroviaire au Canada ont tenté d’entrer en lutte. Qualifié d’« inédit » par son ampleur, ce mouvement avorté a rassemblé près de 10 000 ouvriers dans un pays où le droit de grève est encadré par un dispositif réglementaire extrêmement draconien. Le gouvernement a aussitôt interdit toute grève au nom de la sauvegarde de l’économie nationale, ordonnant de nouvelles négociations entre les compagnies ferroviaires et le principal syndicat du secteur, les Teamsters Canada. Il n’en fallait pas plus à ce dernier pour étouffer le mouvement dans l’œuf en promettant que la décision gouvernementale serait contestée… devant les tribunaux ! En clair, le syndicat a habilement réduit les ouvriers à l’impuissance en renvoyant la lutte aux calendes grecques. Comme l’a si bien expliqué le directeur des relations publiques du syndicat : « Nous, on veut négocier. Nos membres veulent travailler, ils aiment ça, opérer des trains au Canada ». La bourgeoisie ne pouvait trouver meilleur chien de garde…
Un mois plus tard, près de 50 000 dockers de 36 ports des États-Unis, ainsi que ceux du port de Montréal, se lançaient à leur tour dans une grève de plusieurs jours. Un mouvement d’une telle ampleur est lui aussi inédit depuis 1977. En pleine campagne électorale, l’administration Biden s’est empressée de jouer les médiateurs en affichant un « soutien » hypocrite aux dockers. Avec la complicité du gouvernement, les syndicats ont pu stopper le mouvement en faisant prévaloir un « accord de principe sur les salaires » qui sera négocié… au mois de janvier 2025.
Après des arrêts de travail partiels depuis avril, 15 000 travailleurs de 25 grands hôtels américains se sont mis en grève le 1er septembre (fête du travail aux États-Unis), réclamant de meilleurs salaires, une réduction de la charge de travail et l’annulation des suppressions de postes. Les 700 travailleurs du Hilton San Diego ont même mené une grève de 38 jours, la plus longue grève hôtelière de l’histoire de San Diego.
Les travailleurs de l’automobile continuent aussi de se battre, particulièrement dans les usines du groupe Stellantis. En 2023, les ouvriers de Ford, de General Motors et de Stellantis avaient tenté d’unir leurs luttes au niveau national et même au-delà, avec des ouvriers au Canada. Bien sûr, les syndicats avaient circonscrit la lutte au seul secteur de l’automobile. Mais ce phénomène exprimait la volonté des travailleurs de ne pas rester seul dans leur coin, de ne pas s’enfermer dans l’usine, et s’était traduit par un immense élan de sympathie de la classe ouvrière. Depuis, les syndicats ont réussi un minutieux travail de division des luttes à l’échelle de l’usine, enfermant les ouvriers dans la défense de telle ou telle ligne de production menacée de fermeture.
En Italie aussi, fin octobre, 20 000 salariés du groupe automobile Stellantis ont manifesté à Rome contre la fermeture de plusieurs usines Fiat. Le mouvement a également été qualifié de « grève historique comme il n’y en a pas eu depuis plus de quarante ans ». Mais, là encore, les syndicats ont fait leur possible pour réduire les ouvriers à l’impuissance. Alors que Stellantis licenciait au même moment 2 400 employés dans ses usines de Detroit (États-Unis), les syndicats italiens appelaient à une unique journée de grève avec des mots d’ordre nationalistes autour de la marque Fiat, cet « emblème de l’Italie ».
Mais c’est surtout le mouvement dans les usines de Boeing qui a le plus marqué les esprits. Depuis plus d’un mois, 33 000 ouvriers réclament des augmentations de salaire et le rétablissement de leur régime de retraite. Comme au Canada, les ouvriers en lutte sont accusés d’hypothéquer, par égoïsme, l’avenir de ce « fleuron » de l’industrie américaine et de menacer les emplois des sous-traitants. L’avionneur a même cyniquement menacé de licencier 17 000 employés pour effacer « l’ardoise à plusieurs milliards de dollars » imputable aux grévistes. Là encore, les syndicats cherchent à cloisonner la lutte à la seule entreprise Boeing, enfermant les ouvriers dans une grève dure mais très isolée.
Alors que le prolétariat aux États-Unis et au Canada se montre particulièrement combatif depuis deux ans face à la dégradation considérable de ses conditions de vie, les syndicats ont dû « radicaliser » leur discours et se présentent comme les plus déterminés dans la lutte. Mais derrière leur prétendue volonté d’arracher des augmentations de salaire, ils cherchent surtout à renforcer leur rôle d’encadrement pour mieux saboter toute mobilisation. Partout où des luttes éclatent, les syndicats s’emploient à isoler et diviser la classe, à priver les ouvriers de leur principale force : leur unité. Ils enferment les travailleurs dans leur secteur d’activité, dans leur entreprise, dans leur service. Partout, ils cherchent à couper les grévistes de la solidarité active de leurs frères de classe dans la lutte. Cette division corporatiste est un véritable poison, car lorsque nous nous battons chacun dans notre coin, nous perdons tous dans notre coin !
Malgré la décomposition du capitalisme…
Ces luttes se déroulent dans un contexte extrêmement difficile pour la classe ouvrière. Le capitalisme se décompose sur pied, toutes les structures sociales pourrissent, la violence et l’irrationalité explosent à des niveaux inégalés, fracturant toujours plus la société. Tous les pays, à commencer par les plus fragiles, sont touchés par ce processus. Mais les États-Unis sont aujourd’hui, parmi les pays développés, celui qui est le plus impacté par la putréfaction de la société capitaliste. ([1) Le pays est ravagé, des ghettos les plus miséreux au plus haut sommet de l’État, par le populisme, par la violence, par le trafic de drogue, par les théories du complot les plus délirantes… Le succès des théories de l’extrême droite libertarienne, prônant la débrouille individuelle, la haine de toute démarche collective, le malthusianisme le plus bête, est un symptôme affligeant de ce processus.
Dans ce contexte, le développement de la lutte de classe ne peut en aucun cas prendre la forme d’une montée en puissance homogène et linéaire de la conscience de classe et de la nécessité du communisme. Au contraire, avec l’accélération des phénomènes de la décomposition, la classe ouvrière va sans arrêt se trouver confrontée à des obstacles, à des événements catastrophiques, à la pourriture idéologique de la bourgeoisie. La forme que va prendre la lutte et le développement de la conscience de classe sera nécessairement heurtée, difficile, fluctuante. L’irruption du Covid en 2020, la guerre en Ukraine deux ans plus tard ou les massacres à Gaza ont suffisamment illustré cette réalité. La bourgeoisie tirera profit, comme elle l’a toujours fait, de chaque manifestation de la décomposition pour les retourner aussitôt contre le prolétariat.
C’est d’ailleurs précisément ce qu’elle fait avec la guerre au Proche-Orient, en tentant de détourner le prolétariat de son terrain de classe, en poussant les ouvriers à défendre un camp impérialiste contre un autre. Avec une multitude de manifestations pro-palestiniennes et la création de réseaux de « solidarité », elle a cyniquement instrumentalisé le dégoût que provoquent les massacres pour mobiliser des milliers d’ouvriers sur le terrain du nationalisme.(2) C’est la réponse de la bourgeoisie à la maturation qui commence à s’opérer dans les entrailles de la classe ouvrière. Durant les grèves de 2023 dans le secteur automobile, le sentiment d’être une classe internationale a commencé à poindre. On a pu observer la même dynamique lors du mouvement contre la réforme des retraites en France, lorsque les travailleurs du Mobilier national se sont mobilisés en solidarité avec les grévistes en Grande-Bretagne. Bien que ces expressions de solidarité soient restées à l’état embryonnaire, la bourgeoisie a parfaitement conscience du danger que représente une telle dynamique. Toute la bourgeoisie s’est mobilisée pour enfoncer de la bouillie nationaliste dans le crâne des ouvriers car ces réflexes de solidarité contiennent en germe la défense de l’internationalisme prolétarien.
Avec l’instabilité croissante de son appareil politique dont le populisme est un des symptômes les plus spectaculaires, la bourgeoisie tente encore d’enfoncer un coin dans la maturation de la conscience de classe. Les grèves aux États-Unis se déroulent dans un contexte électoral assourdissant. Les Démocrates ne cessent d’appeler à barrer la route au populisme dans les urnes, à revitaliser les institutions de « la démocratie américaine » face au danger du « fascisme ». Les ouvriers en grève sont sans arrêt accusés d’affaiblir le camp Démocrate et de faire le jeu du trumpisme. En Italie, l’arrivée de l’extrême droite au pouvoir a également suscité toute une campagne en faveur de la démocratie bourgeoise.
Avec les promesses mensongères de la gauche américaine ou européenne sur la « taxation les riches » ou la « réforme en profondeur des droits des travailleurs », comme avec les discours « progressistes » sur les « droits » des minorités, la bourgeoisie s’emploie partout à semer des illusions sur la capacité de l’État bourgeois à organiser une société plus « juste ». Non, la bourgeoisie ne rétablira pas une économie florissante ! Non, la bourgeoisie ne protégera pas les Noirs ou les Arabes de ses flics et de ses patrons racistes ! À travers ces boniments, il ne s’agit ni plus ni moins que de pourrir la réflexion des ouvriers et de les détourner des luttes, la seule voie capable d’offrir une véritablement alternative à la crise historique du capitalisme et à toutes les horreurs qu’elle charrie.
… l’avenir appartient à la lutte de classe !
Malgré tous ces obstacles, la classe lutte massivement. Du point de vue du matérialiste vulgaire, les grèves actuelles ne sont que des luttes corporatistes, dépolitisées, dirigées et conduites dans des impasses par les syndicats. Mais en prenant un recul historique et international, malgré le carcan corporatiste imposé par les syndicats, malgré toutes les faiblesses et illusions bien réelles qui pèsent sur les travailleurs, ces mouvements s’inscrivent dans la continuité de la rupture que nous observons depuis bientôt trois ans. Depuis « l’été de la colère » qui a secoué le Royaume-Uni en 2022 pendant plusieurs mois, la classe ouvrière n’a cessé inlassablement de résister aux attaques de la bourgeoisie. En France, en Allemagne, en Italie, en Espagne, en Finlande, aux Pays-Bas, en Grèce, aux États-Unis, au Canada, en Corée… Le monde n’avait pas connu une telle vague de luttes massives et simultanées dans autant de pays ni sur une si longue période depuis trois décennies.
Alors que la classe a perdu, depuis trente ans, la conscience d’elle-même, de son identité, elle recommence petit à petit à se concevoir comme une force sociale, à retrouver quelques réflexes de solidarité. Mieux, comme le CCI a pu le documenter, les ouvriers recommencent à se réapproprier les leçons des luttes passées, tentent de renouer avec l’expérience de leur classe : comme avec la lutte contre le CPE ou Mai 68 en France, avec le Cordobazo en Argentine, ou la lutte des mineurs en Grande-Bretagne en 1984.
Depuis les années 1980, les luttes ouvrières avaient pratiquement disparu du paysage nord-américain. Avec l’effondrement de l’URSS, les prolétaires aux États-Unis ont subi un matraquage idéologique aussi intense que pendant la guerre froide sur la « victoire du capitalisme contre le (prétendu) communisme ». Les luttes ouvrières ont été jetées sans ménagement dans les poubelles de l’histoire. Dans un pays gangrené par la violence et le populisme, où même Kamala Harris est suspectée d’être « communiste » et de vouloir « faire comme Lénine », le seul fait d’oser à nouveau se mettre massivement en grève, de poser la question de la solidarité et de s’appeler « travailleurs », témoigne d’un changement en profondeur dans les entrailles de la classe ouvrière du monde entier.
La solidarité qui s’est exprimée dans tous les mouvements sociaux depuis 2022 montre que la classe ouvrière, quand elle lutte, parvient non seulement à résister à la putréfaction sociale, mais aussi qu’elle amorce l’ébauche d’un antidote, la promesse d’un autre monde : la fraternité prolétarienne. Sa lutte est l’antithèse de la guerre et du tous contre tous dans laquelle nous enfonce la décomposition.
EG, 28 octobre 2024
[1] Ils représentent aussi un foyer majeur d’instabilité dans le monde. Lire à ce propos : « Résolution sur la situation internationale (décembre 2023) [923] », Revue Internationale n° 171 (2023).
[2] Cf.« Manifestations pro-palestiniennes dans le monde : Choisir un camp contre un autre, c’est toujours choisir la barbarie capitaliste [924] », publié sur le site web du CCI (2024).
Personnages:
- Biden [395]
- Kamala Harris [925]
Récent et en cours:
- Grèves aux États-Unis [926]
- au Canada [927]
- en Italie… [928]
Rubrique:
En Argentine, comme ailleurs… Les travailleurs doivent tirer les leçons de leurs luttes passées pour préparer celles de l'avenir
- 88 lectures
En revenant sur les expériences historiques des luttes du prolétariat en Argentine depuis le Cordobazo en 1969 jusqu’aux difficultés actuelles qu’elles traversent, l’objectif de l’article est de mettre en évidence la nécessité pour le mouvement ouvrier de tirer les leçons du passé pour pouvoir inscrire et développer son combat au niveau international dans l’avenir. Cela n’est possible qu’en se rattachant non seulement aux moments forts du développement de ces luttes mais en développant en même temps une réflexion critique consciente sur pourquoi depuis le milieu des années 1970, ces luttes ont systématiquement été conduites dans des impasses en les laissant aux mains des forces capitalistes chargées de les encadrer tout en suscitant toujours davantage un sentiment d’échec et d’impuissance au sein de la classe. Cela démontre au contraire que la classe ouvrière a pleinement la capacité de surmonter le découragement et de développer les luttes sur son propre terrain de lutte de classe qui est la seule voie possible pour pouvoir résister aux attaques de la bourgeoisie.
Les travailleurs argentins subissent aujourd'hui une dégradation aiguë de leurs conditions de vie. Les mesures mises en œuvre par Milei ne cessent d’accroître le chômage et de diminuer les salaires, conduisant de larges masses prolétariennes à un processus de paupérisation, le pourcentage de pauvres bondissant en quelques mois de 45 % à 57 % de la population. En effet, le plan de choc concerté avec la plupart des gouverneurs de province baptisé «Ley de bases» (lois de base) a imposé des mesures d’austérité drastiques : suppression des aides sociales, notamment dans les secteurs de la santé et de l’éducation ; coupes drastiques dans les budgets sociaux - impliquant en particulier des licenciements massifs dans le secteur public (entre 50 et 60 000 effectués jusqu’alors avec en vue la suppression de 200 000 postes de travail en un an ; gel des salaires et des retraites … - tout cela au nom de la lutte contre l’inflation et accompagné d’un renforcement de l’arsenal répressif de l’État. Dans les premiers jours du gouvernement Milei, face à une nouvelle escalade d’attaques contre les travailleurs aggravant leurs conditions de vie déjà très dégradées, d'importantes manifestations spontanées ont eu lieu, mais la structure syndicale et l'appareil de gauche du capital ont réussi à piéger le mécontentement et la volonté de lutte des travailleurs, empêchant que ce mécontentement ne se transforme en une force consciente et organisée.
Chaque fois que la combativité des travailleurs cherche à s'exprimer, elle trouve face à elle un ensemble d’obstacles dressés par la bourgeoisie qui déploie toutes ses forces d’encadrement de la classe ouvrière : syndicats, partis de gauche, péronistes, gauchistes, piqueteros, … C'est pourquoi les prolétaires doivent se pencher sur leurs luttes passées, afin d'en tirer les leçons, en identifiant les expériences positives, mais aussi en réfléchissant sur les erreurs et les expériences négatives, car cela permettra de préparer leurs prochaines luttes en étant capables de reconnaître et déjouer les pièges tendus par la bourgeoisie.
La nécessité de se réapproprier l’expérience du Cordobazo de 1969 ...
La tradition de lutte ouvrière en Argentine s'est affirmée entre les dernières décennies du 19e siècle et le premier quart du 20e siècle, avec l’industrialisation rapide du pays et la croissance du prolétariat au sein de la société. Cependant, l’impact de la défaite de la vague révolutionnaire mondiale de 1917-23 a plongé l’ensemble de la classe ouvrière au niveau mondial dans une longue période de contre-révolution. En Argentine, cette période de contre-révolution a pris la forme particulière d’un gouvernement comme celui de Péron « démocratiquement » élu mais en réalité dirigé par l’armée, fortement marqué comme ailleurs par le besoin de mesures de contrôle de l’État à la fois sur l’économie nationale et sur l’ensemble de la vie sociale, qui sont des caractéristiques propres à la période de la décadence du capitalisme[1]. Mais de telles mesures ont été badigeonnées d’une coloration « sociale », supposée reposer sur les syndicats et la mainmise du péronisme sur les « couches populaires » de la nation. Celui-ci s’est imposé à travers une succession de coups d’État fomentés tantôt par des militaires, tantôt par des civils permettant un encadrement renforcé de la classe ouvrière.
C’est suite à une période de 40 années de contre-révolution que, à la fin des années 1960, le retour sur la scène du prolétariat mondial se manifestait dans la reprise internationale de la lutte de classe à travers le formidable mouvement de luttes et de grèves de Mai 68 en France suivi par « l’automne chaud » en Italie en 1969. Une manifestation significative et majeure de cette dynamique en Argentine fut le Cordobazo[2] en mai 1969. Cette dynamique se propageait alors en opposition complète aux méthodes de lutte, mensongèrement présentées par les organisations gauchistes comme « socialistes », « communistes » ou « guerilleristes » relevant toutes de « luttes » au sein même du camp bourgeois[3]. Il est ainsi nécessaire et prioritaire que le prolétariat de ce pays se réapproprie cette expérience de lutte, en vue de pouvoir à nouveau se mobiliser solidairement et massivement face aux attaques de la bourgeoisie. Avec le Cordobazo, il s'agissait réellement de mobilisations ouvrières massives qui, bien qu'appelées par les grandes centrales syndicales pour éviter que les ouvriers n'en prennent eux-mêmes l'initiative et le contrôle, ont été capables d’exprimer une grande détermination, une forte combativité dans la lutte et des tendances à l’extension du mouvement, de faire surgir des assemblées dans les rues et sur les barricades, passant outre aux consignes syndicales pour faire cesser le mouvement. En dépit des pièges tendus par la bourgeoisie et son appareil d’encadrement syndical, mais aussi de ses illusions, ce mouvement a constitué un vigoureux et très clair encouragement à la lutte de classe internationale, permettant au prolétariat de prendre confiance en sa propre force, en sa lutte hors du cadre corporatiste dans lequel les syndicats voulaient l’enfermer, en sa solidarité de classe, notamment pour résister avec courage à la féroce répression étatique d’un gouvernement militaire. Ainsi, la mobilisation et les grèves se sont maintenues ou développées dans de nombreux secteurs en Argentine presque tout au long de l’année 1970.
Les facettes d’un même piège : « comedores populares », « piqueteros », « gauche du capital », « structures syndicales », ...
Il est également nécessaire de revenir sur les manifestations de la dernière décennie du 20e siècle et des premières années du 21e siècle, en particulier pour dénoncer l’impasse du mouvement des « piqueteros »[4] (appelés à l'époque les « nouveaux sujets sociaux») et des « comedores populares » (soupes populaires) [5], en tant que fausses expressions de la lutte prolétarienne que la bourgeoisie continue de présenter, à travers ses structures syndicales et tout son appareil politique de gauche, comme les modèles que les travailleurs devraient suivre dans leurs luttes actuelles. Les idéologues bourgeois tentent de masquer que, depuis le Cordobazo, ce sont les forces syndicales et l’aile gauche du capital qui se sont constamment employées à saboter, dévoyer et étouffer la combativité ouvrière pour éviter l’émergence d’une formidable énergie prolétarienne telle qu’elle s’était manifestée lors du Cordobazo en effrayant l’ensemble de la bourgeoisie. En effet, parmi d'autres obstacles, figure le poison idéologique nationaliste contenu dans le credo anti-impérialiste exploité surtout par la gauche du capital, comme par les diverses fractions des défenseurs du péronisme qui est constamment utilisé pour détourner la colère des travailleurs en l’orientant contre la mainmise de capitaux d’entreprises d’« origine étrangère » sur le sol national. L’arme principale de l'État contre la conscience s’est appuyée sur la gauche et le renforcement de la structure syndicale.
Au niveau de l’encadrement syndical, il s’est surtout agi, face au discrédit de la CGT officielle profondément liée au péronisme, de s’appuyer sur la CGT-A[6], qui a joué un rôle important dans la récupération par la bourgeoisie des grèves massives du Cordobazo. La ruse du retour de Perón, avec la complicité de la gauche, a quant à elle été le produit d'une négociation entre différents secteurs bourgeois pour soumettre les travailleurs. Elle a été utilisée aussi bien par le Front Justicialiste de Libération d’obédience péroniste que par les autres partis politiques pour entraîner les travailleurs dans le cirque électoral démocratique de 1973[7]. C'est ainsi que s'est ancrée l’illusion que les travailleurs n'ont que l'option des urnes et de la démocratie pour sortir de la misère.
Au cours des années 1990, à la fin du 20e siècle, la masse des chômeurs a augmenté (générée par les politiques d’austérité de Menem, également d’origine péroniste), ainsi que le mécontentement, représentant ainsi un potentiel croissant de la lutte qui a été phagocyté par des secteurs prétendument plus radicaux du péronisme. Cette forme de mobilisation autour d’initiatives stériles telles que les barrages ou blocages de routes, a d'abord été promue et encouragée par des secteurs du parti justicialiste péroniste, notamment Hilda Duhalde[8]. Afin de gagner la sympathie des chômeurs et garantir leur affiliation ultérieure au parti justicialiste, celui-ci leur avait offert des subventions et de la nourriture pour leurs familles. Différentes organisations de gauche ou gauchistes ont réactivé ces « piqueteros » , notamment lors de la « crise du corralito » qui marquait l’effondrement économique et financier du pays fin 2001. Derrière des slogans totalement étrangers aux intérêts des exploités, comme la défense des entreprises nationalisées ou encore la promotion d’actions minoritaires, allant du pillage des magasins à la mise en autogestion d’usines devant fermer, les piqueteros ont ainsi réussi à circonscrire, encadrer, contrôler et dévoyer le mécontentement des travailleurs sans emploi ou précaires. Aujourd’hui encore, différentes organisations gauchistes se sont regroupées au sein du Mouvement des chômeurs (MTD) pour se disputer et se partager le contrôle du « mouvement piquetero » à travers, à nouveau, comme l’avaient fait les péronistes, la distribution gratuite de nourriture et la création de centres de soupe populaire pour attirer les chômeurs dans leurs filets.
Ces formes de regroupement, bien qu'elles puissent paraître exprimer la solidarité et la prise de décision au moyen d'assemblées, elles représentent en réalité la négation de l'unification consciente, de la discussion et de la réflexion collective, et sont finalement le moyen par lequel la bourgeoisie a contrôlé les mobilisations des chômeurs. Le piège était si efficace que tout l'appareil de gauche et d’extrême gauche du capital, dans toutes ses composantes, des fractions péronistes jusqu’aux groupes gauchistes en passant par les organisations syndicales « alternatives » ou radicales, comme la CTA[9], l'ont utilisé pour mener à bien leur travail d’encadrement et manipulation. De cette manière, ils exploitaient la misère grandissante des travailleurs, leurs difficultés matérielles, leurs réels besoins matériels d’aide pour dévoyer et encadrer la combativité en empêchant toute initiative des prolétaires pour mener la lutte sur leur terrain de classe.
La gauche, les syndicats et les gauchistes se partagent le travail face à la classe ouvrière
Face à la violente crise économique et financière de décembre 2001, les ouvriers avaient réagi vigoureusement et fait preuve d’une forte combativité face aux attaques et à la détérioration brutale de leurs conditions de vie. Mais la classe ouvrière s’est alors fait totalement piéger par le mouvement des piqueteros isolant les chômeurs du reste de leur classe et par les manifestations interclassistes, du style des « cacerolazos », voir sur un terrain purement nationaliste et bourgeois.
L’an dernier encore, d’importants mouvements de grève ont eu lieu, notamment sur les docks et dans les services portuaires, dans le secteur de l’enseignement, des employés des transports publics et même chez les médecins. Mais cette fois-ci, tout le travail de sape et les pièges tendus sur le terrain par les syndicats conjugués au durcissement de l’appareil répressif du gouvernement (comme au temps de la dictature militaire, son évoqués avec insistance des cas de « disparitions » après des arrestations lors des manifestations), ont abouti à un large sentiment de démoralisation au sein de la classe ouvrière du pays.
Ici encore, partie intégrante de l'appareil politique de contrôle du prolétariat, les syndicats, se partageant le travail, manœuvrent en vue de diviser les prolétaires de manière à ce qu’ils ne parviennent pas à unifier leur mécontentement, ni exprimer leur solidarité dans la lutte. Bref, il s’agit de décourager, d’empêcher ou de saboter toute tentative et initiative des ouvriers de prendre en mains leur lutte, de s'organiser contre la division imposée par la bourgeoisie et que les syndicats reproduisent en se divisant eux-mêmes en corporations, entreprises ou secteurs... et cette division du travail, la gauche du capital se charge de lui donner une légitimité en se présentant, au même titre que les syndicats, comme les véritables représentants des travailleurs.
Dans le contexte d’une économie nationale au bord de la faillite depuis des années, de taux d’inflation vertigineux et où la crise frappe très brutalement les travailleurs, les syndicats de la CGT ou de la CTA et les partis « d’opposition » liés à la gauche du capital ont un rôle fondamental de rempart du capital contre la lutte de classe. Dans cette entreprise, leur action est renforcée par la politique des organisations gauchistes qui, tout en feignant de se méfier des syndicats comme des partis de gauche, allant jusqu’à faire semblant de vouloir les combattre tout en semant des illusions quant à la possibilité de les regagner à la cause du prolétariat en leur «mettant la pression ». Ce n’est ni plus ni moins qu’une nouvelle manœuvre pour tenter de les recrédibiliser.
Ces derniers temps, face à l'escalade des attaques du gouvernement Milei, cette chorégraphie grotesque s’est mise en place pas à pas. Ainsi, la CGT feint hypocritement l’indignation et lance des appels à la mobilisation de tel ou tel secteur face aux mesures décrétées par le gouvernement, voire même à des manifestations massives, comme le 9 mai 2024 pour « défendre l’économie nationale ». Les trotskistes d'Izquierda Socialista (IS) et du Partido Obrero (PO) demandent « que la CGT garantisse le succès de la grève du 9 mai... ». La manœuvre atteint ainsi son objectif : redonner du crédit à la CGT et lui permettre ainsi de détourner le mécontentement des travailleurs vers la défense pure et simple de l'économie nationale, en imposant le slogan chauvin « la patrie n'est pas à vendre ». Cela démontre clairement, une fois de plus, que la CGT et tout l'appareil de gauche qui la soutient sont des instruments de défense du capital national dont la fonction essentielle est de saboter une lutte qui se déroulait sur un terrain de classe, d’affaiblir la classe ouvrière face aux attaques qu’elle subit et finalement de faire passer de nouvelles attaques.
Une autre officine gauchiste, le Mouvement des Travailleurs Socialistes (MTS) complète la manœuvre, tout en prétendant permettre aux travailleurs de s’affranchir du contrôle de la CGT sur leurs luttes, il les appelle à créer et rejoindre une autre structure syndicale, présentée différente de l’autre uniquement par le fait de revendiquer « un syndicalisme de combat ».
Tirer les leçons des échecs des luttes et des manœuvres de la bourgeoisie
Il est aujourd’hui fondamental, pour le développement de la lutte en Argentine sur un terrain de classe, que, dans les discussions, dans les assemblées, soit dénoncé le lien existant entre, d'une part, les coups brutaux portés à leurs conditions de vie par la bourgeoisie au sein d’une énième crise économique et, d'autre part, tout l’arsenal de l’État qui a été mis en place pour pousser à la polarisation entre le soutien à Milei et l’opposition à son gouvernement, en vue d'affaiblir toute riposte de la classe ouvrière prenant pour cible le clown Milei à la place de l'État capitaliste avec ses syndicats, ses politiciens, ses forces de répression, etc. L’arrogance de Milei est en réalité celle de la bourgeoisie dans son ensemble qui s’attaque impitoyablement et férocement aux conditions de vie des travailleurs
Cette stratégie a fonctionné jusqu’à aujourd’hui, les travailleurs attendant le moment où le péronisme et l’énorme structure syndicale, qu’ils considèrent toujours comme étant de leur côté, répondront aux attaques.
La classe ouvrière en Argentine doit absolument tirer les leçons de ses défaites, et cet article se veut une contribution militante pour permettre aux ouvriers de dépasser la démoralisation actuelle, en comprenant que le sentiment d’impuissance et d’échec qui la sous-tend ne vient pas du fait que toute lutte est vouée à la défaite mais que les défaites de ces dernières décennies, en particulier les plus récentes d’entre elles, sont imputables à une soumission aux directives dictées par tous ceux qui se font passer pour des défenseurs de la classe mais n’ont pas cessé de saboter, faire capoter, dévoyer toute tentative de lutte ouvrière pour résister à des attaques de plus en plus insoutenables. Cette situation n’est pas inéluctable, au contraire, la classe ouvrière ne doit pas se décourager mais au contraire prendre confiance en ses propres forces car le développement de ses luttes sur son terrain de classe est la seule voie possible pour combattre et à terme renverser le capitalisme. Même si cela peut paraître aujourd’hui comme quelque chose de presque irréalisable, bien que déjà réalisé dans le passé, les prolétaires doivent se donner tous les moyens pour garder le contrôle de leur lutte et décider eux-mêmes des actions à mener.
Un besoin fondamental est l’autonomie de la classe ouvrière, la confiance dans sa capacité à prendre sa lutte en main. Et pour cela, comme dans les autres pays, ils doivent se méfier du partage des tâches entre la droite et la gauche où la première assume ouvertement les attaques et la seconde fait semblant de défendre les travailleurs pour les empêcher de suivre leur propre voie. En particulier, il faut comprendre que la gauche, les structures syndicales sous toutes ses formes et le gauchisme dans toutes ses variantes, ne sont pas des organes de la lutte des travailleurs mais au contraire des ennemis de classe et des serviteurs de l’État capitaliste. Il ne faut pas s’illusionner sur le fait qu’ils vont appeler à la lutte contre la bourgeoisie et, surtout, il faut se méfier quand ils appellent à la mobilisation parce qu’ils le font quand ils savent que le mécontentement et la combativité grandissent pour les faire dérailler dans des impasses. Le péronisme, en particulier, reste un rempart de l’État bourgeois parce qu’il jouit encore d’une grande sympathie auprès des travailleurs qui, par exemple se plaignent de ne pas suffisamment appeler à la mobilisation. Lorsqu’ils le feront, c’est qu’ils chercheront à dévoyer les luttes prolétariennes vers des impasses.
La classe ouvrière en Argentine n’est pas seule
Elle doit prendre conscience que sa lutte n’est pas une spécificité argentine mais qu’au contraire elle est une expression d’une dynamique mondiale du développement de la résistance de la classe ouvrière aux attaques du capitalisme dans tous les pays dont l’expression significative récente d'un renouveau de la lutte de classe avait été la lutte des ouvriers au Royaume-Uni au cours de l’été 2022. À ce propos, le CCI écrivait dans un tract international produit il y a un an :
« Nous devons dire que trop, c’est trop ! Pas seulement nous, mais l’ensemble de la classe ouvrière de ce pays doit dire, à un moment donné, que trop, c’est trop ! » (Littlejohn, chef de maintenance dans les métiers spécialisés à l’usine d’emboutissage Ford de Buffalo aux États-Unis).
Cet ouvrier américain résume en une phrase ce qui est en train de mûrir dans la conscience de toute la classe ouvrière dans tous les pays. Il y a un an, éclatait « L’été de la colère » au Royaume-Uni. En scandant « Enough is enough !» (« trop, c’est trop ! »), les travailleurs britanniques sonnaient la reprise de combat après plus de trente ans d’atonie et de résignation.
Cet appel a été entendu au-delà des frontières. De la Grèce au Mexique, contre la même dégradation insupportable de nos conditions de vie et de travail, les grèves et les manifestations se sont développées durant toute la fin de l’année 2022 et le début de l’année 2023.
Au milieu de l’hiver, en France, un pas supplémentaire a été franchi : les prolétaires ont repris cette idée qu’ « à un moment donné, ça suffit ! ». Mais au lieu de multiplier les luttes locales et corporatistes, isolées les unes des autres, ils ont su se rassembler par millions dans la rue. À la nécessaire combativité s’ajoutait donc la force de la massivité. Et maintenant, c’est aux États-Unis que les travailleurs tentent de porter un peu plus loin le flambeau de la lutte. »
Alors que la reprise des luttes en Grande-Bretagne en 2022 a marqué une rupture avec le climat de passivité et de résignation qui avait suivi les campagnes mensongères de la bourgeoisie à la fin des années 1980 sur la faillite de la perspective communiste et la fin de la lutte de classe, le regain de combativité du prolétariat à l’échelle internationale a été confirmé à travers des mobilisations importantes en France et d’autres pays d’Europe occidentale comme aux États-Unis ou au Canada. Le mot d’ordre « ça suffit ! » a été repris partout, montrant la détermination à s’opposer aux mêmes attaques de plus en plus brutales et intolérables aux conditions de vie et de travail, comme aux baisses de salaire ou aux projets de licenciements que toutes les bourgeoisies nationales tentent d’imposer.
C’est en se réappropriant les expériences passées, en Argentine et dans le monde, que la classe ouvrière de ce pays comme ailleurs, pourra retrouver peu à peu sa confiance en elle et son identité de classe. C'est à travers ses luttes futures qu'elle pourra développer la conscience de la nécessité de renverser le capitalisme et abolir l’exploitation au niveau mondial
RR/T-W, Mai 2024
[1]. Lire notre article : Argentin [929]a El peroni [929]s [929]mo, un arma de la [929]burguesía contra la [929] clase obrera- parte 1 , ICC Online février 2022. Con Perón en el exilio o encumbrado en el gobierno, el peronismo golpea al proletariado en Argentina (Parte II) [930]
[2]. Lire notre article : Le Cordobazo argentin (mai 1969): maillon d’une chaîne de mobilisations ouvrières à travers le monde [931],
ICC Online, novembre 2019.
[3]. Lire par exemple notre article : Che Guevara : mythe et réalité (à propos de courriers d'un lecteur) [932] (Révolution Internationale n° 384, novembre 2007).
[4] Lire : Desde Argentina: Contribución sobre la naturaleza de clase del movimiento piquetero (I), Acción Proletaria n°177, 2006 [933].Par rapport au rôle de “l’union des piqueteros” dans le sabotage des mobilisations actuelles, voir également l’article : Argentina: la crisis golpea a los trabajadores con inflación, precariedad y miseria [934], ICC On line, mars 2023
[6] CGT- A: CGT de los Argentinos, scission animée par Raimundo Ongaro en rupture avec la ligne pro-péroniste du syndicat CGT, rapidement dissoute dès le retour au pouvoir de Péron en 1974.
[7] Voir l’article Con Perón en el exilio o encumbrado en el gobierno, el peronismo golpea al proletariado en Argentina (Parte II) [930], ICC On line juin 2023
[8] Femme de l’ex-président du pays lui-aussi péroniste Eduardo Duhalde entre 2002 et 2003, également responsable de la répression sanglante du mouvement piquetero en juin 2002, qui était auparavant vice-président sous le gouvernement Menem. Son épouse est aujourd’hui encore sénatrice.
[9] CTA : Central de los Trabajadores Argentinos.
Géographique:
- Argentine [604]
Personnages:
- Javier Milei [936]
- Menem [937]
- Hilda Duhalde [938]
- Littlejohn [939]
Evènements historiques:
- le Cordobazo en 1969 [940]
- Mai 68 [941]
- l’automne chaud [942]
- piqueteros [943]
Heritage de la Gauche Communiste:
- La lutte Proletarienne [401]
Rubrique:
Inondations à Valence: Le capitalisme est une catastrophe assurée
- 116 lectures
Les journaux du monde entier ont diffusé les images et informations relatives aux morts emportés par les eaux et ensevelis sous la boue et les glissements de terrain, ainsi qu'aux nombreux autres disparus. Les cadavres s'échouent sur les plages ; de nombreux villages n'ont ni nourriture ni eau potable ; l'eau stagnant depuis une semaine avec des cadavres d'animaux et de personnes, commence à produire des infections avec des risques d'épidémies. Livrée à elle-même, à la limite de la survie, la situation de la population bloquée rappelle parfois celle de Gaza, les bombardements et la guerre en moins. Et tout cela se passe dans la troisième ville d'Espagne, dans un pays de l'Union européenne au cœur du capitalisme. Qu'il s'agisse de guerres ou de catastrophes écologiques, le capitalisme condamne l'humanité à l'extermination.
La DANA[1] qui s'est déchaînée le 30 octobre dans la région de Valence a provoqué des inondations qui ont causé plus de 200 morts, chiffre qui montera en flèche lorsque les corps des quelques 2000 disparus auront été retrouvés. À cela s'ajoute la dévastation de milliers de logements, de routes, de voies ferrées, de moyens de télécommunications, etc., affectant des centaines de milliers de personnes et dont la remise en état prendra des mois. Il s'agit sans aucun doute de l'une des plus grandes catastrophes humanitaires de l'histoire de l'Espagne, du même type que celles qui se sont produites dans les pays du centre de l'Europe, comme les inondations de 2021 en Allemagne, à Bonn, où, malgré la tradition de discipline et d'organisation de l'État, la population a été abandonnée de la même manière ; ou bien comme l'ouragan Katrina[Jl2] aux États-Unis, à la Nouvelle-Orléans. Mais contrairement à ce que disent les porte-parole de la droite, il ne s'agit pas d'une catastrophe « naturelle » imprévisible. Ce n'est pas non plus, comme le proclame la gauche du capital, la conséquence d'une «gestion néolibérale» incompétente. Cette catastrophe est en définitive le résultat d'un système social qui sacrifie la vie des travailleurs et la planète entière aux exigences de la production et de l'accumulation capitalistes.
Accumulant les catastrophes depuis des décennies (changement climatique, urbanisation sauvage, exploitation irrationnelle des ressources en eau, négligences dans l'entretien des infrastructures, etc.[2]), ce système est également entré dans sa phase terminale de décomposition, où toutes ces dévastations sont accélérées et amplifiées par d'autres manifestations de la décadence capitaliste telles que les guerres, les crises économiques, etc. dans un tourbillon[3] infernal qui débouche inévitablement dans la catastrophe. Face à cela, l'attitude de la classe dirigeante relève d'une irresponsabilité croissante dans la gestion de son propre système, privilégiant la défense des intérêts de chaque faction, ce qui accentue encore le désastre.
Ce n'est pas la nature qui est responsable de la catastrophe, c'est le capitalisme
Une grande partie des victimes étaient des travailleurs, contraints par les patrons et les cadres à rester dans les lieux de travail. Chez FORD, les équipes du soir et de la nuit n'ont pas été libérées au moment des inondations et 700 personnes ont dû dormir dans l'usine sans pouvoir communiquer avec leur famille. Dans la zone industrielle de Ribarroja, plus de 1 000 travailleurs ont été secourus le lendemain. Autre « souricière », les centres commerciaux (IKEA, Bonaire de Torrent) où les horaires d'ouverture ont été maintenus et où les employés eux-mêmes ont dû secourir les clients et les usagers. Dans les usines d'Inditex, les travailleurs n'ont pas entendu les alertes parce qu'ils n'ont pas le droit d'avoir avec eux leur téléphone portable et que les managers ne leur ont rien dit... On sait aussi que cette alerte a été lancée par les autorités locales, plusieurs heures après les alertes rouges de la météo et les premières inondations en amont. La discipline du salariat et la santé des entreprises priment sur toute considération pour la vie et la santé des travailleurs. C'est la véritable loi du capitalisme.
La situation rappelle, à une autre échelle, la pandémie de COVID il y a quatre ans. Là aussi, on a dit que l'origine était « naturelle » et on s'est retranché derrière le sempiternel «qui aurait pu prédire une chose pareille?» Mais même à cette époque, nous avons souligné qu'il s'agissait d'une catastrophe annoncée en raison de l'aggravation du désastre environnemental mondial. Et que la société disposait de la technologie et des connaissances nécessaires pour anticiper et prévenir ses ravages, mais que ces ressources sont détournées au profit de l'accumulation capitaliste et de la guerre. Il est navrant et scandaleux qu'à l'heure où les armées disposent de moyens cybernétiques pour faire exploser à distance un téléphone portable, ou des drones sont capables d'espionner au centimètre près, que lors des inondations de Valence les lignes téléphoniques se soient immédiatement effondrées, y compris pour les appels d'urgence et que ceux qui devaient se déplacer cette nuit-là ont dû le faire pratiquement à l'aveugle, sans aucune information, sur des routes et des voies ferrées littéralement saturées, ou s'engager sur des routes secondaires sans savoir si elles étaient inondées ou non.
À quoi sert l'État capitaliste pour nous, les travailleurs ?
Le cauchemar ne s'est pas arrêté avec la fin des pluies. Le lendemain matin, les gens se sont retrouvés à chercher des survivants, à récupérer ce qu'ils pouvaient dans les maisons dévastées etc., pratiquement sans aucune aide, ni nourriture, ni eau potable, ni électricité, ni téléphone, avec des infrastructures routières emportées, sans moyens de secours adaptés (hélicoptères, bulldozers, etc.). C'est pourquoi le cynisme et les larmes de crocodile des gouvernants -régionaux et nationaux- qui sont apparus à plusieurs reprises devant les caméras de télévision sont encore plus répugnants avec les messages rituels de « solidarité » et les promesses qu'« ils ne laisseront pas les victimes seules » (!), alors qu'ils savaient parfaitement qu'ils abandonnaient la population à son sort.
Le fait qu'ils se soient également consacrés à se blâmer et à se tirer dans les pattes montre qu'en cette époque de décomposition capitaliste, les politiques étatiques dites traditionnelles cèdent la place à l'irresponsabilité et au «chacun pour soi». Le gouvernement régional (du PP) a en effet fait preuve de négligence, mais aussi d'arrogance et de provocation (par exemple, en essayant d'expulser les volontaires ou en les chargeant de nettoyer les centres commerciaux, en renvoyant chez eux les parents qui recherchaient les disparus). Mais le gouvernement «ultra-progressiste» de Sánchez et Sumar n'est pas en reste. Il a mis des jours à déployer des moyens d'intervention en personnel, sous prétexte qu'ils n'avaient pas été «officiellement» demandés par le gouvernement régional. De deux choses l'une. Soit il a laissé le PP «mijoter dans son jus» malgré le coût humain que cela représente, soit il se cache derrière des subtilités administratives pour masquer sa propre négligence. Des gouvernements comme en France et dans l'UE ont annoncé leur volonté d'aider, mais ne l'ont pas fait parce que le gouvernement Sánchez n'en a pas fait la «demande» nécessaire.
L'État démocratique se présente comme le garant du bien-être social, comme le moyen pour la population de «se défendre» contre les abus de l'exploitation capitaliste, alors qu'il est en réalité son défenseur le plus énergique[4]. Lorsque les protestations contre le maintien forcé au travail ont commencé à émerger la nuit de l'inondation, la «pseudo-communiste» Yolanda Díaz (également vice-présidente du gouvernement et ministre du travail) est sortie pour déclarer que la loi permettait soi-disant aux travailleurs de quitter leur emploi lorsque leur vie était en danger, mais qu'elle en «appelait» à la responsabilité des employeurs (?). Imputer le choix d'une telle décision aux travailleurs[5] dans une période caractérisée par la précarité de l'emploi relève d'un sarcasme insultant ; de même lorsque le gouvernement appelle les propriétaires à être «compréhensifs» à l'égard des locataires et à freiner la crise du logement.
L'inondation a également suscité un élan de solidarité spontané et généreux, qui a été retransmis par les télévisions du monde entier. Cette solidarité initiale a été interrompue par les autorités craignant une perte de contrôle de la situation du fait de l'indignation de la population des voisins qui se rassemblaient ; elle a ensuite été manipulée, prenant la forme d'un « soutien régionaliste des Valenciens », au son de l'hymne régional. En dehors de la confrontation et de la solidarité de classe, elle était condamnée à devenir un soutien populaire et interclassiste, du type «seul le peuple peut sauver le peuple». Mais croire que le «salut» est possible sans éradiquer le capitalisme, ses désastres, ses guerres et sa misère de la surface de la terre est une illusion fatale. La seule façon de sortir de ce sinistre avenir est de canaliser l'indignation et la rage produites par tous ces désastres dans la lutte des classes, la lutte des exploités de tous les pays contre les exploiteurs. Au fur et à mesure que le prolétariat retrouvera son identité de classe, les travailleurs seront en mesure de soutenir, en la maintenant sur un terrain de classe, la défense de l'ensemble de la population non exploiteuse, créant ainsi un rapport de force contre l'État bourgeois.
Valerio (2 novembre 2024)
[1] Acronyme de "depresion aislada en niveles alto", ou dépression isolée à niveau élevé
[2] Voir une analyse de cette succession de catastrophes climatiques par exemple dans notre récent article en espagnol sur la sécheresse, Sequía en España: el capitalismo no puede mitigar, ni adaptarse, solo destruir [944]
[3] Nous expliquons ce que nous entendons par cet «effet tourbillon» dans notre résolution sur la situation internationale [945] de décembre 2023.
[4] Le roi Felipe VI a déclaré, après la visite mouvementée à la zone zéro, que l'État devait être présent à tous les niveaux, et nous avons effectivement vu comment il a pris en charge la défense de la propriété privée, réprimant les assauts des supermarchés à la recherche de nourriture, interdisant les actes spontanés de solidarité, protégeant les autorités... Et abandonnant la population à son sort.
[5] Légalement, les syndicats peuvent aussi évacuer les lieux de travail en cas de risques professionnels. Il s'est pas avéré qu'ils ne l'ont pas fait dans tous les cas, ce qui illustre qu'ils sont eux aussi alignés sur l'État capitaliste.
Géographique:
- Espagne [16]
Personnages:
- Sánchez [946]
- Sumar [947]
- Yolanda Diaz [948]
Rubrique:
Permanence en ligne - samedi 14 décembre 2024
- 74 lectures
Le Courant Communiste International organise une permanence en ligne le samedi 14 décembre 2024 à 14h30.
Ces permanences sont des lieux de débat ouverts à tous ceux qui souhaitent rencontrer et discuter avec le CCI. Nous invitons vivement tous nos lecteurs et tous nos sympathisants à venir débattre afin de poursuivre la réflexion sur les enjeux de la situation et confronter les points de vue. N'hésitez pas à nous faire part des questions que vous souhaiteriez aborder.
Les lecteurs qui souhaitent participer aux permanences en ligne peuvent adresser un message sur notre adresse électronique ([email protected] [213]) ou dans la rubrique « nous contacter [214] » de notre site internet, en signalant quelles questions ils voudraient aborder afin de nous permettre d’organiser au mieux les débat.
Les modalités techniques pour se connecter à la permanence seront communiquées par mail ultérieurement.
Vie du CCI:
- Permanences [291]
Rubrique:
Triomphe de Trump aux États-Unis: Un pas de géant dans la décomposition du capitalisme!
- 328 lectures
Trump retrouve donc la Maison-Blanche, auréolé d’une victoire écrasante à l’élection présidentielle. Aux yeux de ses supporters, il est un invincible héros américain, celui qui a survécu à tous les obstacles : aux « élections truquées », à « l’inquisition judiciaire », à l’hostilité de « l’establishment » et même… aux balles ! L’image d’un Trump miraculé, l’oreille en sang, le poing levé, après qu’un tir l’a frôlé, restera dans les annales. Mais derrière l’admiration qu’a suscitée sa réaction, cet attentat est surtout l’expression la plus spectaculaire d’une campagne électorale qui a atteint des sommets de violence, de haine et d’irrationalité. Cette campagne hors norme, vomissant le fric et saturée d’obscénités, tout comme sa conclusion, la victoire d’un milliardaire mégalomane et stupide, est à l’image de l’abyme dans lequel s’enfonce la société bourgeoise.
Voter contre le populisme ? Non ! Il faut renverser le capitalisme !
Trump a tout d’un sale type : il est d’une vulgarité sans borne, menteur et cynique, aussi raciste et misogyne qu’homophobe. La presse internationale a glosé durant toute la campagne sur les dangers que son retour aux affaires fait peser tant sur les institutions « démocratiques » que sur les minorités, le climat ou les relations internationales : « Le monde retient son souffle » (Die Zeit), « Cauchemar américain » (L’Humanité), « Comment le monde survivra-t-il à Trump ? » (Público), « Une débâcle morale » (El País)…
Alors fallait-il préférer Harris, choisir le camp d’un prétendu « moindre mal » pour barrer la route au populisme ? C’est ce que s’est employée à faire croire la bourgeoisie. Le nouveau Président des États-Unis s’est trouvé, pendant plusieurs mois, au cœur d’une propagande mondiale contre le populisme. (1) La « souriante » Kamala Harris n’a cessé d’en appeler à la défense de la « démocratie américaine », qualifiant son adversaire de « fasciste ». Même son ancien chef d’état-major n’a pas hésité à le décrire comme un « dictateur en puissance ». La victoire du milliardaire n’a fait qu’alimenter cette campagne mystificatrice en faveur de la « démocratie » bourgeoise.
Beaucoup d’électeurs se sont rendus au bureau de vote en pensant : « Les Démocrates nous en ont fait baver pendant quatre ans, mais ce ne sera malgré tout pas aussi catastrophique que Trump à la Maison-Blanche ». Cette idée, c’est celle que la bourgeoisie a toujours cherché à mettre dans la tête des ouvriers pour les pousser vers les urnes. Mais dans le capitalisme décadent, les élections sont une mascarade, un faux choix qui n’a plus d’autre fonction que d’entraver la réflexion de la classe ouvrière sur ses buts historiques et les moyens d’y parvenir.
Les élections aux États-Unis n’échappent pas à cette réalité. Si Trump a gagné aussi largement, c’est d’abord parce que les Démocrates sont détestés. Contrairement à l’image véhiculée d’une « vague Républicaine », Trump n’a pas suscité d’adhésion massive. Le nombre de ses électeurs est resté relativement stable par rapport à la précédente élection de 2020. C’est surtout la vice-Présidente Harris qui, signe du discrédit des Démocrates, a essuyé une débâcle en perdant pas moins de 10 millions d’électeurs en quatre ans. Et pour cause ! L’administration Biden a mené des attaques féroces contre les conditions de vie et de travail de la classe ouvrière, d’abord par l’inflation qui a fait exploser le prix de l’alimentation, de l’essence et des logements. Par une énorme vague de licenciements et de précarisation, ensuite, qui ont fini par pousser les travailleurs à lutter massivement. (2) Sur l’immigration, Biden et Harris, qui avaient été élus en promettant une politique « plus humaine », n’ont cessé de durcir les conditions d’entrée sur le territoire américain, allant jusqu’à fermer la frontière avec le Mexique et interdire sans ménagement aux migrants ne serait-ce que seulement demander l'asile. Sur le plan international, le militarisme forcené de Biden, le financement dispendieux des massacres en Ukraine et le soutien à peine critique aux exactions de l’armée israélienne ont aussi ulcéré les électeurs.
La candidature d’Harris ne pouvait susciter d’illusion, comme on a pu l’observer par le passé avec Obama et, dans une moindre mesure, avec Biden. Le prolétariat n’a rien à attendre des élections ou du pouvoir bourgeois en place : ce n’est pas telle ou telle clique au pouvoir qui « gère mal les affaires », c’est le système capitaliste qui s’enfonce dans la crise et sa faillite historique. Démocrates ou Républicains, tous continueront d’exploiter sans ménagement la classe ouvrière et à répandre la misère à mesure que la crise s’approfondit, tous continueront d’imposer la féroce dictature de l’État bourgeois et à écraser partout dans le monde des innocents sous les bombes !
Le trumpisme, expression de la décomposition du capitalisme
Les fractions les plus responsables de l’appareil d’État américain (la plupart des médias et des hauts-fonctionnaires, le commandement militaire, la faction la plus modérée du parti Républicain…) ont cependant fait leur possible pour empêcher le retour de Trump et son clan à la Maison-Blanche. La cascade de procès, les avertissements de la quasi-totalité des experts dans tous les domaines et même l’acharnement des médias à ridiculiser le candidat n’ont pas suffi à stopper sa course vers le pouvoir. L’élection de Trump est un véritable camouflet, le signe que la bourgeoisie perd de plus en plus le contrôle sur son jeu électoral et ne parvient plus à empêcher un trublion irresponsable d’accéder aux plus hautes fonctions de l’État.
La réalité de la montée en puissance du populisme n’est pas nouvelle : l’adoption du Brexit en 2016, suivie la même année de la victoire surprise de Trump en ont été les premiers signes les plus spectaculaires. Mais l’approfondissement de la crise du capitalisme et l’impuissance croissante des États à maîtriser la situation, que ce soit sur les plans géostratégique, économique, environnemental ou social, n’ont fait que renforcer l’instabilité politique à travers le monde : parlements écartelés, populisme, tensions entre les cliques bourgeoises, instabilité gouvernementale… Ces phénomènes témoignent d’un processus de délitement qui opère désormais au cœur des États les plus puissants de la planète. Cette tendance a permis à un fou furieux comme Milei de se hisser à la tête de l’État argentin ou de voir les populistes arriver au pouvoir dans plusieurs pays européens, là où la bourgeoisie est la plus expérimentée au monde.
La victoire de Trump s’inscrit dans ce processus mais marque aussi un pas supplémentaire significatif. Si Trump est rejeté par une large partie de l’appareil d’État, c’est avant tout parce que son programme et ses méthodes risquent non seulement de nuire aux intérêts de l’impérialisme américain dans le monde, mais aussi d’accroître davantage les difficultés de l’État à assurer le semblant de cohésion sociale nécessaire au fonctionnement du capital national. Pendant la campagne, Trump a multiplié les discours incendiaires, ravivant comme jamais l’esprit revanchard de ses partisans, menaçant même les institutions « démocratiques » dont la bourgeoisie a tant besoin pour encadrer idéologiquement la classe ouvrière. Il n’a cessé d’alimenter les discours les plus rétrogrades et haineux, faisant planer le risque d’émeutes s’il n’était pas élu. Cela, sans jamais se soucier des conséquences que ses propos pouvaient avoir sur le tissu social. L’extrême violence de cette campagne, dont les Démocrates sont aussi responsables à bien des égards, approfondira sans aucun doute les divisions dans la population américaine et ne pourra qu’accroître encore et encore la violence d’une société déjà très fragmentée. Mais Trump, dans une logique de terre brûlée qui caractérise de plus en plus le système capitaliste, était prêt à tout pour l’emporter.
En 2016, comme la victoire de Trump était relativement inattendue, y compris de lui-même, la bourgeoisie américaine avait pu baliser le terrain en plaçant au gouvernement et dans l’administration des personnalités capables de freiner les décisions les plus délirantes du milliardaire. Ceux que Trump a, par la suite, qualifié de « traîtres », avaient, par exemple, pu empêcher l’abrogation du système de protection sociale (Obamacare) ou le bombardement de l’Iran. Lorsque la pandémie de Covid avait éclaté, son vice-Président, Mike Pence, avait aussi pu assurer la gestion de la crise en dépit d’un Trump qui pensait qu’il suffisait « d’injecter du désinfectant dans les poumons » pour soigner la maladie… C’est ce même Pence qui a fini par désavouer publiquement Trump en assurant la transition de pouvoir avec Biden alors que des émeutiers marchaient sur le Capitole. Désormais, même si l’état-major de l’armée demeure très hostile à Trump et fera encore son possible pour temporiser ses pires décisions, le clan du nouveau Président s’est préparé en écartant les « traîtres » et s’apprête à gouverner seul contre tous, laissant entrevoir un mandat encore plus chaotique que le précédent.
Vers un monde toujours plus chaotique
Durant la campagne, Trump s’est présenté en homme de « paix », affirmant qu’il mettrait fin au conflit ukrainien « en 24 heures ». Son goût pour la paix s’arrête visiblement aux frontières de l’Ukraine puisque, dans le même temps, il a apporté un soutien inconditionnel aux massacres perpétrés par l’État hébreu et s’est montré très virulent à l’égard de l’Iran. En réalité, nul ne sait vraiment ce que fera (ou pourra faire) Trump en Ukraine, au Proche-Orient, en Asie, en Europe ou avec l’OTAN tant il s’est toujours montré versatile et capricieux.
En revanche, son retour va marquer une accélération sans précédent de l’instabilité et du chaos dans le monde. Au Proche-Orient, Netanyahou s’imagine déjà, avec la victoire Trump, les mains plus libres que jamais depuis le début du conflit à Gaza. Israël pourrait chercher à atteindre ses objectifs stratégiques (destruction du Hezbollah, du Hamas, guerre avec l’Iran, etc.) de façon beaucoup plus frontale, répandant davantage la barbarie dans toute la région.
En Ukraine, après la politique de soutien plus ou moins mesuré de Biden, le conflit risque de prendre un tour plus dramatique encore. À la différence du Moyen-Orient, la politique des États-Unis en Ukraine relève d’une stratégie savamment mise en place pour affaiblir la Russie et son alliance avec la Chine, et resserrer les liens des États européens autour de l’Otan. Trump pourrait remettre en cause cette stratégie et affaiblir d’autant plus le leadership américain. Que Trump décide de lâcher Kiev ou de « punir » Poutine, les massacres vont inéluctablement s’aggraver et peut-être s’étendre au-delà de l’Ukraine.
Mais c’est surtout vers la Chine que se tournent les regards. Le conflit entre les États-Unis et la Chine est au centre de la situation mondiale et le nouveau Président pourrait multiplier les provocations, poussant la Chine à réagir avec fermeté ou, tout au contraire, mettre la pression sur ses alliés japonais ou coréens qui ont d’ores et déjà exprimé leurs inquiétudes. Et tout cela sur fond de guerres commerciales aggravées et de protectionnisme dont les principales institutions financières dénoncent les conséquences désastreuses sur l’économie mondiale.
L’imprévisibilité de Trump ne peut donc que considérablement renforcer la tendance au chacun pour soi, poussant toutes les puissances, petites ou grandes, à profiter du « repli » du gendarme américain pour jouer leur propre carte dans une immense confusion et un chaos accrus. Même les « alliés » de l’Amérique cherchent déjà plus ouvertement à s’éloigner de Washington en privilégiant des solutions nationales, tant sur le plan économique que militaire. Le Président français, à peine Trump assuré de l’emporter, a aussitôt appelé les États de l’Union européenne à « défendre » leurs « intérêts » face aux États-Unis et à la Chine…
Un obstacle supplémentaire pour la classe ouvrière
Dans un contexte de crise économique, alors que le prolétariat retrouve sa combativité à l’échelle internationale et redécouvre peu à peu son identité de classe, la clique de Trump n’est, aux yeux de la bourgeoisie américaine, clairement pas la plus adaptée pour gérer la lutte de classe et faire passer les attaques dont le capital à besoin. Entre ses menaces ouvertes de répression contre les grévistes et son partenariat cauchemardesque avec un type aussi ouvertement anti-ouvrier qu’Elon Musk, les déclarations à l’emporte-pièce du milliardaire lors des récentes grèves aux États-Unis (Boeing, dockers, hôtellerie, automobile…) font présager du pire et ne peuvent qu’inquiéter la bourgeoisie. La promesse de Trump de se venger des fonctionnaires d’État qu’il considère comme ses ennemis, en licenciant 400 000 d’entre eux, augure également de troubles après les élections.
Mais il serait erroné de penser que le retour de Trump à la Maison-Blanche pourra favoriser la lutte de classe. Au contraire, cela va constituer un véritable choc. La politique assumée de division entre les ethnies, entre les urbains et les campagnards, entre les diplômés et les non-diplômés, toute la violence et la haine que la campagne électorale a charriée et sur lesquelles Trump continuera de surfer, contre les Noirs, contre les immigrés, contre les homosexuels ou les transgenres, tous les délires irrationnels des évangéliques et autres théoriciens du complot, tout le fatras de la décomposition, en somme, va peser encore plus fortement sur les ouvriers, créer des divisions profondes, voire des affrontements politiques violents en faveur des cliques populistes ou anti-populistes.
L’administration Trump pourra, sans conteste, compter sur les factions de gauche de la bourgeoisie, à commencer par les « socialistes » pour instiller le poison de la division et assurer l’encadrement des luttes. Après avoir fait campagne pour les deux Clinton, Obama, Biden et Harris, Bernie Sanders accuse sans sourciller les Démocrates d’avoir « abandonné la classe ouvrière », comme si ce parti, à la tête de l’État américain depuis le XIXe siècle, militariste et assassin en masse de prolétaires, avait un quelconque rapport avec la classe ouvrière ! Sa comparse en boniments, Ocasio-Cortez, a, dès sa réélection à la Chambre des représentants, promis de faire son possible pour diviser la classe ouvrière en « communautés » : « Notre campagne ne se résume pas à gagner des voix, elle vise à nous donner les moyens de construire des communautés plus fortes ».
Mais la classe ouvrière a la force de retrouver le chemin de la lutte malgré ces nouveaux obstacles. Alors que la campagne battait son plein et malgré les accusations infâmes de faire le jeu du populisme, les ouvriers continuaient de se battre contre l’austérité et les licenciements. Malgré l’isolement imposé par les syndicats, malgré la gigantesque propagande démocratiste, malgré le poids des divisions, ils ont montré que la lutte est la seule réponse à la crise du capitalisme.
Surtout, les travailleurs aux États-Unis ne sont pas seuls ! Ces grèves s’inscrivent dans un contexte de combativité internationale et de réflexion accrue qui durent depuis l’été 2022, lorsque les ouvriers en Grande-Bretagne, après des décennies de résignation, ont poussé un cri de colère, « Enough is enough ! », qui résonne et résonnera encore dans les entrailles de la classe ouvrière !
EG, 9 novembre 2024
1« Élections aux États-Unis, vague populiste dans le monde… L’avenir de l’humanité ne passe pas par les urnes, mais par la lutte de classe ! [949] », Révolution internationale n° 502 (2024).
2« Grèves aux États-Unis, au Canada, en Italie… Depuis trois ans, la classe ouvrière se bat contre l’austérité ! [950] », publié sur le site du CCI (2024).
Géographique:
- Etats-Unis [184]
Personnages:
- Donald Trump [896]
- Joe Biden [914]
- Kamala Harris [925]
Récent et en cours:
- Elections 2024 [888]
Rubrique:
ICConline - Décembre 2024
- 44 lectures
Ukraine, Gaza, Liban, Syrie… La spirale capitaliste du militarisme et du chaos!
- 130 lectures
Le bilan des guerres en cours est terrible. En Ukraine, le nombre de morts et de blessés dépasse déjà le million, avec des territoires et villes entièrement rasés, comme dans la ville de Marioupol entièrement rayée de la carte ! Au Moyen-Orient, avec la fuite en avant à Gaza aboutissant à un véritable génocide. Là aussi tout a été rasé, les territoires laminés resteront en friche pendant des décennies. À cela, s’ajoutent encore les confrontations connexes et meurtrières, comme au Liban, en mer Rouge, au Yémen ou, plus récemment en Syrie. Et d’autres menaces plus graves s’accumulent et risquent d’éclater, notamment entre la Chine et Taïwan.
Une véritable escalade des tensions diplomatiques et guerrières
Nous assistons depuis l’été dernier à une véritable escalade, à l’intensification partout des combats et des massacres. Depuis le début du conflit en Ukraine et bientôt trois années de guerre extrêmement violente, l’armée ukrainienne a fini par réaliser une incursion sur le sol russe, dans la région de Koursk. Dans l’Est de l’Ukraine, l’armée russe semble encore progresser au prix de très lourdes pertes. Des gamins sont envoyés sans vergogne à l’abattoir. Avec l’appui de soldats nord-coréens, mais aussi Sri Lankais, Houtis, etc., le conflit prend une autre dimension, plus périlleuse, entraînant dans son sillage davantage d’États ou de groupes militaires, même si les renforts enregistrés ne font que traduire les difficultés et la pénurie dont souffre la Russie.
Au Moyen-Orient, après deux années de guerre, le conflit s’est également intensifié, déjà plus de 44 000 morts à Gaza, dont une majorité de civils, 1700 israéliens avec quelques ressortissants étrangers et des otages, puis l’ouverture d’un nouveau front qui s’est étendu brutalement au Liban, où le centre de Beyrouth s’est rapidement retrouvé sous les bombes (plus de 3000 morts civils). À ce macabre décompte, il faut encore ajouter une foule de blessés et de déplacés.
Récemment encore, c’est en Syrie que des groupes islamistes, profitant de l’impuissance de la Russie (alliée à Bachar el-Assad) et des bombardements réguliers d’Israël dans le pays, ont lancé une offensive sur la ville d’Alep. Cette nouvelle flambée de violence, tirant opportunément parti du désordre au Moyen-Orient, représente non seulement une expansion supplémentaire du chaos mais pourrait aussi avoir à son tour des conséquences meurtrières encore plus graves.
Ces conflits se sont donc encore envenimés, notamment depuis les élections américaines où Biden a été contraint de soutenir avec gêne le jusqu’auboutisme forcené de Netanyahou ; il a aussi été poussé récemment à autoriser l’usage par l’Ukraine de missiles de plus longue portée, pouvant atteindre en profondeur des cibles dans un rayon de 300 kilomètres sur le sol russe. Depuis, très rapidement, les premiers tirs ukrainiens de missiles américains ATACMS ont fait écho à l’usage plus intense des drones et missiles à fragmentation de la part de la Russie (faisant de nombreuses victimes civiles), mais aussi de nombreux bombardements visant à priver le pays d’électricité pour l’hiver. Surtout, l’envoi symbolique d’un missile de portée intermédiaire, capable de transporter des ogives nucléaires, témoigne d’une volonté croissante du Kremlin de provoquer et intimider les puissances occidentales. L’apprenti sorcier qu’est Poutine vient d’ailleurs de modifier en conséquence la doctrine russe de l’emploi de l’arme atomique.
Pendant ce temps, paradoxalement, viennent de s’ouvrir au Moyen-Orient les voies d’une négociation qui fait suite à un cessez-le-feu accepté par Netanyahou à propos du Liban. Et si la situation n’en est pas là pour l’Ukraine au moment où nous écrivons, si Poutine « ne semble pas prêt à négocier », des voix s’élèvent pour souligner qu’il est peut-être maintenant « possible d’envisager une paix juste ».1
La “paix” dans le capitalisme est un leurre et un mensonge
Les grandes puissances impérialistes et les belligérants seraient-ils devenus « raisonnables », plus enclins à « rétablir la paix » ? Nullement ! Depuis toujours, et plus particulièrement depuis la Première Guerre mondiale, le marxisme a toujours affirmé que « le capitalisme, c’est la guerre ». Un temps de « paix » n’est autre qu’un moment de préparation à la guerre impérialiste, le produit d’un rapport de force politique et militaire. Comme le soulignait Lénine, « plus les capitalistes parlent de paix, plus ils préparent la guerre ». Si aujourd’hui un fragile cessez-le-feu a été signé par Netanyahou, c’est avant tout dans l’espoir d’avoir le soutien de Trump pour capitaliser sur un plan politique ses exactions en territoire palestinien et mieux se positionner face aux prétentions régionales de l’Iran.
La nomination au poste de secrétaire d’État à la défense aux états-Unis de l’ancien vétéran Pete Hegseth va d’ailleurs dans le sens des espoirs de Netanyahou. Animateur vedette de la chaîne de télévision conservatrice Fox News, Hegseth, conservateur évangélique pur et dur, se présente comme un « défenseur d’Israël », un partisan du « sionisme » qui a applaudi des deux mains la décision de déménager l’ambassade américaine à Jérusalem comme capitale de l’État Hébreux. Ce futur ministre soutient naturellement Netanyahou face aux pressions de la justice internationale, d’autant plus aisément qu’il avait déjà plaidé en faveur de soldats américains accusés de crimes de guerre ! Il s’était fait aussi le porte-voix de ceux qui souhaitaient « bombarder l’Iran » au prétexte de « ses caches d’armes »…
En Ukraine, chaque camp tente également d’anticiper la réaction de Washington et essaye au maximum de marquer des points sur le terrain, de façon à pouvoir négocier en position de force. D’un côté la pression désespérée du Kremlin par les bombardements aveugles, la menace nucléaire, de l’autre, en Ukraine, la détermination à utiliser la conquête fragile de la région russe de Koursk comme « monnaie d’échange ». Une chose est certaine, quelle que soit la politique décidée par Trump, elle ne pourra qu’alimenter les mêmes appétits et vengeances.
Il en va de même pour les puissances européennes, prises dans la dynamique du chacun pour soi et confrontées aux initiatives de partenaires de plus en plus audacieux, comme lors de la rencontre entre le chancelier Olaf Scholz et Vladimir Poutine, mais aussi par la relance de discours franco-britanniques sur la possibilité d’envoyer des troupes en Ukraine « pour maintenir la paix », alors que l’Allemagne n’y est pas favorable pour l’instant. Tout un ensemble de sujets de discordes empoisonne des relations de plus en plus tendues, tant face à la Russie et à la guerre en Ukraine (Hongrie pro-russe) qu’au Moyen-Orient (question de l’État palestinien) et même les rapports avec l’OTAN, la place de la défense européenne, le développement de l’économie de guerre… L’incertitude des résultats des élections américaines puis la victoire de Trump qui s’était engagé à « résoudre le conflit ukrainien en 24 heures », ne pouvaient que conduire à souffler davantage sur les braises de la guerre. D’ici le 20 janvier, date d’intronisation de Donald Trump, nul ne sait, en effet, ce qu’il peut envisager tant le nouveau Président américain s’avère capricieux, versatile, imprévisible.
Les tensions de plus en plus importantes vont donc se poursuivre, peut-être aussi sous la forme de discours de « paix ». Cette dynamique de chaos impérialiste, marquée par les tensions majeures entre toutes les puissances du globe, au premier rang desquels la Chine et les états-Unis, ne peut que s’amplifier et s’étendre, même s’il est possible qu’une trêve en marque momentanément le tempo. Mais la guerre ne pourra disparaître. « Il n’y a pas d’autre issue pour le capitalisme, dans sa tentative de maintenir en place les différentes parties d’un corps ayant tendance à se démembrer, que d’imposer la main de fer de la force des armes. Et les moyens mêmes qu’il utilise pour contenir un chaos de plus en plus sanglant sont un facteur d’aggravation considérable de la barbarie guerrière dans laquelle le capitalisme a sombré ».2 Désormais, chaque État impérialiste applique de plus en plus, pour défendre ses intérêts stratégiques, la politique de la « terre brûlée », semant le chaos et la destruction, même dans les aires d’influence des « alliés » les plus proches et à fortiori des rivaux. Laissé à sa propre dynamique, le système capitaliste menace la survie même de l’humanité.
Seul le prolétariat peut offrir une alternative à la barbarie capitaliste
Reconnaître l’obsolescence du capitalisme ne signifie pas pour autant céder au fatalisme. Au contraire ! Au sein de la société bourgeoise, il existe une force antagonique capable de mettre à bas ce système : la lutte massive et internationale du prolétariat. Même si ce dernier est aujourd’hui encore affaibli, incapable de se dresser directement contre la guerre, son potentiel reste intact. Même s’il ne tend que progressivement à s’exprimer à travers un lent processus de prise de conscience, fragile et heurté, encore moléculaire et souterrain, il représente pour l’avenir une force sociale de transformation radicale. Les révolutionnaires se doivent de mettre en évidence cette réalité porteuse d’avenir : « Face à toutes les guerres actuelles ou en gestation, la classe ouvrière n’a aucun camp à choisir et partout elle doit défendre avec acharnement l’étendard de l’internationalisme prolétarien. Pendant toute une période, la classe ouvrière ne sera pas en mesure de se dresser contre la guerre. Par contre, la lutte de classe contre l’exploitation va revêtir une importance accrue car elle pousse le prolétariat à politiser son combat ».3
WH, 30 novembre 2024.
1 Propos du secrétaire de l’ONU, Antonio Guterres
2 « Militarisme et décomposition », Revue internationale n° 64 (1991).
3 « Face au chaos et à la barbarie, les responsabilités des révolutionnaires », Revue international n° 172 (2024).
Géographique:
Personnages:
- Donald Trump [896]
- Benyamin Netanyahou [951]
- Vladimir Poutine [952]
Récent et en cours:
- Guerre en Ukraine [397]
- Gaza [874]
- Conflit israélo-palestinien [262]
Rubrique:
Chute du régime Assad en Syrie: Un boucher est tombé, d’autres apporteront plus de guerres, de massacres et de chaos !
- 159 lectures
Les médias prodiguent aujourd’hui les images des horreurs du régime de Bachar al Assad (comme celles de la sinistre prison de Saydnaya), tout en se réjouissant des célébrations de la population pour la «fin du cauchemar». Mais le soulagement après la fin de ce régime de terreur n’est qu’une vaine illusion. La vérité est que la population (tant en Syrie que dans le reste du monde) est victime d’une nouvelle et criminelle tromperie, d’une nouvelle démonstration de l’hypocrisie frauduleuse de la classe dominante : faire croire que la terreur, la guerre et le la misère étaient uniquement de la responsabilité d’Assad, un «fou» qu’il fallait arrêter pour rétablir la paix et la stabilité.
En réalité, tous les impérialismes, des plus petites puissances de la région aux grandes puissances mondiales, ont trempé sans vergogne dans les atrocités du régime : n’oublions pas comment Obama, «prix Nobel de la Paix», a détourné le regard, en 2013, lorsque Bachar Al Assad bombardait ou utilisait des gaz toxiques contre sa population ; ou comment bien des puissances «démocratiques», qui se félicitent aujourd’hui de la «chute du tyran», se sont accommodées de la famille Assad pendant des décennies, voire en ont été les complices patentés, pour défendre leurs sordides intérêts dans la région. Ces mêmes grandes « démocraties » mentent à nouveau éhontément lorsqu’elles cherchent à blanchir les nouveaux dirigeants du pays, qualifiés il y a encore quelques années de « terroristes » : ces « modérés », aptes à trouver une issue « pacifique », ne sont qu’un ramassis d’islamistes et d’égorgeurs issus des rangs d’Al Qaida ou de Daesh !
Le chaos inexorable qui nous attend
Il y a un an, lorsque le conflit éclatait à Gaza, nous avons distribué un tract dans lequel nous dénoncions l’extension de la barbarie que préparaient déjà ces massacres : "L’attaque du Hamas comme la riposte d’Israël ont un point commun : la politique de la terre brûlée. Le massacre terroriste d’hier et le tapis de bombes d’aujourd’hui ne peuvent mener à aucune victoire réelle et durable. Cette guerre est en train de plonger le Moyen-Orient dans une ère de déstabilisation et d’affrontements. Si Israël continue de raser Gaza et d’ensevelir ses habitants sous les décombres, il y a le risque que la Cisjordanie s’enflamme à son tour, que le Hezbollah entraîne le Liban dans la guerre, que l’Iran finisse par trop s’en mêler (…) Si la concurrence économique et guerrière entre la Chine et les États-Unis est de plus en plus brutale et oppressante, les autres nations ne se plient pas aux ordres de l’un ou l’autre de ces deux mastodontes, elles jouent leur propre partition, dans le désordre, l’imprévisibilité et la cacophonie. La Russie a attaqué l’Ukraine contre l’avis chinois. Israël écrase Gaza contre l’avis américain. Ces deux conflits incarnent le danger qui menace de mort toute l’humanité : la multiplication des guerres dont le seul but est de déstabiliser ou détruire l’adversaire ; une chaîne sans fin d’exactions irrationnelles et nihilistes ; un chacun pour soi, synonyme de chaos incontrôlable" (Massacres et guerres en Israël, à Gaza, en Ukraine, en Azerbaïdjan… Le capitalisme sème la mort! Comment l’en empêcher? [809] (Tract international, 7 novembre 2023)
L’offensive éclair des djihadistes est un acte de pur opportunisme tirant profit de la situation de chaos croissant dans la région : Assad et son régime corrompu jusqu’à la moelle ne tenaient plus qu’à un fil depuis que l’armée russe, enlisée en Ukraine, n’était plus en mesure de le soutenir, et que le Hezbollah, empêtré dans sa guerre avec Israël, avait abandonné ses positions en Syrie. Dans le chaos de la barbarie croissante en Syrie, cette coalition de milices hétéroclites a pu foncer sur Damas sans rencontrer beaucoup de résistance. Ce à quoi nous assistons aujourd’hui en Syrie, comme hier au Liban et en Ukraine, c’est bien à la propagation et à l’amplification de ces guerres de terre brûlée dans lesquelles aucun des adversaires n’obtient une position solide, une influence durable ou une alliance stable, mais alimente au contraire une fuite en avant inexorable dans le chaos.
Qui peut prétendre avoir remporté une victoire solide ? Le nouveau régime syrien doit d’ores et déjà affronter une situation de fragmentation et de déchirement qui n’est pas sans rappeler la Libye post-Kadhafi. La chute du régime Assad est aussi un revers de premier ordre pour l’Iran qui perd là un précieux allié alors que le Hamas et le Hezbollah sont exsangues, mais aussi pour la Russie qui pourrait voir disparaître ses précieuses bases militaires sur la Méditerranée en même temps que sa crédibilité à défendre ses alliés... Même ceux qui, comme Israël ou des États-Unis, pourraient se réjouir de voir arriver de nouveaux maîtres plus conciliants à Damas, en ont une confiance plus que relative, comme en témoignent les bombardements israéliens pour détruire les arsenaux et éviter qu’ils ne tombent entre les mains du nouveau régime. La Turquie, qui apparaît comme le principal bénéficiaire de la chute d’Assad, sait aussi qu’elle va devoir affronter un soutien accru des États-Unis aux Kurdes, et une situation encore plus chaotique à ses frontières. La «chute du tyran» ne promet rien d’autres que toujours plus de guerre et de chaos !
La décomposition capitaliste entraîne l’humanité vers la barbarie et la destruction.
Le chaos, la terreur et les massacres, s’ils sont bien l’œuvre des dirigeants de ce monde, de la bourgeoisie tant autoritaire que démocrate, répondent surtout à la logique propre au capitalisme décadent. Le capitalisme, c’est la concurrence de tous contre tous, c’est le pillage et la guerre ! Le fait que cette guerre s’étende aujourd’hui à de plus en plus de régions du globe, qu’elle occasionne des dévastations insensées et des massacres de masse, est l’expression de l’impasse historique dans lequel se trouve le système capitaliste. À l’occasion de la guerre à Gaza nous écrivions ainsi : «Quelles que soient les mesures adoptées, la dynamique de déstabilisation est inévitable. Il s’agit donc fondamentalement d’une nouvelle étape significative dans l’accélération du chaos mondial […] Cette tendance à l’irrationalité stratégique, aux visions à court terme, à l’instabilité des alliances et au chacun pour soi n’est pas une politique arbitraire de tel ou tel État ni le produit de la simple stupidité de telle ou telle faction bourgeoise au pouvoir. C’est une conséquence des conditions historiques, celles de la décomposition du capitalisme, auxquelles sont confrontés tous les États. Avec le déclenchement de la guerre en Ukraine, cette tendance historique et le poids du militarisme dans la société se sont profondément approfondis. La guerre de Gaza confirme à quel point la guerre impérialiste est désormais le principal facteur déstabilisateur de la société capitaliste. Produit des contradictions du capitalisme, le souffle de la guerre alimente à son tour le feu de ces mêmes contradictions, augmentant, sous le poids du militarisme, la crise économique, le désastre environnemental, le démembrement de la société»[1].
Conséquence de cette décomposition de la société capitaliste, nous avons vu émerger des phénomènes tels que des exodes massifs de réfugiés, comme celui déclenché par la guerre en Syrie en 2015 avec près de 15 millions de personnes déplacées (7 millions en Syrie même, 3 en Turquie, environ 1 million entre l’Allemagne et la Suède). Nous dénoncions alors[2] que les hypocrites «Welcome refugees» de la bourgeoisie ne signifiaient pas une reconversion des exploiteurs à la solidarité mais plutôt une tentative de contenir les explosions du chaos en profitant d’une main d’œuvre à bas prix. Ces mêmes bienfaiteurs poussent aujourd’hui les réfugiés à rentrer dans l’enfer que demeure la Syrie, parce que «le régime oppressif n’existe plus» et que «le pays se dirige vers le rétablissement de la normalité démocratique». Cynisme dégoûtant de ces «démocraties» qui mettent en pratique la politique prônée par les partis populistes et l’extrême droite dont ils prétendent se démarquer. L’alternative à la destruction de l’humanité qu’implique la survie du capitalisme, c’est la solidarité internationale de classe, une solidarité de lutte, de combat contre le capitalisme mondial.
Valerio, 13 décembre 2024 (Version modifiée le 24.12.2024. Nous remercions Internationalist Voice pour les précisions suggérées).
[1] « Spirale d’atrocités au Moyen-Orient: la terrifiante réalité de la décomposition du capitalisme [810] », Revue internationale n° 171, (janvier 2024).
Géographique:
- Moyen Orient [60]
- Syrie [61]
Personnages:
- Bachar al Assad [954]
- Barack Obama [955]
Rubrique:
Courrier de lecteur: Pourquoi les réunions publiques internationales sont primordiales pour l’avenir?
- 132 lectures
Le 16 novembre, le CCI a tenu une Réunion publique en ligne sur le thème « Les implications mondiales des élections américaines ». En plus des militants du CCI, plusieurs dizaines de personnes ont participé à cette discussion, réparties sur quatre continents et une quinzaine de pays. Des traductions simultanées en anglais, en espagnol et en français ont permis à tous de suivre ces échanges qui ont duré un peu plus de trois heures. Nous avons publié un premier bilan de cette rencontre ici : « Un débat international pour comprendre la situation mondiale et préparer l’avenir [956] ».
Depuis, nous avons reçu de nombreux courriers, certains pour saluer cette réunion, d’autres pour prolonger le débat ou poser de nouvelles questions, témoignant ainsi de la dynamique lancée par cette rencontre enthousiasmante.
Parmi ces lettres, il y en a aussi une signée Blake qui fait un bilan plus négatif de cette réunion internationale et propose de faire autrement, de tenir d’autres types de réunions. C’est à cette critique, fraternelle et argumentée, que nous avons voulu répondre en premier.
Nous publions donc ci-dessous ce courrier puis notre réponse.
Courrier de lecteur
Bonjour,
Quelques commentaires sur la réunion publique de samedi dernier.
Je n’ai pas trop à dire sur le contenu proprement dit, je suis d’accord avec la position mise en avant par l’organisation, essentiellement que l’élection de Trump est un signe et un facteur aggravant de la poursuite de la décomposition.
Je voudrais surtout faire des commentaires sur l’organisation de la réunion. Il est très difficile de gérer un grand nombre de personnes en ligne. Toutes les réunions en ligne auxquelles j’ai participé avec un grand nombre de personnes ne sont pas conçues pour la discussion. En général, elles servent à donner des informations et les discussions se déroulent dans des forums/groupes beaucoup plus restreints.
Tout d’abord, il y a constamment des problèmes techniques (la menace d’effacer le pad, les gens qui n’éteignent pas les micros, les problèmes de connexion, etc.) Par ailleurs, en ce qui concerne la discussion, j’ai l’impression qu’il y a très peu de « discussion » à proprement parler lorsqu’il y a autant de monde. La plupart des camarades interviennent une fois, pour exposer leur point de vue, et il y a donc peu de dialogue et d’approfondissement (c’est mon sentiment, et la raison pour laquelle je ne suis pas intervenu dans la réunion). Quelques camarades ont posé des questions (par exemple JC sur la « rationalité »), mais il n’y a pas de discussion de la part des autres, et à la place vous avez « la réponse de l’organisation » (qui est évidemment importante à avoir, mais cela ressemble alors à une relation élève-professeur).
Un autre point négatif (pour moi) était d’avoir des camarades parlant d’autres langues. Si vous ne pouvez pas parler/comprendre, vous avez tendance à vous déconnecter et à attendre que la personne ait cessé de parler, ce qui nuit à la concentration. C’était une bonne idée de traduire ces interventions non anglaises et de les remettre rapidement dans le bloc-notes, mais : (a) certaines traductions étaient médiocres (sans surprise, Google translate n’a pas rattrapé notre vocabulaire quelque peu spécialisé) et (b) pendant que je lisais la dernière intervention, l’intervention suivante était en cours, ce qui fait qu’il est difficile de suivre et de se tenir au courant.
Malgré l’avantage d’avoir des voix différentes et de donner un sentiment d’internationalisme, je pense que cela ne fonctionne pas vraiment pour une réunion publique en ligne (ce qui est très différent, par exemple, d’une réunion publique en face à face où vous pouvez avoir une traduction en direct…).
Une proposition d’organisation de la réunion :
1. présentation à tout le monde (20 minutes),
2. l’assemblée est divisée en groupes linguistiques, qui peuvent alors discuter librement (disons 1 heure),
3. Une pause – au cours de laquelle les discussions / questions / thèmes principaux, etc. sont rassemblés (10 minutes).
4. Suivi d’un plénum avec une discussion de l’ensemble du groupe (1 heure).
Cette méthode présente plusieurs avantages :
1. Des groupes plus petits = une gestion plus facile.
2. Il s’agit toujours d’une réunion internationale (présentation et discussion en plénum), mais les limites de la réunion en ligne sont réduites.
3. Certains camarades sont intimidés par un grand nombre de personnes ou par leur connaissance de la langue (par exemple, les camarades japonais ou australiens) (1) et peuvent donc être davantage encouragés à prendre la parole. (Par ailleurs, pensez-vous que le fait de dire constamment que vous voulez que les « nouveaux camarades/participants » s’expriment fait réellement le travail que vous voulez qu’il fasse ? Le fait de « haranguer » constamment les gens pour qu’ils prennent la parole (c’est ainsi que je l’ai perçu) ne produit généralement pas beaucoup de réactions, personnellement je n’ai pas remarqué que davantage de personnes participaient. Vous disposez d’un plus grand nombre de moyens de communication en ligne, vous devriez donc envisager de les utiliser. Par exemple, pourquoi ne pas demander aux participants, s’ils ne veulent pas parler, d’écrire un court paragraphe de ce qu’ils pensent dans la boîte de dialogue, qui peut ensuite être lu ? Je peux pratiquement vous garantir que vous obtiendrez plus de réponses de cette manière…)
4. Des groupes plus petits, ce qui signifie généralement que chaque personne dispose d’un peu plus de temps pour s’exprimer (vous pouvez insister sur la « limite de 5 minutes » pendant la séance plénière principale).
5. Enfin, il est possible d’éliminer les répétitions et les idées de base dans le petit groupe, ce qui devrait permettre d’avoir une discussion de plus haut niveau lors de la session du groupe entier. […]
Si vous souhaitez en discuter plus avant, n’hésitez pas à me contacter.
Fraternellement,
Blake
Notre réponse
Tout d’abord, nous voulons saluer fortement cette lettre. Par ses critiques et ses propositions, le camarade participe ici à la réflexion collective, dans le but de perfectionner l’organisation des débats, de favoriser la confrontation des arguments et le processus de clarification.
D’autant plus que le camarade Blake a raison : si dans le bilan que nous avons publié sur notre site, nous nous sommes contentés de dire (pour des raisons de sécurité) que « plusieurs dizaines de personnes ont participé, réparties sur quatre continents et une quinzaine de pays », il y avait réellement beaucoup de monde.
Compte-tenu de cette affluence, tous les participants n’ont pas pu intervenir lors des débats, et il n’a pas été possible pour une même personne d’intervenir plusieurs fois. Comme l’écrit Blake, ces contraintes empêchent en partie l’approfondissement des questions en jeu, elles limitent les échanges qui se répondent les uns les autres.
Et le camarade a encore raison quand il pointe les difficultés techniques liées à une réunion internationale, en ligne, en plusieurs langues, ce qui implique de traduire en direct, de jongler avec différents pads, de se discipliner pour couper son micro quand ce n’est pas son tour de parler, etc.
Pour toutes ces raisons, le CCI organise aussi d’autres types de réunions : des réunions en ligne par langues, avec des effectifs plus réduits, des réunions dans les villes où l’on se rassemble physiquement, des permanences aussi qui n’ont pas de sujet défini à l’avance et où chaque participant peut proposer un point à discuter (d’actualité, d’histoire, de théorie…). Il est indéniable que lors de ces réunions se développent des échanges nourris qui permettent l’argumentation et la contre-argumentation, l’évolution des positions… Toutes ces discussions sont annoncées sur notre site internet dans la rubrique « agenda [479] ».
Dans ce spectre, les réunions internationales en ligne ont un rôle particulier, et même crucial. Commençons par le plus évident. Des camarades sont isolés, parfois seuls : se retrouver dan une réunion où d’autres camarades, en plusieurs langues, depuis plusieurs pays, brûlent de la même flamme pour la révolution, cherchent à comprendre l’évolution du monde et comment participer au développement de la conscience ouvrière est un moment enthousiasmant, revigorant.
Cette dimension internationale n’est pas seulement bonne pour le moral, elle l’est aussi et surtout pour la réflexion. Dans le capitalisme en décomposition, où règnent de plus en plus le repli, la peur de l’autre, l’enfermement de la pensée dans le local et le maintenant, il est absolument vital pour les minorités du monde de rompre l’isolement, de se lier, d’élaborer ensemble, dans toutes les langues, pour développer la vision la plus large et la plus profonde. Lors de la réunion du 16 novembre qui nous réunissait pour comprendre ensemble « Les implications mondiales des élections américaines », les différentes interventions des participants prononcées au quatre coins du globe ont permis de croiser les informations et les analyses, de se nourrir des sensibilités et des expériences différentes. Peut-être Blake l’a remarqué, mais les interventions des camarades en langue française portaient une confiance dans le prolétariat et ses luttes futures plus affirmée, ce qui est probablement en partie lié à la combativité et à l’expérience de la classe ouvrière en France. Tous les participants n’ont pas pu intervenir, c’est vrai. Mais tenir à dire « son » mot est-il le réellement le plus important ? Nous pensons qu’au contraire savoir écouter, s’enrichir de la pensée des autres est aussi un moment déterminant de la dynamique d’un débat et du processus de clarification collective. Lors de cette réunion de trois heures, les militants du CCI ne sont intervenus que trois fois, afin de laisser le maximum de temps à tous les autres camarades mais aussi pour mieux écouter, mieux cerner les différentes positions, les nuances et les désaccords en jeu2.
Il y a là-dessous, quelque chose de plus profond encore, ressentir ensemble que « Les prolétaires n’ont pas de patrie ! » Le combat de notre classe est mondial, la révolution communiste sera internationale, cet internationalisme n’est pas simplement un sentiment, un élan, il est aussi concret, réel, une force sociale et politique déterminante.
Passons maintenant à l’organisation concrète de cette réunion. Le camarade met en avant les problèmes de micro et de pads, la difficulté à rester concentré lorsque le débat se fait en plusieurs langues… Tout cela est exact, et justement cela signifie que nous devons apprendre. Nous avons reçu de nombreux courriers de la part de participants nous posant des questions pour savoir comment mieux maîtriser leur ordinateur, sur tel ou tel aspect technique, pour la prochaine fois. Là encore, ce petit exemple concret révèle quelque chose de beaucoup plus profond : cette réunion en plusieurs langues et les prochaines à venir sont un moment d’apprentissage, pour s’habituer à se rassembler nombreux, à s’organiser pour maîtriser nos débats, pour renforcer nos liens à l’échelle internationale. C’est une réunion toute entière dirigée vers l’avenir !
Car, de quoi devra nécessairement être fait le futur de la lutte de classe pour parvenir à renverser le capitalisme par une révolution mondiale ? Avec le développement de la combativité, de la conscience, des minorités révolutionnaires, nos réunions devront rassembler de plus en plus de monde, en provenance de plus en plus de pays. Aujourd’hui, se rassembler à plusieurs dizaines de participants, en trois langues, n’est qu’un avant-goût de ce que nous devrons organiser dans l’avenir. Tant sur le plan technique que dans la gestion des débats, tous les participants doivent accumuler de l’expérience pour que les minorités révolutionnaires, à l’échelle internationale, soient à la hauteur de leurs responsabilités dans la classe et pour la classe.
Une telle activité militante doit tous nous enthousiasmer ! Alors, à la prochaine !
CCI, 8 décembre 2024
1Pour des raisons de sécurité, nous avons modifié les pays désignés dans le courrier du camarade. Les révolutionnaires font d’ores et déjà face à une répression féroce dans de nombreuses régions du monde.
2 Le camarade Blake parle dans sa lettre d’un débat fait surtout de questions des participants et de réponses du CCI, affirmant que cela donne une impression de rapport « maître/élèves ». Le peu d’interventions du CCI (seulement trois en trois heures, rappelons-le) et la dynamique de la discussion où chaque intervenant a répondu aux autres, affirmé ses accords et désaccords, nous semble démentir cette impression. Mais il y a une autre question sous-jacente : les réunions des organisations révolutionnaires ne sont pas un moment où chacun doit avoir « son » intervention, « son » expression libre. Non, ces débats visent la clarification, la confrontation des positions, dans le but de participer au développement de la conscience vers la révolution. Les groupes révolutionnaires ont donc à y défendre leur position, leur clarté, leur cohérence.
Vie du CCI:
- Réunions publiques [219]
- Courrier des lecteurs [252]
Rubrique:
Cyclone Chido à Mayotte: Le capitalisme nous mène à la catastrophe
- 87 lectures
Le 14 décembre 2024, Mayotte a été le sujet d’un désastre d’une ampleur inimaginable. Le cyclone Chido a été un des événements les plus destructeurs qu’ait connu l’île. Ce dernier a provoqué plus de 30 morts, des milliers de blessés, et a détruit une grosse partie des infrastructures et des logements, en particulier les bidonvilles, laissant des centaines de milliers de personnes sans abris. Les camps de réfugiés font face à des crises sanitaires terribles. Les habitants doivent faire face à des pénuries d’eau, les réseaux de distribution ayant été endommagés, et de nourriture, tandis que l’approvisionnement promis par l’État peine à arriver. Le seul hôpital de l’île a été fortement endommagé, empêchant la prise en charge de très nombreuses personnes dans le besoin. Tout cela a favorisé l’exacerbation des tensions sociales déjà très fortes et qui menacent d’exploser.
Face à la situation, la bourgeoisie fait preuve d’un cynisme absolu. Loin d’assumer les conséquences de ses propres politiques, elle cherche à rejeter la faute sur les plus précaires. L’ensemble de la bourgeoisie insiste sur la « nécessité de régler le problème migratoire à Mayotte », prétendant que les dégâts liés au cyclone seraient la faute des immigrés construisant illégalement des bidonvilles. En réalité, la situation est connue depuis bien longtemps. De nombreux rapports et études font état de la vulnérabilité de la population, de la précarité généralisée et du chômage de masse, de l’importance de l’économie informelle, des conditions de vie très rudes, et de l’accès difficile aux ressources. D’autant plus pour les migrants vivant dans des conditions d’autant plus précaires, dans des bidonvilles, sur des terrains à risque, et dont l’accès aux ressources et aux soins est difficile. Les infrastructures manquent d’investissement et sont incapables de supporter la rapide croissance de la population. Malgré cela, la bourgeoisie n’a rien fait pour préparer à l’éventualité d’une catastrophe naturelle. Il n’y a pas de plan d’urgence, peu de sensibilisation auprès de la population, et les infrastructures ne sont pas construites de sorte à résister aux aléas climatiques. Il est donc peu étonnant que cette catastrophe ait pris une telle ampleur.
Mais l’État se fiche bien des victimes de ce cyclone. Pour la bourgeoisie française, Mayotte est, comme la Nouvelle-Calédonie, avant tout une position stratégique. Située au carrefour de grandes routes commerciales mondiales, Mayotte permet à la France d’assurer le contrôle du Canal du Mozambique, une des principales routes maritimes mondiales, et par lequel circule pétrole, gaz, et autres marchandises entre l’Asie, l’Afrique, et l’Europe. Le contrôle de cette zone fournit aussi à la France une excellente position diplomatique avec les États voisins, notamment Madagascar, et lui permet d’assurer une forte influence dans l’Océan Indien, surtout depuis que la concurrence pour l’influence dans cette région devient plus difficile avec la présence croissante de la Chine et de l’Inde. C’est pour cette raison que la France dépense sans compter des fortunes pour garder une base militaire là-bas. Quitte à devoir traîner un « boulet social » dont elle ne s’occupe de toute façon pas.
Cette tragédie illustre la barbarie dans laquelle s’enlise le mode de production capitaliste. La sévérité de la crise qui touche Mayotte et l’enchevêtrement des facteurs qui lui ont donné cette intensité sont symptomatiques de la profonde décomposition dans laquelle le capitalisme se trouve. Le dérèglement climatique, la misère de la population et les conditions de vie indécentes, le délabrement des services publics, ne peuvent qu’amplifier ces catastrophes. Et face à elles, la reconstruction n’en sera que plus longue et anarchique, aggravant d’autant plus la situation. L’État aura bien du mal à mobiliser un budget, des lois et des entreprises, pour une reconstruction qui sera de toute façon limitée, probablement bien plus coûteuse et plus longue que prévue. La situation est relativement similaire à celle de la reconstruction d’Haïti où la timide mobilisation de moyens après le tremblement de terre de 2010 n’a pas empêché de faire sombrer le pays dans le chaos La pauvreté endémique et les tensions sociales ont fortement influencé la montée des gangs et de la violence. Si la situation à Mayotte n’est pas aussi apocalyptique, elle demeure néanmoins très difficile et il faut tout de même s’attendre à une forte montée de la violence de la part de petits groupes.
Tout cela illustre la réalité d’un « effet tourbillon » dans lequel chaque facteur de la décomposition alimente, accélère, et amplifie les autres. On ne saurait prendre cet événement pour lui-même quand déjà en novembre 2024, des inondations à Valence ont causé d’énormes dégâts matériels et pertes humaines. L’enchaînement de ces tragédies exceptionnelles montre une forte tendance à la perte de contrôle de la bourgeoisie, qui est de moins en moins apte à faire face et à anticiper les problèmes générés par les ondes de chocs provoqués par son mode de production putréfié.
Les conditions qui ont donné lieu à ces tragédies continuent de s’amplifier sous l’effet de la crise, et on peut observer que ce qui tenait hier de l’exceptionnel, se normalise aujourd’hui, avec des effets qui seront encore plus désastreux demain tant que perdurera le système capitaliste.
Cam., 28 décembre 2024
Situations territoriales:
- France [508]
Récent et en cours:
- Mayotte [610]
- Catastrophes [957]
Rubrique:
ICConline - 2025
- 95 lectures
Ça suffit ! Face aux attaques, développons un mouvement massif, uni et solidaire
| Fichier attaché | Taille |
|---|---|
| 303.66 Ko |
- 161 lectures
Les cartes sont sur la table : les gouvernements fédéral et régionaux veulent imposer des dizaines de milliards d’économies chacun dans le cadre de leurs compétences respectives afin de rendre l’économie belge plus compétitive et plus rentable. Tous les secteurs de la classe ouvrière seront fortement touchés par ce large programme d’austérité.
Alors que les travailleurs des entreprises privées sont licenciés en masse, l’indexation automatique des salaires et des allocations continue d’être contestée, les primes pour les heures supplémentaires et le travail de nuit diminuées, la flexibilité du travail augmentée, le droit aux allocations de chômage restreint, des coupes sombres opérées dans les pensions et l’assurance maladie, le nombre total de fonctionnaires réduit, la titularisation du personnel enseignant mise en péril, etc.
Et ce alors que les conditions de travail deviennent partout de plus en plus insupportables : sous-emploi, accélération des cadences, effacement de la frontière entre vie professionnelle et vie privée, augmentation des prix due à l’inflation, réduction de toutes sortes de subventions, catastrophes environnementales croissantes, dépression, burn-out. Ça suffit !
Refusons de payer pour la crise du capitalisme
Le gouvernement affirme qu’il n’y a pas le choix. Dans la logique de chaque classe dirigeante en effet, il faut accroître la compétitivité pour faire face à la baisse de la croissance économique et à la guerre commerciale accentuées par les politiques économiques protectionnistes de Trump, mais aussi par le coût croissant des dépenses militaires liées aux tensions et guerres impérialistes. Dans tous les pays, les classes dirigeantes tentent de répercuter sur les travailleurs les conséquences de “leur” crise de surproduction, c’est-à-dire des biens qu’ils ne peuvent plus vendre avec un profit suffisant sur les marchés disponibles. Le travail doit coûter moins cher. Une fois de plus, ce qui est au centre des préoccupations n’est pas le bien-être ou les besoins des travailleurs , mais la vente rentable de biens et de services. Refusons cette logique délétère et suicidaire de la bourgeoisie.
Nous ne sommes pas seul à réagir ! En 2022-23, en Grande-Bretagne, des dizaines de milliers de travailleurs d’entreprises de secteurs différents, ont développé leurs luttes pendant près d’un an. En 2023, en France, les travailleurs ont participé en masse à 14 “journées d’action” contre les attaques sur les retraites du gouvernement. En Belgique même, dès les premières « fuites » concernant les mesures envisagées, la force et le dynamisme des mobilisations lors de la manif intersectorielle du 13 janvier ou de la manif des enseignants du 27 janvier se sont concrétisés par une participation massive de plus de 30.000 manifestants, bien plus que ce qui était “attendu” ou plutôt “espéré” par les syndicats. Des manifestants se sont rassemblés à Bruxelles en provenance de toutes les régions et le mouvement s’est étendu à d’autres secteurs que l’éducation et le rail, au mépris de l’intention initiale des syndicats. La mobilisation a ainsi montré que le mécontentement va au-delà d’une mesure particulière ou d’une “réforme” spécifique : elle exprime la volonté de résister aux intentions du patronat et du gouvernement de faire payer la classe ouvrière pour la crise.
Ça suffit ! Refusons de subir passivement cette avalanche d’attaques contre nos conditions de vie. Notre première victoire, c’est la lutte elle-même. Mais pour contrer véritablement ces attaques, nous devons mener la bataille le plus largement possible de manière unitaire, au delà de l’entreprise, du secteur ou de la région dans lesquels nous travaillons. Tous les travailleurs sont “dans le même bateau. Tous ces groupes ne sont pas des mouvements séparés mais un groupe collectif : ouvriers et employés, syndiqués et non-syndiqués, immigrés et autochtones”, comme l’a dit un enseignant en grève à Los Angeles en mars 2023.
Notre force réside dans l’unification des luttes dans un seul et même mouvement
Contre toute manœuvre et division
La bourgeoisie n’a que trop bien compris que ses plans provoqueraient des réactions dans de larges parties de la classe. C’est principalement aux syndicats qu’il incombe d’encadrer et de détourner cette résistance attendue. Ils ont vu l’inquiétude et le mécontentement des travailleurs grandir de semaine en semaine et occupent préventivement le terrain afin d’empêcher le mécontentement de se manifester par des actions “incontrôlées”.
Des tactiques éprouvées sont à nouveau utilisées : isoler et diviser les différents secteurs alors que les mesures touchent tout le monde ! Une manifestation uniquement pour le personnel de la santé et de l’aide sociale en novembre; puis le 13 décembre une journée d’action en protestation contre les “mesures d’austérités Européennes”. Pour la journée d’action du 13 janvier, seule une grève contre la “réforme des pensions” a été annoncée dans les chemins de fer. Ce n’est que bien plus tard, sous la pression sociale, que les syndicats ont décidé que l’enseignement y participerait également et plus tard, d’autres secteurs, s’y sont joints. En Wallonie, les syndicats ont organisé de leur côté des journées de grève séparées pour les enseignants de la communauté française les 27 et 28 janvier, évitant ainsi une participation massive de leur part à Bruxelles le 13 janvier. La manifestation du 13 février porte pour sa part sur la “défense du service public”, comme si les travailleurs du secteur privé ou les chômeurs ne devaient pas être défendus ! Bref, l’objectif est de planifier une série de journées d’action sans avenir, comme ils l’ont fait en France, ou en essayant à chaque fois de limiter les mobilisations en les concentrant sur certains secteurs, comme ils l’ont fait en Grande-Bretagne, ou sur des aspects particuliers des plans d’austérité, pour finalement épuiser la volonté de se battre et ouvrir la voie à des concessions de grande envergure envers les mesures d’austérité sous l’argumentation fallacieuse « que les sacrifices sont inévitables, à condition qu’ils soient justement répartis ».
Pour éviter les pièges tendus par les syndicats, ces saboteurs des luttes au service des classes dirigeantes et pour développer la riposte, être nombreux est important mais ne suffit pas : il faut aussi prendre nos luttes en main. Pour ce faire, il faut:
- créer des lieux de discussions et de décisions, tels que des assemblées générales souveraines et ouvertes à tous et s’unir derrière des revendications unificatrices;
- surmonter les divisions régionales, celles entre les travailleurs du secteur public et ceux du secteur privé et les chômeurs;
- contrer chaque tendance au saucissonnage des luttes, en envoyant des délégations massives vers d’autres travailleurs pour qu’ils rejoignent la lutte ;
- refuser de payer pour la crise et les guerres du capitalisme.
C’est cette dynamique de solidarité, d’expansion et d’unité qui a toujours ébranlé la bourgeoisie au cours de l’histoire.
Courant Communiste International
10.02.2025
Venez en discuter lors la réunion publique le samedi 1er mars à Bruxelles: rue du Fort 35, 1060 Saint-Gilles de 14h à 18h
Vie du CCI:
- Interventions [492]
Situations territoriales:
Récent et en cours:
- Belgique [960]
- Coupes budgétaires 2025 [961]
- Plans d'épargnes 2025 [962]
- Gouvernement De Wever I [963]
Rubrique:
ICConline - janvier 2025
- 43 lectures
L’élection de Trump va accélérer la décomposition du capitalisme
- 248 lectures
Samedi 25 janvier, de 15h à 18h (heure française)
L’élection de Trump est un produit clair de la décomposition progressive de la société capitaliste, mais elle sera également un facteur actif de l’accélération de ce processus, apportant avec elle des conflits plus aigus au sein de la bourgeoisie américaine, des tensions impérialistes accrues, un nouveau plongeon dans la crise économique et une nouvelle preuve de l’incapacité du capitalisme à faire face à la crise environnementale.
Par-dessus tout, elle annonce de nouvelles attaques brutales contre la classe ouvrière internationale :
-
au niveau économique, par la montée de l’inflation et du chômage
-
Au niveau politique, à la fois par les divisions engendrées par le populisme et par les campagnes pour la « démocratie » contre la menace de l’extrême droite.
La discussion visera donc à approfondir la compréhension des perspectives concrètes pour le capitalisme et la classe ouvrière dans la période à venir.
Le CCI donne ainsi suite à la réunion publique internationale en ligne qu’elle a organisée en novembre (voir : « Un débat international pour comprendre la situation mondiale et préparer l’avenir [956] ») avec une deuxième réunion sur la signification de la victoire de Trump. Le format sera le même que celui de la réunion d’octobre, avec des traductions en anglais, français et espagnol.
Si vous souhaitez participer, écrivez-nous à [email protected] [911]
Des rassemblements physiques sont également prévus à :
- Paris au CICP, 21ter rue Voltaire (métro « rue des boulets »)
- Lyon (Villeurbanne), au CCO La Rayonne, Salle les jeunes ouvrières, 28 rue Alfred de Musset, (Métro A. Arrêt Vaulx-en-Velin la Soie)
- Marseille, local Mille Bâbords, 61 Rue Consolat (métro « Réformés »)
- Nantes, Salle des Hauts Pavés (salle C), 42 rue des Hauts Pavés (Accès par le tramway : ligne 3, direction Marcel Paul, arrêt Viarme-Talensac)
Vie du CCI:
- Réunions publiques [219]
Personnages:
- Donald Trump [896]
Rubrique:
Ni populisme, ni démocratie bourgeoise … La seule véritable alternative c’est le développement mondial de la lutte de classe contre toutes les fractions de la bourgeoisie
- 215 lectures
Trump est de retour à la tête de l’Etat américain, quatre ans après sa défaite électorale face à Biden. Cela représente un échec cuisant pour la bourgeoisie américaine qui intervient malgré tous les efforts déployés depuis 2020 par une partie de celle-ci pour isoler Trump et son camp, avec l’implication de l’administration Biden, du parti démocrate, d’une partie du parti républicain, d’une partie de l’intelligentsia américaine. En fait, la récente victoire électorale contre Harris, encore plus nette que la précédente contre H. Clinton en 2016, n’a rien de fortuit mais est typiquement le produit de la décomposition de la société capitaliste, dont le Trumpisme est un rejeton. Trump ayant déjà clairement démontré son pouvoir de nuisance à la tête de l’Etat lors de son premier mandat et son irresponsabilité délirante lors de l’assaut du capitole qu’il a encouragé face à l’élection de Biden, tout cela illustre l’impasse dans laquelle se trouvent le capitalisme américain et sa bourgeoisie, incapables de juguler, durant les 4 ans du mandat de Biden, l’emprise du populisme. Si bien que celle-ci s’est encore accrue, avec pour effet un Trump2 encore plus délirant que Trump1.
Le programme du populisme, une abomination et une aberration sociale et économique
Le programme de Trump exprime une radicalisation aberrante du populisme, notamment à travers ses promesses électorales les plus délirantes du point de vue même de la gestion du capital national : Expulsion par l’armée de millions d’émigrants illégaux ; licenciement de centaines de milliers de fonctionnaires, dont en particulier ceux qui, dans l’accomplissement de leur fonction, avaient été amenés à se positionner contre Trump, notamment pour son rôle dans l’assaut du Capitole suite à l’élection de Biden.
Pour renouveler l’administration, Trump procède à une sélection des candidats aux postes clés à la tête des ministères et agences stratégiques au moyen de deux critères déterminants mais ne prenant pas en compte la compétence des candidats : «être un fidèle de Trump» et «s’engager dans l’offensive contre l’État fédéral». Parmi les propositions de Trump, la plus stratégique -puisque concernant la tête du Pentagone- et emblématique de la «rupture radicale» promise lors de sa campagne électorale, figure un ancien militaire (Pete Hegseth, très loin de faire l’unanimité dans le camp républicain) et présentateur de Fox News qui, de surcroît, fait l’objet d’accusations d’agression sexuelle et de consommation excessive d’alcool. Cette méthode qui garantit la plus grande incompétence aux postes stratégiques pour la défense des intérêts du capital américain est un très bon indicateur de là vers où Trump2 emmène l’Amérique.
Une fois encore se trouve vérifié ce fait que la politique des populistes, lorsqu’elle n’est pas encadrée à la tête de l’État par d’autres fractions de la bourgeoisie, plus responsables dans la gestion du capital national, s’est toujours avérée préjudiciable aux intérêts de celui-ci. C’est ce qu’avait illustré, par exemple, la gestion désastreuse de la crise du Covid par Trump aux États-Unis, par Bolsonaro au Brésil. Et que peut-il sortir du Tandem Trump/Musk au sommet de l’État américain? Tous deux partagent sans nul doute les valeurs les plus immondes du populisme, de même qu’ils sont profondément en accord sur un certain nombre de questions comme le besoin d’opérer une purge profonde dans l’administration mais tous deux se montrent indifférents aux graves dysfonctionnements de l’appareil d’État pouvant en résulter. De surcroît, derrière leur accord, il existe des motivations différentes qui constitueront tôt au tard un facteur de rivalités et de fragilité au sommet de l’État : Trump voulant délibérément se venger d’institutions qui lui ont été hostiles, Musk voulant, quant à lui, améliorer la rentabilité du capital américain à travers un dégraissage de l’administration. Ce même désaccord existe également à propos de l’immigration légale que Trump veut bloquer totalement, contrairement à Musk qui veut faire une exception pour les ingénieurs étrangers.
Les conséquences mondiales de la politique de Trump au pouvoir
Elles sont prévisibles de la direction qu’elles vont prendre, car annoncées dans sa campagne électorale. Elles sont imprévisibles quant aux décisions finales.
Ce qui aurait pu paraître inconcevable à toute autre époque et à tout autre endroit du globe, à l’exception toutefois de quelques républiques bananières, s’est produit dans la première puissance mondiale, quelque temps avant la deuxième investiture de Trump. Le futur nouveau président s’est mis à rêver à haute voix d’une étoile supplémentaire sur le drapeau américain, correspondant de fait à l’annexion du Canada voisin! Même si ce n’est qu’un « trait d’humour populiste», celui-ci prend toutefois une tout autre coloration lorsque Trump menace également de récupérer le canal de Panama (cédé au Panama par Carter en 1979) par la force si nécessaire au prétexte que la Chine exerce une influence croissante sur cette voie maritime cruciale. Idem pour le Groenland (appartenant au Danemark) que Trump envisage d’annexer car nécessaire à sa sécurité. Personne ne peut dire si cela sera ou non suivi d’effet, toujours est-il que cela a certainement soulevé un vent de panique dans les chancelleries. De même certaines d’entre elles auront certainement été saisies d’un certain effroi face au harcèlement par Musk du premier ministre britannique Keir Starmer, l’accusant notamment de complicité avec les réseaux pédocriminels.
Une nouvelle crise migratoire ?
Si Trump parvient à mettre à exécution l’expulsion par l’armée des centaines de milliers d’émigrants illégaux sur le territoire américain, le risque est grand de provoquer une nouvelle crise migratoire, à l’image de ces populations dans d’autres parties du monde qui, par centaines de mille, fuient la guerre. L’arrivée «forcée» de ces masses de déportés dans les pays d’Amérique latine les condamnera à croupir dans une misère noire -qu’une partie d’entre eux avait tenté de fuir-, vulnérables aux persécutions et au chantage de la police, des gangs, ... et constituera un risque de déstabilisation des pays de destination, etc.
Une impulsion supplémentaire à la crise économique
Le monde est face à la perspective d’un développement historique de la récession économique mondiale, d’une gravité au moins équivalente à celle des années 1930. Ni Trump ni aucun autre représentant de la bourgeoisie n’en est responsable en tant que tel, ce sont les contradictions insurmontables du mode de production capitaliste qui sont à l’œuvre. Mais loin de différer ou atténuer les effets de la crise, la poursuite et l’amplification des doctrines « America First » et «Make America Great Again» ne font que les précipiter, notamment à travers un ensemble de mesures déjà prises par l’administration Biden visant au démantèlement tous les organismes internationaux chargés de soutenir le commerce mondial. Plus globalement, l’objet de la politique des États-Unis est la concentration sur son territoire des capitaux et des industries modernes du monde entier, au détriment du reste du monde dont une partie croissante est appelée à ressembler de plus en plus à une friche industrielle. Une telle politique n’est pas propre à une administration populiste, mais ce qui distingue cette dernière c’est la violence irrationnelle des mesures protectionnistes. Les principales puissances économiques mondiales en Europe et Asie sont bien conscientes de cette situation et se préparent à s’organiser du mieux qu’elles le peuvent pour faire face à une nouvelle étape de la guerre commerciale annoncée par Trump. Quoi qu’il en soit, il faut s’attendre aux conséquences de la guerre commerciale et de la crise, dont le solde se traduira immanquablement par une attaque considérable des conditions de vie de la classe ouvrière et un appauvrissement de la population en général.
Un atout supplémentaire en faveur … de l’aggravation de la crise climatique
On peut mesurer l’implication de Trump à l’égard du changement climatique à travers sa récente prise de position sur les incendies à Los Angeles, attribuant publiquement la responsabilité de ceux-ci au gouverneur de cet État. Cette manière éhontée d’éviter le fond du problème laisse présager du pire quant à l’impact futur sur le climat de la seconde présidence Trump.
L’aggravation des tensions impérialistes
Depuis l’effondrement du bloc de l’Est, les États-Unis, le gendarme du monde s’est avéré constituer le pays le plus gros fauteur de chaos au monde. Il n’y a pas de raison que cela change, vu que c’est une condition du maintien de leur leadership mondial. Les deux principaux foyers de guerre actuels au monde, en Ukraine et au Moyen Orient, vont constituer des illustrations de la défense des intérêts impérialistes de l’Amérique de Trump.
En Ukraine
La guerre en Ukraine a pour contexte la poursuite de l’ancienne politique d’encerclement de la Russie dont l’OTAN était le fer de lance. Elle est une réponse de la Russie aux efforts de l’impérialisme américain pour faire entrer la Géorgie et l’Ukraine dans l’OTAN. Biden ayant assuré que les États-Unis n’interviendraient pas face à une invasion de ce pays par la Russie, celle-ci tomba dans le piège et la guerre en Ukraine a effectivement abouti, après trois ans de massacres et de barbarie, à ce qui était souhaité par l’impérialisme américain, à savoir l’épuisement militaire et économique de la Russie en vue de priver la Chine d’un éventuel allié doté d’un puissant arsenal nucléaire dans une confrontation future avec les Etats-Unis. Mais aujourd’hui l’Ukraine se trouve dans une situation qui, sur le terrain, n’est pas meilleure, voire pire, que celle de la Russie et qui ne pourra que se dégrader d’autant plus rapidement que le soutien des États-Unis, à travers la fourniture de matériel militaire, est appelé à disparaître, Trump ayant toujours été en désaccord avec un tel soutien. Par ailleurs, ce dernier n’a cessé de fanfaronner que, s’il était élu, il «mettrait un terme en deux jours au conflit» sous-entendu en construisant un accord avec les deux parties. Cela parait aujourd’hui très peu probable. Si l’Ukraine s’effondre et que la Russie chancelle l’Union Européenne ne va-t-elle pas être amenée à intervenir pour figer une situation de statut quo en protégeant une Ukraine agonisante vulnérable à un baroud d’honneur de la Russie ? Et comment? Avec quels pays et moyens? C’est l’inconnu et aucune issue ne peut être exclue.
Dans cette optique et aussi face à la très probable réitération par Trump pour imposer à l’Union Européenne de prendre en charge le coût de sa propre défense, en augmentant sa contribution à l’OTAN et les budgets militaires de tous ses pays membres, ceux-ci n’auront pas de choix autre que de s’incliner.
La situation au Moyen Orient offre plus de visibilité. Il est en effet très vraisemblable que Trump poursuivra la politique de soutien inconditionnel aux menées impérialistes d’Israël ; il est même possible qu’il encouragera ouvertement certaines d’entre elles, notamment celles visant à l’anéantissement de la puissance militaire de l’Iran.
Les tensions avec la Chine ne peuvent que s’accentuer, ce pays étant le plus à même de menacer le leadership mondial des États-Unis. Ces derniers vont continuer de faire tout ce qui est en leur pouvoir pour affaiblir la Chine en maintenant sur elle une pression militaire croissante, en entravant son commerce avec les autres pays industrialisés.
Face aux attaques de la bourgeoisie, face à la guerre, face aux fausses alternatives populisme/anti-populisme, fascisme/anti-fascisme, un seul choix, celui de la lutte de classe.
Produit de la décomposition du mode production capitaliste, le populisme constitue en retour un facteur aggravant de celle-ci. Ainsi, la situation mondiale va évoluer vers une aggravation de la décomposition du capitalisme, vers encore plus de chaos, plus de guerres, vers une aggravation drastique des conditions de vie de la classe ouvrière comme conséquence de la crise et de la guerre. Les attaques contre les conditions de vie de la classe ouvrière favorisent les luttes défensives ouvrant la possibilité d’une riposte de plus en plus unie et consciente. Néanmoins les conditions dans lesquelles cette lutte va se développer présentent des dangers mortels que la classe ouvrière doit éviter :
- Le contexte même de la décomposition –en particulier avec le chacun pour soi et l’absence de perspectives- est un obstacle au développement d’une pratique et d’un projet uni et conscient ;
- C’est en permanence que la classe ouvrière sera appelée par les différentes fractions de la bourgeoisie à se positionner en faveur de la démocratie contre le populisme, comme elle a pu l’être dans le passé à soutenir le camp de la démocratie contre celui du fascisme.
La classe ouvrière aurait tout à perdre à succomber au champ du désespoir, du «no futur», …. : Le seul terrain de lutte qui lui est propre et porteur d’avenir c’est celui la défense de ses intérêts économiques de classe en riposte aux attaques du capitalisme en crise, propice à la politisation de ses luttes et donc porteur de la perspective de renversement du capitalisme.
Sylunken (10/01/2025)
Rubrique:
Hommage du CCI au camarade Jean Jacques
- 154 lectures
Dans son numéro 554 du Prolétaire, le PCI rend un hommage au camarade Jean Jacques décédé le 4 juin 2024. Dans son article, le PCI rappelle que Jean Jacques a été un sympathisant du CCI après avoir rompu avec la LCR avec laquelle il avait des désaccords. Convaincu que le communisme est la seule perspective pour l’humanité, se questionnant sur l’effondrement du stalinisme en 1989, il est alors entré en contact avec le CCI dont les positions étaient une réponse à ses questions sur la nature de l’URSS et pour la défense de la perspective révolutionnaire, rompant ainsi avec l’idéologie trotskiste de la défense « critique » de ce régime de terreur contre la classe ouvrière.
Fin des années 1990 début des années 2000, il avait été un animateur d’un cercle de discussion qui réunissait des éléments sur Toulouse et Marseille. L’objectif de ce cercle était de discuter de l’histoire du mouvement ouvrier, acquérir les bases du marxisme et de s’ouvrir aux organisations révolutionnaires, le CCI et le PCI. Sa participation aux réunions des organisations du prolétariat était toujours très dynamique, n’hésitant pas à développer son point de vue, ses accords et désaccords. C’est lors d’une réunion publique du PCI qui se tenait à Aix en Provence que le camarade s’est davantage rapproché des positions bordiguistes, plus particulièrement sur la question du parti. Il n’hésitait pas à les défendre dans les réunions publiques du CCI auxquelles il assistait de manière régulière. Les débats se faisaient dans une ambiance de fraternité, sans sectarisme, il était ouvert à la confrontation des arguments. Dans les manifestations à Marseille, dans des réunions politiques, dans les Assemblées Générales ouvrières comme dernièrement lors des manifestations massives contre la réforme des retraites en 2023, la Gauche communiste était présente. Le CCI et le PCI diffusaient les tracts et, malgré les désaccords entre les deux organisations, en particulier sur la question syndicale, il y avait de part et d’autre, le même souci, que la classe prenne ses luttes en main, il arrivait souvent que Jean Jacques et le militant du CCI sur place discutaient sur les orientations de la lutte.
Militant infatigable, connu du milieu politique local, l’absence de Jean Jacques dans les réunions politiques et notamment celles du CCI, a suscité une inquiétude. C’était un camarade discret sur sa vie personnelle, nous savions qu’il avait des problèmes de santé, mais il affirmait tellement sa présence qu’on pensait qu’il était « indestructible ». C’est avec tristesse que nous apprenons son décès. Jean Jacques nous manquera et il manque déjà pour la Gauche communiste !
Adieu camarade, nous poursuivons le combat auquel tu as participé durant une grande partie de ta vie.
CCI
Vie du CCI:
- Hommage aux militants [964]
Rubrique:
Même mort, Le Pen continue de nourrir le piège de l’anti-fascisme
- 99 lectures
Jean-Marie Le Pen aura incontestablement connu un destin hors du commun. C’est à la fac de droit, juste après la guerre, que cet individu a fait ses débuts en politique dans des opérations coups de poing tabassant à la fois les forces de police et les étudiants « communistes ». Après ces épisodes peu reluisants de petite frappe, menant son bonhomme de chemin, il intègre l’Union et fraternité française de Poujade ; c’est sous cette étiquette qu’il devient, à 27 ans, le plus jeune député d’alors.
La vie de parlementaire ne lui convient pas et c’est dans le déroulement de la guerre d’Algérie qu’il va pouvoir activement défendre son obsession : maintenir « l’Algérie française ». Il défendra jusqu’à la fin de sa vie l’usage de la torture et mettra au profit des services spéciaux coloniaux son savoir-faire où, notamment au service du général Massu, il se livrera avec zèle à des assassinats.
Fondé en 1972, avec un ramassis d’anciens du groupe d’ultra-droite, Ordre nouveau, le Front national rassemble divers courants de l’extrême droite (parmi lesquels d’anciens poujadistes, un ancien SS et un ancien de l’OAS) (1) qui désirent conquérir les foules et s’offrir une vitrine présentable. Cependant, les résultats ne sont pas au rendez-vous. S’ensuivra une longue période jugée « difficile » pour ce barbouze devenu gênant et dont l’extrême-droite voulait faire une marionnette juste utile à intervenir dans les médias au moment des scrutins. Sauf que dans les médias, il n’est pas franchement accueilli à bras ouverts.
Il faudra attendre l’arrivée de Mitterrand au pouvoir, qui, par opportunisme, va obliger les grandes chaînes de télévision à le recevoir en interview, pensant ainsi affaiblir le parti de droite et, au passage, faire diversion sur son propre passé à l’extrême droite et ses fonctions de ministre de la Justice durant la guerre d’Algérie. En polarisant sur le FN, la gauche utilisait cet l’épouvantail pour tenter de dédouaner ses attaques croissantes contre le prolétariat, notamment avec « le tournant de la rigueur » à partir de 1983. Mitterrand espérait surtout utiliser la montée en puissance soigneusement organisée de l’extrême droite pour détourner la classe ouvrière, alors particulièrement combative, de son terrain de lutte en la poussant dans les bras de la « défense de la démocratie » et des partis de gauche face au prétendu « danger fasciste ». Main dans la main avec le FN, avec qui le PS organisa alors de nombreuses « réunions de travail », Mitterrand va ainsi « créer » l’homme politique Le Pen qu’il pense pouvoir utiliser pour ses propres dessins. Et dans un premier temps, la tactique va fonctionner : le FN et ses obsessions racistes sortent de l’anonymat et deviennent le centre de gravité du débat politique. Le Pen déployait des trésors de propos nauséabonds et provocateurs : les chambres à gaz ? « un détail de l’histoire de la Seconde Guerre mondiale ». Quelques mois plus tard, c’est le ministre Durafour qui est rebaptisé en « Durafour-crématoire ». La mise en place de la proportionnelle aux législatives de 1986 va installer 35 députés frontistes à l’Assemblée nationale.
Tout en favorisant sa montée en puissance, la gauche ne va cesser d’utiliser Le Pen et ses outrances pour impulser des campagnes idéologiques visant à embrigader la jeunesse dans des luttes anti-racistes et pousser tout le prolétariat vers les urnes. Ce n’est pas un hasard : la classe ouvrière était, depuis Mai 68, particulièrement combative, développait ses luttes, nourrissait sa réflexion sur le système capitaliste et sa concurrence de tous contre tous, son nationalisme et ses avatars ouvertement racistes. La bourgeoisie et ses partis de gauche ont utilisé le FN pour tenter de couper le prolétariat de son terrain de classe, de sa perspective révolutionnaire. Bref, de le réduire à l’impuissance sur un terrain totalement piégeux, celui des élections. C’est ainsi que parallèlement à la montée du FN, la gauche initiera, là encore avec l’assentiment de Mitterrand, le mouvement « SOS racisme » et toute sorte de groupes « anti-fa ». Tout cela, au nom de la défense de la « démocratie française »… qui a pourtant depuis longtemps et à de nombreuses occasions fait la preuve de la pire xénophobie.
Ces campagnes vont culminer dans les gigantesques manifestations de 2002 lorsque Le Pen réussit à se qualifier au second tour de l’élection présidentielle. Cet événement traduisait déjà une certaine perte de contrôle de la bourgeoisie sur son appareil politique, qui ne va cesser de se confirmer les décennies suivantes avec l’ascension de la fille, Marine. Le « monstre », nourri des pires miasmes de la décomposition, commençait à échapper à tout contrôle. Mais ce fut aussi pour le reste de la bourgeoisie, droite et gauche confondus, une formidable occasion pour refourguer sa camelote « démocratique », alors que l’abstention battait des records. Entre la diabolisation du FN et les campagnes de culpabilisation, la bourgeoisie a martelé ses mensonges sur la démocratie et l’unité nationale.
Au moment de sa mort, alors qu’une large partie de la bourgeoise et de ses médias colportent désormais sans vergogne une large partie de son programme politique et ses idées les plus immondes, la gauche s’est une dernière fois servi du « diable » Le Pen pour alimenter ses campagnes « antifascistes ». Si l’héritière est désormais aux portes du pouvoir, choisir entre l’extrême droite et un « moindre mal » reste toujours un piège destiné à désarmer la classe ouvrière.
Rosalie, 20 janvier 2025
1Organisation armée secrète, organisation terroriste d’extrême droite favorable au maintien de l’Algérie dans le giron tricolore.
Situations territoriales:
Personnages:
- Le Pen [390]
Rubrique:
ICConline - février 2025
- 21 lectures
Bayrou, Valls, Darmanin… Un nouveau gouvernement, pour un monde sans avenir!
- 102 lectures
« La France entre dans l’inconnu », titrait le journal britannique The Economist, au moment où le gouvernement Bayrou était nommé. On ne saurait mieux dire ! La bourgeoisie française se débat aujourd’hui dans une situation de plus en plus inextricable. Non contente de révéler, à des fins idéologiques, son abyssale dette et déficit budgétaire, elle se retrouve avec un nouveau gouvernement faiblard, que le Président Macron cherche déjà à entraver contre son mentor Bayrou, incapable d’impulser et d’imposer une direction claire à la politique de l’État.
L’instabilité de la vie politique de la bourgeoisie française se traduit assez simplement par le fait que l’année 2024 a vu passer quatre gouvernements différents. Au-delà des divisions de plus en plus profondes, et oppositions souvent frontales entre les diverses fractions bourgeoises, on assiste en permanence à des luttes intestines suicidaires : les dernières troupes des Républicains (LR) se sont déchirés de façon grotesque au sujet de l’alliance avec le Rassemblement national (RN). La France Insoumise (FI), tout comme les partis autour de Macron, voient s’affronter les ambitions pour 2027. Même le Parti socialiste (PS), l’une des formations les plus expérimentés et intelligentes de la bourgeoisie française, bien que contraint de maintenir le gouvernement en place en ne votant pas la censure, se divise de plus en plus en deux camps irréconciliables, entre ceux qui voudraient retourner aux affaires y compris avec les macronistes, et une fraction « de gauche » contrainte de faire alliance avec La France insoumise de Mélenchon.
Dans ce contexte, les fractions bourgeoises les plus responsables) peinent de plus en plus à endiguer la montée en puissance de forces populistes incapables d’assumer une orientation politique cohérente pour défendre au mieux les intérêts de l’État. Une partie de la bourgeoisie française semble d’ailleurs se résigner à envisager l’arrivée au pouvoir présidentiel du tandem Le Pen/Bardella, même si elle cherche, à empêcher cette issue potentiellement désastreuse pour le capital national, sans y parvenir pour l’instant. Tout cela montre l’incapacité de plus en plus grande de la bourgeoisie à maîtriser les processus électoraux et permettre une plus grande cohérence dans la conduite de l’État.
L’influence du vote populiste et l’affaiblissement des fractions « de gouvernement » de la bourgeoisie française aboutit aujourd’hui à une situation d’impasse, avec une absence de majorité parlementaire chronique. Toute alliance gouvernementale à droite mais surtout à gauche, pour le Nouveau Front populaire, ne peut aller que vers une décrédibilisation accélérée. Car face à la crise économique et politique, tout gouvernement, de droite comme de gauche, devra assurer les pires attaques contre la classe ouvrière sans assise parlementaire stable.
Une crise loin d’être française
On pourrait croire qu’on a, là, affaire à une crise spécifiquement française, une « crise de la Ve République » comme le répètent les partis de gauche. Or, dans la plupart des pays développés, le même processus se développe sous des formes parfois singulières, mais de nature similaire. L’expression la plus important et dangereuse de ce processus réside dans le retour au pouvoir de Donald Trump aux États-Unis. (1) La crise politique en Allemagne et le développement de l’AfD et du mouvement autour de Sara Wagenknecht, le poids du populisme en Angleterre, en Hongrie, en Pologne, en Italie, aux Pays-Bas notamment, sans parler de fractions en embuscade comme celles de Bolsonaro au Brésil ou de Milei en Argentine, sont aussi l’expression des difficultés de toutes les bourgeoisies à maîtriser leur propre jeu politique et à empêcher l’émergence de groupes ou leaders politiques à l’égo démesuré, centrées sur leurs petits intérêts immédiats de cliques bourgeoises. Ces factions fonctionnent généralement comme des clans, voire de plus en plus comme des gangs, dont le but est d’utiliser l’État à leurs propres fins.
Les causes de ce phénomène sont à chercher, non en soi dans le personnel politique et ses chicaneries habituelles, qui ont toujours existé, mais dans des racines politiques que nous avions mis en avant il y a déjà 35 ans : « Parmi les caractéristiques majeures de la décomposition de la société capitaliste, il faut souligner la difficulté croissante de la bourgeoisie à contrôler l’évolution de la situation sur le plan politique. À la base de ce phénomène, on trouve évidemment la perte de contrôle toujours plus grande de la classe dominante sur son appareil économique, lequel constitue l’infrastructure de la société. L’impasse historique dans laquelle se trouve enfermé le mode de production capitaliste, les échecs successifs des différentes politiques menées par la bourgeoisie, la fuite en avant permanente dans l’endettement généralisé au moyen de laquelle se survit l’économie mondiale, tous ces éléments ne peuvent que se répercuter sur un appareil politique incapable, pour sa part, d’imposer à la société, et particulièrement à la classe ouvrière, la “discipline” et l’adhésion requises pour mobiliser toutes les forces et les énergies vers la guerre mondiale, seule “réponse” historique que la bourgeoisie puisse offrir ». (2)
Ce qui se développe sous nos yeux est la conséquence de l’incapacité de plus en plus grande de la bourgeoisie de contrôler son propre système politique, économique et social.
Pourtant les institutions de la Ve République ont été conçues pour assurer une stabilité politique qui manquait à la IVe République, mais aussi à d’autres pays comme la Belgique ou l’Italie… On avait déjà vu apparaître les premières difficultés lors des « cohabitations » entre un Président obligé de composer avec une Assemblée nationale d’un autre bord politique. Mais aujourd’hui, c’est bien autre chose : la bourgeoisie française, l’une des plus anciennes et expérimentées au monde, a d’immenses difficultés pour assurer le fonctionnement normal de l’État. La France a obtenu aux forceps le budget pour l’année 2025 et avait dû reconduire en catastrophe celui de 2024. Cette difficulté illustre certaines faiblesses qui ne peuvent qu’avoir un impact important sur l’Europe entière du fait du rôle moteur de la France sur le continent.
La mystification démocratiste bat son plein
En votant la censure du précédent gouvernement Barnier, la Gauche a poursuivi sa sale besogne idéologique contre la classe ouvrière, en mettant en avant toutes les mystifications démocratiques : de la dénonciation dénonçant l’article 49.3 de la Constitution (que le PS n’a pourtant jamais hésité à utiliser sous Mitterrand ou Hollande), à l’appel appelant à la démission de Macron, en passant par la proposition d’une VIe République, ou la revendication par LFI d’une meilleure « redistribution sociale » à travers une augmentation des impôts. Toutes les tromperies possibles autour du système électoral y sont passées ! La stratégie et le partage du travail sont clairs, même s’ils tendent à s’user : une partie de la Gauche va se présenter comme « responsable », capable de gérer l’État, tandis qu’une autre partie va jouer la radicalité pour mieux tromper la classe ouvrière, face au mécontentement ouvrier énorme qui s’annonce suite aux attaques en cours et à venir.
Des licenciements comme s’il en pleuvait…
La crise politique actuelle s’accompagne d’une vague de licenciements comme le pays n’en a pas connu depuis longtemps : au moins 180 plans de licenciements recensés entre septembre 2023 et octobre 2024 par les syndicats, et il n’y a aucune raison que cela s’arrête. Cela comme un peu partout en Europe et dans le monde.
Dans trois académies de l’Éducation nationale, les contrats de dizaines de contractuels n’ont pas été renouvelés en décembre pour « raisons budgétaires », contraignant le ministère à intervenir. La chaîne de télévision Canal+ a annoncé 250 licenciements. La Fonderie de Bretagne qui fournissait Renault va fermer définitivement. Michelin, Auchan, Casino, le chimiste Vencorex, Valéo, Arcelor-Mittal, General Electric, Airbus Defense and Space, Stellantis vont licencier voire fermer des sites. Les syndicats estiment au bas mot 150 000 suppressions d’emploi. Et ce n’est que la partie émergée de l’iceberg, car ces grands groupes font travailler des sous-traitants qui vont subir l’effet domino de ces plans sociaux et devoir licencier à leur tour.
Ces attaques contre le prolétariat, inévitables vu le développement de la crise capitaliste, pousseront les prolétaires à lutter et se confronter au piège corporatiste systématique des syndicats, à prendre conscience du lien entre les attaques qu’elle subit et la crise historique du capitalisme et ses guerres.
HD, 14 février 2025
1Cf. « Triomphe de Trump aux États-Unis : Un pas de géant dans la décomposition du capitalisme ! [965] », publié sur le site web du CCI.
2« La décomposition, phase ultime de la décadence capitaliste », Revue internationale n° 62 (1990).
Situations territoriales:
Personnages:
- François Bayrou [966]
- Emmanuel Macron [854]
- Marine Le Pen [882]
Récent et en cours:
- Gouvernement Bayrou [967]
Rubrique:
ICConline - mars 2025
- 18 lectures
L’importance historique de la rupture entre les États-Unis et l’Europe
- 247 lectures
Réunion publique internationale en ligne le samedi 5 avril 2025 de 15h à 18h
L’accélération des événements depuis l’avènement de Trump 2 aux États-Unis se poursuit.
-
Nous assistons aux dernières étapes de la rupture de « l’ordre mondial » inauguré par la guerre impérialiste de 1939-45. Lorsque le bloc impérialiste russe s’est effondré au début des années 1990, le CCI a prédit que le bloc occidental s’effriterait également. Ce processus a été immédiatement signalé par les conflits entre les États-Unis et leurs anciens alliés à propos de la guerre en ex-Yougoslavie et confirmé par les profondes divisions sur l’invasion de l’Irak en 2003. Mais aujourd’hui, le divorce entre les États-Unis et les puissances européennes est devenu définitif.
-
Cela ne nous conduit pas vers un monde de paix et de réconciliation. Loin de là ! La course à la guerre du capitalisme s’intensifie, mais elle prend une forme chaotique d’autant plus dangereuse qu’il n’y a pas de discipline de bloc. L’avenir même de l’humanité est menacé par un tourbillon de guerres impérialistes, de destruction écologique et de désintégration sociale.
-
La croissance du militarisme ne peut que signifier de nouvelles attaques contre les conditions de vie de la classe ouvrière, déjà sous le coup de décennies de crise économique. Les politiciens, en particulier en Europe occidentale, sont tout à fait ouverts à ce sujet et ont décidé de mettre en œuvre de gigantesques programmes d’armement : c’est « les armes ou le beurre » une fois de plus.
C’est pourquoi la CCI organise une troisième réunion publique internationale en ligne consacrée à la situation mondiale. Il est essentiel que tous ceux qui comprennent la nécessité de débarrasser le monde d’un système capitaliste en décomposition reconnaissent exactement ce à quoi la classe ouvrière est confrontée. Nous encourageons donc tous ceux qui sont engagés dans la recherche de la « vérité de ce monde » et de la manière de surmonter le capitalisme à assister à cette réunion et à prendre part au débat.
Si vous souhaitez participer, écrivez-nous sur [email protected] [911]
Vie du CCI:
- Réunions publiques [219]
Rubrique:
ICConline - avril 2025
- 43 lectures
Argentine : le combat des retraités est aussi le nôtre
- 88 lectures
Le mercredi 12 mars, la presse bourgeoise rapportait que : «La manifestation des retraités devant le Congrès s'est à nouveau terminée par une intervention de la police fédérale qui a utilisé des gaz lacrymogènes et des matraques. C'était la troisième répression consécutive : les forces de sécurité en ont déjà pris l'habitude. Malgré la chaleur accablante et le chaos provoqué par les coupures de courant dans la ville de Buenos Aires, des centaines de manifestants ont répondu à l'appel lancé chaque mercredi par des groupes tels que Jubilados Insurgentes («Retraités insurgés», l'Union des travailleurs retraités en lutte (UTJEL) et le Plenario de Trabajadores Jubilados (l’Assemblée des travailleurs retraités). Cette fois-ci, des partis de gauche, l'Association des travailleurs de l'État (ATE) et même des «supporters de l’équipe de foot «Chacarita Juniors» se sont joints à eux»[1].
Crise économique, plans d’austérité et conditions de vie des retraités
Contrairement aux partis de la gauche du capital et aux organisations gauchistes qui prétendent que les causes des programmes d’austérité, des coupes à la tronçonneuse dans les budgets sociaux, des réductions de salaire et des attaques contre les conditions de vie des travailleurs (et des anciens travailleurs) sont la faute de tel ou tel dirigeant, qu’il soit de gauche ou de droite, le CCI soutient qu'elles sont dues à la situation de crise mondiale du capitalisme, quelle que soit la clique au pouvoir, dans le but de protéger les profit de leurs bourgeoisies respectives. C’est cette crise mondiale du capitalisme qui est à l’origine des mesures qui sont assénées comme des coups de massue s’abattant sur le dos de la classe ouvrière.[2]
Comme nous l’affirmions déjà dès 2022, «Cette crise s'annonce plus longue et plus profonde que celle de 1929 [...] car l'irruption des effets de la décomposition de l'économie tend à semer la pagaille dans le fonctionnement de la production, provoquant de constants goulots d’étranglement et des blocages dans une situation de développement du chômage. (...) Elle se traduit surtout par une inflation effrénée que les différents plans de sauvetage n'ont fait qu'alimenter à travers une fuite en avant dans l’endettement»[3].
Depuis que Javier Milei a pris le pouvoir le 10 décembre 2023, il est arrivé à la Casa Rosada en déclarant : «Il n'y a pas d'autre choix que l’austérité et il n'y a pas d'alternative à un électrochoc». Ce plan d'austérité brutal laisse des milliers de familles sans nourriture et des milliers de travailleurs sans emploi. Il fait aussi plonger une large masse de retraités dans la misère. Le décret d'urgence (DNU), parmi ses points les plus importants, établit des déréglementations du commerce, de l'industrie et des services dans tout le pays.
Cela implique la libéralisation des prix, comme celle pratiquée par les entreprises commerciales de sécurité qui ont enregistré des hausses de 100%, et la suppression des subventions aux transports, entraînant des augmentations de 65% à 150% des prix pour les usagers. En outre, cela a entraîné une hausse des tarifs de l'électricité de 270%. La réduction du budget de l'État, la fermeture d’administrations et la suppression de postes dans les ministères, s'est traduite par des licenciements dans le secteur public avec plus de 75,000 emplois supprimés et d'autres sont prévus. La réduction brutale des travaux publics a provoqué l'effondrement de la construction, générant davantage de licenciements de travailleurs dans ce secteur.
La dévaluation du peso de plus de 50% a fait grimper les prix des produits et des services de plus de 100%, pulvérisant le pouvoir d'achat des salariés et bien plus encore celui de la majorité des retraités. Un salaire minimum qui couvre à peine un tiers du prix des produits de consommation de base. En Argentine, dont l’économie traditionnelle repose sur l’élevage, les prolétaires ne peuvent plus consommer de viande rouge, celle-ci ayant été remplacée par le poulet ou les pâtes.
Tout cet ensemble de mesures a provoqué une flambée de la pauvreté, qui existait déjà sous les gouvernements de Kirchner et du péronisme, et qui est passée de 49,5% en décembre 2023 à 57,4% en janvier 2024.
«Il y a un énorme amoncellement de personnes pauvres ou presque pauvres, une classe moyenne laminée et quelques privilégiés. C'est la nouvelle reconfiguration des revenus en Argentine, qui n'a pas été provoquée par le gouvernement de Javier Milei, mais qui s'est encore accélérée depuis que Milei est arrivé au pouvoir.» (déclaration à l'agence de presse EFE de l'économiste Alfredo Serrano Mantilla, directeur exécutif du Centre stratégique latino-américain de géopolitique (CELAG)).
Ces coups de massue brutaux sur le dos des travailleurs, des chômeurs et de la population non exploitée sont subis avec des conséquences terribles pour les retraités et les pensionnés argentins de toute nature. Les mesures d’austérité ont entraîné une amputation de plus de 38% du budget pour les chômeurs, justifiée sous le cynique prétexte de «faire des économies «pour permettre la réduction de… 14 milliards de dollars du montant de la dette nationale !
L'Argentine compte près de 7 millions et demi d'anciens salariés. 63% d'entre eux perçoivent une retraite de misère estimée en moyenne à 280,000 pesos (environ 340 dollars mensuels). Les autres vivent avec moins de 400,000 pesos par mois, alors que le coût des dépenses courantes par foyer dépasse 1,200,000 pesos. Beaucoup de personnes âgées errent désespérément dans la rue et sont réduites à faire la queue dans les quelque 230 soupes populaires que compte le Grand Buenos Aires. Non seulement l’aide sociale de l'État bourgeois est largement insuffisante pour assurer leur survie mais en plus, près de la moitié des retraités (3 des 7,5 millions existant dans le pays) ont été exclus de la couverture d’obtention gratuite de médicaments, ce qui est dramatique si l'on considère que les prix de ceux-ci ont augmenté de 119% en 2024! Tout cela a poussé les anciens ouvriers, exaspérés et lassés des attaques incessantes qu’ils endurent, à se rassembler dans les rues pour clamer «On en a assez d’être affamés et réduits à la misère!».
La lutte face à la répression brutale du gouvernement
C'est dans ce contexte d'attaques contre les conditions de vie de cette partie de la classe ouvrière que s’est déroulée la répression violente du 12 mars. Ce jour-là, comme tous les mercredis, les retraités s’étaient réunis pour manifester devant le Congrès. Le même jour, la centrale syndicale CGT, contrainte par les événements, avait appelé à une marche de «solidarité» avec les retraités, à laquelle se sont jointes d'autres organisations de la gauche du capital (toutes les organisations trotskistes, comme dans le PTS-Front de gauche (FIT), Polo Obrero ou, dans une autre coalition, le MST). Des collectifs et des organisations citoyennes se sont également joints à eux, et surtout les «barras bravas», c’est-à-dire les supporters des principales équipes de football d'Argentine, comme Boca, River, Rosario Central, car quelques jours auparavant, un retraité portant un maillot de l'équipe de Chacarita avait été frappé lors des charges policières et ils étaient là pour «régler leurs comptes», pour «en découdre» en s’affrontant à la police.
La ministre de l’intérieur chargée de la répression, Patricia Bullrich, avait déjà mis en garde contre les «désordres et la violence des piqueteros et des barras bravas» et avait juré de ne pas tolérer le moindre désordre ni leur permettre de passer. Des contingents de nombreux policiers armés jusqu'aux dents et utilisant des tactiques quasi-militaires ont déclenché une répression féroce dès le début de la marche vers le Congrès. Aux coups de matraque, aux balles en caoutchouc et aux bombes lacrymogènes de la police, les supporters ont notamment répondu en jetant des pierres et en brûlant des véhicules de police et des poubelles. Une retraitée a été blessée à la tête après avoir été poussée et frappée par un policier et un caméraman a reçu une bombe lacrymogène en plein visage. Au total, le bilan de la journée a été de 50 blessés et il y a eu plus d’une centaine d’arrestations.
Quel est le bilan de la lutte des retraités ?
La politique d'austérité, d’amputation des salaires et des retraites, la réduction drastique des budgets de la santé et des services sociaux de Milei et de son gouvernement font partie de l'offensive de la bourgeoisie pour maintenir en place l'ordre capitaliste en pleine putréfaction. À l'origine de tout cela se trouve la crise économique mondiale, accélérée par la décomposition, qui conduit toute camarilla arrivant au pouvoir à appliquer des féroces mesures d'attaque contre les conditions de vie de la classe ouvrière. Encore une fois, ce sont les travailleurs qui doivent payer la note de la crise pour que la bourgeoisie tente de sauver les intérêts du capital national.
La lutte des retraités et leurs revendications s'inscrit dans la défense d’un terrain de la classe, car elles sont une forme de résistance aux mesures que la bourgeoisie et son État imposent à toute la classe ouvrière. Par conséquent, la lutte des retraités en Argentine est aussi la nôtre. C'est un combat des travailleurs retraités pour résister aux attaques permanentes contre leurs conditions de vie déclenchées par l'État bourgeois dans le contexte de la crise économique mondiale et de ses politiques d’austérité draconienne. Et ils n'ont pas été seuls. Ils ont défilé accompagnés de jeunes travailleurs, d'adultes, et même d'enfants (certains enfants et petits-enfants de ces anciens travailleurs) qui sont descendus dans la rue pour se battre à leurs côtés. À chaque moment de la mobilisation, les retraités appelaient d'autres jeunes travailleurs à se joindre à la mobilisation avec des pancartes et des slogans, comme lorsqu'une personne les a interpellés : «Vous serez un jour vieux et vous sortirez vous aussi dans la rue pour lutter comme nous aujourd'hui». Par conséquent, la lutte des retraités et des chômeurs en Argentine est aussi celle de la classe ouvrière dans son ensemble.
Malgré sa combativité, le mouvement a montré de sérieuses faiblesses. Par exemple, les difficultés que rencontrent les travailleurs pour se reconnaître comme exploités, comme faisant partie d'une même classe et, en ce sens, pour unir leurs luttes à celles d'autres secteurs de la classe ouvrière qui subissent également les attaques brutales du gouvernement populiste. Nous avons déjà évoqué dans un article précédent la vague de grèves qui, depuis 2022-2024, a fait de ce territoire celui où il y a eu le plus de luttes en Amérique latine l'année dernière[4]. Nous avons déjà parlé des coups très durs que les travailleurs et les retraités ont reçus avec le gouvernement de Milei, mais qui avaient déjà commencé bien avant, en particulier avec les gouvernements de gauche successifs d’obédience péroniste-kirchneriste. Cependant, le mouvement des retraités n'a pas tenté de se connecter avec les travailleurs actifs qui sont en lutte (enseignants ou travailleurs des douanes ou des chemins de fer qui, à cette même période, préparaient des grèves contrôlées par les syndicats et soigneusement isolées, chacune dans son coin) et la plupart des dirigeants syndicaux n’ont cessé d’alimenter l’illusion que le syndicat était la seule organisation possible de «la lutte» pour les travailleurs. À cet égard, il est révélateur qu'une dirigeante de la gauche du Capital, Myriam Bregman (figure de proue du Parti des Travailleurs Socialistes (PTS), trotskiste et ancienne députée représentante du Front de la Gauche unie, ait affirmé que les retraités se plaignaient que la CGT ne vienne pas les soutenir et exigeaient que la centrale syndicale convoque une grève nationale[5].
Les supporters d’équipes de football qui ont participé à la mobilisation des retraités se sont exprimés en tant que «supporters» et non en tant que travailleurs, en tant que classe, mais en tant que membres d'un groupe de la société bourgeoise, comme les hooligans ou les Kops ultras fanatisés en Europe, pour manifester leur soutien inconditionnel à une équipe de football. Les méthodes utilisées par ces derniers ne sont nullement celles de la tradition de lutte de la classe ouvrière, mais une pratique qui lui est totalement étrangère, de lumpen, proclamant et revendiquant une soif de vengeance et un déchaînement nihiliste de violence aveugle comme l’incendie de voitures et la destruction de vitres et de vitrines, une situation qui a rappelé le vandalisme des piqueteros[6] lors des émeutes du «corralito» au début de ce siècle à Buenos Aires et dans d'autres villes. Toutes ces actions ne sont que des expressions désespérées d’un no future, propres à la petite bourgeoisie et non à la classe ouvrière [7].
C'est pourquoi, en pleine manifestation, on a pu entendre à nouveau des slogans tels que «Milei à la poubelle», «SOS dictature !», «La patrie n’est pas à vendre» ou le désormais classique «Qu'ils s'en aillent tous» qui, au lieu d’appeler à une mobilisation de l’ensemble des travailleurs pour défendre leurs conditions de vie face aux attaques du capitalisme, dévoie la colère sur le terrain bourgeois en l’enfermant dans les pièges d’une lutte pour la défense de la démocratie, contre la dictature ou l’autocratie et finalement derrière l’impasse du nationalisme en s’attaquant ou en faisant obstacle au développement de leur conscience de classe.
Les syndicats et les organisations de la gauche du capital, de la CGT péroniste aux organisations trotskistes et citoyennes, ont joué leur sale rôle de diviser les travailleurs pour affaiblir leur lutte. À contrecœur et pour «bien faire», ils ont convoqué une marche censée être de solidarité avec les retraités, puis appelé à une grève nationale de 36 heures le 9 avril dernier, mais qui, en réalité, ne cherchait qu'à récupérer le sentiment de colère et d’exaspération de plus en plus largement répandu au sein de la classe ouvrière et partagé dans tous les secteurs, chez les retraités, les chômeurs ayant perdu leur emploi comme chez les travailleurs encore en activité, en exploitant les fortes illusions et toutes les faiblesses et les confusions qui se sont exprimées dans ce mouvement pour mettre en avant une fausse unité interclassiste autour du seul dénominateur commun, l’opposition à Milei et à son gouvernement ou carrément autour de revendications bourgeoises. Péronistes, syndicats, partis de gauche, organisations gauchistes sont ainsi tous main dans la main pour maintenir les ouvriers divisés, chacun dans son secteur, sa catégorie sociologique et avec sa propre revendication : les chômeurs d'un côté, les actifs de l'autre, les retraités ou pensionnés encore d'un autre. Les autres organisations «citoyennes», allant de la cause féministe aux défenseurs de telle ou telle minorité comme LGTB+ jusqu’aux aux supporters «radicaux» de clubs de foot ont également apporté leur part pour contribuer à cette entreprise de boycott ou de sabotage de l'auto-organisation des travailleurs et de l'extension des luttes, en le dénaturant, en le transformant soit en appels «au «peuple» ou «aux citoyens» à «se venger de Milei» lors des prochaines élections», soit pour les plus «radicaux» en préconisant «l'abstentionnisme politique» pour cette échéance, afin de masquer et d’empêcher la prise de conscience de la nécessité de se battre unis sur un terrain de classe en se mobilisant contre les attaques d’un système capitaliste moribond en pleine putréfaction qui n’a plus rien à offrir à ses exploités que toujours plus d’exploitation et de misère.
Tr.
[3] L’accélération de la décomposition capitaliste pose ouvertement la question de la destruction de l’humanité [971], Revue Internationale 169, 2e semestre 2022.
[4] Agence de presse en espagnol spécialisée dans les informations économiques destinées aux entreprises.
[5] En Argentine, comme ailleurs… Les travailleurs doivent tirer les leçons de leurs luttes passées pour préparer celles de l'avenir [972]
[7] Propos rapportés dans une interview accordée dans le journal La Izquierda.
Géographique:
- Argentine [604]
Conscience et organisation:
Personnages:
- Javier Milei [936]
- Cristina Kirchner [605]
- Alfredo Serrano Mantilla [975]
- Myriam Bregman Patricia Bullrich [976]
Questions théoriques:
- Populisme [29]
- Décomposition [517]
L'importance historique du divorce entre les États-Unis et l'Europe
- 60 lectures
Pour le CCI, ce divorce est la conséquence du chaos et de la décomposition de la société impulsés par l’effondrement du bloc de l’Est en 1989. Il constitue à son tour une impulsion supplémentaire à ce même chaos notamment sur les plans impérialistes et économiques.
La classe ouvrière est confrontée aux implications de cette situation qui est synonyme pour elle de plus d’exploitation et de misère, de multiplication et aggravation des guerres, d’exposition à toutes les manifestations de la décomposition de la société[1]. Quelle réponse peut et doit-elle opposer à la guerre, aux conséquences d’une exploitation terriblement accrue ? … Comment les organisations révolutionnaires doivent elles contribuer au processus de développement de la conscience au sein de la classe ouvrière ? Ces questions ont été au centre de notre dernière réunion publique internationale.
La place des réunions publiques dans l’intervention du CCI
Pour le CCI, seul le développement de la lutte de classe, qui porte en elle la perspective de renversement du capitalisme, est à même d’offrir une alternative à la situation actuelle. C’est pourquoi, nous soulignons dans notre presse et en tout autre occasion d’intervention : « il revient aux minorités révolutionnaires, à tous les éléments en recherche, à tous ceux qui aspirent à une autre perspective que ce capitalisme décadent et barbare, de se regrouper, de discuter, de faire le lien entre la guerre, la crise économique et les attaques contre la classe ouvrière, d'indiquer la nécessité de lutter de façon unie, en tant que classe. [2] ». Les permanences et réunions publiques du CCI offrent des moyens d’assumer ce type d’intervention envers ces éléments en recherche, en particulier les réunions publiques internationales via internet qui présentent le gros avantage de permettre une discussion politique entre éléments répartis de par le monde.
Nous avons tenu notre dernière réunion publique internationale le 5 avril 2025. Signalons que d’autres réunions de ce type ont eu lieu antérieurement et toutes nous confortent dans notre opinion concernant l’importance de ce type d’intervention :
- Le 16 novembre 2024, sur le thème « Les implications mondiales des élections américaines ». Nous en avons publié un compte rendu dans notre presse, « Un débat international pour comprendre la situation mondiale et préparer l’avenir [956] ».
- le 25 janvier 2025, autour des conséquences des élections américaines, « L’élection de Trump va accélérer la décomposition du capitalisme »
- le 2 mars, une nouvelle réunion est organisée dans le but de poursuivre certains débats engagés envers ces éléments en recherche lors de la réunion précédente du 25 janvier.
Nous avons pu constater que ces réunions internationales rassemblaient à chaque fois une assistance plus nombreuse tout en constituant un réel lieu de débat. Un contact nous a cependant fait part de certaines de ses critiques à cette formule qui, selon lui, présente des inconvénients. L’essentiel de ces critiques relatives à notre réunion du 16 novembre a été publié dans notre presse sous la forme d’un courrier de lecteurs accompagné d’une réponse de notre part[3]. Ce camarade, tout en soutenant les initiatives du CCI pour susciter la discussion au sein de notre classe, soulignait qu’une réunion publique en ligne en différentes langues, avec une assistance nombreuse, pouvait ne pas présenter les meilleures conditions pour le développement et l’approfondissement des débats. Si cela est juste d’un point de vue technique, nous avons opposé à cet argument que, pour l’avenir, les réunions publiques internationales sont toutefois primordiales pour les raisons suivantes : « Se rassembler depuis plusieurs pays pour discuter, élaborer, confronter les arguments et ainsi comprendre au mieux la situation mondiale est un moment précieux pour rompre l’isolement de chacun, nouer des liens, ressentir la nature mondiale du combat révolutionnaire prolétarien. Il s’agit de participer à l’effort de notre classe pour sécréter une avant-garde. Ce type de réunion est ainsi un jalon qui présage de la nécessaire organisation des révolutionnaires à l’échelle mondiale. Ce regroupement des forces révolutionnaires est un long processus, qui nécessite un effort conscient et constant. C’est là une des conditions vitales pour préparer l’avenir, pour s’organiser en vue des affrontements révolutionnaires décisifs qui viendront. » (Courrier de lecteur: Pourquoi les réunions publiques internationales sont primordiales pour l’avenir? [977]). Quant à l’approfondissement des grandes questions soulevées et confrontées au sein de ces réunions internationales, nous ne pouvons qu’encourager les participants intéressés à participer -lorsque c’est possible- aux réunions publiques et permanences que le CCI organise en présentiel dans différentes villes. Nous sommes également disposés à organiser des réunions par Internet avec un nombre de participants plus restreint en vue de permettre des discussions plus développées. Par ailleurs, il existe toujours la possibilité d’écrire au CCI qui répondra soit directement, soit à travers un courrier de lecteurs publié dans la presse, ou qui proposera des rencontres, etc.
Le déroulement de la discussion
L’introduction du CCI a présenté le cadre suivant concernant la signification et les implications du divorce transatlantique pour introduire la discussion.
La dynamique mondiale, qui est à l'œuvre depuis 1989 et qui culmine aujourd’hui avec l’élection de et l’éclatement des alliances scellées à la fin de la Seconde Guerre mondiale, a des implications à différents niveaux de la vie de la société. En témoignent, au niveau européen, les innombrables réunions au sein des états-majors politiques, les tentatives des États de se coordonner, d'établir une coopération militaire, l’engagement de la plupart de ces pays à investir massivement dans des programmes d’armements jamais vus en Europe, soutenus par un plan de 800 milliards d'euros dégagés par l’UE. Cette volonté de s’engager dans une politique de réarmement n'enterre cependant pas les intérêts contradictoires existant entre les pays européens.
Le programme que tous les capitalistes du monde entier réservent à la classe ouvrière, notamment face à la nécessité de financer de vastes programmes d'armement, est celui d'attaques brutales contre les conditions de vie et de travail de la classe ouvrière : licenciements de fonctionnaires et coupes massives dans les aides aux handicapés par le gouvernement travailliste de Starmer en Grande-Bretagne, annonce d'une série d'attaques contre les retraites, la sécurité sociale, l’assurance maladie, les allocations logement, etc. dans la plupart des pays européens, suppressions d'emplois dans de nombreux secteurs industriels. Mais ces attaques vont également susciter la résistance de la classe ouvrière.
Même si celle-ci est confrontée à de grandes difficultés, elle n'est pas vaincue et a commencé à relever la tête... C’est ce qu’avaient permis de comprendre les luttes au Royaume-Uni en 2022 ainsi que bien d’autres depuis lors, en particulier aux Etats-Unis et en Europe, et à présent en Belgique[4]. Face à ces perspectives de lutte de classe, les révolutionnaires doivent être prêts à intervenir en vue de soutenir la résistance de notre classe, de défendre l'auto-organisation et l'unification des luttes.
Les participants étaient ensuite appelés à intervenir plus précisément sur les thématiques suivantes :
- derrière les promesses de paix de Trump, pouvons-nous nous attendre à autre chose que plus de militarisme et d'escalade guerrière? La dynamique à l'œuvre depuis 1989 a-t-elle maintenant atteint un nouveau palier historique ?
- la classe capitaliste n'a d'autre choix, afin de financer de vastes programmes d’armement, que d'attaquer les travailleurs partout et de la manière la plus impitoyable. La classe ouvrière sera donc attaquée aussi brutalement que dans les années 1930. Et cette offensive est imminente, elle a d’ailleurs déjà commencé dans de nombreux pays.
- Face à cette situation, la classe ouvrière doit plus que ne jamais se battre sur son propre terrain de classe, à savoir la défense de ses intérêts économiques ; c’est à travers ce processus que se développeront sa conscience de la nécessité de renverser le capitalisme et la confiance en ses propres forces.
La prise en charge ces questions brûlantes a été assurée au moyen de deux discussions distinctes au sein de la réunion publique :
- La compréhension de la dynamique mondiale du capitalisme ;
- Les conséquences pour la lutte de la classe ouvrière.
Les camarades qui sont intervenus ont exprimé un soutien global aux positions défendues par le CCI sur la question des tensions guerrières, avec toutefois des nuances, voire chez un camarade une vision différente à propos de la manière dont le monde s’enfonce dans la barbarie guerrière. Il a exprimé l’idée qu’il y avait un renforcement de « trois » blocs impérialistes rivaux. Dans le cadre de cette RP, il nous a semblé préférable de laisser cette question très importante en suspens afin de privilégier plutôt l’analyse du sens profond du changement historique occasionné par le divorce entre les États-Unis et l’Europe. Nous reviendrons donc sur cette idée ultérieurement à l’occasion d’un autre article.
Concernant les perspectives de la lutte de classe, la discussion a manqué de temps, en particulier pour explorer la question de sa dynamique. Les interventions se basaient en général sur l’analyse selon laquelle « Le prolétariat n'est pas près d'être mobilisé pour la guerre », ce qui est effectivement très important et vérifié dans les parties du monde où le prolétariat détient la plus forte expérience historique. Mais qu’est ce qui permet de dire que, face aux attaques économiques du capital, il va pouvoir récupérer pleinement sa conscience d’être une classe historique aux intérêts opposés à ceux de la bourgeoisie, capable de renforcer son combat en vue du renversement du capitalisme ? La position du CCI est que ce processus a démarré, les luttes au Royaume-Uni de l’été 2022 ayant constitué une rupture dans la dynamique mondiale de la lutte de classe, jusque-là prisonnière des campagnes idéologiques de la bourgeoisie sur « la fin de la lutte de classe » et sur la « non-existence même de la classe ouvrière » bâties à partir de l’effondrement du bloc de l’Est présenté comme l’effondrement du communisme. Mais le recouvrement de l’identité et de la conscience de classe sera un processus long, de plus entravé par de nombreux pièges idéologiques tendus par la bourgeoisie pour tenter de l’en détourner.
Quel bilan de cette réunion publique ?
Introduisons ce bilan en citant une partie de l’intervention d’un participant, la dernière de la réunion : « Merci beaucoup, je suis très heureux de me joindre à vous. C'est une discussion très animée, avec un temps malheureusement limité. Je suis principalement d'accord avec les interventions et le point de vue du CCI. Je pense qu'il est très important de ne pas tomber dans les pièges « nationaux », mais plutôt d'être conscient de la nature internationale du problème auquel la Terre et l'humanité entière sont confrontées. Pour les discussions futures, « Que faire ?» est une question très importante (malheureusement, il ne reste plus beaucoup de temps), donc s'il y a une réunion de suivi à ce sujet, j'aimerais m'y joindre » (Robin)
Nous partageons son point de vue concernant les limitations induites par le temps imparti et sa mise en évidence de la question de « Que faire ? » dans la situation historique présente. Cette réunion a confirmé, de notre point de vue, l’importance des réunions publiques internationales, celle-ci ayant suscité un intérêt plus grand que les fois précédentes.
Pour terminer, nous voulons enfin signaler que, comme c’est son habitude, le CCI avait convié le milieu politique prolétarien (la Tendance Communiste Internationaliste et les groupes bordiguistes) à participer à cette réunion publique. Seul le groupe Internationalist Voice a pris en compte l’importance de telles réunions en participant activement à celle-ci. Il nous semble vital de prendre en compte l’importance de telles réunions, qui sont de rares lieux de vie du débat prolétarien et donc précieuses, en participant activement à celles-ci.
Le CCI (23 04 2025)
[1] Lire à ce propos Rapport sur la décomposition [978], Revue internationale 170.
[2] Quel monde allons-nous devoir affronter ? [979] Revue internationale 173.
[4] Lire notre article « Belgique : la classe ouvrière face à la pression de la crise et du militarisme » [980].
Vie du CCI:
- Réunions publiques [219]
Conscience et organisation:
Personnages:
- Trump [700]
- Keir Starmer [981]
Courants politiques:
Rubrique:
“Nouveau désordre mondial” : que faire ?
- 166 lectures
L’élection de Trump aux États-Unis marque clairement une nouvelle étape dans la décomposition et le chaos du capitalisme. Le divorce historique entre les États-Unis et l’Europe et la « guerre des tarifs » qui est en cours sont tous deux le produit et des facteurs actifs de la tendance au « chacun pour soi » dans les relations internationales. Ils vont tous deux aggraver la crise économique mondiale et intensifier la tendance au militarisme et à la guerre.
Il ne fait aucun doute que cette situation obligera les capitalistes et leur État à intensifier les attaques contre la classe ouvrière, à exiger des sacrifices au nom de la défense nationale, à réduire les salaires, les emplois et les prestations sociales, tout en ravageant de plus en plus de régions de la planète par la guerre et la destruction écologique. Il ne fait aucun doute que les travailleurs devront se défendre contre ces attaques, mais il ne fait pas non plus de doute que la classe dirigeante tendra de nombreux pièges visant à empêcher une réponse prolétarienne massive et unie, notamment la fausse perspective de se ranger du côté de la « défense de la démocratie » contre la menace de l’extrême droite, des « milliardaires cupides » ou des autocrates avides de pouvoir.
Les organisations révolutionnaires en particulier sont confrontées à une responsabilité croissante, à la fois pour analyser la direction des événements mondiaux et pour défendre les besoins de la lutte des classes face aux attaques économiques, à la barbarie croissante et aux illusions colportées par la classe dirigeante. Mais ces analyses et la manière de développer une réponse prolétarienne doivent être débattues et définies plus précisément. C’est l’objectif de la série de réunions publiques que le CCI partout où il est présent. Nous invitons tous ceux qui se posent la question « que faire face à ces défis ? » à participer à ces réunions.
En France, nos réunions publiques auront lieux à :
- Paris : samedi 26 avril 2025 de 15h à 18h. Adresse : CICP, 21ter rue Voltaire, Paris (métro « rue des boulets »).
- Lyon : samedi 26 avril 2025 de 15h à 18h. Adresse : CCO La Rayonne, Salle les jeunes ouvrières, 28 rue Alfred de Musset. Villeurbanne (Métro A. Arrêt Vaulx-en-Velin la Soie)
- Marseille : samedi 26 avril 2025 de 14h à 17h. Adresse : La Ruche 28 Bd National, Marseille.
Vie du CCI:
- Réunions publiques [219]
Géographique:
- Etats-Unis [184]
Personnages:
- Donald Trump [896]
Récent et en cours:
- Populisme [293]
- décomposition [983]
Rubrique:
ICConline - mai 2025
- 22 lectures
Permanence en ligne samedi 17 mai 2025 à 15h
- 55 lectures
Le Courant communiste international organise une permanence en ligne le samedi 15 mai à 15h.
Les permanences sont des moments de débat ouverts à tous ceux qui veulent se rencontrer et discuter avec la CCI.
Nous invitons chaleureusement tous nos lecteurs et tous nos sympathisants à y participer afin de poursuivre la réflexion sur la situation historique et de confronter les points de vue. Les camarades sont également invités à nous faire part des enjeux qu'ils aimeraient aborder.
Si vous souhaitez assister à cette rencontre, vous pouvez envoyer un message à notre adresse internet ([email protected] [213]) ou dans la rubrique « nous contacter [214] » de notre site web, en indiquant les enjeux que vous aimeriez aborder, afin que nous puissions mieux organiser la discussion.
Les modalités techniques de connexion au séjour seront communiquées ultérieurement aux camarades qui auront répondu à l'appel.
Vie du CCI:
- Permanences [291]
Rubrique:
“Black-out” dans la péninsule ibérique : Une illustration de la faillite du capitalisme
- 66 lectures
Le 28 avril dernier, un «black-out» géant frappait toute la péninsule ibérique, soudainement privée d’électricité, son activité paralysée pendant près de huit heures, semant la pagaille et le chaos dans la circulation des métros, des tramways et des trains, bloquant les véhicules privés de signalisation, avec des pannes d’ascenseurs et des personnes enfermées à l’intérieur, provoquant l’annulation des vols dans les aéroports, générant la fermeture des magasins et une véritable galère pour toute la population.
Un phénomène additionnel…
Cet épisode spectaculaire est une illustration non seulement de la fragilité sur le plan énergétique des États les plus puissants, mais encore un des symptômes supplémentaires d’une accumulation de fléaux et de catastrophes qui frappent un monde lui-même de plus en plus désordonné et chaotique. Si cet événement est «sans précédent» en Espagne, il n’est évidemment pas unique et on pourrait rappeler que bien d’autres coupures géantes d’électricité ont eu lieu en différents endroits du monde auparavant. Ce fut le cas par exemple en Inde en 2012, une des plus importantes à ce jour, tout comme celle qui s’était produite aux États-Unis dans des parties du nord-est et dans le Midwest, jusque vers l’Ontario canadien en août 2003.
Bien que liés parfois à des aléas climatiques, comme de violents orages, les problèmes d’alimentation en électricité ont souvent eu pour origine les défaillances de réseaux vétustes ou plus ou moins bien entretenus du fait de maintenances déficientes, faute de crédits suffisants. La crise économique profonde, le manque d’investissement et les désordres croissants de la société, les tensions impérialistes entre États, ne pourront d’ailleurs que favoriser les conditions pour de futures coupures de courant aux conséquences imprévisibles, mais pouvant se révéler dramatiques. L’énergie, comme nous pouvons le constater avec la guerre actuelle entre la Russie et l’Ukraine, est devenu davantage un enjeu stratégique que commercial, une arme de guerre par elle-même[1] [984].
Au moment de la rédaction de cet article, les origines de l’immense panne de courant en Espagne et au Portugal n’ont pas encore été établies (touchant aussi partiellement et momentanément la France, au Pays basque). Bien que la connexion des réseaux soit optimisée afin de permettre une régulation de la distribution d’électricité, le black-out sur la péninsule reste «inexpliqué» par les autorités. Nul doute que le fait d’une cyberattaque, même si l’hypothèse a été très vite écartée, était une éventualité crédible au vu de la dégradation des tensions géopolitiques actuelles.
En réalité, au-delà de notre ignorance sur les causes et de la prudence qui s’impose, la raison «technique» du black-out n’a pas plus d’importance que cela pour définir une lecture politique de ce qui s’est produit. Pris en lui-même, le phénomène de cette «panne» brutale pourra trouver une explication particulière. La question qui nous semble la plus pertinente est plutôt de souligner le contexte dans lequel s’est produit l’événement, en tant que phénomène illustratif d’un système à bout de souffle.
… dans la phase de décomposition du capitalisme
Comme pour d’autres phénomènes qui peuvent se produire et se traduire par de véritables tragédies, un tel black-out doit être compris dans un contexte où les accidents et les catastrophes s’accumulent, ou leur rythme d’apparition, leur intensité et leur ampleur ne cessent de croître depuis plus de trente ans. Une situation globale telle que Marx ne pouvait bien sûr pas imaginer à son époque, mais dont il avait été tout de même capable d’anticiper en révélant la dynamique historique du mode de production capitaliste. En percevant les contradictions internes du système et les germes de sa crise et sa décadence future comme de tout mode de production et d’exploitation devenu obsolète, Marx notait que le capitalisme a ceci de particulier qu’il fait surgir «une épidémie sociale, qui a toute autre époque aurait d’emblée semblé absurde, l’épidémie de la surproduction[2] [985]«. Bien entendu, il ne s’agit pas ici d’attribuer la panne d’électricité à une origine purement économique. Ce que nous voulons exprimer ici, c’est que l’obsolescence du capitalisme, en décadence depuis plus de cent ans, du fait de sa crise économique devenue chronique et surtout de l’absence de perspective autre que la misère et la destruction, plonge toute la société dans des convulsions qui sont aujourd’hui celles de sa phase ultime, sa décomposition.
En effet, «la phase de décomposition apparaît comme celle résultant de l’accumulation de toutes ces caractéristiques d’un système moribond, celle qui parachève et chapeaute trois quarts de siècle d’agonie d’un mode de production condamné par l’histoire[3] [986]». Avec une crise économique et sociale plongeant les prolétaires et les populations dans la pauvreté, les tensions guerrières accrues, la multiplication des catastrophes liées au changement climatique, les accidents industriels et phénomènes comme les pénuries, cette coupure d’électricité reste un symptôme comme d’autres qui ne peuvent qu’augmenter fortement.
C’est ce que nous n’avons cessé de mettre en évidence depuis plus de trente ans dans nos articles, alors que ces phénomènes étaient moins fréquents, plus étalés dans le temps et dans l’espace, permettant à la bourgeoisie de mieux faire passer ses propres explications «particulières» afin d’isoler les cas et de dédouaner son système. Ainsi, par exemple, à propos des inondations ou des sécheresses, les médias évoquaient de simple «catastrophes naturelles». Mais avec la multiplication des phénomènes, notamment la catastrophe planétaire du Covid-19, elle a été obligée d’invoquer plus nettement «l’irresponsabilité» des «hommes» ou de tel ou tel individu.
Aujourd’hui, à part culpabiliser en cherchant des coupables et des bouc-émissaires, la bourgeoisie trouve toujours un tas d’explications, comme elle pourra probablement le faire à l’issue de son enquête en cours pour ce récent black-out. Ce qu’elle ne pourra jamais nous dire, en revanche, c’est que son système est en faillite et qu’il ne pourra que générer de nouvelles tragédies. La cécité de la bourgeoisie est à l’image de son cynisme et de sa cupidité, une barbarie croissante que seul le prolétariat pourra surmonter et vaincre par la révolution.
Géographique:
- Espagne [16]
Récent et en cours:
- Panne électrique [990]
Rubrique:
“Jour de la Victoire en Europe” contre le nazisme: Cette victoire n’est pas la nôtre!
- 82 lectures
Les célébrations du 80e anniversaire de la «Victoire en Europe», le 8 mai, de Londres à Moscou, donnent toujours lieu à des défilés militaires, afin que personne ne pense que la Seconde Guerre mondiale (comme celle de 1914-1918) était la «der des ders» …
On nous dit que le prix de la liberté se paie par une vigilance éternelle et que nous devons donc être armés jusqu’aux dents et toujours prêts à nous enrôler pour la cause nationale. N’est-ce pas cela ?
On prétend que mai 1945 a été la victoire de la démocratie sur le fascisme, de la liberté sur la tyrannie et les massacres. Ce n’était cependant pas «tout à fait» la «Victoire» au Japon : les alliés démocratiques devaient encore commettre leurs propres massacres à Hiroshima et Nagasaki avec le largage des premières bombes atomiques, avec pour mission essentiel d’envoyer ainsi un avertissement à l’URSS, l’alliée d’hier et le nouvel ennemi totalitaire de demain. Ainsi, la Seconde Guerre mondiale fut immédiatement suivie par les préparatifs de la Troisième à travers une «Guerre froide» qui ne fut pas si froide que ça pour les millions de personnes brûlées et massacrées par les guerres par procuration sans fin entre les deux blocs impérialistes mis en place au lendemain de la Guerre mondiale. Telle fut la véritable nature des conflits sanglants en Chine, en Corée, au Vietnam, en Afrique et au Moyen-Orient au cours des quatre décennies suivantes.
La «Guerre froide» a pris fin avec l'effondrement du «bloc de l'Est» mais, privée d'un ennemi unificateur, l'alliance occidentale a aussitôt, à son tour, commencé à se déliter. Certaines de ses institutions officielles, comme l'OTAN, subsistent encore. Mais le nouveau régime à la Maison-Blanche entend «dire les choses telles qu'elles sont» : comme l'avait dit Lord Palmerston, il n'y a «ni amis ni ennemis permanents, seulement des intérêts nationaux permanents». C'est donc désormais «l'Amérique d'abord», Trump et ses collaborateurs s'employant à démanteler les derniers vestiges de l'ordre mondial d'après-guerre.
Dans la lignée de la propagande qui a récemment ciblé l'Europe, Trump veut rebaptiser le «Jour de la Victoire en Europe» : «Jour de la Victoire de la Seconde Guerre mondiale» ; tandis que le «Jour de l'Armistice» deviendra «Jour de la Victoire de la Première Guerre mondiale». Trump minimise ainsi la contribution des puissances européennes à la défaite de l’Allemagne nazie, insistant sur le fait que «nous avons gagné les deux guerres, personne ne pouvait nous égaler en termes de bravoure, de force et de génie militaire». C'est un nouveau coup de pied calculé dans la fourmilière des puissances européennes, de ces «profiteurs», qui n’ont pu être sauvés que par la bienveillance des Américains dans les deux guerres mondiales. Trump ne mentionne pas que l’aide américaine n’était pas exactement gratuite : les Britanniques, par exemple, payèrent jusqu’en 2006 leurs dettes de guerre aux États-Unis ; plus lourd encore : ils ont été obligés d’abandonner leur Empire pour faire place à la nouvelle hégémonie mondiale des États-Unis.
Pour ceux qui rejettent les rituels en l'honneur de l'État-nation et qui adhèrent encore au mot d’ordre du mouvement, «les prolétaire n'ont pas de patrie», peu importe qui prétend avoir apporté la plus grande contribution à la boucherie inter-impérialiste des deux guerres mondiales et de la guerre froide. Pour la classe ouvrière, 1945 ne marqua pas une victoire mais le fond d’une profonde défaite historique. En 1917-1918, les révolutions ouvrières en Russie, en Allemagne et ailleurs mirent fin à la Guerre et, pendant un bref intermède, laissèrent entrevoir la perspective d'un monde sans États-nations concurrents ni belligérants. Mais la révolution fut vaincue par les efforts conjugués de la social-démocratie, du fascisme et du stalinisme, et la Seconde Guerre mondiale s'acheva avec les deux camps impérialistes écrasant la moindre menace d'opposition de la classe ouvrière à la guerre. Après les grèves massives du nord de l'Italie en 1943, où des slogans contre la guerre firent leur apparition, la menace fut suffisante pour que Mussolini soit destitué par ses camarades fascistes et que Churchill suspende l'avancée de son armée depuis le sud de l'Italie pour «laisser les Italiens mijoter dans leur jus», ce qui signifiait permettre aux forces hitlériennes de mener la répression nécessaire contre les travailleurs. Puis vinrent les bombardements incendiaires de Hambourg, Dresde et Berlin, pour étouffer tout risque de révolte prolétarienne en Allemagne.
Aujourd'hui, le divorce entre les États-Unis et l'Europe, ainsi que la poursuite des massacres en Ukraine, s'accompagnent de nouvelles exigences de la part de nos dirigeants : être prêts à offrir vie et travail pour la défense nationale. Mais ils sont également conscients de la nécessité de nous le marteler sans cesse, précisément parce que la classe ouvrière se montre aujourd'hui bien moins disposée à consentir à des sacrifices qui ne peuvent jamais servir ses propres intérêts ; elle l'a notamment démontré lors des grandes vagues de grèves mondiales en mai-juin 1968 en France et en Italie en 1969, culminant en Pologne en 1980, et avec les mouvements de classe moins spectaculaires mais néanmoins profondément significatifs qui ont débuté avec l'«Été du mécontentement» en Grande-Bretagne en 2022 et qui se dessinent aujourd'hui dans le monde entier.
Notre seule victoire sera le renversement du capitalisme mondial !
Amos (6 mai)
Questions théoriques:
- Guerre [26]
- Impérialisme [45]
Rubrique:
Réunion publique sur la crise écologique (en ligne et physique)
- 193 lectures
Le bombardement massif par les États-Unis, dans la nuit 21 au 22 juin, de cibles militaires en Iran constitue une nouvelle étape de l’aggravation des tensions et du chaos guerrier, de la désolation et la barbarie sans trêve dans la région.Face la gamme étendue des différentes formes de soutien d’un camp impérialiste contre un autre qui vont occuper toute la scène médiatique et sociale, les prolétaires de tous les pays doivent rejeter toute prétendue « solution » au conflit qui vise à les enchaîner dans le soutien à tel ou tel pays, à telle ou telle fraction bourgeoise. Les révolutionnaires doivent combattre pour le seul principe qui mérite d’être défendu, l’internationalisme prolétarien. La seule lutte qui pourra délivrer l’humanité de la barbarie guerrière, c’est la lutte de classe, pour le renversement de ce système miné par la crise et les besoins de l’économie de guerre.Face à la gravité de la situation et l’importance cruciale de défendre l’internationalisme prolétarien, nous modifions le thème de nos prochaines réunions publiques à Marseille et à Bruxelles, initialement prévues pour discuter de notre Manifeste sur l’écologie.
La CCI a récemment publié un Manifeste sur la crise écologique [991], répondant à la question « Est-il possible d’arrêter la destruction de la planète ? » du point de vue de la classe ouvrière et de l’avenir de l’humanité.
Toutes les « solutions » à la crise écologique proposées par la classe dirigeante sont vaines. Le capitalisme est un système fondé sur l’exploitation de la classe ouvrière et de la nature. Dès le début, il s’est fondé sur le saccage et la destruction de l’environnement naturel, mais aujourd’hui, il montre que sa survie est incompatible avec la survie de l’humanité. Le capitalisme est une forme de société obsolète et décadente depuis plus de cent ans. Ce long déclin a atteint une phase terminale, une impasse où la guerre, les crises de surproduction et les destructions écologiques agissent les unes sur les autres pour produire un terrible tourbillon de destruction.
Mais il existe une alternative au cauchemar que réalise le capitalisme : la lutte internationale de la classe exploitée pour le renversement du capitalisme et la construction d’une société communiste.
Pour discuter de ces questions importantes, nous organisons une réunion publique en ligne (en anglais) le samedi 21 juin de 15h00 à 18h00. Pour participer à cette réunion, contactez nous sur : [email protected] [911].
Des réunions publiques physiques sont également organisées à :
- Paris, le 14 juin au CICP 21 ter rue Voltaire 75011 Paris à 15h
- Marseille, le 28 juin à 15h à Mille Bâbords 61 Rue Consolât 13001 Marseille
Le Manifeste sur la crise écologique [991] a été produit en format papier pour être distribué lors des réunions et des manifestations. Il peut également être consulté sur notre site web
Rubrique:
Gaza, l’enfer d’un capitalisme en décomposition!
- 130 lectures
Plus le temps s’écoule, plus les atrocités s’accumulent, plus les mots sont insuffisants pour décrire le mouroir à ciel ouvert de Gaza. Après le carnage mené par le Hamas, le 7 octobre 2023, la riposte israélienne dépasse tous les niveaux de barbarie. La plupart des plus de 50 000 morts causés par les bombardements et les raids de Tsahal sont des civils, des enfants, des prolétaires sans défense. L’armée israélienne vise délibérément des regroupements de civils et les infrastructures vitales et sanitaires, elle pousse volontairement la population à migrer d’un bout à l’autre du territoire de la gigantesque prison qu’est Gaza et à abandonner tout ce qu’elle possède pour essayer désespérément de se maintenir en vie. Maîtresse des frontières de l’enclave, elle affame cyniquement la population en limitant l’approvisionnement en eau et en nourriture, entrave l’entrée de médicaments et de matériel médical indispensable pour soigner les dizaines de milliers de blessés et détruit dans une orgie de violence méthodiquement tout ce qui y a été construit.
Les « grandes démocraties occidentales » multiplient les déclarations horrifiées face aux atrocités. Elles ont des paroles de plus en plus dures envers le gouvernement israélien, mais ne prennent aucune mesure, comme l’arrêt des livraisons d’armes et de munitions, pour arrêter le bain de sang. Ce ne sont que des cris d’orfraie et pour cause ! Des massacres en Irak, en Afghanistan ou au Vietnam aux bombardements au phosphore des villes allemande de Dresde et Hambourg ou les bombes atomiques sur Hiroshima et Nagasaki, les pays occidentaux, comme tous les pays du monde, n’ont jamais reculé devant les massacres les plus atroces pour faire prévaloir leurs sordides intérêts. L’anniversaire du 8 mai 1945, fêté en grande pompe comme la « victoire sur la barbarie nazie », exprime toute l’hypocrisie des dirigeants de ces puissances démocratiques qui s’accommodent du génocide en cours, toujours prêtes à tous les mensonges et toutes les amnésies pour masquer qu’elles-mêmes ont les mains pleines du sang des victimes des massacres coloniaux et des deux guerres mondiales.
Derrière le génocide à Gaza : la barbarie du capitalisme
Cette barbarie déchaînée par les deux camps, même s’ils sont asymétriques, nous la voyons à l’œuvre partout dans le monde : en Syrie et au Liban, au Soudan et au Yémen, par Inde au Pakistan, en Ukraine ou au Congo. Certes, les massacres à Gaza trouvent leur source dans 75 années de confrontations entre bourgeoisies israéliennes et palestiniennes et de grenouillages impérialistes au Proche-Orient, mais ils ont pour fondement une origine commune à tous les conflits, clairement posée par Rosa Luxemburg et Lénine au début du XXe siècle : avec l’entrée du capitalisme dans sa phase de déclin historique, s’ouvrait l’ère de « l’impérialisme, stade suprême du capitalisme ». Tous les États capitalistes doivent désormais défendre leurs intérêts au détriment direct de leurs concurrents internationaux. Aucun État ne saurait se soustraire à cette logique. Aucun État ne pouvant renoncer à défendre sa place sur le marché mondial, tous les coups, même les plus ignobles, les plus barbares, les plus répugnants, sont permis.
La période actuelle, celle de la phase ultime de décomposition du système, ne fait qu’accentuer l’escalade dans la barbarie. Il y a 35 ans dans nos Thèses sur la décomposition, nous écrivions déjà : « Ainsi [nous voyons] le développement du terrorisme, des prises d’otages, comme moyens de la guerre entre États, au détriment des “lois” que le capitalisme s’était données par le passé pour “réglementer” les conflits entre fractions de la classe dominante ». À Gaza, le Hamas utilise des otages comme bouclier humain pour tenter d’endiguer la riposte militaire israélienne, en même temps que l’armée israélienne utilise les deux millions d’habitants de la bande de Gaza comme monnaie d’échange avec son ennemi palestinien. Chaque camp utilise la menace contre les civils dans sa lutte contre son ennemi.
Du fait de la fragmentation politique croissante des factions bourgeoises, une politique orientée vers la défense cohérente des intérêts de l’État apparaît de plus en plus difficile, voire impossible. Ce phénomène qui existe dans tous les pays se traduit par une politique générale de chacun-pour-soi menée par une grande partie de l’appareil politique bourgeois. (1) Ce chacun-pour-soi se traduit en Israël par le fait que, dans sa lutte désespérée pour sa survie politique, Netanyahu est devenu un projectile incontrôlé pour le parrain américain, à la tête d’un gouvernement, intégrant des factions sioniste d’extrême-droite irresponsables qui ne cachent plus leur intention d’appliquer une « solution finale » au problème palestinien, un gouvernement qui ne fait même plus semblant de prendre en considération la vie des otages détenus par le Hamas ou celle des civils palestiniens, en Cisjordanie comme à Gaza. Il n’y a plus qu’une fuite en avant nihiliste dans la barbarie, dont la conclusion ne peut être que l’élimination physique, par le massacre ou l’exil, de l’ensemble des Palestiniens de Cisjordanie et de Gaza. Il s’agit fondamentalement de la même logique que celle du Hamas, celle des classes dominantes incarnant la logique répressive et militariste à outrance : les otages, vivants ou morts, n’ont jamais empêché la population de Gaza de subir des représailles atroces, ni le Hamas de porter le crime et d’exercer sa propre répression contre les Palestiniens manifestant pour arrêter le carnage !
Voilà clairement tout le futur que nous réserve le capitalisme : Le massacre massif de civils à travers des guerres n’épargnant personne, l’appétit de vengeance pure, l’extermination des opposants politiques et des factions ennemies, la destruction totale de villes entières, d’hôpitaux et d’écoles, le développement d’idéologies totalement irrationnelles basées sur la religion, sur des visions complotistes, sur une méfiance envers tous et envers tout. L’aboutissement, c’est la destruction de toute vie organisée pour l’humanité entière et on peut déjà voir que ce cancer qui ronge le capitalisme a des métastases partout sur la planète.
La seule perspective alternative face à cette dynamique destructrice est le développement de la lutte prolétarienne contre les sacrifices humains, économiques, sociaux, culturels qu’impose cette société en décomposition. Le prolétariat est la seule classe dont la perspective propre s’oppose frontalement à celle de la bourgeoisie. Plus que jamais, le seul avenir de l’Humanité est entre les mains de la classe ouvrière, seule classe révolutionnaire dans le capitalisme. Elle seule, par son combat qui n’a pas de frontière, est capable de défendre un principe potentiellement salvateur : celui de l’internationalisme prolétarien. A Gaza comme ailleurs, face aux confrontations impérialistes de plus en plus nombreuses et sanglantes, il n’y a aucun camp, aucun belligérant à soutenir.
HD, le 25 mai 2025
1 L’irruption au pouvoir du gang Trump aux États-Unis en est une expression, mais on retrouve peu ou prou la même situation en Corée du Sud, en Argentine, dans la quasi-totalité des pays européens.
Rubrique:
80 ans de la fin du nazisme: La barbarie du la Seconde Guerre mondiale, c’est celle du capitalisme!
- 135 lectures
À l’occasion des 80 ans de la fin de la Seconde Guerre mondiale, nous republions, ci-dessous, deux articles de L’Etincelle, organe de la Fraction française de la Gauche communiste. En 1945, en pleine hystérie nationaliste, alors que l’Europe était « libérée » du nazisme par les forces Alliées, une poignée de militants révolutionnaires maintenait la flamme de l’internationalisme prolétarien en dénonçant la guerre impérialiste et tous les camps en conflit : la barbarie du nazisme n’était pas un produit de la « folie humaine » mais du capitalisme décadent ; les Alliées, avec leurs bombardements massifs ou leurs bombes nucléaires, n’avaient rien à envier en matière de barbarie à leurs adversaires ; le militarisme demeurait, comme aujourd’hui, le mode de vie du capitalisme décadent.
Au péril de leur vie, ils collaient des affiches, jetaient des tracts dans les trains partant pour le front, lançaient des appels à tous les soldats et ouvriers leur demandant de manifester leur solidarité de classe par-delà les frontières, de cesser le feu et de baisser les armes, de s'unir tous contre le capitalisme mondial.
- « Buchenwald, Maideneck : démagogie macabre », L’Etincelle n° 6 (juin 1945) [993].
Nous republions également deux extraits de notre brochure Fascisme & démocratie deux expressions de la dictature du capital [22] : « Les crimes nazis [994] » et « Les massacres et les crimes des grandes démocraties [995] »
Rubrique:
ICConline - juin 2025
- 28 lectures
Révolution de 1905: Il y a 120 ans, surgissaient la grève de masse et les conseils ouvriers
- 186 lectures
Il y a 120 ans, une vague de grèves spontanées, d’une ampleur sans précédent, surgissait en Russie avec une spectaculaire irruption de colère ouvrière et une conscience de classe aiguisée qui inaugurait une forme de lutte d’une qualité désormais nouvelle pour le prolétariat : celle de la grève de masse. Cette irruption des masses a été une source d’inspiration pour les révolutionnaires de l’époque qui en ont tiré les leçons essentielles pour la lutte de classe, comme le firent Rosa Luxemburg, Trotski et Lénine qui combattaient alors les réformistes avec acharnement.
La révolution de 1905 témoigne aujourd’hui, alors que la classe ouvrière n’a pas encore retrouvé la conscience de sa force, alors qu’elle manque cruellement de confiance en ses capacités et son potentiel politique, de sa réelle puissance historique et de toute la créativité de son être : « cette première lutte générale et directe des classes déclencha une réaction d’autant plus puissante à l’intérieur qu’elle éveillait pour la première fois, comme une secousse électrique, le sentiment et la conscience de classe chez des millions d’hommes. Cet éveil de la conscience de classe se manifeste immédiatement de la manière suivante : une masse de prolétaires découvre tout d’un coup, avec un sentiment d’acuité insupportable, le caractère intolérable de son existence sociale et économique, dont elle subissait l’esclavage depuis des décennies sous le joug du capitalisme. Aussitôt se déclenche un soulèvement général et spontané en vue de secouer ce joug, de briser ces chaînes » (Rosa Luxemburg, « grève de masses, parti et syndicats »).
Cette expérience historique, bien qu’oubliée, reste une référence de tout premier ordre pour le prolétariat mondial, pour ses luttes et son futur révolutionnaire. Et c’est déjà ce que décelait Lénine à cette occasion qui était à l’époque un des rares à avoir su saisir le sens et la signification de l’émergence des premiers conseils ouvriers dans l’histoire, la « forme enfin trouvée de la dictature du prolétariat ». Il s’agissait là ni plus ni moins que d’un mode opératoire du combat de classe initié dans la période d’apogée du capitalisme et qui deviendra celui de toute sa phase de déclin ; cela, jusqu’à la révolution prolétarienne future. La compréhension en profondeur de la signification des événements de 1905, prélude à l’Octobre rouge de 1917, était bel et bien une des conditions de la prise du pouvoir en Russie.
Aujourd’hui, le manque de perspective pour la grande masse des ouvriers qui reprennent le combat après plus de trois décennies d’atonie, tend à réduire son action aux contingences immédiates. En ce sens, mettre en lumière l’expérience des grands combats du mouvement ouvrier, comme le furent les événements de 1905 en Russie, reste vital pour alimenter la réflexion en cours, pour nourrir le processus de maturation souterraine de sa conscience, afin de le relier à nouveau à toute une mémoire historique. Car 1905 n’est pas le simple produit de l’éclatement d’un orage dans un ciel d’azur ! L’événement n’a pu surgir que du fait de toute une expérience antérieure, notamment de tout un processus de maturation souterraine, de digestion politique, d’une lente et longue réflexion qui a suivi de grandes luttes, en particulier à Saint-Pétersbourg et ailleurs durant les années 1890.
Aujourd’hui, même si le contexte est radicalement différent, une réflexion en profondeur tend également à se développer au sein de la classe ouvrière. Après 1968 et durant les différentes vagues de luttes qui ont suivi, celles notamment des années 1980, un pas décisif était nécessaire et il a malheureusement fait défaut : celui de la politisation des luttes. Aujourd’hui, c’est dans le contexte terriblement plus difficile de la décomposition que le prolétariat mène à nouveau une réflexion et qu’il doit parvenir à la réaliser, à hisser son niveau de conscience et sa détermination, sans quoi le capitalisme emportera toute l’humanité dans la barbarie et la destruction.
La grève de masse en 1905 n’était pas un phénomène isolé. Elle était accompagnée par des luttes dans toute l’Europe. Aujourd’hui, une nouvelle génération de prolétaires reprend aussi le chemin de la lutte partout dans le monde, notamment depuis les grèves de « l’été de la colère » en Grande-Bretagne en 2022. Cette génération appartient à toute cette chaîne de combattants qui nous relie aux premières luttes de notre classe, capable de développer sa conscience pour la hisser à un niveau supérieur. Ce processus non linéaire, avec des phases de développement, de reflux et des reculs, caractérise la lutte depuis l’aube du mouvement ouvrier. En republiant la série d’articles de la Revue internationale sur ce que fut cette révolution de 1905, nous espérons contribuer à ces efforts, ceux menés actuellement par la classe ouvrière. Favoriser un processus de maturation en profondeur, difficile, lent et heurté, pour tenter de renouer avec la perspective communiste, avec le combat révolutionnaire contre un monde capitaliste condamné par l’histoire.
– « Il y a 100 ans : la révolution de 1905 en Russie (I) [996] », publié dans la Revue Internationale n°120
– « Il y a 100 ans, la révolution de 1905 en Russie (II) [997] », publié dans la Revue Internationale n°122
– « Il y a 100 ans, la révolution de 1905 en Russie (III) – Le surgissement des soviets ouvre une nouvelle période historique [998] », publié dans la Revue Internationale n°123
– « Il y a 100 ans, la révolution de 1905 en Russie (IV) – Le débat dans l’avant-garde [999] », publié dans la Revue Internationale n°125
Conscience et organisation:
Personnages:
- Rosa Luxemburg [909]
- Lénine [796]
Evènements historiques:
- 1905 [1000]
- Révolution de 1905 [1001]
Rubrique:
Confrontation entre l’Inde et le Pakistan: Le capitalisme, c’est la guerre et le chaos!
- 61 lectures
Le 7 mai, apparemment en réponse à un attentat qui avait fait 28 morts au Cachemire quelques semaines plus tôt, l’armée indienne a déclenché une première attaque contre le territoire pakistanais destiné à détruire les bases des organisations accusées d’avoir commis l’attentat. Les trois jours suivants ont vu une succession de contre-attaques et de nouvelles vagues de bombardements entre l’Inde et le Pakistan, marquant la confrontation la plus intense entre les deux pays depuis des décennies. Une nouvelle angoisse s’est emparée de la population mondiale, s’ajoutant aux ravages de la guerre en Ukraine (près d’un million de soldats morts et blessés), aux épouvantables massacres à Gaza et à une myriade de conflits tous plus barbares les uns que les autres au Soudan (plus de 9 millions de déplacés), au Yémen, au Congo, en Syrie, etc. Une nouvelle éruption de barbarie dans un monde en proie à la guerre et aux carnages !
Cette confrontation militaire est d’autant plus dévastatrice qu’elle implique deux nations surpeuplées, militarisées à outrance (1,2 million de soldats pour l’Inde, 500 000 pour le Pakistan) avec des arsenaux meurtriers comprenant de part et d’autre des armes nucléaires. Elle se déroule dans une région du monde d’une importance stratégique cruciale, où les États-Unis tentent de « couper les ailes » de leur principal challenger : la Chine. Mais plus encore que la « charge explosive » contenue dans ce conflit, c’est le contexte dans lequel ce conflit se déroule qui est le plus dangereux : celui d’une accélération du chaos impérialiste, de la montée du bellicisme et de l’irrationalité, de l’accentuation des tendances au « chacun pour soi ». (1)
Un conflit intensifié par l’explosion du “chacun pour soi”
Le Pakistan et l’Inde ont certes une longue histoire de confrontation, liée à la dissolution de l’Inde britannique, lorsque les deux États sont nés dans un bain de sang (guerre de 1947-1948, des millions de déplacés et 1 million de morts). Depuis, les guerres et escarmouches se sont succédé : en 1965 lorsque le Pakistan a voulu précipiter l’indépendance du Cachemire par rapport à l’Inde, en 1971 lorsque l’Inde a poussé à l’indépendance du Pakistan oriental (actuel Bangladesh), en 1999 lors de la « guerre de Kargil », en 2001 avec l’assaut du parlement indien par un groupe terroriste parrainé par le Pakistan, etc.
Initialement, les affrontements se sont déroulés dans le cadre de la discipline de fer imposée par les blocs impérialistes antagonistes de la guerre froide, le bloc occidental et celui dominé par l’URSS. Depuis les années 1990, en revanche, on assiste à l’effritement de cette discipline de bloc, chaque bourgeoisie nationale réglant seule ses conflits avec d’autres bourgeoisies nationales, en recourant à des conflits de plus en plus sanglants et irrationnels, donc potentiellement particulièrement dangereux. C’est ce que l’on observe en particulier dans le conflit actuel entre l’Inde et le Pakistan :
– Depuis le début des années 1990, l’Inde et le Pakistan ont développé leur arsenal nucléaire, chacun des pays disposant aujourd’hui d’environ 170 têtes nucléaires.
– Au cours du XXIe siècle, les tensions communautaires et religieuses se sont intensifiées. Les massacres sanglants perpétrés par des groupes radicaux islamistes pakistanais se sont multipliés contre des civils et militaires indiens (2001, en Inde, 2019 et 2025 au Cachemire). Le gouvernement indien nationaliste et populiste de Modi, a révoqué l’autonomie constitutionnelle du Cachemire et l’a placé sous l’autorité directe du gouvernement central. Il s’ensuit une répression féroce des Cachemiris et une forte pression sur la minorité musulmane en Inde.
– Lors des affrontements récents, et contrairement aux conflits précédents qui étaient largement limités à la région contestée du Cachemire, les représailles indiennes ont touché trois bases aériennes au cœur du Pakistan (Nur Khan près de Rawalpindi, Murid et Rafiqui). Contrairement aux bombardements précédents effectués dans des régions abritant des milices islamistes opérant au Cachemire, ils ont visé cette fois-ci des centres vitaux de l’armée pakistanaise (Nur Khan abrite le quartier général de l’armée pakistanaise et le centre de contrôle de la riposte nucléaire) et ceci au moyen de drones, d’avions de chasse et de missiles de croisière.
Le risque d’escalade vers un niveau de destruction catastrophique est donc évident, comme le souligne un expert en géostratégie de la région : « Alors que les armées attaquent un plus grand nombre de cibles avec un arsenal d’armes nouvelles en constante évolution, la possibilité d’une catastrophe monte en flèche. Quelle que soit la rationalité des dirigeants indiens et pakistanais, le risque d’erreur de calcul ou d’incompréhension, en l’absence de canaux de communication de crise fiables, rend toute future flambée de violence plus dangereuse ». (2)
Dans la phase actuelle d’accélération de la décomposition capitaliste, la guerre devient de plus en plus irrationnelle et barbare, comme en témoigne encore l’intention du gouvernement Modi d’utiliser les ressources naturelles comme arme de guerre : « l’Inde a pris la mesure sans précédent de suspendre unilatéralement le traité de l’Indus, un accord négocié par la Banque mondiale en 1960 pour gérer le flux d’eau essentiel pour l’hydroélectricité, l’irrigation et l’agriculture au Pakistan. Le traité avait résisté à plusieurs guerres et conflits militarisés entre les deux pays, mais plus maintenant ». (3)
En fin de compte, toutes les parties y perdent sans en retirer aucun gain ou avantage économique ou stratégique, tandis que les factions bourgeoises les plus irresponsables sont renforcées : cette guerre renforce davantage les généraux pakistanais, qui parlent de victoire militaire et appellent à une réponse de plus en plus agressive à l’égard de l’Inde, tout en réprimant brutalement tout mouvement de protestation. Il en va de même en Inde où Modi trouve dans le conflit avec le Pakistan un alibi pour relancer l’hystérie nationaliste et la propagande antimusulmane. Cette situation n’est pas unique. C’est la même chose que ce que nous voyons avec Poutine en Russie ou avec les délires mégalomaniaques de la faction Netanyahu en Israël.
Que le gouvernement indien ait sous-estimé la capacité de réaction du Pakistan (de plus en plus et de mieux en mieux armé par la Chine) ou qu’il ait voulu faire une démonstration de force pour affirmer ses capacités militaires face au Pakistan, à la Chine et aux Américains n’est qu’une question de conjectures. Ce que l’on peut prévoir sans aucun doute, en revanche, c’est que ce jeu macabre d’ambitions impérialistes va s’intensifier et que le fragile cessez-le-feu « négocié » par l’administration américaine (intervention d’ailleurs niée par l’Inde) ne résistera pas à la tendance dominante à la guerre et au chaos dans laquelle s’enfonce le capitalisme. Car ce ne sont pas les crapules dirigeantes en Inde et au Pakistan qui sont responsables en dernier ressort de la prolifération et de l’aggravation des massacres impérialistes : la cause première des massacres en cours et à venir, c’est l’« ordre » capitaliste pourrissant.
Dénonçons les campagnes nationalistes !
Les bourgeoisies indienne et pakistanaise appellent les travailleurs à se rallier au drapeau national pour défendre « l’honneur outragé de la patrie ». Quelle hypocrisie criminelle !
Dans la guerre en Ukraine, tous les belligérants sacrifient des centaines de milliers d’êtres humains pour la conquête de quelques misérables km2 d’une terre ravagée par les combats. Au Moyen-Orient, toutes les factions en guerre utilisent la terreur pour dévaster une région en ruines et massacrer de la manière la plus barbare les populations.
Au Pakistan même, des régions entières deviennent inhabitables par des conflits armés internes et par des inondations massives, tandis que les conflits ethniques et religieux déchirent l’Inde. Alors que le capitalisme, sous l’effet de ses propres contradictions, s’enfonce inéluctablement dans le chaos, toutes les fractions de la classe exploiteuse du monde entier n’ont plus rien à offrir que le sacrifice des prolétaires sur l’hôtel de leurs sordides et barbares ambitions impérialistes. Et dans la perspective d’une confrontation entre les puissances atomiques indienne et pakistanaise, tout comme des menaces contre le nucléaire iranien ou du bombardement de la centrale nucléaire de Zaporiya, le risque d’un accident nucléaire majeur devient de plus une option à redouter.
Il n’y a qu’une seule alternative : le développement de l’internationalisme prolétarien, le refus de lutter contre nos frères et sœurs de classe. Tous les travailleurs du monde ont le même intérêt. Nous sommes les principales victimes de la guerre, envoyés au front comme chair à canon ou otages surexploités jusqu’à l’épuisement pour payer un effort d’armement qui s’accroît partout dans le monde.
Le prolétariat n’a pas encore la force d’empêcher la prolifération des guerres, mais il peut l’acquérir par ses luttes contre les attaques capitalistes sur ses conditions de vie. Une telle lutte se déroule dans de nombreux pays et dans ces luttes, les travailleurs tendent à se reconnaître comme une même classe. Ils constatent progressivement qu’ils ont tous les mêmes ennemis : les exploiteurs, quelles que soient leur couleur, leur religion ou leur nationalité.
Valerio, 31 mai 2025
1 Cf. « Résolution sur la situation internationale de notre 26 ème Congrès international [1002] », publiée sur le site web du CCI.
2 Aqil Shah cité dans « The Next War Between India and Pakistan », Foreign Affairs (23 mai 2025).
3 Idem.
Géographique:
Personnages:
- Modi [703]
Récent et en cours:
- Guerre Inde-Pakistan [1004]
Rubrique:
Face aux assauts xénophobes de Trump contre la classe ouvrière et au cri de “défense de la démocratie”… la classe ouvrière doit développer sa lutte sur son propre terrain!
| Fichier attaché | Taille |
|---|---|
| 166.49 Ko |
- 247 lectures
Face aux rafles d’immigrés sans papiers et à l’envoi de forces militaires à Los Angeles contre ceux qui manifestaient contre ce nouvel « exploit » de Trump, un de nos sympathisants très proches vivant aux États-Unis a pris l’initiative de rédiger un tract qu’il se proposait de distribuer autour de lui. Le CCI a pleinement encouragé cette initiative. Nous estimons que le document finalement rédigé par le camarade correspond tout à fait à l’analyse que fait le CCI de ces événements et à la nécessaire dénonciation du jeu sordide des différentes forces de la bourgeoisie dans cette situation : autant la brutalité cynique de la répression policière et militaire que l’hypocrisie de ceux qui la dénoncent au nom de la « défense de la démocratie ».
C’est de façon très valable que ce document analyse les causes historiques de la politique de l’administration Trump, une politique qui fait partie du chaos grandissant dans lequel s’enfonce de plus en plus un capitalisme mondial en putréfaction. C’est également avec beaucoup de clarté que le document met en évidence que la persécution contre les immigrés constitue une attaque contre l’ensemble du prolétariat et que seule cette classe peut apporter une réponse à la fois immédiate et historique en se mobilisant sur son propre terrain contre la barbarie croissante du système capitaliste. C’est pour l’ensemble de ces raisons que nous faisons nôtre ce document et que nous le considérons comme une première prise de position de notre organisation face aux affrontements sociaux qui se déroulent actuellement à Los Angeles et dans de nombreuses autres villes des États-Unis.
Le document signale fort justement la faiblesse actuelle du prolétariat des États-Unis. C’est une réalité, mais les multiples grèves et mobilisations qui se sont déroulées depuis 2022 (grèves massives dans le secteur automobile en 2023 ; dans les usines de Boeing et chez les dockers dans une quarantaine de ports de la côte Est en 2024…) sont la preuve que la classe ouvrière de ce pays porte avec elle la capacité de mener des combats de grande amplitude et de rejoindre le moment venu la lutte du prolétariat mondial pour son émancipation.
Depuis son entrée en fonction en janvier, Donald Trump a massivement intensifié la campagne de terreur contre certains des travailleurs les plus précaires des États-Unis, menaçant d’arracher des personnes à leur famille et à leur communauté sous prétexte qu’elles n’ont pas de papiers en règle. Il accompagne cela de sa rhétorique révoltante : un déluge constant de mensonges, de théories du complot et de xénophobie provenant de la Maison Blanche est destiné à attiser les divisions au sein de la classe ouvrière, tandis que les agents de l’ICE (police anti-immigration) menacent ceux d’entre nous qui sont le moins en mesure de se défendre. Diviser pour mieux régner, telle est sa devise. Mais si, comme le veut le cliché, les États-Unis sont une « nation d’immigrants », nous pouvons ajouter que la migration a toujours été la condition de la classe ouvrière. Depuis l’aube du capitalisme, les travailleurs ont été contraints de se déplacer d’un endroit à l’autre en fonction des caprices du capital ou, comme c’est de plus en plus le cas aujourd’hui, de fuir les guerres dévastatrices et l’instabilité d’un système mondial qui pourrit sur pied. Nous devons donc être absolument clairs : la campagne de terreur de Trump contre les travailleurs sans papiers n’est rien d’autre qu’une attaque directe contre la classe ouvrière américaine, une classe d’immigrés ! Et, selon le mot d’ordre historique du mouvement ouvrier dans ce pays : Un préjudice pour l’un est un préjudice pour tous !
Le projet de budget de Trump est une attaque en règle contre la classe ouvrière
Alors que Trump tente grossièrement de monter les travailleurs américains les uns contre les autres, son projet de budget à la tronçonneuse se traduirait par des coupes de près de 1 000 milliards de dollars dans Medicaid au cours des dix prochaines années, ainsi que des attaques similaires contre le SNAP (Programme d’aide alimentaire), les prêts étudiants fédéraux et les pensions des employés fédéraux. Et tout cela en allouant au moins 350 milliards de dollars supplémentaires à l’armée et à l’application des lois sur l’immigration. Et la réalité est que cela ne s’arrêtera pas là. Confrontée à une crise économique de plus en plus grave et à une position de plus en plus faible sur la scène mondiale, la bourgeoisie américaine (quel que soit le parti au pouvoir) ne peut répondre que par des attaques féroces contre la classe ouvrière et des tentatives de plus en plus irrationnelles pour maintenir la portée et l’influence mondiales de l’impérialisme américain. Que ce soit en Europe, en mer de Chine méridionale, au Moyen-Orient ou en Afrique, l’avenir ne peut qu’annoncer toujours plus de sacrifices pour la classe ouvrière concernant ses conditions de vie pour les intérêts de nos ennemis de classe.
Défense de la démocratie et populisme xénophobe : deux poisons pour la classe ouvrière
Pour les éléments les plus « rationnels » de la bourgeoisie américaine, les manœuvres internationales erratiques et imprévisibles de Trump (qui ébranlent des alliances autrefois fondamentales de la stratégie impérialiste américaine)constituent une grave préoccupation. En outre, le fait qu’il ait pu s’assurer un soutien beaucoup plus important de la part de l’armée et des services de renseignement menace deux remparts qui ont permis de contenir son pouvoir au cours de son premier mandat. Mais surtout, il menace l’une des armes idéologiques les plus puissantes brandies par la bourgeoisie contre le développement de la conscience de la classe ouvrière dans ce pays : la démocratie bourgeoise.
Au niveau international, la démocratie est depuis longtemps le cri de l’impérialisme américain pour justifier toutes ses aventures, de la Première Guerre mondiale à l’Irak et à l’Ukraine. Et bien sûr, le régime israélien qui cible les hôpitaux, les universités et les enfants dans sa campagne génocidaire à Gaza se déclare la « seule démocratie au Moyen-Orient », avec le soutien des États-Unis. De même, les États-Unis présentent leurs interventions militaires comme ayant un but humanitaire, par exemple pour protéger les droits des Kurdes en Irak ou des femmes en Afghanistan. Mais pour la bourgeoisie libérale, tout cela disparaît lorsqu’il s’agit des actions des États-Unis ou d’un allié comme Israël. Sur le plan intérieur, malgré toute l’indignation feinte du Parti démocrate, Obama et Biden ne sont que juste derrière Trump en ce qui concerne le nombre de personnes expulsées. Pour cette faction de la bourgeoisie, il est également important de terroriser constamment ce secteur de la population afin qu’il reste le plus facilement exploitable. C’est ainsi que le maire de Los Angeles déplore l’impact des déportations massives sur l’économie locale. Enfin, les démocrates crient aujourd’hui à la « défense de la démocratie » contre l’autoritarisme de Trump.
La classe ouvrière ne peut pas se laisser enfermer dans la fausse alternative entre autoritarisme et démocratie ! En fin de compte, le rôle principal de cette campagne est de rediriger toute opposition des travailleurs aux coupes brutales et à l’application militarisée de l’immigration de Trump vers le processus électoral stérile. Il est illustratif que ceux qui mènent la charge pour les Démocrates contre Trump soient des individus comme Gavin Newsom (qui ambitionne de remporter la prochaine présidence) et ceux de l’aile gauche « socialiste » du parti qui prétendent « représenter » la classe ouvrière. Bernie Sanders, Alexandria Ocasio-Cortez et d’autres du même acabit, y compris les organisations qui se placent encore plus à gauche : la DSA (organisation socialiste démocrate), le PSL (Parti pour le Socialisme et la Libération), le CPUSA (Parti Communiste des États-Unis d’Amérique), la RCA (Parti Communiste révolutionnaire) etc, peuvent toujours prétendre s’opposer à ce système mais, en réalité, ils défendent des programmes pour sa gestion et attirent la classe ouvrière loin de sa propre lutte et vers des impasses et des actions stériles. Ils ne sont que l’avant-garde de la campagne visant à étouffer la lutte des travailleurs dans le berceau. La classe ouvrière ne doit pas oublier qu’en fin de compte, même si Trump est le représentant le plus repoussant de la bourgeoisie, ce que même les éléments les plus à gauche de la classe dirigeante craignent le plus, c’est leur ennemi de classe. Et le moment venu, l’histoire montre qu’ils se tiendront aux côtés de leurs frères de classe et tireront pour tuer au nom de ce système moribond.
Trump est le produit d’un système pourri jusqu’à la moelle
Cela fait plus de cent ans que le capitalisme a atteint son objectif de diviser le monde entier en marchés nationaux et qu’il est entré dans sa phase de déclin. Depuis lors, l’expansion d’une bourgeoisie nationale ne peut se faire qu’aux dépens d’une autre. C’est pourquoi la guerre impérialiste permanente est à l’ordre du jour. Mais après un siècle de déclin, ce système et sa classe dirigeante ont commencé à devenir de plus en plus séniles. La rhétorique infâme du nationalisme xénophobe, la diabolisation des immigrés, des minorités raciales, des homosexuels et des transsexuels (tactiques de longue date d’une classe déterminée à survivre à tout prix en divisant son ennemi de classe) se sont enracinées avec force dans le monde entier. Parallèlement, les théories conspirationnistes les plus irrationnelles ont trouvé un écho parmi les représentants les plus éminents de la bourgeoisie. Enfin, la scène mondiale, autrefois strictement contrôlée par les États-Unis et l’URSS, est devenue extrêmement chaotique. Ainsi, les phénomènes qui sont peut-être les plus apparents aux États-Unis ne s’y limitent pas. La montée du populisme trumpiste n’est pas un accident de parcours ou le résultat des actions d’un individu particulièrement répugnant : Trump est avant tout le produit d’un système en déclin et le représentant d’une classe incapable d’offrir une quelconque perspective à l’humanité.
Seule la classe ouvrière a une réponse !
Contre les attaques abominables de l’administration Trump contre les immigrés sans papiers, face à la campagne visant à s’aligner derrière les Démocrates ou leurs complices de gauche pour « défendre la démocratie », et à la lumière de la menace crédible que le capitalisme va (par la guerre impérialiste, la destruction écologique ou la désintégration sociale) détruire l’humanité, il n’y a qu’une seule force sociale capable de se battre pour un monde meilleur. La route est longue, mais la classe ouvrière doit se battre sur son propre terrain : en défendant ses intérêts économiques fondamentaux et en exprimant sa solidarité avec ses frères de classe, quelle que soit leur nationalité. Cela fait de nombreuses années que la classe ouvrière américaine n’a pas véritablement déployé ses muscles et il lui faudra beaucoup de temps pour retrouver ses marques, mais c’est la seule façon d’avancer. En attendant, les individus qui comprennent cette nécessité brûlante doivent se réunir partout où c’est possible, discuter, tirer les leçons des luttes passées et préparer l’avenir.
Pour le développement international de la lutte des classes !
« Les travailleurs n’ont pas de patrie ! »
« Travailleurs du monde, unissez-vous ! »
Un sympathisant du Courant communiste international
13 juin 2025
Vie du CCI:
- Interventions [492]
Géographique:
- Etats-Unis [184]
Personnages:
- Donald Trump [896]
Rubrique:
Guerre Iran/Israël: Le capitalisme s’enfonce dans un chaos guerrier généralisé!
- 253 lectures
Une nouvelle offensive meurtrière d’Israël sur l’Iran bat son plein depuis plusieurs jours à laquelle répond un déluge de missiles de la République islamique qui, malgré la supériorité militaire israélienne, a provoqué de nombreux dégâts et plusieurs victimes. Pour le moment, le brouillard de la propagande de guerre ne permet pas d’évaluer l’ampleur du massacre, mais c’est un déluge de feu qui s’abat de part et d’autre : tandis que l’Iran vise à l’aveugle les villes de l’État hébreu et quelques sites symboliques, Tsahal a, semble-t-il, surtout ciblé les installations nucléaires iraniennes susceptibles de produire l’arme atomique mais aussi le personnel scientifique et les responsables du programme nucléaire, ainsi que les chefs militaires et religieux susceptibles d’encadrer la riposte. Cette opération de « légitime défense » (selon Trump) a causé au moins plusieurs centaines de victimes civiles en Iran.
L’objectif de décapiter la force de frappe iranienne et de briser sa riposte en dit long sur la volonté d’Israël d’aller beaucoup plus loin qu’en avril dernier lorsque Tsahal avait ciblé le consulat iranien à Damas pour éliminer plusieurs chefs militaires, et en septembre suivant avec l’assassinat du secrétaire général du Hezbollah, Hassan Nasrallah. Le gouvernement de Netanyahou dissimule à peine sa volonté de voir s’effondrer le régime des Mollahs et d’enfoncer son grand rival régional dans le chaos.
Jusqu’à présent, l’Iran avait tenté de répondre aux provocations sans réelle capacité à déstabiliser directement Israël, mais en accroissant surtout la pression au moyen des organisations terroristes qu’il parraine (Houthis, Hezbollah…) et en soutenant la Russie dans le conflit ukrainien. Face au risque de déstabilisation, voire d’effondrement de leur régime, les « gardiens de la révolution » n’ont d’autre choix que de miser sur la fuite en avant dans le chaos et la barbarie. Faute de pouvoir vaincre l’État hébreu, la République islamique a sans aucun doute les moyens d’entraîner la région entière dans sa chute.
Le véritable responsable des guerres, c’est le capitalisme !
Ce conflit n’est pas un « fait isolé », ni le produit de la seule « folie » meurtrière de l’extrême droite israélienne ou du « fanatisme » assassin des Mollahs : il est l’expression d’un système capitaliste à bout de souffle ! Après chaque conflit, chaque massacre, la presse et les politiciens accusent tel ou tel État, tel ou tel dirigeant : « Ici, c’est la faute à la folie de Poutine ! », « Là, c’est la faute aux délires messianiques de Netanyahou », « Non, à la barbarie du Hamas ! », « À celle de l’impérialisme américain ! », « Au néocolonialisme de la France ! », « À l’expansionnisme chinois ! »… Certes, tous ces États, petits ou grands, tous ces dirigeants, de gauche ou de droite, extrémistes ou « démocrates », font preuve d’une barbarie sans borne et d’un cynisme glaçant. Mais ils agissent tous au sein d’un système en crise et sans avenir où la concurrence de tous contre tous pousse chaque nation à intervenir sur la scène internationale avec une sauvagerie croissante.
Aujourd’hui, avec cette nouvelle guerre ouverte, nous ne pouvons que constater le pas supplémentaire très grave, l’accélération de la dynamique du militarisme et du chaos. Un chaos qui gangrène de plus en plus le monde avec des conflits qui s’enkystent, une fuite en avant générant des bourbiers sans fin qui provoquent des monceaux de cadavres et des destructions à grande échelle. Au Moyen-Orient, en Ukraine, en Afrique ou ailleurs, les conflits incontrôlables ne font que se multiplier et s’élargir davantage, sans qu’aucun espoir de paix durable n’apparaisse, ni qu’aucun belligérant ne puisse imposer un « ordre » ou même tirer un quelconque profit de tels massacres ! En Ukraine, les belligérants sacrifient absurdement des dizaines de milliers de vies pour le moindre mètre carré en ruine, espérant apparaître en position de force lors d’hypothétiques négociations. Au Soudan, la guerre « oubliée » reste plus dévastatrice que jamais avec plus de 150 000 morts et plus de 13 millions de déplacés en seulement deux ans ! [1006] Entre l’Inde et le Pakistan, le cessez le feu temporaire après les confrontations violentes de ces dernières semaines ne rassure personne sur la dangerosité des tensions entre ces deux puissances nucléaires. Au Yémen, la guerre menée par les rebelles houthistes sur leur sol et en Mer Rouge, comme les ripostes israéliennes, saoudiennes et américaines, ont engendré des dizaines de milliers de morts et une immense catastrophe humanitaire. Ces déstabilisations incontrôlables de régions entières, visibles également au Liban, en Syrie, en Libye, dans toute l’Afrique sub-saharienne ou dans les guerres de gangs en Haïti, s’aggravent réellement de jour en jour !
Le Moyen-Orient est ainsi pris dans une spirale infernale où de plus en plus d’acteurs entrent dans l’arène pour tenter d’imposer leurs sordides intérêts : sur le terreau pourri de l’historique conflit israélo-palestinien, l’attaque du Hamas d’octobre 2023 (au moins soutenue par l’Iran, si ce n’est directement pilotée) a engendré une série de conflits embrasant de plus en plus de pays dans la région : Liban, Yémen, attaque opportune des rebelles islamistes en Syrie, opérations de la Turquie à sa frontière… Et c’est maintenant au tour de l’Iran, jusque-là actif dans la coulisse, d’entrer durablement en scène !
Tsahal a (potentiellement) réussi à décapiter le programme nucléaire iranien et nombreuses sont les chancelleries, à commencer par Washington, à se féliciter du succès de l’opération « Rising Lion ». Mais cette barbarie guerrière absurde ne bénéficiera, à terme, à personne ! Israël a réussi un coup, mais à quel prix ? Non seulement Netanyahu en jouant avec la politique irresponsable de la terre brûlée accélère encore le discrédit et l’isolement d’Israël sur la scène internationale, mais il expose son pays à un environnement encore plus chaotique : l’Iran est obligé de riposter, même si cela l’expose davantage à un ennemi très supérieur militairement. Une situation très grave qui peut même conduire à un effondrement militaire et politique du pays qui possède des frontières communes avec l’Irak, le Koweït, le Pakistan et l’Afghanistan. Avec ses réserves de pétrole et le contrôle qu’il exerce sur le détroit stratégique d’Ormuz, l’Iran est aussi un acteur économique mondial de premier plan. Et la République islamique n’hésitera pas à jouer avec tous les risques d’extension et d’intensification du chaos si elle se sent en danger. D’ailleurs, les autres requins impérialistes comme la Turquie, l’Arabie Saoudite ou les pays du Golfe ne sont pas en reste et sont aussi aux premières loges, dans cette poudrière, pour tenter, non d’apaiser la situation, mais de déstabiliser de tel ou tel concurrent. La boîte de Pandore continue donc de cracher sa vermine ! La guerre ne pourra que s’éterniser et porter les confrontations à un niveau bien supérieur, même si le désir de Netanyahu de voir le régime des Mollahs s’effondrer pouvait rapidement se réaliser !
Face à la guerre impérialiste, le seul camp à choisir : c’est celui de la révolution prolétarienne !
Les « bonnes volontés » pacifistes n’y pourront rien : le capitalisme, c’est la guerre ! La bourgeoisie est incapable de stopper cette machine infernale ! Seule la révolution prolétarienne, en renversant le pouvoir de la bourgeoisie partout sur la planète, pourra libérer l’humanité de cette menace de plus en plus meurtrière et omniprésente.
Mais le chemin vers la révolution est encore long, même très long. Comme nous l’avons montré depuis 2022 dans notre presse, le prolétariat renoue désormais avec sa combativité, commence peu à peu à retrouver ses forces et son identité de classe. De toutes petites minorités en son sein cherchent même à renouer avec les positions révolutionnaires. Mais le prolétariat, s’il détient les clefs de l’histoire, n’a pas encore la force et la conscience de s’opposer à la guerre en tant que classe, d’opposer à la barbarie guerrière du capitalisme sa propre perspective de transformation révolutionnaire de la société.
La bourgeoisie est parfaitement consciente de ces faiblesses et mobilise tout son arsenal idéologique pour empêcher la maturation de la conscience de classe. Les prolétaires du monde entier doivent apprendre à se méfier des discours de la bourgeoisie, en particulier ses chapelles de gauche et d’extrême-gauche du capital (trotskistes, en particulier), destinés à légitimer, de manière prétendument critique, la politique d’un camp impérialiste en présence ou de l’autre. C’est le sens de la différence subtile que font certaines variétés du trotskisme entre agresseurs et agressés : « L’Iran a tout à fait le droit de riposter contre Israël, et nous devons nous opposer à l’attaque brutale d’Israël contre le peuple iranien ». (1) C’est la même confusion qu’induisent les appels aux dirigeants d’autres pays à rompre les liens avec Israël : « À bas l’agression israélienne contre l’Iran ! […] Macron, assez d’hypocrisie ! Rompez immédiatement tous les liens diplomatiques, militaires, économiques, commerciaux avec Israël ! ». (2) Derrière un langage soi-disant révolutionnaire, tous ces mystificateurs professionnels nous ont vendu pendant des mois leur camelote idéologique avec la « défense du peuple palestinien », c’est-à-dire le soutien au nationalisme palestinien dirigé par le Hamas, clique bourgeoise de la pire espèce largement soutenue et financée par l’Iran. Maintenant que les Mollahs doivent affronter plus directement Israël, les trotskistes plongent un peu plus dans la fange (si cela était encore possible) en appelant la classe ouvrière à soutenir la République islamique (pardon !… « le peuple iranien ») !
Face à la dynamique de pourrissement du capitalisme, toutes les nations, qu’elles soient puissantes ou faibles, n’ont plus rien à offrir que la guerre et la misère. Que ce soit au nom du « droit international », des « luttes de libération nationale » ou de la « lutte contre l’impérialisme », tous ces partis bourgeois, qui cherchent à faire croire qu’une solution de « paix » existe dans le capitalisme, qui poussent à soutenir les prétendus « agressés », font partie des plus dangereux ennemis de la classe ouvrière et cherchent à la détourner de son combat historique.
Car aujourd’hui, c’est dans la lutte de la classe ouvrière contre la dégradation généralisée de ses conditions de vie et de travail, conséquence de la crise historique du capitalisme et de l’augmentation considérable des budgets militaires, que la classe ouvrière pourra développer et politiser sa lutte en vue du renversement du capitalisme et de l’instauration d’une société sans nations, sans guerre et sans exploitation.
Stopio, 17 juin 2025
1 « Key questions about Israel’s escalation of war in Iran », Socialist Workers Party (juin 2025).
2 Le Parti des travailleurs en « délégation » à l’Élysée, le 11 juin.
Géographique:
- Moyen Orient [60]
- Iran [565]
- Israel [260]
Personnages:
- Benyamin Netanyahou [951]
Rubrique:
Guerre Israël, Iran, États-Unis: Un pas de plus dans le chaos guerrier!
- 187 lectures
Le bombardement massif par les États-Unis, dans la nuit 21 au 22 juin, de cibles militaires en Iran constitue une nouvelle étape de l’aggravation des tensions et du chaos guerrier, de la désolation et la barbarie sans trêve dans la région.
Face la gamme étendue des différentes formes de soutien d’un camp impérialiste contre un autre qui vont occuper toute la scène médiatique et sociale, les prolétaires de tous les pays doivent rejeter toute prétendue « solution » au conflit qui vise à les enchaîner dans le soutien à tel ou tel pays, à telle ou telle fraction bourgeoise. Les révolutionnaires doivent combattre pour le seul principe qui mérite d’être défendu, l’internationalisme prolétarien. La seule lutte qui pourra délivrer l’humanité de la barbarie guerrière, c’est la lutte de classe, pour le renversement de ce système miné par la crise et les besoins de l’économie de guerre.
Face à la gravité de la situation et l’importance cruciale de défendre l’internationalisme prolétarien, le CCI organise une réunion publique internationale en ligne, le samedi 28 juin à 15h (heure de Paris). Les lecteurs qui souhaitent participer à cette discussion peuvent adresser un message sur notre adresse électronique ([email protected] [213]) ou dans la rubrique « nous contacter [214] » de notre site internet. Les modalités techniques pour se connecter à la réunion publique seront communiquées ultérieurement.
Il sera possible de se rassembler physiquement pour participer à la réunion dans les ville suivantes :
- Marseille, le 28 juin à 15h. Adresse : Mille Bâbords 61 Rue Consolât 13001 Marseille
- Bruxelles, le 28 juin 2025 à 15h. Adresse : Pianofabriek - Rue du Fort 35, 1060 Saint-Gilles
Vie du CCI:
- Réunions publiques [219]
Rubrique:
ICConline - juillet 2025
- 17 lectures
Répression des migrants aux États-Unis: Face aux rafles, notre solidarité, c’est la lutte de classe!
- 93 lectures
Depuis le 6 juin dernier, l’administration Trump a décidé d’intensifier spectaculairement la politique anti-migrants de la bourgeoisie américaine en organisant des véritables chasses à l’homme contre les immigrés sans papiers, concentrées en particulier en Californie dans la région de Los Angeles, deuxième ville du pays, où vivent de nombreux ouvriers d’origine latino-américaine.
Les rafles de migrants : une attaque contre toute la classe ouvrière
Comme nous l’avons souligné dans un tract écrit par un sympathisant proche du CCI, 1 cette provocation menée avec une brutalité extrême constitue une attaque contre l’ensemble du prolétariat. Ce sont nos frères de classe, la plupart du temps exploités dans des conditions difficiles, que la police traque et réprime. Ces descentes de la police fédérale de l’immigration (ICE) pour traquer, arrêter, entasser et expulser manu militari les migrants en allant les cueillir sur leur lieu de travail (chantiers, fabriques, commerces…) ont largement rappelé les scènes de rafles en Europe lors de la Seconde Guerre mondiale exercées contre les populations d’origine juive ou tzigane pour les déporter.
Cela a suscité des réactions de solidarité, d’indignation et de dégoût dans une large partie de la population, mais plus particulièrement parmi les exploités qui se sont mobilisés, y compris spontanées, et sont parfois parvenues à empêcher des arrestations, comme à Paramount dans la banlieue ouvrière de Los Angeles.
Se mobiliser en tant que citoyens nous réduit à l’impuissance
Mais ces réflexes initiaux de solidarité ont été immédiatement exploités et instrumentalisés par la bourgeoisie comme cela s’est déjà produit, en 2020, après l’assassinat de Georges Floyd à Minneapolis par des policiers. La bourgeoisie avait totalement détourné ces réflexes de solidarité derrière des marches de protestations encadrées par le mouvement antiraciste Black Lives Matter afin de réclamer plus de justice et d’égalité, voire l’abolition de la police… à l’État capitaliste, le fer de lance de l’exploitation et de la défense de l’ordre bourgeois !
De même aujourd’hui, les « comités de défense » (ceux du Los Angeles Rapid Response Network, notamment), composés de syndicats et de plusieurs organisations et associations de la gauche du capital, ont pu immédiatement canaliser les tentatives de réponses sur le terrain pourri de la « défense de l’État de droit », de la « solidarité citoyenne », de « l’anti-trumpisme »… c’est-à-dire les mêmes mystifications démocratiques qui conduisent inévitablement à désarmer le prolétariat, à désamorcer ses luttes, en faisant croire qu’il serait possible de rendre le capitalisme plus juste et humain. Nulle part les mobilisations ne sont exprimées sur un terrain de défense des intérêts de classe ouvrière, contrairement, par exemple, à ce qui s’était passé en 1917 en Russie lorsque la violente répression des manifestations lors de la journée internationale des femmes avait été le point de départ de l’extension des mouvements de grève ayant servi de détonateur à la vague révolutionnaire. De même, en février 1941, en pleine guerre, alors que les conditions de la lutte étaient extrêmement difficiles, les travailleurs d’Amsterdam, s’étaient mis en grève contre la déportation des Juifs. Entre le 22 mars et le 13 mai 1968, la répression féroce des étudiants avaient également mobilisé la classe ouvrière portée par ses élans instinctifs de solidarité.
Aujourd’hui, à l’inverse, comme le prolétariat n’est pas encore capable de répondre à la répression sur son terrain de classe, la bourgeoisie peut facilement le conduire vers des impasses et le réduire à l’impuissance. Ce n’est pas en tant que classe que les prolétaires de Los Angeles se sont mobilisés, mais en tant qu’individus indignés, voire en tant que citoyen. Dans ce contexte, les ouvriers présents dans ces mobilisations ne pouvaient nullement étendre la lutte à l’ensemble du prolétariat pour constituer un véritable rapport de force de classe contre la répression. Cela ne peut que favoriser l’instauration d’un climat de terreur et l’exacerbation des tensions entre communautés et alimenter les divisions entre prolétaires en favorisant le surgissement d’émeutes populaires impuissantes à l’instar des émeutes raciales du passé, nombreuses aux États-Unis et comme celles de 1992 en Californie après l’acquittement des policiers responsables des violences exercées sur le chauffeur de taxi Rodney King l’année précédente. Cela n’a fait que susciter soit des heurts et des affrontements sans aucune perspective avec la police et des blocages de circulation totalement stériles, soit engendrer des actions désespérées, des scènes de pillages, de vandalisme ou d’incendies de voitures… Bref, des piqûres de moustique sur le cuir épais de la bourgeoisie qui ont justifié un énorme déploiement de l’appareil répressif pour assurer le maintien de l’ordre public. C’est précisément le « maintien de l’ordre » qui a aujourd’hui servi de prétexte au gouvernement pour faire appel à l’armée avec l’envoi de plus de 4 000 réservistes de la garde nationale et de 700 marines, justement qualifiés par le passé de « chiens de guerre » dressés à tuer (et particulièrement redoutés) pour quadriller la ville.
Le piège des campagnes démocratiques tendu par la bourgeoisie
Ce climat a également laissé le champ libre à une fraction de l’appareil du Parti démocrate pour dénaturer ces réactions élémentaires de solidarité et entraîner les prolétaires dans une vaste campagne idéologique sur le terrain totalement pourri de la défense de la démocratie bourgeoise et des droits des « citoyens », du non-respect des lois et de la Constitution américaine. Ce cheval de bataille a été mis en avant en particulier par le gouverneur de Californie, Gavin Newsom, qui se présente déjà comme candidat potentiel à la prochaine présidentielle en multipliant les déclarations d’opposition à la politique de Trump, accusant ce dernier « d’abus de pouvoir », d’avoir procédé à des « enlèvements illégaux » sans passer par l’aval des autorités locales, d’avoir « pris un virage vers l’autoritarisme », de « se comporter comme un tyran » pour « réaliser le fantasme fou d’un président dictatorial », ajoutant que « son comportement menace le fondement même de notre démocratie ». 2 La maire démocrate de Los Angeles, Karen Bass, n’est pas en reste dans ce torrent hypocrite d’invectives. 3 En outre, le procureur général de Californie a déclaré avoir engagé une procédure de destitution de Trump devant les tribunaux pour « violation » de la Constitution américaine. Cette campagne anti-Trump s’est propagée très rapidement à l’ensemble du territoire, notamment dans d’autres grandes villes : San Francisco et Santa Ana en Californie, Dallas, Austin au Texas mais aussi à Chicago, Minneapolis, Atlanta, Boston, New York, etc.
Cette campagne très médiatisée pour la défense de la démocratie a du même coup permis de relancer la propagande anti-populiste, variante de la fausse opposition fascisme/antifascisme,4 déjà mise en avant par les franges les plus « radicales » du parti démocrate derrière Bernie Sanders et Alejandra Ocasio-Cortez et par le mouvement « Hands Off ! » (« Bas les pattes ! »), il y a quelques mois. Cette assimilation s’appuie aussi sur la protestation contre les méthodes « dictatoriales » de Trump aux États-Unis et elles ont été largement relayées par une vaste propagande anti-trumpienne au niveau international. Elle correspond, en réalité, à une gigantesque intoxication idéologique en désignant Trump comme le responsable de tous les maux pour mieux dédouaner le capitalisme et faire obstacle au développement d’une prise de conscience de la faillite irrémédiable d’un système d’exploitation en pleine putréfaction dont le populisme et Trump ne sont qu’une expression caricaturale.
Cependant, cette campagne idéologique revêt en apparence une certaine crédibilité car il existe une réelle mobilisation de certaines fractions bourgeoises américaines contre la politique de Trump et qui s’en inquiètent pour deux raisons essentielles :
– d’une part, ces fractions sont conscientes des dangers de cette politique qui ne fait que générer davantage de chaos, affaiblissant la crédibilité et ternissant l’image des États-Unis au niveau international et, sur le plan intérieur, accentuant les fractures sociales, risquant même à terme de créer un climat de guerre civile ;
– d’autre part, elles sont persuadées (et cela à juste titre) que cette politique ouvertement xénophobe va avoir des répercussions catastrophiques pour l’économie américaine en la privant d’une main-d’œuvre bon marché qui a permis jusqu’ici de maintenir à flots beaucoup d’entreprises ou de secteurs et de faire fructifier l’économie nationale. Les employeurs de plusieurs secteurs de l’économie ont ainsi exprimé leur inquiétude face à ces raids. Trump, lui-même, a finalement reconnu que ses politiques d’immigration nuisaient aux agriculteurs, aux hôtels et aux restaurants. Peu après, il a temporairement suspendu les raids contre ces entreprises.
Trump n’a cessé d’attiser cette campagne en allant toujours plus loin dans la surenchère sécuritaire, menaçant d’intervenir dans d’autres parties du territoire, en particulier à Chicago avec l’armée et de recourir aux mêmes moyens qu’à Los Angeles. Il menace également de recourir à l’Insurrection Act, c’est-à-dire d’instaurer l’état d’urgence tout en allant encore plus loin dans la persécution des migrants.
Dans le même temps, les mesures anti-migrants tendent à s’étendre dans les parties du territoire dominées par les populistes. Ainsi, le couvre-feu a été décrété à son tour par le gouverneur du Texas. Par ailleurs, la Cour suprême dominée par les conservateurs vient de légaliser la demande gouvernementale de leur déportation dans des pays tiers. Dans ce contexte, une escalade incontrôlée des tensions ne peut être exclue car la situation devient de plus en plus imprédictible et irrationnelle.
L’hypocrisie sans bornes de la bourgeoisie
Il s’agit là d’une hypocrisie totale doublée d’un profond cynisme de la classe dominante qui se manifeste partout :
– aux États-Unis où la politique anti-migrants de Trump ne fait que suivre le sillon déjà tracé et développé par ses prédécesseurs Démocrates au gouvernement : c’est sous l’administration Obama que les mesures d’expulsion de travailleurs sans papiers ont atteint des chiffres record et c’est l’administration Biden qui a servi de modèle aux brutalités des méthodes de répression notamment en 2021 lors des charges féroces des garde-frontières à cheval et de la police aux abords de la frontière avec le Mexique ;
– dans le reste du monde, particulièrement sur le sol européen, que des masses croissantes de réfugiés cherchent à atteindre par tous les moyens. On en retrouve en perdition au large de la Méditerranée tentant d’échapper désespérément à la misère et à la guerre tant en Afrique qu’au Moyen-Orient. C’est là encore au nom du respect du Droit et des accords de l’espace Schengen de l’Union européenne que ces abominations sont pratiquées, quel que soit le gouvernement en place : en Italie Meloni a durci la législation anti-migrants (multiplication de centres de rétention, suppression de la protection des demandeurs d’asile, transfert en Albanie, incitation à signer des contrats de retour vers le pays d’origine, etc.). En France, Macron, qui cherche à se présenter dans l’arène internationale comme un champion des droits démocratiques, charge en même temps son ministre de l’intérieur Retailleau du sale boulot avec des méthodes qui n’ont rien à envier à Trump : ainsi, mi-juin, ce dernier a mobilisé plus de 4 000 hommes (gendarmes, policiers, douaniers, force armée baptisée « Sentinelle ») pour une vaste opération de contrôle contre « l’immigration illégale » au nom de la « tolérance zéro » gare du Nord à Paris et quasi simultanément sur 450 autres sites, tout en se félicitant d’avoir procédé à l’arrestation et au renvoi de plus de 47 000 « clandestins » depuis le début de l’année 2025. Des opérations similaires ont été déclenchées en Allemagne. En Espagne, sous le vernis respectable d’une « politique de régularisation » du gouvernement social-démocrate de Pedro Sanchez, des actes de barbarie sont régulièrement recensés : par exemple des cadavres de migrants ont été récemment découverts mains et pieds ligotés au large des îles Baléares.
La bourgeoisie n’a pas non plus manqué d’utiliser les fractions de migrants les plus perméables au poison du nationalisme. Ainsi, lors des mobilisations de protestation contre la politique anti-migrants de Trump, les médias ont complaisamment et largement diffusé les images de drapeaux mexicains brandis par certains manifestants.
Tous ces éléments ne font que confirmer le piège partout tendu à la classe ouvrière pour l’éloigner d’une riposte et d’une lutte sur son propre terrain en utilisant ses faiblesses et ses illusions pour l’entraîner dans un faux dilemme entre émeutes populaires impuissantes et désespérées ou ralliement aux campagnes démocratiques de la bourgeoisie.
Le prolétariat doit ainsi fermement rejeter les discours de violence xénophobes MAGA et autres, tout comme les appels des autres fractions de la bourgeoisie à défendre la démocratie sous peine de subir le joug de la dictature du capital qui ne peut l’entraîner que vers toujours plus de misère et de barbarie.
Pas d’illusions ! La défense des intérêts de la classe ouvrière passe par le rejet catégorique de céder aux chants de sirènes de la bourgeoisie et de sa défense de la démocratie qui tente de masquer la face hideuse de la dictature du capitalisme comme la puanteur de son propre pourrissement sur pied !
Malgré les obstacles, l’avenir appartient à la lutte de classe !
Malgré toutes leurs faiblesses et leurs difficultés, en particulier aux États-Unis, malgré aussi tous les obstacles et pièges dressés par leur ennemi de classe, les prolétaires ont démontré, ces dernières années, leur capacité de réagir aux attaques incessantes et toujours plus fortes de la bourgeoisie. Ils ont ainsi exprimé qu’il existe un autre pôle dans l’évolution de la situation actuelle, un pôle opposé à l’enfoncement dans la misère, la barbarie guerrière et l’anéantissement vers laquelle se dirige inexorablement ce système agonisant. Dans les entrailles de la société mûrit ce même cri de colère, « ça suffit ! » qui s’exprime ouvertement dans les luttes ouvrières, de façon encore confuse et heurtée mais qui proclame partout : « nous n’acceptons plus de subir passivement les attaques et la dégradation accélérée de nos conditions de vie et de travail qui nous sont infligées quotidiennement ! » 5
C’est ce qui s’est produit déjà aux États-Unis à l’automne 2023 lors des grands mouvements de grèves quasi-simultanées au sein des trois grandes firmes du secteur automobile, puis chez Boeing, contre les programmes de licenciements ou contre l’austérité. 6 Mais de façon tout aussi significative en pleine campagne électorale américaine, fin 2024, les ouvriers ont su se mobiliser sur leur terrain de classe comme dans le secteur hôtelier ou lors de la grève de près de 50 000 dockers qui a duré plusieurs jours avant que l’administration Biden n’y mette fin en négociant précipitamment. Ces derniers mois encore, sous l’ère « Trump 2 », où les attaques et les coupes budgétaires massives se sont intensifiées, les travailleurs ont démontré une combativité intacte, en particulier dans le secteur de la santé : en janvier, ce sont plus de 5 000 infirmières, sage-femmes et médecins qui ont déclenché une grève de 46 jours dans le réseau Providence de l’État d’Oregon (la plus longue jamais menée dans le secteur de la santé de cet État) ; en février, c’était au tour des infirmières du centre médical universitaire de La Nouvelle-Orléans de mener une grève de 48 heures, suivie par 800 autres en Pennsylvanie cette fois qui a duré 5 jours. En mars, c’est la Californie qui est devenue un des principaux foyers d’agitation sociale : les employés de la compagnie de transports de la vallée de Santa Clara sont entrés en grève pendant 17 jours, interrompue seulement par décision de justice et peu après des travailleurs des hôpitaux publics de la même région ont fait grève pendant 4 jours. Fin avril, plus de 50 000 travailleurs du district de Los Angeles ont fait grève, regroupant plusieurs secteurs (santé, services sociaux, personnel de nettoyage ou de garde des locaux, laborantins…) pour protester contre le nouveau contrat de travail qui leur était imposé.
Cela démontre clairement que la montée de la colère et que la rupture avec la passivité au niveau international que nous avons maintes fois souligné depuis 2022, avec le changement d’état d’esprit qui les sous-tend au sein du prolétariat, ne sont pas un feu de paille et se poursuivent. Ces luttes ne peuvent que se développer face aux coups de boutoir de la crise et des attaques que réserve partout le capitalisme dans l’avenir.
Il doit aussi ressortir de cette situation qu’aux États-Unis comme ailleurs, la grève et les luttes contre les effets de la crise sont le terrain le plus favorable au développement du combat de classe et au développement de sa conscience. Dans ce contexte et avec cette perspective du futur certes encore lointain, où la classe aura davantage développé sa force collective et récupéré son identité de classe mais aussi sa capacité à politiser ses luttes, il ne fait aucun doute qu’elle sera aussi capable de répondre à la répression des migrants directement sur son terrain de mobilisation comme classe.
Wim, 26 juin 2025
1 « Face aux assauts xénophobes de Trump contre la classe ouvrière et au cri de “ [1007]défense de la démocratie” [1007], la classe ouvrière doit développer sa lutte sur son propre terrain ! [1007] », publié sur le site web du CCI (juin 2025).
2 La duplicité de ce discours anti-Trump est à souligner : ce n’est nullement un souci de protéger les travailleurs immigrés qui est avancé. À preuve, c’est ce même gouverneur qui n’a pas hésité à appeler un contingent encore plus important de la garde nationale (8 000 hommes) en Californie en 2020 pour assurer le maintien de l’ordre par crainte des émeutes dans les jours qui ont suivi le meurtre de Georges Floyd
3 Il faut noter que Trump lui-même participe activement à cette joute verbale en disant que Gavin Newsom fait « un boulot horrible » et a même agité la menace d’une arrestation : « l’arrêter serait une bonne chose ».
4 Même si en réalité, cette assimilation masque que la situation et le contexte historique sont totalement différents d’une période à l’autre : le fascisme est une conséquence de l’écrasement physique et idéologique du prolétariat au cœur de la contre-révolution alors que la montée du populisme est un pur produit du degré de pourrissement de la bourgeoisie au sein de la période de décomposition du capitalisme décadent. Mais la fonction mystificatrice de ces idéologies reste la même. Lire notre brochure Fascisme et démocratie : deux expressions de la dictature du capital [22].
5 Cf. « La dynamique de la lutte de classes depuis 2022 [1008] » Revue internationale n° 173 (mars 2025) et plus particulièrement la partie 1 sur « la maturation souterraine de la conscience de classe ».
Géographique:
- Etats-Unis [184]
Personnages:
- Donald Trump [896]
Récent et en cours:
- anti-populisme [1009]
Rubrique:
De 1914 au génocide des palestiniens à Gaza: Une chaine ininterrompue de massacres
- 222 lectures
Depuis plus d’un an et demi, nous assistons aux opérations de l’armée israélienne dans la bande de Gaza. Au nom du «droit d’Israël à se défendre», Netanyahou prétend traquer les commandos meurtriers du Hamas dans leurs tunnels et partout où le groupe terroriste aurait trouvé refuge, que ce soit dans les hôpitaux, les écoles ou les camps de réfugiés, «pour libérer», affirme-t-il, les otages du 7 octobre encore en vie.
Mais le gouvernement israélien se soucie comme d’une guigne des otages, simples prétextes à ses sordides objectifs impérialistes : Netanyahou et sa clique ont ainsi annoncé vouloir occuper pour toujours l’ensemble de la bande de Gaza… entièrement épurée de la population arabe ! Pour ce faire, la bourgeoisie israélienne ne lésine pas sur les moyens. L’armée fait preuve d’une cruauté sans borne dans cette prison à ciel ouvert : entre les monceaux de cadavres, la population, ballottée de zone en zone, au nord un jour, au sud le lendemain, plongée dans le désespoir et manquant de tout, vit dans la peur permanente des crimes abjects de la soldatesque, des bombes, de la faim, de la maladie. Dans le même temps, les attaques et la politique d’expulsion se sont intensifiées en Cisjordanie, où des milliers de Palestiniens sont terrorisés et contraints de fuir.
Pour Netanyahou et les fanatiques religieux qui l’entourent, éliminer les Palestiniens de la surface de la Terre est désormais un objectif assumé : quand l’armée ne tire pas sciemment sur des foules apeurées, elle ne cesse d’entraver l’approvisionnement en nourriture et en biens de première nécessité, affamant sans vergogne adultes, vieillards et enfants. Pendant plus de trois mois, le gouvernement a même entièrement bloqué l’approvisionnement sous des prétextes tellement extravagants qu’ils n’étaient en eux-mêmes qu’une énième provocation, un aveu à peine dissimulé d’épuration ethnique. Et tout cela avec la complicité active de l’Égypte et de la Jordanie qui s’émeuvent officiellement du sort des Palestiniens pour mieux les étrangler en leur interdisant de quitter cet enfer.
Partout dans le monde, nous assistons à une immense indignation et des protestations face aux crimes qui se déroulent sous nos yeux. Des manifestations ont lieu dans de nombreuses villes en faveur de l’arrêt des combats, au cri de «Free Palestine ! ».[1] Même les dirigeants de plusieurs pays européens, après avoir louvoyé pendant des mois, se sentent désormais contraints de condamner les exactions de Tsahal à Gaza, voire de dénoncer la réalité d’un génocide en cours, tel le Premier ministre espagnol, Pedro Sánchez, qui s’est récemment exprimé contre «une situation catastrophique de génocide». [2]
Mais derrière ces déclarations, il n’y a qu’hypocrisie et mensonge. La politique de destruction systématique à Gaza n’est pas une exception. Bien au contraire ! Loin d’un «monde en paix», toute l’histoire du capitalisme décadent montre que la société s’enfonce inexorablement dans la barbarie et qu’aucune fraction de la bourgeoisie n’est en mesure d’y mettre un terme.
Une chaîne ininterrompue de violence
Au XIXe siècle, Karl Marx avait déjà montré que le capitalisme est venu au monde dans la violence, les massacres, la destruction et le pillage, «suant le sang et la boue par tous les pores» : «La découverte des contrées aurifères et argentifères de l’Amérique, la réduction des indigènes en esclavage, leur enfouissement dans les mines ou leur extermination, les commencements de conquête et de pillage aux Indes orientales, la transformation de l’Afrique en une sorte de garenne commerciale pour la chasse aux peaux noires, voilà les procédés idylliques d’accumulation primitive qui signalent l’ère capitaliste à son aurore».[3] Le capital primitif nécessaire à la révolution industrielle n’est pas tombé miraculeusement du ciel ; son accumulation initiale n’a pu exister que par la spoliation, le brigandage et l’esclavage. De fait, l’histoire des premières puissances capitalistes est une succession d’ignominies, bien éloignée des idéaux de sa philosophie des Lumières : depuis le génocide à grande échelle des peuples amérindiens (entre 80 et 100 millions de victimes !), le développement du capitalisme s’est fait partout dans le sang. Que ce soit la Grande-Bretagne (génocide des Aborigènes d’Australie, entre autres nombreux exemples), la France (extermination d’un tiers de la population algérienne à partir de 1830), l’Allemagne (génocide des Héréros et des Namas en Namibie entre 1904 et 1908), la Russie (1 à 2 millions de victimes lors du nettoyage ethnique des Circassiens entre 1864 et 1867), les États-Unis (lors de la conquête de l’Ouest, par exemple) et même le «petit pays» qu’était la Belgique (et ses 10 millions de morts aux Congo !), toutes les bourgeoisies ont trempé dans les pires atrocités. Cette violence s’est aussi exprimée à l’égard de la paysannerie issue de la société traditionnelle, comme en témoigne la cruauté que la Grande-Bretagne a exercée sur les paysans irlandais.
Le capitalisme est synonyme de violence structurelle et institutionnalisée, mais le processus a pris un tournant qualitatif nouveau après la Première Guerre mondiale. L’Internationale communiste, lors de son congrès fondateur en 1919, avait clairement identifié l’entrée du capitalisme dans sa période de décadence : «Une nouvelle époque est née : l’époque de désagrégation du capitalisme, de son effondrement intérieur. L’époque de la révolution communiste du prolétariat». Là où les conquêtes de l’ascendance avaient permis aux puissances capitalistes de développer et d’universaliser les nouveaux rapports de production, la Première Guerre mondiale a, au contraire, signifié que, faute d’espace et de marchés suffisants, la conquête devait désormais s’opérer, non plus essentiellement sur des «terres vierges» mais par la confrontation à mort avec les autres puissances capitalistes.
Ainsi, alors que les violences de la période d’ascendance du capitalisme avaient au moins permis le développement des forces productives, celles de la décadence ont représenté une formidable chaîne de destructions qui n’a cessé de s’étendre et de s’approfondir : «Souillée, déshonorée, pataugeant dans le sang, couverte de crasse ; voilà comment se présente la société bourgeoise, voilà ce qu’elle est. Ce n’est pas lorsque, bien léchée et bien honnête, elle se donne les dehors de la culture et de la philosophie, de la morale et de l’ordre, de la paix et du droit, c’est quand elle ressemble à une bête fauve, quand elle danse le sabbat de l’anarchie, quand elle souffle la peste sur la civilisation et l’humanité qu’elle se montre toute nue, telle qu’elle est vraiment […] Une chose est certaine, la guerre mondiale représente un tournant pour le monde. C’est une folie insensée de s’imaginer que nous n’avons qu’à laisser passer la guerre, comme le lièvre attend la fin de l’orage sous un buisson pour reprendre ensuite gaiement son petit train. La guerre mondiale a changé les conditions de notre lutte et nous a changés nous-mêmes radicalement».[4]
Lors de la Première Guerre mondiale, les meurtres de masse scientifiquement planifiés (comme les attaques au gaz) et les exactions organisées à très grande échelle ont commencé à faire leur apparition, comme lors des génocides des Grecs pontiques ou des Arméniens au cours desquels des millions de personnes ont été tuées et déplacées. C’est pourquoi l’Internationale communiste avait très clairement identifié que face à un capitalisme devenu obsolète, l’alternative qui s’offrait désormais à l’humanité était soit le socialisme, soit la barbarie : «L’humanité, dont toute la culture a été dévastée, est menacée de destruction totale […]. Le résultat final du mode de production capitaliste est le chaos, et ce chaos ne peut être vaincu que par la plus grande classe productive : la classe ouvrière».
Depuis, le capitalisme n’a cessé de répandre la mort et de semer la barbarie : les expulsions, les génocides, le nettoyage ethnique, les politiques de famine sont devenues des armes ordinaires de guerre utilisées sans interruption par tous les belligérants à une échelle sans précédent dans l’histoire de l’humanité. Après la Première Guerre mondiale, avant même que les horreurs de la Seconde ne commencent, cette chaîne de violences s’est donc poursuivie. Des atrocités ont, par exemple, été perpétrées, cette fois non pas contre un «ennemi étranger», mais contre les paysans ukrainiens (Holodomor) lors d’une famine organisée par Staline (entre 2,6 et 5 millions de morts), ou contre la population russe, morte par millions au travail dans les goulags.
Seconde Guerre mondiale : l’implacable logique du capitalisme en décadence
La chaîne de violence a fini par atteindre un niveau supérieur de barbarie lors de la Seconde Guerre mondiale avec 60 à 80 millions de morts en 6 ans seulement, sans compter les innombrables victimes de la faim, de la maladie ou de la répression après la fin des combats. Ce conflit s’inscrit de bout en bout dans la même logique que celui de 1914-1918, mais à une échelle encore plus meurtrière, reflétant l’approfondissement de la crise historique du système.
Les atrocités de masse du régime nazi et de ses alliés sont largement documentées, mais c’est sans aucun doute la mise à mort industrialisée de 3 millions de personnes, en grande majorité juives, dans les camps d’extermination (sur 6 millions de juifs exterminés au total), qui exprime le plus clairement le sommet de barbarie qu’a représenté ce conflit. Mais si les nazis étaient d’effroyables barbares, il ne faut pas oublier qu’ils exprimaient la barbarie d’un système décadent, réduit aux plus ignobles extrémités dans la concurrence à mort entre tous les États et toutes les factions bourgeoises.
Ce qui est, en revanche, bien moins médiatisé, ce sont les crimes des Alliés durant la guerre, y compris à l’égard des Juifs. Il est désormais établi que les Alliés connaissaient parfaitement l’existence des camps d’extermination, dès leur mise en œuvre en 1942, tout comme le détail des méthodes d’extermination, le nombre de victimes déjà liquidées et à venir.[5] Pourtant, ni le gouvernement britannique, ni celui des États-Unis, ni celui de l’URSS n’ont entrepris d’action pour, si ce n’est stopper, au moins freiner le massacre. Pas même une voie ferrée bombardée ! Au lieu de cela, ils ont bombardé (avec de terrifiantes bombes incendiaires au phosphore) de façon répétée de nombreuses villes allemandes ne comportant que des populations civiles, notamment des banlieues ouvrières, comme à Leipzig, Hambourg (au moins 45,000 victimes civiles) et surtout Dresde. Ce dernier bombardement a occasionné d’innombrables victimes. Les estimations varient considérablement entre 25,000 et 200,000 morts. Nous ne sommes pas en mesure de déterminer le nombre de victimes, mais le bombardement de Dresde présente certaines particularités significatives de la barbarie déchaînée par les Alliés, tant par la mobilisation de moyens exceptionnels (1,300 bombardiers en une nuit et deux jours) que l’utilisation de bombes au phosphore «interdites» qui ont transformé la ville en véritable fournaise. Tous ces moyens ne prennent réellement leur sens que lorsqu’on sait que Dresde n’était pas une ville industrielle majeure, ni ne présentait de véritable intérêt stratégique. Elle comptait en revanche une énorme population de réfugiés qui avaient fui le front de l’Est en s’imaginant que Dresde ne serait pas bombardée. Le but de cet anéantissement exemplaire était de terroriser les populations et la classe ouvrière, en particulier, pour lui ôter toute velléité de se mobiliser sur son terrain de classe comme cela s’était déjà produit en 1943 dans plusieurs villes allemandes et italiennes. Dans un mémorandum du 28 mars 1945 adressé à l’État-major britannique, Winston Churchill écrivait à propos de ces bombardements : «Il me semble que le moment est venu de remettre en question le bombardement des villes allemandes effectué dans le but d’accroître la terreur, tout en invoquant d’autres prétextes. Sinon, nous irions nous emparer d’un pays ruiné de fond en comble. Par exemple, nous ne pourrions pas puiser en Allemagne des matériaux de construction pour nos propres besoins […]. La destruction de Dresde a semé un sérieux doute sur la conduite des bombardements alliés». Stupéfiant de cynisme !
Mais ces crimes n’ont finalement été qu’un préambule à l’immense tragédie qu’ont représenté les bombardements nucléaires, totalement inutiles d’un point de vue militaire, d’Hiroshima et de Nagasaki (environ 200,000 victimes), destinés à intimider le rival «soviétique». Et c’est avec le même cynisme, avec la même indifférence à l’égard des victimes, que les troupes russes ont stoppé les combats aux portes de Varsovie afin de laisser aux nazis le soin de mater l’insurrection en cours (160,000 à 250,000 civils tués). Il s’agissait pour la bourgeoisie stalinienne, hantée par le fantôme de la vague révolutionnaire de 1917, en pleine guerre mondiale, d’écraser toute possibilité de réaction prolétarienne et d’avoir les mains entièrement libres pour installer un gouvernement à sa botte. En Italie, Churchill a également freiné les combats pour permettre aux fascistes de réprimer les grèves qui se multipliaient en les laissant, selon ses propres mots, «mijoter dans leur jus».
Le capitalisme s’enfonce dans la barbarie généralisée
Depuis 1945, les massacres n’ont jamais cessé : notre planète n’a pas connu un seul jour dépourvu des conflits militaires. À peine la guerre terminée, la confrontation entre les deux nouveaux blocs rivaux aboutissait aux horreurs de la guerre froide : guerre de Corée (3 et 5 millions de morts), guerre du Vietnam (environ 2 millions de morts), première guerre d’Afghanistan (2 millions de morts selon les estimations) et d’innombrables guerres par pays interposés extrêmement meurtrières, comme la guerre Iran-Irak à la fin des années 1980 qui a fait au moins 1,2 million de morts.
Après la guerre froide, les massacres reprennent de plus belle, le monde prenant un tour d’autant plus chaotique et anarchique que la logique des blocs n’imposait plus aucune discipline aux différents États ou fractions. Une nouvelle dynamique de pourrissement apparaissait dans cette ultime phase de la décadence, celle de la décomposition. Les conflits sont alors devenus de plus en plus destructeurs, caractérisés par des coups de force à courtes vues sans objectifs stratégiques rationnels, si ce n’est semer le chaos parmi les rivaux.
Là aussi, les grandes démocraties ont les mains pleines de sang, comme en témoignent les guerres de Yougoslavie (au moins 130,000 morts), alimentées en armes par les États-Unis, la France et l’Allemagne. L’attitude des troupes de l’ONU pendant ce conflit, lorsqu’elles ont laissé les escadrons de la mort de Milosevic massacrer la population de Srebrenica en juillet 1995 (environ 8,000 tués) est aussi caractéristique du permanent cynisme de la bourgeoisie. On peut encore citer l’attitude des troupes françaises, sous mandat de l’ONU, pendant la guerre du Rwanda dans les années 1990, qui ont été complices du génocide des Tutsis (1 million de morts). Les grandes puissances se sont également directement impliquées dans les massacres à grande échelle, semant le chaos partout où elles sont intervenues, en particulier en Afghanistan (165,000 morts, officiellement, sans doute davantage), en Irak (1,2 million de personnes tuées) et aujourd’hui, au Moyen-Orient et en Ukraine, conflit dont le nombre de victimes s’élève déjà à plus d’un million de morts. La liste est sans fin.
Gaza, une illustration du futur du capitalisme
La chaîne de violence qui a traversé le XXe siècle aboutit désormais, par la menace de la guerre généralisée, des risques atomiques ou de la destruction de l’environnement, à une possible disparition de la civilisation, voire de l’humanité toute entière. Si les scènes d’horreur à Gaza sont particulièrement révoltantes, la population ukrainienne et certaines régions de Russie vivent aussi depuis plus de trois ans sous les bombes et une politique de terreur assumée, avec le soutien ouvertement va-t-en-guerre de ceux qui s’indignent aujourd’hui du sort des Palestiniens. Dans le même temps, les millions de personnes qui souffrent de la guerre au Soudan, au Congo, au Yémen et dans tant d’autres régions du monde ne retiennent guère l’attention des médias. Rien qu’au Soudan, 12 millions de personnes ont tenté en vain de fuir la guerre, et des millions d’autres sont menacées de mourir de faim sous le regard indifférent de toutes les «démocraties». Le Sahara est à feu et à sang, le Proche-Orient s’enfonce plus que jamais dans le chaos. L’Asie est sous de fortes tensions et au bord de la guerre. En Amérique du Sud, les régions où sévissent les affrontements entre gangs rivaux ressemblent à s’y méprendre à des zones de guerre, comme en témoigne la situation catastrophique d’Haïti. Même aux États-Unis, les prémisses d’une potentielle guerre civile se font sentir. Le capitalisme offre aujourd’hui une image d’apocalypse et il est, à ce titre, frappant de constater que les champs de ruines, typiques de la fin de la Seconde Guerre mondiale, ont fait leur apparition en quelques semaines en Ukraine et à Gaza.
C’est dans ce processus mortifère que les guerres au Moyen-Orient s’inscrivent. Symbole de l’impasse dans laquelle s’enfonce le capitalisme, Israël lançait en mai une nouvelle offensive dans la bande de Gaza au moment même où Trump effectuait une tournée des pays arabes, où il célébrait une succession d’accords commerciaux et de projets d’investissement, dont une grande partie concernait, bien sûr, des ventes d’armes (142 milliards de dollars rien qu’avec l’Arabie saoudite !).
La bourgeoisie européenne n’est pas en reste en matière de cynisme. Tout en s’indignant un peu tardivement du nettoyage ethnique des Palestiniens et en menaçant (sans trop d’insistance) Israël de sanctions, elle se réunissait au même moment en Albanie au sommet de la Communauté politique européenne pour rallier les soutiens à l’Ukraine. Sa principale préoccupation n’est pas tant d’aider les réfugiés, ni les victimes de la politique génocidaire israélienne, ni les millions de réfugiés qui ont pris la fuite et tentent désespérément de rejoindre l’Europe. Leur seule préoccupation a été de mobiliser davantage d’armes et de soldats pour la guerre contre la Russie, tout en renforçant les mesures brutales contre les «clandestins».
Alors qu’une propagande du gouvernement israélien cherche à faire passer toute indignation face aux crimes de Gaza pour de l’antisémitisme[6] en instrumentalisant l’holocauste de façon ignoble, l’État hébreu, qui se présente comme le protecteur des Juifs, des descendants du génocide nazi,[7] s’est lui-même transformé en exterminateur. Rien d’étonnant à cela : l’État-nation n’est pas une catégorie transcendante, au-dessus de l’histoire, c’est la forme achevée de l’exploitation et de la concurrence capitaliste. Dans un monde dominé par la logique implacable de l’impérialisme et des rivalités de tous contre tous, chaque État, faible ou puissant, démocratique ou non, est un maillon de la chaîne de violence que le capitalisme inflige à l’humanité. Lutter pour la création d’un nouvel État, Israël hier, la Palestine aujourd’hui, c’est lutter pour institutionnaliser l’armement de nouveaux belligérants et alimenter un nouveau cimetière. C’est pourquoi tous les groupes d’extrême gauche qui appellent à soutenir la «cause palestinienne», choisissent de facto un camp armé et contribuent en fait à la perpétuation des massacres et non à la libération de l’humanité.
EG, 13 juillet 2025
[1]Cf. « Manifestations pro-palestiniennes dans le monde : Choisir un camp contre un autre, c’est toujours choisir la barbarie capitaliste ! [924] », publié sur le site web du CCI (mai 2024).
[2]Sánchez, comme tous ses homologues, ne s’est pas exprimé ainsi par bonté d’âme : l’Espagne déploie des trésors de séduction en direction des pays arabes pour tenter de s’imposer en acteur central de l’espace méditerranéen. Lorsque les intérêts espagnols étaient alignés sur ceux d’Israël, le PSOE n’a jamais levé un sourcil pour protester contre les agissements de Tsahal.
[3]Karl Marx, Le Capital (1867).
[4]Rosa Luxemburg, La crise de la social-démocratie (1915).
[5]C’est un fait documenté depuis longtemps par les historiens que la publication des archives de l’ONU en 2017 [1010] a rendu en quelque sorte officiel.
[6]Ce qui ne retire rien à la réalité d’un antisémitisme montant dans la société, y compris dans les rangs de la gauche du capital.
[7]Sur les mensonges du sionisme dans la période de décadence, voir : « Antisémitisme, sionisme, antisionisme : tous sont les ennemis du prolétariat [1011] », disponible sur le site web du CCI.
Personnages:
- Benyamin Netanyahou [951]
- Pedro Sanchez [66]
- Karl Marx [597]
- Winston Churchill [731]
- Slobodan Milošević [1012]
Questions théoriques:
- Guerre [26]
- Impérialisme [45]
Rubrique:
Permanence en ligne, samedi 26 juillet 2025 à 15h
- 77 lectures
Le Courant communiste international organise une permanence en ligne (en français) le samedi 26 juillet 2025 à 15h. Ces permanences sont des lieux de débat ouverts à tous ceux qui souhaitent rencontrer et discuter avec le CCI. Nous vous invitons vivement à venir débattre afin d’approfondir la réflexion sur les enjeux de la situation, confronter les positions et les questionnements, contribuer à la clarification des questions politiques.
Les camarades qui souhaitent participer à cette permanence en ligne nous adresseront à l’adresse suivante un message pour confirmer leur participation, en signalant quelles questions ils voudraient aborder, afin de nous permettre d’organiser au mieux les débats : [email protected] [213] ou dans la rubrique « contact [214] ».
Les modalités techniques pour se connecter à la permanence seront communiquées par mail ultérieurement.
Vie du CCI:
- Permanences [291]
Rubrique:
ICConline - septembre 2025
- 15 lectures
Contre tous les drapeaux nationaux!
- 96 lectures
Trompés par les discours rendant les « étrangers » responsables de tous les maux, depuis les coupes dans les aides sociales à la menace qu’ils constitueraient pour les enfants, les participants aux manifestations contre les demandeurs d’asile et les réfugiés en Grande-Bretagne se présentent comme de véritables patriotes en brandissant l’Union Jack et la croix de Saint-Georges. Le drapeau anglais, en particulier, est accroché aux lampadaires ou peint sur les murs et les ronds-points. Le message est clair : certains d’entre nous ont le droit de vivre ici, les étrangers et/ou les « clandestins » doivent partir. Une illustration parfaite de la nécessité pour la classe exploiteuse de diviser les exploités entre eux.
Aux États-Unis, où des expulsions massives brutales sont déjà en cours, certaines des personnes visées par la même logique raciste brandissent également des drapeaux. Parfois le drapeau américain pour montrer que les immigrants peuvent aussi être patriotes, parfois le drapeau du Mexique ou d’autres pays d’Amérique latine, car une grande partie des travailleurs touchés par les raids de l’ICE1 viennent de ces pays.
L’idée que les exploités eux-mêmes doivent montrer leur loyauté envers tel ou tel drapeau national n’est pas nouvelle. En 1912, aux États-Unis, les grévistes de l’industrie textile de Lawrence, dont beaucoup étaient des immigrants nouvellement arrivés, ont également brandi le drapeau américain en réponse à l’accusation selon laquelle ils étaient des fauteurs de troubles étrangers et anti-américains. Mais les Industrial Workers of the World, qui soutenaient la grève, n’ont pas hésité à critiquer cette approche dans un article intitulé : « Le drapeau de la liberté » (Industrial Worker, 21 mars 1912)2 :
« Le drapeau des libertés, balivernes ! Des milliers de grévistes de Lawrence et des centaines de personnes dans la foule à San Diego auront découvert que le seul patriotisme que le capitalisme reconnaît est le patriotisme du profit, le patriotisme du dollar. Et les centaines de milliers de personnes qui lisent et entendent parler de ces événements verront la véritable signification du respect idolâtre pour le bout de tissu des maîtres. Le drapeau n’est qu’un bandeau sur les yeux des travailleurs ».
Nous ne pouvons qu’être d’accord : tous les drapeaux nationaux sont les chiffons des maîtres ! Un bandeau sur nos yeux, nous aveuglant par rapport à la réalité que la classe ouvrière n’a pas de pays, que la nation appartient toujours à ceux qui ont accumulé la richesse, le pouvoir politique et les armes les plus puissantes. En bref, à la classe dirigeante. Deux ans après la publication de cet article, l’IWW aurait ajouté que le drapeau américain est un moyen d’enrôler les travailleurs dans le carnage de la guerre impérialiste, au même titre que l’Union Jack britannique et les tricolores français ou allemand.
Et c’est pourquoi les révolutionnaires sont contre tous les drapeaux nationaux. Non seulement les drapeaux des États impérialistes les plus puissants, mais aussi ceux des « nations opprimées », comme l’Ukraine ou la Palestine, qui ne peuvent « résister » à la domination d’une puissance qu’en s’alliant à d’autres impérialismes. Dans le cas de l’Ukraine, les États américains et d’Europe occidentale, dans le cas de la Palestine et du Hamas, le régime islamique d’Iran, entre autres.
Contre tous les drapeaux nationaux et toutes les divisions, pour l’unité internationale de la classe ouvrière !
Amos,
1I CE : Service de l’Immigration et des Douanes.
2 Cet article a été porté à notre attention par un camarade qui signe « Adri » sur le forum de discussion libcom. Avec un autre camarade, « Msommer », qui s’identifie comme communiste conseilliste, ils critiquaient les anarchistes américains qui justifient le fait de brandir des drapeaux mexicains et palestiniens lors de manifestations parce qu’ils sont des symboles de la lutte contre l’oppression, alors qu’en réalité, ils sont un moyen d’emprisonner les travailleurs dans la politique bourgeoise. Le fil de discussion en question s’intitule « Les organisations anarchistes sont-elles en déclin ? » dans la section Discussions de libcom.org (allez d’abord dans « Recent », puis dans « Discussions »). Le lien que nous avons initialement publié ne semble pas fonctionner.
Conscience et organisation:
Courants politiques:
Rubrique:
L'importance des leçons de 1905 pour les luttes d'aujourd'hui et à venir (20 septembre 2025)
- 240 lectures
Il y a 120 ans, la classe ouvrière en Russie se soulevait contre le régime tsariste. Face à l’avènement d’une nouvelle ère dans la vie du capitalisme mondial, elle développait de nouvelles formes de lutte et d’organisation : la grève de masse et les soviets (conseils ouvriers). Ces formes et méthodes de lutte allaient réapparaître à plusieurs reprises au cours des décennies suivantes, notamment lors de la vague révolutionnaire internationale de 1917-1923, qui vit la classe ouvrière russe, organisée en conseils, s’emparer du pouvoir politique et le conserver pendant une brève période.
La révolution de 1905 contient encore de nombreuses leçons pour la lutte de classe aujourd’hui et à l’avenir, et il appartient à tous ceux qui reconnaissent la nécessité d’une lutte révolutionnaire contre le capitalisme de discuter et de clarifier ces leçons à la lumière des expériences ultérieures.
C’est l’objectif des réunions publiques qui se tiendront en France, en Belgique et en Espagne. Compte tenu de l’instabilité de la situation mondiale, nous serons prêts à consacrer une partie de la réunion à d’éventuels développements majeurs.
Le 20 septembre 2025 :
– Paris : 15h à 18h au CICP 21 Ter rue Voltaire 75011 Paris
– Marseille : 14h à 17h Association Mille Bâbords 61 Rue Consolât 13001 Marseille
– Bruxelles : 14h30 à 18h PIANOFABRIEK, Rue du fort 35, 1060 Saint-Gilles (Bruxelles)
En attendant, voici quelques lectures recommandées issues d’un dossier d’articles disponibles sur notre site web :
– « Révolution de 1905 : Il y a 120 ans, surgissaient la grève de masse et les conseils ouvriers [1013] »
– « 1905 : Il y a 120 ans, la classe ouvrière en Russie montrait sa nature révolutionnaire [1014] »
Vie du CCI:
- Réunions publiques [219]
Rubrique:
80 ans d'Hiroshima et de Nagasaki: L’arme atomique est le visage monstrueux du capitalisme
- 76 lectures
Il y a 80 ans, l’explosion de la bombe nucléaire à Hiroshima et Nagasaki plongeaient le monde dans une horreur sans précédent. Désormais, l’épée de Damoclès qui pendait sur l’humanité prenait la forme de l’Apocalypse. Loin de disparaître avec l’effondrement de l’URSS et la fin de l’existence des blocs issus de la guerre froide, la menace nucléaire, permanente s’est accrue aujourd’hui, exprimant l’exacerbation des tensions impérialistes entre les grandes puissances et celle de la barbarie guerrière sur le sol européen même. Ce triste anniversaire se caractérise non seulement par l’exubérance verbale d’un Trump et les menaces d’un Poutine, mais également par toute une propagande présentant la tragédie des explosions au Japon en 1945 comme une « volonté » et « erreur » des États-Unis seuls, une « folie » de son armée revancharde pour défendre des intérêts géopolitiques. La reconnaissance va même jusqu’à préciser ce que le CCI a toujours défendu, que les explosions avaient valeur de démonstration pour intimider et faire reculer l’ennemi soviétique et en vue d’expérimentations scientifiques et militaire, (les victimes irradiées servant de simple cobayes).1
Alors qu’un divorce s’est opéré entre les États-unis et l’Europe, de tels propos permettent d’écorner un peu plus l’image d’une première puissance mondiale en déclin. Jamais la bourgeoisie et les media en Europe n’avaient tenu si ouvertement ce genre de « révélations ». Habituellement, ils se bornaient à la thèse officielle du camp Allié rabâchée dans les manuels scolaires : « l’usage de la bombe atomique avait permis d’épargner la vie d’un million de soldats ». La bourgeoisie française a toujours insisté sur le fait que les essais nucléaires étaient soigneusement contrôlés afin qu’il n’y ait aucun préjudice pour l’environnement. Elle révèle aujourd’hui l’ampleur des dégâts causés par les essais nucléaires dans le pacifique, notamment de Mururoa, au mépris des populations et de l’environnement. Toute cette propagande autour de l’arme nucléaire montre que la bourgeoisie savait et mentait ouvertement, manipulait les masses, comme elle continue de le faire avec un froid cynisme aujourd’hui.
Mais ces révélations sont aussi une propagande qui vise au moins deux objectifs : :
– réactiver la défense de l’idéologie démocratique en dédouanant le système capitaliste de l’horreur des conflits et de la course aux armements ;
– justifier les dépenses militaires censées « dissuader » des « tyrans comme Poutine » dans un contexte de prolifération des armes et de tensions.
Loin de toute idée de « dissuasion » (même si les apparences trompeuses de la période de « l’équilibre de la terreur » peuvent le laisser penser), le développement de l’arme nucléaire et les dépenses militaires présentent un danger et une menace croissante de destruction de l’humanité. Suite à l’effondrement de l’URSS, le CCI, conscient de l’irrationalité portée par un chaos de plus en plus sanglant, par la décomposition du mode de production capitaliste, envisageait la possibilité d’un nouvel usage de l’arme nucléaire : « La dislocation de l’URSS, par ses dimensions, sa profondeur (c’est la Russie qui est maintenant menacée de désintégration), est un facteur d’aggravation considérable du chaos à l’échelle mondiale : risque des plus grands exodes de populations de l’histoire, de dérapages nucléaires majeurs ».2
En republiant une série d’articles sur les questions touchant à l’armement nucléaire, toujours d’actualité, nous souhaitons participer à la réflexion nécessaire : sur le lien entre la crise économique, les attaques et les dépenses militaires, mais aussi et surtout sur l’absurdité du capitalisme, un système barbare et obsolète qu’il faut détruire avant qu’il n’anéantisse l’humanité.
– « 70 ans après Hiroshima et Nagasaki [1015] »
– « Le capitalisme menace l’humanité d’un avenir apocalyptique [1016] »
– « Le vrai père de la bombe atomique et des crimes nucléaires, c’est le capitalisme [1017] »
– « Nucléaire et économie de guerre [1018] »
1 Voir l’émission « Hiroshima : la véritable Histoire » sur la chaîne franco-allemande ARTE.
2 Lire sur notre site : « Notes sur l’l’impérialisme et la décomposition : : vers le plus grand chaos de l’l’histoire », 18 novembre 1991.
Evènements historiques:
- Hiroshima [1019]
Rubrique:
Le gouvernement “socialiste” espagnol n’est pas plus efficace, rationnel ou humain que ses voisins
- 133 lectures
Alors que les économies des principaux pays européens sont en récession ou connaissent une croissance modeste, l'économie espagnole brille par une croissance du PIB de 3,2% en 2024. Tandis qu'en Belgique, en Grande-Bretagne et en France, des plans d'austérité drastiques et des coupes sociales sont annoncés, le gouvernement espagnol «progressiste» se vante d'«améliorer la vie des gens». Alors que Paris, Londres, Berlin, etc., parlent ouvertement d'augmenter les dépenses militaires, le président Sánchez apparaît comme «résistant» à ces augmentations. Alors que les gouvernements européens prennent des mesures éhontées contre l'arrivée d'immigrants, le gouvernement espagnol apparaît comme un «rempart» contre la xénophobie et le populisme. Cette aura progressiste du gouvernement espagnol de gauche est-elle fondée ? Absolument pas.
Si d’autres États, tout aussi défenseurs de la guerre et de l’exploitation capitaliste que l’Espagne, sont prêts à entretenir ce mythe du «nouveau miracle espagnol», c’est parce qu’ils cherchent à alimenter l’idée fausse selon laquelle un capitalisme «prospère» serait possible, qu’il serait possible d’arrêter la guerre ou la montée du populisme avec des gouvernements de «gauche» comme celui dirigé par Sánchez.
Le niveau de vie de la classe ouvrière s'est-il amélioré ?
Les statistiques officielles contredisent cette affirmation. Depuis 2008, les salaires perdent de leur pouvoir d'achat, engloutis par la hausse des prix, notamment ceux du logement, qui augmentent rapidement, aggravant la surpopulation et la précarité des familles ouvrières. Ce qui se développe, c'est ce qu'on appelle la «pauvreté au travail», c'est-à-dire le nombre de familles ouvrières qui, même en travaillant, ne peuvent subvenir à leurs besoins de première nécessité.[1]
La réduction du chômage, tant vantée par le gouvernement et ses partenaires syndicaux et de gauche, est en réalité un remplacement de l'emploi stable par des emplois à temps partiel, temporaires ou «fixes-discontinus»[2], où la vie des travailleurs est à la merci des besoins de la production ou des caprices de l'employeur. On nous parle maintenant d'une nouvelle «avancée sociale» avec l'hypothétique réduction de la journée de travail, alors qu'en réalité, la proportion de salariés effectuant des heures supplémentaires non rémunérées est encore plus élevée aujourd'hui qu'avant la réforme du travail de 2019.
Le gouvernement se vante d’une croissance économique qui, en réalité, repose sur des investissements largement spéculatifs (le secteur immobilier), dépendant d’une «monoculture» du tourisme (qui représente 13% du PIB) et profitant de la surexploitation des travailleurs, principalement ceux issus de l’émigration.
Un gouvernement pour la paix ?
En tant que gouvernement de gauche, celui de Sánchez a tendance à dissimuler sa loyauté envers l'exploitation et la guerre derrière la «solidarité» et des pantomimes pacifistes. Ce fut le cas lors du récent sommet de l'OTAN, où le président s'est «mis à l'écart» des autres dirigeants, semblant ignorer la course effrénée à la guerre et l'augmentation des budgets militaires. Mais la vérité est que, quelques mois auparavant, le gouvernement «progressiste» s'était engagé à consacrer 2,5 % du PIB aux dépenses militaires (près de 41 milliards d'euros), augmentées d'un Plan industriel de défense (10 milliards supplémentaires) et d'un engagement à investir 34 milliards supplémentaires dans les années à venir.[3] Quelques semaines plus tard, Pedro Sánchez lui-même annonçait un plan visant à augmenter les effectifs militaires de 116 000 à 140 000 au cours des huit prochaines années.
Avec un cynisme révoltant, Sira Rego, ministre de la Jeunesse et membre du parti le plus à gauche, SUMAR, a déclaré : «Il serait contradictoire de devoir choisir entre le développement d'un programme social et les dépenses militaires, et de voir des hôpitaux et des écoles fermer, et de voir l'avenir de notre génération menacé par la production accumulée d'armes.» Or, c'est exactement ce qu'ils font ! Gel des aides aux personnes dépendantes, incitant les travailleurs à souscrire à une assurance maladie privée en raison de la détérioration du système de santé publique. Réduction des effectifs enseignants, comme le dénoncent les mobilisations d'enseignants en Catalogne, au Pays Basque, dans les Asturies, à Madrid, etc.
Un gouvernement en faveur des travailleurs migrants ?
Une autre caractéristique de la propagande des partis de gauche du Capital est d'exagérer les atrocités de la droite pour camoufler les leurs. On le constate récemment, par exemple, aux États-Unis,[4] comme lors des événements de Torre Pacheco en Espagne, lorsque le gouvernement «socialiste» de Sánchez et ses camarades gauchistes tentent d'afficher leur image «progressiste» en exhibant la rage xénophobe et raciste des gangs d'extrême droite. A l’opposé, le gouvernement «progressiste» tape sur les épaules de nos frères de classe, mais pour mieux les exploiter. Il leur dit que la «prospérité» espagnole leur doit beaucoup. Et elle leur doit beaucoup ! Une étude récente a révélé que les travailleurs migrants en Espagne gagnent 30 % de moins que les travailleurs nationaux.[5] Avec toute son hypocrisie, la ministre Pilar Alegría a déclaré, à propos des attaques contre la population migrante à Torre Pacheco : «Notre pays n'a rien à voir avec ces individus violents qui les maltraitent sous prétexte de défendre l'Espagne.» Et cela vient du porte-parole d’un gouvernement qui a perpétré le massacre de la barrière de Melilla, ou qui négocie avec les gouvernements du Maroc, de Mauritanie, etc., la répression de ceux qui tentent d’échapper à la guerre et au chaos.
Le gouvernement de gauche affirme que le «peuple» lui demande de «résister» pour défendre les «acquis sociaux acquis au fil des décennies». Ce qu'il tente de dissimuler avec ce mensonge, c'est que, quel que soit le gouvernement, la voie du capitalisme mondial vers la guerre et la misère est la seule voie qu'il offre à l'humanité. La seule possibilité d'échapper à ce sinistre destin est de lutter, unis, en tant que classe, contre toutes les factions de la classe exploiteuse. Nous faire croire qu'au sein de ces factions, il y en a d'autres «plus favorables aux travailleurs» ou qu'elles représentent un capitalisme «plus humain» est la pire tromperie par laquelle ils tentent de nous enchaîner, impuissants, dans cette voie de la barbarie.
Valerio (1er août)
[1] Selon un rapport de l'ONG Save the Children, c’est le cas de 17 % des familles. Ce pourcentage monte à 33 % si elles ont un enfant.
[2] La lutte contre l'augmentation de ce type de contrats a été au cœur des manifestations, notamment celles des enseignants des Asturies et des métallurgistes de Cadix. En mai 2025, 83 % des contrats de travail étaient temporaires, à temps partiel ou à durée déterminée.
[3] Ce sont les chiffres du rapport du Centre Delás, équivalent du SIPRI en Espagne.
[4] Voir sur notre site le tract que nous appelons à distribuer (juin 2025) : « Contre les attaques xénophobes de Trump contre la classe ouvrière et le slogan de « défense de la démocratie » : La classe ouvrière doit développer sa propre lutte ».
[5] Ce sont des données publiées dans le journal El País.
Géographique:
- Espagne [16]
Personnages:
- Pedro Sanchez [66]
- Sira Rego [1020]
- Pilar Alegría [1021]
Rubrique:
Ni fascisme, ni populisme, ni démocratie
- 181 lectures
Nous publions ci-dessous l’échange épistolaire entre le CCI et un camarade qui nous a écrit des Pays-Bas. Nous saluons son courrier et surtout sa démarche visant à faire part de désaccords sur une question politique essentielle : le rapport entre le fascisme, le populisme et la démocratie. L’importance de cette question aujourd’hui réside dans le fait que la situation internationale est marquée par la montée du populisme, par une tendance généralisée à l’assimiler au fascisme des années 1930 et par les appels à la défense de la démocratie que cela suscite.
Il s’agit là d’une question vitale pour le prolétariat du fait que la bourgeoisie exploite pleinement et instrumentalise idéologiquement cette situation pour mystifier la classe ouvrière et l’entraîner sur un faux terrain lui permettant de dédouaner et protéger son système : le capitalisme. C’est notamment le cas aux États-Unis, où la politique de Trump est présentée comme une «menace pour la démocratie» ou encore en Allemagne où la montée inexorable de l’AfD est présentée comme une nouvelle «menace fasciste». Face à ces dangers, les fractions «libérales» de la bourgeoisie et surtout la gauche du capital appellent à des mobilisations significatives pour «défendre les institutions démocratiques». L’ennemi n’est plus le capitalisme mais le populisme ou le «nouveau fascisme».
Dans notre réponse, nous voulons mettre en exergue, non seulement combien le contexte aujourd’hui est totalement différent des années 1930 et de l’ère du fascisme, mais aussi combien la mystification de la «défense de la démocratie» a toujours été une arme redoutable de la bourgeoisie pour mener la classe ouvrière à la défaite. Notre réponse vise avant tout à apporter quelques premiers éléments de réponse, à pousser au débat et à la réflexion sur ce sujet afin d’élargir et d’approfondir cette question. Elle nécessite cependant d’être prolongée et enrichie par des débats et des lectures complémentaires. Nous encourageons d’ailleurs tous les camarades qui le souhaitent à nous écrire, à aborder toutes les questions qui se posent au sein du prolétariat, comme l’a fait ce camarade de Hollande.
Le courrier de notre lecteur
Chers camarades,
Voici une réaction à l'article «La bourgeoisie tente d'attirer la classe ouvrière dans le piège de l'antifascisme» publié dans Internationalisme et Wereldrevolutie n° 382.
En général, je lis votre journal avec beaucoup d'approbation. C'est surtout votre internationalisme qui m’attire beaucoup. La solidarité internationale devrait être très importante pour la gauche, plutôt que le nationalisme. L'article susmentionné m'a moins plu.
Voici ma réaction à votre article :
Il est très important de constater que le fascisme moderne ne diffère pas fondamentalement de l'ancien fascisme.
Le fascisme diffère fondamentalement du libéralisme d'avant le 11 septembre. Le fascisme soutient à nouveau le capitalisme avec beaucoup de fanatisme et aspire en outre à un retour à l'époque d'avant les Lumières. La répression des protestations s'intensifie considérablement. Les droits acquis sont rapidement supprimés. Cela vaut pour les droits des travailleurs. Cela vaut également pour les droits d'un grand nombre de groupes sociaux, des réfugiés aux femmes. Cela vise en partie à semer la division parmi les travailleurs. Nous devons donc lutter pour le maintien et, de préférence, l'extension de tous les droits acquis. À cet égard, la lutte contre la division entre les travailleurs est un point important.
Voici maintenant quelques remarques sur certaines parties de l'article
Vous affirmez que ce que j'appelle la «gauche parlementaire» s'oppose fermement au fascisme. C'est tout le contraire. Le fascisme est considéré comme inoffensif et n'est généralement pas nommé, mais qualifié de «populisme», comme s'il s'agissait d'un phénomène populaire. Malheureusement, c'est également le cas dans votre article.
Vous affirmez à juste titre que le fascisme était un moyen très efficace pour écraser le prolétariat. N'est-ce pas toujours le cas aujourd'hui ? Le fait qu'il y ait moins de protestations du prolétariat qu'il y a 100 ans ne constitue pas une différence fondamentale.
La «gauche parlementaire» affirme en effet que le choix se situe entre le fascisme et le système parlementaire. Lutter contre le fascisme ne signifie certainement pas approuver le système parlementaire. On n'arrête pas le fascisme en votant une fois tous les quatre ans. De plus, la gauche parlementaire a, dans un passé (récent), approuvé à maintes reprises des mesures d'austérité sévères et/ou a contrecarré les protestations contre celles-ci. Les actions extraparlementaires sont essentielles pour lutter contre le fascisme et parvenir à un changement social
Vous considérez «toutes sortes de revendications fragmentées» du «mouvement LGBTQ aux organisations caritatives» comme «toutes de nature idéologique bourgeoise». Il me semble que vous négligez ainsi la diversité de ces mouvements. Certains militants sont nettement plus radicaux que d'autres. Il est important de soutenir la lutte de ces groupes contre la restriction de leurs droits. La manière dont cela doit être fait doit bien sûr faire l'objet d'un débat.
J'espère que vous considérerez ceci comme une contribution à cette discussion si nécessaire.
Avec mes salutations fraternelles,
R.V., Amsterdam
Le 03/07/2025
------------------------
Notre réponse
Cher camarade R.,
Merci pour ton évaluation enthousiaste de la presse du CCI. Dans ton courrier, tu abordes différents points importants, mais nous souhaitons nous centrer dans cette réponse sur la question politique du fascisme, du populisme et de la démocratie. Tu écris à ce propos : «Il est très important de constater que le fascisme moderne ne diffère pas fondamentalement de l'ancien fascisme. Le fascisme n'est généralement pas désigné comme tel, mais sous le nom de «populisme », comme s'il s'agissait d'un phénomène populaire.»
C'est une position qu’il est important de discuter car elle est souvent exprimée dans des débats et des textes à propos du raz de marée populiste. Quant au CCI, il ne la partage pas, pour deux raisons :
-le contexte social actuel et plus spécifiquement la situation de la classe ouvrière n’est nullement comparable à celui de l’avènement du fascisme dans les années 1930 en Allemagne et en Italie ;
-le phénomène du populisme actuel n’est pas comparable à celui du fascisme, mais exprime la putréfaction politique et idéologique d'une bourgeoisie qui n'a plus de perspective pour orienter la société.
Expliquons-nous[1] :
Le fascisme est un produit historique, un courant politique qui a émergé pendant la période de contre-révolution (les années 1920 et 1930), après que la classe ouvrière en Europe a été vaincue idéologiquement et physiquement. Il y a d’abord eu l’échec sanglant de la révolution en Allemagne (1919-1923), notamment par l’écrasement du soulèvement du prolétariat à Berlin, massacré par les corps francs sous l’impulsion et les ordres de la social-démocratie (SPD) traitre, parti qui, en votant les crédits de guerre et en soutenant l’Union sacrée pour la boucherie de la première guerre mondiale, était passé du côté de la bourgeoisie. Il y a eu ensuite l’échec de la révolution russe, isolée par l’échec de l’extension de la révolution mondiale, affaiblie par une terrible guerre civile et où la contre-révolution est incarnée par le parti bolchevik lui-même sous la direction de Staline (1917-1927). C’est cet écrasement physique et idéologique des bataillons à la pointe du mouvement révolutionnaire mondial et l'assassinat de l'élite du mouvement communiste dans ces pays (1919-1923) qui ont permis l’avènement du fascisme. En d’autres termes, le fascisme (comme le stalinisme d’ailleurs) n’a fait que consacrer la lourde défaite du prolétariat, qui ouvrait d’ailleurs à nouveau la voie à l’affrontement guerrier entre puissances impérialistes. De ce point de vue, l'avènement des régimes fascistes répondait aux besoins du capital national : il fallait concentrer tous les pouvoirs au sein de l'État, accélérer l'économie de guerre, militariser le travail. Dans les pays de l’Europe de l’Ouest où la classe ouvrière n’avait pas été défaite, c’est, au nom de “l’antifascisme”, que le prolétariat est mobilisé par la gauche du capital pour défendre la démocratie et est enrôlé pour la guerre.
Bref, le fascisme n’est pas la cause mais est le produit de la défaite physique et idéologique écrasante de la classe ouvrière orchestrée par la social-démocratie, le stalinisme et d’autres «forces démocratiques», fraternellement unis au sein des «fronts populaires». Par ailleurs le contexte de la lutte des classes est aujourd’hui fondamentalement différent par rapport à celui des années 1930. Actuellement, la classe ouvrière dans les principaux pays du monde n’a été ni physiquement ni idéologiquement défaite. Au contraire, depuis 2022, différentes luttes importantes indiquent qu’elle s’efforce de recouvrer son identité de classe et les tentatives de mobiliser et diviser les travailleurs derrière les campagnes populistes ou au contraire derrière celle pour la défense des institutions démocratiques visent précisément à casser cette dynamique prolétarienne.
On peut discuter de l'utilisation du mot populisme, mais quel que soit le nom qu'on donne à ce phénomène, il diffère fondamentalement du fascisme. Contrairement à ce dernier, il n’est pas le produit d'une classe ouvrière vaincue, mais des contradictions croissantes dans la société capitaliste, qui rendent la rivalité au sein de la bourgeoisie de plus en plus incontrôlable et entraînent, par conséquent, une perte croissante de contrôle sur l'appareil politique. Le populisme est donc un pur produit de la profonde désintégration et de la pourriture de la société capitaliste. En raison de l'absence de perspective significative pour la société, «il se développe au sein de la classe dominante, et en particulier au sein de l'appareil politique, une tendance à la perte de la discipline politique et à une attitude du chacun pour soi» (Thèses sur la décomposition). Il en résulte que, dans de nombreux cas, les élections actuelles ne conduisent pas à la désignation d'une fraction bourgeoise capable de représenter le mieux possible, les intérêts généraux du capital national, mais à celle de factions qui défendent leurs propres intérêts, souvent en contradiction avec les intérêts nationaux globaux. Les mouvements populistes trouvent leur soutien dans le «peuple», victime de la crise économique et financière, qui se sent abandonné par “l'establishment” politique, trahi par les médias de gauche et menacé par le flot d'immigrants. Il s'agit souvent de personnes issues de la petite bourgeoisie, mais aussi de couches ouvrières plus marginalisées, dans des régions autrefois fortement industrialisées. En 2016, la campagne de Trump a reçu «le soutien des Blancs sans diplôme universitaire, et en particulier des ouvriers de la «Rust Belt», les nouveaux déserts industriels qui ont voté pour Trump en signe de protestation contre l'ordre politique établi, incarné par la soi-disant «élite libérale des grandes villes». Leur vote était avant tout un vote contre – contre les inégalités croissantes de richesse, contre un système qui, selon eux, les privait, eux et leurs enfants, de tout avenir.» (President Trump: symbol of a dying social system).
Bien évidemment, la bourgeoisie utilise et exploite cette situation idéologiquement en tentant d’entraîner la classe ouvrière dans un combat entre vandales populistes et défenseurs des principes démocratiques et de préserver ainsi son système capitaliste de toute remise en question. La gauche en particulier réagit au populisme en brandissant volontiers le spectre du fascisme et le Drapeau de la “défense de la démocratie” afin de rallier le plus grand nombre possible d’ouvriers. Cependant, cette opposition de gauche au populisme fait tout autant partie de la classe bourgeoise et s'attaque tout autant aux conditions de travail et de vie des travailleurs que tous les autres partis et, comme tu l’écris toi-même, «a approuvé à maintes reprises, dans un passé (récent), des mesures d'austérité drastiques». Les travailleurs doivent donc refuser de suivre cette voie et ne se laisser diviser en aucun cas en travailleurs «populistes» et «démocrates».
Or, si tu sembles rejeter dans ta lettre l'activité parlementaire («lutter contre le fascisme ne signifie certainement pas approuver le système parlementaire»), en même temps, rien dans ta lettre n'indique que tu rejettes la démocratie qui, tout comme la dictature, le despotisme et l'autocratie, est également une expression politique de la dictature du capital. C'est d’ailleurs en substance le thème central de l'article que tu critiques. Il faut être clair, cette question est vitale et centrale pour le prolétariat. Ce sont bien les campagnes pour la défense de la démocratie qui désarmeront la classe ouvrière et mèneront à la défaite en préparant la mobilisation en vue de la guerre si nous ne les combattons pas et nous laissons abuser par le mythe démocratique. La bourgeoisie tente bel et bien d'attirer la classe ouvrière dans le piège de l'antipopulisme. Les travailleurs ne doivent pas se laisser entraîner dans «les campagnes pour la défense de l'État démocratique». Ils doivent mener, indépendamment des partis bourgeois, la lutte sur leur propre terrain de classe.
Enfin, dans ta lettre, tu pointes également un phénomène qui indiquerait une similitude avec l’émergence du fascisme dans les années 1930 : «La répression des protestations s'intensifie considérablement.». Certes, tout comme c’est d’ailleurs le cas d'autres phénomènes comme, par exemple, la chasse aux migrants et leur enfermement dans des camps, l'exclusion de certains groupes de population, la recherche de boucs émissaires, le recours au chantage, aux menaces, aux règlements de comptes, etc. Mais tous ces phénomènes sont loin d’être spécifiques au fascisme : on les retrouvait déjà dans les pays staliniens comme la Chine, dans des régimes «démocratiques forts» (sic) comme la Russie, la Turquie ou le Pakistan par exemple et ils se généralisent de plus en plus dans les pays «champions de la démocratie». Et surtout, l’explosion de ces phénomènes est une manifestation caractéristique de la généralisation de la barbarie qui caractérise la plongée actuelle de la société dans la période de décomposition du capitalisme décadent.
CCI
[1] Voir pour une argumentation plus complète l’article sur notre site «Dans la période actuelle. Y a-t-il un danger fasciste ? », ainsi que notre brochure «Fascisme et démocratie, deux expressions de la dictature du capital ».
Conscience et organisation:
Questions théoriques:
- Nationalisme [1022]
- Populisme [29]
- Démocratie [166]
- Internationalisme [311]
Heritage de la Gauche Communiste:
- Luttes parcellaires [1023]
Rubrique:
ICConline - Octobre 2025
- 43 lectures
Rubrique:
Contre les attaques du gouvernement: poursuivons la lutte!
| Fichier attaché | Taille |
|---|---|
| 314.29 Ko |
- 164 lectures
Nous sommes aujourd’hui des milliers dans la rue pour exprimer notre colère et notre rejet des attaques, d’une ampleur sans précé dent depuis des décennies, que nous impose le gouvernement Ari zona. Dix mois déjà que, conscients que ces attaques concernent tous les travailleurs, nous nous mobilisons, au-delà des régions, des secteurs, des catégories et des générations, pour affirmer tous unis, haut et fort notre refus de subir toutes nouvelles mesures d’austérité : « Trop c’est trop ! »
Et nous ne sommes pas seuls. Nos frères de classe au Royaume Uni, en Espagne, au Canada, en Chine et aux États-Unis… et ré cemment en France, nous rappellent que c’est au niveau interna tional que le prolétariat résiste aux attaques, résultat de la crise du système capitaliste et de la course aux armements.
Un constat s’impose cependant aujourd’hui : 10 mois de mobili sation et de multiples manifestations et grèves nationales et régio nales, n’ont pas réussi à repousser les attaques, quoi qu’en disent les syndicats. Descendre dans la rue tous les mois ne suffira pas! Pour repousser les attaques, il faudra être en mesure d’imposer un véritable rapport de force. Alors, comment ?
Les syndicats nous mènent toujours à la défaite !
Pour les syndicats, la recette est toujours la même : ils appellent les travailleurs à se regrouper par corporations et par centrales, sous leurs banderoles lors de « journées d’action », pour soi-disant « leur donner la force de négocier avec le gouvernement ». C’est tout le sens de l’appel de l’intersyndicale pour ce 14 octobre : se «compter» pour peser et négocier avec l’Arizona ! Ces méthodes nous mènent toujours à la défaite.
Le gouvernement De Wever ne se soucie pas plus des « journées d’action » à répétition depuis janvier de cette année que de la der nière pluie. Pour preuve les nouvelles attaques qu’il concocte ces jours-ci d’un montant minimum de 10 milliards d’euros. Mais rap pelons nous l’expérience importante similaire en France. Lors de la lutte contre la réforme des retraites en 2023, les travailleurs étai ent des millions dans la rue, combatifs et en colère, déterminés à se battre tous ensemble. Six mois durant, l’intersyndicale a égrai né quatorze journées de manifestations. Pour quel résultat ? Les «journées d’action» se sont de plus en plus espacées dans le temps, la mobilisation s’est peu à peu affaiblie… et le gouvernement a pu passer son attaque.
Aujourd’hui, il faudrait encore et encore accepter les « balades » syndicales à répétition ? Chacun derrière la banderole de son en treprise, de son secteur, sono à fond, sans discussion, sans débat, sans prise en main de l’organisation de la lutte ? Puis, en fin de ma nif rejoindre son domicile et attendre la prochaine « journée » que les syndicats voudront bien organiser. Et à la fin, le gouvernement ne reculera pas, les attaques passeront… comme toujours !
« Taxer les riches », pour mieux imposer les attaques !
Les syndicats et les partis de gauche nous expliquent que nous devons « faire payer les riches ». Ces mots d’ordre sont un véritable piège ! Oui, les milliards des grands bourgeois sont à vomir face à la misère. Mais avec ses discours sur la « justice fiscale », la gauche nous arnaque. L’idée de participer « équitablement » à l’effort national veut dire : « Puisque les ultra-riches paient un peu, il faut bien que nous acceptions nous aussi les sacrifices ! » C’est ce que fait actuellement le « socialiste » Sanchez en Espagne et son allié le Sumar (gauche radicale), ou le travailliste Starmer en Grande-Bretagne ! C’est ce que faisait, hier, Syriza en Grèce et tous les partis de gauche qui, une fois au pouvoir, se sont révélés pour ce qu’ils sont : des défenseurs inconditionnels du capital !
Pour gagner, il faut étendre et prendre en main nos luttes Pourtant, nous avons la force de faire reculer le gouvernement, de freiner ses attaques. Certaines luttes du passé montrent que c’est possible. Comme en Mai 1968 ou en 1980 en Pologne, ou encore plus récemment en 2006 en France ((lutte anti “Contrat Première Embauche”), autant de luttes qui ont fait reculer la bourgeoisie ! Ces mouvements de luttes ont toutes en commun l’organisation et la prise en main d’assemblée générales (AG) massives, ouvertes aux travailleurs, aux chômeurs et aux retraités et de l’extension active de la lutte à d’autres secteurs, à toutes les générations. Ils mettaient en avant des mots d’ordre unificateurs, qui englobe tous les travailleurs, jeunes ou vieux, au chômage ou actifs. L’extension de la lutte et les AG réellement souveraines ont obligé les gouvernements à céder. Aujourd’hui, comme hier, pour gagner, il faut nous regrouper, discuter partout sur les lieux de travail et proposer des assemblées générales en essayant de convaincre que ce qui fait notre force, c’est notre unité, notre solidarité de classe. Seules des AG prolétariennes peuvent constituer la base d’une lutte unie et qui s’étend. Une lutte indispensable pour en finir avec se système qui ne nous promet que plus de sacrifices et de guerres.
Courant Communiste International, 14.10.2025
Le capitalisme, c’est la guerre ! Guerre au capitalisme !
Aujourd’hui, les guerres n’en finissent pas de ravager le monde : de l’Ukraine à Gaza, en passant par la Birmanie, le Soudan, le Congo et bien d’autres conflits meurtriers, le chaos la mobilisation s’est peu à peu affaiblie… et le gouvernement a pu passer son attaque. Aujourd’hui, il faudrait encore et encore accepter les « balades » syndicales à répétition ? Chacun derrière la banderole de son en treprise, de son secteur, sono à fond, sans discussion, sans débat, sans prise en main de l’organisation de la lutte ? Puis, en fin de ma nif rejoindre son domicile et attendre la prochaine « journée » que les syndicats voudront bien organiser. Et à la fin, le gouvernement ne reculera pas, les attaques passeront… comme toujours ! « Taxer les riches », pour mieux imposer les attaques ! Les syndicats et les partis de gauche nous expliquent que nous devons « faire payer les riches ». Ces mots d’ordre sont un véritable piège ! Oui, les milliards des grands bourgeois sont à vomir face à la misère. Mais avec ses discours sur la « justice fiscale », la gau che nous arnaque. L’idée de participer « équitablement » à l’effort national veut dire : « Puisque les ultra-riches paient un peu, il faut bien que nous acceptions nous aussi les sacrifices ! » C’est ce que fait actuellement le « socialiste » Sanchez en Espagne et son allié le Sumar (gauche radicale), ou le travailliste Starmer en guerrier s’aggrave et fauche des centaines de milliers de sol dats et de civils. Cette logique meurtrière n’est pas seulement le fait de dictateur sanguinaire ou de l’irrationalité des popu listes, c’est la logique du monde capitaliste en putréfaction, de la concurrence de plus en plus exacerbée et meurtrière de tou tes les nations, petites ou grandes, de toutes les cliques bour geoises. Oui ! Le capitalisme c’est la guerre, la destruction et la mort. N’ayons pas d’illusions avec leurs promesses de paix. C’est au nom de la paix que tous les gouvernements nous ap pellent à toujours plus de sacrifices pour financer leurs armes et préparer les conflits à venir. Cette perspective, la classe ou vrière n’en veut pas ! Et pour cause : les guerres sont toujours un affrontement entre des nations concurrentes, entre des bourgeoisies rivales. Elles sont toujours des conflits dans les quels meurent les exploités au profit de leurs exploiteurs. La solidarité des prolétaires ne va donc pas aux « peuples », elle doit aller aux exploités d’Iran, d’Israël ou de Palestine, comme elle va aux travailleurs de tous les autres pays du monde. « Les travailleurs n’ont pas de patrie », ils doivent refuser partout de prendre parti pour un camp bourgeois ou pour un autre. En refusant les plans d’austérité et les sacrifices, nous nous attaquons à l’exploitation capitaliste et à toute sa logique de concurrence, nous préparons l’avenir, nous semons les grai nes d’un monde sans exploitations, sans guerre, ni frontière
Situations territoriales:
Personnages:
- Bart De Wever [1025]
- George-Louis Bouchez [1026]
Récent et en cours:
Rubrique:
Le capitalisme menace l'humanité La révolution mondiale est la seule solution réaliste
- 26 lectures
Notre organisation, le Courant Communiste International, a été fondée en janvier 1975, il y a un peu plus d'un demi-siècle. Depuis cette date, le monde a subi d'importants bouleversements et il nous appartient de présenter face au prolétariat un bilan de cette période afin de pouvoir dégager les perspectives qui aujourd'hui se présentent à l’humanité. Ces perspectives sont particulièrement sombres. C'est une réalité qui est ressentie de plus en plus violemment dans les populations, ce qui explique notamment la croissance permanente de la consommation de drogues de toutes sortes et la hausse des suicides, y compris chez les enfants. Même les instances suprêmes de la bourgeoisie mondiale, de l'Organisation des Nations Unies jusqu'au Forum de Davos, qui tous les ans, en janvier, réunit les principaux dirigeants économiques de la planète, sont contraintes d'admettre la gravité des fléaux qui torturent l'humanité et qui menacent de plus en plus son avenir.
Les années 20 du 21e siècle se sont présentées comme celles d'une accélération brutale de la dégradation de la situation du monde avec une accumulation de catastrophes —inondations ou incendies— liées au changement climatique, une accélération de la destruction du vivant, une pandémie qui a tué plus de 20 millions d'êtres humains, le déchaînement de nouvelles guerres de plus en plus meurtrières comme en Ukraine, à Gaza ou en Afrique, particulièrement au Soudan, au Congo et en Éthiopie. Ce chaos mondial a connu une nouvelle étape en janvier 2025 avec la venue au pouvoir de la première puissance mondiale d'un bateleur de foire sinistre, Donald Trump, qui ambitionne de jouer avec le globe terrestre à l'image de Charlie Chaplin dans son film "Le Dictateur".
Ainsi, le présent manifeste ne se justifie pas seulement par le demi-siècle d'existence de notre organisation mais aussi parce que nous devons faire face aujourd'hui à une situation historique d’une extrême gravité : le système capitaliste qui domine la planète est en train de conduire inexorablement la société humaine vers sa destruction. Face à cette perspective abominable, il appartient à ceux qui combattent pour le renversement révolutionnaire de ce système, les communistes, de mettre en avant les arguments historiques, politiques et théoriques afin d'armer la seule force de la société capable de mener à bien cette révolution : le prolétariat mondial. Car, oui, une autre société est possible !
Révolution communiste mondiale ou destruction de l’humanité
La fin du monde ! Cette hantise a été présente pendant les quatre décennies de la "Guerre froide" qui opposait les États-Unis et l'Union "soviétique" et leurs alliés respectifs. Ces deux puissances avaient accumulé suffisamment d'armements nucléaires pour détruire plusieurs fois toute vie humaine sur la Terre et leurs conflits permanents au moyen de leurs vassaux faisaient craindre que ces conflits n'aboutissent à un affrontement direct entre les deux mastodontes avec, finalement, l'emploi de ces armements terrifiants. Pour représenter cette menace de mort qui pesait sur toute l’humanité, l’université de Chicago a d’ailleurs créé en 1947 une Horloge de l’Apocalypse sur laquelle minuit représente la fin du monde.
Mais après 1989, qui a vu s'effondrer un des deux blocs, celui qui se faisait appeler "socialiste", on a vu fleurir des discours sur la "paix" et la "prospérité" de la part des dirigeants de la planète, des journalistes et des "experts" qui tous les soirs viennent étaler sur les plateaux de la télévision leurs préjugés, leur incompétence et leurs mensonges. Menteur en chef, le président américain d’alors, George Bush père, promettait même en 1990 une ère de paix basée sur un "nouvel ordre mondial, où la règle de droit supplantera la loi de la jungle et où le fort respectera les droits des plus faibles". (Discours devant le Congrès des États-Unis, 11 septembre 1990)
Aujourd'hui, ces mêmes personnages nous servent des discours bien différents, conscients qu'ils se ridiculiseraient complètement s'ils continuaient à afficher leur optimisme des décennies précédentes. Car ce n'est plus un secret pour personne que le monde va très mal et l'idée qu'il ait pris le chemin de sa destruction est de nouveau de plus en plus présente dans la société, particulièrement chez les jeunes générations. Comme première cause de cette angoisse, il y a évidemment la destruction de l'environnement qui n'est pas une perspective pour demain mais déjà une réalité d'aujourd'hui. Cette destruction ne prend pas seulement la forme de la crise climatique avec ses "événements extrêmes" que sont les inondations, les tempêtes, les canicules, les sécheresses porteuses de désertification et d'incendies d'une ampleur jamais vue. C'est aussi le vivant qui est menacé d'extinction, avec la disparition accélérée d’espèces, notamment végétales et animales. C'est l'empoisonnement de l'air, de l'eau, des aliments et la menace croissante de pandémies résultant de la destruction des milieux naturels, des pandémies à côté desquelles celle de la Covid du début des années 2020 risque d'apparaître comme une broutille. Et, comme si ces catastrophes ne suffisaient pas à semer assez d’angoisse, s'ajoute maintenant la multiplication des guerres de plus en plus meurtrières dont nous parviennent les images abominables des champs de ruines et des enfants squelettiques de Gaza ou du Soudan. Des images qui rappellent aux plus anciens celles de la terrible famine connue par le Biafra en guerre à la fin des années 1960 et qui fit deux millions de morts.
La fin de la Guerre froide, il y a quatre décennies, n'a pas signifié la fin des guerres. Bien au contraire, la disparition de la discipline qu'imposaient à leurs vassaux les deux superpuissances a ouvert la porte à une multiplication d'affrontements particulièrement meurtriers (plusieurs centaines de milliers de morts en Irak lors des guerres de 1991 et 2003 par exemple). Mais ces affrontements ne s'inscrivaient plus dans le cadre de l'antagonisme entre les deux blocs Est-Ouest et on avait assisté pendant cette période à une réduction significative des dépenses militaires, notamment de la part des grandes puissances. Ce n'est plus le cas aujourd'hui : même s'il n'y a pas eu reconstitution de nouveaux blocs, prélude à une troisième guerre mondiale, les dépenses militaires sont reparties à la hausse de façon spectaculaire. Et les armes qui s'accumulent à nouveau sont faites pour être utilisées comme on le voit en ce moment même en Ukraine, au Liban, à Gaza et en Iran. La sentence bien connue "Si tu veux la paix, prépare la guerre", que les dirigeants du monde nous assènent aujourd'hui avec insistance, s'est toujours révélée fausse. Plus il y aura d'armements et plus les guerres, qui sont inévitables dans un système capitaliste aux abois, seront meurtrières, sèmeront à une échelle toujours croissante la misère, la destruction, la famine, la mort. Et une des caractéristiques de la situation mondiale depuis le début des années 2020 est que les calamités qui s'abattent sur le monde tendent à se combiner de plus en plus, à s'entretenir et à se stimuler les unes les autres en une sorte de tourbillon infernal. C'est ainsi, par exemple, que la fonte des glaciers résultant du réchauffement de la Terre accentue ce réchauffement en favorisant la transformation des rayons lumineux du soleil en chaleur. De même, ce changement climatique et les guerres engendrent de plus en plus de famines à l'origine d'une émigration croissante vers les pays les plus développés. Et cette immigration favorise la montée du populisme xénophobe dans ces pays et l'accession au pouvoir de forces politiques qui ne peuvent qu'aggraver encore plus la situation. C'est notamment le cas sur le plan économique, comme on peut le voir avec la politique de Trump dont les mesures douanières accentuent encore plus l'instabilité du marché mondial et de l'ensemble de l'économie capitaliste, y compris aux États-Unis. Et nous pourrions ainsi passer en revue toutes les crises et catastrophes qui s'abattent sur le monde pour voir à quel point celles-ci ne sont que différentes manifestations d'un chaos généralisé qui, de plus en plus, échappe au contrôle des dirigeants de la planète et entraîne l'humanité vers sa destruction. Depuis, le 28 janvier 2025, l'Horloge de l’Apocalypse de Chicago affiche 23h 58min 31s, le niveau le plus proche de minuit à ce jour.
Face à la catastrophe qui se déploie, face à la menace qui se précise d'une destruction de l'humanité, une partie de la population, particulièrement dans la jeunesse, ne veut pas se soumettre au désespoir général qui envahit la société. On assiste régulièrement à des mobilisations pour le climat, contre la destruction de l'environnement, contre la guerre, mais il est clair que les dirigeants du monde, même lorsqu'ils tiennent des discours écologistes ou pacifistes, s'abstiennent fondamentalement de s'opposer à ces fléaux. Ce qu'on voit aujourd'hui, c'est au contraire une remise en cause générale des petites mesures "vertes" annoncées hier par les gouvernants en même temps que sont démentis jour après jour leurs discours de paix. Et ce n'est pas une question de "bonne" ou de "mauvaise volonté" de ces dirigeants. Certains d'entre eux assument de façon ouverte et cynique leurs politiques criminelles : Poutine et Netanyahou justifient de façon obscène leurs bombardements des populations civiles, Trump se fait, en paroles et en actes, l'avocat du saccage de l'environnement. Cela dit, ce sont tous les gouvernements, quels que soient leurs discours et leur couleur politique, qui mettent en œuvre une augmentation massive des armements et qui amputent de façon répétée les politiques de protection de l'environnement en plus d'attaquer le niveau de vie des travailleurs. Et cela pour des raisons très simples. En premier lieu, face à un effondrement croissant de l'économie capitaliste, la concurrence entre les États ne peut que s'intensifier et ces derniers n'ont d'autre recours, en plus que de réduire le coût de la force de travail, que de s'attaquer aux politiques de protection de l'environnement afin d'être plus compétitifs sur le marché mondial. En second lieu, comme cela s'est toujours vérifié dans le passé, l'aggravation des contradictions économiques du capitalisme débouche sur une intensification des antagonismes militaires.
En fait, si ces mobilisations de la jeunesse contre la destruction de l'environnement et contre la guerre révèlent une préoccupation profonde face à des questions essentielles, elles ne peuvent avoir de poids réel face à la bourgeoisie qui dirige le monde, car elles ne se déterminent pas comme un combat frontal de la seule classe qui puisse menacer la classe dominante, le prolétariat. De ce fait, elles sont une proie toute désignée pour les campagnes démagogiques des partis bourgeois qui visent justement à détourner la classe ouvrière de son combat fondamental contre le capitalisme. Et c'est là le cœur de la situation historique.
En réalité, le système capitaliste est condamné par l'histoire tout comme le furent, en leur temps, le système esclavagiste de l'antiquité et le système féodal du moyen-âge. Comme la société féodale et, avant elle, la société esclavagiste, la société capitaliste est entrée dans une période de décadence. Cette décadence a commencé au début du 20e siècle et a connu sa première grande manifestation avec la Première Guerre mondiale. C'était la preuve que les lois économiques du système capitaliste, qui avaient permis un progrès considérable de la production matérielle au cours du 19e siècle, s'étaient désormais converties en de lourdes entraves qui s'exprimaient par des convulsions croissantes comme la Guerre mondiale ou la crise de 1929. Cette décadence s'est poursuivie tout au long du 20e siècle, notamment avec la Seconde Guerre mondiale, qui résultait de cette crise. Et si l'après-guerre a connu une période de prospérité coïncidant avec la reconstruction, les contradictions économiques du système capitaliste sont revenues à la charge à la fin des années 1960, plongeant le monde dans des convulsions croissantes, avec une succession de crises sur le plan économique, militaire, politique et climatique. Et ces crises ne pourront avoir de solution, car elles résultent des contradictions insurmontables qui affectent les lois économiques du capitalisme. Ainsi, la situation du monde ne pourra que s'aggraver avec un chaos croissant et une barbarie toujours plus effrayante. Voilà le seul futur que puisse nous proposer le système capitaliste.
Faut-il en conclure qu'il n'y a plus d'espoir, que rien, qu'aucune force dans la société ne sera en mesure de s'opposer à ce cours vers la destruction de l'humanité ? Une idée s'impose de plus en plus parmi ceux qui sont conscients de la gravité de la situation : il n'y a pas de solution au sein du système capitaliste, qui domine le monde. Mais alors comment sortir de ce système ? Comment renverser le pouvoir de ceux qui le dirigent ? Comment se frayer un chemin vers une société qui ne connaîtrait plus la barbarie du monde actuel, où les immenses progrès de la science et de la technologie ne seraient plus destinés à fabriquer des engins de mort toujours plus effroyables ou à rendre la terre de plus en plus inhabitable mais seraient, au contraire, mis au service de l'épanouissement des êtres humains ? Une société où seraient abolies les guerres, les injustices, la misère, l'exploitation, l'oppression. Une société où tous les êtres humains pourraient vivre en harmonie, dans la solidarité et non dans la concurrence et la violence. Une société qui n’opposerait plus l’Homme et la nature mais au contraire qui replacerait celui-ci comme une partie de celle-là.
Quand on envisage la possibilité d'une telle société, il ne manque pas d'esprits "réalistes" pour hausser les épaules et tenter de ridiculiser de telles pensées : "ce sont des songe-creux, des contes pour enfants, des utopies". Évidemment, c'est dans les secteurs privilégiés de la société et parmi ceux qui s'en font les défenseurs serviles qu'on trouve les plus fanatiques porte-parole de ce mépris pour ces "idées utopiques", mais il faut bien reconnaître que leur discours influence la grande majorité de la société.
Pour répondre à toutes ces questions concernant l'avenir, il est d'abord nécessaire de se pencher sur le passé.
Retrouver la mémoire de nos luttes passées pour préparer les luttes à venir
Les rêves d'une société idéale où seraient abolies les injustices, où les humains vivraient en harmonie existent depuis très longtemps. On les retrouve notamment dans le christianisme primitif, dans la guerre des paysans en Allemagne au 16e siècle (les anabaptistes autour du moine Thomas Müntzer), dans la révolution anglaise du 17e siècle (les "Diggers" ou "True Levellers") et la révolution française de la fin du 18e siècle (Babeuf et la "Conjuration des Égaux"). Ces rêves étaient utopiques, c'est vrai. Ils ne pouvaient pas se concrétiser car, à ces époques, il n'existait pas les conditions matérielles pour qu'ils puissent se réaliser. C'est le développement de la classe ouvrière en même temps que la révolution industrielle à la fin du 18e siècle et au début du 19e siècle qui fonde la possibilité d'une société communiste sur des bases matérielles solides.
Ces bases ce sont, d'une part, l'énorme abondance des richesses rendue possible par les lois du capitalisme, une abondance permettant potentiellement une pleine satisfaction des besoins humains et, d'autre part, la formidable croissance de la classe produisant l'essentiel de ces richesses, le prolétariat moderne. En effet, seule la classe ouvrière est en mesure de réaliser l'énorme bouleversement que représente l'abolition du capitalisme et l'instauration du communisme. Elle seule dans la société est réellement intéressée à s'attaquer radicalement aux fondements du capitalisme et, en premier lieu, à la production marchande, qui se trouve au cœur de la crise de ce système. Car c'est justement le marché, la domination de la marchandise dans la production capitaliste, qui est à la base de l'exploitation des salariés. Le propre de la classe ouvrière, contrairement à d'autres catégories de producteurs comme les propriétaires agricoles ou les artisans, c'est d'être privée des moyens de production et d'être obligée, pour vivre, de vendre sa force de travail aux détenteurs de ces moyens de production : les capitalistes privés ou bien l'État. C'est parce que, dans le système capitaliste, la force de travail elle-même est devenue une marchandise, et même la principale de toutes les marchandises, que les prolétaires sont exploités. C'est pour cela que la lutte du prolétariat contre l'exploitation capitaliste porte en elle l'abolition du salariat et, partant, l'abolition de toute forme de marchandise. En outre, cette classe produit, dès à présent, l'essentiel des richesses de la société. Elle le fait dans un cadre collectif, grâce au travail associé développé par le capitalisme lui-même. Mais ce système n'a pu poursuivre jusqu'au bout la socialisation de la production qu'il avait entreprise au détriment de la petite production individuelle.
C'est bien là une des contradictions essentielles du capitalisme : sous son règne, la production a acquis un caractère mondial, mais les moyens de production sont restés dispersés entre les mains de multiples propriétaires, patrons privés ou États nationaux, qui se vendent et s'achètent les marchandises produites, et qui sont en concurrence les uns contre les autres. L'abolition du marché passe donc par l'expropriation de tous les capitalistes, par la prise en main collective par la société de l'ensemble de ces moyens de production. Cette tâche, seule la classe qui ne possède aucun moyen de production, alors que c'est elle qui les met en œuvre de façon collective, peut la réaliser.
1917 : la révolution en Russie
À ceux qui continuent d’affirmer que cette lutte révolutionnaire du prolétariat n'est qu'un « doux rêve », il suffit de rappeler la réalité historique. En effet, au milieu du 19e siècle, notamment avec le mouvement chartiste en Angleterre, l'insurrection de juin 1848 à Paris, la fondation en 1864 à Londres de l'Association Internationale des Travailleurs (qui devient rapidement une "puissance" en Europe) et la Commune de 1871, le prolétariat a commencé à faire la preuve qu'il constitue une menace réelle pour la classe capitaliste. Et cette menace s'est ensuite pleinement confirmée avec la révolution de 1917 en Russie et de 1918-23 en Allemagne.
Ces révolutions constituaient une éclatante confirmation de la perspective du Manifeste communiste adopté par la Ligue des communistes en 1848 et rédigé par Karl Marx et Friedrich Engels. Ce document fondamental se concluait ainsi : "Les communistes ne s'abaissent pas à dissimuler leurs opinions et leurs projets. Ils proclament ouvertement que leurs buts ne peuvent être atteints que par le renversement violent de tout l'ordre social passé. Que les classes dirigeantes tremblent à l'idée d'une révolution communiste ! Les prolétaires n'y ont rien à perdre que leurs chaînes. Ils ont un monde à y gagner."
Et en effet, à partir de 1917, les classes dirigeantes, et particulièrement la bourgeoisie, se sont mises à trembler. La force de la vague révolutionnaire internationale, culminant en Russie et en Allemagne, est telle qu’elle contraint les gouvernements à arrêter la guerre. Les ouvriers prennent alors conscience de leur force, ils s’organisent en tant que classe, se rassemblent dans des assemblées générales permanentes, s'organisent en soviets ("conseils" en langue russe), discutent, décident et agissent ensemble. Ils voient naître sous leurs yeux les prémices d'un autre monde possible.
1920-1930-1940-1950 : la contre-révolution
Du côté de la bourgeoisie, face à la possibilité réelle de voir son système d’exploitation être renversé et donc de perdre ses privilèges, c’est l’effroi et la haine. En 1871, alors que le prolétariat de Paris avait pris le pouvoir depuis deux mois, la bourgeoisie française, avec la complicité des troupes prussiennes qui occupaient encore la France, avait déchaîné une répression terrible contre les "communards", une "semaine sanglante" faisant 20,000 morts. Face à la vague révolutionnaire de 1917, c'est la bourgeoisie mondiale et pas seulement celle d'un ou deux pays qui va déchaîner sa haine et sa barbarie. De façon unanime, les dirigeants de tous les pays, même les plus "démocratiques", apportent leur soutien aux armées blanches encadrées par les officiers du régime tsariste déchu, un des plus rétrogrades du monde. Pire, les partis "socialistes", qui avaient déjà trahi le principe prolétarien essentiel de l’internationalisme en participant activement à la Guerre mondiale, touchent le fond de l'ignominie en prenant la tête de la répression de la révolution en Allemagne, provoquant des milliers de morts et l'assassinat de sang-froid des deux figures les plus lumineuses du combat prolétarien : Rosa Luxemburg et Karl Liebknecht. "Il faut que quelqu’un joue le rôle du chien sanglant. Je n’ai pas peur de la responsabilité" avait d’ailleurs déclaré Gustav Noske, un des dirigeants du Parti social-démocrate (SPD) et ministre de la Défense.
En Russie, les armées blanches ont finalement été vaincues par l'Armée rouge. Mais, en Allemagne, la bourgeoisie est parvenue à écraser dans le sang les tentatives d'insurrection ouvrière, en 1919, 1921 et 1923. La révolution russe s'est retrouvée alors isolée, ce qui ouvrait la voie à la contre-révolution.
Se joue alors le plus grand drame du 20e siècle : en Russie, la contre-révolution n’a pas triomphé de "l’extérieur", par les canons d’une armée étrangère, non, elle a œuvré de "l’intérieur", elle a su dévoyer, écraser, déporter, assassiner en portant un masque rouge, en faisant croire qu’elle était la révolution communiste. C'est en effet de l'État qui avait surgi après le renversement de l’État bourgeois qu'est venue la contre-révolution. Cet État a cessé d'être au service du prolétariat en Russie et dans le reste du monde pour se convertir en défenseur de la nouvelle bourgeoisie d'État qui a succédé à la bourgeoisie classique et qui avait désormais la tâche de poursuivre l'exploitation de la classe ouvrière. C'était une nouvelle confirmation de la perspective mise en avant par les révolutionnaires au milieu du 19e siècle : la révolution communiste ne pourra être que mondiale. Cette perspective était clairement affirmée dans le texte d'Engels "Principes du communisme" qui préparait le Manifeste communiste : "La révolution communiste (...) ne sera pas une révolution purement nationale ; elle se produira en même temps dans tous les pays civilisés (...) Elle exercera également sur tous les autres pays du globe une répercussion considérable et elle transformera complètement et accélérera le cours de leur développement. Elle est une révolution universelle ; elle aura, par conséquent, un terrain universel." C'est un principe qui a été défendu avec vigueur par tous les révolutionnaires du 20e siècle, notamment par Lénine à qui l'on doit cette affirmation on ne peut plus claire : "La révolution russe n'est qu'un détachement de l'armée socialiste mondiale, et le succès et le triomphe de la révolution que nous avons accomplie dépendent de l'action de cette armée. C'est un fait que personne parmi nous n'oublie (...). Le prolétariat russe a conscience de son isolement révolutionnaire, et il voit clairement que sa victoire a pour condition indispensable et prémisse fondamentale, l'intervention unie des ouvriers du monde entier". (23 juillet 1918)
C'est pour cela que la thèse de la "Construction du socialisme dans un seul pays", mise en avant par Staline à partir de 1924, révèle la trahison de celui-ci et du parti bolchevique dont il avait pris la direction. Cette trahison était le premier acte de la terrible contre-révolution qui s'est abattue sur le prolétariat en Russie et à l'échelle internationale. En Russie, nous avons vu Staline et ses complices éliminer les uns après les autres les meilleurs combattants de la révolution de 1917, notamment lors des sinistres "procès de Moscou" en 1936-38 où les prévenus, brisés par la torture et les menaces contre leur famille, s'accusaient eux-mêmes des pires crimes avant d'être abattus d'une balle dans la nuque. En même temps, des millions de travailleurs étaient assassinés ou déportés dans des camps de concentration sans le moindre motif afin d'entretenir un climat de terreur dans la population. En dehors de la Russie, les partis "communistes" stalinisés se sont retrouvés en première ligne du sabotage et même de la répression des luttes ouvrières comme ce fut le cas à Barcelone en mai 1937 alors que le prolétariat de cette ville s'était révolté contre la soumission que lui imposaient de façon croissante les staliniens.
En Allemagne, la part la plus importante de la défense du régime capitaliste avait été assumée par les partis "démocratiques" de la République de Weimar, et particulièrement par le Parti social-démocrate, mais il fallait pour la bourgeoisie infliger une "punition" d'une violence inouïe aux prolétaires de ce pays afin de leur enlever de façon définitive toute envie de se soulever contre l'ordre capitaliste. Et c'est le Parti nazi qui s'est chargé de cette tache immonde avec la cruauté monstrueuse que l'on sait.
Quant aux secteurs "démocratiques" de la bourgeoisie, notamment ceux qui dominaient en France, au Royaume-Uni et aux États-Unis, ils ont pris leur part dans la contre-révolution d'une façon moins spectaculaire mais tout aussi efficace. Ces secteurs ne se sont pas contentés d'apporter leur soutien à la répression du prolétariat révolutionnaire en Russie et en Allemagne (ainsi la France victorieuse de l'Allemagne en 1918 lui a restitué 16,000 mitrailleuses pour assassiner les ouvriers insurgés). Ce sont les institutions "démocratiques" qui ont servi de marchepied à Hitler pour accéder au pouvoir et c'est la très démocratique Angleterre qui a favorisé en Espagne la victoire de Franco, l'allié d'Hitler et de Mussolini. C'est aussi au cours des années 1930 que les "démocraties" ont apporté une respectabilité au régime stalinien en l'acceptant en septembre 1934 dans la Société des Nations (SDN), un organisme bourgeois que Lénine avait qualifié de "repaire de brigands" lors de sa création en 1919. Une respectabilité qui a été renforcée par la signature en mai 1935 du "traité franco-soviétique d'assistance mutuelle" (dit pacte Laval-Staline).
Ainsi, l'horrible barbarie qui s'est développée au cours des années 1930 avec les régimes stalinien et hitlérien, et avec la complicité des régimes "démocratiques", nous avertit de la fureur sanguinaire qui saisit la classe exploiteuse lorsque sont menacés ses privilèges et son pouvoir sur la société.
Mais au cours des années 1930, le prolétariat, et l'ensemble de la société mondiale, n'avaient pas encore touché le fond. Ces années sont marquées par l'effondrement de l'économie mondiale avec de terribles attaques contre la classe ouvrière mais celle-ci, du fait de la profondeur de sa défaite, n'est pas en mesure de riposter à ces attaques en prenant à nouveau le chemin de la révolution. Bien au contraire, ces années débouchent sur la plus grande tragédie qu'ait vécue la société humaine : la Seconde Guerre mondiale avec ses 60 millions de morts, en majorité des civils, massacrés dans les camps de concentration nazis ou sous les tapis de bombes largués sur les villes des deux côtés. Il n'est pas nécessaire ici de donner une description de cette tragédie : huit décennies après son achèvement, on trouve encore de nombreux ouvrages, articles, programmes de télévision qui nous en fournissent des récits. C'est même tout récemment qu'un film à succès, Oppenheimer, a rappelé un épisode particulièrement atroce de cette période : les bombes atomiques larguées sur le Japon par la "grande démocratie américaine" en août 1945.
Un des aspects les plus terribles de cette guerre, c'est qu'elle n'a pas engendré une réponse du prolétariat comme ce fut le cas au cours de la Première Guerre mondiale. Au contraire, la victoire des Alliés en 1945, présentée comme le triomphe de la civilisation sur la barbarie, de la "démocratie" sur le fascisme, a permis le renforcement des illusions que la bourgeoisie entretient au sein de la classe ouvrière des principaux pays, et en particulier celles sur la "démocratie" présentée comme la forme idéale d'organisation de la société, une organisation qui, au-delà des discours de ses défenseurs, perpétue en réalité l'exploitation des travailleurs, les injustices, l'oppression et les guerres.
Ainsi, après la Seconde Guerre mondiale, la classe dominante a repris les méthodes qui, au cours des années 1930, lui avaient permis de paralyser le prolétariat et de l'embrigader dans la boucherie impérialiste. Avant et après la guerre, une des principales mystifications servies par la bourgeoisie aux prolétaires était de leur présenter leurs défaites comme autant de victoires. C'est sans doute le mythe frauduleux de "l'État socialiste" issu de la révolution en Russie et présenté comme bastion du prolétariat alors qu'il n'était devenu rien d'autre que le défenseur du capital national étatisé, qui a constitué l'arme essentielle, tant d'embrigadement que de démoralisation du prolétariat. Les prolétaires du monde entier en qui l'embrasement de 1917 avait fait naître un espoir immense étaient maintenant invités à soumettre inconditionnellement leurs luttes à la défense de la "patrie socialiste" et à ceux qui commençaient à deviner la nature anti-ouvrière de celle-ci, l'idéologie bourgeoise se chargeait d'inculquer l'idée que la révolution ne pouvait avoir d'autre aboutissement que celui qu'elle avait eu en Russie : l'apparition d'une nouvelle société d'exploitation et d'oppression encore pire que la société capitaliste.
De fait, le monde qui est sorti de la Seconde Guerre mondiale a vu un renforcement de la contre-révolution, non plus principalement sous la forme de la terreur, des assassinats de prolétaires, des camps de concentration, réservés désormais aux États "socialistes" (comme lors des répressions sanglantes en Allemagne de l'Est en 1953, en Hongrie en 1956, en Pologne en 1970) mais sous la forme beaucoup plus sournoise d'une emprise idéologique de la bourgeoisie sur les exploités, une emprise favorisée par l'amélioration momentanée de la situation économique lors de la reconstruction d'après-guerre.
Mais comme dit la chanson La semaine sanglante écrite après la répression de la Commune de Paris par le communard Jean-Baptiste Clément (également auteur du "Temps des cerises") : "Les mauvais jours finiront". Et les "mauvais jours" de la totale domination idéologique de la bourgeoisie se sont achevés en mai 1968.
1968 : la reprise du combat prolétarien
L'immense grève de Mai 68 en France (alors la plus grande grève de toute l'histoire du prolétariat mondial) est le symbole de la reprise des luttes ouvrières et de la fin de la contre-révolution. Car Mai 68 n'est pas une "affaire française", c'est la première réponse d'envergure apportée par le prolétariat mondial aux attaques de la bourgeoisie confrontée à une crise économique qui signe la fin du boom de l'après-guerre. Notre Manifeste adopté lors de notre premier congrès, affirme ainsi : "Aujourd'hui, la flamme prolétarienne s'est rallumée à travers le monde. De façon souvent confuse, hésitante, mais avec des soubresauts qui parfois étonnent même les révolutionnaires, le géant prolétarien a relevé la tête et revient faire trembler le vieil édifice capitaliste. De Paris à Cordoba [en Argentine], de Turin à Gdansk, de Lisbonne à Shanghai, du Caire à Barcelone les luttes ouvrières sont redevenues un cauchemar pour les capitalistes. En même temps, et comme part de cette reprise générale de la classe sont réapparus des groupes et courants révolutionnaires qui se sont attelés à l'immense tâche de la reconstitution théorique et pratique d'un des instruments les plus importants du prolétariat : son parti de classe."
Une nouvelle génération émerge, une génération qui n’a pas subi la contre-révolution, une génération qui se confronte au retour de la crise économique en exprimant tout un potentiel de lutte et de réflexion. C’est toute l’atmosphère sociale qui change : après les années de plomb, les ouvriers ont soif de discuter, de "refaire le monde", particulièrement parmi les jeunes générations. Le mot "révolution" se prononce partout. Les textes de Marx, Lénine, Luxemburg circulent et provoquent des débats incessants. La classe ouvrière essaie de se réapproprier son passé et ses expériences.
Mais un des aspects les plus fondamentaux de cette vague de combats ouvriers, c'est qu'elle signifie que la bourgeoisie n'a pas les mains libres pour apporter sa propre réponse à la crise de son système économique. Pour les communistes, mais aussi pour la grande majorité des historiens, il est clair que la Seconde Guerre mondiale résultait de la crise économique générale qui avait débuté en 1929. Cette guerre avait nécessité une profonde défaite préalable de la classe ouvrière, la seule force capable de s'opposer au déchaînement guerrier comme on l'avait vu en 1917 en Russie et en 1918 en Allemagne. Mais la capacité du prolétariat mondial de réagir de façon massive et déterminée face aux premières attaques de la crise à partir de 1968 signifiait que ses principaux secteurs n'étaient pas disposés à se laisser embrigader pour la "défense de la Patrie" contrairement à ce qui s'était passé au cours des années 1930. Et même s'il ne résultait pas directement de combats ouvriers, le retrait en 1973 des États-Unis du Vietnam a fait la preuve que la bourgeoisie de la première puissance mondiale n'était plus en mesure de mobiliser sa jeunesse ouvrière pour la guerre, que cette jeunesse refusait d'aller se faire trouer la peau ou de tuer des Vietnamiens au nom de la "défense du monde libre".
C'est fondamentalement pour cette raison que le développement des contradictions de l'économie capitaliste mondiale n'a pas débouché sur un affrontement généralisé entre les deux blocs, sur une troisième guerre mondiale.
Un autre aspect essentiel de cette reprise des combats de classe, c'est qu'elle a impulsé non seulement le retour dans la conscience de nombreux travailleurs de l'idée de la révolution, mais aussi le développement de petites minorités se réclamant de la Gauche communiste, ce courant qui, au sein et en dehors des partis communistes passés à l'ennemi, avait engagé dès le début des années 1920 le combat contre la dégénérescence de ces partis puis contre l'embrigadement des prolétaires dans la Seconde Guerre mondiale. Comme nous l'écrivions dans le Manifeste du 1er Congrès du CCI : "Pendant des années, les différentes fractions, plus particulièrement les gauches Allemande, Hollandaise et surtout Italienne, poursuivent une activité remarquable de réflexion et de dénonciation des trahisons des partis qui continuent à se dire prolétariens. Mais la contre-révolution est trop profonde et trop longue pour permettre la survie des fractions. Durement frappées par la Seconde Guerre mondiale et par le fait que celle-ci ne provoque aucun resurgissement de la classe, les dernières fractions qui ont survécu jusqu'alors disparaissent progressivement ou bien s'engagent dans un processus de dégénérescence, de sclérose ou de régression." Et justement, dans la foulée des luttes ouvrières à partir de Mai 1968, on a vu apparaître toute une série de groupes et de cercles de discussion qui se lancent à la redécouverte de la Gauche communiste, engagent des discussions entre eux et dont certains, après plusieurs conférences internationales au cours des années 1973-74 participent à la fondation du Courant Communiste International en janvier 1975.
1970-1980 : deux décennies d’expérience de lutte
La première vague de luttes inaugurée par Mai 1968 a sans aucun doute été la plus spectaculaire : "l’automne chaud italien" en 1969 (appelé aussi "Mai rampant"), le soulèvement violent à Cordoba en Argentine en mai de la même année et l’immense grève en Pologne durant l'hiver 1970, des mouvements importants en Espagne et en Grande-Bretagne en 1972... En Espagne en particulier, les travailleurs commencent à s'organiser à travers des assemblées de masse, alors que subsiste encore le régime franquiste, un processus qui atteint son point culminant à Vitoria en 1976. La dimension internationale de la vague de luttes porte ses échos jusqu’en Israël (1969 et 1972) et en Égypte (1972), une région pourtant dominée par les guerres et le nationalisme.
En partie, l'impétuosité de cette vague de luttes s'explique par la surprise qui a frappé la bourgeoisie mondiale en 1968 : après des dizaines d'années de contre-révolution, de domination idéologique et politique sur le prolétariat, cette classe avait fini par croire les discours de ceux qui annonçaient la disparition de toute perspective révolutionnaire, voire la fin de la lutte des classes. Mais la classe régnante est vite revenue de sa surprise et elle a engagé une contre-offensive afin de canaliser la colère ouvrière vers des objectifs bourgeois. C'est ainsi qu'au Royaume-Uni, la bourgeoisie la plus ancienne et expérimentée du monde a remplacé, à partir de mars 1974, à la suite de toute une série de grèves, le Premier ministre conservateur par Harold Wilson, chef d'un parti, le Labour, qui se présente comme le défenseur des travailleurs, notamment du fait de ses liens étroits avec les syndicats. Dans ce pays, comme dans de nombreux autres, les exploités ont été appelés à abandonner leurs luttes afin de ne pas gêner les gouvernements de gauche censés défendre leurs intérêts ou bien pour permettre une victoire de celle-ci aux élections.
Cette politique de la bourgeoisie dans les principaux pays développés a réussi à calmer momentanément la combativité ouvrière mais, à partir de 1974, l'aggravation considérable de la crise capitaliste et des attaques contre les prolétaires a provoqué une reprise importante de cette combativité : grèves des ouvriers du pétrole iranien, des aciéries en France en 1978, "l’hiver de la colère" de 1978-79 en Grande-Bretagne, des dockers à Rotterdam (menée par un comité de grève indépendant), des sidérurgistes au Brésil en 1979 (qui contestent également le contrôle des syndicats). Cette vague de luttes connaît son point culminant avec la grève de masse en Pologne en août 1980, dirigée par un comité de grève interentreprises indépendant (le MKS), certainement l’épisode le plus important de la lutte de classe depuis 1968. Et bien que la répression sévère des ouvriers polonais en décembre 1981 donne un coup d’arrêt à cette vague, il n’a pas fallu longtemps avant que ne s'exprime à nouveau la combativité ouvrière avec les luttes en Belgique en 1983 et 1986, la grève générale au Danemark en 1985, la grève des mineurs en Angleterre en 1984-85, les luttes des cheminots et des travailleurs de la santé en France en 1986 et 1988, de même le mouvement des employés de l’éducation en Italie en 1987. Les luttes en France et en Italie, en particulier – comme la grève de masse en Pologne – montrent une réelle capacité d’auto-organisation avec des assemblées générales et des comités de grève.
Ce n’est pas une simple liste de grèves. Ce mouvement en vagues de luttes ne tourne pas en rond, mais fait faire de réelles avancées dans la conscience de classe. Cette avancée est à l'origine des "coordinations" qui, dans plusieurs pays, notamment en France et en Italie, viennent concurrencer les syndicats officiels dont le rôle de pompiers au service de l'État bourgeois s'est révélé de plus en plus au cours des luttes. Ces coordinations, qui souvent avaient un caractère corporatiste, constituaient une tentative des appareils syndicaux et des organisations d'extrême gauche de perpétuer, sous de nouvelles formes, l'emprise du syndicalisme sur les travailleurs afin de faire obstacle à une politisation de leurs luttes, c'est-à-dire la conception de celles-ci non comme uniquement une forme de résistance aux attaques capitalistes mais aussi comme des préparatifs en vue du combat décisif contre le système capitaliste pour son renversement.
1990 : la décomposition
En réalité, les années 1980 commencent déjà à révéler les difficultés de la classe ouvrière à développer sa lutte plus avant, à porter son projet révolutionnaire.
La grève de masse en Pologne en 1980 est extraordinaire par son ampleur et par la capacité des ouvriers à s’auto-organiser dans la lutte. Mais elle indique aussi que, dans les pays de l'Est, les illusions dans la "démocratie" de l’Ouest sont immenses. Plus grave encore, face à la répression qui s’abat en décembre 1981 sur les ouvriers de Pologne, la solidarité du prolétariat des pays occidentaux se réduit aux déclarations platoniques, incapables de voir que, de chaque côté du rideau de fer, il s’agit en fait d’une seule et même lutte de la classe ouvrière contre le capitalisme. C’est là le premier indice de l’incapacité du prolétariat à politiser sa lutte, à développer plus avant sa conscience révolutionnaire.
Mais ces difficultés rencontrées par la classe ouvrière sont aggravées par la nouvelle politique mise en place par les secteurs dominants de la bourgeoisie. Dans la plupart des pays, "l'alternative de gauche" au pouvoir laisse la place à une autre formule pour affronter la classe ouvrière. La droite revient au pouvoir et se charge de porter des attaques d'une violence inédite contre les travailleurs alors que la gauche dans l'opposition se charge de saboter les luttes de l'intérieur. Ainsi, en 1981, le président américain Ronald Reagan licencie 11,000 contrôleurs aériens au motif que leur grève est illégale. En 1984, la Première ministre britannique Margaret Thatcher va aller encore beaucoup plus loin que son ami Reagan. La classe ouvrière de Grande-Bretagne est à cette période la plus combative du monde, elle établit année après année le record du nombre de jours de grève. Pour la bourgeoisie de ce pays, et aussi des autres pays, il faut lui casser les reins. En mars 1984, la "Dame de fer" provoque les mineurs en annonçant la fermeture de nombreux puits et, main dans la main avec les syndicats, elle les isole du reste de leurs frères de classe. Pendant un an, les mineurs vont ainsi lutter seuls, jusqu’à épuisement (Thatcher et son gouvernement avaient préparé leur coup, en accumulant en secret des stocks de charbon). Les manifestations sont réprimées dans le sang (trois morts, 20,000 blessés, 11,300 arrestations). Il faudra quatre décennies aux ouvriers de Grande-Bretagne pour surmonter la démoralisation et la paralysie engendrées par cette défaite. Celle-ci fait la preuve de la capacité de la classe bourgeoise, en Grande-Bretagne et ailleurs dans le monde, à réagir de façon intelligente et efficace contre le développement des luttes ouvrières, à empêcher celles-ci de déboucher sur une politisation du prolétariat et même à lui ôter dans un certain nombre de pays son sentiment d'appartenance à une classe à travers notamment la destruction de sa combativité dans des secteurs emblématiques comme les mines, les chantiers navals, la sidérurgie ou l'automobile.
Une petite phrase d’un de nos articles de 1988 résume le problème crucial affronté par la classe ouvrière à l’époque : "On parle peut-être moins facilement de révolution en 1988 qu'en 1968."
Cette absence temporaire de perspective commence à marquer toute la société. Le nihilisme se répand. Deux petits mots contenus dans une chanson du groupe punk les Sex Pistols sont tagués sur les murs de Londres : "No future".
C’est dans ce contexte où commencent à poindre l'épuisement de la génération de 1968 et le pourrissement de la société qu’un terrible coup va être porté à notre classe : l’effondrement du bloc de l’Est puis de l'Union "soviétique" en 1989-91 déclenche une assourdissante campagne sur "la mort du communisme". Le grand mensonge "stalinisme=communisme" est exploité une nouvelle fois à fond ; tous les crimes abominables de ce régime, en réalité capitaliste, vont être attribués à la classe ouvrière et à "son" système. Pire, il va être claironné jour et nuit : "Voilà où mène la lutte ouvrière : à la barbarie et à la faillite ! Voilà où mène ce rêve de révolution : au cauchemar !" En septembre 1989 nous écrivions : "Même dans sa mort, le stalinisme rend un dernier service à la domination capitaliste : en se décomposant, son cadavre continue encore à polluer l'atmosphère que respire le prolétariat." (Thèses sur la crise économique et politique en URSS et dans les pays de l'Est, Revue Internationale n° 60) Et cela s'est vérifié de façon dramatique. Ce changement historique majeur dans la situation mondiale aggrave un phénomène qui a commencé à se développer au cours des années 1980, et qui a contribué à l'effondrement des régimes staliniens : la décomposition générale de la société capitaliste. La décomposition n’est pas un moment passager et superficiel, il s’agit d’une dynamique profonde qui imprime sa marque sur toute la société. C'est la phase ultime de la décadence du capitalisme, une phase d’agonie qui se terminera par la destruction de l’humanité ou par la révolution communiste mondiale. Comme nous l'écrivions en 1990 : "… la crise actuelle s'est développée à un moment où la classe ouvrière ne subissait plus la chape de plomb de la contre-révolution. De ce fait, par son resurgissement historique à partir de 1968, elle a fait la preuve que la bourgeoisie n'avait pas les mains libres pour déchaîner une troisième guerre mondiale. En même temps, si le prolétariat avait déjà la force d'empêcher un tel aboutissement, il n'a pas encore trouvé celle de renverser le capitalisme (…). Dans une telle situation où les deux classes fondamentales et antagoniques de la société s'affrontent sans parvenir à imposer leur propre réponse décisive, l'histoire ne saurait pourtant s'arrêter. Encore moins que pour les autres modes de production qui l'ont précédé, il ne peut exister pour le capitalisme de "gel", de "stagnation" de la vie sociale. Alors que les contradictions du capitalisme en crise ne font que s'aggraver, l'incapacité de la bourgeoisie à offrir la moindre perspective pour l'ensemble de la société et l'incapacité du prolétariat à affirmer ouvertement la sienne dans l'immédiat ne peuvent que déboucher sur un phénomène de décomposition généralisée, de pourrissement sur pied de la société. (Thèses : la décomposition, phase ultime de la décadence capitaliste, Point 4)
Cette putréfaction affecte la société à tous les niveaux et agit comme un véritable poison : montée de l’individualisme, de l’irrationalité, de la violence, de l’autodestruction, etc. La peur et la haine l’emportent peu à peu. Se développent les cartels de la drogue en Amérique latine, le racisme partout… La pensée est marquée par l’impossibilité de se projeter vers l'avenir, par une vision à court terme et bornée ; la politique de la bourgeoisie se retrouve elle-même de plus en plus limitée au coup par coup. Ce bain quotidien imprègne forcément les prolétaires. Atomisés, réduits à des individus-citoyens, ils subissent de plein fouet le pourrissement de la société.
2000-2010 : des tentatives de luttes entravées par la perte d'identité de classe
Les années 2000-2010 vont être une succession de tentatives de luttes qui toutes vont se confronter au fait que la classe ouvrière ne sait plus qu'elle existe, que la bourgeoisie est parvenue à lui faire oublier qu'elle est la force sociale motrice de la société et de l'avenir.
Le 15 février 2003 a lieu une manifestation mondiale contre la guerre en Irak qui se profile (elle éclatera effectivement en mars, au prétexte de "lutte contre le terrorisme", durera 8 ans et fera 1 million de morts). Dans ce mouvement, il y a le refus de la guerre, alors que les guerres successives des années 1990 n’avaient soulevé aucune résistance. Mais c’est surtout un mouvement enfermé sur le terrain citoyen et pacifiste ; ce n’est pas la classe ouvrière qui lutte contre les velléités guerrières de son État respectif, mais une addition de citoyens qui réclament à leur gouvernement une politique de paix.
En mai-juin 2003, en France, de nombreuses manifestations vont se succéder contre une réforme du régime de retraite. La grève éclate dans le secteur de l’Éducation nationale, une menace de "grève générale" plane, elle n’aura finalement pas lieu et les enseignants resteront isolés. Cet enfermement sectoriel est le fruit, évidemment, d’une politique délibérée de division de la part des syndicats, mais ce sabotage réussit, car il s’appuie sur une très grande faiblesse dans la classe : les enseignants se considèrent comme à part, ils ne se ressentent pas comme des membres de la classe ouvrière. Pour l’instant, la notion même de classe ouvrière est toujours perdue dans les limbes, rejetée, ringardisée, honteuse.
En 2006, les étudiants en France se mobilisent massivement contre un contrat précaire spécial jeunes : le CPE (Contrat Première Embauche). Ce mouvement va démontrer un paradoxe : la réflexion se poursuit dans la classe ouvrière mais la classe ne le sait pas. Les étudiants redécouvrent en effet une forme de lutte authentiquement ouvrière : les assemblées générales. Dans ces AG ont lieu de réelles discussions ; elles sont ouvertes aux travailleurs, aux chômeurs, aux retraités. Il y a là le développement de la solidarité ouvrière entre les générations et entre les secteurs. Ce mouvement montre l’émergence d’une nouvelle génération prête à refuser les sacrifices imposés et à lutter. Cependant, cette génération a aussi grandi dans les années 1990, elle se trouve ainsi fortement marquée par l’apparente absence de la classe ouvrière, la disparition de son projet et de son expérience. Cette nouvelle génération ne se mobilise donc pas comme classe exploitée mais se dilue dans la masse des "citoyens".
Le "mouvement d'occupation des places" qui va s'étendre en 2011 sur une bonne partie de la planète est marqué des mêmes forces et faiblesses. Là aussi la combativité se développe, comme la réflexion, mais sans référence à la classe ouvrière et à son histoire. Pour les Indignados d'Espagne ou de Occupy des États-Unis, d'Israël et du Royaume-Uni, la tendance à se voir comme "citoyens" plutôt que comme prolétaires rend tout ce mouvement vulnérable à l’idéologie démocratique. Résultat, "Democracia Real Ya ! (Démocratie réelle maintenant !) devient le mot d’ordre du mouvement. Et les partis bourgeois comme Syriza en Grèce et Podemos en Espagne peuvent se présenter comme les vrais héritiers de ces révoltes. Autrement dit, les ouvriers et enfants d'ouvriers, mobilisés comme "citoyens" parmi les autres couches en colère de la société, les petits patrons, les commerçants et les artisans appauvris, les paysans, etc., ne peuvent pas développer leurs luttes contre l'exploitation et donc contre le capitalisme ; au contraire, ils se retrouvent sous la banderole des revendications pour un capitalisme plus juste, plus humain, mieux géré, pour de meilleurs dirigeants.
La période 2003-2011 représente ainsi toute une série d’efforts de notre classe pour lutter face à la dégradation continue des conditions de vie et de travail sous ce capitalisme en crise mais, privée d’identité de classe, elle aboutit (temporairement) à un marasme plus grand.
Et l’aggravation de la décomposition dans les années 2010 va encore renforcer ces difficultés : développement du populisme, avec toute l’irrationalité et la haine que ce courant politique bourgeois contient, prolifération à l’échelle internationale des attentats terroristes, prise de pouvoir sur des régions entières par les narcotrafiquants en Amérique latine, par les seigneurs de guerre au Moyen-Orient, en Afrique et dans le Caucase, immenses vagues de migrants fuyant l’horreur de la faim, de la guerre, de la barbarie, de la désertification liée au réchauffement climatique… la méditerranée devient un cimetière aquatique.
Cette dynamique pourrie et mortifère tend à renforcer le nationalisme et à se reposer sur la "protection" de l’État, à être influencé par les fausses critiques du système offertes par le populisme (et, pour une minorité, par le djihadisme). Le manque d'identité de classe est aggravé par la tendance à la fragmentation en identités raciales, sexuelles et autres catégories particulières, ce qui renforce à son tour l'exclusion et la division, alors que seul le combat prolétarien peut porter avec lui l'unité de tous les secteurs de la société victimes de la barbarie du capitalisme. Et cela pour la raison fondamentale que c'est le seul combat qui puisse abolir ce système.
2020 : le retour de la combativité ouvrière
Mais la situation actuelle ne saurait se résumer à ce pourrissement de la société. D’autres forces que celles de la destruction et de la barbarie sont aussi à l’œuvre : la crise économique ne cesse de s’aggraver et impulse chaque jour plus l'exigence de la lutte ; l’horreur du quotidien pose sans cesse des questions que les travailleurs ne peuvent qu’avoir en tête ; les luttes de ces dernières années ont commencé à apporter quelques réponses et ces expériences creusent leur sillon sans que l’on s’en rende compte. Pour reprendre les mots de Marx : "Nous reconnaissons notre vieille amie, notre vieille taupe qui sait si bien travailler sous terre pour apparaître brusquement".
En 2019, se développe en France un mouvement social contre une nouvelle réforme des retraites. Plus encore que la combativité, qui est très grande, ce qui est plus significatif encore de la dynamique à l’œuvre c'est la tendance à la solidarité entre les générations qui s’exprime dans les cortèges : de nombreux ouvriers proches de la soixantaine – et donc non concernés directement par la réforme – font grève et manifestent pour que les jeunes salariés ne subissent pas cette attaque de la bourgeoisie.
L’éclatement de la guerre en Ukraine, en février 2022, provoque l’effroi ; il y a dans la classe ouvrière la peur que le conflit se répande et dégénère. Mais, en même temps, la guerre aggrave considérablement l’inflation. Confronté déjà aux effets désastreux du Brexit, c’est le Royaume-Uni qui est le plus durement touché. Face à cette dégradation des conditions de vie et de travail insoutenables, la grève éclate dans ce pays dans de multiples secteurs (santé, éducation, transports…) : c’est ce que les médias vont appeler "l’été de la colère", en référence à "l’hiver de la colère" de 1978-79 !
En faisant ce parallèle entre ces deux grands mouvements séparés de 43 ans, les journalistes vont, souvent de façon involontaire, mettre le doigt sur une réalité fondamentale : derrière cette expression de "colère" se cache un mouvement extrêmement profond. Deux expressions vont courir de piquet de grève en piquet de grève : "Enough is enough" et "Nous sommes des travailleurs". Autrement dit, si les ouvriers britanniques se dressent face à l’inflation, ce n’est pas seulement parce que c’est insoutenable. C’est aussi parce que la conscience a mûri dans les têtes ouvrières, que la taupe a creusé durant des décennies et ressort à présent un petit bout de son museau : le prolétariat commence à recouvrer son identité de classe, à se sentir plus confiant, à se sentir une force sociale et collective. Les combats de la classe ouvrière au Royaume-Uni en 2022 ont une importance et une signification qui dépassent très largement les frontières de ce pays. D'une part, ils sont menés dans un pays de première importance dans le monde, sur le plan économique, financier et politique, notamment du fait de la domination de la langue anglaise et des vestiges de l'Empire britannique de la grande époque du capitalisme. D'autre part, c'est le plus vieux prolétariat du monde qu'on a vu à l'œuvre, un prolétariat qui, au cours des années 1970, avait fait preuve d'une combativité exceptionnelle mais qui ensuite, avec les années Thatcher, avait subi une défaite majeure qui l'avait paralysé pendant des décennies malgré des attaques massives portées par la bourgeoisie. Le réveil spectaculaire de ce prolétariat est l'indice d'un changement en profondeur dans l'état d'esprit et la conscience de l'ensemble du prolétariat mondial.
En France, une nouvelle mobilisation se développe et, là aussi, les manifestants mettent en avant leur appartenance au camp des travailleurs et reprennent le "Enough is enough" en le traduisant par "C’est assez !". Dans les cortèges, apparaissent des références à la grande grève de Mai 68. Nous avions donc raison d’écrire en 2020 : "Les acquis des luttes de la période 1968-89 ne sont pas perdus, même s’ils ont pu être oubliés par beaucoup d’ouvriers (et de révolutionnaires) : combat pour l’auto-organisation et l’extension des luttes ; début de compréhension du rôle anti-ouvrier des syndicats et des partis capitalistes de gauche ; résistance à l’embrigadement guerrier ; méfiance envers le jeu électoral et parlementaire etc. Les luttes futures devront s'appuyer sur l'assimilation critique de ces acquis en allant beaucoup plus loin et certainement pas sur leur négation ou leur oubli."
La classe ouvrière doit partir à la reconquête de sa propre histoire. Concrètement, les générations qui ont connu 1968 et la confrontation aux syndicats dans les années 1970s/80s sont aujourd’hui encore vivantes. Les jeunes des assemblées de 2006 et 2011 doivent eux aussi faire partager aux jeunes d'aujourd'hui leurs tentatives. Cette nouvelle génération des années 2020 n’a pas subi les défaites des années 1980 (notamment sous Thatcher et Reagan), ni le mensonge de 1990 sur la "mort du communisme" et la "fin de la lutte des classes", ni les années de plomb qui ont suivi. Elle a grandi dans une crise économique permanente et un monde en perdition ; c’est pourquoi elle porte en elle une combativité intacte. Cette nouvelle génération peut entraîner derrière elle toutes les autres, tout en devant les écouter, apprendre de leurs expériences, de leurs victoires comme de leurs défaites. Passé, présent et futur peuvent à nouveau se rejoindre dans la conscience des prolétaires.
Face aux effets dévastateurs de la décomposition, le prolétariat va devoir politiser ses luttes
Comme on l'a vu, les années 2020 ont ouvert à deux battants, partout dans le monde, la perspective de convulsions sans exemple dans le passé, avec au bout, la destruction de l'humanité.
Plus que jamais, la classe ouvrière est donc confrontée à un défi majeur, celui de parvenir à développer son projet révolutionnaire et ainsi proposer la seule autre perspective possible : le communisme. Pour ce faire, elle doit déjà parvenir à résister à toutes les forces centrifuges qui s’exercent sur elle sans relâche, elle doit être capable de ne pas se laisser happer par la fragmentation sociale qui pousse au racisme, à la confrontation entre bandes rivales, au repli, à la peur, elle doit être capable de ne pas céder aux sirènes du nationalisme et de la guerre (qu'elle se présente comme "humanitaire", "antiterroriste", de "résistance", etc.) Les différentes bourgeoisies accusent toujours la partie ennemie de "barbarie" pour justifier leur propre barbarie. Résister à toute cette pourriture qui gangrène peu à peu l’ensemble de la société et parvenir à développer son combat et sa perspective implique forcément pour toute la classe ouvrière d’élever son niveau de conscience et d’organisation, de parvenir à politiser ses luttes, à créer des lieux de débats, d’élaboration et de prise en main des grèves par les ouvriers eux-mêmes. Parce que la lutte du prolétariat contre le capitalisme c’est :
- La solidarité ouvrière contre la fragmentation sociale.
- L’internationalisme contre la guerre.
- La conscience révolutionnaire contre les mensonges de la bourgeoisie et l’irrationalité populiste.
- La préoccupation pour l’avenir de l’humanité contre le nihilisme et la destruction de la nature.
Révolutionnaires du monde entier
Ce bref survol de décennies de luttes ouvrières fait émerger une idée essentielle : le combat historique de notre classe pour le renversement du capitalisme va encore être long. Sur sa route, va se dresser une succession d’embûches, de pièges et de défaites. Pour être finalement victorieux, ce combat révolutionnaire va nécessiter une élévation générale de la conscience et de l'organisation de toute la classe ouvrière, au niveau mondial. Pour que cette élévation générale puisse se produire, il faudra au prolétariat se confronter dans la lutte à tous les pièges tendus par la bourgeoisie et, en même temps, se réapproprier son passé, son expérience accumulée depuis deux siècles.
Quand, le 28 septembre 1864 est fondée à Londres l'Association Internationale des Travailleurs (AIT), cette organisation devient l'incarnation de la nature mondiale du combat prolétarien, condition du triomphe de la révolution mondiale. Elle est la source d'inspiration du poème écrit en 1871 par le communard Eugène Pottier qui deviendra un chant révolutionnaire transmis de générations en générations de prolétaires en lutte, dans presque toutes les langues de la planète. Les paroles de L'Internationale soulignent à quel point cette solidarité du prolétariat mondial n'appartient pas au passé mais pointe vers le futur :
Groupons-nous, et demain,
L’Internationale,
Sera le genre humain
Ce regroupement international des forces révolutionnaires, c'est aux minorités militantes organisées que revient la tâche de le porter. En effet, si les masses de la classe ouvrière produisent cet effort de réflexion et d’auto-organisation essentiellement durant les périodes de luttes ouvertes, une minorité s'est toujours engagée, à toutes les périodes de l'histoire, dans le combat permanent pour la révolution. Ces minorités incarnent et défendent la constance et la continuité historiques du projet révolutionnaire du prolétariat, qui les a sécrétées à cet effet. Pour reprendre les mots du Manifeste communiste de 1848 : « Quelle est la position des communistes par rapport à l'ensemble des prolétaires ? Les communistes ne forment pas un parti distinct opposé aux autres partis ouvriers. Ils n'ont point d'intérêts qui les séparent de l'ensemble du prolétariat. Ils n'établissent pas de principes particuliers sur lesquels ils voudraient modeler le mouvement ouvrier. Les communistes ne se distinguent des autres partis ouvriers que sur deux points : 1. Dans les différentes luttes nationales des prolétaires, ils mettent en avant et font valoir les intérêts indépendants de la nationalité et communs à tout le prolétariat. 2. Dans les différentes phases que traverse la lutte entre prolétaires et bourgeois, ils représentent toujours les intérêts du mouvement dans sa totalité. Pratiquement, les communistes sont donc la fraction la plus résolue des partis ouvriers de tous les pays, la fraction qui stimule toutes les autres ; théoriquement, ils ont sur le reste du prolétariat l'avantage d'une intelligence claire des conditions, de la marche et des fins générales du mouvement prolétarien ».
C'est sur cette minorité que repose la responsabilité première de s’organiser, de débattre, de clarifier toutes les questions, de tirer les leçons des échecs passés, de faire vivre l'expérience accumulée. Aujourd'hui, cette minorité, extrêmement peu nombreuse et morcelée dans de multiples petites organisations, doit se regrouper pour confronter les différentes positions et analyses, se réapproprier les enseignements que nous ont légués les fractions de la Gauche communiste et préparer l'avenir. Pour mener à bien le projet révolutionnaire mondial, le renversement du capitalisme sur toute la planète, il faut que le prolétariat se dote de l’une de ses armes les plus précieuses et dont la carence lui a coûté si cher dans le passé : son parti révolutionnaire mondial. Ainsi, en octobre 1917, le parti bolchevique a joué un rôle essentiel dans le renversement de l’État bourgeois en Russie. Inversement, une des causes de la défaite du prolétariat en Allemagne consiste dans l'impréparation du parti communiste dans ce pays, parti qui n'a été fondé qu'au cours même de la révolution. Son inexpérience lui a fait commettre des erreurs qui ont contribué à la défaite finale de la révolution en Allemagne et, partant, dans le reste du monde.
ET MAINTENANT ?
La situation du combat prolétarien a changé considérablement depuis un demi-siècle. Comme on l'a vu, les obstacles rencontrés par la classe ouvrière sur son chemin vers la révolution se sont révélés bien plus importants qu'on ne pouvait le soupçonner lors de la fondation de notre organisation. Cependant, restent aujourd'hui totalement d'actualité les mots qui figuraient sur le Manifeste adopté par le Premier congrès du CCI : "Avec ses moyens encore modestes, le Courant Communiste International s'est attelé à la tâche longue et difficile du regroupement des révolutionnaires (…). Tournant le dos au monolithisme des sectes, il appelle les communistes de tous les pays à prendre conscience des responsabilités immenses qui sont les leurs, à abandonner les fausses querelles qui les opposent, à surmonter les divisions factices que le vieux monde fait peser sur eux. Il les appelle à se joindre à cet effort afin de constituer, avant les combats décisifs, l'organisation internationale et unifiée de son avant-garde."
De même, les mots du Manifeste du 9e congrès du CCI conservent toute la validité qu'ils avaient en 1991 : "Jamais dans l'histoire les enjeux n'ont été aussi dramatiques et décisifs que ceux d'aujourd'hui. Jamais une classe sociale n'a dû affronter une responsabilité comparable à celle qui repose sur le prolétariat. Si celui-ci n'est pas en mesure d'assumer cette responsabilité, il en sera fini de la civilisation, et même de l'humanité. Des millénaires de progrès, de travail et de pensée seront anéantis à tout jamais. Deux siècles de luttes prolétariennes, des millions de martyrs ouvriers n'auront servi à rien. Pour repousser toutes les manœuvres criminelles de la bourgeoisie, pour déjouer ses mensonges odieux et développer vos luttes en vue de la révolution communiste mondiale, pour abolir le règne de la nécessité et accéder enfin à celui de la liberté :
Prolétaires de tous les pays, unissez-vous !"
Courant Communiste International
(septembre 2025)
Conscience et organisation:
Personnages:
- Donald Trump [896]
- Charlie Chaplin [1028]
- George Bush [1029]
- Thomas Müntzer [1030]
- Babeuf [1031]
- Karl Marx [597]
- Friedrich Engels [1032]
- Rosa Luxemburg [909]
- Karl Liebknecht [1033]
- Gustav Noske [1034]
- Lénine [796]
- Francisco Franco [1035]
- Adolphe Hitler [1036]
- Benito Mussolini [1037]
- Pierre Laval [1038]
- Joseph Staline [1039]
- Robert Oppenheimer [1040]
- Jean-Baptiste Clément [1041]
- Ronald Reagan [1042]
- Margaret Thatcher [1043]
Heritage de la Gauche Communiste:
Rubrique:
Permanence en ligne - samedi 18 octobre 2025 à 15h
- 42 lectures
Le Courant communiste international organise une permanence en ligne (en français, espagnol, italien et néerlandais) le samedi 18 octobre 2025 à 15h. Ces permanences sont des lieux de débat ouverts à tous ceux qui souhaitent rencontrer et discuter avec le CCI.
Nous invitons chaleureusement tous nos lecteurs et tous nos sympathisants à y participer afin de poursuivre la réflexion sur la situation historique et de confronter les points de vue. Les camarades sont également invités à nous faire part des enjeux qu'ils aimeraient aborder.
Si vous souhaitez assister à cette rencontre, envoyez un message à l’adresse suivante pour confirmer votre participation, en signalant quelles questions vous souhaiteriez aborder afin de nous permettre d’organiser au mieux les débats : [email protected] [213] ou dans la rubrique « contact [214] » de notre site web.
Les modalités techniques pour se connecter à la permanence seront communiquées par mail ultérieurement.
Vie du CCI:
- Permanences [291]
Rubrique:
Grèves contre le massacre à Gaza: Le prolétariat en Italie dans les filets du pacifisme et du nationalisme
- 179 lectures
Plus que toute autre, la paix imposée par Donald Trump à Gaza mérite l’appellation de « paix des cimetières ». Après deux ans de conflit et de blocus, après 68 000 morts, la plupart des civils dont 20 000 enfants, après la destruction des habitations, des hôpitaux et des écoles, les deux millions de Gazaouis survivants sont épuisés, 50 000 enfants sont menacés de malnutrition aiguë et ont besoin d’un traitement immédiat. C’est un cessez-le-feu bien précaire tant les conflits d’intérêts impérialistes sont explosifs au Proche-Orient.
Ces conflits d’intérêts entre les grandes puissances, entre les puissances régionales, entre les différentes fractions bourgeoises au sein de chaque pays, les affrontements entre clans et bandes armées, viendront vite démentir les promesses d’une « aube historique d’un nouveau Moyen-Orient » proférées par le promoteur américain. À ce jour la trêve est violée et le cycle infernal des massacres a repris. Le passage de Rafah, à la frontière avec l’Égypte, est à nouveau bloqué, empêchant l’arrivée de l’aide alimentaire et sanitaire tant attendue.
Dans la période historique actuelle où tous les phénomènes de la décadence capitaliste sont poussés à l’extrême, où le militarisme et la mort rodent partout, ce massacre ne pouvait que se transformer en génocide. Chaque Palestinien était déclaré coupable et méritait donc la mort. « Il n’y a pas de Palestinien innocent », telle était la litanie de l’opinion publique israélienne, modelée comme toujours et comme partout par les médias aux ordres du gouvernement. Tous les événements qui s’enchaînèrent prirent la forme d’un déchaînement aveugle, irrationnel, barbare, depuis l’attaque surprise du Hamas le 7 octobre 2023, la riposte apocalyptique d’Israël ensuite, qui semblait abandonner la préoccupation de la survie des otages, jusqu’aux humiliations et aux tortures infligées aux otages dans les souterrains de Gaza et aux Palestiniens dans les prisons israéliennes.
Cette situation a partout provoqué un écœurement, une indignation et parfois même une réflexion sur la nature du capitalisme et l’avenir qu’il nous promet. Ces réactions d’empathie et de colère sont certainement présentes dans les grèves qui ont éclaté en Italie le 19 septembre et suivi par la première plus grande mobilisation au 22 septembre. Cette grève a touché de nombreux secteurs du public comme du privé et a conduit à de gigantesques manifestations dans plus de 80 villes italiennes. Un million de personnes a défilé dans les rues contre le massacre en cours à Gaza.
Cependant l’indignation et la colère, qui peuvent être des éléments de la conscience de classe, ne doivent pas être confondues avec elle. Le prolétariat d’aujourd’hui n’a pas eu le temps de développer suffisamment sa conscience depuis la reprise de la combativité en 2022. Le poids du recul qu’il a subi après l’effondrement du bloc impérialiste russe et la campagne démocratique assourdissante qui s’est déchaînée après 1989, pèse encore et entrave la maturation de sa conscience et la restauration de son identité de classe.
Lorsqu’on prend du recul et qu’on examine les faits de plus près, on s’aperçoit que la « grève générale » lancée par le syndicat USB (Unione Sindacale di Base) et les syndicats de base (Adl Cobas, Cobas, Cub et Sgb) adresse un soutien et une solidarité non pas aux travailleurs palestiniens et à la population exploitée, victime de ce génocide, mais à la Palestine, c’est-à-dire à l’un des camps de cette guerre impérialiste qui met aux prises Israël et le Hamas. Malgré la crise économique et les conflits impérialistes qui la frappent de plein fouet, la bourgeoisie internationale a encore la force de détourner les réactions spontanées de son ennemi de classe à vouloir faire au moins quelque chose contre la barbarie qui se déroule à Gaza, vers le terrain du nationalisme, du chauvinisme et du pacifisme, c’est-à-dire de l’emprisonner dans les filets de l’idéologie bourgeoise. Telle est la signification des nombreux drapeaux palestiniens présents dans les manifestations dans les villes italiennes et les slogans comme « Free Palestine ». La bourgeoisie et ses appendices de gauche et gauchistes demandaient au prolétariat de choisir l’un des deux camps en présence.
Bien entendu cette guerre concerne le prolétariat tout entier, car il est le dépositaire de la solidarité de classe internationale qu’il sera obligé de développer dans ses luttes pour forger son unité. Il est aussi la principale victime de la guerre impérialiste, sur le front comme chair à canon sacrifiée au nom du profit capitaliste, à l’arrière comme force de travail surexploitée pour faire face à la demande exponentielle en armes. Il est enfin la seule force sociale capable d’opposer sa propre alternative à la perspective bourgeoise ; celle de la multiplication des guerres impérialistes menaçant jusqu’à la disparition de l’humanité dans le maelstrom de la crise actuelle, du chaos et de la barbarie.
Rappelons que c’est la révolution prolétarienne, en Russie et en Allemagne, qui a obligé la bourgeoisie à mettre fin à la Première Guerre mondiale. Rappelons qu’en pleine contre-révolution, les travailleurs d’Amsterdam, entraînant derrière eux la population dans une dizaine de villes des Pays-Bas, sont entrés en grève en février 1941 pour entraver les rafles de Juifs par les nazis. Nous étions effectivement en pleine contre-révolution, mais, avant que le bulldozer de la Deuxième Guerre ne vienne tout écraser, la classe ouvrière hollandaise avait conservé le souvenir des luttes révolutionnaires qui avait débuté en Russie en 1917. Aujourd’hui, nous ne sommes plus dans la contre-révolution, mais le prolétariat est encore trop faible pour déjouer la force idéologique et la propagande massive de la classe dominante.
La classe ouvrière reste cependant capable de réagir, de se mobiliser face aux attaques économiques contre ses conditions de travail et de vie, comme elle l’a montré à l’échelle internationale depuis 2022, elle est même capable de comprendre, notamment pour ses minorités les plus conscientes et combatives, le lien entre le réarmement, les budgets militaires et les politiques d’austérité.
Mais c’est, aujourd’hui, rendu plus difficile et compliqué face à la guerre dont les massacres et la terreur lui renvoient l’image de sa propre impuissance. La sidération provoque la paralysie tandis que les maoïstes, les trotskistes ou encore l’anarchisme officiel encensent la résistance palestinienne ou les bataillons féminins de la résistance kurde. Qu’il s’agisse d’un État officiel ou d’un État potentiel comme en Palestine et au Kurdistan, la guerre impérialiste met aux prises des fractions bourgeoises qui tentent de mobiliser toute la population, et en particulier la classe ouvrière, dans l’effort de guerre. Face à la classe dominante israélienne, le Hamas ne vaut guère mieux, lui qui se réclame de l’islamisme radical qu’on voit à l’œuvre en Afghanistan ou en Iran. Dès que l’armée israélienne s’est retirée partiellement, le Hamas a repris ses défilés militaires et a exécuté sur la place publique quelques trois-cents « traîtres » qui auraient collaboré avec Israël.
Comme le dit Engels dans L’Origine de la famille, de la propriété privée et de l’État, l’existence des classes est la source de la dynamique qui conduit à la formation d’un État qui est toujours aux mains de la classe dominante et vise à protéger les conditions de l’exploitation, telle est la situation de la Palestine. La classe ouvrière n’a aucun intérêt dans cette guerre et ses intérêts divergent de ceux de la classe bourgeoise palestinienne, qu’il s’agisse du Hamas, de l’Autorité palestinienne, du Fatah ou autre organisation de l’Organisation de libération de la Palestine.
Lors des premières manifestations ouvrières contre la Première Guerre mondiale, Lénine expliquait que le pacifisme proclamé par les grandes masses du prolétariat en 1915 et 1916 était, certes, une faiblesse mais que la dynamique portait alors le prolétariat vers la révolution. Nous ne sommes pas dans une telle situation aujourd’hui. C’est pourquoi il est important que les révolutionnaires expliquent patiemment aux ouvriers que le pacifisme est un piège, tout comme le soutient au droit international ou la défense de la démocratie contre les fractions bourgeoises populistes. Défendre le droit à l’auto-détermination nationale c’est pour le prolétariat creuser sa propre tombe. À l’inverse l’internationalisme, le refus de choisir entre les deux camps impérialistes, est l’antidote qui va lui permettre de se constituer en classe et d’être en mesure d’abattre le capitalisme qui, à travers chaque guerre, prélève chaque jour sa livre de chair sur le grand corps du prolétariat.
Dans De Tribune, l’organe du Sociaal-Democratische Partij en Hollande, Anton Pannekoek écrivait le 19 juin 1915 : « Ce n’est qu’en tant que partie de la lutte générale contre le capitalisme que la lutte contre le militarisme peut donner des résultats ». En effet, la paix est impossible sous le capitalisme et les événements à Gaza se chargent déjà de la confirmer. De même, la mystification de l’émancipation nationale a déjà coûté cher aux prolétaires palestiniens comme il exprime aujourd’hui les difficultés auxquelles se heurte le prolétariat en Italie.
YR, 20 octobre 2025
Géographique:
Récent et en cours:
- Gaza [874]
- Conflit israélo-palestinien [262]
Rubrique:
ICConline - Novembre 2025
- 21 lectures
Rubrique:
Les effets de la décomposition constituent un obstacle majeur à la lutte de classe
- 132 lectures
Au second semestre 2025, plusieurs pays d'Asie, d'Afrique et d'Amérique latine, où la misère est intense et généralisée, ont été secoués par des révoltes populaires. Les protestations ont débuté en Indonésie en août, suivies par le Népal et les Philippines en septembre. Elles se sont ensuite propagées dans des pays d'Amérique latine (Pérou) et d'Afrique (Maroc, Madagascar et Tanzanie). Au total, huit révoltes ont éclaté en seulement quelques mois. La colère a été attisée par des problèmes tels que la corruption, l'injustice, les inégalités et le manque de transparence, dans des pays durement touchés par la déstabilisation économique du capitalisme mondial. Les médias dominants ont instrumentalisé ces manifestations, affirmant que la jeunesse, la génération Z[1], allait changer le monde. Mais le monde a-t-il réellement besoin de ces révoltes et contribuent-elles à mettre fin à la barbarie ?
Les trois pays étudiés dans cet article sont confrontés à une grave crise économique. Le Népal compte parmi les pays les plus pauvres du monde et est confronté à une forte inflation, au chômage, à un faible niveau d'investissement et à une économie en difficulté. Son économie se maintient à flot principalement grâce aux transferts de fonds de centaines de milliers de jeunes travaillant à l'étranger. L'économie indonésienne est soumise à de fortes tensions, et tout indique que le pays approche d'un point de rupture budgétaire, avec un chômage important, des licenciements massifs dans le secteur industriel et des ménages confrontés à une crise du coût de la vie brutale. Les Philippines luttent contre une pauvreté chronique, des inégalités de revenus considérables, le sous-emploi et une crise alimentaire naissante.
Dans ces trois pays, le nombre de jeunes est en augmentation. Aux Philippines, près de 30% de la population a moins de 30 ans ; en Indonésie, c’est le cas d’environ la moitié des 270 millions d’habitants et au Népal, il s’agit de plus de la moitié des 30 millions d’habitants. En Indonésie, le chômage des jeunes dépasse les 15%, et au Népal, il dépasse les 20%. Pour une grande partie de la jeunesse, les perspectives sont extrêmement sombres. C’est l’une des raisons de l’implication massive des jeunes dans les révoltes populaires.
Ces trois pays sont en proie à une corruption endémique et disposent d’une législation anticorruption exhaustive pour la combattre. De hauts fonctionnaires, des hommes politiques et des chefs d’entreprise sont régulièrement poursuivis pour corruption. Pourtant, la corruption n’a jamais reculé. Dans l’indice de corruption « Transparency International's 2024 Corruption Perceptions Index », ces trois pays figurent encore parmi les plus corrompus : l’Indonésie se classe 99e, le Népal 107e et les Philippines 114e sur 180 pays. Lors des manifestations au Népal, en Indonésie et aux Philippines, la corruption persistante de la clique au pouvoir était l'un des enjeux centraux.
L'essor des mouvements de protestation populaire
En Indonésie, les manifestations du 25 août ont été déclenchées par l'annonce d'une allocation logement de 50 millions de roupies par mois pour les parlementaires. Cette annonce intervenait dans un contexte de licenciements massifs (plus de 80.000 travailleurs), d'une hausse de plus de 100% de la taxe foncière et de coupes budgétaires drastiques de l'État, notamment dans l'éducation, les travaux publics et la santé. Face à ce mouvement, la Coalition des syndicats (KSPI) a tenté de prendre le contrôle de la situation par une grève générale le 28 août, formulant des revendications économiques comme la hausse du salaire minimum national, la fin de la délocalisation, le gel des licenciements, la réforme de la fiscalité du travail et la révision des lois anticorruption. Cependant, le 29 août, un incident mineur –la mort d'un livreur percuté par une voiture de police– a envenimé la situation et des émeutes ont éclaté pendant une semaine dans tout le pays. Au cours de ces émeutes, des dizaines de bâtiments publics et privés ont été incendiés et plus de 2.000 personnes ont finalement été arrêtées.
Au Népal, le déclencheur immédiat des manifestations a été l'interdiction par le gouvernement de 26 plateformes de médias sociaux le 4 septembre. Ce blocage a été perçu comme une tentative de soustraire à toute responsabilité les élites politiques corrompues. Les banderoles et les pancartes brandies lors des manifestations dénonçaient le népotisme, la corruption et l'impunité. Pour une génération confrontée au chômage, à l'inflation et à la désillusion envers les partis traditionnels, le népotisme et la corruption incarnent un système défaillant. Les manifestations ont commencé à s'intensifier lorsque la police anti-émeute a fait usage de balles réelles les 8 et 9 septembre, tuant plus de 70 manifestants et en blessant plus de 2.000. Dès lors, la réaction des jeunes est devenue ouvertement violente : incendies criminels et pillages ciblés, incendie du Parlement, agressions et poursuites de politiciens et incendies de leurs maisons.
Aux Philippines, les manifestations ont été déclenchées par un scandale de corruption lié aux projets de protection contre les inondations. Une enquête portant sur des milliers de projets a révélé que nombre d'entre eux n'avaient jamais été achevés et que d'autres n'existaient même pas. Malgré l'augmentation annuelle des budgets alloués à la lutte contre les inondations, des centaines de communautés restaient vulnérables face à la montée des eaux. L'État philippin a immédiatement lancé une enquête pour divulguer l'ampleur de la corruption des fonctionnaires et des politiciens impliqués dans ces projets. Parallèlement, la colère s'est accrue avec la diffusion sur les réseaux sociaux de photos et de vidéos montrant le train de vie fastueux des enfants de politiciens et de familles riches, communément appelés « bébés népotistes ». Ces événements ont déclenché des manifestations anticorruption le 21 septembre, où, rien qu'à Manille, 150.000 personnes sont descendues dans la rue. Cette mobilisation s'est déroulée sous le slogan : « S'il n'y avait pas de corrompus, il n'y aurait pas de pauvres ». Le 16 novembre, elle a été suivie d'une autre mobilisation massive de plus d'un demi-million de personnes.
Révoltes populaires : expression de la déliquescence du capitalisme
Ces trois pays sont frappés par les conséquences de multiples crises. Aux Philippines, par exemple, les phénomènes météorologiques extrêmes récurrents s'accompagnent d'instabilité économique, d'une crise alimentaire naissante et des effets persistants de la pandémie de COVID-19. L'effet cumulatif de ces crises les rend bien plus graves que la somme de leurs composantes, les populations les plus pauvres étant les premières victimes. Et chaque année, les effets de la décomposition du capitalisme ont un impact plus important sur la vie quotidienne dans ces pays.
Contrairement à ce que pensent les manifestants, la mauvaise gestion de l'État ou la corruption de tel ou tel politicien ou faction bourgeoise, qui sont pourtant bien réelles, ne constituent qu'un symptôme de la putréfaction de l'ensemble du système capitaliste, qui affecte également l'économie. La souffrance et la misère dans ces pays sont fondamentalement dues à l'économie capitaliste, qui traverse une crise sans précédent et sacrifie toujours plus de pans de la population mondiale dans une tentative de prolonger son agonie. La crise historique du capitalisme se traduit par une absence totale de perspectives d'avenir pour la masse de la population, et en particulier pour les jeunes, qui souffrent d'un chômage de masse.
Les révoltes populaires ne résolvent pas les maux du peuple.
Les révoltes populaires n'ont pas de caractère de classe spécifique et sont par définition hétérogènes. Elles sont incapables de développer une perspective autre que celle d'un État-nation libéré de ses inévitables dérives. Les révoltes populaires ne sont pas dirigées contre l'État bourgeois, mais seulement contre ses effets pervers. La violence est une caractéristique inhérente aux protestations populaires lorsque les revendications ne sont pas satisfaites immédiatement ou de manière satisfaisante. En ce sens, elles sont des exemples frappants de comment l'impuissance et le désespoir peuvent se transformer en une rage aveugle.
Mais les affrontements avec les forces répressives, l'occupation des bâtiments gouvernementaux, la traque des membres du gouvernement et même la participation massive des travailleurs à ces actions ne confèrent pas à ces révoltes un caractère révolutionnaire potentiel, malgré les efforts répétés de l'extrême gauche capitaliste pour nous le faire croire[2].
En Indonésie, le mécontentement s'accumulait depuis des mois et lorsque le président a refusé de céder aux revendications le 28 août, une simple étincelle a suffi pour déclencher des émeutes sans précédent depuis des décennies. La colère s’est retournée contre les symboles mêmes de l'État bourgeois. Mais la destruction de commissariats, de parlements régionaux, de gares routières et ferroviaires n’a évidemment pas rapproché d'un iota la solution à leur misère.
D’aucune manière même, car les manifestations sont régulièrement exploitées, manipulées par des cliques bourgeoises et utilisées à leur avantage. La lutte contre la corruption aux Philippines, contre les inégalités de revenus en Indonésie ou contre l'interdiction des réseaux sociaux au Népal, etc.; tous ces prétextes offrent aux organisations bourgeoises un excellent paravent pour régler leurs rivalités, comme ce fut le cas lors de la manifestation anticorruption du 17 novembre à Manille, récupérée par une secte chrétienne en faveur du camp de Duterte[3].
Toutes ces manifestations aboutissent soit à une victoire amère, lorsque l'ancienne faction bourgeoise est remplacée par une nouvelle, soit à une répression d'État pure et simple, soit aux deux. Et la réponse de l'État à ces manifestations est généralement brutale : au Népal, elle a fait plus de 70 morts et des centaines de blessés, et en Indonésie, des milliers d'arrestations. Les révoltes populaires, reflet d'un monde sans avenir, caractéristique par excellence de la phase de décomposition du système, ne peuvent que propager les maux d'un capitalisme en putréfaction[4].
Le point de vue de la classe ouvrière
Les revendications des protestations restent superficielles et n'abordent en rien les racines de la misère : l'économie capitaliste, fondement de la vie sociale sous le capitalisme. Par conséquent, aucune concession faite aux protestations populaires ne change ni la situation particulière des démunis ni la situation générale du pays, comme les manifestants doivent rapidement l'admettre, à leur grand déplaisir. La seule solution à la misère croissante est le renversement du capitalisme par le prolétariat mondial.
Les protestations populaires ne constituent en aucun cas un tremplin vers la lutte des classes. Elles représentent au minimum un obstacle majeur, au pire un piège dangereux. Car les revendications formulées lors de ces mouvements « diluent le prolétariat dans l'ensemble de la population, estompant la conscience de son combat historique, le soumettant à la logique de la domination capitaliste et le réduisant à l'impuissance politique »[5]. Le prolétariat a tout à perdre en se laissant entraîner dans une vague de protestations populaires, totalement aveuglées par les illusions démocratiques quant à la possibilité d'un État capitaliste « propre ».
Au lieu de participer à ces révoltes, les travailleurs doivent imposer leurs propres slogans et organiser leurs propres réunions, dans le cadre d'un mouvement qui leur soit propre. Le prolétariat est la seule force de la société capable d'offrir une alternative aux conditions toujours plus insupportables d'un capitalisme obsolète. Mais cela ne peut réussir à l'intérieur des frontières d'un seul pays, surtout lorsque le prolétariat ne représente qu'une faible proportion de la population totale, que les concentrations prolétariennes sont plutôt dispersées et que les travailleurs ont peu d'expérience de la lutte contre la démocratie bourgeoise et les multiples pièges que cette classe lui tend. Ce n'est qu'en développant une lutte commune avec les masses laborieuses des pays du cœur du capitalisme, qui ont accumulé une longue expérience de la mystification démocratique, que sera possible le renversement nécessaire du capitalisme et l'émancipation de l'humanité.
Novembre 2025 / Dennis
[1] Selon la bourgeoisie, une révolution de la génération Z déferle sur le monde. Elle salue les mouvements de protestation qui ont réussi à renverser des gouvernements en place, sans pour autant avoir fondamentalement transformé la société capitaliste. Assimiler de tels événements à une révolution vise à discréditer le point de vue de la classe ouvrière.
[2] La section anglaise de l'Internationale communiste révolutionnaire (ex-IMT) donne comme titre à l'un de ses articles : «De l'Italie à l'Indonésie, de Madagascar au Maroc : une vague de révolution, de rébellion et de révolte déferle sur le monde.»
[3] Philippine massive anti-corruption protests hijacked by evangelical sect [1045], Europe Solidaire Sans Frontières
[4] La Tendance communiste internationale (TCI) a fait preuve d'un opportunisme flagrant en publiant une déclaration sur les manifestations au Népal (Statement on the Protests in Nepal [1046]), signée par la section sud-asiatique du NWBCW. En soutenant l'appel lancé à la génération Z népalaise à « mener une lutte politique et violente », elle les incite en réalité à se lancer dans des actions aventuristes qui s'apparentent à un suicide !
[5] Face à la plongée dans la crise économique mondiale et la misère, les "révoltes populaires" constituent une impasse [104], Revue Internationale 163.
Géographique:
- Indonésie [1047]
Conscience et organisation:
Personnages:
- Rodrigo Duterte [1048]
Courants politiques:
- TCI / BIPR [247]
Questions théoriques:
- Décomposition [517]
Rubrique:
Permanence en ligne, samedi 22 novembre 2025 de 15h à 18h
- 46 lectures
Le Courant communiste international organise une permanence en ligne (en français) le samedi 22 novembre 2025 de 15h à 18h. Ces permanences sont des lieux de débat ouverts à tous ceux qui souhaitent rencontrer et discuter avec le CCI. Nous vous invitons vivement à venir débattre afin d’approfondir la réflexion sur les enjeux de la situation, confronter les positions et les questionnements, contribuer à la clarification des questions politiques.
Les camarades qui souhaitent participer à cette permanence en ligne nous adresseront à l’adresse suivante un message pour confirmer leur participation, [email protected] [213] ou dans la rubrique « contact [214] ».
Les modalités techniques pour se connecter à la permanence seront communiquées par mail ultérieurement.
Vie du CCI:
- Permanences [291]
Rubrique:
50 ans du CCI, 50 ans de convulsions capitalistes : le combat pour la révolution communiste est plus que jamais nécessaire !
- 194 lectures
Samedi 6 décembre 2025, de 15h à 18h (heure française)
Notre organisation, le Courant communiste international, a été fondée en janvier 1975, il y a un peu plus d’un demi-siècle. Pour marquer cette occasion, nous avons publié un nouveau Manifeste : « Le capitalisme menace l’humanité : la révolution mondiale est la seule solution réaliste [1049] », qui analyse le contexte historique de la réémergence de la Gauche communiste internationale à la fin des années 1960, mais aussi les bouleversements profonds qui ont eu lieu depuis lors et qui démontrent clairement que le mode de production capitaliste menace la survie même de l’humanité avec un tourbillon catastrophique de guerres, d’effondrement écologique et de crises économiques et politiques. Mais le Manifeste soutient également que la capacité de la classe ouvrière mondiale à défendre ses propres intérêts et, à plus long terme, à renverser ce système pourri, est toujours intacte.
Cette réunion publique internationale est organisée afin de discuter de l’analyse de la situation mondiale présentée dans ce Manifeste. Mais ce document insiste également sur la responsabilité historique des organisations révolutionnaires du prolétariat, sur leur rôle indispensable dans la maturation des conditions subjectives de la future révolution prolétarienne.
La présentation à la réunion sera faite en anglais, mais nous assurerons également la traduction de cette contribution et de toutes les autres en plusieurs autres langues (français, espagnol, portugais et éventuellement d’autres).
Pour participer à la réunion, écrivez-nous à [email protected] [911] ou rendez-vous dans la rubrique « Contactez-nous » de notre site web.
Vie du CCI:
- Réunions publiques [219]
Rubrique:
ICConline - Décembre 2025
- 19 lectures
Soudan: une guerre barbare alimentée par de nombreux appétits impérialistes
- 84 lectures
La Cour pénale internationale, ce bastion de la morale bourgeoise et des «droits de l’homme», parmi tant d’autres chimères de l’idéologie bourgeoise, a rendu son verdict à l’encontre d’un des chefs de guerre du conflit qui ravage le Soudan, Ali Kushayb, sinistre personnage à la tête des milices janjawid pro gouvernementales. Il est accusé de «crime de guerre» et de «crime contre l’humanité». Un examen pénal qui s’est accompagné d’une enquête pour déterminer si un génocide avait été commis au Darfour en 2003, année où au moins 300.000 personnes ont péri. Pour la population soudanaise, ces épisodes juridiques ne changent rien aux souffrances qui ne font que s’accroître. Le jugement a d’ailleurs été prononcés alors que la «pire crise humanitaire au monde» qui a déjà coûté la vie à près de 150.000 personnes[1] depuis le 15 avril 2023 et déplacé entre 12 et 14 millions d’individus, fait rage dans cette même région. Au massacre des civils s’ajoute encore la famine et une épidémie de choléra (depuis l’été 2024). L’orgie du carnage et une telle situation ne font qu’illustrer le vide de la «justice» bourgeoise et du «droit international» qui apparaît encore pour la supercherie qu’il a toujours été et qu’il sera toujours.
Le monde a assisté simultanément au spectacle répugnant du nettoyage ethnique à Gaza et aux massacres d’innocents, notamment de femmes et d’enfants. Une folie militariste qui se poursuit également dans d’autres régions du globe. C’est le cas surtout en Ukraine où un déluge de fer et de feu endeuille de nombreuses villes, dont la capitale Kiev, particulièrement visée et harcelée. L’usage massif de vagues de drones et de missiles plonge de multiples localités, aussi dans l’Est du pays déjà occupé, dans une terreur quotidienne effarante. A Gaza, en dépit du cessez-le-feu du 10 octobre dernier, sous «autorité américaine» et dont se réjouissent Trump et consorts, les bombardements meurtriers se poursuivent et la «trêve» comptabilise à elle seule 275 morts et plus de 600 blessés (bilan du 19 novembre). Les souffrances du peuple de Gaza saturent la propagande multiforme de la bourgeoisie mondiale, mais celles de la population soudanaise sont largement reléguées au second plan. La principale raison de cette «guerre oubliée» est probablement qu’elle ne présente pas un caractère suffisamment exploitable sur le plan idéologique, grâce auquel l’indignation qu’inspirent les massacres peut être manipulée pour susciter un élan nationaliste dans un sens ou dans l’autre.
Plongée dans le chaos
Depuis le début des violents affrontements, le 15 avril 2023, entre les Forces armées soudanaises (FAS) et les Forces de soutien rapide (FSR), une milice paramilitaire, les deux camps se livrent à une effroyable guerre civile, avec le soutien de milices armées venues de tout le Soudan et de plusieurs autres pays qui mettent sans vergogne de l’huile sur le feu. Le Soudan est aujourd’hui déchiré par un conflit aux multiples facettes échappant au contrôle des deux principales forces armées. Le pays nous offre un exemple de folie irrationnelle où les alliances, de toutes parts, recèlent des contradictions intrinsèques dès leur origine et se défont au gré des intérêts immédiats ou de circonstances des protagonistes.
Dans ce conflit sanglant, il n’y a pas de véritable ligne de front et les civils sont pris entre tous les feux. Les deux camps majeurs et les nombreuses milices informelles mènent des attaques aveugles contre les infrastructures civiles, notamment les hôpitaux[2], contre les civils dans des zones densément peuplées comme les camps de réfugiés, et font un usage généralisé des violences sexuelles. Les RSF, en particulier, instrumentalisent le conflit pour intensifier le nettoyage ethnique, ciblant les communautés non arabes. Un épisode d’une violence extrême dans cette guerre civile a eu lieu en avril dernier, lorsque les RSF ont perpétré un massacre «génocidaire» de 72 heures dans le camp de réfugiés de Zamzam. Les 500.000 habitants (majoritairement des femmes et des enfants) étaient sans défense, et environ 1500 d’entre eux ont été tués dans l’un des «crimes de guerre» les plus sanglants commis dans ce conflit. Fin octobre, le siège de la ville d’El Fasher débouchait aussi sur un nouveau massacre : les mosquées étaient visées tout comme les volontaires de la croix rouge et les civils, sans discernement (plus de 2000 morts).
La famine s’ajoute et sévit de plus en plus contre la population. Elle s’est étendue à 10 régions du pays, et 17 autres sont menacées. Près d’un million de personnes sont confrontées à ce fléau. Faute d’une alimentation saine, les habitants sont par exemple contraints de préparer de la bouillie avec des ingrédients normalement destinés à l’alimentation animale. La guerre entrave considérablement l’acheminement de l’aide là où elle est le plus nécessaire. La famine est même provoquée délibérément, devenant elle-même une arme de guerre. Le Soudan est une manifestation évidente de la dynamique de désintégration du capitalisme : «de dangereuses failles impérialistes se sont ouvertes et continuent de s’ouvrir à travers le globe, le militarisme étant le principal exutoire qui reste à l’État capitaliste». Le déclenchement de la guerre civile «exprime la profonde tendance centrifuge vers un chaos irrationnel et militariste[3]« dans le monde d’aujourd’hui. Il montre l’avenir que ce système nous réserve à tous. Cet avenir n’est toutefois pas qu’une descente directe vers le chaos ; c’est une dynamique folle que les bourgeoisies de toutes les nations accélèrent en tentant de les exploiter à leurs propres fins cupides, dans une fuite en avant sans issue. Les contours de ces politiques se dessinent de plus en plus nettement. De vastes zones de chaos et de violence encerclent des îlots en sursis ceints de forteresses frontalières et de centres de détention. Du Soudan et du Sahel à Gaza, de la Libye au Salvador, en passant par Calais/Douvres et la frontière américano-mexicaine, cet avenir fait de destructions et de dislocation prend chaque jour de l’ampleur. Il imprime le visage du futur que nous réserve le capitalisme.
Un enjeu de rivalités impérialistes
L’Afrique est un objet d’intérêts importants pour d’innombrables puissances impérialistes dans le monde qui tentent de conquérir une position favorable. Outre les États-Unis et la Chine, pays qui ont d’énormes intérêts commerciaux et géopolitiques en Afrique, la Turquie, la Russie, le Japon, le Brésil et l’Inde ont également investi à des degrés divers, que ce soit sur le plan militaire, commercial ou uniquement diplomatique. Le chaos croissant, marqué par l’effondrement social, environnemental et économique de régions entières, est considéré par de nombreux autres pays comme une occasion de s’immiscer sur le théâtre africain. Cette ruée moderne vers l’Afrique s’accompagne plus que jamais d’une violence organisée, perpétrée par les milices les plus impitoyables et les plus brutales.
Au Soudan, ce sont principalement les États du Golfe qui «profitent» de la déstabilisation du pays et du chaos qui s’y installe. Le conflit a incité plusieurs puissances impérialistes de la région à soutenir l’un des camps belligérants. L’Arabie saoudite, la Turquie et l’Égypte soutiennent les SAF (les forces gouvernementales dites «légitimes») contre les Émirats arabes unis qui soutiennent de plus en plus ouvertement les RSF. Mais d’autres prédateurs impérialistes attisent également le chaos dans le pays. Non seulement les intérêts saoudiens, émiratis, égyptiens et turcs, mais aussi qataris, russes, ukrainiens et iraniens se croisent et se chevauchent, transformant le conflit en une situation extrêmement explosive.
L’ensemble du Sahel fait de plus en plus partie de ce que certains journaux bourgeois ont qualifié d’»écosystème» de conflit[4]. Il s’inscrit de plus en plus dans une tendance générale à la balkanisation qui, en dernière analyse, est un aspect de la tendance plus large au «chacun pour soi» dans la société capitaliste. Ainsi, l’une des conséquences de la guerre au Soudan est son extension par la prolifération de petits conflits armés, qui traversent les frontières poreuses du Soudan, conduisant à une aggravation de la situation dans une grande partie du Sahel, tendant à se transformer en une mare de sang régional. Le Darfour n’est pas la seule destination de la RSF. Les aéroports de Libye et du Tchad sont déjà utilisés pour l’approvisionner en armes. Le chef de la RSF, Dagalo, a des racines au Tchad et a exprimé son aspiration à étendre son influence à travers le Sahel.
La bourgeoisie est assez arrogante pour croire qu’elle peut maîtriser cette descente aux enfers. Certes, cela a été une stratégie à bien des égards employée par diverses puissances impérialistes jusqu’à présent ; cependant, cette maîtrise est et restera toujours une chimère. Elle ne maîtrise pas, et ne pourra jamais maîtriser toutes les manifestations barbares de son propre système social ! C’est ce qu’il faut garder à l’esprit lorsqu’on analyse les stratégies impérialistes de notre époque. Malgré ses tentatives d’exploiter le chaos à son avantage et d’instaurer des formes de contrôle toujours plus brutales pour le contenir, la bourgeoisie creuse en réalité sa propre tombe.
La situation catastrophique au Soudan est généralement présentée comme une «crise humanitaire». Mais le conflit et ses conséquences désastreuses ne peuvent être résolus par l’intervention d’organisations caritatives ou de pays «responsables». Le véritable problème est la guerre interne entre les différents gangsters, utilisés par les nations impérialistes de la région pour accroître leur influence sur le continent africain. Et pour beaucoup, leur principal intérêt n’est pas un Soudan unifié ; un Soudan divisé, à leurs yeux, est censé offrir davantage d’opportunités de s’implanter dans le pays.
La solution de la classe ouvrière
La guerre en phase de décomposition représente un danger majeur pour les travailleurs du monde entier. Ils risquent d’être engloutis par un océan de phénomènes putrides et de perdre ainsi la capacité d’agir sur l’histoire, en tant que classe. C’est précisément pourquoi nous devons réaffirmer que notre force réside dans la solidarité internationaliste. Nous devons résister à la tentative du capitalisme de nous diviser en «citoyens», logés dans des cages plus ou moins confortables, et en «paria», livrés en pâture aux idoles de la destruction militariste.
Le résultat positif d’une telle résistance ne sera pas obtenu grâce à des notions idéalistes de fraternité et d’unité, mais uniquement par la pratique de la lutte internationale de la classe ouvrière contre la classe dominante, où que nous soyons. Les fractions de la classe prolétarienne qui vivent dans des régions du globe qui n’ont pas été plongées dans les profondeurs de la barbarie qui nous attend tous doivent lutter avec d’autant plus de détermination en vue du moment où toutes les luttes des travailleurs du monde pourront être unifiées. Partout cependant, l’ennemi est le même et partout, l’enjeu ultime reste le même : le renversement du capitalisme ou la destruction de l’humanité.
(D’après World Revolution, 21 novembre 2025)
[1]Le nombre de morts est difficile à estimer en raison de la désorganisation générale du système de santé et du manque d’hôpitaux et de données. Un envoyé américain au Soudan avance le chiffre d’environ 150.000 victimes, tandis que certaines estimations sont bien inférieures (environ 60.000).
[2]Au moins 119 attaques contre des établissements de santé ont été recensées entre avril 2023 et octobre 2024, mais le chiffre réel est probablement beaucoup plus élevé. Dans les zones de conflit, plus de 80% des hôpitaux sont hors service.
[3] Voir : « Soudan 2023 : une illustration frappante de la décomposition du capitalisme [1050]», ICConline.
[4] Un conflit non isolé, mais résultant de multiples interactions.
Géographique:
Questions théoriques:
- Décomposition [517]
- Impérialisme [45]
Rubrique:
Bruxelles
- 21 lectures
- Calendrier [867]
Adresse:
PIANOFABRIEK, Rue du fort 35, 1060 Saint-Gilles (Bruxelles)
Date:
Type de rencontre:
Thème:
Introduction:
Une année de luttes en Belgique
Vers une poursuite de la résistance ouvrière malgré les manœuvres des syndicats
Face à la déstabilisation mondiale et à la multiplication des guerres, seule la résistance ouvrière sur son terrain de classe offre une alternative à la barbarie. Sur ce plan, le combat que mènent les travailleurs en Belgique depuis un an est une contribution importante au combat contre le capitalisme en putréfaction dont il faut tirer les leçons.
Dès l’annonce fin 2024 des mesures drastiques d’austérité planifiés par le gouvernement Arizona, touchant en particulier les chômeurs, les malades « de longue durée » et les pensions, la colère est grande et la réaction des travailleurs belges explose.
Depuis fin 2024, ce sont des milliers de manifestants de tout secteur, de toute région qui se retrouvent dans les manifestations nationales à Bruxelles, exprimant ainsi la volonté de se mobiliser tous ensemble unis “dans la rue”. Ils rejoignent ainsi le mouvement de résistance déclenché par les ouvriers en Grande-Bretagne en 2022 suivi par la France, les USA,… face aux sacrifices insupportables sur les conditions de vie et de travail exigés pour financer les dettes d’Etat et l’augmentation des budgets militaires.
Les syndicats, main gauche de la bourgeoisie, conscients du danger de débordement de cette combativité croissante, s’organisent pour contrôler la réaction de la classe ouvrière. Organisation de grèves générales totalement passives, de mouvements sectoriels et régionaux, tout vise à contrer la dynamique d’unification des manifs de la première moitié de 2025 et à épuiser la classe ouvrière dans des mouvements longs et impopulaires.
Mais la classe ouvrière reste en colère et est capable de tirer des enseignements de ses luttes. Face aux mesures qui ne cesseront de s’amplifier face à une situation de crise économique mondiale qui exigera toujours plus de “sacrifices », elle ne manquera pas de réagir à nouveau. Elle devra le faire en s’organisant elle-même, en prenant en mains ses luttes pour faire reculer la bourgeoisie même temporairement. Les organisations révolutionnaires sont là pour lui mémoriser ses combats antérieurs et ses moyens de lutte sur un terrain de classe.
Voir l’article :
Venez discuter de toute cette expérience de luttes en Belgique mais aussi d’ailleurs, à la réunion publique du CCI qui se tiendra à :
Bruxelles en présentiel, le samedi 13 décembre de 14h30 à 18h00
Adresse : PIANOFABRIEK, Rue du fort 35, 1060 Saint-Gilles (Bruxelles)
Il y a 120 ans le surgissement des soviets en Russie
- 79 lectures
Le CCI a jugé important de marquer le 120e anniversaire de ce moment historique de la lutte de la classe ouvrière en organisant une réunion publique en ligne en anglais (ainsi que dans d'autres langues) sur ce thème, afin de mettre en évidence sa pertinence pour la lutte des classes dans la période actuelle.
Nous ne pouvons que déplorer que, une fois de plus, à part Internationalist Voice[1], aucun des autres groupes du milieu politique prolétarien, pourtant invités à participer, n'était présent. En fait, la CWO a programmé sa réunion publique à Londres en même temps que la nôtre, ce qui est particulièrement regrettable alors que la coopération entre les organisations communistes est nécessaire (dans cet esprit, le CCI a d’ailleurs envoyé une délégation à cette réunion de la CWO).
Nous rendons compte des discussions de cette réunion, de l’intérêt qu’elles représentent mais aussi des difficultés qu’elles ont rencontrées.
Certains des jeunes camarades présents à la réunion, peu familiers avec les événements discutés, tendaient à se limiter à poser des questions au CCI. Ce n'est pas un problème en soi, dès lors que de telles réunions ne sont pas comprises comme de purs exercices «pédagogiques» mais des moments permettant de stimuler la discussion collective, l’expression des doutes et des désaccords dans le but de clarifier les questions politiques qui se posent à la classe ouvrière. Suite à la tenue de notre réunion, un participant -qui est aussi un proche sympathisant du CCI- nous a fait parvenir une courte contribution écrite mettant en évidence toute l’importance des événements de 1905 en Russie pour la lutte de classe passée, présente et future du prolétariat mondial. Nous en citerons quelques extraits appropriés.
La discussion a permis de clarifier un certain nombre de questions soulevées par notre présentation initiale.
Quelles questions ont été au cœur de la discussion ?
Une nouvelle période dans l'histoire du capitalisme
Un large consensus s’est exprimé sur l’importance historique des événements de 1905 qui ont marqué le début d'une nouvelle période dans l'histoire du capitalisme, celle de la fin de son ascendance, l’amorce de sa décadence, exigeant de nouvelles formes de lutte et d'organisation de la classe ouvrière, en particulier les assemblées générales et surtout le surgissement des conseils ouvrier[2]. Cette période se caractérise par la fusion des dimensions économiques et politiques du mouvement et par l'adoption du programme maximal comme principe de la révolution prolétarienne.
Comme le souligne la contribution qu’un proche contact du CCI ayant participé à la RP nous a transmise par la suite : «La grève générale s'inscrit dans le développement de la lutte historique de la classe ouvrière contre le capitalisme. Il ne s'agissait pas de la «grève générale» prônée par l'anarchisme ou de la lutte pacifique pour des réformes de Kautsky, ni d'une «répétition» de la révolution d'octobre 1917, mais d'une partie du développement politique de la lutte des classes, issue de la maturation souterraine de la conscience de classe face à la transition du capitalisme de sa phase ascendante, généralement progressiste, à celle de sa décadence : «Les choses ont atteint un tel point que l'humanité est aujourd'hui confrontée à deux alternatives : elle peut périr dans le chaos ou trouver le salut dans le socialisme » (Discours de Rosa Luxemburg sur le programme lors du congrès fondateur du KPD)». Certaines questions ont été posées pour savoir si le mouvement de 1905 était, au moins dans une certaine mesure, le produit de conditions spécifiques à la Russie. La même contribution de notre contact rapporte : «Les décennies qui ont précédé les événements de 1905 en Russie ont vu s'accélérer et s'aiguiser les questions concernant le séisme politique qui se préparait : l'Afrique a été entièrement colonisée et morcelée par l'impérialisme en l'espace de vingt ans seulement. Juste avant les années 1900, les tensions entre la Grande-Bretagne et la France au sujet de Fachoda ont failli dégénérer en une guerre majeure entre les deux pays». Si certaines spécificités étaient effectivement présentes telles que la nature arriérée du régime tsariste, le poids des masses paysannes, etc... ce qu’il est important de retenir à propos de 1905, c’est avant tout que ce mouvement a préfiguré les méthodes de lutte et la forme d'organisation appropriées à la lutte des classes dans la phase historique de décadence du capitalisme qui allait suivre, et ce à l'échelle mondiale : à savoir la grève de masse et les soviets. Cela a d'ailleurs été confirmé par de nombreuses luttes ultérieures, durant la première vague révolutionnaire mondiale en particulier en Russie de nouveau en1917 et en Allemagne en 1918-19 notamment, mais également depuis 1968, avec la grève de masse en Pologne en 1980 et le surgissement d’assemblées générales massives, de comités de grève élus et révocables, les MKS.
Une perspective concrète, celle de la révolution prolétarienne
La nouvelle période historique de la vie du capitalisme ainsi ouverte par les événements de 1905 pose, dans la pratique, la perspective concrète du combat pour la révolution prolétarienne, désormais à l’ordre du jour de l’histoire avec des implications très importantes notamment concernant l’organisation des révolutionnaires.
Comme un camarade l’a alors souligné dans la réunion publique, la scission de 1903 dans la social-démocratie russe met justement en relief la validité de la vision des bolcheviks sur la question de l'organisation politique d’avant-garde du prolétariat, composée de révolutionnaires convaincus et fondée sur des critères stricts d'adhésion et de participation. Celle-ci correspondait aux besoins et conditions nouvelles de la lutte de la classe ouvrière à une époque où la révolution prolétarienne devenait partout à l'ordre du jour de l’histoire. Ainsi posée dans la pratique par les événements de 1905, cette question de l’avant-garde révolutionnaire allait devenir une question en débat donnant lieu à un combat politique dans le milieu révolutionnaire.
Un autre camarade a rappelé que l'aile opportuniste de la social-démocratie, incarnée par Kautsky, avait rejeté l'importance de la grève de masse en Russie, précisément en la caractérisant comme étant un produit du retard russe plutôt que comme un précurseur de l'avenir. Face à une telle vision, un autre camarade s’appuyait sur «L'Idéologie allemande» de Marx, citations à l’appui, pour souligner que des développements dans un pays –ici la grève de masse de 1905- peuvent préfigurer une tendance plus générale. Ainsi, si la montée du capitalisme en Grande-Bretagne préfigurait celle du capitalisme mondial, la grève de masse de 1905 en Russie préfigurait les caractéristiques de la lutte révolutionnaire du prolétariat mondial, comme l’illustra la révolution de 1917 en Russie et 1918-19 en Allemagne[3].
Le terrain de classe de la lutte du prolétariat
Dans la dernière partie de la réunion, la discussion a bien mis en évidence les liens entre les leçons tirées des évènements de 1905 et la situation présente. Ainsi, en lien avec la discussion sur les mouvements récents de grève en France, il a été posé la question de la distinction entre les caractéristiques des luttes ouvrières et celles des luttes interclassistes[4]. La discussion a permis de clarifier ce qui constitue le terrain de classe de la classe ouvrière avec la défense de revendications économiques, propices au développement de l'identité de classe, à travers des méthodes de lutte propres à la classe ouvrière tendant vers son auto-organisation. À ce propos, la contribution de notre contact souligne : «Au cours de la discussion lors de la réunion, il a été question que les travailleurs devraient s'impliquer davantage dans des mouvements plus larges aujourd'hui afin de faire valoir leurs propres perspectives et d'élargir le mouvement. Mais ce serait une grave erreur qui irait complètement dans la mauvaise direction. Nous avons de bons exemples récents qui montrent que cela est néfaste pour la lutte des classes. Récemment, dans le cadre de la guerre menée par Israël contre Gaza, on a vu des exemples aux États-Unis où les travailleurs ont été dilués dans des mouvements hétérogènes. Plus frappant encore est le cas de l'Italie aujourd'hui, où les travailleurs ont été mobilisés à grande échelle pour soutenir le nationalisme palestinien. Le slogan communiste « les travailleurs n'ont pas de patrie » ne s'applique pas seulement au pays dans lequel ils vivent, mais au poison du nationalisme dans son ensemble.» La discussion a également été claire sur le fait que, dans la période actuelle, la récupération de son identité de classe par le prolétariat était cruciale pour impulser la nécessaire politisation de la lutte.[5]
Concernant le rôle des révolutionnaires dans le mouvement, un camarade a posé une question sur le danger du substitutionnisme tel qu'il s'est manifesté lors de la dégénérescence de la révolution russe. Nous avons souligné que la Gauche communiste, en particulier, avait clarifié cette question à travers ses réflexions sur la révolution russe, et que nos objectifs actuels par rapport aux conseils ouvriers sont fondamentalement les mêmes dans la période actuelle que dans le passé : Défendre la nécessité absolue pour les travailleurs de prendre le contrôle direct de leurs propres luttes dans les assemblées, en tant que classe distincte et seule classe révolutionnaire de la société.
Nous avons également souligné que la bourgeoisie avait beaucoup appris de l'histoire et serait bien mieux armée que la classe dirigeante russe en 1905 pour entraver dans le futur l'émergence d'organes de classe véritablement autonomes, notamment à travers l’encadrement des luttes par ces organes d’État que sont les syndicats et les organisations gauchistes. Une telle situation requiert plus que jamais l’intervention active de l'organisation révolutionnaire pour orienter l’action politique du prolétariat et favoriser le développement de la conscience dans la classe ouvrière.
Enfin, plusieurs camarades sont intervenus pour exprimer leur accord avec le CCI sur le fait que les luttes qui ont émergé en Grande-Bretagne en 2022 et se sont depuis étendues à plusieurs autres pays -marquant ainsi une rupture avec une longue période de passivité de la classe ouvrière[6]- constituent la base indispensable pour de futures confrontations de classe qui pourront permettre la réappropriation des leçons les plus importantes des luttes passées et ouvrir la voie vers les grèves de masse de l'avenir.
Amos, Décembre 2025
[1] Internationalist Voice [1054]
[2] « Une nouvelle époque est née : l’époque de la désagrégation du capitalisme, de son effondrement intérieur. L’époque de la révolution communiste du prolétariat ». Plateforme de l’Internationale Communiste. (Centenaire de la fondation de l’IC: l'internationale de l'action révolutionnaire de la classe ouvrière [1055]. Revue internationale 162.)
[3] 1918-1919 : il y a 70 ans, a propos de la révolution en Allemagne (1ere partie) [1056]. Revue internationale n° 55.
[4] À propos des luttes interclassistes lire Rapport sur la lutte de classe internationale au 24ème Congrès du CCI [415]; Revue internationale 167.
[5] À propos de la politisation des luttes, lire notre article : Après la rupture dans la lutte de classe, la nécessité de la politisation des luttes [1057] ; Revue internationale 171.
[6] Idem
Vie du CCI:
- Mémoire [1058]
Histoire du mouvement ouvrier:
- Révolution Russe [217]
Conscience et organisation:
Heritage de la Gauche Communiste:
Rubrique:
Une année de luttes en Belgique - Vers une poursuite de la résistance ouvrière malgré les manœuvres des syndicats
- 107 lectures
Face à la déstabilisation mondiale et à la multiplication des guerres, seule la résistance ouvrière sur son terrain de classe offre une alternative à la barbarie. Sur ce plan, le combat que mènent les travailleurs en Belgique depuis un an est une contribution importante au combat contre le capitalisme en putréfaction dont il faut tirer les leçons.
Dès l’annonce fin 2024 des mesures drastiques d’austérité planifiés par le gouvernement Arizona, touchant en particulier les chômeurs, les malades « de longue durée » et les pensions, la colère est grande et la réaction des travailleurs belges explose.
Depuis fin 2024, ce sont des milliers de manifestants de tout secteur, de toute région qui se retrouvent dans les manifestations nationales à Bruxelles, exprimant ainsi la volonté de se mobiliser tous ensemble unis “dans la rue”. Ils rejoignent ainsi le mouvement de résistance déclenché par les ouvriers en Grande-Bretagne en 2022 suivi par la France, les USA,… face aux sacrifices insupportables sur les conditions de vie et de travail exigés pour financer les dettes d’Etat et l’augmentation des budgets militaires.
Les syndicats, main gauche de la bourgeoisie, conscients du danger de débordement de cette combativité croissante, s’organisent pour contrôler la réaction de la classe ouvrière. Organisation de grèves générales totalement passives, de mouvements sectoriels et régionaux, tout vise à contrer la dynamique d’unification des manifs de la première moitié de 2025 et à épuiser la classe ouvrière dans des mouvements longs et impopulaires.
Mais la classe ouvrière reste en colère et est capable de tirer des enseignements de ses luttes. Face aux mesures qui ne cesseront de s’amplifier face à une situation de crise économique mondiale qui exigera toujours plus de “sacrifices », elle ne manquera pas de réagir à nouveau. Elle devra le faire en s’organisant elle-même, en prenant en mains ses luttes pour faire reculer la bourgeoisie même temporairement. Les organisations révolutionnaires sont là pour lui mémoriser ses combats antérieurs et ses moyens de lutte sur un terrain de classe.
Voir l’article :
Venez discuter de toute cette expérience de luttes en Belgique mais aussi d’ailleurs, à la réunion publique du CCI qui se tiendra à :
Bruxelles en présentiel, le samedi 13 décembre de 14h30 à 18h00
Adresse : PIANOFABRIEK, Rue du fort 35, 1060 Saint-Gilles (Bruxelles)
Rubrique:
ICConline - 2026
- 22 lectures
ICConline - janvier 2026
- 27 lectures
Coup de force des États-Unis au Venezuela: Tous les États sont impérialistes! Le capitalisme, c’est la guerre!
- 304 lectures
Il aura suffi d’une nuit aux forces spéciales américaines pour enlever Nicolas Maduro en plein cœur de Caracas, et l’incarcérer dans une prison new-yorkaise. Cette impressionnante démonstration de force destinée à décapiter le pouvoir vénézuélien a été l’occasion de nouvelles fanfaronnades de Donald Trump et d’un avertissement au monde : « Aucune nation au monde ne peut accomplir ce que nous avons accompli » !
Derrière Trump et Maduro, la même barbarie capitaliste
Les soutiens de Trump y sont allés de l’habituel numéro de défenseurs de la démocratie : en renversant un dictateur, l’Amérique aurait exporté « la paix, la liberté et la justice pour le grand peuple du Venezuela ».
La bouffonnerie passe mal, cette fois-ci. Car Trump ne s’embarrasse même plus du droit international, cache-sexe mensonger dont les grandes puissances, États-Unis en tête, se sont prévalues jusqu’à présent pour justifier leurs menées impérialistes et imposer leur « ordre » depuis 1945. L’armée américaine est ainsi intervenue en dehors de tout cadre légal sous le prétexte fumeux de lutter contre le narco-terrorisme. Et Trump n’a pas même hésité à lourdement justifier son intervention par les juteux profits que pourrait générer, selon lui, la main-mise américaine sur le pétrole vénézuélien. Trump et sa clique n’ont donc que faire de la démocratie ; ils n’avaient qu’un objectif en tête : renverser un régime peu accommodant, placer le Venezuela sous tutelle et administrer une énorme gifle à ses rivaux, notamment la Russie et surtout la Chine qui est à l’offensive depuis des années et s’implante en Amérique Latine : « La domination américaine dans l’hémisphère occidental ne sera plus jamais remise en question » (Trump).
Bien sûr, les soutiens de Maduro, en particulier les forces d’encadrement du capital que sont les partis de la gauche « radicale », ont aussitôt dénoncé une atteinte au droit international et une « agression impérialiste ». Le régime bolivarien ; à la tête d’un pays « non aligné » représenterait, selon eux, un foyer de résistance à « l’impérialisme américain ».
Ce discours est une véritable tartufferie ! Le Venezuela est loin de la petite victime innocente de l’ogre américain. Dans leur confrontation avec les États-Unis, Maduro, et Chavez avant lui, se sont adjoints sans ciller le soutien de la Russie de Poutine et de la République islamique d’Iran, démontrant par là-même que Caracas est, comme tous les pays du monde, aussi faibles soient-ils, un authentique rouage de l’impérialisme, de ses guerres et de ses pillages. Si le Venezuela ne fait clairement pas le poids militairement face au mastodonte américain, ses dirigeants n’ont pas hésité à utiliser tant le pétrole que les cartels comme armes de guerre. En véritable corridor de la cocaïne produite en Colombie, le Venezuela a ainsi largement contribué à la déferlante de drogues chez ses ennemis.
Les partis de gauche peuvent bien vanter le « socialisme du XXIe siècle », les « dirigeants bolivariens » ne sont qu’une clique bourgeoise détestée et corrompue jusqu’à l’os. Chavez et Maduro ont tous deux menés une politique systématique de précarisation du travail et de renforcement de l’exploitation, appauvrissant la population comme jamais et réprimant dans le sang les nombreuses manifestations de colère qui ont émaillé leur règne. Le pays compte des milliers de prisonniers politiques. Les enlèvements, la torture et les exécutions extrajudiciaires sont monnaies courantes. Ce « paradis sur terre » de 28 millions d’habitants compte 8 millions de réfugiés, soit le taux le plus élevé du monde ! Le « terrorisme » de Maduro, c’est d’abord contre la classe ouvrière qu’il l’a exercé !
Comme lors de chaque conflit, la bourgeoisie cherche à nous faire choisir un camp bourgeois contre un autre, à nous enfermer dans une fausse alternative entre nations en guerre. Mais, nulle part, ni aux États-Unis, ni au Venezuela, ni en Ukraine, ni en Russie, ni en Israël, ni en Palestine, aucune faction bourgeoise ne porte le moindre espoir d’un monde plus juste et en paix. Car ce monde, c’est celui d’un capitalisme irrémédiablement en crise, où tous les États, qu’ils soient démocratiques ou autoritaires, populistes ou libéraux, sont en concurrence, tous sont impérialistes et sont des agents actifs de la destruction et du chaos.
Une nouvelle étape dans le chaos est franchie
L’Amérique Latine est un concentré de la barbarie dans laquelle s’enfonce le capitalisme. Misère rampante, trafics en tout genre, corruption à grande échelle, délitement des structures sociales et étatiques… le continent apparaît de plus en plus comme un gigantesque Far West. À travers son opération militaire, Trump y importe la guerre et la promesse d’accélérer considérablement ce chaos.
Aujourd’hui, Trump plastronne, sûr de la toute puissance de son armée : « Nous allons diriger le pays jusqu’à ce que nous puissions effectuer une transition sûre, appropriée et judicieuse ». Mais les ennuis ne font que commencer. Loin du scénario « idéal » du coup d’État de 1973 au Chili, Washington n’est plus en mesure de remplacer à sa guise un dirigeant par un autre. Nous ne sommes plus au temps de la guerre froide, lorsque les bourgeoisies se montraient encore disciplinées et soucieuses de préserver les intérêts généraux du capital national dans le cadre de leur bloc militaire.
Désormais, sans l’existence de ces blocs, le chacun-pour-soi et le chaos règnent en maîtres. Les États-Unis ont passé vingt ans à tenter, en vain, d’instaurer un gouvernement stable en Afghanistan, en Irak, en Libye ou en Syrie. Même si Trump n’a « pas peur d’envoyer des troupes sur le terrain », il en sera de même au Venezuela. Quoi qu’il arrive, l’Administration américaine devra composer avec une bourgeoisie vénézuélienne extrêmement divisée1 et que Maduro avait difficilement réussi à mettre au pas. Ce que risque de récolter Trump, c’est un État impuissant, un pays fracturé, misérable et anarchique, une plaque tournante gangrenée par tous les trafics et le point de départ de nouvelles vagues d’émigration.
Tout cela risque d’ailleurs de déstabiliser le continent entier et d’imposer aux États-Unis une fuite en avant dans les interventions et aventures militaires. La Colombie voisine a déjà déployé ses troupes à la frontière, craignant les conséquences d’une crise humanitaire et des conflits entre cartels. Même le gouvernement américain est conscient de l’instabilité à venir : « Nous sommes prêts à lancer une deuxième attaque plus importante si nécessaire », a lancé Trump. Et son Secrétaire d’État, Marco Rubio, a déjà menacé Cuba avec des propos dignes d’un mafieux de cinéma : « Si je vivais à La Havane et que je faisais partie du gouvernement, je serais au moins un peu inquiet… »
Les conséquences de cette intervention vont même au-delà du seul continent américain. Trump vient de piétiner toutes les instances internationales de régulation destinées à encadrer les rivalités entre nations et de s’essuyer les pieds sur le cadre légal qui avait permis aux États-Unis de s’imposer, par le passé, en gendarme du monde. Trump prend acte du fait que les États-Unis n’ont plus le pouvoir d’imposer un ordre mondial face à l’avènement du chacun-pour-soi. Aussi, il exploite encore plus brutalement l’immense supériorité militaire américaine pour imposer les intérêts américains. Au milieu du chaos, seule la force à valeur de Loi.
De fait, l’opération Absolute Resolve n’est pas qu’un coup porté au grand rival chinois, c’est aussi un avertissement aux Européens : alors que Trump a fait part de son intention de faire main basse sur les vastes réserves d’hydrocarbure du Venezuela, les États-Unis n’hésiteront pas à poignarder leurs « alliés » dans le dos si la défense des intérêts stratégiques américains le nécessite. Katie Miller, l’épouse du directeur de cabinet adjoint de la Maison-Blanche, a ainsi publié, le jour de l’enlèvement de Maduro, une photo du Groenland aux couleurs du drapeau américain, assortie d’une légende pour le moins explicite : « bientôt »…
Le capitalisme n’a plus rien à offrir à l’humanité que toujours plus de guerres et de barbarie. La seule force qui peut mettre fin à la guerre capitaliste, c’est la classe ouvrière, parce qu’elle porte en elle une perspective révolutionnaire, celle du renversement du capitalisme. Ce sont les luttes révolutionnaires du prolétariat en Russie et en Allemagne qui ont mis fin à la Première Guerre mondiale ! La paix réelle et définitive, partout, la classe ouvrière devra la conquérir en renversant le capitalisme à l’échelle mondiale. Il lui faudra des années de luttes pour reconquérir son identité de classe et ses armes de combat. Mais il n’y a pas d’autre chemin pour renverser ce système moribond et destructeur !
EG, 4 janvier 2026
1 D’ailleurs, les États-Unis n’ont pas caché que l’opération Absolute Resolve avait été permise grâce à des complicités au plus haut niveau de l’État.
Géographique:
- Vénézuela [1060]
- Etats-Unis [184]
Personnages:
- Donald Trump [896]
- Nicolas Maduro [1061]
Récent et en cours:
- Socialisme du XXIe siècle [1062]
- Absolute Resolve [1063]
- Enlèvement de Nicolas Maduro [1064]
L'atrocité de Bondi Beach: Derrière les actes terroristes, un capitalisme en putréfaction
- 93 lectures
Le 14 décembre dernier, sur le sable de Bondi Beach, en Australie, deux hommes armés, un père et son fils, ont utilisé deux fusils d’assaut, détenus légalement, pour ouvrir le feu sur un grand rassemblement marquant le début de la fête juive d’Hanoukka. Quinze personnes ont été tuées par les deux hommes, dont une fillette de 10 ans et un vieillard qui avait survécu à l'Holocauste. L'aîné des deux tireurs avait fait l'objet d'une enquête de la police australienne pour ses liens avec l'État islamique en 2019. Des dizaines d'autres personnes ont été blessées. Comme c'est désormais habituel dans ces manifestations de l'horreur capitaliste, des individus ont fait preuve d'un grand courage et d'un grand honneur en essayant de protéger leurs semblables et, comme c'est également habituel dans ces cas-là, les forces de l’ordre étaient impuissantes. La première réaction du gouvernement australien, par la voix du Premier ministre Anthony Albanese et de ses collaborateurs, a été de défendre leur État et sa «démocratie», tout en promettant de renforcer encore les mesures de sécurité et de répression qui pèseront avant tout sur la classe ouvrière. Ce dernier massacre d'innocents survient dix ans après la fusillade de Charlie Hebdo à Paris, la fusillade de masse au Bataclan à Paris, l'attentat à la bombe de l'aéroport de Bruxelles il y a neuf ans et, il y a huit ans, l'attentat à la bombe de la Manchester Arena pendant un concert, perpétré par un individu dont la famille djihadiste libyenne basée à Manchester travaillait pour le MI6. Au cours de ces quatre événements, tous étroitement liés aux intérêts impérialistes, plus de 200 personnes de tous âges ont été tuées et des milliers d'autres blessées par des engins explosifs sur lesquels était inscrit «à qui de droit». Le massacre de civils, qui a toujours été une caractéristique des systèmes oppressifs, atteint sans cesse de nouveaux sommets révoltants sous le capitalisme, qui se débat dans sa propre décomposition. Et au milieu de tout cela, les dirigeants ne peuvent qu'offrir leurs «condoléances» hypocrites et vides de sens aux victimes de leur propre système, tout en promettant de fliquer davantage les populations.
La décomposition du capitalisme, système pourrissant sur pied, s'accompagne d'une augmentation de tous les niveaux de violence aveugle, d'atrocités en tous genre, au premier rang desquels celle des États dans le renforcement de la terreur destinée au maintien de leur domination et de la défense de leurs intérêts impérialistes, que ce soit par la violence sociale exacerbée jusqu’au cœur des grandes puissances capitaliste, la guerre ou du terrorisme. Grandissant dans et entourés par cette putréfaction mondiale, la santé mentale des plus fragiles ne peut qu'être affectée et souvent déformée par les forces du désespoir, par l'absence d'avenir et de perspectives que le capitalisme maintient et généralise à travers le monde. Ainsi, les attaques aveugles explosent un peu partout : contre les écoliers et les étudiants, contre de simples passants… Elles sont en augmentation partout, devenues courantes et banales, tout comme les attaques des élèves contre les enseignants : «La société se fragmente et se désintègre. Le chômage, la misère, les problèmes de logement, de travail et de santé sont omniprésents. Partout, les guerres se multiplient. Partout, la planète part à vau-l'eau. Partout, l'angoisse de ne voir aucun avenir.»[1] Les jeunes sont particulièrement touchés par cette barbarie croissante. Ils se retrouvent désorientés, confus et psychologiquement affectés par la morbidité et la destruction qui les entourent.
Les États ne se soucient nullement des victimes et exploitent cyniquement les actes violents qui se produisent chez eux ou dans d'autres États. Ainsi, le boucher Netanyahu instrumentalise l’attaque en Australie en fustigeant le Premier ministre Albanese, affirmant que ce dernier «a laissé la maladie de l'antisémitisme se propager« en raison de son soutien à un État palestinien. Pour sa part, Albanese propose «un moment d'unité nationale», tout en préconisant de nouvelles mesures qui renforcent encore la machine répressive de l'État. La classe dirigeante lance généralement des campagnes idéologiques massives au moment de ces atrocités, attisant les divisions raciales et mettant en œuvre des mesures qui n’ont jamais permis de protéger la population, mais à accroître son contrôle totalitaire sur la société et se donner davantage de moyens pour réprimer la classe ouvrière. Et en Occident en particulier, la bourgeoisie la plus expérimentée utilise ces atrocités, non pas pour s'attaquer à leurs causes profondes, car elles échappent à son contrôle, mais pour défendre le mensonge de l'État démocratique.
Les effets de la décomposition, la violence, les destructions, l'irrationalité et l'absurdité du capitalisme resteront une menace mortelle pour l'humanité et un danger constant pour la classe ouvrière et sa lutte. Tant que le capitalisme existera, ces menaces ne feront que devenir plus manifestes et plus graves. Il y a eu des moments importants dans l'histoire qui montrent que seule la lutte de la classe ouvrière (et de la classe ouvrière seule) peut repousser la barbarie et les attaques de la classe dirigeante et ouvrir une perspective pour l'avenir de l'humanité : la révolution communiste. En 1905, en Russie, les travailleurs ont défendu les Juifs contre les pogroms déclenchés par le régime tsariste pour contrer la vague révolutionnaire ; en 1941, aux Pays-Bas, au plus fort de la guerre mondiale et de la contre-révolution, les travailleurs d'Amsterdam ont mené des grèves entravant autant que possible les mesures antijuives des nazis qui travaillaient en collaboration avec les autorités néerlandaises; en Hongrie, en 1956, lorsque les travailleurs sont descendus dans la rue pour s'opposer à la répression sanglante de la bourgeoisie à Poznan en Pologne, en France en 1968, lorsque les jeunes travailleurs ont manifesté leur solidarité avec les étudiants en se joignant à eux lorsqu'ils étaient attaqués par la police. Qu'il s'agisse d'une attaque terroriste ou d'un individu psychologiquement perturbé, la classe ouvrière ne peut pas faire grand-chose pour empêcher de tels événements, qui ne peuvent que se multiplier avec la décomposition du capitalisme. En s'impliquant dans les campagnes de la classe dirigeante autour de tels événements, elle ne peut que renier les principes de son combat. Ce que la classe ouvrière peut et doit faire, comme elle a commencé à l’exprimer avec force et vigueur en 2022, c'est développer sa propre lutte contre ce système pourri, car c'est dans cette lutte que réside sa force politique et la possibilité d’affirmer la perspective d'un avenir qui peut dépasser les horreurs du capitalisme.
Baboon, 24 décembre 2025
[1] Lire notre article « Assassinat dans les établissements scolaires : Derrière les actes monstrueux, une société monstrueuse ! [1065] ».
Géographique:
- Australasie [1066]
Conscience et organisation:
Rubrique:
La démocratie est un piège pour la conscience et le combat de classe
- 102 lectures
Lettre d’un contact
J’ai beaucoup de mal à accepter votre point de vue sur l’instauration d’une dictature du prolétariat.
De toutes les formes de société, la démocratie est, selon moi, la meilleure. Parce que dans une démocratie, la liberté d’expression est respectée. C’est grâce à notre forme de société démocratique que le CCI peut exprimer ses critiques à l’égard du système capitaliste. Dans une dictature fasciste, par exemple, le CCI n’aurait pas pu critiquer le système capitaliste. Si le CCI avait tout de même exprimé son opinion contre le capitalisme, vous auriez probablement disparu dans des camps de concentration. Mais dans une dictature du prolétariat, les libéraux, par exemple, ne peuvent pas critiquer le communisme. Si les libéraux avaient tout de même exprimé leur critique du communisme, ils auraient probablement disparu dans des camps de rééducation. C’est pourquoi je suis en faveur d’une société démocratique et contre toute forme de dictature. Car dans une société démocratique, toutes les opinions sont respectées.
Notre réponse
Le camarade pose dans son courrier une question importante qui est au cœur de la mystification sur la démocratie que la classe dominante veut enfoncer dans le crâne des exploités : dans une véritable démocratie, tous les individus seraient égaux («un homme, une voix») et, même si sa mise en œuvre n’est pas parfaite, les «citoyens» auraient pour tâche de défendre l’État démocratique qui est, selon les mots de Churchill, «le moins mauvais de tous les systèmes».
Nous saluons le sens des responsabilités du camarade en ce qu’il exprime très explicitement un désaccord de fond, ou du moins un questionnement, sur une position fondamentale du CCI et de l’héritage du marxisme en général. Cependant, sans vouloir offenser le camarade, la vision qu’il exprime dans son courrier ignore totalement les conditions dans laquelle la démocratie bourgeoise a émergé et s’est développée, au premier rang desquelles figurent les massacres des États démocratiques à l’égard du prolétariat en lutte et leur férocité contre les organisations révolutionnaires dès que celles-ci commencent à représenter le moindre danger pour l’ordre établi. Car c’est bien la démocratique République française qui a exterminé la Commune de Paris, c’est la démocratique République de Weimar qui a écrasé la révolution allemande de 1918-1919 dans le sang, ce sont les «grandes démocraties occidentales» qui ont pourchassé, bien souvent main dans la main avec les régimes autocratiques, fascistes ou staliniens, des révolutionnaires comme Rosa Luxemburg ou Léon Trotsky.
Alors, d’où vient ce décalage entre l’histoire sanglante de la démocratie bourgeoise et l’idée du camarade selon laquelle «dans une société démocratique, toutes les opinions sont respectées» ? Bien souvent, la difficulté ne se trouve pas dans la réponse, mais dans la façon de poser la question. Dans son courrier, le camarade parle de la démocratie comme un concept abstrait, celui de «démocratie en général» compris en dehors de l’histoire et des rapports entre les classes. Mais, dans l’histoire, il n’a jamais existé de «démocratie en général». Dès l’antiquité, la démocratie athénienne était l’organisation politique des propriétaires d’esclaves qui exerçaient impitoyablement leur domination sur la masse des exploités. De même, aujourd’hui, il n’existe aucune «démocratie en général» : il n’existe que des démocraties bourgeoises, qui se révèlent, comme nous allons tenter d’en convaincre le camarade et nos lecteurs, n’être qu’une machine à opprimer la classe ouvrière et l’arme la plus sophistiquée de la bourgeoisie pour exercer sa dictature sur le reste de la société.
La démocratie bourgeoise, c’est la dictature de la bourgeoise
En effet, pour les marxistes, la société actuelle n’est pas un ensemble d’individus égaux, une sorte d’agora où toutes les opinions viendraient se confronter librement sur le marché des idées. Au contraire, la société actuelle est divisée en classes aux intérêts contradictoires, une société dans laquelle la bourgeoisie domine et exploite le prolétariat. C’est ainsi qu’au XIXe siècle, les différentes fractions de la classe dominante ont pu se partager le pouvoir au Parlement en cherchant à en exclure le prolétariat (par le suffrage censitaire, par exemple). Le mouvement ouvrier se battait pourtant alors pour l’établissement d’États démocratiques. Pourquoi ? Parce que la «démocratie en général» est «le moins mauvais de tous les systèmes» ? Parce que le marxisme se faisait des illusions sur la possibilité de renverser le capitalisme grâce au Parlement ? Non ! Le courant marxiste voyait plus loin encore. La démocratie était alors l’arme de la bourgeoisie révolutionnaire contre les vieilles structures féodales qui s’accrochaient encore au pouvoir, et la classe ouvrière pouvait encore arracher des réformes véritables (temps de travail, salaires, fin du travail des enfants, etc.) au capitalisme à son apogée. Dans les deux cas, il s’agissait de favoriser le développement du prolétariat pour… mieux renverser le capitalisme et son État démocratique. Systématiquement, la bourgeoisie réprimait dans le sang les revendications démocratiques de la classe ouvrière.
Cependant, avec l’entrée du capitalisme dans sa phase de décadence à partir de la Première Guerre mondiale, les conditions d’exercice du pouvoir changeaient. La concurrence impérialiste s’exacerbait entre nations, contraignant la bourgeoisie à davantage de discipline derrière l’État. Le Parlement devenait une simple chambre d’enregistrement des directives du pouvoir Exécutif et le capitalisme n’était plus en mesure d’accorder de véritables réformes à la classe ouvrière. Partout, la forme démocratique de l’État devenait une coquille vide, une pure mystification idéologique destinée à entraver la perspective révolutionnaire désormais à l’ordre du jour.
La structure démocratique de l’État est, comme toutes les autres formes d’État au sein du capitalisme (dictature militaire, fascisme, stalinisme, etc.), un instrument visant à assurer et à perpétuer la domination de la bourgeoisie sur la société. C’en est même la forme la plus sophistiquée :
— le «suffrage universel» s’est avéré l’un des moyens les plus efficaces pour dissimuler la dictature du capital derrière l’illusion d’un «peuple souverain». C’est encore l’un des instruments privilégiés pour canaliser à la fois le mécontentement de la classe ouvrière et pour entretenir l’illusion qu’il est possible de rendre le monde capitaliste plus juste et plus humain grâce à la démocratie. Pour les marxistes, au contraire, depuis que le capitalisme est entré dans sa période de décadence (au moment de la Première Guerre mondiale), le prolétariat n’a plus aucune réforme réellement positive à arracher à la bourgeoisie, le capitalisme est devenu un système irrémédiablement réactionnaire et destructeur. Ce n’est pas un hasard si la bourgeoisie a commencé à pousser massivement le prolétariat vers les urnes avec l’entrée du capitalisme dans sa période de décadence, en particulier dans les pays où la classe ouvrière est fortement concentrée et expérimentée.
— La «liberté de la presse» est parfaitement compatible avec le monopole de l’information par la bourgeoisie et ses grands médias. Ces derniers ont pour rôle de diffuser les communiqués officiels de l’État et de noyer (avec les réseaux sociaux) la vérité sous un déluge quotidien de mensonges, de fausses informations et d’absurdités. Le message diffusé ad nauseam par le rouleau compresseur de la presse bourgeoise, c’est qu’il n’y a pas d’autre alternative au capitalisme. Et lorsque l’État démocratique le juge nécessaire, la liberté de la presse peut également être «restreinte» à tout moment, comme le font tous les gouvernements pendant les guerres ou lorsque le prolétariat défend sa perspective révolutionnaire.
— La «liberté d’expression et d’association», tout comme la «liberté d’opinion» sont elles aussi des mystifications, «tolérés»… tant qu’elles ne menacent pas le pouvoir de la bourgeoisie et ses intérêts impérialistes. Les exemples de restrictions ostentatoires de ces «libertés» ne manquent pas, y compris à l’égard de fractions bourgeoises concurrentes. Aux États-Unis, «champion mondial de la démocratie» et «patrie des droits de l’homme», des citoyens américains ont été persécutés pour leurs sympathies de gauche pendant la période du maccarthysme dans les années 1950. Lors de la grande grève de Mai 1968 en France, des groupes d’extrême gauche ont été interdits et leurs dirigeants arrêtés. Au cours de l’année dernière, le groupe Palestine Action en Grande-Bretagne a été qualifié d’organisation terroriste et mis sur liste noire. Depuis sa création en 1975 et malgré sa taille relativement modeste, le CCI n’a pas non plus été épargnée : ses militants ont également été suivis, intimidés et soumis à des perquisitions.
Comme l’écrivait Lénine dans L’État et la révolution (1917), «la république démocratique est la meilleure forme politique possible du capitalisme ; aussi bien le Capital, après s’en être emparé […] assoit son pouvoir si solidement, si sûrement, que celui-ci ne peut être ébranlé par aucun changement de personnes, d’institutions ou de partis dans la république démocratique bourgeoise». En bref, la démocratie bourgeoise est un exact synonyme de dictature de la bourgeoisie.
Mais qu’en est-il de la dictature du prolétariat ?
Au cours de l’histoire, aucune classe opprimée n’a pu renverser l’ancienne société sans passer par une révolution et une phase de dictature destinée à briser par la force la résistance de la classe dominante du passé, prête à toutes les extrémités pour conserver sa domination. C’est ainsi que la bourgeoisie a dû, à l’image des révolutions américaine et française, arracher l’appareil d’État des mains de l’aristocratie, menant, au nom de la démocratie et des Droits de l’Homme, une politique de répression et de terreur à l’égard de la contre-révolution.
Toutefois, comme l’a enseigné la Commune de Paris et l’expérience révolutionnaire de 1917-1923, la classe ouvrière ne peut pas, elle, utiliser l’État bourgeois pour établir sa propre domination sur la société. En effet, l’État n’est pas un instrument neutre qui pourrait tout aussi bien servir à la défense des privilèges des exploiteurs qu’au bénéfice de la classe exploitée. Au contraire, sous toutes ses formes, l’État est par essence un instrument de la domination d’une classe sur la société. Engels, dans L’Origine de la famille, de la propriété privée et de l’État, démontre très bien que l’État est un produit spécifique de la société de classe, destiné à maintenir, par la coercition (armée, police, justice, surveillance, contrôle social…), la cohésion de la société au profit de la classe dominante, un instrument de violence dirigé contre les classes exploitées. La tâche de la révolution prolétarienne, qui contient la disparition des classes et de l’exploitation, est donc de détruire de fond en comble l’État bourgeois[1]. Et l’arme politique de cette destruction, ce sont les conseils ouvriers. Ces conseils ne sont pas un vœu pieu, ni une utopie, mais la «forme enfin trouvée», comme l’écrivait Lénine, de la dictature du prolétariat. C’est la classe ouvrière qui a elle-même fait surgir cette forme d’organisation politique pour la première fois pendant la révolution russe de 1905. Pour la première fois dans l’histoire, à la place de la police et de l’armée, les conseils ouvriers revendiquaient le monopole des armes ; à la place d’une poignée de politiciens professionnels «choisis» tous les quatre ou cinq ans pour assurer la défense de la propriété bourgeoise et de l’exploitation, le pouvoir était exercé par toute la classe ouvrière, avec des représentants mandatés et révocables à tous moments ; à la place de la dictature de la minorité sur l’immense majorité, c’était la dictature de l’immense majorité sur la minorité.
Vouloir priver le prolétariat de ses armes que sont les conseils parce qu’ils seraient des instruments de dictature, vouloir dissoudre la classe ouvrière dans «le peuple» au nom de la démocratie, c’est lui imposer de renoncer à défendre sa perspective révolutionnaire, la seule alternative à l’inéluctable enfoncement du capitalisme dans la barbarie, la guerre et la misère généralisée.
Le CCI, 31 décembre 2025
[1]Le marxisme rejette néanmoins l’idée anarchiste de l’abolition du jour au lendemain de toute forme d’État. Comme le prolétariat est contraint de prendre le pouvoir avant de développer de nouveaux rapports de production communiste, il y aura tout une période de transition entre la prise du pouvoir par le prolétariat et la disparition de toutes les classes sociales avec la socialisation complète de la production. Or, comme on l’a vu précédemment, qui dit «classes sociales», dit «État». L‘expérience révolutionnaire de 1917 a montré que dans cette «période de transitions», surgira ce que Lénine appelait un «semi-État» destiné à assurer la cohésion de la société en train de naître. Mais ce semi-État est à des années-lumière de l’État stalinien hypertrophié. Comme tout État, il demeurera un corps conservateur sur lequel le prolétariat devra exercer sa dictature et le dissoudre à terme.
Vie du CCI:
- Courrier des lecteurs [252]
Questions théoriques:
- l'Etat capitaliste [1067]
Heritage de la Gauche Communiste:
- La dictature du prolétariat [1068]
Rubrique:
Venezuela, Ukraine, Moyen-Orient: Face à l'aggravation du chaos guerrier, quelle est la seule réponse possible?
- 214 lectures
Réunion publique du CCI, samedi 7 février 2026.
En 1991, en réponse à l'effondrement du bloc de l'Est et à la guerre du Golfe, le CCI écrivait : «Face à la tendance au chaos généralisé propre a la phase de décomposition, et à laquelle l'effondrement du bloc de l'Est a donné un coup d'accélérateur considérable, il n'y a pas d'autre issue pour le capitalisme, dans sa tentative de maintenir en place les différentes parties d'un corps qui tend à se disloquer, que l'imposition du corset de fer que constitue la force des armes. En ce sens, les moyens mêmes qu'il utilise pour tenter de contenir un chaos de plus en plus sanglant sont un facteur d'aggravation considérable de la barbarie guerrière dans laquelle est plongé le capitalisme». (« Texte d'orientation : Militarisme et décomposition », Revue internationale 64).
L'attaque américaine contre le Venezuela, la menace croissante d'annexion du Groenland et de nouvelles frappes aériennes contre le régime de Téhéran confirment que la première puissance mondiale est devenue le principal facteur d'accélération du chaos et de désintégration, un processus qui porte en lui la menace de la destruction de l'humanité.
Le CCI organise des réunions publiques pour discuter des implications de ces développements. Nous souhaitons approfondir l'évolution des conflits impérialistes, mais aussi poser la question de l'impact de ces événements sur la lutte des classes et sur la réponse que devrait apporter la minorité internationaliste face à l'aggravation de la barbarie militaire dans laquelle le capitalisme est en train de sombrer.
À cette occasion, trois réunions auront lieu le même jour, en anglais, en français et en espagnol.
Les réunions se dérouleront à :
- Paris de 15h à 18h : CICP, 21 Ter rue Voltaire 75011 Paris (Métro 9, Rue des Boulets).
- Marseille de 15h à 18h : 61 Rue Consolât 13001 (Métro Réformé).
- Nantes de 15h à 18h : Salle de la Mairie de Nantes, salle C, 42 rue des Hauts-Pavés (Ligne 3 du tramway, direction Marcel Paul, arrêt Viarme-Talensac).
- Lille de 15h à 18h : Au MRESS, 5 rue Jules Vicq (Métro Fives).
- Lyon de 15h à 18h : Bâtiment de La Rayonne, 22 rue Alfred de Musset, salle 19 (Métro A. Arrêt à Vaulx -en-Velin, La Soie).
- Bruxelles de 14h à 18h : Pianofabriek, rue du Fort 35, 1060 St Gilles.
Dans le cas où des camarades voulant participer aux réunions publiques du CCI et ne pouvant pas se déplacer dans les villes où elles ont lieu, que ce soit en France, en Italie, en Belgique, en Espagne ou en Hollande, envoient un message à [email protected] [213] ou dans la rubrique « contact » de notre site web. Un lien de connexion leur sera envoyé ultérieurement.
Rubrique:
L'effondrement de la décharge de Cebu (Philippines): Le coupable, c'est le capitalisme en putréfaction
- 82 lectures
Le 8 janvier 2026, une montagne de déchets s'est effondrée à Barangay Binaliw, dans la ville de Cebu aux Philippines, écrasant des vies sous des tonnes de déchets capitalistes. Au moins quatre personnes ont été tuées. Des dizaines d'autres sont toujours portées disparues. Mais le véritable coupable n'est ni la force de gravité, ni la nature, mais un système social qui accumule les déchets sur le dos des pauvres et appelle cela «développement».
Ce n'était pas une tragédie. C'était un crime. Et les empreintes digitales du capitalisme sont partout.
Le profit avant la vie : la négligence calculée de Binaliw
La décharge de Binaliw n'a jamais été sûre. C'était un monument purulent, laissant le capitalisme dans l'indifférence totale, exploité par «Prime Integrated Waste Solutions» sous le couvert d'un «partenariat public-privé». En réalité, c'était une bombe à retardement : une décharge à ciel ouvert déguisée en site d'enfouissement, creusée dans une montagne et remplie de déchets, au mépris des règles élémentaires de l'ingénierie et de la décence humaine.
Des avertissements avaient pourtant été émis, les habitants avaient protesté. Le conseiller municipal Joël Garganera, lui-même, a condamné le site, le qualifiant de catastrophe annoncée. Mais la municipalité et ses partenaires privés ont persisté. Pourquoi ? Parce que, dans le capitalisme, les déchets ne sont pas un problème à résoudre, mais une activité à exploiter. Et la vie des travailleurs et des pauvres des villes peut être sacrifiée sur l’Autel des bilans financiers.
Mensonges verts et théâtre de la réforme
Aujourd'hui, alors que les morts sont retirés des décombres, l'État accomplit son rituel habituel : larmes de crocodile, promesses d'«enquête» et vagues discours sur des «améliorations». Mais comme le Courant Communiste International (CCI) le met clairement en évidence dans son Manifeste sur la crise écologique [1069], ces gesticulations ne sont que du théâtre. La réforme est un mensonge. La réglementation n'est qu'un écran de fumée. Le système ne peut être «réparé», car il fonctionne exactement en conformité avec ses fondements.
Le «greenwashing» du capitalisme –ses sommets sur le climat, ses promesses de «zéro émission nette», ses bricolages technocratiques– ne font qu'aggraver la crise. Il ne s'agit pas d'un dysfonctionnement. Il s'agit de la décomposition d’un système. Et dans sa décomposition, il empoisonne l'air, l'eau, le sol –et la possibilité même d'un avenir.
La classe ouvrière jetable : sacrifiée au dieu des ordures
Qui est mort à Binaliw ? Pas les cadres. Pas les politiciens. Ce sont les travailleurs. Les chiffonniers. Les familles vivant dans l'ombre d'une montagne d'ordures. Ils ont été sacrifiés sur l'autel de l'«efficacité» capitaliste, ensevelis non seulement sous les déchets, mais aussi sous le mépris d'un système qui les considère comme des déchets.
Ce phénomène n'est pas propre à Cebu. De Payatas à Delhi, de Lagos à Jakarta, les pauvres sont contraints de vivre et de mourir en marge des déchets. Le capitalisme crée des zones - géographiques et humaines sacrifiées – et il appelle cela le progrès.
Révolution ou extinction : le verdict sans appel du CCI
Le CCI ne mâche pas ses mots : le capitalisme est écocide. Il ne peut être réformé. Il doit être renversé. La classe ouvrière est la seule force qui ait le pouvoir et l'intérêt de réorganiser la société sur une base rationnelle, écologique et humaine.
Cela signifie rejeter toutes les illusions : la politique électorale, les «solutions» nationalistes, les pansements des ONG et l'activisme climatique bourgeois. Cela signifie construire un mouvement international et révolutionnaire enraciné dans la lutte des classes et basé sur la mémoire historique du prolétariat, en particulier les leçons des conseils ouvriers de 1917-1919.
Plus de tombes sous les ordures !
L'effondrement de Binaliw n'est pas un événement isolé. C'est le symptôme d'un système moribond qui nous entraînera tous dans sa chute si nous n'agissons pas. Le choix n'est pas entre une meilleure gestion des déchets et une moins bonne, mais entre un monde organisé pour répondre aux besoins humains et un monde enseveli sous ses propres déchets.
Nous devons plus aux morts que de les pleurer. Nous leur devons justice. Et la justice ne viendra pas de l'État, du marché ou des urnes. Elle viendra de la rue, des usines, des assemblées de travailleurs qui refusent d'être enterrés vivants.
Que la puanteur de Binaliw soit l'odeur du cadavre en décomposition du capitalisme. Enterrons le système avant qu'il ne nous enterre.
Internacionalismo (Philippines)
Géographique:
- Philippines [1070]
Conscience et organisation:
Questions théoriques:
- "Ecologie" [290]
- Décomposition [517]
Rubrique:
Les États-Unis chassent la Chine et la Russie de leur arrière-cour
- 71 lectures
Le raid militaire américain sur le Venezuela, samedi 3 janvier, a soulevé plusieurs questions quant à l'ampleur de l'attaque, aux motivations du gouvernement américain et à la position à défendre en tant que révolutionnaires.
Nous avons reçu une contribution de deux contacts différents, que nous saluons en raison de leur défense claire de la position internationaliste en réaction à l’intervention militaire américaine au Venezuela. Tous deux reconnaissent le motif de cette attaque de la part des États-Unis, à savoir contraindre toute nation récalcitrante du continent américain à se plier aux exigences des États-Unis. Tous deux sont convaincus que cette démonstration de force vise également la Chine et a pour but de chasser ce pays de l'hémisphère occidental.
Une des contributions mentionne également un autre motif : « la bourgeoisie américaine a besoin d'une expansion des marchés ». C'est Trump qui se vantait sans cesse des dizaines de millions de barils de pétrole que le Venezuela allait fournir aux États-Unis. Mais la bourgeoisie américaine, et en particulier les compagnies pétrolières, savaient très bien que le Venezuela n'offrirait pas la possibilité d'investissements rentables à long terme. D'autre part, la population vénézuélienne est trop pauvre pour acheter en masse les produits américains coûteux.
En général, les guerres de la période actuelle ne conduisent pas à un essor économique du capitalisme, ni même à un avantage économique pour la nation victorieuse. C'est l'une des raisons pour lesquelles nous parlons de l'irrationalité de la guerre. La seule « victoire » pour les États-Unis, conformément à la récente stratégie de sécurité nationale américaine, est d'avoir plus ou moins chassé la Chine et la Russie (les alliés les plus proches du Venezuela) du continent. Mais ils doivent en payer le prix par une instabilité accrue dans cette partie du continent, « forçant les États-Unis à se lancer tête baissée dans des interventions et des aventures militaires ». C'est là une autre caractéristique de la période actuelle de décomposition : les États-Unis qui violent le droit international et incitent d'autres pays à faire de même, deviennent le principal acteur de l'aggravation du chaos dans le monde.
CCI.
Première contribution
Depuis un certain temps, Trump et la clique de nationalistes qui le soutiennent à la tête du mouvement MAGA (qu'il s'agisse de politiciens, de propagandistes ou de militants) ont ouvertement exprimé leur intention d'exercer un contrôle plus strict sur la région où se trouvent les États-Unis, par la force si nécessaire, en réclamant notamment : faire du Canada le 51e État, envahir le Mexique et même annexer le Groenland. Un nouvel événement est survenu à cet égard. Après des mois de bombardements au Venezuela et de menaces de changement de régime contre son président « socialiste », Nicolas Maduro, ce dernier a été capturé par les forces militaires américaines. L'administration Trump a alors affirmé son rôle prépondérant dans la formation du futur gouvernement vénézuélien, menaçant la nouvelle présidente et l'ancienne vice-présidente, Delcy Rodriguez, de céder aux intérêts impérialistes américains si le Venezuela ne subissait pas une nouvelle attaque, cette fois-ci plus virulente. Suite à cela, Trump a proféré des menaces contre Gustavo Petro, le président de gauche colombien qui a condamné le coup d'État contre Maduro, et a également réitéré son désir d'annexer le Groenland.
Deux raisons principales expliquent cette attitude belliciste dans la région. Premièrement, la bourgeoisie américaine a besoin d'étendre ses marchés, ce qui serait d'autant plus avantageux en cas d'occupation politique par les États-Unis, leur conférant un avantage considérable sur le marché mondial. Des politiques protectionnistes seraient probablement mises en œuvre afin de garantir que les industries issues de ces projets expansionnistes soient suffisamment monopolisées par la bourgeoisie américaine. Deuxièmement, l'État américain, sous la présidence de Trump, se prépare à la guerre, notamment contre la Chine, et juge nécessaire d'intégrer les pays de sa région à son giron politique, ou du moins de les subordonner de fait, même si leur souveraineté officielle est maintenue. Concernant la Chine, la capture de Maduro et l'insistance de Rodriguez à s'aligner sur les États-Unis ne relèvent pas seulement du Venezuela ou de l'Amérique latine, mais témoignent également de la rivalité entre les deux plus grandes puissances sur la scène impérialiste mondiale : les États-Unis et la Chine. Étant donné que le Venezuela de Maduro était aligné sur l'impérialisme chinois, la perspective d'un réalignement vers les États-Unis signifie pour la Chine la menace de perdre un allié important dans la région de son rival impérialiste.
Les propagandistes MAGA présentent souvent la situation vénézuélienne comme la libération du peuple vénézuélien d'un dictateur brutal. Même une grande partie de l'opposition démocratique ne conteste pas le coup d'État de Mauro ; elle critique simplement la méthode employée. Elle aussi a toujours appelé à libérer le peuple vénézuélien du régime de Mauro, d'une manière ou d'une autre. Tout cela n'est pourtant qu'un langage voilé masquant les véritables intentions. Pour les partisans de MAGA comme pour la bourgeoisie démocratique, la liberté signifie la possibilité pour les capitaux américains de pénétrer les marchés vénézuéliens. Que cela se produise dans un contexte de démocratie libérale ou de « dictature » leur importe peu, malgré ce que leur propagande pourrait laisser entendre. En fin de compte, que l'on vive en démocratie libérale ou sous une « dictature », on est inévitablement soumis à la dictature de la bourgeoisie, du capital.
En revanche, les propagandistes de gauche présentent souvent la situation vénézuélienne comme une nouvelle attaque des États-Unis contre un pays socialiste. Loin d'être socialiste, le Venezuela de Maduro, et celui de Chavez avant lui, était simplement un régime capitaliste d'État, c'est-à-dire qu'il nationalisait des pans importants de son économie, lesquels étaient contrôlés par la bureaucratie d'État. Mais la nationalisation n'est pas synonyme de socialisme, car elle perpétue les rapports sociaux capitalistes. Le fait que l'État, plutôt que les entreprises privées, devienne un employeur plus important de main-d'œuvre salariée ne change rien à cela. Le gouvernement de Maduro n'était pas non plus un gouvernement de la classe ouvrière, ni une dictature du prolétariat, comme ce fut le cas, par exemple, lors de la Commune de Paris à la fin du XIXe siècle ou dans les républiques de conseils du début du XXe siècle. La classe ouvrière n'a jamais accédé au pouvoir au Venezuela par la voie d'une révolution. Maduro était plutôt le successeur de Chavez, qui avait lui-même accédé au pouvoir par les urnes dans le cadre d'un État bourgeois, en s'adressant largement aux « masses » avec un discours petit-bourgeois et en promettant des réformes sociales.
Que le Venezuela soit aligné sur la Chine ou sur les États-Unis, « dictatorial » ou libéral-démocrate, capitaliste d'État ou capitaliste privé, le prolétariat vénézuélien restera exploité et opprimé. Ce n'est que par la création de ses propres organes politiques indépendants, en opposition à l'État bourgeois existant, et par l'écrasement subséquent de ce dernier, que le prolétariat vénézuélien pourra commencer à transformer sa condition. Et ce n'est que par la fraternisation, et la fusion éventuelle, du prolétariat vénézuélien avec le prolétariat des autres pays du monde, à condition que ceux-ci aient également réussi à conquérir le pouvoir politique, que la révolution sociale pourra être menée à un point tel que le capitalisme sera transcendé et qu'un nouveau mode de production émergera : le communisme, dans lequel les États et les classes auront disparu.
Synthezis
Deuxième contribution
Sur l'extorsion au Venezuela
Le deuxième quart du XXIe siècle a commencé comme le précédent s'était terminé : par des guerres, des occupations et des aventures militaires. Trois jours seulement après le Nouvel An, l'enlèvement spectaculaire du président vénézuélien Maduro et de son épouse par les États-Unis – appuyés par des forces aériennes et navales, dont le plus grand porte-avions du monde, un sous-marin nucléaire, des avions espions et 15 000 soldats – en est l'exemple le plus flagrant. Mais la poursuite de la guerre en Ukraine, l'étranglement génocidaire en cours à Gaza et l'expansion de l'occupation israélienne de la Cisjordanie, sans oublier le carnage au Soudan, témoignent d'un système social en proie à une spirale d'autodestruction qui s'aggrave à l'échelle mondiale.
Pourquoi cette capture de Maduro digne d'un film hollywoodien ?
Ce n'était certainement pas, comme l'a affirmé Trump, à cause de Maduro ou de l'implication de son État dans le trafic de drogue, un domaine que les États-Unis connaissent bien. En effet, le président Trump a gracié plus de 100 personnes condamnées pour trafic de stupéfiants depuis son second mandat – la plus récente étant la libération de l'ancien président hondurien Hernández, condamné à 45 ans de prison par un tribunal américain en mars 2025.
Ce n'était pas non plus principalement pour accéder aux réserves pétrolières du Venezuela, considérées comme les plus importantes au monde. Alors que l'État américain, aux allures de mafia, a confirmé qu'il « dirigerait » le pays et « s'enrichirait » grâce aux profits pétroliers qu'il espère en tirer, la demande mondiale de pétrole (et les prix) sont en baisse et même la Chine, qui avait investi des milliards pour sécuriser son approvisionnement, a largement considéré cette situation comme une mauvaise affaire. Non : la principale motivation de cette « mission impossible » – orchestrée au mépris de toutes les règles établies du droit international – était de démontrer une fois de plus la supériorité militaire des États-Unis devant leurs « alliés » et leurs rivaux. Dans un monde où règne la loi du plus fort, l’Amérique a une fois de plus joué les héros de Top Gun.
C’était un avertissement aux alliés des États-Unis : contrairement aux affirmations de Trump, cette situation était incontestée dans l’hémisphère occidental. C’était un signal clair adressé à la clique religieuse au pouvoir en Iran : un changement de régime était la norme. Cela signifiait que Poutine, qui avait rencontré Maduro à Moscou quelques mois auparavant et lui avait réaffirmé son soutien indéfectible, était en réalité impuissant à défendre les pays de son entourage, comme l’avait démontré la chute d’Assad (en Syrie) l’année précédente. Et tandis que certains commentateurs bourgeois estimaient que l’anarchie cautionnée par l’entourage de Trump ne ferait qu’inciter la Chine à imiter de telles manœuvres à l’égard de Taïwan, la puissante machine de guerre américaine déployée dans les Caraïbes a une portée à la fois mondiale et régionale
Pourquoi une telle démonstration de force de la part des États-Unis ?
Après l’effondrement du bloc de l’Est, les États-Unis ont utilisé la première guerre du Golfe non seulement pour menacer leurs ennemis, mais surtout pour maintenir leurs alliés sous leur emprise. Car la disparition de l’Union soviétique et de sa sphère d’influence impliquait un effondrement concomitant de l’alliance occidentale – un processus reconnu et achevé dès le début du second mandat de Trump avec le « divorce atlantique ».
Mais de même que les guerres du Golfe n'ont pas empêché le chaos croissant des relations internationales, la tendance au « chacun pour soi » a été en réalité stimulée par l'intervention américaine, qui a engendré une véritable frénésie belliqueuse suite à ses actions en Irak, en Afghanistan, en Libye et aujourd'hui en Syrie.
La décomposition, phase finale de la décadence du capitalisme, a elle-même une histoire. Aujourd'hui, l'explosion des budgets militaires dans presque tous les pays, à mesure que la guerre ou les préparatifs de guerre se généralisent, et en particulier la montée en puissance de la Chine comme rival économique sérieux, même si sa puissance militaire n'est pas encore égale à celle des États-Unis, menace l'hégémonie américaine. Washington a renfloué le régime de Milei, proche de Trump, en Argentine, avec un plan de sauvetage de 20 milliards de dollars afin de contrebalancer l'influence chinoise dans ce pays. Le Venezuela était un autre pays d'Amérique du Sud dépendant de la générosité de Pékin. Ainsi, la bravade ostentatoire des États-Unis découle en réalité d'un affaiblissement global et historique de leur domination, même dans leur propre « arrière-cour ». Leurs actions créent une instabilité régionale et mondiale accrue, démontrant l'irrationalité totale des guerres impérialistes à notre époque.
L’intervention américaine au Venezuela est bien plus qu’un simple spectacle. Elle marque une escalade des tensions, un nouvel écart par rapport aux normes internationales et un pas de plus vers le chaos. Elle réaffirmera un temps la volonté des États-Unis. Mais elle ne pourra empêcher la décomposition croissante des relations capitalistes, aux conséquences meurtrières pour les populations de la planète. Elle ne fera en réalité qu’accélérer ce processus.
KT 4.1.2026
Vie du CCI:
- Courrier des lecteurs [252]
Conscience et organisation:
Rubrique:
ICConline -février 2026
- 7 lectures
Aux États-Unis aussi, la putréfaction du capitalisme mondial s’accélère
- 33 lectures
Depuis le retour de Trump à la Maison blanche, le chaos mondial qui s’était déjà fortement manifesté accélère de plus belle sa course effrénée : partout la guerre s’enlise et accumule les cadavres, les catastrophes climatiques, l’instabilité, la fragmentation des appareils politique. La violence et la brutalité ne font que redoubler plongeant davantage la planète dans un tourbillon mortifère. L’incurie croissante de la bourgeoisie, dont les mœurs de voyous et de vandales éclaboussent les écrans,[1] souligne à quel point le mode de production capitaliste précipite l’humanité vers sa destruction.
Terreur et désolation aux États-Unis
La situation intérieure de la première puissance mondiale, les États-Unis, est devenue emblématique de cette dynamique macabre qui alimente une véritable tragédie humaine. Dans toutes les grandes villes américaines, des rafles d’une grande sauvagerie se déploient contre les immigrés. Les meurtres de sang-froid par la police se banalisent, comme en atteste les morts de Renée Nicole Good, tuée à bout portant dans sa voiture, ou Alex Pretti, mort lui aussi de la même manière à Minneapolis.[2] Le moindre accent suspect ou la couleur de peau jugée trop basanée sont motifs à une arrestation brutale. Sans mandat, les portes des domiciles d’étrangers présumés illégaux sont forcées. Dans les parcs publics, comme celui du Centre de Los Angeles l’été dernier, très fréquenté par les latinos, la police de l’immigration,[3] en tenue de combat, s’est précipitée vers les tables de pique-nique et les balançoires pour procéder à des arrestations musclées. Il en va de même dans les rues, les hôpitaux, les lieux de cultes… Les enfants sont raflés sans vergogne sur le chemin de l’école, comme ce fut le cas pour le petit Liam, âgé de seulement 5 ans, conduit avec son père dans un centre de détention à 1.500 kilomètres de leur domicile. Une telle politique de terreur, où les immigrés n’osent même plus sortir de chez eux, conduit forcément la population indignée à réagir.
La bourgeoisie exploite la colère qu’elle génère
Face à ces violences et au racisme ambiant décuplé, cultivé par des actions qui répugnent autant qu’elles inquiètent, une grande majorité de la population exprime sa colère, notamment contre les méthodes de l’ICE dont les agents sont régulièrement sifflés, pris à partie, traités de «nazis» ou d’«agent de la Gestapo». Un peu partout, dès le mois de juin, des manifestations se sont organisées et multipliées, étendues, accompagnées de scènes d’émeutes. À Los Angeles, suite aux déclarations provocatrices de Trump, assurant que la Ville était «envahie par des ennemis étrangers», des affrontements violents se sont produits durant plusieurs nuits entre les protestataires et les forces de l’ordre. Une situation qui a amené Trump à déployer 700 Marines basés dans le sud de la Californie, ajoutant à ceux déjà présents 2.000 membres de la Garde nationale.
Partout ailleurs, les manifestations se sont multipliées : à New York, Washington, Boston, San Francisco, Seattle, Chicago, Austin, Dallas… et dernièrement à Minneapolis. Dans cette ville phare du Minnesota, des milliers de manifestants ont bravé le froid pour dénoncer une telle barbarie et les meurtres de deux manifestants, obligeant finalement Trump à faire marche arrière et à retirer ses sbires de l’ICE de la ville.
Pourtant, malgré la massivité des mobilisations, toutes ces manifestations n’ont pas arrêté Trump, n’ont pas fait cesser les exactions de la police de l’immigration. Pourquoi ? Certes, la colère qui a drainé des millions de personnes dans toute l’Amérique est légitime, mais ce n’est pas la classe ouvrière, avec ses armes de combat, qui s’est mobilisée contre la barbarie de la bourgeoisie, c’est la population des citoyens contre une faction de la bourgeoisie, celle de Trump et sa clique. Et c’est très différent ! En effet, les manifestations ont été aussitôt impulsées par de nombreuses composantes du milieu associatif, comme l’American Civil Liberties Union, MoveOn, Greepeace, ou encore par le mouvement syndical, revendiquant une société «plus équitable», prônant la défense des principes d’une «démocratie participative» contre «l’autoritarisme» du trumpisme, sans remettre en cause le moins du monde le système capitaliste. Si Trump et sa milice de l’ICE sont ignobles, ils sont à l’image de tout le capitalisme, de toutes les bourgeoisies ! Faut-il rappeler la politique du Parti démocrate américain, qui pleure aujourd’hui des larmes de crocodiles alors qu’il n’a cessé, sous Biden et Obama, de refouler massivement les migrants et de séparer des enfants hispaniques de leur famille ? Faut-il rappeler les ignobles camps de concentration aux marges de l’Europe, soi-disant paradis des droits de l’homme et du progressisme, et les dizaines de milliers de cadavres qui peuplent les fonds de la Méditerranée et de la Manche ? Tous mènent des politiques parfaitement inhumaines à l’égard des migrants !
En fait, les associations et partis de gauche tentent encore de détourner le prolétariat de son combat de classe, de lui faire croire que c’est en tant que citoyen qu’il faut se battre, que son salut réside dans la défense de la démocratie bourgeoise. Ce mouvement protéiforme présente en cela un grand danger pour la classe ouvrière, déjà contenu dans son nom : «No kings». En effet, son appellation issue de la gauche bourgeoise, a pour origine le slogan des insurgés de la Révolution américaine, un slogan nationaliste qui rejetait en son temps la monarchie anglaise.
Tous ces mouvements n’ont donc rien de prolétarien ni de véritablement spontané et ont été, dès le départ, organisés et instrumentalisés sur un terrain bourgeois. Il n’est donc pas étonnant que ces mouvements aient été soutenus par des personnalités du show-business et par le Parti démocrate, Obama en tête.
Il s’agit donc là d’un véritable piège idéologique, comme ce fût le cas, dans le passé, du mouvement Black Live Matters suite au meurtre ignoble de George Floyd par la police, qui risque d’entraîner la classe ouvrière sur le faux terrain de la bourgeoisie, celui qui l’amène à soutenir une fraction bourgeoise soi-disant plus «progressiste» contre une autre, en défense de la «démocratie» ou d’une «bonne police», ou celui du piège de «l’anti-populisme» ou de «l’antifascisme». Bref, à choisir une faction bourgeoise contre une autre, à se bercer d’illusion sur un capitalisme plus juste. Une telle situation constitue donc un obstacle supplémentaire contre la prise de conscience de la classe ouvrière, un véritable danger pour le maintien de l’autonomie de sa lutte.
Affrontements au sein de la classe dominante
Ce danger est d’autant plus réel que la situation de plus en plus chaotique aux États-Unis est marquée par des affrontements croissants et brutaux au sein de la classe dominante, dont les diverses fractions putréfiées n’expriment autre chose que l’impasse d’un système capitaliste agonisant.
Ceci se manifeste d’une part sur le plan des options impérialistes, telles les avances de Trump envers la Russie, qui ont provoqué l’indignation de factions importantes, y compris au sein du parti Républicain et des forces armées, mais aussi la multiplication des interventions armées dans le monde qui déplaisent à certaines factions MAGA. Il en va de même en ce qui concerne sa politique économique et climatique déstabilisante, ouvertement contestée lors du forum de Davos par le discours du gouverneur démocrate de la Californie Gary Newsom. Par ailleurs, Trump n’hésite pas à favoriser de manière éhontée son clan et les factions qui le soutiennent tout en limogeant et poursuivant en justice ses adversaires, accentuant les divisions entre factions, y compris au sein de son propre camp (telles les critiques de la «Trumpiste historique» Marjorie Taylor Greene ou de l’influenceur pro-Trump Joe Rogan qui compare ICE à la Gestapo), renforçant ainsi la spirale d’imprévisibilité et de chaos.[4]
Cette situation produit une atmosphère particulièrement délétère, dans un pays fragmenté et de plus en plus clivé. Tout cela ne peut qu’avoir des répercussions négatives en Amérique-même et laisse entrevoir de plus grandes fractures encore avec la perspective de confrontations plus ouvertes, où le précédent assaut du Capitole par les hordes MAGA pourrait faire pâle figure à côté des menaces contenues et des rivalités croissantes qui risquent d’enflammer les diverses fractions de la bourgeoisie américaine.
C’est vers ces affrontements mortifères sans fin et de plus en plus violents que la bourgeoisie cherche à mobiliser la population !
Face à la barbarie, quelle perspective pour la classe ouvrière ?
Cela signifie-t-il qu’il n’y ait pour autant rien à faire pour la classe ouvrière ? Bien sûr que non ! Elle aussi est révulsée par le sort des migrants. Et la classe ouvrière, «native» ou «immigrée», subit comme partout une détérioration croissante de ses conditions de vie. Aux États-Unis, on parle ouvertement de la «crise du coût de la vie» («affordability») avec 66 % de la population ayant des difficultés à joindre les deux bouts. Comme ailleurs, la crise de surproduction mondiale, aggravée par la pression des dépenses militaires et l’inflation, engendre une misère qui se propage de plus en plus rapidement et touche les autochtones comme les immigrés. D’autant plus que partout la bourgeoisie demande davantage de sacrifices pour acheter ses armes et répandre la mort partout sur la planète !
En réalité, le prolétariat n’est pas encore en mesure d’arrêter les guerres ou de freiner le chaos actuel. Il lui faudra développer sa conscience politique pour être capable de réellement rejeter pleinement les pièges que lui tend la bourgeoisie, pour retourner contre celle-ci son indignation face aux cruautés infligées aux migrants. Mais il est la seule force capable, à terme, de donner une orientation alternative à la société, Et ce, d’abord à condition de résister à la crise par la lutte de manière solidaire.
Pour l’instant, il ne doit pas céder, ni s’engager derrière les pièges idéologiques qui lui sont tendus. Il doit au contraire mener une réflexion en profondeur sur la véritable manière d’être solidaire avec les migrants et plus largement avec tous ses frères de classe. Et, aujourd’hui, seule une réponse sur le terrain de la défense commune des intérêts ouvriers, sur le terrain de la défense des conditions de vie et des salaires peut apporter un début de réponse.
Ce début de réponse, on le trouve bien évidemment dans les luttes que le prolétariat a commencé à engager au niveau international depuis 2022, suite aux grèves et manifestations massives en Grande-Bretagne, en France et aux Etats-Unis même, pour dire «ça suffit !». Mais tout aussi significatives sont les luttes récentes aux États-Unis qui se déroulent dans des conditions particulièrement défavorables et que la classe dominante cherche à masquer et à torpiller. Au cours de ces mêmes mois où les médias nous ont inondés des fanfaronnades de Trump dans l’Air Force One, une lutte importante était en effet en cours parmi les 15.000 infirmières des hôpitaux de l’État de New York. Une lutte qui a duré plus de quatre semaines.
Alors que les mouvements engagés sur un terrain bourgeois n’ont d’autre perspective que les risques d’affrontements stériles et destructeurs entre factions bourgeoises toutes aussi barbares les unes que les autres, les luttes des infirmières représentent un pas singulier vers le futur. Cette lutte, parce qu’elle est potentiellement celle dans laquelle tous les prolétaires, immigrés et natifs, peuvent se reconnaître, contient une dimension universelle. Cette petite flamme ne demande qu’à nourrir un feu bien plus vaste, celui d’une lutte internationale, capable, à terme, de se politiser au point d’affirmer la perspective communiste. Une lutte qui permettra de poser les conditions nécessaires en vue d’abattre le capitalisme et proposer un autre monde sans classe ni exploitation.
WH, 16 février 2026
[1]Dont l’affaire Epstein n’est que le dessus de l’iceberg.
[2]Et ce ne sont pas les seuls cas : Keith Porter, par exemple, père de deux enfants, a été tué le soir du Nouvel an par un agent de l’ICE devant son immeuble à Los Angeles.
[3]Le tristement célèbre Service de l’immigration et des douanes des États-Unis ou ICE.
[4]Cf. «Venezuela, Groenland… Derrière les coups de force, les États-Unis exacerbent le chaos capitaliste !», Révolution internationale n° 506.
Géographique:
- Etats-Unis [184]
Conscience et organisation:
Personnages:
- Renée Nicole Good [1071]
- Alex Pretti [1072]
- Donald Trump [896]
- Joe Biden [914]
- Barack Obama [955]
- Gary Newsom [1073]
- Marjorie Taylor Greene [1074]
- Joe Rogan [1075]
Questions théoriques:
- Décomposition [517]
Rubrique:
ICConline - mars 2026
- 3 lectures
ICConline - avril 2026
- 1 lecture
Rubrique:
ICConline - mai 2026
- 1 lecture
Rubrique:
ICConline - juin 2026
- 3 lectures